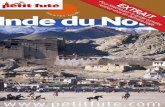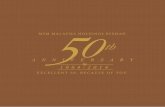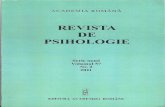La lutte contre le VIH/sida comme espace de redéfinitions identitaires pour les minorités...
-
Upload
bibliotheque-diderot -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La lutte contre le VIH/sida comme espace de redéfinitions identitaires pour les minorités...
1
NEFF MAÏA
Politiques de lutte contre le VIH & identités
La lut t e contre l e VIH/sida comme espace de r edé f in i t ions ident i ta ir es pour l e s minor i t é s s exue l l e s MSM à Delhi (Inde) :
- Retours sur une expérience et des données de terrain –
Communication dans le cadre du 12ème séminaire Jeunes Chercheurs de l’AJEI, au Centre d’études et de relations internationales (CERI, Salle Jean Monnet), avec le soutien du CEIAS (EHESS-CNRS) et de l’École doctorale de Sciences Po / 1ère année de master. Discutant : Patrice Pinell (Directeur de recherche INSERM, Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne CESSP Paris 1, 8209 CNRS - EHESS) Résumé Ce travail présente une partie des résultats d’une enquête ethnographique de plus de quatre mois menée au sein d’une organisation non gouvernementale (ONG) et de deux community based organization (CBO) de lutte contre le VIH/sida. L’analyse de documents institutionnels comme ceux de la National AIDS Control Office (NACO) a constitué une autre approche méthodologique. L’objet de cette recherche est d’interroger une partie des effets de la lutte contre le VIH/sida sur la construction identitaires des minorités sexuelles « Men who have sex with Men » (MSM). En effet, phénomène pourtant ancien, la visibilité et la construction d’un groupe social nommé MSM est assez récente et coïncide avec la mise sur agenda politique de la maladie du sida comme enjeu de santé publique. En cette période de pandémie, il s’agit avant tout de définir des catégories viables d’après des comportements et des espaces spécifiques et ce, afin de lutter contre la propagation de la maladie. Longtemps confinés aux frontières de l’épidémiologie, un ensemble d’acteurs de lutte contre le sida (institutionnels, militants, associatifs etc.) participent alors à localiser et à façonner des comportements traditionnels existants au sein d’identités sexuelles politisées. Cependant, dans un contexte légal répressif jusqu’aux années 2009, ce processus de visibilisation ne concerne pas tous les individus dits « MSM » de la même manière. Les Men who have Sew with Men, construction identitaire très hétérogène, représentent de multiples réalités d’un point de vue social, économique, ethnique, culturel et, de genre. La notion de groupe MSM est donc à relativiser et aussi à comprendre en fonction d’enjeux politiques. Cette identité est avant tout dynamique, au sein d’un environnement multiforme. Les mobilisations identitaires par les individus et les possibilités de réitération d’identités allo ou auto définies sont en effet sans cesse renégociées en fonction du contexte et des contraintes dans lesquels ils évoluent. Mots- clefs : ethnographie, identités, minorités sexuelles, politisation, VIH/sida, Inde.
2
Introduction
Les Men who have sex with men : que lques premiers é l éments de dé f in i t ions d ’un terme po lysémique
La colonisation britannique institue dans le code pénal indien la section 377 qui détermine comme «contraires à l’ordre naturel » un ensemble de pratiques sexuelles. Le 2 juillet 2009, la Haute Cour de Delhi donne raison à la longue mobilisation du collectif « Voices Against 377 » en revenant sur ce cadre juridique et en décriminalisant les rapports sexuels entre adultes de même sexe. Parmi ces adultes, un groupe social plus particulier est en effet désigné pendant plusieurs décennies comme ayant des pratiques sexuelles illégitimes et illégales. Ce sont les Men who have Sex with Men (MSM), soit, de façon très schématique, des individus nés biologiquement hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. Terme-parapluie, il désigne un ensemble de minorités sexuelles telles que les Hijras/Kinnars1, les Shemales2, les Kothis3et, les gays. Ces MSM se définissent en partie par rapport à des types d’attitudes et représentations, de comportements, de rapports au corps, de préférences et des pratiques sexuelles et sociales qui sont construits comme spécifique à un groupe, celui des MSM. L’analyse croisée des définitions que donnent les enquêtés allo- labellisés MSM, des institutions de santé publique et des travaux universitaires au cours d’une enquête ethnographique de plus de 6 mois nous ont permis d’identifier quelques composantes identitaires plus précises de cette appellation. Bien qu’une partie des MSM mobilise un vocabulaire inspiré pour une partie des MSM par les mouvements de défense des minorités sexuelles nord-américain et européen (utilisation de termes récurrents tels que transgenre, eunuque, transsexuels, travestis et gays), il a été jugé plus pertinent au cours de cette recherche de se référer aux termes indiens cités ci-dessus. En effet, malgré son inscription dans des dynamiques mondialisées, la construction identitaire des minorités sexuelles MSM, du genre et du sexe en Inde comporte quelques particularités à appréhender par le prisme d’une approche historique et culturelle.
Le genre en quest ion
En Inde, un ensemble de textes historiographiques recensent et décrivent un éventail d’identités sexuelles et de pratiques sexuelles entre personnes de même sexe de la période classique jusqu’à la colonisation [Vanita et Kidwai, 2000]. Ces identités ne font pas référence à une simple dichotomie d’identité sexuelle hétérosexuelle où homosexuelle mais sont considérées comme faisant partie des « mastis », c’est à dire des jeux sexuels entre hommes. Des actes sexuels comme les mastis ne définissent donc pas nécessairement une identité sexuelle précise et revendiquée, pas plus qu’une orientation sexuelle. Comprendre les logiques identitaires de ce groupe ne peut donc se faire sans questionner les notions de sexualité, de genre, de construction sociale des masculinités et féminités qui sont mobilisés. Terme parfois polysémique, le genre est appréhendé dans cette recherche d’après l’approche de J. Butler, à savoir comme le résultat de la « réitération de comportements et d’actes de langage ayant une valeur performative » [Broqua, 2009]. Le genre, système intériorisé ou l’individu
1 Les Hijras sont traditionnellement considérés en Inde comme le troisième genre , c’est-à-dire, des individus asexués et inter-sexes qui vivraient en communauté. Historiquement, des rôles et des occupations précises leurs sont attribués (bénédiction de nouveau-nés et des mariés etc.). Actuellement, la plupart sont cependant des hommes biologiques qui se sont fait émasculés au moment de rejoindre la communauté Hijras. 2 Les Shemales sont des hommes biologiques qui changent de sexe. Une partie des individus sont émasculés ou suivent des traitements hormonaux. 3 Les Kothis sont des hommes biologiques qui ont le sentiment de ne pas appartenir à l’identité sexuelle assigné à leurs naissances. Ils ne sont pas émasculés et certains suivent des traitements hormonaux. Ils adoptent des comportements, des rôles, des pratiques (sexuelles, vestimentaires etc.) dites féminines d’après les standards indiens.
3
adopte des normes comportementales conséquentes à son sexe biologique devient alors « sexe social » [Delphy, 2002]. Un « rôle de genre » est donc tout ce que la personne dit ou fait pour indiquer aux autres ou à elle-même son degré de « genre » masculin, féminin ou androgyne d’après l’environnement et les normes culturelles de la société dans laquelle elle évolue [Nanda, 2010]. La définition du genre est donc dynamique et contextuelle.
« Risque sani ta ire » e t émergence des thèmes autour de la sexual i t é
Pratiques ancrées historiquement, la politisation de ces dites minorités sexuelles ne se fait que progressivement dans un contexte répressif et fortement contraint (cf. Section 377 mention ci-dessus). Comment sont-elles rendues plus visibles sur la sphère publique en Inde ? Les dynamiques discursives les reconnaissant officiellement et délimitant des identités sexuelles spécifiques sont assez récentes et en lien, dans un premier temps, avec des enjeux de santé publique. En effet, l’apparition du virus du VIH et la gestion de ce nouveau risque sanitaire favorisent parallèlement l’émergence de thématiques liées à la sexualité et au genre, notamment dans les pays du Sud [Broqua, Eboko, 2009]. En Inde, la mise sur agenda politique de la maladie comme enjeu de santé publique au début des années 1990 s’accompagne d’une publicisation de minorités sexuelles. La National AIDS Control Office (NACO) créée en 1992 par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la maladie détermine ainsi des risques endémiques spécifiques selon des groupes d’individus, définis notamment en fonction de leurs pratiques sexuelles. Un grand nombre d’ONG se développe afin de participer à la lutte contre la pandémie. Au sein de ces collectifs, l’ONG NAZ Foundation joue un rôle important. Historiquement, il s’agit de la première organisation de santé publique de lutte contre le VIH à Delhi qui propose l’implantation de programmes de prévention du VIH/SIDA à destination des minorités sexuelles « Men who have Sex with Men » (MSM). Créée en 1991 à Londres par Shivananda Khan et initialement à destination de la diaspora gay et lesbienne d’Asie du Sud, cette organisation ouvre finalement une antenne à Delhi en 1994. Face à l’ampleur de l’épidémie du VIH, des questionnements concernant des pratiques sexuelles théoriquement illégales et taboues entre hommes vont donc être suscités et générer des réponses publiques. Ainsi, la notion de « Men who have Sex with Men» se développe et se vulgarise dans un premier temps au sein d’organismes de lutte contre le sida, tel que l’ONG la NAZ ou la NACO. Le terme MSM est progressivement utilisé et politisé par un grand nombre d’acteurs institutionnels, associatifs, universitaires et même dans les médias pour désigner en Inde des hommes biologiques ayant une sexualité dirigée essentiellement vers d’autres hommes. Un vaste panel d’identités, assignées ou non, multidimensionnelles, dynamiques et contextuelles sont ainsi regroupés sous cette étiquette. Par l’intermédiaire de politiques de lutte contre la pandémie et de rhétoriques institutionnelles concentrant les définitions officielles, mais aussi par celles des associations, des militants ou universitaires, des minorités sexuelles jugées plus ou moins à risques sont conceptualisées.
Au delà de ces dynamiques sémantiques, en quoi la gouvernance de la lutte contre le VIH façonne-t-elle des espaces sociaux de redéfinitions identitaires pour les minorités Men who have Sex with Men à Delhi ?
Pour questionner ce sujet, il semble pertinent de construire une approche autour de la notion « d’espace »4 [Bereni, 2013]. En effet, il s’agit d’observer les différents mécanismes de « l’espace de la 4 BERENI Laure, Penser la transversalité des mobilisations féministes : l’espace de la cause des femmes, 2012. « L’espace de la cause SIDA » fait référence à « l’espace de la cause des femmes », c’est-à-dire, à une certaine « configuration des sites de mobilisation pour la cause des femmes dans une pluralité de sphères sociales » [Bereni, 2012]. Ce terme permet d’inclure une grande variété d’acteurs (institutionnels, organisationnels, universitaires, politiques etc.) qui « gravitent » autour de la « cause des femmes » et qui ont des représentations sociales diverses.
4
cause du VIH/SIDA » qui s’articule autour de la question des transidentités à Delhi. L’« espace de la cause SIDA » est délimité ici par une partie du travail de prévention et des dynamiques discursives de la NACO, de l’ONG la NAZ Fondation et de deux autres « Community-Based Organization » (la Kinnar Bharati et la DART), ainsi que d’un panel d’activistes autour de la cause MSM, et d’individus auto-définis et allo-définis MSM. Le concept « d’espace » permet ainsi d’inclure à l’analyse un ensemble d’acteurs hétérogènes : des militants, des individus en dehors du « mouvement », des organisations (ONG, CBO), des institutions (NACO), le champ universitaire etc., avec des représentations du réel différentes. Il permet surtout de souligner la pluralité des sphères sociales qui se rencontrent et gravitent autour de la cause sida et en quoi elles modifient les frontières symboliques de l’identité des « MSM » et la « morphologie de l’espace de la cause » [Bereni, 2007].
Eléments méthodolog iques de la re cherche :
Un travail d’observation participante de plus de quatre mois au sein de l’ONG NAZ Fondation (plus spécifiquement au sein du programme MSM, le « Milan Project ») et de deux « Community-Based Organization » (la DART et la Kinnar Bharati) permet d’appréhender ce questionnement. Les trois organismes sont tous des structures de santé publique de lutte contre le sida, sans pour autant avoir les mêmes marges de manœuvres5. L’échantillon des enquêtés se compose d’individus de 19 à 40 ans, auto ou allo –labellisé MSM. Bien que l’on retrouve parfois les mêmes individus d’une organisation à l’autre, les publics ne sont pas toujours similaires. Si elle s’adresse officiellement à l’ensemble des MSM, la DART par exemple à un public principallement Kothi, Hijra et Shemale. La Kinnar Bharati quant à elle cible initialement les Hijras. Comme les dirigeants de ces structures il s’agit de publics maîtrisant mal l’anglais. A l’inverse, l’ONG Naz Foundation correspond à un public se présentant voir se revendiquant comme «gay» et, maîtrisant l’anglais. Les entretiens effectués, semi-directifs, se sont donc déroulés en anglais et en hindi. Plusieurs entretiens formels ont été réalisés avec des personnes travaillant au sein de ces organisations, personnes pour la plupart se déclarant comme non-atteintes par le virus du sida/VIH. En dehors des entretiens formels semi-directifs menés (une quinzaine), ce travail repose principalement sur plusieurs mois d’observation, d’observation participante, sur des temps d’échanges et d’entretiens informel. La participation à des événements dits « Queer » à Delhi : projections de films, débats, spectacles, réunions, festivités etc. a aussi été privilégiée.
Ainsi, principalement par la collecte des données issues des observations quotidiennes sur ces différents terrains, nous verrons dans un premier temps que la lutte contre le sida a fortement participé à définir et catégoriser des individus. D’après un ensemble de comportements et de pratiques, une identité de genre et une sexualité particulière sont attribuées à un groupe, participant ainsi à la production d’une identité sexuelle MSM délimitée par des enjeux de santé publique. Nous verrons dans un second temps, comment ces enjeux ont permis parallèlement de politiser et de créer dans une certaine mesure un «mouvement», mouvement très hétérogène. On assiste alors à des processus de « déconfinement » [Carricaburu, 2007] des thématiques MSM, LGBTQ par rapport à celle du problème de santé du SIDA.
5 Ce que nous verrons ultérieurement.
5
I) La définition de minorités sexuelles Men who have Sex with Men
Le processus par lequel des identités ont été définies s’est mis en place dans un contexte spécifique et à une période où le VIH/sida est devenu un enjeu de santé publique en Inde (fin des années 1980, années 1990) et, plus généralement, à une échelle mondialisée.
a) Effets de la mise à l’agenda du VIH/sida comme enjeu de santé publique
Sous l’impulsion d’un mouvement transnational dans les années 1990, la question du sida devient centrale au sein de politiques publiques sanitaires occidentales et d’organismes internationaux (Nations-Unis, Banque Mondiale etc.). Un grand nombre d’institutions de développement et d’agences internationales de lutte contre le sida sont créées. En effet, au moment de la libéralisation économique de l’Inde (1991), un grand nombre d’ONG internationales vont venir travailler en Inde (Mc Arthur Fondation, HIVOS, Bill et Melina Gates Fondations, International HIV/AIDS Alliance etc.). La mise sur agenda des questions liées au sida en Inde peut en partie être comprise par l’influence de ces acteurs-donneurs internationaux. Le gouvernement indien accepte également un prêt de la Banque Mondiale pour la prévention et le contrôle du sida en Inde. De 1990 à 2005, les fonds internationaux pour le VIH/sida en Inde sont passés de 19 à 608 millions de dollars [Kole, 2007].
A cet égard, la National AIDS Control Organization (NACO), organisme étatique chargé de lutter contre la pandémie a été créée en 1992 en Inde, six ans après la détection du premier cas indien. Elle centralise la plupart des fonds nationaux et internationaux. Les ONG chargées de mettre en œuvre sur le terrain les politiques de prévention reçoivent une partie de ce budget. De 1999 à 2005, 313,9 millions de dollars (financements internationaux) ont ainsi été mis à la disposition de la NACO et 62 millions de dollars ont été destinés à d’autres organismes indiens [Kole, 2007]. Un ensemble d’experts se professionnalise sur ces questions et défini des objectifs. Afin de procéder à ce travail, la NACO s’appuie sur un vaste panel d’acteurs associatifs. Par l’intermédiaire d’agences chargée de la gestion d’organisations locales (exemple, les Community-Based Organization telles la DART et la Kinnar Bharti), elle apporte un soutien financier ou matériel et, décentralise ainsi son action. On estime, pour la seule année 2005 à 1970 le nombre d’ONG dans le secteur sida en Inde, devenu enjeu de santé publique [Kole, 2007]. La façon de traiter l’épidémie se centre alors sur des groupes plus particulièrement ciblés, notamment les dites minorités sexuelles.
b) La constitution d’une identité sexuelle MSM
D’après un ensemble de documents officiels dont ceux de la NACO, il est établi que la propagation du SIDA se fait essentiellement par voie sexuelle. Cela représente 87% des cas de la propagation de la maladie [NACO III, 2010]. Des individus sont alors définis comme particulièrement vulnérables face à la maladie de par leurs comportements sexuels spécifiques : ce sont les « Men who have Sex with Men ».
Les politiques de prévention menées par différents acteurs distinguent officiellement ce « groupe » afin d’avoir des dispositifs de luttes contre la maladie en fonction de besoins distinctifs. D’un ensemble de rapports au corps, de comportements sexuels - le fait d’avoir des rapports sexuels entre hommes biologiques - s’est progressivement dessiné un groupe, et même une identité sexuelle : celle de MSM avec ses caractéristiques face au sida. Ce travail de labellisation est alors censé accroître l’efficacité des programmes de lutte contre la pandémie en ciblant dans les dispositifs de prévention des « catégories viables » [Cohen, 2005], c’est-à-dire des groupes d’individus définis de façon
6
intelligible et qui puissent ainsi être facilement identifiables. Originellement, la notion de « Men Who have Sex with Men » serait donc apparue et aurait été vulgarisée en premier lieu par l’intermédiaire d’organisations de lutte contre le sida. Une ONG telle que « Shahodaran » (basée à Chennai) et deux de ses activistes, Shavananda Khan et Sunil Menon, ont contribué à sa popularisation [Cohen, 2005]. De plus, une branche du militantisme des minorités sexuelles indienne redéfinit sémantiquement certains termes inspirés de pays occidentaux tels que LGBT, jugés inadéquats pour décrire le contexte indien [Cohen, 2005]. Progressivement ont donc été élaborées des socles de références en fonction de ce qui était considéré comme étant le plus adapté pour décrire des pratiques et des identités dans le cadre de la société indienne. Ces socles référentiels sont véhiculés en grande partie au sein des organisations de lutte contre le sida. En effet, d’après les entretiens réalisés avec les publics fréquentant des organisations telles la NAZ, la DART ou la Kinnar Bharati, ces dernières sont les vecteurs principaux de la construction de leurs identités sexuelles. Elles procèdent ainsi à des « opérations de cadrage »6 [Benford, Snow, 2000]. La NAZ plus particulièrement semble avoir joué un rôle déterminant. Une partie des individus, dont ceux qui ne fréquentent plus la NAZ aujourd’hui, citent cette dernière comme l’organisation leurs ayant permis de se reconnaître dans des définitions identitaires qui faisaient sens par rapport à leurs expériences individuelles. C’est ce qu’exprime Sami, étudiant sikh au Jammu de 21 ans, s’auto-identifiant comme MSM (gay) et fréquentant la NAZ Fondation depuis deux ans: “Ils ont fait tellement pour nous. Tellement. Ils m’ont dit exactement ce que je suis. Ils m’ont aidé. Ils t’aident à te contruire. NAZ a répondu à la question que je me posais : “Qui suis-je” »7. C’est aussi ce qu’explique Popy, hindou originaire d’un village du Bengal, s’auto-identifiant comme MSM (Kothi), en procédure de divorce et travaillant depuis 7 ans à la NAZ en tant que « personnel de maintenance » (cuisine, ménage) : « [...] On a obtenu un travail ici (ndrl : au Milan Project de la NAZ). Puis, on a suivi les formations où l’on nous a parlé de notre sexe et de qui on attirait [...] il y a des sessions de formations qui aident à obtenir les définitions exactes : « gay », « hétérosexuel », qui catégorisent en « homme », « femme » etc. en fonction de ton comportement, tes goûts, tes habitudes etc. [...] j’ai donc compris à quelle catégorie j’appartenais »8. Les associations proposent un discours, une typologie d’identités collectives dans laquelle les individus peuvent se reconnaître, intérioriser ces notions et les revendiquer.
Au sein de cette typologie, on observe des sous-catégories de genre plus précises telles que Kothis, Hijras, Shemales, Gays, Panthis. La synthèse des discours des enquêtés permet de considérer globalement que, les Kothis seraient, des hommes biologiques dotés d’une « âme féminine ». Ils adopteraient alors des « manières efféminées » (rapport au corps, gestuelles, langages, conduites, pratiques sexuelles, psychique) qui correspondraient à la représentation sociale dominante de ce qu’est une femme en Inde. Les partenaires des Kothis sont désignés par le terme de Panthis et ont quant à eux, toujours d’après les standards indiens, des caractéristiques dites masculines. Au sein des politiques de prévention, les Panthis sont considérés comme ayant des relations homosexuelles (avec des Kothis) mais aussi hétérosexuelles (avec des femmes). Le concept de Kothi/Panthi serait plus particulièrement apparu en lien direct avec la gestion du sida [Cohen, 2005]. Il permet ainsi de désigner une catégorie d’individus, les Panthis, relais du virus entre des MSM et le reste de la population puisqu’ils ont des relations sexuelles à la fois avec les hommes et les femmes.
6 La notion de « cadrage » ici permet d’analyser le poids des organisations, leurs dynamiques discursives et ainsi leur « travail de construction de sens » au sein d’un mouvement social. Elles participent à une « politique de la signification »[Benford et Snow, 2000]. C’est-à-dire qu’elles donnent une trame d’interprétation de la réalité qui remet en cause celles déjà existantes. 7 “They did so much for us. So much. They told me exactly what I am. They helped me. They help to construct yourself. NAZ answered to the question I was wondering myself: «who I am »” 8 « [...] we got a job here (ndrl: in the Milan Project at NAZ). Then we attended the training here, where we told about our sex and who we attracted to [...] there is some training sessions which help to get exacts definitions: “gay, straight” which categorize as “male, female” etc. according to your behavior, your tastes, habits etc.[...] Then I understood to which category I belong to”.
7
Les Hijras, figures traditionnelles d’ascètes en Inde suivent officiellement une culture qui leurs est propre. Les enquêtés Hijras revendiquent des rôles et des fonctions bien précises qui sont par ailleurs leurs source de revenus (par exemple : bénédiction des nouveau-nées et de jeunes mariés). Dans la pratique, la plupart des enquêtés rencontrés travaillent dans une Community Based Organization, mendient ou, se prostituent. Pour cette raison, un ensemble de programme de lutte contre le sida visent la communauté Hijra. Initialement regroupées sous le label « MSM », les Hijras et les Shemales deviennent progressivement au sein des politiques de prévention une catégorie à part : celle des Transgenre. Enfin, une dernière sous- catégorie intègre celle de MSM, celle des Gays. Une distinction s’opère alors qui est celle de « gay non efféminés » afin de se démarquer des autres MSM dits efféminés tels que les Kothis. Les enquêtés auto-définis Gays se réclament d’une identité distincte, qui se serait structurée à la fin des années 1980. Ils sont les plus visibles sur l’espace publique et mobilisent pour majorité des références et un vocabulaire influencés par un mouvement LGBT occidental [Kole, 2007].
L’identité sexuelle d’une partie des minorités sexuelles est donc plus particulièrement définie par ces organisations puis, pour partie intériorisée par les « Men who have Sex with Men ». S’ajoute à celle-ci et ce, toujours dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida, une autre composante qui leur ai attribué: celle de « groupe à risque ».
c) Une catégorie identitaire au sein de « groupes à risques »
Au sein de la NACO est progressivement établi un ensemble de typologies en ciblant des groupes précis à atteindre avec des moyens d’actions et des besoins différents. D’après les premiers dossiers d’interventions proposées par l’agence gouvernementale, il semble ainsi souvent communément admis au sein de différents espaces sociaux en Inde, que, le VIH/sida est une épidémie qui aurait pour épicentre les «groupes à risque» et, s’étendrait graduellement à la population générale. Ces groupes à risques sont composés de personnes se prostituant, d’utilisateurs de drogues par voie intraveineuses et de Men who have Sex with Men. Un ensemble de données éditées par la NACO et diverses études épidémiologiques en Inde porte alors leur attention sur des comparaisons de taux de prévalence entre la société segmentée entre : « groupe à risque », « population générale » et « population relais ». Ainsi, les groupes à risque auraient un taux de prévalence du VIH jusqu’à vingt fois plus élevés que la population générale [Rapport de la NACO, janvier 2011]. Au sein des groupes à risques, les MSM figurent donc comme particulièrement susceptibles d’être contaminés par le VIH et de le transmettre à la population générale. Ces conséquences seraient dû à la pratique de relations sexuelles anales et, à un nombre de partenaires élevés, notamment avec des individus issus des populations-relais (à savoir les migrants, les conducteurs de camions, les individus ne s’auto-identifiant pas MSM mais ayant des rapports sexuels avec des individus identifiés MSM par exemple)9. Une partie de ce concept de propagation de la maladie via l’épicentre groupe à risque est aussi intériorisé par une partie des membres d’organisations MSM. Ainsi, ces dynamiques discursives associent l’identité MSM à des comportements à risque, à une vulnérabilité particulière face à la maladie du sida. A l’inverse, l’enquête de terrain montre aussi que certains considèrent que les MSM sont les plus informés sur un sujet en partie tabou qu’est la sexualité en Inde et donc, les plus prudents face au VIH. Une partie des minorités sexuelles masculine en Inde sont donc initialement redéfinit par cet aspect épidémiologique nouveau. A ces aspects discursifs et sémantiques, des stratégies d’endiguement et de préventions spécifiques se développent.
9 Voir schéma illustratif réalisé par un membre de la Kinnar Bharati, en annexe 1.
8
A la mise en place de la phase II de la NACO se succèdent de véritables opérations ciblées et de terrain afin de développer la prévention chez ces groupes. Pour ce faire, la NACO peut s’appuyer en partie sur des ONG, ou plus particulièrement sur les Community-Based Organisation dont les membres doivent nécessairement faire partie de la « communauté » MSM ciblées. Les CBO qui sont basés sur des modèles structurels similaires (organisations internes, ressources, espace médical) sont ainsi des partenaires organisationnels qui assurent un relais entre les dispositions gouvernementales définies par la NACO et l’implantation des programmes au niveau local. Les MSM qui font partie d’une CBO ou d’une ONG sont alors considérés comme des relais, interfaces des messages de prévention entre des acteurs étatiques au sein d’agences (exemple, la NACO) et, ceux des communautés. Bien qu’il ait été difficile d’obtenir des informations au sujet de la nature des liens entre les CBO, les ONG et l’Etat, la plupart des CBO reçoivent plus ou moins un soutien financier, matériel ou technique de la part d’institutions nationales- essentiellement de la NACO ou d’ONG. C’est un système qui semble parfois assez opaque. Par exemple, le comptable de la Kinnar Bharati explique que les fonds de la CBO proviennent de l’ONG Alliance. Celle-ci recevrait elle-même ses fonds de la NACO et serait alors chargée de les distribuer à un réseau de CBO afin de coordonner et de renforcer les actions locales, et, de soutenir les efforts de la NACO. Cependant, il apparaît que les subventions de l’ONG Alliance soient essentiellement issues de donations internationales10. Le directeur de la CBO DART explique quant à lui que ses fonds viennent de l’Etat (NACO), ce pourquoi il recevait assez peu de subventions comparé à une ONG comme la NAZ (fonds internationaux).
Des interventions ciblées sont réalisés par des membres de la communauté qui travaillent pour des CBO et ce, afin d’implanter des projets sur le terrain et de fournir des informations sur les maladies sexuellement transmissibles. Ceux qui élaborent ces interventions et leurs lieux d’action sont appelés les « Groupes de Ressources Techniques ». Ils sont considérés comme des groupes d’experts. Les acteurs de terrain sont appelés dans les organisations « outreach worker » ou « peer educator » et doivent avoir des compétences particulières de par leurs appartenances à la communauté MSM. Les enquêtés insistent sur la nécessité de faire partie de la communauté afin de mener des missions de terrain à destination d’autres MSM. Cela permet ainsi d’établir des rapports de confiance et de pouvoir constituer des réseaux d’interlocuteurs privilégiés. Ces derniers sont alors la source de connaissances profanes dans un projet global d’endiguement de la pandémie. Des organisations comme la Kinnar Bharati sont centrées essentiellement sur ce travail de prévention entre groupe de pairs. Les personnes infectées par le sida peuvent aussi recevoir un traitement anti-rétroviral et des consultations médicales mais l’essentiel du projet est concerne la prévention de la maladie. A ce titre, la technique plus particulière du « mapping » est utilisée. La prévention à Delhi se fait selon certains espaces délimités. C’est-à-dire, des zones d’interventions prioritaires de prévention en fonction du nombre de MSM qui fréquentent ces lieux sont définies. Un vocabulaire de gestion de l’épidémie précis est alors utilisé : « encerclement des communautés les plus à risques », « package d’interventions pour les groupes à haut risques », «estimation du site», «interventions ciblées», «concentration de groupes à risque», « hotspot » etc.
En pratique, la façon dont les différents acteurs appréhendent leurs missions est très variée. La manière dont ils sont formés laisse une part importante à l’interprétation des situations. Les « outreach worker » et « peer educator » sont soumis à des prérequis quantitatifs mais pas qualitatifs. Une de leurs missions essentielles à l’extérieur des locaux est de recenser le plus de MSM possibles et d’informer les individus de l’existence des organisations (collage d’auto-collants dans les toilettes, les arrêts de 10 Cf : http://www.allianceindia.org/donors/donors.php
9
bus et les parcs fréquentés par des MSM et, distributions de prospectus). Un individu est recensé par le biais d’un questionnaire rempli par les « peer educator » ou « outreach-worker ». Il est ensuite censé se rendre dans l’organisation se faire enregistrés par la CBO qui devient son organisme de référence. Un même individu ne peut pas se faire enregistrer dans plusieurs organisations, ce que m’explique Bishamber, « outreach-worker » depuis quelques mois à la DART : « Une fois qu’on nous a donné une zone particulière et que l’on a enregistré une personne, nous seul pouvons lui procurer des services. Les autres ONG ne peuvent pas l’enregistrer. Ils [ndrl : les MSM enregistrés] peuvent aller « traîner » dans d’autres ONG, rencontrer des gens [...] Pas d’exemplaire en double [...] l’enregistrement se fait seulement par une ONG. On doit les enregistrer les premiers »11 . D’après la NACO, un « peer educator » doit maintenir le contact avec 60 « Men who have Sex with Men » ou transgenre. Un système de prévention dont les objectifs à respecter, notamment quantitatifs sont très précisément décrits. Officiellement, tout une stratégie est mise en place pour que les MSM, caractérisé comme «groupe à risque soient identifiés, informées et ne puissent pas contracter mais surtout diffuser la maladie.
Cette labellisation qui est faite d’un « groupe MSM » peut avoir des conséquences importantes. En effet, au sein des discours de politiques de prévention peut être véhiculée l’idée que les « High Risk Groups » sont susceptibles de mettre « la communauté » générale en danger. Cela renforce alors le présupposé selon lequel les « MSM » sont des individus marginaux, déviants, déracinés de leurs communautés d’appartenances initiales qui les protégeaient du « risque ». Celui-ci est alors moralisé. D’après Marcel Calvez, « en reliant l’existence de la menace que constitue le sida à des groupes particuliers ou des conduites spécifiques, il peut servir à soutenir la collectivité contre certaines conduites ou certains groupes », ce qui est le cas majoritairement des MSM au sein de la société indienne. Le sida est alors associé au style de vie des MSM, à leurs comportements, voir à leurs identités.
De plus, on est ici en présence d’une vision objectivé du risque, à un modèle de type « epidemiological-bahavioural ». C'est-à-dire, le risque est présenté comme une « possibilité objective d’évènements à venir ». Cela postule alors la réalité de l’objet étudié sans remettre en cause des catégories essentialisées telles que « MSM », « groupes à risque », « population générale ». Ce travail de catégorisation conduit à renforcer l’idée dans ce cas précis d’une science de la santé rationnelle, légitimé de part un caractère qui serait, scientifique, techno-rationnel afin de mieux gérer l’épidémie du sida. Utiliser ce type de vocabulaire permet d’intégrer au discours officiel ou de la morale, celui de la science, légitime. Pourtant, d’après Marcel Calvez, il n’existe pas en santé publique de rationalité désincarnée mais : « des normes de conduites souhaitables que les actions de prévention cherchent à imposer par le truchement de la catégorie du risque ». La façon dont sont produits et mobilisés des données au sein de programmes internationaux de santé n’est pas anodine. Ce qui est revendiqué comme une approche scientifique de la sexualité serait pour grande partie une application de préceptes normatifs établis en matière de santé publique et de sexualité. Ces vérités articulées autour d’un langage clinique voulu neutre, à la base de l’action publique, acquièrent alors une certaine universalité et, une « plausibilité culturelle » [Leigh Pigg, 2005]. L’usage social qui est fait de cet apparent détachement peut ainsi présenter des limites. En effet, à force d’intérioriser ces différentes notions et de les associer aux MSM, ces derniers sont considérés en partie sous ce prisme pour tous les aspects de la vie social et économique. Les perspectives d’avenir sont donc d’ores et déjà limitées[Patel, 2007]. Enfin, la focalisation est faite sur la transmission sexuelle du sida mais assez peu sur les autres moyens de contracter la maladie (exemple : les transfusions sanguines) [Kole, 2007] ou sur ces causes sociales.
11 Once we’re given a particular area and we register a person, then we alone provide services to him. Other NGO can then no register them. But they can go to other NGOs to hang out, meet other people [...] No duplicacy [...] registration is only for one NGO to do. We have to register them first ».
10
Les politiques de lutte contre le sida ont donc ici un impact dans la définition qui est faite des minorités sexuelles dans la mesure ou initialement, elles sont à l’origine d’un processus de labellisation de ces dernières et d’un regroupement de ces minorités sous l’étiquette de MSM et de « groupe à risque ». Elles participent ici par ce travail de définition à structurer des identités sous une catégorie viable d’individus autour d’un enjeu, le sida devenu problème de santé publique. Au delà de ces labels et de construction sociale d’un groupe, la lutte contre le sida marque aussi de nouvelles dynamiques en termes de politisation d’identités sexuelles, jusqu’à faire de ces dernières de véritables identités politiques. Le développement que nous venons de voir des organisations de lutte contre le sida est aussi l’occasion de voir émerger un activisme politique du droit des minorités autour de cette thématique.
II) La «cause sida» comme 1er élément fédérateur visible de la politisation de minorités sexuelles
a) Des organisations informelles à la structuration de mouvements.
Avant les années 1990, le réseau des minorités sexuelles est assez informel [Cohen, 2006]. Il est principalement destiné à des groupes sociaux économiques aisés qui s’auto-définissent comme «gays» et se regroupent notamment par le biais de festivités (dans des « farmhouses »), et d’évènements privés. La mise sur agenda politique progressive de l’enjeu du SIDA, associée à l’arrivée de flux de financement (nationaux et internationaux), contribue au développement d’organisations (taille, effectifs, etc.). Ces dernières vont parfois imploser et se constituer en structures distinctes. De plus en plus d’espaces organisationnels MSM prennent donc forme et, permettent aux individus de se regrouper, de se faire un réseau. Ils favorisent la construction d’un groupe de pairs MSM, et permettent à des individus d’avoir un espace sécurisé pour échanger, entre autre, sur différentes expériences vécues par tous (exemple, les discriminations subies au quotidien). L’identité MSM est alors progressivement aussi représentée, par des individus s’auto-identifiant comme Kothis. Ces derniers commencent à fréquenter les espaces organisationnels et sont recrutés au sein d’ONG afin d’y travailler comme « peer educator » [Cohen, 2006], c’est-à-dire, comme acteurs de terrain comme nous l’avons vu dans un premier temps auparavant.
La question des financements joue alors un rôle prépondérant dans la structuration de ces espaces et de ces identités. La distribution de fonds vient surtout de l’Etat [Menon, 2008]. Seulement, d’après les enquêtés, les initiatives MSM n’attirent l’attention de l’Etat et de ses dotations que lorsqu’elles s’apparentent à des enjeux publics sanitaires, à des programme d’actions relatifs à la lutte contre le sida. Celui-ci devient ainsi un enjeu politique pour des organisations, MSM ou autre, qui réussissent à obtenir le « capital sida » [Cohen, 2006]. En effet, la création et la structuration d’un espace MSM sous une forme associative par exemple, dépend principalement des financements obtenus pour la lutte contre le sida. D’autres sources de financements privés sont aussi disponibles.
Selon les différents types de financements obtenus et leurs donateurs, les marges de manœuvre des organisations ne semblent pas être les mêmes. Par exemple, une organisation comme la NAZ qui dispose de fonds internationaux (Suédois) a des activités variées telles que la prévention du sida mais aussi la mise en place d’ateliers (anglais, artisanat, informatique), des débats sur la sexualité et les identités sexuelles, l’organisation de fêtes etc. les CBO quant à elles, essentiellement financé par la NACO ne peuvent se concentrer que sur des domaines d’actions exclusivement en lien avec la prévention du sida. Il est à noter par ailleurs qu’une fois financées, les organisations, plus particulièrement les CBO, ont des impératifs de rentabilité : elles doivent atteindre un certain nombre d’individus. Un nombre insuffisant de MSM comptabilisés peut entraîner un licenciement ou la
11
fermeture de l’organisation. C’est aussi pour ces raisons que l’on a construit « l’identité Kothi » comme une catégorie viable : les fonds que l’on reçoit dépendent du nombre de « Kothis » qu’une organisation a pu atteindre [Menon, 2007]. Face à ces impératifs quantitatifs et à des façons parfois floues de procéder au comptage, des auteurs comme Subir Kole et Daniel Halperin ont alors remis en question la fiabilité des données épistémologiques recueillies [Kole, 2007].
La façon dont les financements sont utilisés varie ainsi selon le champ de possibilités laissées par les donateurs. La NAZ dispose de beaucoup plus de ressources matérielles qu’une CBO comme la DART que ce soit lorsqu’elle décide de lancer un programme ou lorsqu’il s’agit de disposer de locaux. La NAZ, n’étant pas dépendante du Ministère de la Santé ou d’une agence particulière, peut aussi faire le choix de financer en partie des programmes qui ne soient pas uniquement en lien avec la thématique du sida et même développer un certain « activisme Queer ». Par exemple, presque chaque semaine des réunions « Queer Campus » ont lieu dans les locaux du « Milan Project » (le programme MSM de la NAZ). Cette organisation regroupe un ensemble disparate d’étudiants de Delhi, s’auto-définissant comme gays et appartenant à des catégories socio-économique favorisées. Le langage utilisé est essentiellement l’anglais. A chaque séance, des thématiques de discussion de groupe sont proposés, notamment autour des stratégies à mettre en place pour lancer un « mouvement Queer ». Les questions relatives au sida n’ont pas été abordées pendant les semaines d’observations, les participants à «Queer Campus» semblaient déjà informés sur ces thématiques. Ces réunions permettent quelques partages d’expériences collectives dans un espace protégé, ainsi que l’accès à un certain nombre d’informations et de débats. Ces différents aspects de ces réunions peuvent donner forme à des identités, favoriser un sentiment d’appartenance et donc contribuer à une certaine mobilisation sur des questions qui ne sont pas centrées autour de la prévention de l’épidémie. Cependant, il serait erroné de considérer qu’un programme comme le Milan Project de la NAZ a une marge de manœuvre très importante. En effet, les locaux du Milan Project ont été soudainement fermés (officiellement déplacés), un ensemble d’acteurs de l’ONG considèrant que les organisations de MSM sont assez nombreuses à Delhi et qu’il est désormais préférable de se concentrer sur d’autres populations dans la lutte contre le sida (exemple : les enfants orphelins séropositifs). L’abrogation de la section 377 étant en cours, la directrice de la NAZ semble aussi estimer que sa mission première est achevée.
Privé ou publique, les financements obtenus contribuent à la structuration des communautés MSM dans des espaces nouveaux de socialisation et, de politisation, à savoir les organisations de lutte contre le sida.
b) Mobilisation pour la reconnaissance des minorités sexuelles MSM ou LGBT
La lutte contre le VIH/sida est aussi une opportunité d’ouvrir un ensemble de débats sur la sexualité et ce, plus largement que dans le seul cadre associatif. Elle contribue à ce que ces thématiques émergent sur la sphère publique [Menon, 2007]. A l’origine, la plupart des revendications sont abordées officiellement en termes de santé publique, ce qui est une opportunité parallèle de développer d’autres thèmes dans un contexte répressif à l’égard des minorités sexuelles. Le cas de l’abrogation de la section 377 est significatif à ce sujet. En effet, afin d’être intelligible sur une sphère publique dominante qui criminalise socialement et légalement l’homosexualité, les premiers débats se font officiellement sur la question de gestion de la pandémie. Suite à « l’affaire Lucknow », un ensemble d’acteurs se mobilisent pour exiger le retrait de la section 377 de code pénal indien. A titre de rappel, l’affaire de Lucknow concerne l’arrestation de travailleurs d’une ONG en lien avec la NAZ au moment où ils font de la prévention VIH/sida au sein de groupes MSM. Leurs arrestations, justifiées officiellement en vertu de la section 377 de la loi pénale (« atteinte à la pudeur », promotion de sexualité « non naturelle » etc.) symbolise le début d’une longue mobilisation contre la section 377.
12
Cette dernière définissant que: « whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature [...] shall be punished with imprisonment [...]» va progressivement être dénoncée dans un contexte de lutte contre la maladie. Une partie de l’argumentaire d’activistes au sein d’ONG ou d’hommes politiques (exemple : le ministre de la Santé en 2008, A. Ramadoss) est de souligner que cette loi empêche les travailleurs de santé de combattre le virus efficacement. Dès 1994, une pétition est lancée par l’ONG de lutte contre la maladie ABVA afin d’abroger cette section de la constitution. Pendant plusieurs années, les activistes MSM sont confrontés à un refus d’une partie des autorités publiques de modifier la loi. Leurs revendications sont alors principalement basées sur arguments autour de questions de « moralité publique », d’élément « contre-nature », et d’inadéquation avec la « culture indienne ». Un des arguments utilisé est aussi de souligner que cet article n’est que rarement appliqué et qu’il ne considère donc pas en soi un obstacle pour le travail des associations. Il faut attendre 2002 pour que la NAZ lance une « Public Interest Litigation » et 2009, après de nombreux débats juridiques, sociaux et politiques, pour que l’article soit abrogé, La plupart des activistes MSM la formule en termes d’efficacité dans la lutte contre le sida. Ainsi, elle apparaît plus intelligible auprès de la sphère politique et sociale. A l’ origine, bien que des agencements parallèles se fassent, les espaces de protestations Queer sont cantonnés par le champ légal. Dans un premier temps, la mobilisation la plus visible est donc celle qui touche à cette sphère.
Parallèlement, la lutte contre le SIDA des années 1990 et les différentes contestations qui émergent autour de la médiatisation de la section 377 sont aussi l’occasion de rendre plus visibles des minorités sexuelles et de développer un autre ensemble de revendications concernant les droits fondamentaux humains. Ainsi, on assiste parfois à un « déconfinement des luttes définitionnelles » [Carricaburu, 2007] MSM. C’est-à-dire que les thématiques MSM ne sont plus uniquement confinées à « l’espace de la cause » sida mais sont localisées dans un espace plus ouvert. Progressivement ce sont des thématiques qui s’émancipent de la tutelle épistémologique. Une des façons d’être rendu intelligible sur la scène politique et sociale est alors de dénoncer publiquement des situations globales d’injustices, d’expériences marquées par des formes de violences en termes de droits fondamentaux humains.
Le contexte international est par ailleurs propice à l’émergence de cette politisation du droit des minorités sexuelle sur la scène indienne et à son cadrage. En effet, des organisations comme les Nations-Unis donnent des définitions précises des droits fondamentaux, de la sexualité etc. Les sociétés ne s’y référant pas sont accusées en partie de, réprimer les minorités sexuelles de leurs pays. Pour recevoir des fonds de donneurs internationaux, les receveurs doivent donc chercher à promouvoir les droits des minorités sexuelles et le travail en collaboration avec des populations marginalisées. Dans un objectif de prévention du sida, un certain nombre de normes occidentales de développement et de droits inaliénables sont alors implantés parallèlement. Une partie du mouvement va donc s’articuler d’après un vocabulaire de droits, en référence à catégories de représentations des mouvements LGBT internationalisé et des normes d’agences transnationales. Ce contexte a donc aussi pu influencer en partie l’abrogation de la section 377.
L’abrogation de cette dernière n’est pas évoquée au cours des différents entretiens menés comme un facteur déterminant pour la lutte contre le sida et sa prévention. En effet, les personnes interrogées soulignent que cela leur permet surtout de ne plus être considérés comme criminelles et de pouvoir intégrer certains espaces sociaux sans se sentir menacés.
Les débats ouverts en termes de droits fondamentaux sont aussi l’occasion de susciter des questionnements sur les thèmes de la sexualité et des minorités sexuelles. En effet, jusque dans les années 1990, les questionnements autour de la sexualité sont cantonnés à la sphère privée. Un des défis réside dans la proposition d’un débat public, permis par la médiatisation de la section 377 et
13
notamment par des soutiens affichés de figures emblématiques (exemples : Amartya Sen, Vikram Seth, le Prince de Rajpila Manvendra Singh Gohil etc.) On observe alors la mobilisation d’un ensemble d’activistes au sein d’ONG afin de rendre plus visible les minorités sexuelles MSM, présentées dès lors parfois comme un « groupe » LGBT. A travers les médias, des thématiques développées en occident ainsi que des dynamiques publics de « coming-out » de certains auteurs et de certains activistes (exemple : Asho Kow Kavi) apparaissent aussi à la fin des années 1990 en Inde [Menon, 2007]. Dès juin 2008, des marches inspirées des gays pride (Delhi, Mumbai, Bangalore, Kolkata, Indore, Pondicherry), des magazine gays (en 2009 le Bombay Dost), des festivals de cinémas Queer (en 2010 à Mumbai), des sites de rencontres MSM (Planet Romeo), des groupes de soutiens ou d’images Queer se créent et se développent.
En outre, cette période coïncide aussi avec des propositions de lectures historiques « Queer » de l’histoire nationale par des historiens ou des militants des minorités sexuelles [Menon, 2007]. Pour ces derniers, il s’agit de montrer qu’une multitude d’identités sexuelles existaient en Inde avant la colonisation britannique, histoire mise de côté par un ensemble de textes issus du courant orientaliste [Baccheta, 2007]. Derrière ces lectures de l’histoire se cache un enjeu de reconnaissance et de légitimation des minorités sexuelles. A partir des années 1990 et de la mise à l’agenda du VIH/sida comme enjeu de santé publique, on observe donc la politisation et la médiatisation de minorités sexuelles qui participe de la création officielle d’une identité sexuelle (« MSM », « Queer » ou« LGBT » selon les interlocuteurs).
c) Les minorités sexuelles comme espaces hétérogènes et renégociés.
Bien que la lutte contre le sida favorise la mise en place d’une identité collective présentée comme objectivée et homogène sous le sigle MSM, les individus auto-défini.e.s Kothis, Hijras et Gays revendiquent souvent d’appartenir à des identités bien distinctes. Les Hijras ou les Kothis sont incorporés au terme MSM ou LGBT mais, pour la plupart, ne s’y reconnaissent pas et n’y revendiquent pas une appartenance spécifique. Dans cette politisation qui est faite de minorités sexuelles, il y a alors parfois un risque d’homogénéisation des catégories qui couvrent des réalités très distinctes.
En effet, le « groupe MSM » présente des caractéristiques sociales, économiques, culturelles, ethniques, de genre très hétérogènes qui peuvent contribuer à fragmenter l’unité de ce qui est présenté comme groupe. Un des enjeux entre les sous-groupes est celui de la légitimation au sein de la société. Par exemple, les Hijras revendiquent le fait d’avoir une identité sexuelle historique et authentique- de par leur lignage direct avec les eunuques des cours moghole- et affirment donc une légitimité particulière [Cohen 2006]. Entre les Kothis et les Hijras des phénomènes de concurrence s’articulent alors en termes de nouvelles versus anciennes identités. Même au sein d’une organisation comme la NAZ qui élabore officiellement des programmes à destination de l’ensemble des MSM, les individus interagissent principalement entre groupes de pairs MSM (Kothis, Hijras, Gay). Un des arguments principal utilisé pour expliquer ces divisions par les enquêtés est celle de différences de cultures. Ces phénomènes de concurrences sont aussi à la source d’exclusions ou de reproduction de la marginalisation intra MSM. Par exemple, les personnes MSM enquêtés s’accordent sur l’idée que les Kothis, assimilés aux rôles traditionnellement tenus par la femme, doivent être soumis à l’autorité de leurs Panthis, représentatifs des hommes dans la société indienne. Les Kothis efféminés sont alors stigmatisés n’étant pas considérés ni comme des hommes, ni comme des femmes à part entière et ce, sans détenir une légitimité particulière traditionnellement attribuée aux Hijras. De par leurs féminisations, ils ne se conforment pas aux standards indiens de genre que leurs sexes de naissance leur assigne et sont donc victimes de diverses marginalisations. Les observations au sein de réunions comme « Queer Campus », association représentant des étudiants LGBT sont aussi l’opportunité de
14
constater que les personnes lesbiennes, en infériorité ne sont que peu écoutées dans un univers principalement masculin.
Enfin, comme nous l’’avons vu précédemment, la lutte contre le SIDA participe pour partie à des processus de visibilité pour les MSM. Seulement, il est à noter que ce processus ne touche pas de la même façon toutes les minorités sexuelles MSM. On assiste alors à des accès différenciés et inégaux aux ressources (organisationnelles, etc.) selon les sous-groupes MSM. Par exemple, une partie des Hijras et des Kothis accusent les gays d’être la minorité la plus visible. Ils auraient un accès privilégié à des ressources (matérielles et immatérielles), à des réseaux et seraient ainsi les plus publicisés dans ce mouvement. En effet, les individus rencontrés lors des entretiens, s’auto-identifiant gays, appartiennent majoritairement à des catégories socio-économique plus aisées et parlent pour la plupart anglais, ce qui exclut une grande majorité de MSM ne maîtrisant pas cette langue. Dans un contexte où les fonds sont internationaux, cela peut-être alors un gros avantage pour les individus qui parlent anglais, et qui accèdent plus facilement à des ONG ayant des ressources et des moyens d’actions plus importants. A l’inverse les Kothis féminisés et les Hijras sont issues de groupes sociaux plus défavorisés et marginalisés. Facilement reconnaissables et parallèlement socialement exclus, la plupart n’ont pas d’autres possibilités de revenus économiques que la prostitution ou de travailler dans des CBO. Il est à noter que, d’après les enquêtés, travailler dans une CBO où même parfois dans une ONG de lutte contre le sida n’est pas une opportunité économique très rentable (bien qu’assurant une certaine source fixe de revenus). La plupart se prostitue donc aussi occasionnellement. Au sein de minorités sexuelles, on a alors de nouveau des phénomènes d’exclusions et des processus de divisions internes qui contribuent à redéfinir les identités sexuelles MSM, identités dynamiques. De plus tout un ensemble d’individus ne se « labellisent » pas. Entre l’activisme du milieu associatif, les discours de ceux qui se définissent MSM et les pratiques, il y a parfois un fossé. Des pratiques de contestation de l’hétéronormativité qui ne s’identifient pas à des mouvements [Menon, 2007]. Elles ne sont pas rendues visibles mais elles existent.
La façon dont les discours produisent des identités sexuelles MSM réitère donc parfois des phénomènes de concurrences et des formes hégémoniques liées principalement au genre, à la classe sociale d’appartenance et à l’ethnie.
***
Nous avons donc pu voir que la mise sur agenda politique de la maladie du sida comme enjeu de santé public favorise la visibilité des minorités sexuelles « MSM». Au sein d’un contexte mondial de lutte et de gestion de la maladie, a été définie une catégorie viable : les MSM, caractérisés par des comportements et des espaces spécifiques. Mécanismes ayant contribué à l’homogénéisation d’un groupe, ils ont aussi favorisés le façonnement d’une identité sexuelle MSM. Cette dernière est même devenue principalement une identité politique. Bien que longtemps confinée aux frontières du domaine épidémiologique la « cause MSM » s’étend progressivement à d’autres champs. Sous le sigle LGBT ou MSM des activistes d’ONG de lutte contre le SIDA participent alors à localiser des identités sexuelles traditionnelles existantes au sein d’identités politisées et globalisées. Cependant, ce processus de « visibilisation » ne concerne pas tous les individus dits MSM de la même manière. Catégorie très hétérogène et les MSM représentent de multiples réalités d’un point de vue social, économique, ethnique, culturel et, de genre. La notion de groupe MSM est donc à relativiser et aussi à comprendre en fonction d’enjeux politiques. Cette identité est avant tout dynamique, au sein d’un environnement multiforme. Les mobilisations identitaires par les individus et les possibilités de réitération d’identités allo ou auto définies sont en effet sans cesse renégociées en fonction du contexte et des contraintes dans lesquels ils évoluent.
15
Annexe: « Groupe à risque », « Population relais » et « Population générale »
Source : Terrain de l’auteure
16
Corpus indicatif Ouvrages
BERENI, Laure, « Penser la transversalité des mobilisations féministes: l'espace de la cause des femmes », in BARD Christine, 2012, Les féministes de la 2ème vague, PUR, « Archives du féminisme »
CALVEZ Marcel, « Pour une approche constructiviste des risques de santé. De quelques leçon des recherches sur la prévention du SIDA », in CARRICABRU D, CASTRA M, COHEN P, 2010, Ed, pp. 226
CARRICABURU, Danièle, « Confinement et déconfinement des luttes définitionnelles : les cas de la périnatalité et des infections nosocomiales » in GILBERT, Claude, HENRY, Emmanuel, Comment se construisent les probèmes de santé publique, 2009, Recherches, La Découverte.
COHEN, Lawrence, «the Kothis Wars: AIDS Cosmopolitanism and the Morality of Classification», in ADAMS, Vincanne, LEIGH PIGG, Stacy, sous la dir, 2006, Sex in development : Science, Sexuality, and Morality in Global Perspective, pp. 187-207, pp. 269-305
MENON, Nivedita, « Outing hetronormativity : Nation, Citizen, Feminist Disruptions », in Sexualities, Women unlimited, New Delhi, Issues in Contemporary Indian Feminism, 2007, pp. 1-52, pp. 52-91
NARRAIN, Arvind, « Queer struggles Around the Law : The contemporary Contex », in Sexualities, Women unlimited, New Delhi, Issues in Contemporary Indian Feminism, 2007, pp. 1-52, pp. 52-91
Article
KOLE, K, Subir, “Globalizing queer? AIDS, homophobia and the politics of sexual identity in India” in Globalization and AIDS, 3(8), July 11
BENFORD, Robert, SNOW, David, Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment, Annual Review of Sociology, Volume 26: 611-639, August 2000
Rapports
Annual report 2011-2012, Departement of AIDS Control, ministry of Health and Family Welfare, NACO, 2012 Annual report 2011, Departement of AIDS Control, ministry of Health and Family Welfare, NACO, 2011 Annual report 2009-2010, Departement of AIDS Control, ministry of Health and Family Welfare, NACO, 2010 KHAN Shivananda, MSM and HIV/AIDS in India, Naz Foundation International, 2004/1, pp. 23
VOICES AGAINST 377, “Rights for all : ending discrimination against queer desire under section 377”, Delhi, 2004, pp. 51
Site:
http://www.nacoonline.org/National_AIDS_Control_Program/