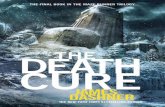Rake's Progress: Cure and Reinstatement of Secured Claims ...
La cure psychanalytique : un salut profane ?
-
Upload
univ-montp3 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La cure psychanalytique : un salut profane ?
LA CURE PSYCHANALYTIQUE: UN SALUT PROFANE? Jean-Daniel Causse Institut protestant de théologie | Études théologiques et religieuses 2008/3 - Tome 83pages 377 387
ISSN 0014-2239
Article disponible en ligne l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-etudes-theologiques-et-religieuses-2008-3-page-377.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Causse Jean-Daniel, La cure psychanalytique : un salut profane ?,
Études théologiques et religieuses, 2008/3 Tome 83, p. 377-387.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution ectronique Cairn.info pour Institut protestant de théologie.
Institut protestant de théologie. Tous droits rerv pour tous pays.
La reproduction ou reprentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autoris que dans les limites des conditionsgales d'utilisation du site ou, le cas hnt, des conditions gales de la licence souscrite par votre ablissement. Touteautre reproduction ou reprentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manie que ce soit, est interdite saufaccord prlable et rit de l'iteur, en dehors des cas prus par la lislation en vigueur en France. Il est prisque son stockagedans une base de donns est alement interdit.
1 / 1
Doc
umen
t t&
eacu
te;l&
eacu
te;c
harg
&ea
cute
; dep
uis
ww
w.c
airn
.info
- B
IU M
ontp
ellie
r -
- 1
94.2
14.1
61.1
5 -
05/0
3/20
14 1
8h14
. &co
py; I
nstit
ut p
rote
stan
t de
théo
logi
e D
ocument t&
eacute;lécharg&
eacute; depuis ww
w.cairn.info - B
IU M
ontpellier - - 194.214.161.15 - 05/03/2014 18h14. © Institut protestant de théologie
LA CURE PSYCHANALYTIQUE : UN SALUT PROFANE ?
Un salut sans dieu est-il envisageable et la cure psychanalytique peut-elleêtre une de ses expressions ? Considérant le célèbre cas de Françoise Doltopour laquelle, d’une certaine manière, la psychanalyse poursuit une tradi-tion chrétienne tout en la sécularisant, Jean-Daniel CAUSSE * relève quatrepoints de rencontre entre salut chrétien et cure psychanalytique : l’impor-tance du croire, la fonction de la parole, l’ouverture à une grâce, l’enjeu del’acceptation de soi. L’homologie ainsi constatée conduit à poser la questiondu salut chrétien à partir de ses thèmes caractéristiques, notamment celui dela victoire sur le péché et la mort 1.
I. SEUL UN DIEU PEUT-IL ENCORE NOUS SAUVER ?
Dans un entretien qu’il avait accordé à l’hebdomadaire Der Spiegel, en1976, peu de temps avant sa mort, le philosophe Martin Heideggerdéclarait : « Seul un dieu peut encore nous sauver 2. » Élevée au rang d’apho-risme, cette célèbre affirmation a fait l’objet de nombreuses interprétations 3.On prendra l’énoncé heideggérien comme point de départ, même si c’estaussi pour marquer un écart avec lui. Dans l’affirmation de Heidegger,entendons qu’il n’y a qu’un dieu qui puisse être l’auteur de ce qui méritevraiment le nom de salut. Un dieu seul peut réaliser ce dont l’homme reste
377
ÉTUDES THÉOLOGIQUES ET RELIGIEUSES83e année – 2008/3 – P. 377 à 387
* Jean-Daniel CAUSSE est professeur à l’Université Paul-Valéry-Montpellier III (départe-ment de psychanalyse) et à l’Institut Protestant de Théologie, Faculté de Montpellier (départe-ment de systématique).
1. Cet article est la reprise d’une conférence prononcée dans le cadre du cours public de laFaculté de théologie de Montpellier pendant l’année universitaire 2007-2008.
2. Martin HEIDEGGER, Entretien accordé par Heidegger au journal Der Spiegel, in Écritspolitiques 1933-1966, Paris, Gallimard, 1995, p. 260.
3. Cf. dernièrement, Bernard SICHÈRE, Seul un Dieu peut encore nous sauver : le nihilismeet son envers, Paris, Desclée de Brouwer, 2002.
ETR/Jean-Daniel CAUSSE 25/08/08 11:36 Page 377
Doc
umen
t t&
eacu
te;l&
eacu
te;c
harg
&ea
cute
; dep
uis
ww
w.c
airn
.info
- B
IU M
ontp
ellie
r -
- 1
94.2
14.1
61.1
5 -
05/0
3/20
14 1
8h14
. &co
py; I
nstit
ut p
rote
stan
t de
théo
logi
e D
ocument t&
eacute;lécharg&
eacute; depuis ww
w.cairn.info - B
IU M
ontpellier - - 194.214.161.15 - 05/03/2014 18h14. © Institut protestant de théologie
incapable. Si un homme peut faire beaucoup pour un autre homme (l’aider, lesoutenir, le secourir, le consoler, l’enseigner, etc.), il ne saurait être l’auteurde son salut. Seul un dieu le peut. S’il n’y a plus de dieu, alors il n’y a pasnon plus de salut. Il n’existe plus de raison véritable de parler encore desalut. Le problème est ainsi de savoir s’il se trouve encore un dieu qu’onpuisse attendre. Qui serait-il alors ? Et de quoi pourrait-il encore noussauver ? À quoi nous arracherait-il ? On notera en tout cas que, pourHeidegger, la question se pose dans un temps qui est celui de la mort de Dieuou des dieux, c’est-à-dire un temps où Dieu ne tient plus la place qu’il avaitpu occuper dans la cohérence générale du monde. C’est un temps marqué parle retrait des dieux, sans retour envisageable. Le Dieu qui pourrait encoresauver doit donc être un nouveau Dieu, un autre Dieu, qui n’est pas celui dela métaphysique, ni celui de la religion. Quel nom lui attribuer ? PourHeidegger, il s’agit peut-être du Dieu des poètes sur lequel il médite longue-ment en reprenant Hölderlin 4. Le Dieu des poètes désigne ce qui fait advenirles choses ou, plus précisément, ce qui les fait naître par le pouvoir même dulangage.
La position de Heidegger peut surprendre et elle témoigne d’une certaineaporie : d’un côté Dieu se trouve congédié, alors que de l’autre il est à nou-veau requis, même si c’est sous une nouvelle figure. Pourquoi ne pas choisirplutôt d’abandonner toute référence à Dieu ? Pourquoi vouloir réinvestir lathématique du « dieu » au lieu d’y renoncer ? En affirmant que seul un dieupeut encore nous sauver, la réponse apportée par Heidegger peut être enten-due comme un aveu : je ne peux renoncer au salut, je désire ce qui peut sau-ver, j’ai encore besoin d’être sauvé. Ou encore : je ne peux me résoudre àabandonner la notion de « salut » et ce qu’elle recouvre. Dès lors, nous com-prenons que le problème n’est pas seulement de savoir s’il y a un dieu quipuisse sauver, qui est le dieu qui peut sauver, mais ce que peut signifier enréalité « être sauvé ». C’est la question qui demeure. De quoi a-t-on besoind’être sauvé ? De quelle attente de salut peut-il s’agir pour autant que le salutcorresponde à ce que nous espérons (ce qui n’est pas certain) ? Tout le pro-blème réside dans le verbe « sauver » lui-même. Que contient-il ? Quel sensou quelle portée peut-il encore avoir ? Qu’est-ce que peut sauver en nous, denous, un acte de salut ?
C’est à partir de ces questions que nous pouvons nous demander si la psy-chanalyse ne constitue pas une forme de salut profane ou laïcisé, c’est-à-direun salut pour des hommes qui se passent finalement de Dieu et qui demeu-rent malgré tout confrontés à ce que recouvre la nécessité d’être sauvé ou laréalité même du salut. Nous aurions ici une proposition sensiblement diffé-
JEAN-DANIEL CAUSSE ETR
378
4. Cf. Martin HEIDEGGER, Approche de Hölderlin, Paris, Gallimard, 1996. On se reporteraaussi à Jean-François MATTEI, Heidegger et Hölderlin : le quadriparti, Paris, PUF, 2001.
ETR/Jean-Daniel CAUSSE 25/08/08 11:36 Page 378
Doc
umen
t t&
eacu
te;l&
eacu
te;c
harg
&ea
cute
; dep
uis
ww
w.c
airn
.info
- B
IU M
ontp
ellie
r -
- 1
94.2
14.1
61.1
5 -
05/0
3/20
14 1
8h14
. &co
py; I
nstit
ut p
rote
stan
t de
théo
logi
e D
ocument t&
eacute;lécharg&
eacute; depuis ww
w.cairn.info - B
IU M
ontpellier - - 194.214.161.15 - 05/03/2014 18h14. © Institut protestant de théologie
rente de celle de Heidegger dans la mesure où il s’agit d’un salut qui juste-ment ne suppose pas de Dieu, quel qu’il soit, tout en restant ce qui concernechacun de façon impérieuse. En somme, la disparition de Dieu ou des dieux,leur retrait, n’a pas eu pour effet d’annuler la nécessité de salut, mais elle lafait apparaître autrement. Elle en fait une question non religieuse liée à laréalité même du monde et de l’humain. La cure psychanalytique occupe-t-elle une fonction qui consiste à assurer un salut profane ? Représente-t-elle,en un mouvement qui lui est spécifique, un salut séculier ? Considérons leproblème ainsi posé tout en nous souvenant que Freud comme Lacan voulaient situer la psychanalyse sur un terrain qui n’est ni pour ni contre lareligion, s’il est vrai que, pour eux, guérir n’est pas sauver et que la psycha-nalyse ne vise aucun salut.
II. LE CAS FRANÇOISE DOLTO
La célèbre psychanalyste Françoise Dolto (1908-1988) est exemplaire,vraisemblablement sans en avoir l’intention, de ce que je nomme ici « salutprofane » 5. L’attitude de Dolto est singulière dans l’espace de la psychana-lyse, qui a plutôt une attitude réservée, et souvent simplement négative, àl’égard de toute expression du religieux. Il est de bon ton de se dire athée. Or,Dolto n’a jamais caché sa référence à la foi chrétienne et la figure de Jésusoccupe chez elle une place essentielle. Sa profession de foi explicite a sou-vent gêné, agacé, certains de ses amis psychanalystes qui considéraient cetélément comme un îlot dans sa pensée. Au moment de la publication de sesouvrages sur la foi chrétienne, un débat avait été engagé par certains de sescollègues sur le thème : la psychanalyse n’est pas une Bonne Nouvelle 6.Chez Dolto, la foi en celui qu’elle appelle « Dieu » n’est pas un élément mar-ginal, mais un point constitutif de son rapport à la psychanalyse 7. D’un autrecôté, pourtant, le risque a été grand de « christianiser » trop vite la psychana-lyse, via Dolto, c’est-à-dire de « baptiser » la psychanalyse, ce qui est tou-
379
2008/3 LA CURE PSYCHANALYTIQUE
5. Pour une approche générale du parcours et de l’œuvre de Dolto, on peut consulterFrançoise DOLTO, Autoportrait d’une psychanalyste : 1934-1988, Paris, Seuil, 1989, et Jean-François de SAUVERZAC, Françoise Dolto : itinéraire d’une psychanalyste, Paris, LibrairieGénérale d’édition, 1995.
6. C’est ce que rappelle Willy BARRAL dans « La psychanalyse est-elle une BonneNouvelle ? » in Françoise Dolto, aujourd’hui présente, Paris, Gallimard, 2000, p. 521-522.
7. À propos du rapport de Dolto à la foi chrétienne, Jean-Pierre WINTER écrit, avec unepointe d’ironie, que Dolto « montrait qu’à tout prendre le type d’adhésion qui fut le sien estpréférable (du point de vue de la disponibilité de l’inconscient) à la soumission aux chefs ouaux doctrinaires, si courante dans les associations analytiques qui regroupent tant de praticiensfaisant profession d’athéisme. La morale de l’histoire pourrait être : méfiez-vous de ceux qui seproclament athées, ils vouent leur désir à un dieu terrestre qui n’incarne pas la face vivante etvivifiante du Verbe, mais sa face meurtrière », « De la métaphysique à la métapsychologie.Dieu profane, sujet divin » in Françoise Dolto, aujourd’hui présente, op. cit., p. 539.
ETR/Jean-Daniel CAUSSE 25/08/08 11:36 Page 379
Doc
umen
t t&
eacu
te;l&
eacu
te;c
harg
&ea
cute
; dep
uis
ww
w.c
airn
.info
- B
IU M
ontp
ellie
r -
- 1
94.2
14.1
61.1
5 -
05/0
3/20
14 1
8h14
. &co
py; I
nstit
ut p
rote
stan
t de
théo
logi
e D
ocument t&
eacute;lécharg&
eacute; depuis ww
w.cairn.info - B
IU M
ontpellier - - 194.214.161.15 - 05/03/2014 18h14. © Institut protestant de théologie
JEAN-DANIEL CAUSSE ETR
380
jours le meilleur moyen pour en désamorcer la charge subversive et en faireune nouvelle morale. Cette tentative récurrente de normalisation de la psy-chanalyse n’est pas le seul fait de la religion, et elle trahit un désir de prendrele contrôle de ce qui représente un danger et s’apparente même à un malcomme en témoigne le jugement qu’on prête à Freud au moment où, en1909, il monte sur le paquebot qui doit le conduire en Amérique du Nord encompagnie de Jung et de Ferenczi. « Je leur apporte la peste », aurait-il dit àpropos des Américains, témoignant par là de la façon dont il pensait que lapsychanalyse serait perçue.
Dolto a rendu accessible au grand public une approche psychanalytiquede la foi et de la Bible, notamment par deux de ses ouvrages plusieurs foisréédités : L’Évangile au risque de la psychanalyse (1977) et La foi au risquede la psychanalyse (1981) qui prennent la forme d’un dialogue entreFrançoise Dolto et Gérard Séverin, psychanalyste lui aussi 8. Dans ces deuxlivres, Dolto se place à distance de la religion chrétienne, notamment de sesinstitutions, et elle se montre en même temps profondément croyante. Quandpar exemple Séverin l’interpelle : « On vous reprochera d’être tantôt freu-dienne, tantôt croyante. Freud était athée, en effet », elle répond : « Si Freudétait resté cantonné dans sa religion juive, s’il avait gardé la vision du mondemédical de son temps, il n’aurait rien trouvé d’original, il n’aurait rieninventé 9. » Et, à propos des religions, elle poursuit : « Les religions, à monsens, pervertissent le désir profond de l’être humain en codifiant une moralequi n’a rien à voir avec l’Évangile 10. » Un peu plus loin dans l’entretien, elleajoute : « Si je m’étais contentée des réponses religieuses à l’angoisse, jamaisje n’aurais étudié la psychanalyse 11. » La position de Dolto en terrain catho-lique, puisque telle est sa culture religieuse, n’est pas si éloignée de l’attituded’un théologien protestant comme Dietrich Bonhœffer lorsqu’il en appelle àun christianisme non religieux. Dolto s’efforce de dégager la foi de la reli-gion, c’est-à-dire de retrouver la puissance vivifiante de l’Évangile au-delàde ses enfermements et de ses perversions. D’ailleurs, toujours à la mêmepage de La foi au risque de la psychanalyse et dans un langage qui aurait puêtre celui de Bonhœffer, elle affirme que « Dieu n’est pas un superbe bouche-trou qui rendrait clos notre monde et nous y ferait voyager sans but 12. »
8. Françoise DOLTO et Gérard SÉVERIN, L’Évangile au risque de la psychanalyse, t. 1 et 2,Paris, Seuil, 1977 ; Françoise DOLTO et Gérard SÉVERIN, La foi au risque de la psychanalyse,Paris, Seuil, 1981. Ces deux ouvrages ont été regroupé en une édition augmentée, présentée parGérard SÉVERIN et annotée par Claude BALDY-MOULINIER dans Les Évangiles et la foi au risquede la psychanalyse ou la vie du désir, Paris, Gallimard, 1996.
9. Françoise DOLTO et Gérard SÉVERIN, La foi au risque de la psychanalyse, op. cit., p. 101-102.
10. Ibid., p. 103.11. Ibid.12. Ibid., p. 104 (c’est l’auteur qui souligne).
ETR/Jean-Daniel CAUSSE 25/08/08 11:36 Page 380
Doc
umen
t t&
eacu
te;l&
eacu
te;c
harg
&ea
cute
; dep
uis
ww
w.c
airn
.info
- B
IU M
ontp
ellie
r -
- 1
94.2
14.1
61.1
5 -
05/0
3/20
14 1
8h14
. &co
py; I
nstit
ut p
rote
stan
t de
théo
logi
e D
ocument t&
eacute;lécharg&
eacute; depuis ww
w.cairn.info - B
IU M
ontpellier - - 194.214.161.15 - 05/03/2014 18h14. © Institut protestant de théologie
381
2008/3 LA CURE PSYCHANALYTIQUE
Ainsi, Dolto conserve constamment une attitude critique à l’égard de la reli-gion, chrétienne en particulier, non par anti-institutionnalisme, mais parcequ’elle considère la religion comme une moralisation inévitable de la foi ouune codification désastreuse de l’Évangile. C’est en ce sens que l’Évangilesera toujours anti-religieux, qu’il nous délivre de la religion et de ses idoles.Jésus est, pour Dolto, la figure divine que les religieux ne cessent pas demettre à mort parce qu’ils ne peuvent pas supporter la puissance de vie et laliberté qui sont en lui. Dans ce jugement, on peut entendre un écho deNietzsche pour lequel les dévots sont toujours les auteurs de la mort de Dieu.
Qui est donc le Jésus de Dolto ? Qu’en dit-elle ? Quelle figure lui donne-t-elle ? La réponse de Dolto est sans ambiguïté : elle consiste à soutenir queJésus est tout simplement le premier psychanalyste ou qu’il est le Maître dudésir que tout humain porte en lui. Comprenons ici que Jésus est celui quitravaille à délier l’humain de ce qui aliène et entrave le pouvoir d’être. Jésusne dit pas ce qu’il faut faire, comment il faut conduire sa vie, ni quel cheminil faut emprunter. Il rend seulement possible un mouvement, une dynamiquede vie, un désir, alors que chacun se trouve pris dans ce qui le laisse surplace, dans un malheur ou un trauma qu’il ne fait que répéter sans pouvoir sedéplacer. Le contraire du désir, en effet, réside toujours dans la sidération.Désirer consiste à être « désidéré », c’est-à-dire à retrouver une mobilité, unepossibilité de se mouvoir dans une histoire devenue nouvelle. La sidérationest d’abord le sidus, l’astre, ce qui est écrit, la puissance inconsciente de ladétermination de soi et, de ce fait, elle est également l’augure, la prédiction,le message qui déclare que notre vie est écrite par avance. Sidérer quelqu’uns’effectue par l’acte de le prédire. Or, prédire c’est toujours maudire. Le désirest tout l’inverse : il est ce qui « désidère », il est l’imprévisible qui se trouvedans chaque histoire. Or, écrit Dolto, « cette dynamique du désir, c’estDieu 13 ». Pour elle, Jésus incarne la possibilité, toujours inouïe quand elle seréalise pour nous, de retrouver la joie de se savoir aimé, de s’éprouver déliéde la peur de l’autre, de la culpabilité et des erreurs du désir. C’est de cettemanière qu’elle comprend l’annonce du salut au moment où Jésus déclare : « Tes péchés te sont remis. » La rémission des péchés n’est rien d’autre quele fait d’être redonné à soi-même et à sa propre histoire qu’il devient alorspossible d’écrire en son propre nom au lieu qu’elle soit une histoire déjàécrite par avance, une histoire où « ça » s’est écrit et dont nous sommes seu-lement le jouet 14.
13. Ibid.14. Dolto écrit : « Jésus leur dit souvent : “Tes péchés te sont remis”. Ce qui peut vouloir
dire : De tes erreurs de désir (dont ton état actuel est le résultat), je te délie. De tes sentimentsde culpabilité, je te délivre. Retrouve la joie de te savoir aimé de Dieu. Aime-toi à nouveau,mais autrement, en t’acceptant. Je te délie de ton mal moral », ibid., p. 68.
ETR/Jean-Daniel CAUSSE 25/08/08 11:36 Page 381
Doc
umen
t t&
eacu
te;l&
eacu
te;c
harg
&ea
cute
; dep
uis
ww
w.c
airn
.info
- B
IU M
ontp
ellie
r -
- 1
94.2
14.1
61.1
5 -
05/0
3/20
14 1
8h14
. &co
py; I
nstit
ut p
rote
stan
t de
théo
logi
e D
ocument t&
eacute;lécharg&
eacute; depuis ww
w.cairn.info - B
IU M
ontpellier - - 194.214.161.15 - 05/03/2014 18h14. © Institut protestant de théologie
JEAN-DANIEL CAUSSE ETR
382
Dans cette perspective d’ensemble, le Jésus de Dolto est un Jésus profane.Il incarne quelque chose d’universel, mais dans le sens de ce qui se trouve enchacun, même si c’est à son insu. Jésus est le nom de la puissance du désir ennous. Il est la face vivifiante du Verbe et, en ce sens, la transcendance de laparole. « Dieu, pour moi, écrit Dolto, c’est l’inconnu de ma soif, soif que jene connais que par une sensation du manque 15. » Ainsi le mot « Dieu »désigne ce qui nous fait vivre en vérité et qui ne se confond avec rien de cequ’on peut avoir. Le salut est là : il est dans cet appel, dans ce qui nousappelle loin de ce qui nous enferme et nous terrasse. Pourtant, la question estde savoir pour quelle raison nommer ce désir « Dieu ». Pourquoi ne pasappeler ce qui est le désir seulement « désir » ? À cette question, justementposée par Séverin, Dolto répond : « L’homme, en tant qu’homme, est né de laparole. D’où vient la parole ? De la relation de désir entre les êtres. Mais dequi vient cette relation de désir ? L’origine du désir, c’est le Verbe, c’estl’acte de désir de rencontrer l’autre 16. » C’est donc à la place de l’origine queDolto situe ce qu’elle appelle « Dieu ». Celui-ci n’est pas seulement laParole, mais ce qui la rend possible, ce qui depuis toujours fait de chacun unêtre de langage, c’est-à-dire un être avec les autres, un être de relation. Dansun entretien avec Jean-Pierre Winter, reprenant la question du rapport entre lemessage de Jésus et la psychanalyse, elle affirme : « Je suis convaincue quela psychanalyse est l’impact lointain du dire, des paroles de Jésus deNazareth dans son peuple, et que nous en sommes la suite 17. » La psychana-lyse serait ainsi une sorte de poursuite du mouvement évangélique, unereprise donc, mais une reprise profane.
III. UNE CERTAINE HOMOLOGIE
L’exemple de Françoise Dolto permet de considérer une certaine homolo-gie entre la foi et la psychanalyse et, par là, un salut qui, situé dans un champprofane, en conserve pourtant l’algèbre, c’est-à-dire la structure formelle, aumoins en partie. Même si le salut chrétien répond à des critères particuliers,on ne peut s’étonner de retrouver en lui des réalités communes. On devraitplutôt se troubler si le salut chrétien ne se situait pas sur le terrain de l’huma-num, c’est-à-dire s’il n’avait rien de commun, en une sorte d’hétérogénéitéabsolue, avec ce qui nous constitue profondément dans notre humanité. Onrelèvera brièvement quatre aspects principaux.
15. Ibid., p. 3516. Ibid., p. 10517. Françoise DOLTO et Jean-Pierre WINTER, Les images, les mots, le corps, Paris,
Gallimard, 1986, p. 147.
ETR/Jean-Daniel CAUSSE 25/08/08 11:36 Page 382
Doc
umen
t t&
eacu
te;l&
eacu
te;c
harg
&ea
cute
; dep
uis
ww
w.c
airn
.info
- B
IU M
ontp
ellie
r -
- 1
94.2
14.1
61.1
5 -
05/0
3/20
14 1
8h14
. &co
py; I
nstit
ut p
rote
stan
t de
théo
logi
e D
ocument t&
eacute;lécharg&
eacute; depuis ww
w.cairn.info - B
IU M
ontpellier - - 194.214.161.15 - 05/03/2014 18h14. © Institut protestant de théologie
383
2008/3 LA CURE PSYCHANALYTIQUE
● Un mouvement du « croire »
Au cœur du processus de la cure psychanalytique, se trouve un acte decroire qui ne concerne ni des objets de croyance ni un contenu quelconque,mais l’acte qui consiste à faire crédit, à croire en la fiabilité de quelqu’un,donc à oser faire confiance. Aucun travail psychanalytique n’est possiblesans un tel acte ; c’est pourquoi Lacan, reprenant Freud, caractérise la para-noïa par l’incroyance (Unglauben), c’est-à-dire justement l’impossibilité defaire crédit, de se fier à la parole de l’autre qui sans cesse apparaît menson-gère et meurtrière 18. Freud n’évoquait nullement ici une foi religieuse, maisune foi profondément humaine dans le lien de la parole. Dans une logiquefreudienne, c’est parce que rien ne peut garantir la vérité du langage quiforme un lien entre les humains qu’il y a nécessité d’un « croire ». Il n’existeaucune position de surplomb qui éviterait d’avoir à se fier au langage et à s’yrisquer soi-même en prenant la parole à son tour. Parler suppose de croire enla fiabilité d’un langage qui toujours précède et qui constitue ce que JacquesDerrida appelle une foi en la fiabilité originaire de la parole 19. Un acte de foiest ainsi au cœur de la cure psychanalytique et il est de structure transféren-tielle. Le transfert n’est pas seulement imaginaire. Il est aussi symbolique,c’est-à-dire le lien de la parole. En sa dynamique première, le transfert est unacte de foi. Il se définit par un acte qui consiste à « faire crédit », et dont onpeut dire qu’il est une confiance dans la capacité même de faire confiance.C’est d’ailleurs, comme on sait, cette même réalité qui peut avoir été profon-dément désavouée ou meurtrie en l’être humain au point qu’il en arrive àsupposer parfois que la parole ne peut que mentir, qu’elle ne peut pas êtredigne de confiance, qu’elle ne peut que tromper. Dans les récits évangé-liques, et d’une manière comparable, ce n’est pas sans raison si Jésus com-mence son ministère par ces régions où il rencontre des femmes et deshommes qui ne peuvent plus croire. Provoquant une restauration ou une « surrection » de leur être, il leur dit : « Ta foi t’a sauvé ». Le salut résidedans la foi que chacun a pu mettre dans l’acte qui consiste à se fier à unerelation de parole.
● Une puissance de la parole
La psychanalyse, comme chacun sait, est une cure par la parole. Elle tientdans l’hypothèse que la parole a la capacité de guérir. Non pas qu’il s’agisseseulement de parler comme lorsqu’on conseille banalement à quelqu’un :
18. « Au fond de la paranoïa elle-même qui nous paraît pourtant toute animée de croyance,règne ce phénomène de l’Unglauben. Ce n’est pas le n’y pas croire, mais l’absence d’un destermes de la croyance, du terme où se désigne la division du sujet. » Jacques LACAN, SéminaireXI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse [1964], Paris, Cerf, 1973, p. 215-216.
19. Cf. Jacques DERRIDA, De l’esprit, Paris, Galilée, 1987, p. 146-152.
ETR/Jean-Daniel CAUSSE 25/08/08 11:36 Page 383
Doc
umen
t t&
eacu
te;l&
eacu
te;c
harg
&ea
cute
; dep
uis
ww
w.c
airn
.info
- B
IU M
ontp
ellie
r -
- 1
94.2
14.1
61.1
5 -
05/0
3/20
14 1
8h14
. &co
py; I
nstit
ut p
rote
stan
t de
théo
logi
e D
ocument t&
eacute;lécharg&
eacute; depuis ww
w.cairn.info - B
IU M
ontpellier - - 194.214.161.15 - 05/03/2014 18h14. © Institut protestant de théologie
JEAN-DANIEL CAUSSE ETR
384
« Tu devrais verbaliser, ça te ferait du bien ». Que la parole puisse opérer cequ’il faut appeler une guérison, un relèvement, une possibilité de redéployersa propre vie, tient à l’altérité, c’est-à-dire au fait que la parole contient tou-jours ce qui est Autre que nous-mêmes et que nous portons pourtant en nous-mêmes. Une parole vraie, une parole authentique ou, pour utiliser un termede Lacan, une « parole pleine », est une parole en acte, une parole qui, d’unecertaine manière, ne se contente pas de transmettre une information, mais quiengage et porte à conséquence. Accomplissant ce qu’elle énonce, une parolepleine implique, une fois dite, que le sujet en soit modifié. Il n’est pas ques-tion de la parole de l’analyste lui-même, mais de celle qui advient, au coursde la cure, de la bouche même de l’analysant. Cette fonction de la parolen’est pas sans rapport avec la parole créatrice de la Genèse (Dabar) : Dieu ditet la chose advient. Le psychanalyste n’est évidemment pas le maître de lapuissance de la parole ; il en est le passeur. Ainsi, la vérité de la parole ne sevérifie pas au fait qu’elle contient des choses vraies, mais en ce qu’elle a uneffet de vérité qui modifie durablement la compréhension du monde, desautres et de soi-même. Ici encore, la thématique du salut évangélique n’estpas sans faire écho à une telle logique de la parole. Le salut – le pardon parexemple – est un acte de parole. Il ne tient pas à l’énoncé lui-même, mais ausujet de l’énonciation, c’est-à-dire au fait que la parole accomplit en nous cequ’elle dit : je suis pardonné, non de savoir que je le suis, mais d’en éprouverl’effet dans ma propre existence. Je ne suis pardonné que lorsque la parolefait en moi ce qu’elle dit.
● Une grâce de la guérison
La notion de guérison fait l’objet d’un questionnement dans le champ dela psychanalyse : vise-t-on une guérison et, en amont, que signifie « guérir » ? À la différence d’un certain nombre de psychothérapies, la psy-chanalyse ne considère pas le manque qui constitue notre être comme ce dontil faudrait guérir. Autrement dit, elle suppose de ne pas confondre la satisfac-tion narcissique avec la guérison. L’élément central est le suivant : le psycha-nalyste doit reconnaître que la guérison du patient est ce qui lui échappe. Ilne sait pas vraiment quand a eu lieu ce qui peut être discerné, souvent après-coup, comme une guérison. Jean-David Nasio explique avec clarté la posi-tion du psychanalyste par rapport à l’événement de la guérison.
La question que nous nous posons tous, après la dernière poignée demain et une fois la porte refermée derrière celui qui ne sera plus notrepatient, est la suivante : Que s’est-il passé pour qu’il aille bien mainte-nant ? Quel fut le véritable agent de sa guérison ? À la fin de chaquecure, je me pose toujours cette même question sans jamais lui trouverde réponse définitive. C’est pourquoi la meilleure devise qu’un psy-chanalyste puisse se donner, résonne en écho au célèbre adage
ETR/Jean-Daniel CAUSSE 25/08/08 11:36 Page 384
Doc
umen
t t&
eacu
te;l&
eacu
te;c
harg
&ea
cute
; dep
uis
ww
w.c
airn
.info
- B
IU M
ontp
ellie
r -
- 1
94.2
14.1
61.1
5 -
05/0
3/20
14 1
8h14
. &co
py; I
nstit
ut p
rote
stan
t de
théo
logi
e D
ocument t&
eacute;lécharg&
eacute; depuis ww
w.cairn.info - B
IU M
ontpellier - - 194.214.161.15 - 05/03/2014 18h14. © Institut protestant de théologie
d’Ambroise Paré. Notre savant constatait : « Je le soigne, Dieu le gué-rit » ; je dirais : « J’écoute mon patient avec toute la force de moninconscient, et c’est l’Inconnu qui le guérit » 20.
Le psychanalyste ne cherche pas à guérir son patient. Il ne s’occupe pasde la guérison. Il ne la veut même pas. Il n’en fait pas son problème, faute dequoi il enfermerait le patient dans sa propre demande d’analyste. En effet,c’est pour répondre à la demande imaginaire de l’analyste que le patientserait conduit à « aller mieux ». L’analyste s’occupe seulement de construireune relation dans le cadre de la séance en établissant un lien entre les incons-cients. La guérison, quant à elle, est toujours ce qui advient « de surcroît »selon l’expression de Lacan 21. La guérison est un supplément, un surcroît,autrement dit, une grâce. Il n’y a de guérison que sous la forme de l’événe-ment qui advient toujours et seulement comme une grâce. Non pas qu’ellenous tombe simplement dessus. Il y a un désir, un travail, un trajet. Et, pourl’analysant évidemment, il y a un désir de guérir. Mais, en réalité, la guérisonarrive sans qu’on sache ce qui s’est vraiment passé. N’est-ce pas égalementune expérience dont le croyant témoigne, à sa manière, quand il évoque cequi s’est passé pour lui en termes de conversion et de salut ?
● Une acceptation de soi
L’acceptation de soi ou l’amour de soi-même ne doit pas être confonduavec un quelconque narcissisme, c’est-à-dire une sorte d’exaltation du moi. Ils’agit plutôt de la capacité de se dégager partiellement des idéaux, desimages de soi, bref de ce qui produit une confusion permanente entre notrevéritable identité et des identités imaginaires que nous ne cessons deconstruire et de défendre. Il faut distinguer la personne et le sujet. La notionde personne vient du latin persona qui a d’abord été le masque que lesacteurs mettaient sur leur visage pour entrer en scène et jouer la tragédie oula comédie. La personne appartient au registre de la représentation de soi.Toutefois, si chacun est une personne construite par identification, il ne s’yréduit pas. Il est également un sujet dans le sens où il n’a pas de représenta-tion adéquate de lui-même. Ni lui ni un autre que lui-même ne dispose dumot qui tomberait juste pour qualifier son être. Ici, l’amour de soi concerneun sujet et non seulement une personne. Il consiste dans le fait d’aimer ensoi-même autre chose qu’une image de soi-même. On mesure sans peine laproximité avec ce que la théologie place sous les termes de « justification par
385
2008/3 LA CURE PSYCHANALYTIQUE
20. Jean-David NASIO, « Guérir, c’est porter un regard neuf sur soi-même » in AlainHOUZIAUX, dir., La psychanalyse peut-elle guérir ?, Paris, Éditions de l’Atelier, 2005, p. 75.
21. À propos de Freud, Lacan écrit : « S’il admet donc la guérison comme bénéfice de sur-croît de la cure psychanalytique, il se garde de tout abus du désir de guérir, et ceci si habituelle-ment qu’au seul fait qu’une innovation s’y motive, il s’inquiète en son for intérieur, voire réagitau for du groupe par la question automatique à s’ériger d’un : si l’on est encore là dans la psy-chanalyse. » Jacques LACAN, » Variantes de la cure-type », Écrits, Seuil, 1966, p. 324-325.
ETR/Jean-Daniel CAUSSE 25/08/08 11:36 Page 385
Doc
umen
t t&
eacu
te;l&
eacu
te;c
harg
&ea
cute
; dep
uis
ww
w.c
airn
.info
- B
IU M
ontp
ellie
r -
- 1
94.2
14.1
61.1
5 -
05/0
3/20
14 1
8h14
. &co
py; I
nstit
ut p
rote
stan
t de
théo
logi
e D
ocument t&
eacute;lécharg&
eacute; depuis ww
w.cairn.info - B
IU M
ontpellier - - 194.214.161.15 - 05/03/2014 18h14. © Institut protestant de théologie
la foi », c’est-à-dire une reconnaissance qui n’a pas à se conquérir car elle nepeut que se recevoir. C’est le pouvoir de vivre d’une parole qui reconnaîtl’être humain à l’écart de toute logique méritoire et qui institue une légitimefierté d’être.
IV. LE SALUT CHRÉTIEN
Ces quatre éléments, brièvement évoqués, signalent une reprise ou unetraduction possible du salut chrétien en terrain profane. On ne voit pas com-ment il pourrait en être autrement, sauf à supposer un salut chrétien sans lienaucun avec ce qui trouble, fait souffrir, aliène. Il n’y a pas en l’être humainune partie isolable – une âme, par exemple – qui ferait l’objet d’un traitementparticulier du point de vue religieux. L’être humain doit être considéré dansla totalité de son être. Il n’en reste pas moins que le salut, tout en prenantplace au cœur de l’humain et du monde dans ce qui les constituent, est uneréalité spécifique. Deux remarques vont permettre d’indiquer pour finir cequi nécessiterait un développement plus important.
● Le salut du pécheur
Au cœur du christianisme se trouve l’affirmation centrale du salut commesalut du pécheur. Sauver n’est pas guérir. Sauver n’est pas un processus,mais l’acte du Dieu qui vient chercher l’être humain dans l’abîme. De cepoint de vue, il est nécessaire de réhabiliter la catégorie du péché qui ne seconfond nullement avec le registre de la faute morale, s’il est vrai, comme ledisait Kierkegaard, que le contraire du péché n’est pas la vertu, mais la foi 22.Qu’est-ce qui fait l’être pécheur ? On trouve ici un paradoxe selon lequel lepécheur est celui qui se pense juste ou, classiquement, qui veut exister grâceà lui-même. On en trouve une illustration exemplaire dans le récit de l’Évan-gile de Jean au moment où Jésus, après avoir rendu la vue à un aveugle denaissance, fait fonctionner l’aveuglement comme métaphore de l’incrédulité.Il déclare brutalement à ses adversaires que les véritables aveugles sont ceuxqui prétendent voir. Les pharisiens lui demandent : « Est-ce que, par hasard,nous serions des aveugles, nous aussi ? », ce à quoi, il répond : « Si vousétiez des aveugles, vous n’auriez pas de péché. Mais à présent vous ditesnous voyons, c’est pourquoi votre péché demeure » (Jn 9, 40-41). La défini-tion du péché est alors ici non pas l’aveuglement su, mais le refus persistantde se savoir aveugle. Jésus ne rencontre pas des humains qui voient, mais desaveugles qui croient voir et qui précisément, pour cette raison, sont aveugles.Ainsi donc, l’être pécheur ne se situe pas du côté de ce qui nous fait souffrir,de ce que nous savons être en échec, mais paradoxalement du côté de ce qui
JEAN-DANIEL CAUSSE ETR
386
22. Sœren KIERKEGAARD, La maladie à la mort (1849), Œuvres complètes, t. 16, Paris,L’Orante, 1971, p. 238.
ETR/Jean-Daniel CAUSSE 25/08/08 11:36 Page 386
Doc
umen
t t&
eacu
te;l&
eacu
te;c
harg
&ea
cute
; dep
uis
ww
w.c
airn
.info
- B
IU M
ontp
ellie
r -
- 1
94.2
14.1
61.1
5 -
05/0
3/20
14 1
8h14
. &co
py; I
nstit
ut p
rote
stan
t de
théo
logi
e D
ocument t&
eacute;lécharg&
eacute; depuis ww
w.cairn.info - B
IU M
ontpellier - - 194.214.161.15 - 05/03/2014 18h14. © Institut protestant de théologie
prétend nous faire vivre et dont nous tirons orgueil. Comme le soulignaitLuther : « La nature du péché, c’est de ne pas vouloir être péché 23. » C’est laraison pour laquelle, il pouvait ajouter que l’enjeu principal consiste à deve-nir pécheur, c’est-à-dire non pas chercher le salut par sa propre justice, maisle recevoir du Dieu qui justifie le pécheur. Le péché n’est donc pas simple-ment la mort. Il est plutôt la mort qui se fait passer pour la vie. Il consiste àêtre mort alors même qu’on pense vivre, si l’on tient que la mort n’est pas icila simple mortalité, mais une position subjective. Sur ce plan, quelque chosetranche avec la souffrance qui conduit quelqu’un à entreprendre un travailpsychanalytique. Le péché reste une catégorie proprement théologique.
● Le salut et l’éternité
En confession chrétienne, le salut arrache au pouvoir de la mort. Il offrece que le monde ne peut pas donner. Il est un salut éternel. Les théologienséprouvent une certaine difficulté avec l’idée d’un salut qui vise un au-delà desoi-même et du monde. C’est pourquoi, on a insisté sur un « ici etmaintenant » de la résurrection et sur son impact pour l’existence présente.On a mis en avant, d’une façon légitime, un salut à vivre dès maintenant. Onaurait tort cependant de renoncer à articuler le salut à un au-delà. C’est en cesens d’ailleurs que le salut peut être dit en espérance, c’est-à-dire un salut quiplace l’existence humaine sous le signe de l’inachèvement. Le salut corres-pond à ce qui reste ouvert et qui toujours maintient chacun en excès ou ensurcroît de ce qu’il peut dire ou savoir de lui-même. La catégorie de l’in-achevé est l’impossibilité de faire la somme d’une vie vécue. En l’êtrehumain, se trouve ce qui demeure soustrait à toute logique comptable ou quireste indéchiffrable. Dans l’acte de salut, c’est ainsi le mystère de l’être quise trouve sauvé. Le salut marque une résistance radicale à toute volonté deréduire l’être au seul déroulement historique de son existence. Un êtrehumain n’est réductible à rien de ce qui prête à l’identifier dans le « ici etmaintenant » de son histoire. Ce qu’il est ultimement, nul ne peut en disposerou l’enfermer dans un savoir définitif. Autrement dit, il y a en l’être humainune part imprenable, un sujet qui demeure hors prise du pouvoir deshommes. En somme, vivre du salut c’est vivre de la conviction que le « jesuis » est imprenable et que nul ne peut y accéder. Il est déclaré « caché enChrist » par l’apôtre Paul, c’est-à-dire inconnu et corrélé à l’espérance. Le « je suis » ultime et secret ne superpose pas simplement au « je suis » denotre être au monde. Il est à venir.
Jean-Daniel CAUSSE
Université Paul-Valéry - Montpellier III ; IPT, Montpellier
387
2008/3 LA CURE PSYCHANALYTIQUE
23. Martin LUTHER, Werke, Weimarer Ausgabe, t. 39/2, p. 276 (cité d’après Pierre BÜHLER,Le problème du mal et la doctrine du péché, Genève, Labor et Fides, 1976, p. 56).
ETR/Jean-Daniel CAUSSE 25/08/08 11:36 Page 387
Doc
umen
t t&
eacu
te;l&
eacu
te;c
harg
&ea
cute
; dep
uis
ww
w.c
airn
.info
- B
IU M
ontp
ellie
r -
- 1
94.2
14.1
61.1
5 -
05/0
3/20
14 1
8h14
. &co
py; I
nstit
ut p
rote
stan
t de
théo
logi
e D
ocument t&
eacute;lécharg&
eacute; depuis ww
w.cairn.info - B
IU M
ontpellier - - 194.214.161.15 - 05/03/2014 18h14. © Institut protestant de théologie