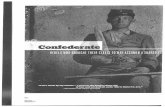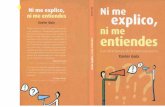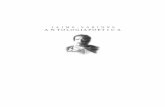Je me souviens de Liège
-
Upload
polytechnique -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Je me souviens de Liège
Je me souviens de Liège
Ma fréquentation de Liège est complémentaire de celle de Simenon, telle qu’il se remémore cette
ville dans Pedigree. [i] La cité de mon enfance n’est point Liège, mais Grenoble. Je n’avais jamais
visité Liège, avant d’être nommé dans son université au début de l’année 1970. Comme bien des
Français, ce que je connaissais de la Belgique se restreignait aux grandes villes flamandes et à leurs
musées. Puis j’ai vécu 30 ans à Liège et dans la région liégeoise, jusqu’à ma prise de retraite, à
l’automne 1999.
Je fus tout de suite séduit par l’exercice proposé. L’archétexte est ample, en effet. Il se trouve que je
rédige une chronique plus ou moins hebdomadaire à l’adresse de mes enfants, et que ce texte
comporte justement une rubrique du souvenir. De plus, je lisai il y a quelques mois la nouvelle
édition, remaniée, augmentée et corrigée du Je me souviens de Grenoble, de Jean-Pierre Andrevon.
[ii] Andrevon, un écrivain de science-fiction, fut plusieurs années durant, mon camarade de classe
au Lycée Champollion de Grenoble. Confronter mes souvenirs d’enfance avec ceux de cet exact
contemporain me fit percevoir une stratification de la mémoire.
De plus, le livre d’Andrevon est, très explicitement, dans la mouvance du précieux petit chef
d’œuvre, le Je me souviens de Georges Pérec—un autre contemporain, disparu prématurément—
qui, à sa parution, m’avait ému: sentimentalement, par les souvenirs partagés; et d’admiration
intellectuelle pour l’exploit. [iii]
L’archétexte personnel, structurant, animant et colorant ma vision de Liège, d’une ville de Liège
très actuelle mais déjà délitée par l’assaut du temps, s’estompant donc ici et là par des bribes qui, si
elles sont vivaces en mémoire, deviennent déjà du passé, font déjà partie de notre mémoire,
individuelle et collective, a au moins quatre autres points d’ancrage.
Ce sont encore des livres—des chefs d’œuvre tous. Dans ses Impressions d’un passant à Lausanne,
l’immense écrivain que fut le Vaudois de Paris, Charles-Albert Cingria, fait le portrait d’une ville,
qui donne l’impression d’avoir inventé la douceur de vivre. [iv] Dans Le voyage muet, que je
considère son chef d’oeuvre, Jacques Spitz articule une vision de l’existence, comme passage
dilettante et nonchalant, en un ouvrage comparable pour l’inspiration aux Faux Monnayeurs,
d’André Gide, mais à mon sens largement supérieur. [v] Plus récemment, un géographe français,
Armand Frémont, héritier de Vidal de la Blache et d’autres géographes qui furent des fondateurs des
sciences humaines par leurs riches monographies, André Demaison, Raoul Blanchard et quelques
autres, a réussi un Portrait de la France d’aujourd’hui, élégamment rédigé, constamment habile, et
emportant la conviction par sa ferveur amoureuse. [vi]
Enfin, pour l’ancrage historique, inévitable à considérer Liège, même dans cette topographie
urbaine mentale à laquelle Pedigree nous invite, il me faut remonter aux débuts mêmes de la
littérature de langue française. Chrétien de Troyes, en son dernier roman, Perceval ou le Conte du
Graal, écrit vers 1185 et inachevé (sans doute par la mort de l’auteur), donne cette description
d’une opulente cité médiévale, que je ne peux m’empêcher d’associer au Liège du XIIe siècle:
[vii]
« Il regarde aussi la ville, peuplée de beaux hommes et de belles femmes, et les tables des changeurs, couvertes de pièces d’or, d’argent et de menue monnaie ; il voit les places et les rues pleines de bons ouvriers qui travaillaient aux métiers les plus variés : ici on fait des heaumes et des hauberts, là des selles et des écus, ailleurs des harnachements de cuir et des éperons ; les uns fourbissent des épées, les autres tissent des draps et les foulent, les peignent et les tondent, d’autres encore fondent l’or et l’argent ; ailleurs enfin on fait de belle et riche vaisselle, coupes, hanaps, écuelles, et des émaux précieux, anneaux, ceintures et colliers. Vraiment on eût volontiers dit qu’en la ville se tenait une foire perpétuelle, tant elle regorgeait de richesses, cire, poivre, graines, et fourrures de vair et de gris, et toutes marchandises qui se peuvent imaginer. »
Mieux que l’actuelle rue du Pot d’Or, n’est-ce pas?
Mais il y a aussi un Liège plus récent, tout aussi réel, celui de la frénésie hausmannienne de
construction des années 1950, lorsque se construisirent les immeubles bourgeois du quai de Rome
ou de la rue du Parc. Ce Liège opulent, sur fond de désindustrialisation accélérée de la région, a
aussi son charme et son romanesque.
Si je situais un roman à Liège, à coup sûr y figurerait une insomnie. Notre héros est éveillé, aux
petites heures. Il entend un bruit familier—si habituel qu’il en est devenu rassurant. Un avion à
hélice survole Liège, et s’en éloigne peu à peu. Il s’agit assurément d’un chargement clandestin
d’armes à destination de l’un des points chauds de la planète, Afrique, Philippines, Amérique Latine
ou Moyen-Orient. Notre héros se rendort, rassuré: les malfrats veillent, et l’argent rentre dans les
caisses. La Wallonie peut dormir en paix—à fournir à bon prix les armes de guerre pour que
d’autres s’entretuent, dans un ailleurs tellement imprécis qu’il vaut mieux ne pas trop y penser. Cela
fatiguerait. Rendormons-nous.
Dépossession
La langue wallonne est d’origine germanique, comme le picard, un parler apparenté. Elle résiste
depuis des siècles à la pression du français, qui la contamine un peu. Ce fait de langue détermine le
caractère liégeois. Outre une mauvaise maîtrise de la langue maternelle, ce peuple, assis entre les
deux chaises de la Principauté d’Empire et de l’appartenance à la République du grand pays du Sud,
a été chercher en Sicile sa représentation symbolique: les marionnettes siciliennes, contant les
prouesses de l’empereur à la barbe fleurie (Charlemagne est né à Herstal, l’un des faubourgs actuels
de Liège), se sont augmentées de Tchantchès, le héros liégeois, rebelle par essence.
Le liégeois est en effet germanique d’aspect physique, et des traits superficiels de caractère que sont
discipline et obéissance. Mais, sous cette écorce on ne peut plus trompeuse, la réalité profonde est
celle d’un fier Latin, individualiste forcené, râleur et contestataire, volontiers anarchiste.
La fierté est le trait dominant, fierté d’être wallon, fierté d’être liégeois, d’appartenir à cette ville
unique, conçue comme le centre du monde civilisé. Liège est, à ce titre, sœur de la Vienne de
Robert Musil. Le complexe principautaire est une clé évidente du caractère liégeois, de
comportements bizarres pour un étranger et que donc l’histoire, un passé glorieux, seule vient
justifier.
Mais revenons à cette mauvaise maîtrise de la langue maternelle, bifide c’est le cas de le dire. Elle
explique bien des comportements. Selon un dicton wallon, vâl mî di s’taire qui dè mâ pârlér.
« Mieux vaut se taire qu’encourir le risque d’une parole hors de propos. » Le Liégeois est ainsi fait
qu’il admire, très sincèrement, les beaux parleurs (il s’en méfie, certes). Il a un cheveu sur la langue.
Son manque d’habileté linguistique lui pèse. Il aimerait s’exprimer en français avec élégance,
drôlerie et de manière imagée—toutes qualités qui sont celles de la langue wallonne. Mais il
intériorise sa prétendue infériorité ou infirmité linguistique d’une façon si contraignante qu’il en
devient, quasiment, muet.
A l’école ou à l’université, cela rend le wallon passif devant le personnage qui parle français, là-bas
sur la chaire, et dont il ne comprend qu’imparfaitement le langage. Il l’admire, sans trop le
comprendre. Il ne parvient pas à l’émuler. L’outil analytique de la langue ne lui a pas été donné,
dans sa famille ou à l’école primaire. Il en reste maladroit d’expression, écrite ou orale. Cette
mauvaise maîtrise du français, langue maternelle, par des jeunes dont les grands-parents parlaient
encore wallon, est l’une des principales causes d’échec des étudiants à l’université de Liège, encore
aujourd’hui.
En son temps, elle fut notée par l’observateur si scrupuleux que fut Henri Michaux, qui se sentait
invalide en français, de ce que le wallon fut sa langue maternelle. [viii]
Trésors du français de Liège
La langue française s’enrichit et se colore d’affects de la langue wallonne. Certaines tournures de
syntaxe sont révélatrices. C’est, par exemple, la position de l’adjectif. Epithète, il vient devant le
substantif—lointaine influence du latin, relayée par le germanique : Li noû pont, pour le pont neuf,
ou dè nêur fi, du noir fil. C’est aussi la préposition signalant un verbe à l’infinitif, il aime d’être
battu, ou, de même, j’ainm’reûs mi dè mori qui d’fér ine si faite, « j’aimerais mieux mourir que de
commettre un pareil forfait ».
Venons-en maintenant à quelques expressions choisies [ix]—la plupart auraient enchanté Marcel
Proust, d’oreille si fine, ou encore notre Vaudois Charles-Albert quant à celles d’évidente
provenance latine :
comme on avait bon chez vous, direz-vous à vos hôtes en les remerciant de vous avoir invité.
Généralisons: j’ai eu bon à vivre au Pays de Liège, plusieurs décennies durant.
demander après (Monsieur Simenon): où je vois un vestige d’influence germanique.
enfin: l’interjection est à Liège un tic de conversation, à rôle strictement prosodique—ou
phonologique, comme on préfère—et non sémantique. L’interlocuteur français ne doit pas se laisser
affecter par cette répétition lassante, mais dénuée de toute méchanceté.
il a bu assez: l’adverbe vient après le mot qu’il modifie dans cette construction wallonne, elle aussi
dérivée du germanique.
étuve: je me souviens d’une rue de l’Etuve, et d’un théâtre de l’Etuve, près de la Grande Poste. Et
ne puis m’empêcher de faire le rapprochement avec la signification de ce mot pour François Villon:
l’étuve, là où il faisait chaud, là où il faisait bon de se retrouver, là où on avait bon et où on prenait
son plaisir, le bain public, était le lieu de rencontre des mauvais garçons et des filles de joie, le
bordel en un mot.
faire un cumulet: c’est ce qu’en France nous appelons « faire la culbute ». Par temps sec, mes
enfants faisaient de beaux cumulets sur notre pelouse de Plainevaux.
frauder: ou le verbe définissant la notion, à vrai dire, assez particulière qu’on se fait en Belgique de
la citoyenneté. Le civisme est étranger à ce peuple, qui se pique de réalisme, et n’a donc aucun
respect pour un pouvoir politique traditionnellement faible. Frauder le fisc est, avant le football, le
cyclisme ou la colombophilie, le sport national, à l’extrême détriment des fonctionnaires, que le fisc
saigne à blanc par voie de compensation.
fréquenter: terme pudibond, périphrase pour « coucher avec », là où le français parlera
hypocritement de « relations sentimentales » et l’anglais, de même, de romantic relationship ou
involvement.
il fait cru: au sens de « il fait froid et humide ». L’expression remonte, semble t’il, à Froissart, qui
était originaire des Flandres. Je l’ai retrouvée, non sans délice, à Lausanne. Que les Vaudois et les
Wallons aient en partage des manières de parler atteste d’une très ancienne communauté, qui fut
politique tout un temps, celui de la Grande Bourgogne.
il ne peut mal: l’expression est d’autant plus savoureuse, qu’elle est ambiguë. Faut-il l’entendre
comme « il ne peut rien lui arriver de mauvais » ou comme « il renâcle, et ne le fera pas » ? La
seconde interprétation est probablement à rejeter, l’attentisme si caractéristique de la part d’un
liégeois, ayant à jouer un rôle quelconque de subordonné, ne s’explicite jamais, au grand jamais.
j’ai eu difficile à lire vos notes de cours, Monsieur le professeur: avoir (facile / difficile / bon / mal /
etc.) est une construction très révélatrice de la pensée et de l’âme wallonne. Des faits d’existence
basculent en des concepts d’acquisition et de propriété; la dynamique du vivant se coule et
s’immobilise en une statique.
je le vois toujours en rue: et de multiples autres spécifications de lieu-dit sur le même modèle, en
Neuvice, en Roture, en Outremeuse, en Vinave d’Ile, etc.
Li p’tit crollé: les crolles sont les boucles, les cheveux bouclés ou frisés. L’emprunt germanique est
évident, le mot se retrouve par exemple dans l’anglais curl.
mamé Vicou: nom d’un restaurant spécialisé en cuisine régionale. Ce surnom familier, pour une
femme plus tout-à-fait de première fraîcheur, m’a toujours ravi. En France, l’expression synonyme
(ou à peu près) « vieux con » n’a plus du tout le même sens. Si elle a conservé un peu de la
tendresse de « vi cou » (vieux cul), elle a changé de genre, et s’applique plutôt à un homme qu’on
veut insulter.
on bê ovrèdje: de la belle ouvrage ; parfois, et ç’était l’une des rares phrases que j’avais apprises en
wallon, comportant ce même verbe « œuvrer » je demandais en fin de journée à mes collaborateurs
s’ils avaient fait du bon travail ce jour-là.
se trébucher: je ne peux m’empêcher de citer ce verbe, intransitif en français mais réfléchi en
Wallonie, il fit mes délices.
un essuie: pour ce qu’en français de France nous appelons un torchon. Je crois bien que la géniale
langue wallonne, de même, fait « suer » le linge (fér souwér dès drap).
vous auriez bien facile: l’expression, qui se dit en wallon vos âriz bin ahéïe, est drue, elle me fait
penser à la chair d’une cerise bien mûre.
Gourmandises
Si les wallonismes sont un régal pour l’esprit, la langue exprime leur drue saveur, si j’ose dire. Car,
au nombre des organes des sens, la bouche est sans doute celui privilégié dans la perception de
Liège et des Liégeois. Les étrangers y viennent d’ailleurs, en soirée ou le weekend, faire bombance
dans ses restaurants.
La cuisine liégeoise, très Europe Centrale en cela, a des spécialités qui pour ne pas être fines et
délicates, n’en sont pas moins délicieuses. Ah, qui dira tout le charme séducteur des pommes
pétées! La chose paraît banale, des pommes de terre cuites au four—en robe de chambre, comme on
disait chez moi. Mais, sous leur dénomination liégeoise, elles ont comme une continuité historique;
les dégustant, en accompagnement d’une viande, nous savourons quasiment un archétype jungien.
Ces pommes pétées subissent la même préparation, je le gage, depuis le XVIIIe siècle. Me donnait
une impression similaire la soupe au cerfeuil, comme on sait si bien la faire à Liège.
M’enchante de même ce plat de légumes, rehaussé de quelques bouts de viande ou lardons, qu’on
nomme si improprement, si richement aussi salade liégeoise—et qu’on vous sert pour accompagner
de la saucisse cuite ou des côtelettes de porc.
Mes menus liégeois s’ancraient surtout dans deux ou trois spécialités, dont je raffole: les rognons à
la liégeoise, dont je suis certain que Maigret s’est régalé plus d’une fois ; cette tête de veau en
tortue, (un terme sentant sa flibuste, venu je ne sais d’où) servie le plus souvent accompagnée de
frites ; ou un steak américain, que tout Américain répudie avec indignation. A l’automne, les plats
de gibier, biche ou sanglier, ont une connotation à la fois plus aristocratique et ardennaise.
Je garde pour la bonne bouche les desserts, ces pâtisseries sœurs de celles qu’on trouve aussi (moins
bonnes) à Aix-la-Chapelle ou à Vienne, et ces deux sommets de la culture populaire, à nouveau, que
sont, d’une part la mousse au chocolat, d’autre part les poires au vin, connues sous le vocable de
cuttes peûres. Ou bien, aurais-je commandé ces bouquettes, au nom si joli, évoquant le bouquet
mais à tort, puisque d’origine flamande (boekweit, le buck-wheat anglais).
N’oublions certes pas les friandises, massepain cru ou massepain cuit, lettres farcies du temps de la
St Nicolas. La bouche à Liège s’amuse encore ou s’agace de chiques, pour désigner ce qu’en France
on dénomme des bonbons ; de pralines, pour ce qu’en Français hexagonal on appelle des chocolats.
Absences géographiques
Si le Liégeois est un infirme qui s’ignore, côté langue, la ville de Liège pourrait se définir, en une
première approche, par ce qu’elle n’est pas. Me frappe à cet égard la non-inscription dans un terroir.
Les campagnes avoisinantes ne se sont pas données Liège comme leur métropole, elles gravitent
autour de bourgades qui pour être proches de la capitale de la Wallonnie n’en ont pas moins
conservé une bonne individualité: Tilff, Esneux, Spa, Huy, Visé, etc. Cela se constate, par exemple,
à l’absence de marchés hebdomadaires, où des fermiers des régions avoisinantes apporteraient leurs
primeurs.
De même, je fus frappé, à mon arrivée à Liège, par l’absence de banlieue à la française. L’influence
britannique et/ou américaine domine, avec un suburban living à base de villas et bungalows sur
pelouses manicurés. Cela commence dans les banlieux chics, comme Embourg ou la montée du
Sart-Tilman. Point de grands ensembles, sauf quelques tours à Droixhe, un quartier de Liège dont le
cinéma «Le Parc», cette oasis, fit un haut-lieu de la culture locale, aussi important que la maison de
la culture «Les Chiroux».
Autre singularité liégeoise: en dépit de l’existence de ces grandes classiques du cyclisme que sont
La Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, cette dernière n’est pas une ville du vélo—si elle l’a
jamais été. Alors que la campagne sur le pourtour, celle du Condroz par exemple, est infestée les
weekends de petites motos vrombissantes, du modèle servant au moto-cross, Liège est une ville
sans bicyclettes. Cela est dû, je le conjecture, à sa géographie, enclavée que fut la cité vers l’ouest
par d’abruptes falaises formant remparts, raides à gravir pour le cycliste; que d’incessants crachins à
longueur d’année auront pu commencer de décourager.
Traversée de Liège
Liège se pense volontiers ville-sœur, ou ville-compagne de Paris: non seulement par la langue, mais
par l’animation, par l’esprit du lieu, et par vanité, tout bonnement. Néanmoins, je peux abonder en
ce sens. La démonstration en est presque mathématique. Tout un chacun peut aisément en faire
l’expérience. Il s’agit d’un parcours des deux villes en autobus, mais pas n’importe lesquels.
Je propose ainsi un parallèle entre le 63 à Paris et le 48 à Liège. Vous êtes prêts? Embarquons dans
le 63, à son terminus de la Gare de Lyon. Son trajet est ample, il ceinture la Ville, courant parallèle à
la Seine. Avec ses points de départ et d’arrivée sur la rive droite, l’autobus numéro 63 balade sa
cargaison de passagers, qui en deviennent autant de touristes, pour l’essentiel au travers de la Rive
Gauche. Il traverse le Quartier Latin d’est en ouest, longe Saint Sulpice, et poursuit son périple le
long du boulevard Saint-Germain, puis de la Seine. Parvenu à la tour Eiffel, il franchit le fleuve au
Quai de l’Alma, et amorce l’ascension de la colline du Trocadéro. Parvenu devant les musées qui
s’y trouvent, il poursuit jusqu’à son terminus de la Muette.
Ainsi, l’autobus numéro 63 donne à voir Paris, non dans sa dimension laborieuse ou prolétarienne,
mais, à l’instar du discours que Giraudoux place dans l’un de ses livres, du haut de la Tour Eiffel,
envisagé comme panorama de ce haut lieu de la pensée et de la civilisation. L’autobus numéro 63
parcourt ce cortex cérébral où se conçoivent cours et séminaires, traités savants et romans,
périodiques et beaux livres; il effleure l’iconothèque des galeries d’art de la rue de Seine et de la rue
Bonaparte; il traverse le quartier Saint Germain- des-Près de part en part. Son cours y est parallèle à
celui de la rue de l’Université, l’une des plus belles de Paris, un parcours imposé pour tout piéton de
Paris. Enfin, l’autobus 63 accède aux beaux quartiers, donnant l’illusion à celui de ses passagers,
venu en simple dilettante, que son itinéraire est celui même du parcours de l’existence, avec cette
promesse implicite d’une vie dans un bel appartement de luxe, au calme, dominant Paris et avec
cette vue imprenable que les agents immobiliers vous chiffrent à 0,1 % près.
A Liège, ma nostalgie parisienne se confortait volontiers d’un parcours de 48. L’autobus numéro 48
joint le centre de Liège au Sart-Tilman. Ses points de départ et d’arrivée se trouvent dans de la
matière grise: le complexe abritant la bibliothèque universitaire qui jouxte le Rectorat et les bureaux
administratifs de la place du XX Août, au voisinage de la grand-poste; et les bâtiments du
«nouveau» domaine universitaire, sur la hauteur entre Meuse et Ourthe, sur ce promontoire du
plateau du Condroz, dominant au sud la cuvette où gît la ville de Liège.
L’autobus numéro 48 charge surtout des étudiants, et l’atmosphère en est potache plus que patache:
faites un voyage en 48, tendez l’oreille un tant soit peu, vous saurez ceux des professeurs
d’université chahutés, vous connaîtrez aussi les noms de ceux qui sont exigeants aux examens et qui
osent coller leurs étudiants (les moffleurs), et vous découvrirez combien les étudiants, contrairement
à ce qu’on imagine trop volontiers, sont obsédés par leurs études, bien davantage que par l’alcool
(la guindaille), le sexe ou les vacances à l’étranger.
La circulation du 48 se fait via la place de la République Française, puis à contre-flot du boulevard
de la Sauvenière—le nom d’un ancien bras de la Meuse. Laissant à tribord le pittoresque quartier
Saint-Gilles, puis le lycée Léonie de Waha et d’autres établissements d’enseignement secondaire ou
supérieur (dont une école d’arts graphiques réputée), laissant à babord le terre-plein sur lequel se
tient au mois d’octobre, plusieurs semaines durant, la foire, avec ses stands de vendeurs de
laquemants (ou laekmans), ceux de tir à la carabine, ses maisons fantômes et ses autos-
tamponneuses, ses manèges anciens ou dernier jeu, la grande roue dominant tout ce clinquant
spectacle, l’autobus numéro 48 parvient enfin à l’orée de la rue des Guillemins.
Il la remonte jusqu’à la gare, cette pauvre gare deux fois victime: d’émeutes insurrectionnelles des
années 1950, lorsque l’ancienne gare fut incendiée; puis la gare des Guillemins construite, telle que
je l’ai connue de 1970 à 2000. Elle fut victime à nouveau, sous prétexte du passage par Liège, de la
ligne de TGV reliant Bruxelles à Cologne, de la cupidité des politiques, des entrepreneurs et des
promoteurs immobiliers, flairant un Pactole dans l’édification d’une nouvelle gare et de ses annexes.
Cette dernière, de Santiago Calatreva, est une merveille architecturale, une splendide œuvre d’art.
Après la gare des Guillemins, l’autobus 48 vous donnait rue Varin la vue d’une exquise série de
miniatures, ou d’une bande dessinée dont chacune des images était un émerveillement. Ces Très
Riches Heures étaient, je me suis laissé dire, de Très Coûteuses Heures, ces allumeuses peu
habillées, tentatrices par toutes les ressources de la lingerie, facturaient cher leurs services qui,
parait-il, se limitaient à des boissons.
Survenait alors encore une autre avenue bordée, comme l’avait été le boulevard, d’immeubles
bourgeois cossus, et l’on parvenait à l’équivalent liégeois de ce qu’est le Champ de Mars pour
l’autobus numéro 63 de la Régie Autonome des Transports Parisiens (un sigle à quatre lettres
comme celui de l’entreprise liégeoise de transports urbains et suburbains, la STIL, est-ce un
hasard ?). On accédait à cette merveille, le Pont de Fragnée. Double merveille, à présent que la
traversée de ce pont donne à admirer du grand art d’ingénieur, novateur et audacieux, un pont
suspendu, celui d’une autoroute traversant la Meuse en direction des Ardennes, parallèle à une voix
ferrée enjambant aussi le fleuve à cet endroit.
Frère du Pont Alexandre III à Paris, le pont de Fragnée est un ressuscité, reconstitué qu’il fut à
l’identique après sa destruction durant la Seconde Guerre Mondiale, sous l’effet cumulé de
l’offensive allemande à grands coups d’engins volants, des V1, et des bombardements par l’aviation
alliée.
Passager du 48: recueille-toi, c’est le lieu: le pont de Fragnée est l’équivalent, pour la ville de Liège
tout entière, d’un monument aux morts. Passager du 48, médite la leçon muette de ce pont et de ses
ornements somptueux: la guerre est maudite, elle enrichit les marchands de canons locaux mais elle
décime la population civile. La guerre est bénie, la Wallonie en vit, les fabriques d’armes font son
gagne-pain depuis le Moyen-Âge.
La ville de Liège en a connu tant, de ces hécatombes. C’est une ville martyre. En 882, les Vikings la
saccagèrent. En 1212, Henri, duc de Brabant, prit et pilla Liège. En 1408, le duc Jean de Bourgogne
à son tour s’attaque à Liège. Il prit la ville, après avoir tué le gros de sa population, 25.000 Liégeois.
En 1468, Charles le Téméraire s’en empara à son tour, et la livra à ses soudards ; puis il força Louis
XI à venir voir le résultat—histoire de convaincre le roi de France de sa faiblesse impuissante, à
venir en aide à ses alliés liégeois. La France se vengea, tardivement, de cette avanie. Après maintes
invasions et prises de la ville de Liège aux XVIIe et XVIIIe siècle, elle l’annexa, et en fit de 1794 à
1814 le chef-lieu du département de l’Ourthe. Et les malheurs de la guerre frappèrent à nouveau très
durement la ville de Liège durant les deux guerres mondiales du XXe siècle. Mais la fabrication
d’armes reprit de plus belle …
Le pont de Fragnée et ses sculptures font oublier par leur angélisme ces désastres à répétition. Puis,
passant sous la voie ferrée en direction de Visé-Maastricht et de Verviers-Aix la Chapelle, le 48
entre dans Angleur, laissant sur sa droite la rue Rénory et sur sa gauche la mairie, un ancien
château. N’ayant qu’écorné la commune d’Angleur, le trajet de l’autobus numéro 48 aborde
maintenant la route du Condroz.
Au début de cette montée, point trop rude encore, le passager de l’autobus saluera au passage la
statut du « Génie de la route », représentant, comme il se doit, Hermès, dieu des voyageurs. Cette
sculpture m’a toujours ému. Lorsqu’un conducteur de camion ayant raté son virage la détruisit, dans
les années 1980 je crois, j’intervins afin qu’on réinstalla un double, ce qui fut fait.
Tournant vers la droite, la route augmente encore sa déclivité et l’autobus numéro 48 se hisse,
poussivement, entre les opulentes villas bordant cette montée du Sart-Tilman. Ce quartier est un peu
le pendant pour le 48 du XVIe arrondissement à Paris, pour le 63.
Parvenu à ce village du Sart-Tilman, l’autobus pénètre dans le campus, où il trouvera enfin son
terminus. C’est un domaine universitaire, parmi les plus beaux au monde. Combien de fois me suis-
je pris à rêver de ce que le site, les bâtiments, certains magnifiques, s’assortissent de travailleurs
intellectuels assidus, enthousiastes, travaillant jour et nuit, comme dans les grandes universités
américaines. Ce serait dès lors l’une des plus belles universités du monde.
Liège-sur-Méditerranée
L’Europe Occidentale les a t’elle hérités de la Route de la Soie ? De bazars orientaux ? De souks
persans ou maghrébins ? Je veux parler de certains marchés en plein air. Ils sont un facteur partout
indispensable à une bonne économie urbaine: recycler ce qui fut mal acquis, héritage encombrant
dont on veut se défaire, don non désiré, ou encore produits si divers du vol à la tire, de
cambriolages, rapines ou hold-ups. Il s’agit du « marché des voleurs », comme on le surnomme un
peu partout, de l’ile des musées à Berlin au marché aux puces de la Porte de Clignancourt, à Paris.
A Liège, c’est une véritable et très vénérable institution. Depuis des siècles, depuis le Moyen-Age
peut-être, le marché de la Batte a lieu le dimanche matin. Il tient son nom de son emplacement, le
quai de la Batte. Je ne serais pas surpris qu’il existât déjà, au même endroit, à la grande époque des
foires de Troyes, en Champagne, ou de celles de la Baucroissant, en Dauphiné. Mais il ne faudrait
pas le confondre avec une kermesse flamande, telle que Pieter Brueghel les représenta ou, plus près
de nous ce classique du cinéma français, « La kermesse héroïque ».
La Batte est une rue pavée longeant la Meuse, rive gauche, sur quelques centaines de mètres
seulement. L’ambiance y est indubitablement portuaire. Qu’est-ce qui fait ça? Ç’est Nyhavn à
Copenhague, le canal du Nord à Paris, un quai d’Helsinki où les habitants lavent leurs tapis à
grande eau, ou la Dogana à Venise—en modèle réduit. Un archéologue ou un urbaniste dirait mieux
que moi les indices d’un actif passé de navigation. Anneaux d’amarrage au bord de l’eau; entrepôts
qui se trouvaient à proximité, antan; bars à matelots… La Batte exhale les souvenirs de l’ancienne
halte de bateliers qu’elle fut, il n’y a pas si longtemps. Des bateliers frayant avec les bateleurs.
Car tout un caravansérail s’y installe, tôt les dimanches matins. Le marché s’ouvre vers les 8 h,
comme on dit à Liège, il se poursuit jusqu’en début d’après-midi, vers 14 h. Il connaît sa
fréquentation maximum vers 10-11 h du matin, lorsqu’une foule dense s’y presse. Si dense qu’elle
piétine sans plus avancer. Outre des liégeois, venus de tout le Grand Liège, ce sont des ardennais,
des verviétois, des condruziens. Ce sont aussi des voisins d’outre-frontière, linguistique ou
politique, des limbourgeois et des rhénans. Ces derniers viennent déguster des relans de latinité. Ils
sont friands aussi du repas fin qui s’ensuivra dans un restaurant de Liège.
La Batte est, aurais-je oublié de le signaler car la précision est d’importance, un marché à ciel
ouvert; un marché de forains; et un marché polyvalent. On y trouve de tout. Cela va du préservatif à
l’arquebuse, du poulet à une radio modèle 1930, de la vaisselle à des jeans. S’y côtoient, sans
structure apparente, étals de fruits et légumes; orateurs de l’Armée du Salut ou missionnaires
mormons; fromagers; un Tunisien proposant de délectables olives et un attirail d’épices; des
éventaires avec des uniformes militaires, voire des insignes nazis, pour les collectionneurs ou pire,
pour de détestables cinglés; cages d’animaux vivants, du poussin au lapin, et du chiot au ouistiti;
guinguettes de fritures; quelques bouquinistes; et de très nombreux brocanteurs.
Le temps d’une matinée, Liège exhibe ainsi son bas-ventre, son essence intime un peu surprenante
dans une ville d’Europe du Nord. C’est sa fibre méditerranéenne. On la retrouve ailleurs. Certains
quartiers, du côté par exemple de la montée de Buren, vous ont des airs de casbah. La Batte vous le
rappelle avec ostentation, une fraction significative de la population liégeoise est exogène, et vient
de lointains pays du Sud : un sous-prolétariat d’africains, italiens, portugais, yougoslaves,
maghrébins ou turcs.
Liège la bourgeoise
Les nantis, ç’est-à-dire les bien-nés. Liège s’enorgueillit de ses racines populaires, mais la
bourgeoisie y est reine. Cela se perçoit à mille signes, les banques d’affaires, les anciens hôtels
particuliers, le public des concerts du Conservatoire, les restaurants chics et à la mode, les coiffeurs
et les tailleurs, les antiquaires et les magasins vendant des fourrures, les patisseries snobs et leur
clientèle de dames prenant le thé… Cette bourgeoisie, très XVIIIe siècle, fait toujours éduquer ses
enfants chez les Jésuites, et s’habille à la Britannique, les hommes surtout afin de se démarquer de
manière bien visible, de la petite bourgeoisie surtout, et de son uniforme à base de manteau de
loden. Cette bonne société liégeoise, dont l’endogamie est le mode de reproduction préféré, copie
conforme du Paris 1925, a ses clubs, tels que l’Automobile Club ou le Golf du Sart-Tilman, ses
toilettes, on l’a déjà dit, ses voitures de luxe, le tennis comme sport privilégié, et se donne un profil
très discret. La plupart de ses réunions se tiennent dans des salons affectés à ces fonctions, pérennes
puisqu’ils datent souvent de l’époque de Marcel Proust, la Société d’Émulation par exemple. Les
weekends au littoral, à Knokke entre autres, ceux dans une résidence secondaire en Ardenne, les
vacances plus longues dans telle station de ski des Alpes ou telle villégiature de la Riviéra,
permettent aussi de se retrouver entre gens du même milieu. La voiture et le chien font partie de
l’habillement, l’une non ostentatoire (d’où la vogue des Mercédès), et l’autre compensatoire et donc
plutôt de lignées peu usitées, retriever doré par exemple.
On est volontiers franc-maçon dans les milieux liégeois de nantis. Et on affectionne l’appartenance
à tout réseau influent, redevable autrefois de l’Evéché ou de la Loge, aujourd’hui du Rotary et du
Lions, ainsi que de ces multiples sociétés dont l’objectif avoué est la réindustrialisation de la
Wallonie, mais dont la vraie fonction est le rassemblement de notables.
Qui sont ces derniers? Les héritiers des grosses fortunes d’antan, foncières ou industrielles; une
bourgeoisie d’affaires, banques et assurances ; des professions libérales, avocats, médecins,
chirurgiens, dentistes, … ; des commerçants aisés; et des professeurs d’université.
Ceux-ci, qu’on ne trouve le plus souvent qu’en uniforme, le costume trois-pièces gris, ont en charge
un rôle social précis, la reproduction à l’identique. Nommés dans leurs fonctions après une
procédure, souterraine pour l’essentielle, et dont des composantes majeures sont d’exclure les
candidatures hors-Principauté, et le népotisme, leur réputation leur vient de leur seule aptitude
« à bien donner cours. » Y participe, pour une part essentielle, leur comportement lors de la
cérémonie rituelle, deux fois l’an, des examens. Les impétrants s’y présentent, en beau costume et
bien coiffés, et, satisfaisant au même fétichisme d’un langage aisé et châtié, débobinent pour le
Maître ses propres discours, sténographiés en un recueil polycopié, qu’ils ont appris par cœur sans
trop s’attacher à en tirer, pour eux-même une heuristique ou d’autres outils de pensée.
D’autre part, les stratégies familiales en matière matrimoniale visent davantage une endogamie
élargie à l’ensemble de la Belgique francophone, un si petit pays, que restreinte à quelques
douzaines de familles liégeoises. Car l’élite de la jeune génération liégeoise ne se retrouve pas, ou
très peu, sur les bancs de l’université de Liège. Les nantis de la Province, pénétrés qu’ils sont de
patrimoine, y compris en matière intellectuelle, expédient plus volontiers leurs rejetons étudier à
Louvain. L’université catholique est l’une des plus anciennes au monde, elle est connue dans le
monde entier. Celle de Liège est plus confidentielle.
Carte postale
L’esprit du lieu liégeois est, j’en suis convaincu, la courbure de la Meuse, du fleuve qui traverse et
découpe la ville, déterminant ce faisant des caractères fondamentaux de l’agglomération. Un point
idéal pour s’en convaincre, pour admirer aussi un très beau paysage urbain, est le monument à
Zénobe Gramme, qui se trouve à l’entrée sud du Pont de Fragnée. Mettez-vous là, et regardez en
direction du centre de la ville. Vous voyez, par delà l’héliport faisant face sur la rive gauche au
Palais des Congrès, le complexe architectural de l’Evéché; vous apercevez, par derrière, un grand
immeuble, la Tour Kennedy; et puis, sur une lointaine colline dominant la ville et où se trouvait
anciennement le gros des fortifications, l’hôpital de la Citadelle.
Devant vous, à main droite, l’Ourthe venant se joindre à la Meuse, mais canalisée, en un ultime
effort des ingénieurs pour prévenir leur réunion, en ce qu’on appelle la Dérivation. Et à main
gauche, droit devant vous, la Meuse pousse son flot lent et puissant en une courbe admirable par son
ampleur.
Il n’y a là, d’ailleurs, que la continuation de son comportement antérieur. Depuis Namur, la vallée
de la Meuse s’est creusée, non pas rectiligne, mais en de grandes ondulations butant sur d’abruptes
falaises calcaires. Les sites urbains, celui de Namur, celui de Huy, celui de Liège, se sont installés
au long de ce superbe couloir naturel de communication.
Cette voie navigable a dû être l’une des splendeurs d’Europe jusqu’au XVIIIe siècle inclus. On en
retrouve assez facilement l’idée, à cheminer le long de la Meuse, surtout en amont de Huy. En aval,
l’industrialisation a fait des ravages, a fait du beau fleuve le drain utilitaire d’un paysage souvent
sinistre, sinon sinistré, qu’il s’agisse de la première industrialisation par John Cockerill à Seraing au
XIXe siècle, ou de réalisations plus tardives, du XXe siècle, centrale nucléaire de Tihange ou,
toujours à Seraing, une usine de liquéfaction d’air pour fabriquer l’oxygène liquide utilisé dans les
aciéries.
La Meuse y a perdu sa splendide unité. Le visiteur, venant à passer par Liège, reconstruit en
imagination son ancienne homogénéité. Les liégeois font de même, la Meuse est pour eux un
imaginaire, davantage encore qu’une réalité vécue—celle d’un fleuve à parcourir sur un esquif, se
poussant vigoureusement à l’aviron, ou à survoler en canot à moteur, voire en ski nautique, ou
encore le long duquel se promener, comme sur les berges de la Seine. Cette réalité d’un fleuve
urbain—j’aurais pu citer aussi le Rhin à Bâle—est compromise à Liège. Elle est présente, mais non
évidente.
Néanmoins, elle obsède. C’est ainsi que je m’explique ce désastre urbanistique dont le principal
coupable fut Jean Lejeune, échevin aux travaux publics dans les années 1960 et 1970. Sur le modèle
de la traversée de l’agglomération par la Meuse, il organisa des flux automobiles et quasi
autoroutiers le long du fleuve. Or, la leçon constante, celle d’actions comparables mais très
largement antérieures, comme celle de Robert Moses à New York, est que la circulation automobile
doit éviter la ville. Lorsqu’on facilite la pénétration urbaine par le trafic automobile, le seul résultat
est un rapide engorgement. Il appelle l’agrandissement des artères bouchées—ce qui présage un
bouchonnement plus grave encore. Bref, l’action de Jean Lejeune fut redoutablement efficace,
certains quartiers de Liège y ont perdu leur âme, et ne sont plus que des friches autoroutières de part
et d’autre d’une voie, en principe rapide et souvent, en fait, embouteillée.
Une charpie
Du point de vue de l’urbaniste, la ville de Liège est morcelée en des unités disjointes, et cela fait
peine à voir. Jusqu’au XIXe siècle, cette ville d’Eglise était un ensemble architectural très
homogène, formé d’une vingtaine de quartiers au moins, chacun à l’ombre tutélaire d’un clocher
d’église. En notre époque de déchristianisation, la toponymie est à peu près la dernière relique de ce
passé : Ste Véronique, St Luc, St Jacques, St Paul, Ste Rosalie, St Barthelémy, St Léonard, Ste
Marie, Ste Barbe, St Lambert, St Gilles, St Christophe, et j’en passe.
La dépossession des vastes domaines des abbayes—celle de St Laurent, à l’écart de la ville,
rachetée par un promoteur, permit dans les années 1960 au Recteur Dubuisson d’installer
l’Université au Sart-Tilman—amorça un premier morcellement, au XIXe siècle. Le XXe siècle,
surtout durant sa seconde partie, détruisit une bonne part de ce qui restait du tissu urbain, dans sa
texture utile plutôt que foncière, celle des rapports humains.
Les deux facteurs principaux de destruction ne furent pas la Seconde Guerre Mondiale, en dépit des
destructions que subit alors Liège vers la fin de celle-ci. Ils furent le cablage, et l’enfermement
subséquent des habitants devant leur poste de télévision; et la transformation de lieux publics en
voies de passage pour l’automobile, cette dernière venant se substituer, comme objet de culte, aux
statues de saints dans les églises de quartier, et renforçant de la sorte l’individualisme aux dépens du
collectif.
Pour le ressentir, il suffit à notre promeneur de se trouver dans la grand-rue d’un faubourg liégeois,
celle de Rocourt ou bien l’une des deux ou trois qu’avait Angleur, la rue Rénory par exemple.
Anciennement, de telles rues étaient typiques de l’urbanisme fin XIXe: des quartiers ouvriers, faits
de maisonnettes adossées à des jardinets, alignées le long d’un axe de circulation, conçu
essentiellement pour des piétons, pour des cyclistes à la rigueur.
Avant la construction de l’autoroute Bruxelles-Liège, achevée dans les années 1970, la route
Bruxelles-Liège égrenait ainsi un chapelet de tels villages-rues, comme on en trouve aussi à foison
dans le nord de la France. Dans cet urbanisme du village-rue, cette dernière servait de place
publique. C’était un lieu de réunion, de parlotes et donc de circulation de l’information, de
rencontres des personnes âgées, un espace de jeu pour les enfants et de bavardages entre leurs
mères, bref d’échanges sociaux. Comme ce que Jane Jacobs décrivit à New York ou Toronto.
Le Grand Liège abondait en de telles rues, qui n’étaient pas absentes non plus de la ville de Liège.
La rue St Gilles ou Longdoz en sont des exemples. A l’évidence, il aurait fallu boucler la plupart
des quartiers, riches d’un tel urbanisme, et en faire le pendant moderne des anciens béguinages
(c’est un peu le parti qui fut pris dans les villes-sœurs, Maastricht ou Aix-la-Chapelle, où l’on peut
voir ce que Liège aurait pu devenir). Liège offrait deux ou trois douzaines de telles possibilités.
Au lieu de cela, on a laissé se commettre un massacre. L’automobile a tué tous ces quartiers, toute
possibilité de vie associative, toute solidarité communautaire. Même sous l’aspect capitaliste de la
plus-value immobilière, de celui des agences et des promoteurs, c’est un désastre. La désertification
des espaces publics en fut la conséquence.
Là-dessus, telle ou telle initiative discutable, de la part d’un promoteur et du conseil communal, est
un épiphénomène. Certes, les quelques tours disproportionnées avec le site, la Cité administrative,
l’immeuble Kennedy, le Simenon (dont le nom est une véritable insulte à l’écrivain populaire),
déparent le paysage, mais ne viennent pas le stériliser au sol, comme le trafic automobile le fit.
Si j’avais à faire un film de fiction situé à Liège, ce serait une féerie rétro. Je montrerais un quartier
populaire, Outremeuse ou St Gilles, et l’âpre beauté de la vie ouvrière qui s’y déroulait, vers 1930
pour fixer les idées, les durs affrontements avec le patronat, la xénophobie à l’encontre des
Flamands, des Italiens ou des Polonais, les conformismes pesants; mais aussi les messianismes,
politiques et syndicaux ; et tout un réseau de solidarité interindividuelle.
Si le peuple liégeois est exilé de sa ville, par cette transformation des lieux publics en friches et axes
de circulation, il s’est néanmoins trouvé d’autres lieux de réunion. L’un des points de
rassemblement du petit peuple liégeois, des ouvriers de Seraing et d’autres lieux de la ceinture
prolétarienne de la Cité Ardente, est le stade du Standard à Sclessin. Leur cause est bicolore, le
rouge du cœur, du sang et du socialisme—un socialisme de clientèle avec des élus parfois
corrompus, en tout cas rompus à la négociation et au compromis de dernière minute, à la belge—se
mâtine de blanc, afin de bien signifier l’appartenance liégeoise, par cette double dénégation: ni
adhésion à un populisme marxiste engagé et militant, ni celle au parti blanc d’une aristocratie
catholique, encore puissante, mais symbolique d’un passé rejeté.
Les matchs du Standard s’observent debout, en un rituel qui pour être d’origine ecclésiale, émeut,
dans cette partie du stade affectée à la foule. L’ambiance y est fraternelle, et machiste. J’imagine les
stades de football, à Glasgow ou à Belfast, sur le même modèle vibrant, de buveurs de bière venus
là célèbrer un simulacre de guerre civile, insultant violemment le camp opposé—surtout s’il est
flamand, s’il s’agit par exemple du FC Bruges.
Combien je comprends Simenon ! Tout son œuvre exalte les petits et leur qualité de vie :
indubitablement, son populisme est enraciné dans son enfance liégeoise, dans ce rejet instinctif de
la bourgeoisie et de son paternalisme oppressif.
Le promeneur pressé
Je garais ma voiture habituellement dans le parking de l’héliport. Ce n’était point tant goût du
risque, on disait que des voleurs y sévissaient, que plaisir du site, et de la déambulation qui
s’ensuivait.
Plaisir du site: il était voisin de l’hotel particulier où le Baron Graindorge avait sa magnifique
collection d’art contemporain, que j’avais eu plusieurs fois le privilège de voir ; et ce personnage
modeste et attachant, friand de Tristan Tzara, avait coutume de fastueusement régaler ensuite ses
invités au restaurant de l’héliport.
Plaisir de la promenade: le boulevard Frère Orban est agrémenté en effet d’une allée ombragée de
beaux arbres. Elle me conduisait, après la traversée du boulevard Piercot—où je me retrouvai
souvent, en soirée, pour les concerts du Conservatoire dirigés par l’excellent Pierre Bartholomée—,
face au vaste quadrilatère occupé par les bâtiments de l’Evéché. Je prenais la ruelle le longeant sur
sa gauche, et me retrouvais ainsi au voisinage immédiat de la rue des Clarisses, en face de la place
St Jacques, autre endroit où, de temps à autre, je mettai ma Triumph.
Je pouvais alors prendre à droite et arpenter la rue des Clarisses jusqu’aux Chiroux, passant devant
l’Athénée Liège 1 sans y entrer. J’étais sans doute en manque, de mon habituelle tasse de café du
milieu de la matinée. J’allais la prendre au « Cappuccino » comme se dénomme, si ma mémoire ne
m’abuse, une très agréable encoignure de l’immeuble abritant la Maison de la culture. Ma
gourmandise s’y récompensait d’un verre de jus de cerise, en prélude, et du spéculoos ou de la
praline offerts avec la tasse de café.
S’ j’avais à faire au bâtiment central de l’Université, place du XX Août, je n’avais plus qu’à la
rejoindre, au bout de la rue, après une petite halte à la librairie Halbart, pour un contact sensuel et
intellectuel avec les livres récemment arrivés.
Mais je pouvais aussi avoir évité la rue des Clarisses, et pris plutôt par la rue St Paul, fort d’un
prétexte pour un crochet par la papeterie IPL (Imprimerie Papéterie Liégeoise), lieu baudelairien («
luxe, calme et volupté »), ou que la fantaisie du promeneur m’ait voué à ce lieu, pour moi magique
de la ville de Liège, cette rue tranquille, à distance de toute agitation, discrète, imprégnée d’un sens
de l’écart, la rue St Paul. Le Consulat de France s’y est installé. Je me réjouissais intérieurement de
ce que la représentation de mon pays se soit donné une si belle adresse, au 1 rue St Paul.
Je parvenais ainsi aux abords de la Cathédrale. Je n’y pénétrai que rarement. L’édifice à l’intérieur
était décevant. M’avait surtout rebuté une séance solennelle, un Te Deum rassemblant les corps
constitués, en cortège et en costumes, où la vulgarité des élus ayant préseance—qu’on ne s’y
trompe pas, j’applaudis au principe—sur les autres personnalités, dont les universitaires en queue de
protocole, faisait un spectacle à mon sens consternant.
Mais cette église servait de plaque tournante. Piéton dans Liège, je pouvais dès lors rejoindre
l’Université par la rue Charles Magnette, pour moi familière par l’agence de voyages Parfait—un
nom qui ne s’invente pas—et la si chaleureuse personnalité de Madame Cœurderoi (autre joli nom),
affectée à mes billets de train et d’avion. Un passage couvert achevait de rendre cette rue plaisante,
offrant un petit nombre de commerces de luxe, lingerie, beaux disques de musique classique, le
photographe Hubert Grooteclaes, l’encadreur à la rime, Claes, ayant essaimé à partir de son atelier
de la rue Jean d’Outremeuse—bref du lèche-vitrines de haut de gamme.
Autre possibilité, une fois rendu place Cathédrale, pousser jusqu’au Théâtre, et, ce faisant, pénétrer
le réduit piétonnier. Me laisser tenter, peut-être par une halte-café ou -eau minérale dans l’un des
établissements de l’endroit; assurément, par la traversée, soit de Pont d’Ile—réminiscence du plan
de Liège au XIe ou au XIIe siècle, lorsque le lit principal de la Meuse présentait l’énorme hernie de
la Sauvenière—soit de l’exquis et délicat Passage Lemonnier, un somptueux passage couvert,
réplique d’endroits plus illustres, tels que le Passage Pommeraye à Nantes, celui des Panoramas à
Paris, ou Burlington Arcade à Londres.
Le Passage Lemonnier montrait à mon imagination ses trois poles majeurs d’attraction que
formaient, à ses deux extrémités, d’une part un magasin de somptueux sous-vêtements, pyjamas,
chemises et cravates masculines—un Arnys liégeois, en quelque sorte; d’autre part, un magasin,
tout aussi luxueux, de stylographes; tandis que le centre de cette galerie marchande abritait la
Brasserie de la Renaissance et ses choucroutes garnies, des plus traditionnelles. Si j’avais eu l’heur
d’un entretien avec M. Georges Sim, c’est là, à la Renaissance, que je lui aurais suggéré de nous
rencontrer: «Mais si, Monsieur Simenon», me promettais-je d’insister, le taquinant de la sorte pour
son surnom.
Un tel trajet me rapprochait des petits plaisirs d’emplettes, qu’il s’agissât du siège de la Société
Générale de Banque, de courses dans l’un des deux grands magasins, le Grand Bazar ou le Bon
Marché, ou, tout bonnement, de passer m’acheter Le Monde chez Bellens, rue de la Régence.
De la place de la République française, je faisai parfois un crochet jusqu’au magnifique Musée de la
vie wallonne, ne manquant pas d’aller m’infiltrer au passage dans l’une des salles d’audience, au
sein du Palais des Princes-Evêques, aux figures inspirées, disent certains, de l’Eloge de la folie. Je
m’étonnai, traversant la place du Marché, de la relative modestie de l’Hotel du Ville, vis-à-vis de
nombreux autres bâtiments publics ou privés. Et, me pénétrant de la charge émotionnelle qu’a dans
l’imaginaire collectif liégeois, le monument central, dénommé le Perron, emblème des libertés
communales, je me donnai un bain d’histoire, à base de sac de Liège et de vaillants Franchimontois.
Ou j’allai plus loin, soit pour récupérer mon «ramasse-minettes», comme Michel Zink le qualifia, en
son garage Imperia-Standard du quai St Léonard, spécialisé dans les voitures britanniques; soit que,
plus ou moins consciemment, je m’étais mis en quête, une fois de plus, de cette évanescente, de
cette insaisissable « âme liégoise ».
Je ne l’ai jamais trouvée. Et pourtant, je sais de tout mon corps de promeneur qu’elle se trouve du
côté de ces rues au gras pavé entre Hors Château et Meuse, au pied des rudes montées vers la
Citadelle. Ce cœur liégeois est, pour l’anatomiste, adossé à l’église St Barthelémy—j’entends
encore le grand historien d’art Nordenfalk, de passage à l’Institute of Advanced Study, m’expliquer
que l’œuvre de Rénier de Huy était une copie tardive d’un orginal sicilien, un puits je crois me
souvenir—; tandis que la poitrine et le bréchet jouxtent le pont des Arches avec, à sa tête, le café-
concert «Les Olivettes», et son inénarrable pianiste, du plus pur style 1925, qu’on aurait pu croire
une invention de Simenon.
J’aimais aussi beaucoup prendre le chemin du retour vers l’héliport au prix d’un grand détour, Pont
d’Avroy, puis la si merveilleuse rue St Gilles avant d’obliquer en direction du boulevard et des
bords de Meuse. Il me faudra décrire, à une autre occasion, mes promenades dans cet autre univers
qu’est Outremeuse, traversant la Meuse sur la Passerelle, empruntant le boulevard Saucy pour
rejoindre le boulevard de la Constitution, pour un collègue médecin à rencontrer à l’hopital de
Bavière ; ou bien rejoignant la rue Puits-en-Sock et revenant par la place Delcour, pour saluer ces
grands amis trop tôt disparus que furent Marcel Florkin, puis Ernest Schoffeniels.
Le marcheur se promenant à Liège voit, un peu partout, des affiches pour des concerts. Davantage
encore que le théâtre, ceux-ci drainent un public de jeunes, d’intellectuels, mais aussi d’une petite
bourgeoisie volontiers mélomane. Notre promeneur de Liège note intérieurement sa surprise à voir,
ici ou là, des boutiques de luthiers, d’assez nombreux disquaires en dépit de l’arrogance du magasin
de la FNAC place Saint-Lambert, ce y compris des éditeurs de partitions ou de disques.
Cette vie musicale intense, bien réelle, est l’un des aspects les plus chaleureux de la qualité de vie
dans la métropole du confluent Meuse-Ourthe. J’ai souvenir des concerts hebdomadaires du jeudi
midi, dans la salle de l’Émulation. Les habitués, souvent porteurs de la partition, venaient
communier, avec discernement et une grande culture de répertoire, dans l’audition de solistes
souvent remarquables, une heure durant. « Sur le temps de midi », comme on le dit si joliment à
Liège, ils venaient se réjouir l’oreille d’un divertissement, indubitablement passéiste servant
d’exutoire à la dureté des temps (ou tout simplement de refuge au climat ingrat).
Je n’ai quasiment point parlé de celui-ci: car Simenon est, à ce sujet, intarissable et indépassable.
Références
[i] Simenon, Georges. Pedigree. Babel, Arles: Actes Sud, 1992.
[ii] Andrevon, Jean-Pierre. Je me souviens de Grenoble. Il y avait des marrons et des hannetons. . .
L'empreinte du temps, Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2001.
[iii] Pérec, Georges. Je me souviens. Paris: Hachette Littérature, 1978.
[iv] Cingria, Charles-Albert. Impressions d'un passant à Lausanne. Vol. 3. Oeuvres complètes,
Lausanne: L'Age d'Homme, sd (1932).
[v] Spitz, Jacques. Le voyage muet. nrf, collection blanche, Paris: Gallimard, 1930.
[vi] Frémont, Armand. Portrait de la France. Paris: Flammarion, 2001.
[vii] Troyes, Chrétien de. Conte du Graal (Perceval). Traduit par L. Foulet, Stock, Paris, 1947.
Paris: A.G. Nizet, 1972.
[viii] Brosse, Jacques. Les Grandes Personnes. Paris: Robert Laffont, 1988, p. 338. À Jacques
Brosse, Michaux déclara: “Ah, vous évidemment ce n’est pas la même chose, vous écrivez dans votre langue maternelle! –Vous n’allez tout de même pas me dire qu’on ne parle pas le français à
Namur? –Ce n’est pas le français qu’on y parle, mais le wallon!” Cité par Leys, Simon. L'ange et le cachalot. Paris: Le Seuil, 1998, p. 139.
[ix] Voir par exemple Defrecheux, Jean. Expressions en wallon liégeois. Liège: CRIWE,