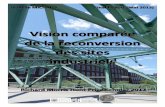Sécurité dans les réseaux Wi-Fi : étude détaillée des attaques ...
Hurons chez les Touaregs: une analyse comparée de deux réseaux matrimoniaux
-
Upload
univ-tlse2 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Hurons chez les Touaregs: une analyse comparée de deux réseaux matrimoniaux
Nous nous proposons ici de revisiterdeux corpus touaregs, à l’aide d’unensemble d’outils développés très récem-ment dans le cadre du groupe TIP (Trai-tement informatique de la parenté)1. Lesauteurs de cette contribution ne sontaucunement spécialistes de la parentétouareg, mais il leur paraissait intéressantde soumettre ces données d’une granderichesse, ayant fait l’objet d’analysesparfois très fines, à l’épreuve d’un outilnouveau.Après une brève présentation des deux
sociétés et des corpus de données, nousexaminerons dans le détail, les échangesentre les différents groupes lignagers quistructurent ces sociétés et nous verronsles difficultés qu’il y a mettre enévidence un « système d’échange ». Dansun second temps, nous examinerons lesrégularités observables dans les agence-ments consécutifs de mariages entrecousins, ce qui nous conduira à insistersur les multiples lectures dont unmariage avec un parent proche peut êtrel’objet. C’est enfin à la lumière de ceséléments que nous reviendrons sur lalecture des « échanges en spirale » propo-sée par Érik Guignard (1984) pour enmontrer la fragilité.Les sociétés touaregs s’inscrivent dans
un ensemble sahélien plus global au seinduquel l’opposition entre systèmesélémentaires2 et systèmes semi-complexespose problème. Certaines de ces sociétés
affirment une préférence pour un type demariage (il semble que les Touaregs soientdans ce cas, avec une préférence déclaréepour la cousine croisée matrilatérale),d’autres hésitent (les Peuls, par exemple,qui, selon Dupire (1972, 12), aspirent aumariage avec une cousine croisée matrila-térale sans perdre du vue que l’endogamielignagère – représentée, dans leur cas, parun mariage avec une cousine parallèlepatrilatérale – a également ses vertus). Ordans tous ces cas, l’examen soigneux desdonnées ethnographiques montre quel’affirmation d’une règle dans un cas oul’hésitation à affirmer une règle dans l’au-tre relève du discours mais que lespratiques réellement relevées placent l’ob-servateur devant un même problème. Unmaquis de liens d’alliance qui présente unmaillage assez fin pouvant être lu demultiples manières en termes de mariagesconsanguins, de redoublement d’allianceou de renchaînements à deux groupesvoire plus.Les nouveaux outils développés par
l’équipe TIP ont été ici mis à contribu-tion pour tenter de mieux cerner d’unepart, la question de la co-existence dedeux logiques matrimoniales conjointe-ment à l’œuvre dans ces sociétés, celle del’endogamie lignagère et celle del’échange interlignager ; d’autre part,l’articulation entre mariage parallèle etmariage croisé, ainsi que le repérage decircuits matrimoniaux*3 impliquant
197
ANNALES DE DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE 2008 n° 2 p. 197 à 232
HURONS CHEZ LES TOUAREGS :
UNE ANALYSE COMPARÉE DE
DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
par Laurent GABAIL et Olivier KYBURZ
plusieurs paires de germains, s’agissantd’une lecture se situant au niveau duréseau même de la parenté. Nous auronsl’occasion de voir que ces deux niveauxde lecture s’intègrent difficilement à unemême théorie et que certaines idéescommunes de l’anthropologie socialeassez largement admises (une préférencedéclarée pour le mariage avec la cousinecroisée matrilatérale, MBD4, impliquantun « échange généralisé », ce dernierétant conçu comme un modèle réguléde circulation des épouses entre des« groupes de filiation » donneurs etpreneurs) sont plutôt mises à mal, dèslors que l’on peut s’offrir le luxe d’explo-rer de manière systématique des relevésgénéalogiques aussi soigneusementétablis.André Chaventré a recueilli dans les
années soixante un corpus généalogiqueextrêmement complet chez les Iwellemed-den de l’Ouest, un groupe touareg patrili-néaire installé au Mali, à l’est de Gao.Leur territoire a été limité par une série deconventions (1903, 1907, 1908, 1910)visant à fixer les Iwellemedden sur la rivegauche du fleuve Niger et à établir unezone tampon avec les Kounta. Ces limitesterritoriales ont été progressivementrepoussées d’une centaine de kilomètresvers l’est et c’est la région de Ménaka quiabrite désormais les Iwellemedden occi-dentaux (Chaventré, 1983, 37-40). LesIwellemedden sont essentiellement deséleveurs de bovins et leurs déplacementssaisonniers sont globalement pendulairessur un axe nord-est sud-ouest mais defaible amplitude lorsque la pluviométrieest normale (idem, 47-48). Lors du recueildes données, Chaventré a systématique-ment recherché à placer les individus dansce qu’il nomme une « triade parentale »,parvenant ainsi à reconstituer l’ascen-dance utérine de la plupart des membres
du groupe. Compte tenu du confinementde cette société et de l’endogamie qui lacaractérise, nous avons là une descriptionquasi exhaustive de cet isolat.Pour sa part, Érik Guignard, à la
même période, recueillit un corpus chezles Udalen. Il s’agit d’un groupe touaregmatrilinéaire installé dans l’Oudalan,une région située au nord-est duBurkina Faso, aux alentours de Gorom-Gorom. Ils occupent en quelque sorteun espace symétrique à celui des Iwelle-medden par rapport au fleuve Niger etsont, comme ces derniers, des éleveursde bovins. Le corpus, solidement établipar Érik Guignard, est d’une ampleur etd’une profondeur inférieures au précé-dent mais il est également très complet.Dans la mesure où la plupart des indivi-dus sont à la fois inscrits dans leurgroupe de filiation utérine appelé« ventre » et dans leur groupe résidentielpatrilocal appelé «dos », il lui a été possi-ble de reconstituer l’ascendancecomplète de la plupart des individus.Ces deux recherches, contemporaines
dans leur phase d’enquête, portant surdes groupes touaregs proches, ont donnélieu à deux thèses (Chaventré, 1973 etGuignard, 1975) dont les conclusionssont diamétralement opposées quant àl’interprétation à donner à une préférenceaffirmée pour le mariage d’un hommeavec la fille de son oncle maternel. Lesdeux auteurs analysent leurs matériauxethnographiques en référence au modèledéveloppé par Claude Lévi-Strauss quifait de la prescription d’une telle union lefondement d’un système d’échangebaptisé « échange généralisé », caractérisépar une circulation régulière des femmesentre trois groupes exogames ou plus. Or,Chaventré affirme l’existence d’unsystème d’échange généralisé chez lesIwellemedden, sans toutefois en apporter
198
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
la démonstration, alors que Guignard sedéclare « étonné par la complexité desfaits et la difficulté de leur appliquer lesschémas de l’anthropologie, en particu-lier ceux de Lévi-Strauss » (Guignard,1984, 3).L’analyse d’Érik Guignard met en
évidence une forme particulière d’échangequ’il qualifie de spirales car les cycles sereferment une génération après leurouverture. Ce sont des dizaines et desdizaines de spirales qui ont été mises enévidence manuellement et analysées parl’auteur. Dans le dernier chapitre de sonouvrage, il tente d’appliquer le modèleudalen aux données de Chaventré : l’am-pleur du corpus Iwellemedden rendaittoutefois l’entreprise impossible et lacomparaison n’a donc porté que sur unlignage, celui des Kel Telataye. Disposantdésormais d’un outil permettant descomptages systématiques, il était tentantde reprendre le travail de comparaisonentrepris par Érik Guignard.Il est toutefois un point sur lequel nous
n’avons pas suivi nos prédécesseurs. C’estla prise en compte des relations classifica-toires fondées sur la terminologie5, dansnos recensements. Non que nousmettions en doute la réalité du phéno-mène mais il nous était difficile de fixer leslimites où celle-ci opère véritablement.Sachant que chez les Touaregs, deux indi-vidus dont les mères sont sœurs ou dontles pères sont frères, sont des germainsclassificatoires, une première définitiondes cousins croisés consiste à dire qu’ils’agit des enfants issus d’une paire degermains classificatoires de sexe opposé.C’est la définition adoptée par ÉrikGuignard, s’agissant de ce qu’il nommeles cousins croisés «directs ». Cependant,aucune indication n’est donnée quant à laprofondeur jusqu’à laquelle de tels liens degermanité classificatoire sont encore
perçus ; n’existe-t-il pas un seuil au-delàduquel la relation entre les mêmes indivi-dus se formule différemment? La défini-tion donnée par A. Chaventré élargit lechamp déjà vaste des cousins croisés«directs» d’Érik Guignard. Il indique eneffet que « les descendants de toutes lespersonnes désignées comme anat massont cousins croisés », or anat mas désigneselon lui, tous les parents masculins de lagénération du père autres que le père et sesfrères classificatoires agnatiques.Érik Guignard, pour sa part, propose
de prendre en compte ce qu’il appelle descousins croisés « indirects » pouvant allerjusqu’à être des enfants d’une sœur classi-ficatoire de l’épouse d’un frère classifica-toire : « ce qui peut exclure tout lien deconsanguinité » (Guignard, 1984, 121).Il s’agit d’une extension qu’A. Chaventrésemble admettre car, comme nous leverrons, il a considéré qu’une FBWBDétait une MBD classificatoire (cf. infrafigure 9). À vouloir donner pareille exten-sion à ces relations, il devient difficile dene pas trouver de nombreux mariagesavec une « cousine croisée » dans uncorpus, où, nous le verrons, les relationssont extrêmement denses.
PRÉSENTATION DES CORPUS
Lors du codage des données, notreobjectif était, à tout prix, de garder lesnumérotations propres aux auteurs descorpus (ces corpus publiés – chose rare –faisant, par leur existence, référence) demanière à rendre les échanges et lesdiscussions possibles avec les « auteurspremiers» et toutes les personnes se réfé-rant à ces textes « premiers »6. ÉrikGuignard a adopté un codage qui suit lalogique lignagère, permettant de distin-guer les aînés des cadets au premier coupd’œil et il n’a affecté un numéro qu’aux
199
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
seuls membres des matrilignages udalen,soit 538 individus. Nous avons attribuéun numéro (supérieur à 538) à tous lesgens étrangers aux matrilignages udalen,dans l’ordre de leur apparition. AndréChaventré semble avoir opté pour uncodage respectant le principe de généra-tion ; des compléments d’enquête ont dûêtre apportés à plusieurs reprises par l’au-teur, car les patrilignages iwellemeddencomportent des sauts importants dans lanumérotation de leurs membres. Sauferreur de notre part, le lecteur devraitcependant retrouver un codage en touspoints identique à celui de Chaventré.
Le logiciel Puck fournit d’intéressantsrenseignements sur la structure descorpus parmi lesquels on trouve unesérie de mesures portant sur la densité*[la densité d’un réseau est le rapportentre les relations existantes et les rela-tions théoriquement possibles dans unréseau. Pour des relations orientées, cedernier nombre est (N*N-1) où N est lenombre d’individus dans le réseau]. Letableau 1 présente les résultats obtenuspour l’ensemble des individus – Puckfournit des chiffres analogues pour desrelations strictement utérines et stricte-ment agnatiques.
200
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Tab. 1 Densités comparées des deux réseaux complets
Corpus « brut » Udalen X/712 Densité % Iwellemedden X’/2588 Densité %
Individus 712 Densité 2588 DensitéMariages 329 0,46 0,26 1146 0,44 0,07
Relation « parent - enfant » 1118 1,57 0,21 4640 1,79 0,06
Rel. de consanguinitéde degré 1
1510 2,12 0,29 5883 2,27 0,08
Rel. de consanguinitéde degré ≤2 6730 9,45 1,29 19561 7,56 0,27
Rel. de consanguinitéde degré ≤3 21916 30,78 4,21 48751 18,84 0,67
Rel. de consanguinitéde degré ≤4 53179 74,69 10,22 189898 73,38 2,60
Rel. de consanguinitéde degré ≤5 93877 131,85 18,03 1050550 405,93 14,41
Remarquons tout d’abord que si, enpremière approximation, on rapporte lenombre de mariages ou de relations«parent – enfant » ou encore de consan-guins de premier degré canon7 à la taillede chacun des corpus – X/712 et respec-tivement X’/2588 – on se situe dans desordres de grandeur comparables : 0,46et 0,44 pour les mariages ; 1,57 et 1,79pour les relations «parent/enfant », 2,12et 2,27 pour les consanguins de premierdegré. Il n’en va pas de même de la
densité des réseaux, qui est beaucoupplus faible pour les Iwellemedden quepour les Udalen.Intuitivement, on comprend que la
progression du dénominateur de la frac-tion (relations théoriquement possiblesavec tous les autres membres du réseau)est plus rapide que celle du numérateur(les relations existant réellement) lorsquela taille du réseau augmente. Il nous fautinsister sur la très faible densité de cesréseaux. Il s’agit d’une caractéristique
générale de tout réseau de parenté. Lesrelations qui sont à la base de leur consti-tution (mariage, filiation) sont très limi-tées au regard des connexions théorique-ment possibles entre les individus.Contrairement à un réseau de platefor-mes aéroportuaires dans lequel tout pointpeut théoriquement être connecté à toutautre, un Iwellemedden (par exemple) necontracte des mariages qu’en nombrelimité. Lawey [26] est le seul individu ducorpus à avoir eu huit épouses. Shaybata[66] a épousé son arrière-petite-nièceTaasha [161], un mariage peut doncconnecter des générations assez distantes,il n’en demeure pas moins que les inci-dences de ces mariages intergénération-nels sont d’ordre qualitatif (ils donnentune physionomie particulière au réseau)
et non quantitatif (la densité par exemplen’en est pas augmentée pour autant)8. Enrevanche, à partir des relations de degré2,la densité augmente de manière quadra-tique et la forte endogamie de ces sociétésaccentue le phénomène en multipliant lesliens de parenté entre individus demanière considérable.Puck produit également des diagram-
mes reflétant la structure du corpus : lesfigures 1 et 2 présentent la distributiondes individus selon leur sexe et leurgénération. On remarque ici que lecorpus iwellemedden compte cinq géné-rations de plus que le corpus udalenmais que leurs effectifs sont limités ; lagrande majorité des individus présentsdans le corpus (89 %) se trouve entre lesgénérations 6 et 13.
201
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
1413121110987654321
Femmes Hommes
0
50
100
150
987654321
Femmes Hommes
Fig. 1 Générations udalen
Fig. 2 Générations iwellemedden
Les figures 3 et 4 présentent la distri-bution des fratries, pour chacun descorpus. La taille de la fratrie figure enabscisse et le pourcentage d’individusqu’elles représentent figure en ordon-née. Il apparaît assez clairement que lataille des fratries est plus importantechez les Iwellemedden que chez lesUdalen.En effet, le total cumulé des fratries
de taille inférieure ou égale à 6 englobe80% environ des Udalen (83% desfemmes et 80% des hommes) alors qu’ilcouvre 60% environ des Iwellemedden(58% des femmes et 62% des
hommes). La taille importante desfratries iwellemedden et leur regroupe-ment dans un intervalle de 8 généra-tions consécutives permettent d’engen-drer – par des mariages globalementendogames – un nombre considérablede relations de consanguinité au pointd’atteindre une densité supérieure à14%, alors que les mêmes mécanismespermettent d’atteindre, avec des fratriesplus réduites mais dans un réseau plusrestreint, une densité remarquablementélevée de 18% chez les Udalen. Passonsmaintenant à l’examen des échangesentre les groupes lignagers.
202
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Fig. 3 Fratries udalen
Fig. 4 Fratries iwellemedden
0
5
10
15
20
13121110987654321
Femmes Hommes
0
5
10
15
17151413121110987654321
Femmes Hommes
ANALYSE DES ÉCHANGESENTRE UNITÉS LIGNAGÈRES
Au niveau lignager, les deux corpus – etles deux sociétés – présentent des différen-ces importantes. Nous passerons donc enrevue les principaux groupes que ces deuxsociétés reconnaissent en leur sein, avantd’examiner les échanges qui peuvent êtrerelevés.
« Dos » et « ventres »dans la société udalen
Par Udalen, on désigne des Touaregsimajeghen (nobles) qui se seraient instal-lés dans la région de l’Oudalan à la findu XVIIIe siècle. Plus précisément, on ytrouve deux groupes distincts, deuxtawsit qui ont chacune leur commande-ment, leur amenokal (Guignard, 1984,42 sq.). Les Idamosan tout d’abord, quise répartissent en noirs et rouges, deuxmatrilignages ou « ventres » qui ont étéfondés par deux sœurs utérines. Toute-fois le lignage noir avait pratiquementdisparu au moment de l’enquête et lesIdamosan noirs présents dans le corpussont majoritairement ceux d’un lignage« apparenté » d’origine igowadaghen9 etassimilé à ceux-ci. Les Idamosan rougesconstituent, quant à eux, le lignage leplus important numériquement de tousles Udalen (86 personnes). Bien quecadets des noirs, les Idamosan rougesdétiennent le commandement de leurtawsit. L’autre groupe, les Udalenproprement dits, comprend 8 matrili-gnages. Les quatre premiers « ventres »sont désignés par le nom de leur repré-sentant ou amaqqar . Notons toutefoisque le lignage de Balloqqiya rassemble 3segments utérins distincts dont le ratta-chement au reste des Udalen estméconnu et que le lignage d’Edemsirkn’est pas clairement situé non plus dans
la généalogie des Udalen. Parmi lesquatre lignages restants l’un avait prati-quement disparu au moment de l’en-quête et ses rares représentants ont étéassimilés au «ventre » Kel Zinge I. Enfin,les lignages d’Eshegh et de MoghamedAghmed, tous deux alliés à des mara-bouts (ineslemen), ont été regroupés sousune même étiquette Kel Zinge 2 parÉrik Guignard. Le tableau 2 présente lastructure des matrilignages udalen, lenom de leur représentant ainsi que leurregroupement en «ventres » pour l’étudedes échanges.À ce système lignager matrilinéaire des
« ventres », les Udalen ajoutent desregroupements par « dos » fondés sur lafiliation patrilinéaire. Ces « dos » inter-viennent dans la constitution des grou-pes résidentiels et se donnent à voir dansle marquage du bétail. Ils sont aunombre de dix : on trouve trois groupes(E1, E2, E3) dont les marques de bétailfont référence à l’etebel – le tambour dechefferie –, symbolisé par un cercledivisé en quatre ou parfois en deux – quiont des liens agnatiques (non précisés)au niveau apical. Érik Guignard aregroupé les deux plus petits E2 et E3(respectivement 20 et 21 individus)dans son analyse des échanges. Lamarque dite kradet, dont l’élément debase est un Ε ouvert vers le bas ou vers lagauche est partagée par 4 « dos » (K1,K2, K3, K4) qui comptent de nom-breux amenokal dans les deux tawsit. Lesdos K1 et K3 ont un lien agnatique en lapersonne de Halhal [690]. La troisièmemarque, un ∀, est celle des Edawurak(EDA), des étrangers ayant pris épousechez les Udalen Baloqqiya ainsi que leurdescendance peu nombreuse (au totalune trentaine d’individus). Deux grou-pes, enfin dont on ne connaît pas lamarque de bétail «peut-être parce qu’ils
203
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
n’en ont plus guère. Ils sont doncmarqués par le nom d’un ancêtre »(Guignard, 1984, 73). Ce sont les dosd’Aya (une quarantaine d’individus) etd’Elgateyga (ELG), pratiquement éteintpuisqu’il ne comptait qu’un survivant aumoment de l’enquête.
Les patrilignagesde la société Iwellemedden
Le corpus Iwellemedden, beaucoup plusvaste que le précédent, est égalementstructuré de manière plus complexe.Dans la tawsit des Iwellemedden Kel-Ataram on trouve principalement 5 ligna-ges maximaux : les Kel-Tamelokast, Kel-Agays, Kel-Tekniwin, Kel-Egeyoq et desIfoghas. L’articulation des différentssegments de lignages est présentée dans letableau 3. Nous verrons que les segmentsn’ont pas tous la même profondeur ni lamême importance numérique dans lecorpus. Cela tient, en partie, à desfacteurs historiques et en particulier aux
affrontements répétés deTouaregs avec lesKounta10 à l’époque coloniale : «En 1899tous les hommes Kel-Tabankort et lesKel-Elwat ont été massacrés par lesKounta à Tilensi. En mars et avril 1901,ce sont tous les Kel-Agays et la plupartdes Ibawen qui périssent lors d’affronte-ments avec les Kounta à Hessel puis àTigigirit. En mai 1901 trois patriclansIfoghas tombent à In Tekinit. Enfin, enmai 1916 ce sont les Ibelghawe, une frac-tion des Kel-Tebonant et la plupart desTameshgedda qui sont tués à Ader amBoukar. » (Chaventré, 1971, 190). Ceslignages dévastés sont marqués d’un asté-risque (*). Mais d’autres tiennent égale-ment une faible place dans le corpus,comme les Kel-Taytoq et les Tengerege-desh qui ne comptent qu’une vingtainede représentants chacun ; l’éloignementde Ménaka – les Tengeregedesh étaientinstallés dans la région de Tombouctou –et des conflits politiques peuvent consti-tuer des débuts d’explication : “Towards
204
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Tawsit Lignages maximaux« Lignages » du nom de leur représentant aumoment de l’enquête [avec son n°]
« Ventres » É. Guignard.
Idamosan
Idamosan noirsLajegdat [61] (a pratiquement disparu) lignagedu premier Amenokal Idamosan noirs
Abu [31] (lignage ighowadaghen rattaché)
Idamosan rouges Adalyet [86 ] Idamosan rougesTaha [81] lignage des 7 Amenokal suivants
Udalen
Udalen
Nasaradin [206] lignage des 3 premiersAmenokal (aîné de Mazadewal)
Nasaradin
Mazadewal [278] lignages des 3 Amenokalsuivants (cadet de Nasaradin)
Mazadewal
Baloqqiya [379] (constitué de trois segments,rattachement inconnu)
Baloqqiya
Edemsirk [302] (rattachement possible àBaloqqiya mais incertain)
Edemsirk
Udalen Kel Zinge
Reymadudin [447] lignage apparenté auniveau apical à ceux de Nasaradin etMazadewal
Kel Zinge 1
Bashebashatu [463] (a pratiquement disparu)
Eshegh [522] (alliés à des Ineslem)Kel Zinge 2
Moghamed Aghmed [492]
Tab. 2 Organisation segmentaire udalen
the end of his life he [amenokal al-Insar]had to withstand the vigorous threat ofthe Ahaggar who where raiding the Adrar.About 1875 he was forced to accept thesecession of the tribes of the Niger bent,
who formed an autonomous confedera-tion directed by the Tengeregedesh.”(Ganiage,1985, 247). Ces lignages faible-ment représentés sont marqués de deuxastérisques (**).
205
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
Tab. 3 Organisation segmentaire iwellemedden
Lignages maximaux Lignages majeurs Lignages mineurs Segments (non codés)
Kel-Tamelokast
La réunion des troispremiers lignages majeursest également appelée« Kel-Kummer »
Kel-Tagiwelt (1) RougesNoirs
Kel-Telataye (2) Rouges
AsakrafiSalemiAgulaEl-InsarLawey
Kel-Ahara (3)Rouges
Noirs
Ibawen (7) Rouges
Kel-Agays
Idaragagän (4) LongsCourts
Ibelghawe (*) (11) Rouges-
Noirs
Agays (6) Rouges-Noirs
Kel-Elwat (*)(13) ---Tamezgedda (*) (14) Rouges
Kel-Tekniwin
Kel-Tebonant (*) (12) [Dinnik]Ataram
Kel-Tabankort (*) (10) RougesNoirs
Ikarabasän (9) RougesNoirs
Kel-Taytoq (**) (15) ---Tengeregedesh (**) (16) ---
Kel-EgeyoqKel Taraytamut Egeyoq (5) ---
Kel Taraytamut wan-Adagh (5) ---
Ifoghas Ifoghas Imajghän (8)
Circulation des épousesau sein des « ventres »
Pour ce qui est des Udalen, Guignardnous donne les matrices des échangesinterlignagers aux pages 109 et 110 deson ouvrage, sans trop s’attarder toute-fois dans son commentaire : « L’examendes tableaux apporte une première
impression sur la circulation des femmesdont on ne voit guère qu’elle puissecorrespondre à des cycles d’échangesgénéralisés. » (Guignard, 1984, 108).Voyant que les lignages donnent àchacun des autres autant qu’il en reçoit(à quelques exceptions près), il note quecela « renverrait plutôt à des formules
d’échange restreint » (id.). Même si nousn’apportons ici rien de nouveau sur lefond (nos résultats calculés sur la totalitédu corpus sont tout à fait comparables à
ceux qu’Érik Guignard avait obtenus surles cinq générations les plus fiables),nous présentons ces résultats sous uneforme graphique aux figures 5 et 6.
206
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Fig. 5 Réseaux d’alliance* entre « ventres » udalen
413
3
1
3
22
4
6.
2
2
2
1
16.
6.
4
4
41
6.
33
6.
1
6.
9.
1
3
1
1
2
8.
3
4
5
57
1
2
3
6.
4
1
2
6.3
2
3
3
1
3
3
1
Idamosan noirs
Idamosan rouges
U. Nasaradin
U. Mazadewal
U. Edemsirk
U. Baloqqiya
Kel Zinge 1(Reymadudin)
Kel Zinge 2(Esheg)
Pajek
Lignages ayant fourni laquasi totalité des Amenokal
Tab. 4 Endogamie et échange udalen (ventres)
Idamosan noirs 16 27 1,69 24 39 1,63 62 23 (37%) 4 (6%) 35 (56%) 152%
Idamosan rouges 34 55 1,62 28 55 1,96 88 33 (38%) 22 (25%) 33 (38%) 100%
U. Nasaradin 17 27 1,59 23 34 1,48 55 21 (38%) 6 (11%) 28 (51%) 133%
U. Mazadewal 18 32 1,78 25 38 1,52 64 26 (41%) 6 (9%) 32 (50%) 123%
U. Edemzirk 6 9 1,50 16 20 1,25 28 8 (29%) 1 (4%) 19 (68%) 238%
U. Baloqqiya 20 27 1,35 28 40 1,43 60 20 (33%) 7 (12%) 33 (55%) 165%
Kel Zinge 1 17 31 1,82 28 46 1,64 71 25 (35%) 6 (8%) 40 (56%) 160%
Kel Zinge 2 18 19 1,06 25 37 1,48 55 18 (33%) 1 (2%) 36 (65%) 200%
Moyenne 1,55 1,55
«Ventre»
Hom
mesmariés
Nbde
mariages♂
Txde
polygynie
Femmesmariées
Nbde
mariages♀
Txde
remariage
Nb.de
mariages
Mariages
«entrants»
Mariagesendogames
Mariages«sortants»
M.«
sortants»/
M.«
entrants»
Le tableau 4 reprend, pour chaquelignage, des indicateurs d’endogamie etd’échange11. La singularité des Idamosanrouges apparaît assez clairement. C’est lelignage de très loin le plus endogame alorsque globalement les échanges avec lesautres lignages sont assez équilibrés ; ilssont cependant nettement «preneurs »d’épouse auprès des Idamosan noirs,comme le montrait la figure 5. Les UdalenEdemsirk en constituent l’exact opposé :un seul mariage endogame et une positionbien marquée de donneur, envers les KelZinge 2. Les lignages restants pour lesquelson a assez peu de mariages endogamescomprennent quelques «donneurs », lesUdalen Mazadewal et Baloqqiya etquelques «preneurs», les Idamosan noirs,en particulier.Il est toutefois un point sur lequel il
nous faut insister : tous les « ventres », àl’exception des Idamosan rouges sonttrès nettement donneurs. Les mariages« sortants » sont en effet bien plus nom-breux que les mariages « entrants ». Sil’on met en relation ces deux types demariages avec les effectifs des hommes etdes femmes mariés d’une part, et lenombre de mariages contractés par lesgens mariés d’autre part, il apparaît clai-rement que c’est parce qu’il y a plus defemmes mariées que d’hommes mariés –et que les femmes se remarient autantque les hommes12 – que les mariages« sortants » sont à ce point plus nom-breux que les mariages « entrants ». Or,les effectifs hommes/femmes de chacundes « ventres » ne présentent pas le mêmedéséquilibre13, ces résultats – qui ne sontdonc pas l’effet d’un biais de corpus –doivent dès lors être expliqués. On peutavancer que la grande différence d’âgeau mariage entre les hommes et lesfemmes constitue un des facteurs de cedéséquilibre, à quoi s’ajoute peut-être
une mortalité importante des jeuneshommes dans des opérations guerrièresou de rezzou. Mais il revient aux spécia-listes de ces sociétés d’en juger, voired’apporter des éléments supplémentairesà la discussion.Enfin, le tableau 4 indique que le
système d’échange entre « ventres » nefonctionne pas en vase clos, et que lesUdalen donnent des femmes en mariageà des hommes étrangers à leurs matrili-gnages. En effet, 35 mariages ont étécontractés avec des hommes ineslemenKel Esuk et 69 avec d’autres hommesextérieurs.
Circulation des épousesau sein des « dos »
Les dos, quant à eux (tableau 5), sontbeaucoup moins endogames, E1, K3 etK4, en position centrale dans le systèmed’échange sont les plus endogames avecrespectivement 7, 4 et 4 mariages ; trois« dos » sont strictement exogames. Onéchange donc plus entre «dos » qu’on nele faisait entre « ventres ». Le « dos » K1est donneur essentiellement vers E1, E2et K4 ; alors que les Edawurak, situés enpériphérie sont eux, clairement rece-veurs, en particulier à l’égard du «dos »Elgateyga. Les échanges entre les « dos »apparaissent beaucoup plus diffus, queles échanges entre les « ventres », car leséchanges se font dans toutes les direc-tions. Il est bien difficile de voir unestructure d’échange généralisé entre lesdifférents «dos ».L’examen du tableau 5 laisse entrevoir
un paysage assez différent de celuiobservé au niveau des « ventres ». Eneffet, les hommes y sont parfois en plusgrand nombre que les femmes qui, elles,se remarient un peu plus que leshommes. La faible endogamie polarise
207
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
les mariages en mariages « entrants » et« sortants ». On trouve ainsi des « dos »nettement donneurs (K1, E3 et Elga-teyga) et d’autres nettement preneurs(K4, E2 et Edawurak). Ces donnéessemblent contredire l’assertion faite, ausujet des « ventres », que la différenced’âge au mariage permet à un plus grandnombre de femmes de se marier qued’hommes ! N’a-t-on pas ici 170hommes impliqués dans 250 mariagescontre 148 femmes engagées dans 239mariages ?Comparons l’ensemble du corpus
udalen (tableau 6a) à sa réduction auxseuls individus mariés (tableau 6b) etexaminons leur distribution par sexeentre les « dos » et les « ventres ».Il apparaît clairement que les 529
individus qui appartiennent à un ventrese répartissent de manière équilibréeentre les deux sexes et que 75% desfemmes accèdent au mariage alors que
seuls 55% des hommes sont dans ce cas.En revanche, les 493 individus apparte-nant à un dos montrent une nette sur-représentation masculine : 61% d’hom-mes pour 39% de femmes. Au sein desdos, 76% des femmes accèdent aumariage contre 57% des hommes ; nousretrouvons donc des valeurs proches decelles des « ventres », ce qui nous permetde maintenir notre explication relative àla différence d’âge, en apparence mise àmal par les données du tableau 5. L’accèsau mariage est plus important chez lesfemmes que chez les hommes et cettedifférence a des effets paradoxaux.Lorsque le corpus complet est équilibré– c’est le cas des « ventres » – le corpusdes individus mariés comporte un netbiais utérin, sociologiquement perti-nent. Alors qu’un corpus completcomportant un fort biais agnatique –c’est le cas des «dos » – se traduit par uneapparence d’équilibre au niveau des
208
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Fig. 6 Réseau d’alliances entre « dos » udalen
individus mariés dont on ne devrait tireraucune conséquence sociologique sansapporter de correction. Une discussiondes échanges entre groupes, fondée surdes données empiriques, qui ne prendpas en compte la réalité démographiquede ceux-ci, nous paraît dès lors sujette àcaution. Ce constat étant fait, passonsmaintenant aux Iwellemedden.
Circulation des épouses au sein deslignages majeurs Iwellemedden
Bien que Chaventré ait soigneusementcodé les appartenances de chaque indi-vidu aux différents segments de lignage (ilexiste également une partition par ligna-ges minimaux que le listing ne permet pasde restituer14), l’auteur ne fournit à notre
209
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
Tab. 5 Endogamie et échange udalen (dos)
Tab. 6a et 6b Distribution des individus entre dos et ventres
K1 Kradet 17 26 1,53 17 32 1,88 56 24 (43%) 2 (4%) 30 (54%) 125%
K2 17 23 1,35 12 22 1,83 44 22 (50%) 1 (2%) 21 (48%) 95%
K3 21 30 1,43 20 32 1,6 58 26 (45%) 4 (7%) 28 (48%) 108%
K4 31 47 1,52 27 35 1,3 78 43 (55%) 4 (5%) 31 (40%) 72%
E1 Etebel agays 27 40 1,48 20 39 1,95 72 33 (46%) 7 (10%) 32 (44%) 97%
E2 8 18 2,25 9 15 1,67 33 18 (55%) 0 (0%) 15 (45%) 83%
E3 7 11 1,57 9 13 1,44 24 11 (46%) 0 (0%) 13 (54%) 118%
Elgateyga 14 18 1,29 14 24 1,71 41 17 (41%) 1 (2%) 23 (56%) 135%
Aya 13 18 1,38 14 18 1,29 34 16 (47%) 2 (6%) 16 (47%) 100%
Edawurak 15 19 1,27 6 9 1,5 28 19 (68%) 0 (0%) 9 (32%) 47%
Moyenne 1,51 1,62
« Dos »Hom
mesmariés
Nbde
mariages♂
Txde
polygynie
Femmesmariées
Nbde
mariages♀
Txde
remariage
Nb.de
mariages
Mariages
«entrants»
Mariagesendogames
Mariages«sortants»
M.«
sortants»/
M.«
entrants»
connaissance aucun aperçu général deséchanges entre lignages, qu’ils soientmaximaux, majeurs ou mineurs. Lesseules considérations tenues au sujet deséchanges concernent la recherche du prin-cipe de transmission du titre d’amenokalau sein des Kel-Talataye rouges où l’au-teur développe l’idée que, dans les faits,c’est le segment en position de donneurd’épouses qui a la prééminence, alors quela règle aurait exigé que le segment aîné aitla préséance. Une des raisons qui pourraitexpliquer le renoncement de l’auteur àprésenter des matrices de l’ensemble deséchanges interlignagers – alors qu’il enavait la possibilité technique – tient peut-être à sa conviction intime qu’il avaitaffaire à un système d’échange généralisé,conforté en cela (nous le verrons plustard) par le fait que le mariage avec lacousine croisée matrilatéraleMBD est trèslargement attesté. Nous nous proposonsdonc, dans un premier temps, de reconsti-tuer les échanges entre lignages majeursafin d’avoir la vision globale qui nousfaisait défaut, en vérifiant que les conclu-sions provisoires que nous pourrions tirerne sont pas dues à un « effet d’échelle » ;pour cela nous effectuerons une plongéeau niveau des lignages mineurs.Seules les données de base ayant été
saisies initialement (n° d’individu, sexe,nom, n° du père, n° de la mère, n° du ou
des conjoints), les partitions lignagèresont d’abord été produites automatique-ment mais ont dû être ajustées manuelle-ment. Ainsi, tous les Kel-Tamelokast, àl’exception des Ibawen, se trouvaient dansle même « cluster » car la connexiongénéalogique entre Kel-Tagiwelt, Kel-Telataye et Kel-Ahara était connue, alorsque le détail du rattachement des Ibawenne l’était pas.Ce dernier lignage majeur, comprenant
des hommes de parents inconnus maisayant eu une descendance connue, s’esttrouvé réparti en plusieurs « clusters ». Untravail d’agrégation des lignages dispersésen divers «clusters» ainsi qu’un travail desegmentation des «clusters » comprenantplusieurs lignages a donc été nécessaire.Ayant établi une partition correcte deslignages majeurs, nous avons procédé àl’analyse des échanges. Avant d’examinerles résultats Iwellemedden, présentons trèsschématiquement les physionomies desmatrices que l’on peut attendre. Unematrice d’un échange généralisé tel qu’ilest conçu dans le modèle du mariagepréférentiel avec une MBD doit placerclairement les groupes en donneurs etpreneurs, la diagonale, vide, étant lamarque de l’exogamie (figure 7) alorsqu’une matrice rendant compte d’échan-ges restreints devrait avoir un caractèresymétrique (figure 8).
210
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Fig. 7 Matrice d’un système d’échange généralisé Fig. 8 Matrice d’un système d’échange restreint
Or, voici le résultat obtenu (tableau7).Pour des raisons de place, nous nedonnons que les 11 premiers lignagesmajeurs, ce qui correspond sommaire-ment aux lignages les plus importants.Certes, la présence de zéros indique
que tous les lignages n’échangent pasentre eux, mais nous sommes bien loind’une matrice d’échange généralisé :a) La diagonale de la matrice indi-
quant les mariages endogames est extrê-mement fournie : les chiffres sontmassifs pour de gros lignages comme lesKel-Ahara (3) ou les Taraytamut (5)mais des lignages plus petits comme lesIbelghawe (11) sont, eux aussi, trèsfortement endogames : sur 20 mariagesde femmes16 ibelgawe, 15 le sont dans lelignage.b) Les cas d’apparente réciprocité sont
nombreux entre lignages mais biensouvent, ils sont inégaux et nous ne lesdétaillerons pas ici ; il nous sera en effetplus aisé de repérer ces cas dans la repré-sentation graphique de la matrice(figure9).
L’épaisseur des traits et la taille des poin-tes de flèches y sont strictement propor-tionnels à l’importance numérique desmariages. La taille des points reflète lenombre de mariages des femmes des diffé-rents lignages. En blanc les lignages appa-rentés aux Kel-Kummer, en gris les Kel-Kummer, le gris le plus soutenu désignantle lignage détenteur du commandementles Kel-Telataye.Trois points paraissent remarquables.
Le premier, facilement identifiable dansla matrice déjà, est la très forte endoga-mie des Kel-Tagiwelt, Kel-Ahara, Idara-gagän et Taraytamut par rapport auxKel-Telataye. À l’exception de cesderniers, en effet, les autres Kel-Kummer, tout comme les gros lignagesmajeurs alliés apparaissent très forte-ment endogames. Que l’on rapporte lesmariages endogames à l’ensemble desmariages des femmes du lignage (totalde la ligne) ou à l’ensemble des mariagesdes hommes du lignage (total de lacolonne), les taux d’endogamie sontbien souvent largement supérieurs à
211
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
Tab. 7 Matrice d’alliances* iwellemedden (lignages majeurs)15
50% et les écarts entre les Kel-Tela-taye et les autres lignages sont trèsimportants : chez les Udalen, les Idamo-san rouges constituaient une exceptionavec un taux d’endogamie élevé. Ici cesont les Kel-Talataye qui font exception,avec un faible taux d’endogamie.Le second point concerne les échanges
entre lignages. La figure 9 montre claire-ment que les flèches vont le plus souventpar paires et lorsque la circulation desfemmes est « à sens unique », elle est detrès faible ampleur – une femme Kel-Tebonant est donnée en mariage aux Kel-Telataye, une femme Kel-Tebonant estdonnée en mariage aux Kel-Tagiwelt etc.– avec un maximum de 3 femmes Taban-kort données aux Kel-Telataye. Lafaiblesse des effectifs de tels échanges « àsens unique » les rend peu significatifs :lorsqu’une seule femme est donnée, c’estnécessairement… à sens unique! Certainséchanges entre lignages semblent assezéquilibrés, l’ordre de grandeur des épousesdonnées et de celles reçues est le même :(13/13) entre Kel-Tebonant et Kel-Taray-tamut, (15/17) entre Kel-Telataye etIdaragagän, (11/9) entre Kel-Agays etKel-Tagiwelt. Nous pourrions, toutcomme Érik Guignard le faisait à propos
des Udalen, dire que cela « renverraitplutôt à des formules d’échange restreint»(Guignard, 1984, 108).Toutefois, il nous faut noter qu’il existe
des paires de flèches très inégales : (31/8)entre Kel-Tagiwelt et Kel-Ahara, (35/18)entre Kel-Telataye et Kel-Ahara, (21/4)entre Kel-Ahara et Ifoghas, (15/3) entreKel-Ahara et Ikarabasän, (11/2) entreKel-Ahara et Ibelghawe, de sorte que lesKel-Ahara semblent bien être le seullignage majeur qui reçoit bien plus qu’ilne donne aux autres Kel-Kummer et quidonne bien plus qu’il ne reçoit des ligna-ges apparentés. Les Kel-Ahara, prenantmajoritairement dans deux lignages etdonnant majoritairement dans troisautres semblent dans une positioncompatible avec l’idée d’échange généra-lisé, mais ils semblent bien être les seulsdans ce cas. Rappelons enfin que c’estégalement le lignage le plus endogame!Le troisième point qui mérite de retenir
notre attention concerne le bilan globaldes échanges pour les Kel-Telataye ;envers les Kel Taraytamut, ils donnentplus qu’ils ne reçoivent (13/6), il en va demême envers les Idaragagän (17/15), lesKel-Tagiwelt (16/10), les Kel-Ahara(35/18) et les Ikarabasän (17/3).
212
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Tab. 8 Endogamie et échange iwellemedden (5 lignages majeurs)
Si l’on prend en compte la totalitédes échanges de la matrice 16 x16 lesKel-Tagiwelt et les Kel Talataye sontclairement des lignages « donneurs »,alors que les Kel-Ahara sont le seullignage majeur qui se trouve proche del’équilibre. Le tableau 8 détaille l’en-semble des mariages contractés par lescinq principaux lignages. Il appelle lesmêmes remarques que celles faites àpropos des « ventres » udalen, à savoirune prépondérance des mariages« sortants » due à un nombre supérieurde femmes mariées que d’hommesmariés, avec des taux de remariagescomparables. Et l’exception Taray-tamut trouve la même explication queprécédemment : dans le corpus com-plet, ce lignage est entaché d’un fortbiais agnatique, 62% d’hommes et38% de femmes.
Circulation des épouses au sein deslignages mineurs Iwellemedden
Voyons maintenant si, à l’échelle deslignages mineurs, la position singulière desKel-Telataye (largement donneurs), d’unepart, et celle des Kel-Ahara (à l’équilibre),preneurs d’un côté et donneurs de l’autrese confirme. Voyons également commentla forte endogamie des lignages majeurs sedécompose au niveau des lignagesmineurs:La segmentation des lignages produit
une baisse de l’endogamie. Le fait quepour les Kel-Talataye rouges, les chiffressoient identiques au lignage majeur tientau fait que le fondateur des Talatayenoirs est mort sans descendance, tous lesTalataye sont donc rouges. Les Idaraga-gän longs ne comptent qu’un mariageendogame mais il s’agit d’un lignagepour lequel Chaventré ne disposait que
213
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
Fig. 9 Circulation des femmes entre les principaux lignages majeurs iwellemedden
de peu de données, ils apparaissent doncessentiellement par les mariages qu’ilsont contractés avec les autres Kel-Kummer (88% individus du corpuscomplet sont mariés). On observe unnivellement des écarts dans l’endogamiedes lignages, mais les Idagaragän courtset les Taraytamut Egeyoq sont les plusnettement endogames (plus d’un quartde leurs mariages sont endogames). Àl’équilibre, au niveau du lignage majeur,les Kel-Ahara comptent en leur sein unlignage mineur donneur – les rouges – etun lignage nettement preneur – lesnoirs.La figure 10 représente l’ensemble des
échanges entre les huit principauxlignages mineurs, à partir des donnéesde Chaventré. Nous avons conservé lemême principe de partition (Kel-Kummer en gris, alliés en blanc). Lataille des points représente ici la sommedes hommes et femmes du lignagemariés.Si nous reprenons la lecture des échan-
ges comme nous l’avions menée auniveau des lignages majeurs, il nous fauttout d’abord noter que les dons d’épouse
à « sens unique » sont, ici encore, mino-ritaires et de faible ampleur à l’exceptionde 10 épouses données par les Kel-Tagi-welt noirs aux Kel-Ahara noirs. Cesderniers reçoivent beaucoup plus qu’ilsne donnent. De nombreuses flèches, detailles analogues, relient les lignagesmineurs entre eux, de telle sorte que l’onpuisse concevoir des cycles impliquanttrois partenaires ou plus : Taraytamut-Egeyoq/Idaragagän courts/Kel-Telatayepar exemple ou Kel-Telataye/Kel-Aharanoirs/Kel-Ahara rouges ou encore Kel-Tagiwelt rouges/Kel-Ahara rouges/Kel-Telataye. Ces cycles semblent conformesà l’idée que l’on peut se faire d’unéchange généralisé. Mais ces flèches vontbien souvent par paires de sorte que lesparcours de circulation des épouses sontréversibles. Ce point avait déjà été misen évidence par Guignard qui notait queces cycles étaient passibles d’une doublelecture : trois groupes unis deux à deuxsur le modèle de l’échange restreint oudeux cycles d’échange généralisé «qui secroiseraient » (Guignard, 1984, 202-203). Le niveau d’analyse auquel nousnous sommes situés jusqu’ici, l’examen
214
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Tab. 9 Endogamie et échange iwellemedden (8 lignages mineurs)
des échanges au niveau de groupes defiliation, ne nous permet pas de déciderde l’interprétation à donner à de tels« cycles ». Il faudra pour cela examinerl’agencement des différents mariagesentre eux. Toutefois, tant la persistance àl’échelle des lignages mineurs d’uneforte endogamie que le caractère réversi-ble des cycles d’échange ne sont pascompatibles avec l’idée d’un échangegénéralisé, au sens où l’envisageaitChaventré.
MARIAGES COMBINÉS ETLECTURES MULTIPLES
Examinons maintenant plus en détailles circuits matrimoniaux* que contien-nent ces réseaux. Pour prolonger la
démarche comparative, nous envisage-rons pour chacun des corpus : 1) unrecensement des mariages des quatrecousins de premier degré ; 2) un recense-ment des mariages des seize cousins dedeuxième degré ; 3) le réseau d’intersec-tions de circuits* des vingt cousins depremier et deuxième degré afin derendre compte de l’interdépendance destypes les plus fréquents.
IwellemeddenPour l’essentiel, l’analyse des pratiques
matrimoniales iwellemedden par Chaventréa consisté à faire l’inventaire du nombrede mariages avec la cousine croisée matri-latérale. Relativement fidèles à la préfé-rence qu’ils énoncent, les hommes iwelle-medden épousent fréquemment leur
215
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
Fig. 10 Circulation des femmes entre les principaux lignages mineurs iwellemedden
216
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Fig. 11 Échange généralisé (selon Chaventré)
Fig. 12 Échange généralisé (guide pour une lecture détaillée de la fig. 11)
cousine croisée matrilatérale (MBD). Decette fréquence élevée, Chaventré a déduitun «système d’échange généralisé», direc-tement dérivé du modèle mécanique oùchaque homme (ou presque) épouse sacousine croisée matrilatérale. La figure 11reproduit la figure originale de Chaventré(1983, 270). Dans la figure 12, nousavons tramé les Kel-Ahara et ajouté, tantque possible, les appartenances lignagèresdes autres individus laissés en blanc.La magnifique trame inspirée des
structures élémentaires correspond bienà des réalisations empiriques. Les indivi-dus représentés par des numéros existentdans le corpus et les hommes ont biensouvent épousé leur cousine croiséematrilatérale (MBD). Cependant, lacorrespondance des données empiriquesavec le modèle n’est pas aussi bonne quela figure 11 peut le faire penser. Unelecture attentive de la figure 12 montreen effet {1} que les individus 218, 707,221, 236 et 320 apparaissent en deuxendroits différents du schéma. Premièreconséquence, 249 épouse, en fait {2}, lafille 321 de sa sœur 320. Il ne s’agit paslà d’une erreur, Alkisawi a bien épouséFona, sa nièce. Deuxième conséquence,le mariage de 309 et 357 présentécomme MBD {3} est également unmariage d’un homme avec sa nièce, eneffet 309, enfant de 320, a épousé 357,fille de 321 qui est elle même enfant de320 donc sœur de 309. Notons égale-ment que le mariage entre 323 et 339implique une cousine croisée classifica-toire MFBSD {4}. En effet, si le père de339 est enfant de 220, la mère de 323,elle, est enfant de 219, un frère de 220.On remarquera {5} que 219 est repré-senté sur le schéma original mais que lelien de germanité avec 220 a été omis,qu’ils semblent appartenir à des généra-tions différentes et qu’ils ont des
couleurs différentes, ce qui montre lecaractère arbitraire de l’alternance dunoir et du blanc dans la figure originale.Si nous prenons ce lien en compte, alorson peut dire {4} que 323 a non seule-ment épousé une cousine croisée classifi-catoire mais qu’il a épousé la fille de sacousine croisée directe ! Autre consé-quence, le mariage {6} de 244 et 440devient le mariage d’un homme avec lafille de son « frère » et le mariage {7} de447 et 454 trouve dès lors aussi unelecture purement agnatique FFBSSD.Le mariage de 563 et 572, signalé par
un trait pointillé représente un mariageavec une cousine croisée, selon une défi-nition « élargie », FBWBD {8} qui s’ap-parente à ce qu’Érik Guignard nommedes cousins croisés indirects (Guignard,1984, 121). L’homme 563 n’est, eneffet, pas fils de 431 mais de son frère432. On remarquera, au passage {8},que la femme 451 n’est pas plus la mèrede 560 que de 563 contrairement à celaisse penser le schéma original. Enfin,deux autres liens de germanité ont étéomis : 692 et 693 (le père de 720) sontfrères, de sorte que 720 et 707 sont« sœurs » ; d’autre part, 218 et 221 sontfrères de sorte que {9} les époux 236 et320 sont des cousins doublement paral-lèles. Dernière conséquence, le mariage{10}, non spécifié sur la figure originale,est bien un mariage MBD.On le voit, les données empiriques
entrent difficilement dans le « modèle »,sinon à taire des liens de germanité, quisont pourtant fondamentaux s’agissantd’une discussion entre catégories decousins, dès lors qu’ils viennent compli-quer la lecture idéale que l’on souhaitefaire partager. Ces omissions se fontparfois au détriment de la thèse soutenue–on perd ainsi au passage quelques maria-ges MBD – mais c’est semble-t-il le prix à
217
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
payer pour ne pas brouiller la lecture avecdes mariages contraires à la thèse, mariagesparallèles, mariages obliques etc.Le schéma original de Chaventré est
trompeur. Dans le même temps qu’ilsuggère une circulation orientée et systé-matique des mariages entre des unitéspatrilinéaires, il se contredit : le choix dereprésentation par seulement deux grou-pes (Kel Ahara et Ibelghawe) ou deuxcouleurs (noir et blanc) n’est pas parti-culièrement judicieux dans la mesure oùil en aurait fallu au moins trois (groupesou couleurs) pour rendre l’hypothèse del’échange généralisé crédible. En fait, laquasi-totalité des mariages MBD repéréspar Chaventré concerne les mariages
conclus au sein du patrilignage Kel-Ahara, dont a vu précédemment qu’ilétait également l’un des plus endoga-mes. En fait, si échange généralisé il y a,force est de constater que c’est en grandepartie au sein du même patrilignage quecelui-ci se réalise. Ce faisant, on s’écarteconsidérablement de la définition cano-nique des structures élémentaires oùchaque groupe se doit d’être exogamepour être échangiste.Plutôt que d’appuyer la critique, reve-
nons sur un examen un peu plus systé-matique des données empiriques. Puckpermet d’obtenir très facilement uninventaire des mariages de cousins depremier degré (figure 13).
218
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Fig. 13 Fréquences des mariages de cousins de premier degré
0
40
80
120
160
MZDMBDFZDFBD
Au sein du corpus collecté parChaventré,lequel contient 2588 individus (1442hommes et 1146 femmes) connectés par1147 relations de mariage (812 hommes,811 femmes), il y a 142 mariages avec lacousine croisée matrilatérale MBD, 48mariages avec la cousine parallèle patrilaté-rale FBD, 27 avec la cousine parallèlematrilatérale MZD et 17 avec la cousinecroisée patrilatérale FZD. Si toutes les
cousines sont épousées, le nombre deMBD est important : 60% des mariagesentre cousins de premier degré et 12% del’ensemble des mariages. Si l’on restreint lecorpus à l’ensemble des individus dont onconnaît les quatre grands-parents17 (2003personnes, 1098 hommes et 905 femmes),la fréquence de mariages MBD reste iden-tique mais la proportion relative augmentecar les 142 mariages représentent cette fois
plus de 17% de l’ensemble des mariages etprès de 65% des mariages entre cousins depremier degré.Toujours dans l’univers restreint des
mariages entre cousins, il est possible decalculer le coefficient de préférence* pourle mariage de type MBD en établissantle rapport entre le nombre d’occurren-ces et le pourcentage de relationscorrespondantes existant dans le corpus(tableau 10) : les relations avec descousines croisées matrilatérales mariéesreprésentent 27,85% de toutes les rela-tions entre cousins mariés, alors que lemariage de type MBD représentepresque 65% des mariages entre
cousins de premier degré, ce qui placece mariage dans un rapport de préfé-rence de plus de 217. Autrement dit, lacousine croisée matrilatérale est épouséedans plus de deux fois plus de cas que ceque les conditions démographiquespermettraient de prévoir si les mariagesentre cousins de premier degré se répar-tissaient de façon aléatoire. Le tableau10, extrait d’un recensement effectuépar Puck sur le corpus restreint auxseuls individus dont les quatre grands-parents sont connus, donne ces chiffres(nombre de mariages, pourcentage demariages, coefficient de préférence)pour les quatre cousines :
219
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
Tab. 10 Fréquences et préférences du corpus restreint aux individusdont les quatre grands-parents sont connus
Si l’on peut voir dans ce tableau que lapréférence pour la MBD est évidente, ilfaut cependant remarquer que toutes lescousines sont épousées. Contrairement àce qu’on aurait été tenté de supposer enconstatant la forte endogamie lignagère,l’ordonnancement général (MBD > FBD> MZD > FZD) n’est à l’évidence pascelui du mariage arabe : FBD > MBD >FZD > MZD18. Avec 37 occurrences, lenombre de mariages FBD est loin d’êtrenégligeable mais reste légèrement en deçàdes prévisions démographiques si on lerapporte au nombre de relationscorrespondantes existant dans le corpus.La différence est toutefois trop faible pourparler d’un véritable évitement : unecousine sur quatre est une cousine FBD,cette dernière étant effectivement épouséeun peu moins d’une fois sur cinq. La
question d’un évitement pourrait se poserpour la FZD mais reste difficilementtraduisible en termes sociologiques fautede données ethnographiques. En fait,hormis l’aspect cognatique des pratiquesmatrimoniales iwellemedden, caractéris-tique de nombre de sociétés touaregs(Bonte, 1986, 2000) et qui semble êtreconfirmé par ce recensement des mariagesentre cousins, il est difficile d’en diredavantage sur cette seule base. Il est possi-ble, dans un premier temps, d’élargir unpeu le champ du recensement matrimo-nial* et d’obtenir toutes les fréquences demariage des seize cousins de deuxièmedegré (figure 14).À cet horizon généalogique, le
contraste déjà visible entre les deuxcousines parallèles FBD et MZD appa-raît beaucoup plus nettement si l’on
Standard Mariages % Mariages % Relations Préf.FBD 45 20,55 26,11 74,94FZD 17 7,76 21,87 33,80MBD 142 64,84 28,40 217,41MZD 26 11,87 23,63 47,85
regarde l’écart de fréquence entre lacousine parallèle patrilatérale FFBSD etla cousine parallèle matrilatéraleMMZDD, comptant respectivement 68et 10 réalisations. On remarque d’autrespics (70 FMBSD, 48 MFBSD, 34MMBDD) mais qui, considérés isolé-ment, sont difficilement interprétables.Il est plus intéressant en revanche d’ob-server la relation qui existe entre la fortefréquence de MBD et ce recensementdu deuxième degré. À l’aide du réseaude mariages produit par Puck et lu par
Pajek comme un réseau d’intersectionde circuits, on peut obtenir le détail desmariages qui appartiennent aussi bien àdes circuits de premier degré qu’à descircuits de deuxième degré. Il est doncpossible de savoir quels sont les circuitsconsanguins de deuxième degré quicomprennent également un mariageMBD. La figure 15 représente les quatreintersections les plus fréquentes dumariage MBD avec les autres types decousines de deuxième degré : FFBSD,FMBSD, MFBDD, MMBDD.
220
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Fig. 14 Fréquences des mariages de cousins de deuxième degré
0
20
40
60
80
MMZDD
MMZSD
MMBDD
MMBSD
FMZDD
FMZSD
FMBDD
FMBSD
MFZDD
MFZSD
MFBDD
MFBSD
FFZDD
FFZSD
FFBDD
FFBSD
Fig. 15 Réseau d’intersection de circuits des mariagesavec les cousines de premier et deuxième degré
Le point intéressant ici est que lesquatre types les plus fréquentscorrespondent aux quatre possibilitéslogiques de combinaison d’un mariageMBD enchâssé dans un circuit plusvaste formé par le mariage du père d’Egoou d’Alter avec sa cousine croisée matri-latérale ou avec sa cousine parallèlepatrilatérale19. Le détail des circuits estreproduit sous la forme de schémas« classiques » pour être plus intelligibles(figure 16) :La forte fréquence de mariages MBD
remarquée précédemment gagne ici ensignification car elle apparaît beaucoupplus étroitement liée à des formesd’union endogames de type FBD ouFFBSD. Il suffit de quelques mariagesde ce type pour qu’un nombre considé-rable de mariages MBD soient en fait
conclus au sein du même patrilignage20.Si l’on reprend l’exemple du lignage desKel-Ahara, sur lequel Chaventré s’estappuyé pour faire une traduction empi-rique du modèle mécanique del’échange généralisé, on constate qu’ils’agit à la fois du patrilignage où l’onpeut compter le plus de mariages MBD,mais aussi de celui qui est le plus endo-game où plus de la moitié des mariagesMBD (28 sur 54) sont en fait conclusentre parents agnatiques (tableau 11).Le décompte isolé du nombre de maria-ges MBD peut être particulièrementtrompeur s’il n’est pas envisagé conjoin-tement, d’une part, avec les autresmariages de cousins existants et, d’autrepart, au sein des configurations généalo-giques plus complexes dans lesquelles ilest enchâssé.
221
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
Fig. 16 Combinaisons matrimoniales iwellemedden
Tab. 11 Mariages MBD par patrilignages
« Udalen »
On peut poursuivre avec le corpusudalen la même démarche que celle adop-tée pour le corpus iwellemedden, mais ilfaut faire au préalable deux remarques.Premièrement, il nous faut rappeler que leréseau udalen est très dense, et qu’il estbeaucoup plus petit (712 personnes : 409hommes et 303 femmes connectés par 329relations de mariage qui chutent, si l’onapplique la même contrainte de restreindreà l’ensemble des individus dont les quatregrands-parents sont connus, à 194 maria-ges unissant 163 hommes et 132 femmes).On peut également noter qu’il est marquépar un biais utérin assez prononcé à partirde la quatrième génération ascendante21.Tant du point de vue de la représentativitédes circuits que l’on peut recenser –compte tenu du nombre finalement assezlimité de mariages pour lesquels on disposede suffisamment d’informations généalo-giques – que de celui de l’éventuelle surre-présentation des liens utérins, il convientde rester un peu plus prudent qu’avec lesdonnées relatives aux Iwellemedden22.Le deuxième point, qui invite d’ailleurs
également à la prudence, concerne larichesse du travail déjà établi par Guignardpour analyser le système d’alliance desUdalen et qui, s’il ne saurait être questiond’en restituer ici toutes les subtilités, nepeut être comparé à celui de Chaventré. Leparti pris de Guignard a beau clairementêtre celui de dégager une structure quirelèverait du modèle de l’échange généra-lisé, il n’est jamais question dans ses analy-ses de réduire ce dernier, à l’instar deChaventré, à la seule formule de la répéti-tion systématique du mariage MBD.Cette question est écartée d’emblée dansl’article comme dans le livre qu’il a consa-crés aux Udalen. En revanche, la solutionqu’il propose (des longs cycles d’échange
entre trois paires de germains classificatoi-res patrilatéraux) mérite d’être discutée,car elle est problématique. Tout d’abord,elle repose sur des circuits qui, par leurlongueur même, tendent à perdre leurcaractère discriminant dans un réseaud’une telle densité. Ensuite, un autreproblème réside dans le fait que les maria-ges que ces circuits impliquent sontsusceptibles de trop de lectures à la foisdifférentes et par des trajets plus «courts».Avant d’aborder le sujet des «spirales clas-sificatoires», regardons les premiers résul-tats d’un recensement des cousins depremier et de deuxième degré, ainsi que leréseau d’intersection de circuits qui résultede leur interconnexion.Même en tenant compte de la taille plus
modeste du corpus, les fréquences demariages entre cousins sont beaucoup plusfaibles que dans le corpus iwellemedden.Les 28 mariages entre cousins de premierdegré relevés représentent moins de 9%des mariages de l’ensemble du corpus. Lenombre de mariages est sensiblement lemême si l’on restreint le corpus aux indivi-dus dont on connaît les quatre grands-parents, mais les 28 mariages restantsreprésentent alors environ 14% des maria-ges. S’il semble que les mariages entrecousins sont un peu moins fréquents chezlesUdalen que chez les Iwellemedden, pourlesquels ils représentent approximative-ment un mariage sur cinq, la différence estplus flagrante dans le détail des fréquences.La cousine croisée matrilatérale est à peineplus épousée que ce que les conditionsdémographiques permettraient de prévoiret c’est en revanche avec la cousine paral-lèle matrilatérale que le mariage apparaîtcomme préférentiel. Le mariage entreenfants de frères (FBD) ne voit que quatreréalisations et l’union avec la FZD semble,comme chez les Iwellemedden, largementévitée avec ici seulement deux occurrences.
222
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Le circuit le plus représenté dans l’hori-zon du cousinage de premier degré est lemariage consanguin MZD. L’examen duréseau d’intersection de circuits montreque les intersections majoritaires ducircuit MZD avec d’autres circuits cogna-tiques (MMZSD, FMZDD) résultent de
la combinaison de ce dernier avec lui-même. Le mariage répété est ici celui dupère d’Alter (également oncle maternelclassificatoire) ou celui du père d’Ego lui-même (oncle maternel classificatoire d’Al-ter). La figure 19 restitue ces deux cas decombinaison.
223
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
Tab. 12 Fréquences et préférences du corpus restreint aux individusdont les quatre grands-parents sont connus
Fig. 17 Fréquences des mariages de cousins de premier degré
0
5
10
15
MZDMBDFZDFBD
Fig. 18 Fréquences des mariages de cousins de deuxième degré
0
5
10
15
MMZDD
MMZSD
MMBDD
MMBSD
FMZDD
FMZSD
FMBDD
FMBSD
MFZDD
MFZSD
MFBDD
MFBSD
FFZDD
FFZSD
FFBDD
FFBSD
Mariages % Mariages % Relations Préf.FBD 4 14,81 19,93 71,7FZD 2 7,41 21,67 32,96MBD 8 29,63 30,26 94,42MZD 14 51,85 28,14 177,65
La logique est ici très différente de celledes Iwellemedden. Si l’on garde commegrille de lecture d’examiner la relation quiexiste entre un type particulier de mariageconsanguin et le type de mariagecontracté par la génération précédente, onconstate qu’il s’agit de la répétition dumariage des parents (père ou mère mêmesi le schéma est ici formulé pour un Egomasculin) d’Ego ou de ceux d’Alter. Là oùle circuit MBD du corpus iwellemedden secombinait avec lui-même et avec uncircuit agnatique pour former quatrepossibilités, dans le cas des Udalen, c’estune répétition du même circuit MZD quidonne lieu à deux configurations cogna-tiques plus complexes. Le nombre d’oc-currences du mariage MBD est beaucoupplus faible que dans le cas des Iwellemed-den, mais on peut remarquer que s’il s’in-tègre dans des circuits plus vastes (nonreprésentés ici), c’est majoritairementdans un circuit utérin du type MMZDD.L’examen des mariages entre cousins
n’est qu’une première étape du type d’ana-lyse qui peut être produit à l’aide du logicielPuck. En procédant de la sorte, il s’agitmoins de formuler une hypothèse généralesur l’ensemble du réseau matrimonial afinde le ranger dans un type prédéfini qued’observer plus localement la manière dont
s’agrègent entre eux des types simples. Uneanalyse plus complète devrait à l’évidenceélargir le recensement pour quitter l’uni-vers des seuls cousins de premier etdeuxième degré. Néanmoins, sur cetteseule base, il est déjà possible d’observer desdifférences entre deux sociétés relevantpourtant du même ensemble culturel. Lapossibilité de combiner le mariageMBD etle mariage FBD permet aux hommes iwel-lemedden de suivre la préférence qu’ils affi-chent tout en se mariant souvent au seindu même patrilignage. La préférence pourle mariageMBDne rencontre pas le mêmesuccès empirique chez les Udalen. Maispour le peu de réalisations effectives donton dispose, la combinaison avec le circuitutérin MMZDD confirme l’orientationvers une endogamie des groupes matrili-néaires. Dans les deux cas existe la possibi-lité d’associer mariage cognatique et orien-tation endogame, mais l’endogamie desIwellemedden est surtout celle des «dos»,alors que celle des Udalen est davantagecelle des «ventres».
Double endogamie etmariages ambivalents
Toutefois, l’endogamie n’est pas exclu-sive. Dans certains cas, elle est double et
224
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Fig. 19 Combinaisons matrimoniales udalen
les individus sont apparentés par le« ventre » et par le « dos ». Le recense-ment du corpus iwellemedden fait ainsiapparaître plusieurs cas de mariages
entre parents utérins très proches maissusceptibles d’une double lecture dans lamesure où les conjoints sont aussi desagnats.
225
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
Fig. 20, 21, 22 Mariages entre utérins et agnats
Un autre point qu’il faut noter à l’examendes figures 20, 21, et 22 est le caractèresystématique du mariage du père d’Egoavec une parente agnatique: FBD pour lesfigures 20 et 21, FFBSD pour la figure 22.Ces cas de mariage dans un degré rappro-ché, certes minoritaires, semblent avoirtous pour condition préalable l’identitéambivalente de l’épouse, à la fois parenteagnatique et utérine. La figure 20 l’illustrede manière singulière en rendant comptede deuxmariages identiques avec une nièceutérine (celui de l’homme 309 et de sononcle 249) qui se réalisent tous deux ausein du même patrilignage.Ce qui reste problématique, c’est le sens à
attribuer à de telles configurations matri-moniales. Dans la mesure où l’on nedispose pas de l’appréciation qu’ont pufaire les acteurs de telles situations, il estdifficile de décider quelle serait la configu-ration matrimoniale qui prime : mariageendogame par le dos et/ou par le ventre?
Dans le contexte d’une société qui pratiquele «mariage arabe», F. Fogel a par exemplerécemment montré que l’ambivalencegénéalogique est passible d’une analyse enterme de genre (Fogel, 2006). Là où leshommes nubiens privilégient un cheminagnatique (le mariage préférentiel FBD),les femmes ne soulignent pas nécessaire-ment le mariage converse (FBS), mais aucontraire des chaînes généalogiquescomplémentaires, utérines ou cognatiques.La mémoire différentielle d’un mêmemariage selon que l’on prend en compte laperspective d’un Ego masculin ou fémininest une avancée décisive car elle permet decomprendre la multiplicité des interpréta-tions selon une logique cumulative où lesreprésentants de chaque sexe identifient demanière complémentaire un «côté » : leshommes le côté paternel et les femmes lecôté maternel. Cette identification des«deux côtés» participe de l’anticipation dela fission inhérente au système segmentaire
et de la volonté de s’y opposer en offrantdes liens d’apparentement qui ne reposentpas exclusivement sur la paire «frère-frère».Pour revenir à l’exemple iwellemedden, la
question est d’autant plus complexe que sil’on regarde par exemple le mariage del’homme 309, restitué partiellement par lafigure 20, il n’est pas uniquement questiond’unmariage qui réaliserait la combinaisonde deux logiques endogames, mais égale-ment d’un mariage qui concrétise laformule préférentielle que rapporteChaventré, c’est-à-dire l’union avec unecousine croisée matrilatérale. Les troislectures que l’on peut faire d’un mêmemariage rendent bien compte de la diffi-culté qu’il y a à trancher sur la primautéque l’on pourrait accorder à telle forme demariage plutôt qu’à telle autre sans unedescription plus fine des interprétationslocales.L’ambiguïté qui résulte de la combinaison
de plusieurs mariages consanguins auxlogiques contradictoires n’est pas unproblème spécifique aux Iwellemedden. Lespratiques matrimoniales des Kel-Ahaggar,par exemple, ont placé Pandolfi devant lamême difficulté : «Quand on essaye decerner ces liens de parenté [entre époux]dans un groupe fortement endogamecomme celui desDag-Ghâli, on est très viteconfronté à un problème majeur. En effet,
la répartition habituelle entre croisés etparallèles se révèle, dans nombre de cas, sanspertinence. Bien souvent, l’épouse d’Ego seretrouve tout à la fois cousine parallèle (ou“sœur” pour reprendre la terminologiepropre aux Kel-Ahaggar) et cousine croiséed’Ego.» (Pandolfi, 1998, 338)23. Comme lerappelle justement Pandolfi, le caractèrepotentiellement contingent de la distinc-tion croisés/parallèles – en raison de la forteendogamie de la tawsit et de la possibilitéd’épouser tous les types de cousines – incitedavantage à envisager les choix matrimo-niaux en termes de stratégies plutôt quecomme une réponse à un impératifd’échange. Des problèmes similaires seposent avec le corpus udalen et la discussiondu modèle proposé par Guignard nous yconfronte directement.
Un « très joli mariage » etses multiples lectures
La figure 23 est la reproduction d’un casempirique de « spirales classificatoires »rapporté par Guignard et commenté parlesUdalen eux-mêmes comme un «très jolimariage». Les mariages ici notés 1 et 2permettent en effet chacun le bouclageavec une génération d’écart d’un cyclematrimonial impliquant trois unités patri-linéaires d’échange.
226
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
Fig. 23 « Enchaînement de deux spirales classificatoires » (d’après Guignard, 1986, 221)
La séquence initiale est le doublemariage de deux frères (114 et 115) et laséquence finale celle qui unit leurs filles(182 et 92) aux deux hommes 425 et278. La description de Guignard est trèsprécise mais la représentation graphiquequ’il en donne est un peu trompeuseregardée rapidement. Les deux spiralessont certes emboîtées l’une dans l’autre,ce qui réduit évidemment le nombred’unités échangistes de six à cinq (une
leur est commune), mais il n’y a en faitque quatre « dos » impliqués dans cecycle d’échange : la femme 279 estdédoublée, sans doute pour rendre lafigure plus lisible. Mais si les liensutérins qui connectent entre ces quatreunités d’échange sont évoqués, ils nesont pas représentés. La figure 24 resti-tue le détail des chaînes agnatiques clas-sificatoires des spirales et complète unepartie des liens utérins manquants :
227
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
Fig. 24 « Double spirale » partiellement remise en contexte
Les deux spirales sont toujours repré-sentées, chacune par la couleur dunuméro de mariage de la figure précé-dente. Ce qui frappe d’emblée, c’est devoir combien les parents agnatiques quisont les unités constitutives des spiralessont pour la plupart d’entre eux, à desdegrés plus ou moins éloignés, égalementdes parents utérins. En fait, la plupart des« échanges » ont lieu au sein du même
matrilignage. On peut aussi remarquerque la réalisation du double mariage de278/425 avec 92/182 est la répétition del’alliance de la génération précédente : lesmariages de leurs parents sont égalementdes mariages doubles de deux frères épou-sant deux sœurs (114/115 avec 180/251et 227/226 avec 255/422). En fait, lesinterprétations peuvent être nombreuses :un recensement 3 2 224, pourtant trop
« court » pour faire apparaître les deuxspirales, offre plus de cinquante circuitsdifférents pour le couple 278=92 et prèsde deux cents pour le couple 425=182.Dans de telles conditions, il nous
semble que la sophistication du modèled’Érik Guignard fait également sa fragi-lité. La densité du réseau matrimonialpermet un nombre tel de lectures diffé-rentes qu’on y trouve presque mécani-quement des « beaux-frères classificatoi-res» ou des «belles-sœurs classificatoires»dont des « beaux-frères classificatoires »ou « belles-sœurs classificatoires » ontdonné une fille en mariage. Ou plus exac-tement on aura de bonnes chances deretrouver a posteriori un tel chemin,passant par des «beaux-frères» et menantà l’épouse. Nous avons tenté d’effectuerdes recensements de circuits matrimo-niaux incluant trois groupes, avec uneprofondeur généalogique de 3 degréscanons, mais la tâche s’est révélée particu-lièrement ardue25. Plusieurs jours decalcul ont été nécessaires pour produiredes dizaines de gigaoctets de résultats quenous ne sommes pas armés pour interpré-ter. Certes, il y a des spirales ternaires, parmilliers chez les Iwellemedden, maisparmi tant d’autres choses encore… Unerequête plus ciblée, correspondant préci-sément à la formule d’Érik Guignard aété effectuée par K. Hamberger surplusieurs corpus. Les résultats montrentque la proportion de mariages impliquésdans des spirales peut être au moins aussigrande (voire, en fait, plus grande) dansdes réseaux denses provenant de sociétéstrès diverses auxquelles l’échange généra-lisé est totalement étranger. Tel est parexemple le cas chez les Gitans d’Andalou-sie, où la préférence matrimoniale porteindifféremment sur toutes les cousines depremier degré (Manrique, 2008), maisaussi dans des sociétés amazoniennes
comme les Parakanã ou les Araweté,régies par un principe d’échange restreint(voir les corpus de Fausto [1995] et deViveiros de Castro [1992], ainsi queDaillant et Hamberger dans ce volume).
CONCLUSION
Au terme de ce parcours, nous devonsbien admettre que nous ne sommes pasencore venus à bout des interrogationsque soulève l’analyse des pratiques matri-moniales touaregs. Toutefois, quelquesenseignements peuvent être tirés : quandbien même les Touaregs disent épouserpréférentiellement une MBD, on ne peutconclure que leur système matrimonialsoit celui d’un «échange généralisé ». Leslignages touaregs ne sont pas des unitéspurement exogames. La densité desréseaux est telle que les relations deparenté ne sont pas univoques, derrièreune MBD se cache souvent une cousineparallèle qui rend ces mariages endoga-mes. Les Udalen matrilinéaires épousentdes cousines parallèles patrilatérales autantque matrilatérales, les Iwellemedden patri-linéaires épousent bien plus de cousinesparallèles agnatiques qu’utérines mais cesdernières n’apparaissent pas comme inter-dites ou systématiquement évitées pourautant. Nous ne sommes donc pas nonplus dans un contexte de stricte endoga-mie lignagère, mais dans une subtilecomposition des deux principes.Le recours à Puck s’est révélé être un
outil précieux dans la lecture critique quenous avons tenté de faire de deux inter-prétations du mariage touareg. Il nous apermis de produire des éléments objectifs– matrices d’échanges, décomptes précisdes circuits matrimoniaux et de leursagencements – permettant de remettre enquestion l’interprétation de Chaventré.Ainsi, nous pensons avoir montré que
228
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
l’application sans restriction dumodèle del’échange généralisé aux matériaux Iwelle-meden permettait moins d’offrir un cadred’intelligibilité aux matériaux généalo-giques qu’une grille de lecture restrictiveposée a priori. Par la mise en évidence dutrès grand nombre de «chemins» pouvantlier deux individus dans des réseaux d’unetelle densité, Puck nous a également invi-tés à la circonspection devant la construc-tion si élégante d’Érik Guignard. La cons-truction du modèle d’échange qu’il aentrepris repose, à l’inverse de Chaventré,sur une recherche a posteriori de parcoursliant les individus et accorde trop peu deplace à la manière dont ces liens sonteffectivement mobilisés dans la vie sociale.Si l’examen critique de tels travaux est
une étape nécessaire, elle ne constitue pasune fin en soi. Notre recours au logicielPuck s’est limité à une discussion desdeux modèles théoriques mais il pourrait
tout aussi bien s’avérer précieux lors de laphase de recherche. En effet, il permet àtout moment à l’ethnographe de connaî-tre l’ensemble des lectures possibles dulien entre Ego et Alter, et dès lors cernerla manière dont les acteurs privilégientune formulation plutôt qu’une autre. Ceque nous avons tenté de montrer au fil decet article, c’est qu’il importe moins d’in-ventorier la fréquence de tel ou tel typede mariage pour le ranger, a priori ou aposteriori, dans un modèle interprétatifglobal que de restituer plus localementl’histoire dans laquelle les liens de parentés’inscrivent.
Laurent GABAIL
CEMAf-UMR [email protected]
Olivier KYBURZ
LESC-UMR [email protected]
229
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
NOTES
1. Nous tenons à remercier Dominique Casajuspour sa lecture d’une première version de cet arti-cle et ses précieuses suggestions.
2. Depuis les travaux de Cl. Lévi-Strausson parle de systèmes élémentaires lorsqu’il existe unerègle indiquant un parent avec lequel le mariage estprescrit ou donné comme «préférentiel». La déno-mination de système semi-complexe s’applique,quant à elle, à des sociétés où les règles de mariagese définissent négativement par des interditsportant sur des catégories de parents. Pour uneprésentation et développement de ces notions voirF. Héritier (1981).
3. Le lecteur pourra se référer au glossaire pourla définition des termes en italiques suivis d’unastérisque.
4. Nous aurons régulièrement recours au systèmeanglo-saxon de notation des relations de parenté,ici MBD pour Mother’s Brother’s Daughter. Pourune présentation de ces abréviations, voir l’intro-duction de ce volume, note 1.
5. Est dit classificatoire un terme de parenté quis’applique à des individus occupant des positionsgénéalogiques différentes.
6. La tâche s’est révélée relativement aisée avec lecorpus udalen dont Guignard avait eu à cœur depublier les données dans des annexes soigneuse-ment établies. Le codage du corpus iwellemedden aété effectué à partir de la reproduction de la «carteperforée » n°4 (Chaventré, 1983, 91-123). Cettereproduction de listings informatiques était, parailleurs, d’assez mauvaise qualité. C’est cependantle document à partir duquel nous avons établi notrecorpus et nous avons pris soin de vérifier les pointsqui pouvaient paraître douteux en nous référant àla thèse d’État (Chaventré, 1973), déposée à labibliothèque de l’Université Paris V, aux « Saints-Pères », sous la cote [TH P 23].
7. D’une manière générale, nous nous référons ausystème canon lorsque nous parlons du degréd’une relation.
8. Le cas de Shaybata (Kel Talataye) est biendocumenté. Il est né (en 1905) de l’union de
notre grand polygyne Lawey [36] né, lui, vers1836 (décédé en 1916) et de sa huitième épouse,Tingelebant [946]. Or, une sœur aînée de Lawey,Galu [34], née vers 1833 avait eu une fille,Alghashaydet [1347], deuxième d’une fratrie deneuf enfants, tous issus d’un père Taghaytamutnommé Namauba [1339] et ce, dans les années1840. Cette Alghashaydet, qui vécut jusqu’en1932, eut une fille Elusidet [1155], vers 1875d’un père Idaragagän nommé Aghomtaye[1119]. Elusidet n’eut qu’un mari, Idaragagän,Daghietu [1114] qui la prit en première épouse.Leur deuxième enfant (la première des filles)Balbod [1143] née en 1898 contracta deuxmariages : le premier avec un Idaragagän, Tayu[1326] et le second avec un Telataye, Tafenut[106] en décembre 1921. La première fille née decette dernière union, en 1927, Taasha [161]épousa son arrière-grand-oncle, Shaybata [66]Telataye comme on l’a vu et dont seule une ving-taine d’années la séparait (ce qui est parfaitementconforme à la norme) et dont elle eut sept enfants(cf. corpus généalogique de Chaventré, 1973,pour les dates et les détails biographiques).
9. Les Igowadaghen sont des Touaregs de la boucleintérieure du fleuve Niger (Mali) installés auxalentours de Hombori.
10. Population maure, rivale des Touaregs. « LesKounta prétendent descendre du conquérantarabe Sidi Okba, qui fut tué près de Kairouan parle chef berbère Koceilata ; ils ont transposé l’événe-ment dans l’Adrar des Iforas et expliquent ainsileur haine ancestrale pour les Touaregs. Ils ontfourni une grande lignée de marabouts renommés,les Bekkay […] et ils contribuèrent à islamiser lesNoirs et les Touaregs. » (Lhote, 1972, 120).
11. Sous la rubrique «mariages entrants » nousfaisons figurer les mariages exogames deshommes du lignage. Sous la rubrique « mariagessortants » nous faisons figurer les mariages exoga-mes des femmes du lignage. Le rapport «mariagessortants »/«mariages entrants » permet de distin-guer les lignages «donneurs d’épouses ».
12. La société touareg est polygyne. Pour leshommes, le taux de mariages contractés par lesindividus mariés inclut donc à la fois les mariagespolygames et les remariages après répudiation oudécès de l’épouse. Ils mêlent donc polygynie stricteet polygynie séquentielle. Alors que pour lesfemmes, le taux de mariages concerne uniquementdes remariages, après répudiation ou veuvage… Etentre donc dans ce qu’il convient d’appeler unepolyandrie séquentielle.
13. Seul le ventre Edemzirk comporte un déséquili-bre démographique (15 hommes pour 25 femmes)qui vient encore accentuer le phénomène.
14. Par lignages minimaux, on entend les pluspetites unités lignagères pertinentes que la chartegénéalogique organise en lignages mineurs, qui àleur tour se regroupent en lignages majeurs etc.
15. La numérotation des lignages correspond àcelle du tableau 3.
16. Cette partie de la matrice n’en comporte que17 mais la matrice complète en comporte bien 20.
17. Un réseau restreint à l’ensemble des individuspour lesquels on connaît 1, 2, 3 ou 4 grands-parents peut être obtenu en utilisant la fonctionde segmentation de corpus au moyen d’unerequête «PEDG 2». Cette restriction du corpusvise à obtenir des chiffres plus précis des fréquen-ces de mariages entre cousins : lorsque les grands-parents ne sont pas connus, il n’est, en effet, paspossible de savoir si deux conjoints sont cousins.
18. Nous faisons ici référence aux conclusions del’analyse de Barry (1998, 41 sq.), «Application duprincipe de transmission et effet de latéralité », enparticulier p. 45-46. Analyse enrichie dans lechapitre IV « Principe de parenté utérin » in(Barry 2008, 232 sq.) où cet ordonnancement estégalement donné p. 292.
19. On trouve chez Murphy et Kasdan (1959, 22)l’évocation de deux cas d’enchâssement de mariagesmatrilatéraux dans un environnement dominé parle mariage parallèle patrilatéral : “1) It is obvious thatinsofar as patrilateral parallel cousin is the dominantpreference, marriage with the matrilateral parallelcousin is also endogamous to the agnatic section; 2)Diagramm C shows a cross-cousin marriage; it can beseen that the cross cousins indicated are also seconddegree patrilateral parallel cousins.” L’implication desagencements de mariages entre cousins de premierdegré à des générations consécutives a été examinéepar Barry (1996, 415) et (1999, 23 sq.).
20. Ce qu’avait très bien vu É. Guignard (1984,135) à propos des MBD udalen.
21. Puck offre plusieurs moyens d’estimer lespropriétés du corpus qui peuvent gauchir sonanalyse ; cette question est traitée en détail dansun autre article du présent volume (Barry etGasperoni).
22. L’intention ici n’est pas de remettre en question letravail de l’ethnographe dont on a, dans l’introduc-tion, souligné la rigueur, mais plutôt de soulignerqu’on traite d’effectifs autrement plus réduits et qui
230
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
concernent une société certes bilinéaire («dos» et« ventres » nommés), mais qui semble franchementvaloriser les liens utérins dans son calcul cognatiquedes liens généalogiques, trait qui n’est d’ailleurs pasisolé dans la mosaïque touareg (Bonte, 2000).
23.Keenan faisait déjà le même constat vingt ansplus tôt : “However, as a result of the almost totaltawsit endogamy, paternal and maternal ascendantsare often merged, so that individuals may conse-quently find themselves related through at least threedifferent ties. The classification of marriages on thebasis of these relationships is therefore to some extentarbitrary. As far as possible, however, the marriages
were classified according to the sociological percep-tion of the individuals concerned.” (Keenan, 1977,333 ; cité par Pandolfi, 1998, 338).
24. Les chiffres « 3 2 2 » du recensement indi-quent, dans l’ordre, l’horizon de requête endegrés canons des circuits consanguins, desrenchaînements à deux groupes, des renchaîne-ment à trois groupes.
25. Nous tenons à remercier A. Ramdani et J.-M.Doublet, du service informatique de l’universitéde Paris Ouest Nanterre La Défense, d’avoir misun serveur à notre disposition et de nous avoirapporté leur aide pour effectuer cette recherche.
231
HURONS CHEZ LES TOUAREGS : UNE ANALYSE COMPARÉE DE DEUX RÉSEAUX MATRIMONIAUX
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BARRY, Laurent (1996), La parentérecomposée. Figures Peul de l’alliance sur leshauts plateaux de l’Adamaoua (NordCameroun), Nanterre, thèse de doctoratde l’Université Paris X.
BARRY, Laurent (1998), « Les modes decomposition de l’alliance. Le “mariagearabe” », L’Homme, 147, 17-50.
BARRY, Laurent (2008), La parenté, Paris,Gallimard.
BONTE, Pierre (1986), « Introduction », 1-36, in Le fils et le neveu. Jeux et enjeux de laparenté touarègue, S. Bernus, P. Bonte, L.Brock et al. (eds.), Paris, CambridgeUniversity Press-Maison des Sciences del’Homme.
BONTE, Pierre (2000), « Les lois du genre.Approche comparative des systèmes deparenté arabes et touaregs », 135-136, inEn substances. Textes pour FrançoiseHéritier, J.-L. Jamard, E. Terray et M.Xanthakou (eds.), Paris, Fayard.
CHAVENTRÉ, André (1971), « Présentationd’un isolat targui. Étude généalogique desKel Koumer, tribu de commandement desIoullemmeden Kel Ataram. Méthode derecueil. Distorsions entre le “dit” et le“fait” », 187-199, in Génétique etpopulation. Hommage à Jean Sutter, Paris,PUF-INED, Travaux et documents n° 60.
CHAVENTRÉ, André (1973), Étude généalogiqued’une tribu saharo-sahelienne: les Kel Kummeret leurs apparentés, Université Paris V, thèsepour le doctorat d’État ès lettres et scienceshumaines.
CHAVENTRÉ, André (1983),Évolution anthropo-biologique d’une population touarègue. Les KelKummer et leurs apparentés, Paris, PUF-INED,Travaux et documents, n° 103.
DUPIRE, Marguerite (1972). «L’incohérenteendogamie des sociétés peul : une analysecomparative », Archives européennes desociologie, XIII, 3-17
FAUSTO, Carlos (1995), «De primos esobrinhas : terminologia e alinaça entre osParakanã (Tupi) do Pará », 61-119, inAntropologia do parentesco. Estudos amerín-dios, Eduardo Viveiros de Castro (ed.),Rio de Janeiro, UFRJ.
FOGEL, Frédérique (2006), «Dumariage “arabe”au sens de la parenté. De “frère-frère” à “frère-sœur”», L’Homme, 177-178, 373-394.
GANIAGE, Jean (1985), “North Africa”, 159-206, in The Cambridge history of Africa:from 1870 to 1905, D. J. Clark, J. D. Fage,R. A. Oliver et al. (eds.), Cambridge,Cambridge University Press.
GUIGNARD, Érik (1984), Les TouaregsUdalen. Faits et modèles de parenté, Paris,L’Harmattan.
GUIGNARD, Érik (1986), «Filiations bilatéraleset cycles d’alliance chez les Udalan et lesIwellemedan», 159-206, in Le fils et le neveu.Jeux et enjeux de la parenté touarègue, S.Bernus, P. Bonte, L. Brock et al. (éd.), Paris,Cambridge University Press – Maison desSciences de l’Homme.
HÉRITIER, Françoise (1981), L’exercice de laparenté, Paris, Le Seuil-Gallimard.
KEENAN, Jeremy H. (1977), “Power andWealth are Cousins. Descent, Class andMarital Strategies among the Kel Ahaggar”,Africa, 47 (3-4), 242-252 et 333-443.
LHOTE, Henri (1972), «Le peuplement del’Afrique du Nord et du Sahara », 75-141,in Ethnologie régionale I, J. Poirier (éd.),Paris, Gallimard.
MANRIQUE, Nathalie (2008), Sois généreux ! Dudon comme principe structurant de l’organisation
sociale des Gitans de deux petits bourgs andalous(Espagne), Paris, thèse de doctorat del’EHESS.
MURPHY, Robert F. (1967), “TuaregKinship”, American Anthropologist, 69 (2),163-170.
MURPHY, Robert F., KASDAN, Leonard (1959),“The Structure of Parallel CousinMarriage”,American Anthropologist, 69 (2), 17-29.
PANDOLFI, Paul (1998), Les Touaregs del’Ahaggar (Sahara algérien). Parenté et rési-dence chez les Dag-Ghâli, Paris, Karthala.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo (1992), Fromthe Enemy’s Point of View : Humanity andDivinity in an Amazonian Society, Chicago-London, University of Chicago Press.
232
LAURENT GABAIL ET OLIVIER KYBURZ
RÉSUMÉ
SUMMARY
Grâce à l’examen minutieux que permetl’utilisation de nouveaux outils informa-tiques (Puck, Pajek), cet article propose unerelecture de deux systèmes matrimoniauxtouaregs étudiés dans les années 1970 : lesUdalen du Burkina Faso (Guignard) et lesIwellemedden du Mali (Chaventré).Contrairement aux ethnographes qui ontinterprété ces sociétés sur le modèle del’échange généralisé, les auteurs de cet article
s’attachent à décrire les mécanismes quipermettent à ces deux groupes touaregs d’as-socier une règle de mariage préférentiellepour la cousine croisée matrilatérale à uneinflexion nettement endogame. Tant auniveau global des unions entre groupes defiliation qu’à l’échelle locale des agence-ments de mariages entre eux, il apparaît quel’hypothèse de cycles orientés entre troisunités d’échange ne peut être retenue.
Founded upon a close examination of datamade possible by recent software (Puck,Pajek), this paper offers new insights intothe workings of two Tuareg marriagesystems well studied in the 1970’s: theUdalen of Burkina Faso (Guignard) and theIwellemedden of Mali (Chaventré). Unlikethe ethnographers themselves, who interpre-ted the marriage patterns of these societiesin terms of models of generalized exchange,
the authors’ goal is to describe the range ofmechanisms by which these Tuareg groupscombine a preferential rule for matrilateralcross cousin marriage with a marked inclina-tion towards endogamy. They demonstratethat one-way, oriented alliance cyclesbetween three exchange units exist neitheron the global level of alliances betweendescent groups, nor on that of local marriagecombinations.