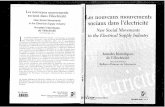Processus historiques urbains et réseaux migratoires marocains à Turin, Italie.
Transcript of Processus historiques urbains et réseaux migratoires marocains à Turin, Italie.
lation en Afrique. Crises economiques, politiques d'ajustement et dy namiques demographiques, Paris , Ceped, EHESS, Insee, Orstom, universite de Paris-VI: 345-373.
LocoH T. , 1993 - « Solidarites et survies des populations africaines: quel role pour la famille, l'Etat et les autres acteurs sociaux ». In Chastelend ]. -C., Veron ]., Barbieri M. (dir. ) : Politiques de
developpement et croissance demographique rapide en Afrique, Paris, Ined/PUF, l3 : 215-221.
LUTUTALA M. B., 1995 - « Les migrations africaines dans le contexte socio-economique actuel. Une revue critique des modeles explicatifs ».In Gerard H., Piche V : Sociologie des populations, Montreal, PUM/Aupelf-Uref : 391-416.
MIMCHE H. , 2006- « Les populations camerounaises face a la privatisation du chemin de fer ». In Chaleardj.-L. et al.: Le chemin de fer en Afrique, Paris, Karthala , Prodig: 241-254.
NDONGMO J.-L. , 1981- Le dynamisme Bamilehe. Yaounde, universite de Yaounde, 2 vol., 423 p . et 293 p.
PLIEZ 0. , 2004 - Le bassin du lac Tchad, un espace migratoire polarise par la Libye ? Politique africaine, 94, dossier Autour dulac Tchad: integrations et desintegrations: 42-58.
RAYAPROL A., 2005 - « Being American: Learning to be Indian: Gender and Generation in the Transnational Migration ». In
Meenakshi T. : Transnational migration and Politics of Identity, Sage Publications Inc : 130-149.
RI CCA S., 1990 - Migrations intemationales en Afrique. Aspect legaux et administratifs. Paris , I.:Harmattan, OIT, 278 p .
ROITMAN ]. , 2004- Introduction au theme : les recompositions du bassin du lac Tchad. Politique africaine, 94, dossier Autour du lac Tchad: integrations et desintegrations: 7-22.
SIMON G., 2002- Penser globalement les migrations. Ceras, revue Projet no 272.
TSAFAK G. , 2000- renseignement secondaire au Cameroun.. Ten.dan.ces organisationnelles et resultats d'appren.tissage de. /c vc· . Ya und , PUY, 281 p.
WESTWOOD S., PHtzA I<Lr:A A., 20 I /11111 N ,lflllllfl// ' "' und th r Politi s o.f BelorrJ{ il"l l{. I. n I 11 , Rotlll t d • llllp
l t.ipl tl 1).
rocessus historiques rbains et reseaux
migratoires marocains Turin, ltalie
lovanni SEMI
« A Porta Palazzo est passee et ne cesse de passer la longue file des hommes et des jeunes qui n 'ont personne.
Ils sont peu nombreux, si on les compare au nombre total des immigres, mais annee apres annee ils se renouvellent.
Cette zone de la ville les attire pour plusieurs raisons : elle est au centre de Turin, tres proche de Via Roma et de la gare,
on y retrouve le vieux et grand marche, il y a la mairie et taus les bureaux administratifs les plus importants.
Mais les raisons principales sont la presence de traiteurs et auberges a bon marche, et aussi pour les annees passees
\a possibilite d'y trouver une mansarde ou un petit appartement assez rapidement (avant le congestionnement actuel,
car les Piemontais quittaient le centre pour la peripherie ou les quarriers nouveaux), la presence des « cooperatives >>
et de recruteurs pour differents types de travail, la presence d'un grand nombre de gens du Sud.
Cette derniere raison est en elle-meme importante : le sentiment de confiance dont profite l'immigre
qui vient d'arriver, la possibilite de retrouver des gens du village, surement quelqu'un de la meme region,
et le fait de trouver des lieux de rencontre et de connaissance (Ia place, qui le dimanche
est pleine d'hommes aux veternents de couleur sombre, reunis en petits groupes, parlant des memes chases
dans des dialectes differents ; les petits cafes, clont celui qui est frequente par les gens
d Ia arclaigne, ou l'autre par les gens de Foggia ou I · Palcrm ). 'a p L de batimcnt , st typique du Nord,
mal I o UI'. •t l ' l tl ii iiHII ion procluisent IIIW lllll tl'•Ph II 111 1 11 11 ' t' llt k . u I,
li ll•li qltt ' 1'1' 11 ti ll I" II I "I ( I I I ill I II II I tl l tt lt ' lll t' t\1 >>
( I 1111 111 / 11 Ill Hi l l
Au debut des annees 1960, Goffredo Fofi, un intelle tuel italien qui penchera bientot vers la critique cinematographique et litteraire, ecrit un livre sur l'immigration des paysans du sud de l'Italie a Turin. Issue d'une enquete de terrain, cette ceuvre demeura longtemps l'une des references obligatoires pour ceux qui s'occuperont de migra tion interne ou du cas turinois . Ce livre parlait du meme quartier turinois dont, quarante ans apres, je voulais faire mon terrain , dans le cadre d'une these de doctora t (SEM I, 2004 a), le quartier de Porta Palazzo. Ce qui surprend, a la lec ture du livre de Fofi , c'est que tres peu de chases ont change en tre les annees 1950 et 1960 et le debut du xxte siecle. Les memes raisons expliquent, aujourd'hui comme hier, le choix de ce quartier pour les nouveaux arrivants (le logement, le travail et la nourriture a bas prix, le fait de retrouver les gens du village, etc.) . On re trouve egalement une continuite dans certains processus economiques et sociaux (comme l'existence du plus grand marche regional au cen tre du quartier). Tou t cela contribue a donner le sentiment du temps qui s'arrete a Porta Palazzo .
Or, la continuite ne peu t pas faire oublier trois changements majeurs : 1e fait que les immigres actuels ne sont plus des nationaux, que la ville de Turin n'est plus la meme que celle des annees 1950 et , en dernier lieu , que la fac;:on d'aborder les migrations a aussi change et cela d'une double fac;:on : non seulement la population « autoch tone » - frequemment les hommes politiques et les journalistes - considere que les immigres actuels sont radicalement differents des anciens immigres nationaux, mais la theorie a laquelle il est souvent fait reference sur les migrations internationales nous dit egalement que le cadre general a radicalement change (PoRTES, 1999 ; FAIST, 2000).
Dans ce texte , je suivrai un fil conducteur tout d'abord genealogique. l'.histoire d'un quartier d'immigration est esquissee depuis sa construction jusqu'a nos jours pour eclairer les rapports entre ville en tant que projet public (et politique) et quartier en tant qu'espace de vie quotidienne pour ses (nouveaux) habitants. l'.histoire de la succession de vagues d migrant s dans I quartier cl Porta Palazzo perm tLra d nw tt rc t' ll 1 11111 It , co nt l r1u it
nv · · I 1 a mai au i ck 0 11 llp. ll t·t It Jh 1 I qll t s, p r ' 111 1 It• lr 1 1
d't I ll lltll ll l! dt I \.1\ 1 I
Porta Palazzo et Ia ville de Turin bref parcours historique
I \ ·spa urbain qui est connu dans la ville de Turin so us le nom de « I rta Palazzo » peut etre decrit a partir de la place << della I ·pubblica », celle-la meme qui est occupee pendant route la
·maine par le plus grand marche a ciel ouvert d'Europe. Autour t I • · tte place, on retrouve deux autres aires, l'une au nord, « Borgo I ora» et l'autre au sud, « Quadrilatero Romano», qui forment en mble Porta Palazzo en tant que quarrier commercial et resid •ntiel du centre-ville de Turin (carte 1).
I a « Piazza della Repubbli.ca » est un bon exemple de ce que l'on 1 1ualifie de« production sociale de l'espace » (LEFEBVRE, 1974): I s onditions materielles de constitution cl'un territoire en un t•spa e identifiable et strategique y sont nettement observables. ,ct L place es t i.nitialement nee en raison de la di.sparition de la
tn urai.lle fortifiee du centre de Turin, que Napoleon fit abattre d 111 tou tes les principales villes reconquises sur les Autrichiens t n 1 00. La Piazza della Repubblica est neanmoins fille indirecte
Carte 1.
de !'expansion economique et demographique du centre de la Maison de Savoie, dont l'expansion d'influence aux bourgs limitrophes etait necessaire. Du point de vue architectural, cet espace nail entre 1826 et 1837 et resulte d'une myriade de projets qui, des 1808, annee de la presentation d'un plan d'embellissement du gouvernement napoleonien, ont continue a se succeder souvent de maniere juxtaposee et desordonnee. Au cours de la premiere moitie du x1xe siecle, Turin etait en effet une ville encore trop petite pour attirer les investissements et les interets immobiliers, sans lesquels le Royaume de Savoie n 'aurait pu soutenir financierement le projet de la remodeler selon ses besoins.
La forme octogonale, la remarquable dimension (51 300m2) et le dessin architectonique fragmentaire temoignent des differentes volontes de production de l'espace qui ont conduit a concevoir la place comme une zone commerciale et marchande, une zone de transit mais aussi de promenade, un lieu de travail mais aussi de distraction. A la difference de la place marchande, les zones du Quadrilatere romain et du Borgo Dora ont connu des evolutions differentes. Alors que la premiere a suivi toutes les vicissitudes du developpement du centre historique originel de la ville, celle du Borgo Dora est, comme son nom l'indique, le fruit d'une expansion de la ville vers l'exterieur. Alors qu'aux epoques romaine et medievale cette vaste zone constituait un ensemble de districts ruraux, la zone du Borgo Dora vit a partir du xve siecle la naissance de l'industrie turinoise, en raison de la force motrice que l'on pouvait tirer de la riviere Dora. Le premier exemple de quarrier populaire manufacturier de la ville se developpe alors. Appele egalement « Borgo del pallone »\ ce territoire fut progressivement integre a la ville en sa qualite de zone industrielle et aire de distraction, en raison des nombreux « bistrots » et des espaces lies au jeu que l'on pouvait y frequenter.
L rapport entre la forme du developpement urbain turinois, la on titution d'un centre-ville et les changements sociaux qui ont
a mpagne ces deux processus cree ce t amalgan1l' : 1 alial que I' n n mm «Porta Palazzo », m me s' ll n't• I It' :tttt' tln . ntit
1 ii '•lllll ili l qll • tl ~ ~~ XVI II •,1 t li •,III I VJiliJII H) I ,, I lli' JIVI' i'l lll li illl t• ll l Ifill 1111111 I
l'ltlll i \\ \J\ Ill l l l l ll) U I ~ tJitii iiiN tl " Al l Mil M llll" l Mll ltOtiii N~ /1 IUIIIN, I'T'ALI
td mini trative qui corresponde a ce nom. Selon la vision de l'hisIDrl •nn de l'urbanisme Donatella Calabi, un element fondamen-1 \I JUi p ut contribuer a eclaircir la nature de cet amalgame est I IISL 111 nt le marc he :
« ui a examine et compare un grand nombre de plans de ville a t> tv nt mis en evidence une correspondance entre l'aire circons
l rl l , specialisee a des fins mercantiles, et des lieux de plus ~ ra nd discontinuite (physique etlou chronologique) du tissu urbain. [ ... ] Le marche semble se poser sou vent comme trait d'union entre deux mondes ; se situer ou l'agglomeration est t 'OI Lituee de parties juxtaposees ; jouer dans la topographic 111'1? ine le meme role que le port assume dans la geographie eco-1\ lmique d'un territoire » (CALABl, 1993: 48) .
, >mme a pu l'observer cette chercheuse, dans les villes europeenn • • d'Anvers, de Londres, de Paris ou de Venise, le marche a mis 1 n relation des mondes urbains differents. Dans le cas de Porta Pal zzo, l'aire marchande qui occupe tous les jours avec ses activ I la superficie de la Piazza della Repubblica continue encore 111j urd'hui a constituer un trait d'union entre deux mondes , l'un 11 li solublement lie au centre historique, l'autre incorpore a
l'dui-ci suivant le role joue par le marche et les conceptions hisloriques du quarrier. Au cours des cinquante dernieres annees en 1 nrt iculier, le Quadrilatere romain et le Borgo Dora se sont soutl au marche, tant dans la memoire historique que dans les pra-1 JLl s sociales ou dans les representations publiques, comme I 1i ant partie de l'aire de Porta Palazzo. rurbanisation turinoise pi u recente, celle de l'apres-guerre, s'est fondee de fa<;;on crois-
tnL sur les arrangements et sur les modifications necessaires pour faire de Turin une ville fonctionnellement fordiste. I ' d i fi ation de quartiers-dortoirs en croissance rap ide et convul-lv • lans les zones peripheriques, I' expansion des zones residen
llt' ll autour des installations industrielles et la naissance d'une vi d ilit fonctionnelle dans cette transformation fordiste de la vi ii · nt fait de Turin la one-company town qui s'est developpee !usqu'a la moitie des annees 1970 (BAGNASCO, 1986).
I • I v I Pl ment cl m p; rrq hiqu cl la ville , comme illustre tlu1. I lnll au 1, a L s )!, 1111 t 11 f. In p ri I qui va d 1853 a 11 0 mnrqttt' I(' d h111 d' lllll ' lrllll 111h111i Ilion llll' inol. c , nvrc dr .
"" ' jliii VI 1\ 11\1 Jll 1\1 p dtlll Ill I " ' ' 11111\11 Jill •
Tableau 1.
Population residant dans Ia commune de Turin, 1853-20010
An nee Residents
2001 865 263 1991 962 507 1981 1 117 154 1971 1 167 968 1961 1 025 882 1951 719 300 1930 600 000 1903 360 000 1853 160 000
Source . Matrre de Turrn.
avec le debut du siecle, des regions septentrionales. On parle d'environ « 400 000 immigres et fils d'immigres » qui concourent ala constitution du premier proletariat urbain turinois (GRIBAUDI, 1987: XV). C'est ce que nous pourrions appeler sommairement la « premiere vague » 0 Par la suite, a partir de l'apres-guerre, la force d'attraction de l'industrie mecanique turinoise domine e~core plus le developpement urbain et se traduit, dans un premier temps, par un developpement demographique a nouveau marque par l'arrivee d'une vague de travailleurs non autochtones. Avec l'arrivee de la deuxieme vague de travailleurs migrants nationaux, provenant cette fois des regions du sud de l'Italie, Turin devient non seulement la principale ville industrielle italienne, mais egalement la troisieme plus grande ville meridionale d'ltalie (CASTRONOVO, 1987)0
Entre 1951 et 1971, soit en seulement vingt ans, la population de Turin augmente de fa <;:on tres importante jusqu'a depasser le seuil du million d'habitants2
, chiffre qui s'est progressivement reduit a un peu plus de 800 000 a ce jour. Pendant la periode fordiste de la ville, la conception du centre historique et sa mise en valeur, sa recuperation et « marchandisation » n'etaient pas au centre du debat public. En particulier, !'appropriation par les class populaires de I' a ire residentielle du centre n'a jamai 1 111 i s~· (' 11 d i ussion
2 n 197 1, 50 % d 1(",1111'111 dt l.r (III U ,7% t, I 11111 •, d oll! ' 1111 1111
pi IIIOIII+Ih/1 (IIC'lNI/ A/11'1 ill I IIIli 1
jtl' qu't un p qu r o ' Ill 'o AI r que les classes superieures s'inst.dlit enL d preferenc dans des contextes suburbains - comme ce 1111 l1 ·a avec la zone collinaire ou dans des zones specifiques du 1 1 til l' ·, mme dans le quartier de la Crocetta3 - la zone du marche dt Ph zza della Repubblica, une bonne partie du Quadrilatere 111 111 \111 t le Borgo Dora sont ainsi restes unifies sous !'etiquette 11 illl'a l t populaire de« Porta Palazzo». Un des ciments utilises jli \1 I ' pouvoirs publics pour « tenir uni » !'ensemble de ces trois IIIPil I a ete justement ce qui divise aujourd'hui ce quartier: la p11· ' 11 d'une vaste et identifiable population « etrangere »0 Le IIIIHtv ment migratoire et les repercussions sociales et culturelles qtt ' 11 ont decoule ont en effet modele le contexte d'evolution de 1 1 1 pace urbain, permettant une identification entre l'idee d'alte-1 11 ' l un quartier du centre historiqueo Porta Palazzo a ete en effet
1111 tout un quartier populaire de travailleurs immigres, mais 1111 i de marginaux et de deviants , de pauvres et d'exclus. Dans la 1 1111 • ption fordiste de la ville, !'attraction et !'integration de vagues II \' o ives de nouveaux residents se sont produites dans un on I ·xte de relatif desinteret pour la conception esthetique du cen-
111 hi torique, alors que l'esthetique de l'usine et du modernisme de I I I ohnique etaient beaucoup plus pregnants. Avec la fin de Turin 1 11 Lnnt que ville fordiste , on a pu noter deux changements concollill nnts et radicaux: d'une part, l'arrivee de la troisieme vague d' 1111n igres, cette fois provenant de regions extranationales ; d'au-111' part, le « retour en ville» de projets, de politiques publiques et d' 11 v tissements (PINSON, 2002).
Porta Palazzo aujourd'hui
I 'h 1 r geneite sociale et culturelle a Porta Palazzo est une carac-11 rlsl i u recurrente depuis longtempso Precisement, l'histoire de 11' 1 pa urbain peut etre reconstruite et presentee en s'interes-
1 All lrlnt d n Ia zone coll inaire que dans Ia zone de Ia Crocetta, le taux d'occupill lon d ~ lo m nt p r des ntr [lr rH 111. llh raux et des dirigeants d'entre-pll I' lmllrjlll' 11 11(1 ~ llr-rrpr l'o rn·t,lli 11 tiP I ' f'll 11(11' 'o J1!1r rnnport ( II totr I d llo!Voilllt •lll '• (1 1II '•IMIIU ,, lll'lH 1\'t'l)
sant a deux dimensions : d'une part, la genese et le developpement du marche quotidien , dont l'origine remonte a 1835 ; d'autre part, le processus complexe d'installation urbaine de populations etrangeres pendant la meme periode. Le quartier s'est enrichi de biens, de produits et de savoir-faire nouveaux, en meme temps qu'il s'est enrichi de la diversite des personnes qui y ont habite. Piemontais, Venitiens, Calabrais, Siciliens, Marocains, Chinois, Nigerians et Roumains sont les principaux acteurs de ce processus qui dure depuis plus d'un siecle.
Depuis une dizaine d'annees, on a assiste a une serie de changements notables , notamment le renouveau commercial et une rehabilitation urbanistique et sociale de cette zone. La presence d'un pourcentage significatif de population etrangere est essentielle dans ces deux processus. Suite et grace au developpement d'un reseau de commerces « ethniques »4
, une augmentation de la demande de biens connotes culturellement s'est amorcee de la part de la population etrangere residente et egalement d'un nombre croissant de ceux que Patrick Simon a appeles les « multiculturels » (SIMON, 1995) , cette fraction de la classe moyenne, sou vent composee de jeunes artistes, d'intellectuels, d'architectes, de graphistes entre autres, « consommateurs » de diversite culturelle. Mais le developpemen t commercial renou vele d'une zone consideree comme en crise au debut des annees 1990 a eu comme consequence paradoxale une conflictualite croissante, precisement liee a !'emergence, entre autres parametres, de !'ethnic busi
ness et a la visibilite retrouvee de l'Etranger.
Simultanement, l'interet pour la recuperation du centre urbain, associe ala volonte d'offrir des reponses au theme de l'insecurite urbaine a conduit a !'elaboration d'une serie de politiques d'intervention sur cette zone. ALLASJNO et al. (2000) ont distingue cinq types de reponses portant sur : la securite et l'ordre public ; la rehabilitation urbaine et les infrastructures ; les services sociaux, les initiatives interculturelles et la mediation des conflits ; les
• Le pourcentage de licences commercia les enregi tr0 1HI n m de citoy n ~mange rs dans Ia zone de Porta Palazzo est d 11, ,; 1
" • 1 1111 I tr n r I tion 1 vc t lc I1HIX d 2 % en moyenne pour TwIn (Ill 111111 11 1•1 11111 1 11, JOO I : 3), 0 11
111 p 111 p 11 oi lllc ur xclur un ou P'. lilllolllltll d 1 •llllllo• 1111 1 l ' iillll ~~ ~l l 11
1h pi It 1111111 1111 ch conjolnl •, tiP 11111 11111 Ill II II 1111
011111111 IIMIIIN I "
IHiitllu pour le d v I 1 1 111 nt et enfin les projets integres. ll 111 un 1 rspective urbaine plus ample et attentive aux translt111111\lt n du territoire dans son ensemble, on assiste a un invest • (' 111 nt qui est a la fois economique et symbolique d'une ville 11111 ur plus complexe dans les changements de l'espace urbain 1 1 d t• n conomie, qualifiee par Sharon ZUKIN (1995) d' ~~ econo-lltlt ymbolique ». Au niveau local, par exemple, une vaste , 1111111 d'interventions precises et visant a augmenter la valeur
nth lique et economique de l'espace ont ete realisees dans le lt\1 I diversifier les offres et les usages et enfin de modifier la 1111pulation. Connu sous le nom de gentrification, il s'agit d'un I'll · us qui, dans le cas de Porta Palazzo, non seulement « prodtlll I' space » mais egalement, a travers les usages qu'il en , nns nt et nie , definit d'une certaine fac;:on les utilisateurs legiti-1111 (ATKINSON, 2003 ; LEY, 1996; SMITH, 1996, 2003; ZUKIN, II q I, 1995).
' t 1 d cette fac;:o n que, dans la zone au sud de Porta Palazzo, on 111 111111 nee a parler de« Quartier latin » (SEMI, 2004 b, 2005) alors qtt' tu nord, les medias locaux utilisent les mots de «ghetto »,
111 I ina» ou «casbah » (SEM I, 2006). La frontiere qui separe les dt•u l rritoires de ce meme quartier n'est pas un fleuve, comme 1 ·ut tre la Seine pour diviser la Rive gauche de la Rive droite a I' u· s, mais une rue, corso Regina Margherita. Comme s'ils revisit 1 •nt le fac;:on postmoderne les murs d'enceinte ou les fosses de lit vi ii medievale qui demarquaient effectivement cette zone de la ill· , l passage souterrain de Regina Margherita et la ligne de
11 1111way (avec ses arrets) brisent le vide urbanistique represente p ill' Ia Piazza della Repubblica qui occupe le centre de cet espace, 111 ll1' 1uant ainsi la separation entre le Quadrilatere romain et le
lung Dora » (le long de la riviere Dora) , entre la gentrification
1 I un orte d'enclave.
I I ' pro sus de rehabilitation qui prend au sud de Piazza della I ·pubbli a l'aspect cite ci-dessus, recouvre au nord plut6t celui dtt ·c ntr le social policier, generalement porteur d'une forte ten-ltl ll , v ir de l'abandon dans certains cas. lnterets de marche, 111 I' 1 • 1 ubli et interactions sont done differents. La remise a
111'\l l d • · rtain difi ou 1 c utl rn I qu lqu activites arti-111 ti t• , CO IIIllH' dans Ia zon(' d11 IIlii• h• tl11 Ral n , 'a ·o1111 ap,n
d ' 1111 r 111 t' t'IH t ,u t ' llll' dt l1111 t de pnllt • ( IVt'l ' l' t• lt ' llllitlll
d'immeubles occupes illegalement ou se trouvant dans des conditions vetustes), mais ne presente pas encore de processus comparable a celui cleveloppe clans le Quaclrilatere romain.
Laire de Borgo Dora - comprise entre la riviere Dora au nord corso Regina Margherita au sud, les boulevards XX settembre ~ l'est et XI febbraio a l'ouest- est un ensemble de lieux et d'espaces caracterises par une degradation visible des habitations, une forte presence de population immigree et de hauts niveaux de pauvrete. Une serie de conduites marginales, voire illegales comme la consommation et la vente de produits stupefiants , le recel d'articles voles ou encore simplement de fortes visibilite et presence dans les espaces publics comme les rues et la place completent le tableau. La zone de la marginalite est aussi facilement identifiable et opposable a celle de la rehabilitation. Limage d'une zone abandonnee a elle-meme es t neanmoins fausse. En parallele de ce processus d'abandon apparent, on observe le developpement d'une autre forme de services et cl'activites commerciales, diriges surtout vers la population etrangere residant dans le quartier. Deux mosquees, presque une trentaine de boucheries islamiques, de bazars et de nombreuses autres activites (p hone-centers , coiffeurs, grossistes, banques specialisees clans le transfert d'argent a l'etranger, restaurants , bars) rendent cet espace beaucoup plus complexe qu'il n'y para it. En bref, les deux « ames commerciales » , celle traditionnelle et celle « ethnique » , sont a la base des rapports sociaux qui definissent cet espace.
La na1ssance d'une economie de bazar
Les vagues migra toires des annees 1920 et 1930, puis celle des annees 1950 et 1960, bien que differentes entre elles, puisaient dans les regions italiennes et etaient marqu 1 ar !'absorption f rdi t de la main-d'ceuvr qui 'u rhnni. ail ( 11 ll I ·tnit au dou-bl ph n m ne d'un urhnnl tllnn d t ttllttlc · dt vlt p ~r d In li vi lu l d fami ll t• ttll ttl cl '11111 1111 grn llon
o ·ln le < 1 1111! vii It• Iordi
• jill l'on ~tdm ltait a l' I jU ' l que chaque vague entrainait des Jllllc t ' '>~ U ciaux tout , fait specifiques (PUGLIESE, 2002) , ces
· ' ~ 111 mi raloires sont de plus en plus considerees comme radi-• .tic Ill •nt differentes de celles qui, dans les annees 1980 et surtout l ilt)( ), >nl caracterise le panorama migratoire italien. Il y a bien
111 I n t l signaler ici la difference des origines geographiques ljll l'nra l rise les migrations recentes : l'aire du Maghreb, la 1 It Ill' l les Philippines, l'Est europeen (Albanie, Roumanie et I li e ti n ) , sont les lieux d'origine de la plupart des immigres 11 1 1 111 n ltalie. On pourrait ajouter les differents traits culturels q11l ont de plus en p lus pris en compte pour argumenter la dislll llilnuit par rapport au passe.
II 1 1 ·atisfaisant de noter que le clivage entre ltaliens du Sud et II til ·n du Nord, entre paysans et citadins, s'est reduit jusqu'a faire lll th l •r que dans les annees 1950 et 1960 les gens du Sud etaient 111 11 n mmes de fa c;on pejorative « napuli » (dans la mesure ou I 11 11 n reconnaissait a la complexite du sud de l'ltali.e qu'un lieu , l,t v II · le Naples, pouvant identifier tousles gens des Pouilles, de t l1llpanie, de Sicile, de Calabre et de Sardaigne !) . De meme, le
1111'1 ·me » quotidien s'exprimait selon des formes tres proches dt n ·Ju ·lles (on ne louait pas les appartements aux « Napuli » ,
111 111111 on ne le fait pas maintenant aux families marocaines) et le ll h ll t' h du travail urbain distinguait tres precisement ses tra, 1 II •ur selon des categories ethnoculturelles plutot que selon le I• 11 d · I' ffre et de la demande. Tout cela rappele, il est remarqualtl l I · onstater que, a l'heure actuelle, les vagues migratoires des l ct ttcWtin , des Marocains, des Albanais et des Chinois , pour ne c It 1 ILl les groupes les plus importants numeriquement, constilll t 11 1 ·n tant que telles un phenomene nouveau (tabl. 2) .
pt s av ir rappele qu'il existe des traits communs entre les • 1 ~ \l l' !> migratoires, l'exemple developpe ci-dessous permet de
111 11 111 r ·r qu'il existe egalement des dements allant dans le sens de It t I '( n Li nuite. Le processus de naissance d'une « economie de lttt tr » P rta Palazzo fait partie de ceux-ci.
I I\ P•ll t1 ull r du point de vue de Ia circu i ~ Lion migratoi re. Pour Ia plupart des il llllllql ~ 11,111 n II nC' ', qi It pas dC' lti p1 11111 l 11• !'Xfl ri nee migratoire familloll l' 1 o11 pltl · .l l't lt ~ t1 •, lm1nlqr •, cl ,m , if • 1\lll tlllt l' ll tiill • tiVol i 111 rl ~ f) tl r nt~ Pn
1111'11111 11' ti ll ',li d, till N111tl , I' ll 1\ll 'oll ti lt 1111 tl II lo f It olt l' i lllfiJII '
Tableau 2. Population etrangere residente a Turin selon Ia nationalite, en 2001 et 2002.
Pays 2001 2002
Maroc 10 034 10 796 Roumanie 5 237 6 637 Perou 3 085 3 414 Albanie 2 483 2 912 Chine 2 110 2 449 Phil ippines 1 717 1 814 Egypte 1 424 1 604 Nigeria 1 511 1 601 Tun isie 1 050 1 134 Bresil 9 74 1 032 France 944 1 027 Senega l 978 1 015
Total 31 547 35 435
Source . Mairie de Tu rin.
On considere par !'expression « economie de hazar » un phenomene qui associe l'etablissement de certain es activites economiques au sein d'un espace urbain precis et la naissance et le developpement de rapports sociaux specifiques a ce type d'activites (GEERTZ, 1978; PERALDI, 2001). Les activites concernees sont principalement commerciales mais, s'agissant d'une forme economique autonome, il faut signaler le role de tou tes les activites qui s'etablissent a cote du commerce : la distribution avant tout, mais aussi les service legaux, ceux pour l'aide financiere a la creation d'entreprises (qu'elles soient formelles ou informelles), etc. Dans plusieurs cas, comme dans celui du commerce du textile, commerce et distribution sont etroitement lies a la production assuree dans d'au tres systemes economiques urbains geres par d'autres immigres (c'est le cas des Chinois dans la region de Prato-Florence et de Naples, mais aussi des en treprises italiennes de Biella qui vendent «au noir » aux commen;:ants marocains de Turin).
A cote du mecanisme economique, on observe une serie de rapports sociaux specifiques, dont plusieurs auteurs ont remarqu le caractere cosmopolite, lie a la confiance plut6t qu' d , id nti t figee (PERALDI, 2001 ; TARRlUS, 2002; SCHM 11 , 200 I) 1 lon t ' • Au t ur 1
l'a ·w mar hand, l'e hang I n' l pl1lll ll' llll tlltl ll 11 1h li n I nl
1 ~ , . I lt ll l'l' 111 m 111 t pos illc q111' 'II y ,, '"" t1 d k· It
1r l 1111111 1H 1 dt•. d1inH 1 11111 11 1 1111 I
( MANRY t PERALDl, 2004) . Dan les echanges marc hands plus petits 1 1 tppar mment evenementiels, on retrouve l'entrecroisement des 11 11 • ' l ires sociales des partenaires avec l'histoire des echanges pas-t <; ' l I renouveau continu du pacte commercial.
I .1 na i ance d'un tel processus s'est produite a Porta Palazzo en 1 dson de la nature conunerciale du quartier et, comme on l'a vu l pur · qulil s'agit du lieu par excellence des activites sociales des mm igres recemment etablis a Turin . Ce sont les Marocains, avec
d ·s ommen;;ants chinois, qui ont permis le developpement de · ' It economie. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas, au d marrage, d'un fait« communautaire », voire « ethnique », mais 1 lut t du fait d'une capacite d'entrepreneur developpee par cer-1 1in individus. N'ayant pas une idee precise de leur action , ceuxl'i ont compris neanmoins que le commerce pouvait servir a deux hut : celui d'encadrer un « marche pour immigres », en germe mn i pas encore exploite, et celui de trouver pour eux-memes une o · upation leur permettant de ne pas rester dependant des march du travail locaux, plut6t segmentes et caracterises par des nlv aux de remuneration faibles (KLOOESTERMAN et RATH, 2003).
as de Salim, l'un des « pionniers » des mondes commerciaux ll lUI" cains de Porta Palazzo (SCHM IDT Dl FRIEDBERG, 2002: 44-45), I'S I interessan t a ce titre. Il s'agit d'un jeune ayant compris avant I s autres les opportunites offertes a ceux qui proposaient a leurs co- Lhnics des produits necessaires au processus de stabilisation de I I vague migratoire de la fin des annees 1980. n s'agissait notam-111 nt de produits alimentaires pour la consommation quotidienne qui manquaient presque completement sur le marche. Au debut d annees 1990, Salim residait regulierement a Valenciennes, en loran e. ll se rendit a Turin pour voir des «gens du pays» , Oued '/. ·m au Maroc, et reflechit aux possibilites liees a l'existence d'une popu lation marocaine en forte croissance a Turin (tabl. 3).
u d but des annees 1990, l' economie de hazar n'en etait qu'a ses d but : les produits arrivaient avec les camionnettes qui faisaient l1 n v tte informelle entre la France et l'l talie, notamment Lyon t' t Mar ille. Avec !'augmentation de la population arabe et notam m nt marocaine, la naissance de cette economie apparai:t ('( mmc un r rm d'in tit uli onn[l li ati 11 de l'intuition des premit'! CIIIITJ"ll"l' l1 ·ur. 1 in[\1 111 lt•l •Ill lOIII c·omm un b n mar h d11 11 ,\V,d l, llld t•jH' IId \111 1 I thl I II' 111 d1 111 11 1 IH de l', mplnl
Tableau 3. Population etrangere et marocaine residente a Turin, 1992-2003.
An nee Population Population Part des Marocains etrangere marocaine dans Ia population
etrangere (en %)
1992 12 579 2 913 23,2 1993 13 704 3 315 24,2 1994 15 105 3 656 24,2 1995 16 137 3 964 24,6 1996 22 065 5 981 27,1 1997 26 166 7 108 27,2 1998 29 225 7 864 26,9 1999 32 405 8 439 26 2000 37 185 9 148 24,6 2001 41 665 10 034 24,1 2002 46 388 10 796 23,3 2003 61 227 12 220 20
Source : Mairie de Turin.
autochtones. Suite a la croissance de la demande de produits qu'on nomme de plus en plus « ethniques » - et qui sont simplement la base de l'alimenta tion marocaine- l'offre s'est egalernent accrue et avec ell e l'economie de hazar.
Les propos tenus par Salim illustrent cette evolution de l'activite : « Un jour je me baladais [a Turin] ... ah et pendant que je faisais mes allers-retours entre France et ltalie il y avait des copains qui me disaient, ils me demandaient toujours "amene-nous du the, du couscous, un peu d'epices" parce qu'ici il n'y avait rien. Puis un jour, c'etait la premiere fois que j'allais au Bal6n6 le samedi. [ ... ] Je traJ:nais et j 'ai vu trois ou quatre etals avec ces procluits-la et je me suis dit "tiens" .. . c'etait deja pas mal quoi! J'ai demande un peu les prix . .. et j 'ai vu qu'il y avait du profit pas mal, et done j'ai demande a un mec "si c;:a t'interesse, je peux t'amener des produits , bas prix . .. " et lui il m'a dit oui car a l'epoque il y avait des problemes pour aller en France, il y avait le visa [ ... ] mais moi j 'avais le permis franc;:ais et je pouvais bouger tranquillement. j'ai done achete une voiture un , Fiat Regata . .. qui ... a l'epoque etait la plu a1 pr ·i [il r it]. j e m ui eli ! : j mmence comme c;:a » ( nlrcticn Sn llnt , tvlil 200 ).
• It Ill"'" •Ill I'll I' "" lllriM, olll II IIIII "' 1111 ,, IIIII I Ifill ol ''"" !liolljlll'
"' till 111 I, '""' ""
I Mllo"-'11111111 MAH) AIN A TU111N, ITALIE
ullm r vient d Ly n av a voiture pleine de produits , llla vide 1 n 111 pI tement et devient rapidement le relais entre Ia France et Porta I 11lnzz . S'appuyant sur cette position dominante dans un marche I' ll • r restreint, il a ensuite augmente son capital et ouvert la troi-
111 boucherie halal de la ville (la deuxieme a Porta Palazzo), puis 1111 bazar. A partir clu bazar-boucherie, il a commenc;:e !'importation de menthe et de coriandre frais. Fort de ces succes, il a ouvert une p •til boutique de traiteur et, dernierement, un cafe-restaurant plu-1 1 hie pour clients italiens dans la partie gentrifiee de Porta Palazzo.
I · fa r;on generale, le pourcentage des entrepreneurs marocains no'i t de maniere progressive depuis le debut des annees 1990 et · • roupe national est le premier pour le nombre d'inscriptions
1\U registre du commerce depuis 2001 (tabl. 4) . La plupart des Maro ains inscrits le sont dans le secteur du commerce. ~ mment cet essor economique s'est-il produit? S'agit-il d'une p ialisation ethnique ? D'un cote, se specialiser dans le com
etait une strategie gagnante, surtout au debut, car le mar
l our une consommation communau taire offrait plusieurs h n hces et les commerc;:ants etaient tres peu nombreux. C'est dnn le moyen terme, dix ans environ apres que Salim ait comIll nee en 1992, que l'on peut voir les effets du choix commercial pour les Maghrebins de Turin, avec une lente diminution de la lll 'trge de profit pour la plupart de ces petits entrepreneurs.
1 artir du recensement effectue personnellement a la fin de 2003 -.ur un ensemble d'une di.zaine de rues du nord de Porta Palazzo, }"' a livites marchandes marocaines pouvaient etre comptabi.lisees ( ltlbl. 5). Plus de la moitie de celles-ci sont des bazars et des bazarIH u heries, des commerces qui vendent une gamme assez variee de Jl i'O luits, allant du petit electromenager aux epices, en passant par d • v tements, de la maroquinerie, des produits pour la maison et de Ia 1 terie. Les phone-shops constituent le plus recent secteur dans I · JU ·I investissent les petits entrepreneurs marchands, s'agissant d'un tivite economique qui sert entre autres les nombreux tnlgran landestins qui habitent dans le quartier sans pouvoir t'OillJ l r ur un contrat telephonique regulier et, plus generalement, lOllS · ·ux qui han nt sou vent d'appart ment et qui utilisent ce serv •t• la J In · c.l'un ntraL L I ph nl•Jlll 1 htr d mi il . P rrap1 ort
111 0 11 11'1'1 ' 11 1' 11\1' 111 , it' pi!OIII' \ lltlf" l l'n ll ol P11h1: 0 0 111 do11hl !' 11
ldbl lU 4. ltoy ns etrangers et marocains inscrits a Ia chambre de commerce de Turi n.
An nee
001
2002
2003
Total
8 598
11 080
11 748
~ou r : Camera d1 Commeroo de Tunn.
ltlbl u 5.
Maroc
990
1 371
1 673
% Maroc sur le total
11 ,5
12,4
14,2
Actlvites commerciales de Porta Palazzo et origine de !'entrepreneur ( ptembre 2003).
Secteur commercial Ita lie Maroc Chine Afrique Total
Produits alimentaires 3 0 0 0 3 IIOtel 2 0 0 0 2
B zar 0 12 6 0 18
P peterie, tabac 2 0 0 0 2
Pharmacie 1 0 0 0 1 Quincaillerie, reparations 2 0 0 0 2 Graphique, architecture 1 0 0 0 1
Boucherie - Bazar 0 9 0 0 9
Or, bijoux 2 0 0 0 2
Opticien 1 0 0 0 1
Coiffeur 3 1 0 0 4
Phone-shop 0 9 0 1 10 Restaurant, cafe 4 3 0 1 8
Tissus 3 1 0 0 4
V~tements 2 0 0 0 2
Autre 1 0 0 0 1
Total 27 35 6 2 70
Source : Recensement auteur.
L m canismes qui font evoluer ce processus peuvent etre ainsi r um s : les premiers entrepreneurs- comme c'est le cas de Salim
1\m dizaine d'autres Marocains - ont connu le succes avec I ur premieres experiences commerciales. En meme temps qu'ils uppr naient les techniques commerciales, la population marocaine •J re de Turin augm ntait. apitnu qut · • pr miers •ntr 1 r n ur ont gagn 0111 t 1 lrr vt• II rl 111 I'II'On orni d
' II
n cliff I'(' IH'I 111t l'u llrr '' ''"" " ' ' lult (Ill I ou h ri
II I
III II 11 11 rl1 l,t
I ntn e, ou plu i ur membres des families avaient essaye de s'etahlir avant que l'Italie, de meme que l'Espagne, ne deviennent les I · Linations de la migration marocaine de fin de siecle. Une fois
I · bazars laisses aux proches, ces entrepreneurs ont soit choisi de 1 •nLer leur chance sur d'autres marches (Salim, par exemple, se 1 n he vers le marche de la « consommation de la difference cult urelle » pour clients ita liens , SEMI, 2004 b) , soit de fa ire evoluer I' onomie de bazar en tissant plusieurs liens avec les autres pla. · marchandes de « l'espace circulatoire » maghrebin et non seu-
1 rnent du sud de l'Europe (TARRIUS, 1994). Pour cela, ils ont \ uvert des activites d'import-export, des agences de voyages, des
ietes de transport pour personnes et produits, qui relient Turin uu reste de l'Italie , notamment les districts industriels du textile et I contrefac;:ons de Biella, de Prato ou de Naples, les villes de Milan, de Padoue et de Bologne pour les transports de passagers, ' L . De l'autre cote de la frontiere , Turin a ete de plus en plus · nnecte avec les autres espaces marchands, de Marseille a narcelone, de Lyon a Paris (ASLAFY GAUTHIER, 2002) .
L plaques d'immatriculation des camionnettes que l'on voit dans I rues de Borgo Dora temoignent de cet encastrement spatial de I' onomie de bazar turinoise dans l'espace circulatoire maghrebin. De meme, en suivant les commerc;:ants turinois a Marseille ou
Lyon (SEMI, 2004 a), on mesure l'ampleur de ce mecanisme et la l'ac;:on dont il prend la forme d'une economie a l'interieur du cadre 1 Ius large de l'economie urbaine. ll s'agit de fait d'un mecanisme
nomique lie directement a la ville eta l'economie urbaine, ne s rait-ce que pour sa forme spatiale aux frontieres identifiables et vis ibles et pour le fait qu'il s'agit d'une economie connue et reconnu par la chambre du commerce local, les institutions et les organi ations commerciales de Turin. A cote de cela, c'est une economie qu i se nourrit de la condition de marginalite de ses clients et de . · travailleurs. Tres peu d'entrepreneurs gagnent bien leur vie , la 1naj rite des gens travaillant dans l'economie de bazar sont plut6t
pl ites comme simples « lieutenants » des proprietaires et soumi aux mecanismes assez connus dans la litterature sur ces ph n m n , qualifi n tmnment par Alejandro PaRTES d '~~ n ·a tr 111 nl r laLiOrtiH'I » ( I ) )"': 2 ). n fait, s lieutenants
0 111 . JU V<' nl lr . Iandt till qtt " ''" lilil ' llt d < 11 ou 1ro i an a1 I'Ortll 11 11 pull t 1 tv 1111 d' 11 ul 11 tll lliiiH 1 't• 1 ouvt' rtl It•
cas dans le contexte italien ou agit un mecanisme institutionnel de regularisation tous les trois ans environ, au lieu cl'une politique cl'acces constant et regulier de la main-d'ceuvre etrangere ( CARFAGNA, 2002 ; BA RBAGLI et al. , 2004). En ceJa, les migrants marocains constituent une force de travail vulnerable et nombreuse qui trouve un refuge temporaire clans l'informalite de l'economie de hazar avant de pouvoir essayer cl'integrer les marches reguliers italiens. I..:insertion clans une economie largement informelle geree par des compatriotes constitue aussi, clans plusieurs cas , une strategie d'evitem ent cl'autres marches clu travail. Plusieurs jeunes clanclestins font ainsi !'experience de l'informel « italien » (surtout dans le secteur du batiment), et de « l'illegal »
(notamment les activites de vente de drogue legere ou de places de parking). Plusieurs carrieres commencent par ces deux types d'experience et l'une des manieres de s'en sortir est justement d'entrer dans l'economie de hazar, en commenc;:ant par etre un petit vendeur a la sauvette a qui on donne a credit des petits produits a vendre et qui, ensuite, peut aller travailler dans un hazar.
Conclusion
Dans la ville de Turin, !'immigration n'est pas un phenomene recent. :Chistoire urbaine des deux clerniers siecles est l'histoire d'une croissance liee a l'arrivee de centaines de milliers de migrants, d'aborcl de l'Italie du Nord a la fin du XIXe siecle, ensuite de l'Italie du Sud pendant les soixante premieres annees clu xxe siecle et, vers la fin du siecle, du bassin de la Mediterranee, de l'est de l'Europe et de la Chine. Les dements de continuite clans ces processus sont multiples , mais le premier et le plus marquant est incontestablement le type d'accueil que ces vagues migratoires ont rec;:u a leur arrivee. A cote du racisme que ces populations experimentaient dans le quotidien, I' existence de marches du travail pour immigres obligeait Ia premiere generation de migrant · 'ins r r dans les secteurs d'emploi les plus diffi il . (' t Ito plu. fnil' I m nL remunerateurs. Lorsqu'on lit quarantr ntl 'Ill • It tt n1olgnagrs
u Irs j urnaux d I' poqu , n n It l1 11ppc 111 11 lc l,dt pt t • 'II. c1 p01111 ,1 I 1\l h I' ll )llV(' Ill In puhll 11j 11 111d ltttl , ttl tit lllp,l' till
c ul 1111 111 J, """' ,., 1. ",,
HO b U HISTORIOUI ~ UHII/IIN T R ~SEAUX MIGRATOIRES MAROCAINS A T URIN, ITALIE
Pour utant, les d ements de discontinuite ne manquent pas. La II n'est plus la meme, en particulier la ville fordiste de Fiat, qui
t n ·adrait les vagues migratoires jusqu'aux annees 1970 et qui, d ' I uis, n'a cesse de perdre de son poids dans l'evolution urbaine. ill •n que des migrants plus recents aient eu acces au monde de 1
1U ·ine (et que d'autres auraient souhaite y acceder) , le salariat
11 lu triel appara!t a la fois comme un emploi numeriquement en l' hute et dont la nature s'est trouvee tres largement transformee I' ll L rmes de relations de travail, tant avec les chefs qu'entre colIt gu s. Dans ce contexte, l'economie des services s'est renforcee t' l 1 avec elle, une petite economie de services pour un secteur spet'l fiqu e de la population de Turin, l'economie de hazar destinee a ll' 111plir les besoins de la nombreuse population etrangere de la viii . Cette economie s'est localisee dans une zone specifique de In ville, Porta Palazzo, un espace urbain qui, dans la memoire des lurinois, est celui des immigres par excellence. Encore une fois t'Onlinuite, done. Mais aussi changement, discontinuite, car cette t • nomie, longtemps etudiee en France, presente la particularite I r lier des espaces urbains tres differents , que ce soit des dis-
11'1 ' l industriels ou des quartiers d'immigres dans les villes de 1
11! tr pe du Sud. S'agit-il d'un phenomene transnational, comme 1111 vaste litterature semble l'incliquer ? S'agit-il d'un simple l'11 ix de refuge pour une vaste population etrangere qui a de plus I' ll plus de mal, en Europe, a trouver un espace d'integration et de vlsibilite ? S'agit-il de la renaissance des espaces marchands, des loir et des routes que l'on connaH en Europe depuis le Moyen
g ? Le sociologue n 'a pas, a la difference de l'historien, la poslbilit de connaitre aujourd'hui ce qui resistera a l'epreuve du
temp , mais il peut pourtant suggerer que seule une prise en •om1 te historiquement fondee du processus de circulation
111igr toire, et des activites economiques correlees, peut fournir 1111 • base pour des interpretations correctes.
R ferences bibliographiques --------------------------
II A IN ) I ' ROI\1\1 0 I 'I Nl ·ill s I 0\)(l
t t•tlr tlnpn c I r pnlltltltr JWI ltl
1 h i I ldwn c: h, co. cr su -,/, 1/cr 1 tlltfllttwrllttt lr,:ttttl
ASLAFY GAUTHIER C., 2002- « Les routes du bled : c nunerce et mobilites marocaines ». In Peraldi M. , (sous la direction de) : La fin des norias ? Reseaux migrants dans les economies marchandes en Mediterranee, Paris, Maisonneuve et Larose.
ATKINSON R. , 2003 - Introduction: Misunderstood Saviour or Vengeful Wrecker? The Many Meanings and Problems of Gentrification. Urban Studies, 40 (12): 2343-2350.
BAGNAsco A., 1986- Torino. Un profilo sociologico. Torino , Einaudi.
BARBAGLI M., COLOMBO A., SCIORTINO G. (sous la direction de) , 2004 - I sommersi e i sanati. Le regolarizzazioni degli immigrati in Italia . Bologna, Il Mulino.
BELLUATI M. , Bocco A., 2001 - Progetto The Gate- Unita dati e monitoraggio. Rapporto di Attivita. Cicsene.
BIANCHI C., 1991 -Porta Palazzo e il Balon. Storia e mito. Torino , Il Punto.
BONIFAZI C., GESANO G., HEINS F, 2001 - Popolaz ione e societa in Piemonte. Mutamenti e meccanismi nell'ultimo mezzo secolo . Torino, Ires , Working paper 153.
CALABI D ., 1993 - Il mercato e la citta: piazze, strade, architetture d'Europa in eta moderna. Venezia, Marsilio.
CARFAGNA M. , 2002- « I sommersi e i sanati. Le regolarizzazioni degli immigrati in Italia ». In Colombo A., Sciortino E. G. (sous la direction de) : Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi Bologna , ' Il Mulino.
CASTRONOVO V, 1987- Torino. Bari, Laterza.
FOFI G., 1976 - Limmigrazione meridionale a Torino. Milano, Feltrinelli, (2) ed. ; ed. or. 1964).
GEERTZ C., 1978 - « Suq: the bazaar economy in Sefrou ». In Geertz C., Geertz H., Rosen L. : Meaning and Order in Moroccan Society, Cambridge, Cambi:idge University Press : 123-276.
GRIBAUDI M. , 1987 - Mondo operaio e mito operaio. Spaz i e p ' I' orsi sociali a Torino nel prima novecento. Torino , Einaudi.
LEFEBVRE H., 197 4- La production de /'e. J?lll 1' . P 111 , t\ I lilt l llj)OS.
LEY D., 1996 - Th N w Middle :111" rlltr/ /111 11 11111/llrll t1j 1/11'
cnt ra l II . for I, fol(l l l td vt ' l It l't
MANRY V., P · RALDI M., 0 4 - « Le lien et le gain. Le march e aux ptl · • d Marseille: une aberration economique? ».In Barbe N., I 111 0u h S. (sous la direction de) : Economies choisies ?, Paris, h llti n de la MSH: 39-58.
Pt ' llAI.D t M. (dir. ), 2001- Cabas et containers . Activites marchandes l11jormelles et reseaux migrants transfrontaliers . Paris, M d nneuve et Larose, 361 p.
Pt 1. IMERIS P, 1998 - Urban Decline and the New Social and l•t h n i Divisions in the Core Cities of the Italian Industrial l l'iangle. Urban Studies , 35 (3) : 449-465.
Pt N · N G. , 2002 - Political Government and Governance: Strategic Planning and the Reshaping of Political Capcity in Turin. /111 rnational]oumal ofUrban and Regional Research , 26 (3): 477-493.
Pu .uESE E., 2002 - Lltalia tra migrazioni internazionali e migra..loni interne. Bologna , Il Mulino.
S .IIMIDT DI FRIEDBERG 0 ., 2002- « Du local au transnational. Les 1 • aux economiques et les activites d'entreprise des Marocains a M II an et Turin ». In Cesari ]. (so us la direction de) : La M di.terranee des reseaux. Marchands, entrepreneurs et migrants
1'111 re !'Europe et le Maghreb, Paris, Maisonneuve et Larose.
:tt MOLL C., 2004- Une place marchande cosmopolite. Dynamiques 111/gratoires et circulations commerciales a Naples. These de docto-1'11 1, universite Paris X-Nanterre.
SI'Mt G., 2004 a - Le multiculturalisme quotidien : Porta Palazzo
I' ll Ire commerce et conflit. These de doctorat en co tutelle , lJn iversita di Torino et EHESS-Paris.
St1Mt G., 2004 b- Il quartiere che (si) distingue. Un caso di "gentl'l f'i ation " a Torin. Studi Culturali, 1: 83-107.
St:Mt ., 2005- « Ch ez Said» a Turin, un exotisme de proximite. l•t/m ologie fram;;aise, 1 : 27-36.
St1Mt ., 2006- « Il ritorno dell'economia di bazar. Attivita commert' lnli marocchine a Porta Palazzo, Torino ». In Decimo F, Sciortino G. ( ou Ia dir ction d ) : trcm icri in Ttalia, vol. 4, Bologna, Il Mulino.
IMON 1. , I - La so< i tr p1111W'i' , I clnti n int r thniques et
lll i' lt'i n . t·. dan 1111 qllttlh 1 ''' 111111 11 11 11 . • CIIiicrs lntcrnettlo
'"'" r/r P1IPIP,1•11' , 'lH I t l I II
SMI III N ., I I evan hisL
- The New Urban hollllt' t, •t'lllt(flwtfoll and Lhe iLy. London and New York, R u tl cl .
M IT! I N., 2003 - « La gentrification generalisee : d'une anomalie lo ·a l a l.a "regenera tion" urbaine comme strategie urbaine globa l ». In Bidou-Zachariasen C. (dir.) : Retours en ville, Paris, I artes & Cie.
Z I< IN 5., 1991 - Landscapes of Power. From Detroit to Disney World . Berkeley, University of California Press.
Z KlN 5. , 1995- The Cultures of Cities. Oxford, Blackwell.
rtie 2
rajectoires t ruptures
geopolitiques