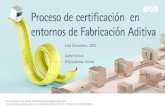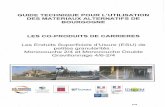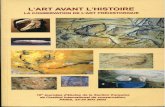H. Cicutta / N. Froeliger / M. Scholz, Les enduits peints de la place du Château à Strasbourg :...
-
Upload
uni-frankfurt -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of H. Cicutta / N. Froeliger / M. Scholz, Les enduits peints de la place du Château à Strasbourg :...
Peintures et stucs d’époque romaine. Révéler l’architecture par l’étude du décor, p. 27-41
Les enduits peints de la place du Château à Strasbourg : résultats préliminaires
Heidi CiCutta*, NatHalie Froeliger**, Markus sCHolz***
* Chargée d’opération et de recherche à l’Inrap, Strasbourg. ** Toichographologue, Inrap Grand Est-Nord, Metz.
*** Chercheur au RGZM et vice-président de “Ductus”.
RésuméDeux plaques d’enduits peints ont été retrouvées sur les deux faces d’un tronçon de mur en adobe effondré sur un sol antique, dans une tranchée profonde, au cours d’un suivi de réseau sur la place du Château à Strasbourg. L’opération réalisée par l’Inrap en 2012 a permis la dépose de ces deux peintures dont l’étude est en cours. Cette découverte est d’autant plus intéressante que ce mur peint fait partie d’un des bâtiments du camp militaire de la VIIIe légion Auguste d’Argentorate. Ces deux décors s’inscrivent dans des panneaux sur fond blanc et présentent, pour l’un, une guirlande rouge accrochée par des rubans verts noués à son cadre et pour l’autre, un personnage en pied vêtu d’un manteau avec, dans chaque main, un bâton et mis en scène au sein d’une architecture fictive. Deux graffiti en latin incisés accompagnent ce personnage qui pourrait être un philosophe1.
1 Nous remercions vivement toutes les personnes qui, au cours des débats suivant notre communication, nous ont apporté leur avis et des suggestions ainsi que tous nos endurants relecteurs et plus particulièrement A. Carbillet. Les hypothèses proposées ici n’engagent bien évidemment que les auteurs.
♦Fig. 1. La place du Château en cours de travaux avec indication des zones de fouille, vue depuis la cathédrale au nord-ouest. La flèche précise le lieu de découverte du mur peint
(cl. H. Cicutta, Inrap).
28 Heidi Cicutta, Nathalie Froeliger, Markus Scholz
Dans le cadre du projet d’aménagement de la place du Château par la communauté urbaine de la ville de Strasbourg, une fouille préventive a été prescrite par le service régional de l’archéologie d’Alsace et réalisée par l’Inrap sous la direction de H. Cicutta, du 2 juillet au 5 octobre 2012.
La prescription concernait une tranchée de suivi de réseau (zone 5) et quatre zones de fouilles positionnées en fonction des futures implantations de bosquets d’arbres (zones 1, 2 et 4) et de la construction d’un local technique (zone 3) (fig. 1).
Cette fouille est d’un intérêt scientifique majeur : localisée au pied de la cathédrale, elle se situe dans l’emprise du camp romain de la VIIIe légion Auguste en garnison à Strasbourg dès la fin du ier siècle p.C.
Contexte arChéologique et méthodologie (h. CiCutta)
Contexte archéologique
La tranchée réalisée pour enfouir une canalisation traverse une partie de la place du Château d’ouest en est, sur une longueur de 50 m. D’une largeur d’1,10 m – largeur du blindage – et d’une profondeur moyenne de 3 m, elle a livré un tronçon de mur antique en terre crue (fig. 3), effondré d’un seul tenant en partie sur un sol de béton (fig. 2) et en partie sur le négatif comblé d’un autre mur (fig. 4). Les vestiges de ce mur antique en adobe ont retenu l’attention des archéologues à plus d’un titre. En effet, le lieu de découverte se situe dans la partie antérieure du camp romain, la praetentura, au sud-est de la via praetoria et au sud-ouest de la via principalis 2. Situé théoriquement dans la partie appelée scamnum tribonorum qui abrite les maisons des tribuns, le mur découvert pourrait appartenir à l’une d’elles. Néanmoins, l’appartenance à un logement de centurion, à la tête d’une des baraques occupant également la praetentura, est aussi envisageable. D’autre part, le tronçon de mur en question présentait l’intérêt d’avoir conservé des enduits peints sur ses deux faces. La nature du mur – construit en adobe – n’apporte aucun renseignement particulier sur sa datation, du fait que les fouilles récentes dans l’emprise du camp ont montré que l’architecture en terre et en bois sur solin en pierre y était prédominante pendant tout le Haut-Empire et a pu perdurer jusqu’au ive siècle. Dans l’attente de l’exploitation des données de terrain et au seul vu de la position altimétrique du mur, nous ne pouvons proposer comme datation provisoire qu’une fourchette large située autour du iiie siècle p.C.
Méthodologie
Ce tronçon de mur effondré était malheureusement entaillé de toute part par des structures en creux plus récentes à l’avant comme à l’arrière de la coupe (fig. 3). La première peinture conservée de ce mur (fig. 2 : peinture 1) a été dégagée à partir de la coupe, en fouillant les couches qui la scellaient.
Une bonne couverture photographique et un relevé graphique à l’échelle 1/1 de cette première face peinte ont pu être réalisés avant son prélèvement en motte.
La fouille des briques en adobe a permis d’accéder avec précaution au revers du mortier de l’autre face peinte (fig. 2 : peinture 2). Ce mortier est apparu extrêmement friable et mince et de ce fait, a nécessité une consolidation avec un encollage à l’aide de gaze et de paraloïd B72® dilué à 20 % dans de l’acétone3.
Une grande plaque (105 x 68 cm) et une plus petite (37 x 29 cm), distantes l’une de l’autre de 5 cm, constituent cette deuxième peinture (fig. 4). Leur dépose a pu s’effectuer correctement en dépit des conditions d’inter-vention en suivi de réseau.
2 Voir dans ce volume, Thorel & Kuhnle, p. 9-26 et notamment fig. 2 n° 4.
3 Sur les conseils de M. Mondy et de N. Froeliger, Inrap.
♦Fig. 2. Détail en coupe du mur effondré (cl. H. Cicutta).
29Les enduits peints de la place du Château à Strasbourg
♦Fig. 3. Vue du mur en stratigraphie et de la peinture 1 en plan (cl. H. Cicutta).
♦Fig. 4. Vue des deux fragments d’enduits peints de la peinture 2 reposant face contre sol, en cours de consolidation (cl. H. Cicutta).
30 Heidi Cicutta, Nathalie Froeliger, Markus Scholz
les peintures (n. Froeliger)
Peinture 1
Description
La première face visible présente un décor sur fond blanc de panneau délimité par une bande rouge bordeaux, doublée d’un filet noir de part et d’autre. Dans ce panneau, s’inscrit une guirlande rouge bordeaux agrémentée de doubles filets verts retombant à espaces réguliers. Cette guirlande s’accroche, d’une part, au filet noir vertical du cadre intérieur par un nœud vert et, d’autre part, par un système d’attache non visible au sommet du cadre, le haut du panneau étant en partie tronqué à l’extrémité de la plaque (fig. 3 et 6). Cette lacune empêche donc de distinguer un hypothétique nœud vert central auquel pourraient appartenir les rubans verts en zigzag pour suspendre la guirlande au cadre supérieur. Ces rubans verts ondulés pourraient toutefois accompagner un autre motif central tel un clipeus, comme c’est par exemple le cas pour l’ensemble 2 de la place Saint-Thomas à Strasbourg4. En l’absence de nœud ou de motif central, la guirlande peut simplement passer par-dessus le filet intérieur horizontal noir avant de retomber de l’autre côté de manière symétrique (fig. 5). Les rubans ondulés verts, dans ce cas, seraient peut-être à rattacher au filet vert présent sous la guirlande entre les deux festons mais que l’on distingue mal en raison d’une lacune. Au-dessus du panneau, sur le filet noir extérieur, se développent ce qui semble être des entrelacs verts ou des volutes. Des petits fragments ramassés lors de la fouille, à proximité de la plaque, ont livré des éléments de boucle verte sur fond blanc pouvant appartenir à ce décor de console fictive au-dessus du cadre (fig. 5). Un tracé préparatoire incisé a servi de repère à l’exécution de la guirlande et le sens de lissage est vertical (fig. 6).
4 Schnitzler et al. 2012, fig. 1 et p. 104.
0 50 cm
Document et DAO: Froeliger N.
♦Fig. 5. Essai de restitution partielle du panneau de la peinture 1 avec ou sans nœud au-dessus du motif central (N. Froeliger, Inrap).
31Les enduits peints de la place du Château à Strasbourg
Comparaison
Le décor reconstitué de l’un des murs du praetorium du camp d’auxiliaires de Ladenburg5 – camp I abandonné peu après 106 p.C. – offre une comparaison à cette peinture (fig. 7). Cette reconstitution présente en zone supérieure, des panneaux ornés de guirlandes assez semblables à celui mis au jour place du Château à Strasbourg avec également des volutes au-dessus du cadre. Reste à savoir si le panneau de Strasbourg se trouvait lui aussi en zone supérieure. La guirlande étant un motif récurrent dans l’iconographie antique, la simple ressemblance avec le décor du praetorium du camp de Ladenburg, ne suffit pas à justifier une position sur la paroi en zone supérieure pour le panneau de Strasbourg.
Essai de restitution
La largeur du panneau a été restituée par symétrie grâce aux éléments de décor conservés sur la partie droite de la plaque (fig. 5). Quant à la question de la position de ce panneau à guirlande en zone supérieure, le contexte archéologique ne permet pas d’y répondre. En effet, le mur effondré n’a pas été conservé dans sa totalité et sa base n’a pas été retrouvée (fig. 3). Ainsi, il nous est impossible de repositionner ce panneau sur une zone précise de la paroi au regard de ces seules informations. Le décor – situé en partie haute de panneau – mais aussi la présence d’inscriptions au revers peuvent cependant nous renseigner sur sa position initiale. La peinture 1 se trouve probablement à hauteur de main d’homme, au regard des graffiti de la peinture 2 de l’autre côté du mur6. Nous pouvons dès lors suggérer que leur hauteur n’excède ainsi pas les 2 m pour rester à portée de la main, sans exclure toutefois une place plus haute en zone supérieure. Il est toujours possible de grimper sur des bancs pour exécuter un graffito mais cela reste peu probable. Par ailleurs, ces panneaux ne se trouvaient certainement pas en zone inférieure. En effet, les graffiti ayant pour partie été réalisés dans le bas du panneau, une position proche du sol aurait rendu fort inconfortable et malaisée leur exécution. La seule information que nous livre l’analyse du mode d’effondrement du mur concerne les dimensions de la pièce à laquelle appartient la peinture 2. En effet, le mur ayant chuté jusqu’à l’emplacement de celui d’en face – alors déjà effondré ou disparu – (fig. 4), l’espace ainsi défini entre les deux murs ne devait pas être très grand.
5 Reddé et al. 2006, pl. III-IV et 440.
6 Barbet 2012.
0 50 cm
Tracé préparatoire incisé
Sens de lissage
Relevé: Gaston C. et DAO: Froeliger N.
♦Fig. 6. Relevé et dessin de la peinture 1 (relevé C. Gaston, DAO N. Froeliger).
32 Heidi Cicutta, Nathalie Froeliger, Markus Scholz
Peinture 2
Description
La deuxième peinture est constituée de deux plaques de 105 cm x 68 cm et de 37 cm x 29 cm. Comme les enduits peints de l’autre côté de la paroi, ce décor est peint sur fond blanc (fig. 8 et 9). Sur la plus grande plaque conservée, le panneau de gauche prend appui sur une base moulurée fictive et abrite un personnage représenté en pied sur cette même base. Le côté gauche du cadre de ce panneau manque, mais on peut estimer ses dimensions à 40 x 56 cm. Le cadre est peint en rose, bordé de filets noirs et souligné intérieurement par deux filets jaunes de part et d’autre d’un trait rose. La corniche fictive moulurée est traitée en une alternance de traits et filets ocre jaune en camaïeu et se poursuivait peut-être sur toute la longueur de la plaque mais nous n’en avons pas la preuve. Le personnage est pieds nus, vêtu d’un simple manteau dont un pan est enroulé autour de son bras gauche, lui laissant l’épaule droite et une partie du buste dénudées. Ce vêtement qui tombe jusqu’aux mollets est réalisé dans des teintes ocre jaune avec des rehauts de rouge bordeaux et blanc crème pour marquer les plis du tissu. Le personnage tient deux bâtons, un dans chaque main. Le bâton sur lequel il semble s’appuyer de la main gauche ne repose pas directement sur la base moulurée matérialisant la ligne de sol mais se termine dans le champ blanc, sans effet d’ombre portée au sol. Cet objet torsadé est peint en rose foncé avec des rehauts rouge bordeaux et blanc crème et présente un renflement bifide à sa base. Une lacune au niveau de la main gauche empêche de distinguer correctement la main qui le tient ; seule est visible une partie de l’articulation des doigts fermés autour de l’extrémité qui se termine en pointe.
♦Fig. 7. Reconstitution de la peinture du praetorium de Ladenburg (dessin C. Nübold, Sommer 2000b ; Reddé et al. pl. IV et p. 440).
33Les enduits peints de la place du Château à Strasbourg
Une autre lacune, au niveau de la main droite, cette fois, s’interrompt juste au niveau des doigts qui tiennent une sorte de tige végétale peinte en vert avec des rehauts de rouge bordeaux, et dont l’extrémité légèrement courbe était pour partie recouverte d’une fine couche d’enduit à l’état de trace.
Les parties dénudées sont traitées dans un camaïeu de rose et rose crème et les zones ombrées sont rehaussées de rouge bordeaux. Les yeux, la bouche, les sourcils sont peints en rouge bordeaux. La chevelure, également rouge bordeaux, semble être couronnée par une tresse peinte en rehauts plus foncés et retomber à l’arrière de l’épaule. Une lacune masque en partie le bas du visage. Son regard, du point de vue du spectateur, se porte vers la droite, direction vers laquelle sont également tournés le pied gauche et son corps représenté de trois-quarts.
Ce personnage semble donc se diriger vers la droite de la composition qui présente, séparé du panneau de gauche par une large bande verte, un décor architecturé. Il prend la forme d’une colonnade traitée en perspective et dont la ligne de fuite monte vers la droite. Deux des trois colonnes de cette dernière, sont peintes en imitations de marbre, de part et d’autre d’une colonne torsadée. Ces imitations de marbre sont traitées de façon assez schématique. Les veinures sont représentées de la même manière pour les deux colonnes, alors que la couleur de fond change de l’une à l’autre. L’une est de couleur blanc crème et l’autre grise. Leurs bases moulurées brunes sont rehaussées de noir pour indiquer les jeux d’ombre et de relief. La colonne la plus à gauche semble être couronnée par un chapiteau jaune orangé dont l’extrémité se termine par une sorte de volute – qui peut rappeler le chapiteau ionique – et sa base repose probablement sur la même corniche que le personnage. La colonne torsadée est peinte en jaune orangé avec des rehauts de rose crème. Une guirlande de feuillage stylisé bleu avec des rehauts de bleu plus foncé, accrochée aux deux extrémités de la colonnade, anime cette dernière. La colonnade se
♦Fig. 8. Grande plaque de la peinture 2 (cl. N. Froeliger).
♦Fig. 9. Petite plaque de la peinture 2 (cl. N. Froeliger).
34 Heidi Cicutta, Nathalie Froeliger, Markus Scholz
termine à droite par une bande rose verticale moins large que la bande verte à gauche. Cette bande rose de 3,8 cm de large est bordée de traits bruns délimitant à l’extrémité droite de la plaque un champ rose orangé. Le décor architecturé est présent également sous la forme d’un édicule à fronton, qui tient lieu d’écrin au personnage. Le fronton de cet édicule est conservé pour partie sur la petite plaque (fig. 9). Il est orné d’une part d’un entablement et d’un rampant moulurés, traités avec la même alternance de jaunes plus ou moins foncés que pour la corniche fictive, et d’autre part d’antéfixes rouges et jaunes. Le tympan est peint en vert et il est souligné de traits noirs discontinus sur tout son pourtour intérieur. L’écoinçon au-dessus du fronton est délimité dans sa partie supérieure par un double filet rouge bordeaux et jaune accolé à un champ vert. Une bande rouge bordeaux sur le côté droit de l’écoinçon, le sépare d’un autre compartiment. Ce compartiment mitoyen, à l’aplomb de la colonnade, est orné de motifs beige-crème représentant peut-être de légers voilages dont les rehauts plus foncés restituent un effet de drapé ; il est délimité dans sa partie supérieure par le retour de la bande rouge bordeaux associée au même filet jaune accolé du champ vert commun à l’écoinçon (fig. 9). La largeur de ce compartiment n’est pas connue et aucun indice ne nous permet de connaître la transition entre cet espace et la colonnade en dessous.
Le sens de lissage est vertical partout sauf à l’extrémité haute de la petite plaque où il devient horizontal, indice d’une interruption dans l’élévation. La présence d’une baie est possible au-dessus du personnage. Le champ blanc et une partie du décor, dont le bout du bâton recourbé, à l’extrémité gauche de la plaque sont par ailleurs recouverts sur plusieurs centimètres d’une fine couche d’enduit, ce qui ne peut s’expliquer que par la présence d’un retour du mur, si ce panneau était à proximité d’un angle de la pièce, ou par une réfection. Un retour de mur est cependant peu probable dans la mesure où cette couche d’enduit ne recouvre pas sur toute sa hauteur l’extrémité gauche de la plaque. La mise en œuvre en est peu soignée par ailleurs. Ce rajout de mortier ne subsiste plus qu’à l’état de trace au niveau du bâton recourbé mais recouvre encore considérablement l’extrémité gauche de la base moulurée fictive. De nombreux tracés préparatoires incisés déterminent le positionnement des panneaux et de leurs bandes, des colonnes, du fronton, ainsi que l’emplacement de la guirlande et du pied droit du personnage (fig. 10). Les imitations de marbre et la base des colonnes sont grossièrement peintes, sans souci de réalisme, de même que la guirlande de feuillage est de facture rapide sans véritable modelé. Les proportions du personnage sont parfaites même si un léger décalage du buste par rapport aux jambes lui confère une sorte de déhanché. Cette posture singulière, qui pourrait être assimilée à une exécution maladroite de la part du peintre, peut fort bien trouver une explication dans le fait que le personnage est représenté plutôt sur le mode de l’exhibition, comme s’il tenait de la main gauche un trophée. Si le personnage avait été représenté en appui sur un bâton, il aurait assurément eu le torse porté plus en avant alors que c’est ici l’impression inverse qui s’en dégage. Le buste est légèrement porté en arrière et cette impression de déhanché est renforcée par sa représentation de trois quart.
Interprétation
Le peintre a pourvu le personnage de deux attributs : une sorte de bâton très tortueux qu’il tient de la main gauche et un élément végétal évoquant un pedum – bâton de berger recourbé à son extrémité pour attraper les pattes des chèvres – qu’il tient de la main droite. Bien qu’il puisse s’apparenter à un cep de vigne, le bâton sinueux n’est pas sans évoquer un serpent. La base renflée et légèrement bifide, telle une gueule béante et prête à mordre, se termine dans le champ blanc. Le serpent est un animal très présent dans l’iconographie antique. L’évocation sinueuse de cet animal nous avait donné à penser en première hypothèse que nous pouvions être en présence de la personnification de la fille du dieu de la médecine, Hygie, habituellement représentée en compagnie de son père Esculape dont l’attribut principal est le bâton enroulé d’un serpent. L’épaule droite dénudée laisse en effet apparaître un sein ou un pectoral très marqué par des rehauts de peinture rouge bordeaux donnant un effet de relief conséquent ; d’autant que la chevelure pourrait être longue et tomber derrière les épaules. Cependant, l’allure générale semble plutôt être celle d’un homme au vu de la représentation des chevilles, un peu fortes pour une femme. Aucun bijou, par ailleurs, ne vient embellir cette figuration et le vêtement est tout de même plus en conformité avec une certaine austérité que l’apanage de l’élégance féminine. Le manteau porté comme un himation évoque en effet plutôt la tenue des philosophes, des écrivains et des orateurs. Le pectoral est très marqué certes, avec une impression de relief rendu par les rehauts de peinture plus sombre, mais les côtes sont traitées un peu de la même manière, ce qui donne une impression de corps massif mais sans embonpoint, pour ne pas dire avec les côtes saillantes. Les épaules tombantes renforcent cet aspect. En outre, si l’on admet que l’objet que tient le personnage dans la main gauche est bel et bien un bâton de pèlerin, il devient sans conteste l’élément déterminant pour une représentation masculine puisqu’il est l’attribut classique des philosophes dans l’Antiquité. L’autre bâton tenu de la main droite, vraisemblablement un pedum, est également un attribut masculin7. Il n’y a évidemment pas d’inscription peinte qui aurait permis une identification certaine. Par ailleurs, les deux inscriptions incisées ne permettent pas d’assurer avec certitude l’identité de ce personnage. Elles ne font que donner une piste en rapport avec la philosophie et la boisson. Si le vêtement du personnage et le bâton qu’il tient dans la main gauche nous orientent, de prime abord, vers cette interprétation, peut-on émettre, pour autant, l’hypothèse d’une effigie de philosophe8 ? La lacune partielle au niveau du bas
7 Les faunes et satyres qui peuplent les paysages idylliques sont souvent pourvus du pedum et vêtus de peaux de bête sur les épaules, comme pouvait l’être Mars Sylvanus. Ascagne, le fils d’Énée, porte le pedum également et le bonnet phrygien.
8 Cette interprétation avait reçu l’agrément d’A. Barbet et de J.-Y. Marc lors des débats suivant notre communication.
35Les enduits peints de la place du Château à Strasbourg
du visage ne permet pas d’attester la présence ou l’absence de barbe, attribut premier du philosophe au même titre que le manteau, et avant même le bâton tortueux. On peut seulement distinguer directement sous l’ombre du nez l’esquisse de ce qui semble être une petite bouche, auquel cas le menton serait assurément glabre (fig. 11). Les traits du visage sont fins et semblent peu marqués par les années et la chevelure n’est apparemment pas celle d’un vieillard car elle n’est pas grisonnante. Tous ces critères ne correspondent évidemment pas au schéma habituel des représentations de philosophes. De même, le pedum, n’est pas un attribut classique pour un philosophe. Cependant, l’extrémité courbe du bâton était masquée par la fine couche d’enduit qui recouvrait tout le côté gauche du panneau. Cette réfection, volontaire ou non, rendait dès lors méconnaissable cet attribut qui pouvait ainsi être interprété plutôt comme un radius – bâton de géomètre – pour tracer au sol les démonstrations pendant les cours d’astronomie. Aussi, tous ces critères inhabituels ne doivent pas être totalement discriminants pour écarter une représentation de philosophe.
♦Fig. 10. Relevé et dessin de la peinture 2 (DAO N. Froeliger).
36 Heidi Cicutta, Nathalie Froeliger, Markus Scholz
Comparaisons
Les figurations de philosophes connues les présentent presque tous de la même manière : parfois debout, la chevelure et la barbe grisonnantes, vêtus d’un seul manteau leur laissant une épaule dénudée et appuyés sur un bâton tortueux comme c’est le cas dans la mégalographie de la villa de P. F. Sinistor de Boscoreale9. Le personnage de cette fresque, représenté en tant que spectateur d’une scène et en pleine méditation, a pu être interprété comme le philosophe Démétrius de Phalère, sans aucune certitude toutefois. Mais le plus souvent les philosophes sont représentés assis comme, par exemple, dans le décor des thermes des Sept Sages à Ostie10. Dans ce cas, une amphore représentée sur l’un des murs dans la même pièce fait référence, au même titre que le cep de vigne, à la boisson dionysiaque. Une effigie de Socrate, par exemple, représente le philosophe comme un vieillard assis avec son bâton et son manteau dans la maison H2/7 à Éphèse11. D’autres figurations de philosophes les présentent cependant dans leur jeunesse en tant que disciples d’un maître illustre par exemple. La mosaïque de la maison des Auteurs grecs à Autun, malheureusement très lacunaire, propose le portrait du disciple d’Épicure, Métrodore. Il apparaît sous les traits d’un homme jeune, chauve et barbu. La célèbre mosaïque des sept philosophes de Pompéi au musée de Naples nous offre à voir également des philosophes dont certains sont jeunes, mais qui tous sont barbus. Cependant, une statue, appartenant au programme décoratif de la villa des Papyri à Herculanum, revêt l’apparence d’un homme jeune et imberbe représenté en pied et vêtu de l’himation. Il ne porte aucun attribut. L’hypothèse que cette représentation pourrait correspondre au chef d’état athénien et, non moins orateur, Démétrius de Phalère, a été proposée sur l’argument que ce dernier s’intègre parfaitement dans la thématique dédiée à l’épicurisme en tant que personnalité contemporaine du célèbre fondateur de cette philosophie12. La présence en grand nombre des œuvres du philosophe épicurien, Philodème de Gadara, semble confirmer l’intérêt que Pison, propriétaire de cette villa, portait à la philosophie épicurienne, ce qui pourrait justifier un programme décoratif exclusivement dédié au chef de file de cette philosophie dans cette demeure. Cependant, cette statue n’étant pas accompagnée d’inscription, il est de mise de rester prudent quant à son interprétation. Pourrait-il s’agir de Démétrius de Phalère, représenté sur le modèle du jeune orateur imberbe sur le mur de Strasbourg ? La forme serpentiforme du bâton peut évoquer l’aspic responsable de la mort du philosophe rhétoricien lors de son exil en Égypte. Tout du moins, il est possible que les spectateurs qui ont laissé leur témoignage sur le ton de la plaisanterie au travers de leurs graffiti aient interprété ces attributs comme tels, ce que tend à suggérer leur allusion à un certain Démétrius, philosophe. Nous ne disposons pas de représentation de Démétrius de Phalère jeune et imberbe avérée par une inscription. Pour notre part, nous ne privilégierons aucune hypothèse concernant l’intention première du peintre. Les colonnes de marbre et la guirlande de feuillage sont peintes de façon schématique, et il en est de même pour les attributs du personnage qui sont difficilement identifiables sans ambiguïté. Sur le mode de la simple évocation, le peintre a fait appel à l’artificiosa memoria de tout un chacun en ne nommant pas par une inscription peinte ce personnage. Avec ses pieds nus, un manteau pour seul vêtement, les attributs qu’il tient en main – soit un cep de vigne en guise de bâton de pèlerin, soit un serpent encore tout frétillant et prêt à mordre – ce personnage apparaît comme humble et itinérant, rustique même. La ressemblance du bâton de pèlerin avec un cep de vigne peut également évoquer l'attribut du centurion romain. La présence du pedum confère un caractère champêtre au personnage dans un premier temps, aspect qui disparaît à la suite de la réfection dans l’enduit, dont on peut se demander si elle participe d’une volonté de rectifier le décor. Le pedum pourrait dès lors être considéré comme un radius. Le personnage n’est pas placé dans un paysage idyllique et aucun autre élément végétal n’a été peint pour y faire allusion. La simplicité du personnage est ainsi mise en exergue par rapport à la richesse et l’opulence du décor architecturé environnant, caractérisées par la présence des colonnes de marbre qui peut également participer de l’évocation d’une stoa dans laquelle des cours étaient prodigués (philosophie, géométrie...).
Essai de restitution
Quant à l’organisation du décor, il faut peut-être restituer à l’extrémité droite de la plaque, par effet de symétrie, une autre colonnade en perspective avec le même point de fuite que celle de la plaque. Dans ce cas de figure, la présence d’un édicule central au point de rencontre des deux colonnades pourrait être envisagée. Toujours par effet de symétrie, il serait envisageable de restituer à la suite de la colonnade, un nouvel édicule abritant une autre figuration sur le modèle d’une galerie de personnages en pied – poètes, philosophes, écrivains – mis en scène dans un décor d’architecture fictive. C’est le cas, par exemple, dans une pièce de l’Insula Occidentalis à Pompéi13, interprétée comme une bibliothèque, où des écrivains cette fois, sont présentés dans des niches en trompe-l’œil, dans le IIe style allégorique le plus pur. Le décor architecturé qui entoure le personnage participe, certes, à la mise en scène de la paroi, mais il n’en est pas l’élément essentiel car il est à la même échelle que le personnage ; la zone médiane se retrouve ainsi compartimentée sur plusieurs registres. L’édicule de la peinture de la place du Château à Strasbourg, mesurant un peu moins d’un mètre de hauteur, ne remplissait assurément pas seul tout
9 Sauron 1993.
10 Von den Hoff 1994, 191.
11 Croisille 2005, fig. 163 et p. 127.
12 Sauron 2009.
13 Sauron 2007, fig. 121 et 190.
37Les enduits peints de la place du Château à Strasbourg
l’espace de la zone médiane. À Mercin-et-Vaux, cette zone est décorée d’édicules à fronton occupant entièrement l’espace, ce qui confère une plus grande unité dans la composition de la paroi ; il en est de même pour l’un des murs peints du Palais impérial de Trèves, aujourd’hui au musée de la ville. Cette compartimentation sous la forme d’édicules à fronton de taille relativement modeste aurait pu s’inscrire en zone supérieure, mais il aurait alors été nécessaire à l’auteur de la première inscription de monter sur un banc pour exécuter celle-ci, de même que pour le second “graffiteur”, ce qui est fort improbable. Quant à l’étude des graffiti, nous avons eu pour les déchiffrer et les traduire, l’aide précieuse de M. Scholz14.
les graffiti (m. sCholz et n. Froeliger)
Ces inscriptions concernent la signification philosophique et idéologique que l’on peut attribuer à la boisson et ne renseignent pas, par conséquent, directement sur l’identité du personnage. Elles peuvent néanmoins offrir des pistes de réflexion.
La première inscription incisée dans le champ blanc, à droite de l’épaule du personnage, présente des lacunes contrairement à la deuxième inscription, gravée au niveau de ses pieds, qui est intégralement conservée.
Pour la première inscription, nous pouvons lire (fig. 11 et 12) : [D]EME TRIVS[¹-³]VSSO ET <C ou I>CASSIO [SALVE]TE BIBETLe texte peut être complété comme suit :[D]emetrius / [¹-³]usso et <C ou i> / Cassio [salve] / te bibetCe qui peut être traduit comme ceci : “Démétrius trinquera à toi avec [---]ussus et Cassius sainement”.Le nom de Demetrius a pu être reconstitué grâce au deuxième graffito au niveau des pieds du personnage dans lequel
ce nom est inscrit à nouveau et en entier. L’espace entre les lettres E et T de [D]EME TRIUS est un peu trop large, mais on retrouve cette anomalie dans les lignes suivantes entre les lettres O et E et entre les lettres I et O de CASSI O. De même dans le deuxième graffito, un espacement existe entre le M et le E de Dem etrius ainsi que dans le mot filo sopus. S’agit-il d’une figure de style ? Ou bien l’auteur a-t-il été gêné par une lacune dans l’enduit qui l’aurait obligé à laisser un espacement dès le premier mot et dans les lignes suivantes ?
Les lettres R et S de DEMETRIUS sont les deux seules ornées d’un empattement. Cette figure de style n’a pas été poursuivie par la suite. Le graveur a apparemment peiné à former son premier O avec des rondeurs à en juger d’après tous les traits qui se superposent. C’est la raison pour laquelle, il a choisi pour le suivant de le graver en forme de losange.
14 Merci à G. E. Thüry (Waldenbuch) pour ses conseils avisés ainsi qu’à G. Kuhnle pour sa participation à ce travail collectif qu’elle a rendu possible en organisant notre rencontre avec M. Scholz.
♦Fig. 11. Graffiti à proximité de la tête du personnage de la peinture 2. (cl. N. Froeliger).
38 Heidi Cicutta, Nathalie Froeliger, Markus Scholz
Au début du nom [---]USSO, il ne manque qu’une, deux ou trois lettres, mais il reste néanmoins trop de possibilités pour pouvoir le reconstituer. La plupart des noms appropriés sont d’origine provinciale, particulièrement de la Gaule de l’Est et de la Rhénanie, par exemple Blussus, Bonussus, Cintussus, Bricussus, Cussus, Ianussus, Marcussus ou Ussus. Ce fait s’applique aussi aux noms en –ossus comme par exemple Cossus, Dossus ou Mossus15.
L’auteur semble initialement avoir décidé de commencer le nom Cassius après ET, mais il aurait changé d’avis avant d’avoir fini la lettre C pour recommencer à la ligne suivante. Dans cette dernière, ne restent de l’adverbe SALVE que le début du S, le sommet du A avec un petit crochet ressemblant au A de Cassius, le début presque horizontal du L cursif et les pointes du V ainsi que le trait inférieur du E. La quatrième ligne est claire bien qu’il manque le troisième trait horizontal du E de BIBET, c’est d’ailleurs le cas également pour le E de ET en deuxième ligne.
La place de ce graffito ne semble pas avoir été choisie par hasard, dans le champ blanc à proximité de la tête du personnage comme pour lui faire porter ce toast en personne.
La deuxième inscription au niveau des pieds de la figure peinte a été gravée assurément par une autre main, d’une écriture plus cursive, comme en réponse à la première. Elle peut être lue comme suit (fig. 13 et 14) :
DEM ETRIUS FILO SOPUSET CALDAS OLA BIBETCes deux phrases peuvent être complétées comme suit :Demetrius filosopus (est) / et caldas (aquas) ol(l)a bibetCe qui peut se traduire de différentes manières :“Démétrius est philosophe et il boira16 le bouillon à la marmite” ou “au gobelet” ; ou bien “Démétrius est philosophe
et il boira les eaux thermales au gobelet”.Une autre traduction est possible encore :“Démétrius, le philosophe, boira même les eaux chaudes au gobelet”.Les lettres C, O, R, M et S se distinguent particulièrement bien de celles du premier graffito. L’écriture est caractérisée
par les formes cursives comme le C, D ou E et par la présence d’un seul trait horizontal pour le E de ET et le F de FILOSOPUS.
15 Mócsy 1983, 391.
16 Nous remercions N. Blanc pour nous avoir très justement signalé notre erreur concernant le temps auquel nous avions conjugué le verbe bibo dans nos traductions lors de notre communication.
♦Fig. 12. Relevé des graffiti hauts (relevé M. Scholz, RGZM Mayence).
39Les enduits peints de la place du Château à Strasbourg
Demetrius est un nom grec qui est fréquemment attesté dans sa version latine dans l’ouest de l’Empire Romain17.Filosopus est la transcription latine du mot grec philosophos (φιλόσοφος). Le début du deuxième mot de la seconde
ligne se lit aisément comme ca-, mais la lettre suivante pose question et elle est à restituer comme un L dans la mesure où l’auteur aurait intégré dans son inscription, le tracé préparatoire incisé pour l’emplacement du pied du personnage. En effet, ce tracé n’a pas été incisé dans l’enduit sec comme le reste du graffito mais bel et bien dans l’enduit frais, avant l’application de la peinture car le fond de l’incision est peint également. Or, ce tracé épouse la forme d’un L et peut ainsi être lu comme tel, dans la mesure où l’auteur du graffito aurait décidé de l’intégrer à sa prose.
La lettre suivante ressemble au D cursif de Demetrius avec peut-être une petite rature, un trait surnuméraire semble avoir été barré d’un autre petit trait ; elle pourrait également être lue comme un Q mais le D est plus probant. Quant à la lettre devant le S terminal, elle peut être interprétée comme un A. Le mot ol(l)a – ici en haplographie – est à l’ablatif.
C’est une figure de style que d’intégrer un tracé préparatoire à un graffito ; cela a nécessité de la part du graffiteur de construire mentalement son inscription autour de ce tracé incisé préexistant, pour l’insérer au bon endroit. Il s’agit de quelqu’un d’assurément cultivé. Ce deuxième graffito se lit comme une réponse au premier. Demetrius est déclaré comme
17 Lőrincz 1999, 96.
♦Fig. 13. Graffiti au niveau des pieds du personnage de la peinture 2 (cl. N. Froeliger).
♦Fig. 14 Relevé des graffiti bas (relevé M. Scholz).
40 Heidi Cicutta, Nathalie Froeliger, Markus Scholz
étant un philosophe dans cette deuxième inscription car il est sensé boire pour une noble cause dans la première et ne pas en profiter pour s’enivrer dans la deuxième, en restant sobre avec une boisson non alcoolisée. La troisième traduction proposée ne va pas tout à fait dans ce sens toutefois, car les eaux chaudes comme les eaux froides d’ailleurs peuvent être mélangées au vin. Dans ce dernier cas, Demetrius serait amené à boire les eaux chaudes mélangées à du vin. Martial évoque, en effet, à propos de frigida et calda (aqua), une technique pour mélanger le vin (Martial, 14, 105).
Le nom même de Demetrius a pu être choisi dans les deux inscriptions en référence à la philosophie grecque, ce qui est un signe de grande culture. Il y avait dans l’Antiquité au moins deux philosophes connus qui s’appelaient Demetrios. L’un d’eux est Demetrios de Phalère (c. 350-280 a.C.), un orateur politicien et philosophe athénien, élève d’Aristote qui est toujours très connu à l’époque romaine. Malheureusement, son œuvre est perdue. On dit qu’il mourut d’une morsure de serpent. Le premier graffito fait peut-être référence dans un premier temps à ce dernier. L’autre philosophe auquel se rapporte peut-être plus précisément le deuxième graffito est Demetrios de Corinthe, un philosophe cynique qui vivait au ier siècle, durant les règnes de Caligula et de Vespasien et qui était un ami et confident de Sénèque18. Ce dernier donne un exemple de son incorruptibilité lorsque l’empereur Caligula lui aurait offert 8000 sesterces, une somme importante pour une personne pauvre, dans le but de l’apitoyer ou de le tenter. Demetrius aurait refusé l’argent en rétorquant qu’il aurait pu être tenté d’accepter l’Empire entier, mais pas cette somme19. Aux iie et iiie siècles, il a dû rester célèbre pour sa vie orientée vers les principes de la philosophie cynique20. La traduction de gobelet est peut-être à préférer à celle de marmite. En effet, l’inscription olla se retrouve fréquemment peinte sur des gobelets. Il est possible que la formulation “boire avec un gobelet” veut faire allusion à une anecdote concernant le philosophe cynique Diogène de Sinope qui préférait mener une vie modeste et exclusivement consacrée à la philosophie en refusant chaque chose superflue : il est relaté qu’il jeta son gobelet quand il remarqua qu’un garçon buvait l’eau à la fontaine avec ses mains21. Diogène était également le célèbre disciple d’Antisthène, fondateur de l’école cynique, et faire boire Demetrius avec un gobelet renvoie peut-être à cette anecdote sous un aspect un rien provocateur. C’est un comble pour un philosophe cynique que de boire du vin dans un gobelet.
En conclusion nous préférons traduire : “Démétrius le Philosophe boira même le vin mélangé aux eaux chaudes – (et ceci) dans un gobelet ! 22”Le message de la conversation livré à travers les deux graffiti est clair : la sagesse et la philosophie préconisent la
sobriété et ne sont pas compatibles avec les boissons alcoolisées, à moins que cette sobriété puisse être transgressée pour une bonne cause : boire à la santé de ses amis ! Avec une allusion précise à une anecdote à la vie du philosophe Diogène de Sinope, en prime. Mais tout ceci est à prendre au conditionnel bien sûr dans la mesure où les restitutions et traductions seraient bien l’une de celles proposées ci-dessus.
Quant au milieu social des graveurs, il faut tenir compte de la fonction du bâtiment, de l’écriture elle-même et des noms propres. Le ductus de l’écriture et le contenu – particulièrement si l’allusion aux philosophes s’avère juste – montrent bien une certaine éducation. Le nom des personnes renvoie plutôt à un milieu régional ou peut-être servile. Pour l’instant, on ne peut que proposer comme hypothèse que les auteurs des deux graffiti étaient peut-être des servants ou esclaves érudits et plein d’humour, agissant dans le logement d’un officier légionnaire – tribun ou centurion par exemple – mais ceci est à mettre au conditionnel. L’acte d’inciser des graffiti dans l’enduit – peint – d’un mur ne constituait en principe pas une “affaire” dans l’Antiquité. Il y a beaucoup d’exemples montrant que plusieurs graffiti étaient placés tour à tour sur l’enduit, non seulement à Pompéi23 mais aussi dans les provinces24. Mais cela n’était possible qu’avec la tolérance des propriétaires ou des autorités25, à moins que ce ne fût à leur insu bien sûr. Du fait de l’absence d’inscription identifiant le personnage, la tentation était sans doute encore plus grande d’y apposer un témoignage comme une réponse à une devinette en quelque sorte.
ConClusion
Les indices archéologiques livrés par la fouille en tranchée étroite ne permettent pas d’attribuer le décor du tronçon de mur mis au jour à une zone précise de la paroi. En revanche, le décor apporte des éléments de réponse : le motif de la peinture 1, de même que les graffiti de la peinture 2 se situent a priori dans la partie haute de la zone médiane tout en restant accessible à la main des graffiteurs. La zone inférieure est exclue. La figuration supposée d’un philosophe représenté dans sa jeunesse et glabre, répondant au nom de Démétrius reste inédite au regard de la documentation consultée. Les représentations
18 Sen., Ep., 20.9 ; 62.3 ; 67.14 ; 91.19 ; Pauly 1901, 2843 ; Kindstrand 1980, 93-98.
19 Sen., Ben., 7.1-2 ; 8-11.
20 Contrairement au second scripteur, le premier ne fait sans doute pas allusion à Démétrios de Corinthe, car il est fort improbable qu’il ait pu reconnaître un philosophe cynique en ce jeune homme imberbe.
21 Diog. Laert., 6.20.
22 En allemand : “Demetrius der Philosoph wird sogar angewärmten Wein trinken – (und das) aus dem Becher !”.
23 Krenkel 1962.
24 Barbet & Fuchs 2008 ; Barbet & Gandel 1997, 271-278 ; Scholz 1998, 41-43.
25 Reuter & Scholz 2004, fig. 6 et p. 11.
41Les enduits peints de la place du Château à Strasbourg
supposées de Démétrius de Phalère qui ont été interprétées comme telles sont toutes sujettes à caution car aucune inscription certaine n’identifie jamais explicitement cette personnalité. La signification des graffiti qui l’accompagnent semble pourtant accréditer cette hypothèse. Il est évident que leurs auteurs sont des témoins privilégiés par rapport à nous car ils avaient sous les yeux l’ensemble du décor et ainsi les clefs de compréhension pour l’interprétation de ce personnage, même si leur témoignage relève plus de l’otium que de l’analyse iconographique. La comparaison avec le décor du praetorium de Ladenburg est intéressante car elle le replace dans un contexte militaire également, même si ce décor de guirlande n’en est absolument pas l’apanage exclusif. Le décor sur fond blanc est sobre, sans superflu. L’étude de ces deux peintures a pu être menée bien en amont de celle du reste du mobilier issu de la fouille, car leur découverte date de l’été 2012 seulement. Ces décors pourront sans doute être datés de manière plus précise par la stratigraphie après étude du mobilier. Par ailleurs, des éléments nouveaux seront peut-être révélés, au retour de la restauration des plaques. Enfin, l’intérêt de ces plaques, en dehors de l’aspect muséographique indéniable qu’elles présentent, réside dans le fait qu’elles ont été découvertes sur un mur effondré dans l’emprise du camp militaire antique de Strasbourg. Un examen plus poussé des graffiti pourra peut-être mettre plus en exergue le caractère cultivé des occupants ou visiteurs de ces lieux, ainsi que le rapport entre le commanditaire de ces décors et le contexte militaire du camp de la VIIIe légion Auguste.
Bibliographie
Barbet, A. (2012) : “Graffitis à la romaine : un essai d’archéologie expérimentale”, in : Actes du 1er colloque DUCTUS, université de Lausanne, 19-20 juin 2008, Berne, 241-260
Barbet, A. et M. Fuchs, éd. (2008) : Les murs murmurent. Graffitis gallo-romains, catalogue d’exposition, Gollion.
Barbet, G. et P. Gandel, éd. (1997) : Chassey-les-Montbozon. Un établissement rural gallo-romain, Paris.
Cicutta, H., B. Dottori, G. Kuhnle, N. Froeliger, F. Jodry et C. Gaston (2012) : “Sous la place du Château à Strasbourg. Des légionnaires romains aux bâtisseurs du Moyen Âge”, Archéologia, 505, 24-33.
Croisille, J. M., éd. (2005) : La peinture romaine, Paris.
Fuchs, M. E., R. Sylvestre et C. Schmidt Heidenreich, éd. (2012) : Inscriptions mineures : nouveautés et réflexions, Actes du 1er colloque DUCTUS, université de Lausanne, 19-20 juin 2008, Berne.
Kindstrand, J. F. (1980) : “Demetrius the Cynic”, Philologus, 124, 93-98.
Krenkel, W. (1962) : Pompeianische Inschriften, Heidelberg.
Lőrincz, B. (1999) : Onomasticon Provinciarum Europae Latinarum, II, Vienne.
Mócsy, A. (1983) : Nomenclator provinciarum Europae Latinarum et Galliae Cisalpinae cum indice inverso, Budapest.
Pauly, A. (1901) : Paulys Realencyclopädie der Classischen Alter-tumswissenschaft, IV (2), Stuttgart.
Reddé, M., R. Brulet, R. Fellmann, J. K. Haalebos et S. von Schnurbein, éd. (2006) : Les fortifications militaires. L’architecture de la Gaule romaine, DAF 100, Bordeaux.
Reuter, M. et M. Scholz, éd. (2004) : Geritzt und Entziffert. Schriftzeugnisse der römischen Informationsgesellschaft, Stuttgart.
Sauron, G. (1993) : “Nature et signification de la mégalographie énigmatique de Boscoreale”, REL, 71, 87-117.
— (2007) : La peinture allégorique à Pompéi. Le regard de Cicéron, Paris-Milan.
— (2009) : Dans l’intimité des maîtres du monde. Les décors privés des Romains, Paris-Milan.
Rabold, B. et C. S. Sommer, éd. (1998) : LOPODVNVM. Vom Kastell zur Stadt, Ladenburg-Stuttgart.
Schnitzler, B., éd. (2012) : Un art de l’illusion. Peintures murales romaines en Alsace, catalogue d’exposition, musée archéologique de Strasbourg, 20 avril 2012-31 août 2013, Strasbourg.
Scholz, M. (1998) : “Kritzeleien in der Wachstube? Wandgraffiti aus dem Stabsgebäude und Schriftgebrauch bei der römischen Armee”, in : Rabold & Sommer 1998, 41-43.
Von den Hof, R. (1994) : Philosophenporträts des Früh- und Hochhellenismus, Munich.