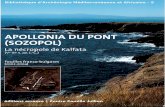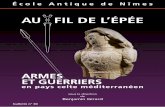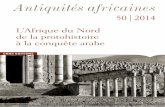Grecs et Ibères dans la nécropole d'Ampurias (VIe-IIe s. av. J.-C.)
Transcript of Grecs et Ibères dans la nécropole d'Ampurias (VIe-IIe s. av. J.-C.)
GRECS ET IBÈRES DANS LA NÉCROPOLE D'AMPURIAS (VP-IIe SIÈCLES AV. J.-C.)
Éric GAILLEDRAT Ancien membre de l'École des hautes études hispaniques
La nécropole préromaine d' Ampurias (L'Escala, Gérone) est connue depuis le début du siècle grâce à une série de découvertes réalisées au lieu-dit El Portitxol, qui mirent en évidence une série de tombes d'époque archaïque dont le mobilier a malheureusement été en grande partie dispersé. Ce n'est qu'à partir des années quarante que des recherches d'envergure furent entreprises, sous l'impulsion de Martin Almagro Basch, pour aboutir à une publication faisant l'inventaire de l'ensemble des sépultures alors mises au jour, du Bronze Final au Bas Empire l. Pour l'époque préromaine, une série de tombes à inhumation et à incinération est alors apparue, sur le Turô de Las Corts d'un côté (nécropole « Paralli » du Bronze Final2), sur le Turô d'Empùries de l'autre avec les nécropoles « Muralla N/E », « Marti », « Bonjoan », « Mateu » et « Granada » (fig. 1). Dans le secteur de Las Corts ont été révélées une série de tombes à incinération, quant à elles datables des ne-ier siècles av. J.-C. ; fouillé à partir de 1926 par E. Gandia et largement perturbé par des travaux clandestins, ce cimetière n'a donc été publié que de seconde main par Martin Almagro, qui tenta une reconstitution des différents ensembles mobiliers alors dispersés. Sans préjuger de la représentativité des contextes ainsi restitués, on retiendra le fait que cette nécropole se caractérise par la spécificité de ses structures funéraires. On relève ainsi l'existence d'un certain nombre de monuments, ou plus exactement de bases monumentales de plan quadrangulaire, tandis que d'autres sépultures présentent des empierrements tumulaires, ces deux types de structures trouvant chacun des parallèles dans le monde péninsulaire3. Dans les années soixante, quelques
1. Martin ALMAGRO Basch, Las necropolis de Ampurias, 2 vol., I, Necropolis griegas, Barcelone, 1953 (= ALMAGRO BASCH, Las necropolis, I) ; H, Necropolis romanasy indigenas, Barcelone, 1955.
2. Id., « Una necropolis de Campos de Urnas en Ampurias : el cementerio Paralli », AEA, 78, 1 950, p. 39-71.
3. Sur la nécropole de « Las Corts » et ses parallèles dans le monde ibérique, voir Emetrio CUA- DRADO, « Las tumbas tumulares de Las Corts », MiscelaneaArqueolôgica (XXVAniversario de los cursos internacionales de Prehistoria y Arqueolôgia en Ampurias, 1947-1971), Barcelone, 1974, p. 251-262.
Mélanges de la Casa de Velazquez (MCV), 1995, XXXI (1), p. 31-54.
32 ÉRIC GAILLEDRAT
/\ Nécropole indigène A Nécropole mixte
grecque / indigène
Zones marécageuses
Fig. 1 . Restitution de la topographie antique du site dans l'antiquité, avec localisation des divers secteurs de la nécropole grecque/indigène (Vle-lle siècles av. J.-C.)
et zones d'extension maximale de l'habitat grec.
tombes mises au jour dans les espaces « Bonjoan » et « Granada » ont été publiées par M. Almagro-Gorbea4. Enfin, les fouilles entreprises plus récemment au sud de la Néapolis ont révélé l'existence en cet endroit - devenu depuis un parking pour les visiteurs - de deux phases d'occupation, dont la première correspond à une partie de la nécropole ampuritaine, en activité dans le courant des rv^-nr5 siècles5.
Laissant de côté les nécropoles « Paralli » et « Las Corts », on dispose donc à l'heure actuelle pour l'intervalle vie-ne siècles av. J.-C. d'un corpus de 266 inhumations et de 98 incinérations. Cette documentation est, on s'en doute, loin d'être complète, tant il est vrai que les espaces fouillés avec plus ou moins d'intensité par M. Almagro ne concernent qu'une partie de ce qu'était la nécropole de l'antique Emporion et de l'habitat indigène qui le jouxtait ou y était confondu6. Les limites de l'information sont donc claires, que l'on tienne compte ou non des perturbations relevées dans moins de la moitié des sépultures explorées, qu'il s'agisse de conséquences de travaux agricoles ou de l'activité des fouilleurs clandestins. Pour une durée de cinq siècles, c'est donc à un « déficit » de sépultures
4. M. ALMAGRO Gorbea, « Nuevas tumbas halladas en las necropolis de Ampurias », Ampurias, XXIV, 1962, p. 225-238.
5. Enric SanmartI Grego et alii, « Les excavacions a l'area del Parking al sud de la Néapolis d'Empùries » (informe preliminar), Empùries, 45-46, 1983-1984, p. 1 10-153.
6. On se rappellera les deux témoignages littéraires essentiels pour la connaissance d'Emporion, à savoir les textes de Strabon (III, 4, 8-9) et de Tite-Live (XXXIV, 9).
GRECS ET IBÈRES DANS LA NÉCROPOLE D'AMPURIAS 33
que nous sommes confrontés, même s'il est vrai qu'il reste difficile d'évaluer l'importance numérique de la population Ibère, dont l'extension de l'habitat reste largement soumise à caution7.
Le présent travail se propose donc de jeter un nouveau regard sur la signification de ces nécropoles préromaines, dans l'optique de l'étude des rapports entre Grecs et indigènes. On ne tiendra pas compte, de manière toute conventionnelle, des ensembles postérieurs au IIe siècle8 (époque qui correspond par ailleurs aux débuts de la présence romaine sur le site), pas plus que de la nécropole de Las Coïts, si ce n'est pour des parallèles ponctuels avec les autres ensembles. De ce fait, en l'absence de données anthropologiques et devant la parcimonie des informations relatives aux structures funéraires (aménagements, dispositifs de signalisation), c'est essentiellement à partir du mobilier que l'on pourra approcher les comportements respectifs des deux populations amenées à cohabiter l'une avec l'autre, tant de leur vivant qu'après la mort.
En effet, la présence conjointe d'inhumations et d'incinérations amène tout naturellement à l'acceptation du postulat suivant : Grecs et Ibères, à qui on attribue respectivement la diversité des rites venant d'être évoquée9, ont manifestement enterré leurs morts dans des espaces communs. Reste toutefois à expliciter les critères qui autorisent effectivement une telle séparation au niveau des pratiques funéraires : la mise en parallèle du mode sépulcral retenu (inhumation ou incinération) avec le type de mobilier présent dans la tombe doit alors mettre en lumière des phénomènes de convergence mais aussi de divergence entre les deux groupes, et donc permettre de s'interroger sur l'ampleur et le sens de cette apparente cohabitation.
LES TOMBES À INHUMATION
L'examen du mobilier déposé dans les sépultures à inhumation révèle, toutes périodes confondues, l'importance constante du matériel céramique, attesté dans près d'une tombe sur deux (fig. 2). Celui-ci, auquel s'ajoutent un certain nombre d'autres récipients (en pâte de verre ou plus rarement en albâtre), concerne principalement deux catégories de vases : flacons à huile et à parfum tout d'abord, vases en rapport avec la boisson ensuite. Les autres formes sont alors plus rares, qu'il s'agisse d'autres pièces du service de table ou de vases miniatures dont la destination votive paraît essentielle. La comparaison effectuée entre tombes « intactes »
7. On est également loin du compte pour la partie grecque, dans la mesure où l'extension maximale de la Néapolis n'a guère dépassé les 2 hectares, auxquels s'ajoute l'espace de la Palaiapolis (l'actuel ilôt Sant Marti d'Empùries), ce qui révèle dans tous les cas une faible démographie.
8. N'est pas prise en compte la nécropole de Las Corts, compte tenu des incertitudes déjà évoquées liées aux associations de mobilier.
9. Il est évident que l'on ne peut suivre la terminologie de M. Almagro, qui considérait comme « grecques » l'ensemble des sépultures à inhumation et incinération des secteurs « Marti », « Bonjoan », « Mateu » et « Granada » ( = ALMAGRO BASCH, Las necropolis, I).
34 ÉRIC GAILLEDRAT
160 t
J-
Sur l'emsemble des tombes
Sur l'emsemble des tombes non perturbées
4 5 6 7 Nombre de vases par tombe
10 11
Fig. 2. Répartition toutes périodes confondues du nombre de vases par inhumation.
et tombes « perturbées » montre en outre une concordance globale des tendances, ce qui nous amène à considérer comme fiables les résultats de l'analyse du mobilier céramique entreprise sur la totalité des sépultures 10.
Toujours dans une optique diachronique, les autres catégories de mobilier sont moins bien représentées, qu'il s'agisse des éléments de vêtement ou de parure (anneaux, bagues, pendentifs, fibules, boutons), des outils (y compris les aiguilles à coudre), ou encore des instruments de toilette (strigiles, pinces à épiler, grattoirs). Une exception doit toutefois être signalée, qui concerne les différents objets à valeur prophylactique ou votive, présents à des degrés divers dans environ une inhumation sur quatre : on trouve ainsi un certain nombre d'éléments caractéristiques, qu'il s'agisse d'astragales, de coquillages ou, plus rarement, de monnaies ou d'amulettes diverses voire de figurines en terre cuite. La présence de clous, relativement abondants (37 tombes sur 265), pose en revanche un problème : si leur destination votive est évidente dans un certain nombre de cas (une déposition dans les mains du défunt est signalée par deux fois n), il n'en demeure pas moins qu'en plusieurs occasions elle ne semble révéler que la présence d'un aménagement en matériau périssable, autrement dit en bois. Le nombre de clous présents varie ainsi entre un et quinze exemplaires; il est compris entre un et quatre dans la majorité
1 0. Dans ce cas, outre les travaux agricoles qui n'ont qu'endommagé les sépultures sans pour autant altérer la composition du mobilier, il faut considérer que les éventuels pillages antiques n'ont concerné que les objets alors précieux, tels les bijoux.
11. Inhumations « Bonjoan » 7 et 19.
GRECS ET IBÈRES DANS LA NÉCROPOLE D'AMPURIAS 35
des cas. Dans l'hypothèse d'une destination « fonctionnelle », s'agit-il de cercueils ou de lits funéraires? Cela reste difficile à préciser, mais c'est bien à de tels dispositifs que pourraient renvoyer les sépultures renfermant au moins six clous, à l'image de l'une d'elles où on été retrouvés des restes de bois encore accrochés au métal 12, ou encore de celles où ces mêmes vestiges sont apparus répartis aux pieds et à la tête du mort 13.
Des traits spécifiquement grecs
On relève par ailleurs l'absence totale d'armes ou d'éléments de cuirasse 14. Ce qui apparaît ici comme un trait distinctif correspond en fait à une situation banale dans les nécropoles grecques d'époque classique et hellénistique, où la déposition des attributs guerriers est tombée en désuétude.
Plus généralement, nous avons dans les inhumations ampuritaines toute une série d'éléments, plus ou moins ponctuels, devant être rattachés à des pratiques spécifiques au monde grec. C'est en particulier le cas de la présence - faible, il est vrai - de pièces de monnaies, déposées à raison de une ou deux par tombe, dans la bouche même du mort ou à côté de sa tête 15 : il s'agit alors de la traditionnelle obole destinée à payer Charon pour le passage du Styx. Cette croyance, qui s'est développée en particulier à l'époque hellénistique, appelle un certain nombre de remarques dans la mesure où la présence de coquillages (ici dans une vingtaine de tombes) semble avoir un lien avec la pratique précédemment décrite : en effet, dans un cas le mollusque a été déposé dans la bouche du mort, comme substitut apparent de la pièce de monnaie 16. Les autres coquillages, loin de constituer de simples amulettes, révèlent alors une symbolique funéraire qui, il est vrai, n'est pas l'apanage du monde grec puisqu'on la retrouve également dans le milieu indigène préexistant. En revanche, la présence déjà évoquée de clous ne correspond en rien à une pratique courante dans le monde ibérique. Dans le monde grec, la symbolique de ces derniers objets est complexe. On les retrouve ainsi employés afin de rendre « inutilisables » divers objets déposés dans la tombe. La feuille de plomb inscrite de malédictions à l'attention des divinités infernales ainsi enclouée est un autre exemple de cette pratique d'enclouage à valeur symbolique dont la signification est en tous les cas celle d'une rupture consacrée avec le monde des vivants.
12. Inhumation « Marti » 109. 13. Inhumations « Marti » 101, 105, 109 et 1 1 1. 14. M. Almagro rapporte néanmoins la découverte (non vérifiée) d'une panoplie complète de type
grec qui aurait été faite dans une inhumation de la nécropole d'« El Portitxol » (ALMAGRO BASCH, Las necropolis, I, p. 18), découverte qui correspondrait dans ce cas à une sépulture d'époque archaïque.
15. Pratique attestée dans seulement quatre tombes : respectivement, inhumations « Marti » 36, 96, 108 et 109 (ivMir3 siècles).
16. Inhumation « Bonjoan » 50 (IIIe siècle?).
36 ÉRIC GAILLEDRAT
La présence de figurines de terre cuite, dans seulement quatre tombes 17, renvoie ici une nouvelle fois au domaine religieux hellénique et semble en outre plus caractéristique de la période archaïque ou classique. La symbolique de ces figurines est apparemment assez diversifiée, et l'on retrouve dans un cas le thème de l'homme allongé tenant un oiseau, associé dans le même ensemble clos à une figurine féminine, dans un autre celui de l'Hermès ithyphallique 18.
Pour en revenir aux céramiques présentes dans les tombes, qui représentent, on l'a vu, l'essentiel du mobilier funéraire, la fonction des vases déposés aux côtés du mort révèle également une empreinte grecque indiscutable. L'importance du flacon à parfum, du lécythe, de l'aryballe, de l'alabastron ou de Yunguentarium traduit bien, à l'intérieur du rituel, cette omniprésence des essences aromatiques, destinées à entourer le mort jusque dans la tombe. Dans le même temps, la boisson occupe une place importante, que traduit l'abondance des formes à boire (coupes, skyphos, gobelets) ou des vases de service liés à la boisson, et plus précisément au vin : olpés et œnochoés, plus rarement amphore ou péliké. L'existence de rites de libation est alors probable, mais peu d'indices vont dans ce sens 19. Cela ne préjuge en rien de l'existence de tels gestes effectués le cas échéant sur la tombe, comme cela est de coutume dans le monde grec. Quoi qu'il en soit, l'importance du vin dans les croyances en l'au-delà, la symbolique dionysiaque en rapport avec le renouvellement de la vie, la nécessaire satisfaction de la soif éprouvée par le défunt, tous ces éléments transparaissent de manière plus ou moins directe dans la présence de ces mêmes vases dont les fonctions ne varient guère tout au long de la période considérée. Qui plus est, ces éléments se retrouvent régulièrement dans une grande partie des tombes, indépendamment du nombre d'objets concernés. Autrement dit, y compris dans les sépultures les plus « riches », il ne semble pas y avoir de substitution de ces vases à usage spécifique par d'autres types de récipients ni même par d'autres objets.
Enfin, on remarque l'existence d'un certain nombre de sépultures infantiles en amphores (37 au total), qui correspondent à un type d'inhumation commun à plusieurs civilisations méditerranéennes y compris le monde grec.
À ce niveau se pose inévitablement la question essentielle d'une éventuelle distinction intervenue en fonction du sexe ou des classes d'âge des défunts.
1 7. Inhumations « Marti » 20 (première moitié du IVe siècle) et 77 (début du Ve siècle), « Bon-joan » 43, tombe probablement infantile (début du Ve siècle), dans ce cas peut-être plus des jouets que de véritables ex-votos, et « Bonjoan » 69 (seconde moitié du VIe siècle). Plusieurs variantes de ce « mobilier-type » existent, avec l'omniprésence du flacon en pête de verre (amphoriskos, ala- bastron, aryballe) : dans l'inhumation « Bonjoan » 57 (toujours infantile, fin du VIe siècle) sont associés le flacon en pâte de verre et l'aryballe corinthien ; dans l'inhumation « Bonjoan » 69 (mêmes caractéristiques que la précédente) le flacon en verre est le seul vase à parfum (au milieu d'une large gamme de formes à boire), mais les circonstances de la découverte laissent préjuger d'une certaine dispersion du mobilier (ALMAGRO BASCH, Las necropolis, I, p. 202-203).
1 8. Inhumations « Marti » 77 et 20. 19. M. ALMAGRO note toutefois dans une sépulture (inhumation « Bonjoan» 29, IVe siècle?)
la présence de fragments éparpillés d'une même olpé, qui pourraient alors correspondre à un bris volontaire au moment de la déposition du corps.
GRECS ET IBÈRES DANS LA NÉCROPOLE D'AMPURIAS 37
En l'absence de données anthropologiques (si ce n'est les quelques mentions de sépultures infantiles), la pauvreté globale du mobilier pose un problème évident, dans la mesure où plus d'une tombe sur deux ne renfermait aucun mobilier. De plus, les éléments discriminants sont en apparence peu nombreux : pour le domaine féminin, il n'y a guère que l'aiguille à coudre qui puisse être considérée - de manière arbitraire, j'en conviens - comme étant un probable marqueur féminin. À l'inverse, si le strigile est, lui, spécifiquement masculin, il est malheureusement quasiment absent des inhumations ampuritaines20. Posant le même problème, la présence d'éléments de vêtements ou d'ornements ne semble pas pouvoir être prise en compte ici, car elle ne révèle pas l'existence de mobiliers spécifiquement masculins ou féminins. Il est également inutile de vouloir faire du couteau un critère distinctif (on a vu par ailleurs que les armes étaient absentes) : il est ici non seulement exceptionnel, mais également aussi bien féminin que masculin21. De la sorte, il faut se tourner en priorité vers le mobilier céramique, qui lui seul devrait nous éclairer sur la nature des éventuelles distinctions intervenues à ce niveau.
Huiles, parfums et boissons
La prédominance de deux catégories fonctionnelles de récipients (vases à parfum et vases en rapport avec la boisson), a donc été évoquée. Or, l'analyse de leur répartition montre bien qu'il existe globalement entre elles un phénomène d'exclusion. En effet, alors que l'on possède 72 ensembles où seul le vase à parfum est représenté et 16 autres où - à l'inverse - seul le contenant à boisson est présent (vase à boire proprement dit ou vase de service), il n'y a que sept exemples sûrs d'association entre l'un et l'autre22. D'autre part, lorsque le vase à parfum est ainsi isolé, il l'est fréquemment à l'exclusion de tout autre type de forme céramique. Plus encore, le cas de figure courant est celui d'un seul type de vase à parfum (alors représenté en un ou deux exemplaires), généralement Vunguentarium, plus rarement le lécythe aryballisque. Lorsque deux types de formes sont présents, il s'agit alors le plus souvent d'une association caractéristique de certaines sépultures infantiles, à savoir celle entre flacon(s) en pâte de verre et lécythe, que l'on rattachera volontiers à une « panoplie » apparemment en vogue durant un laps de temps réduit23. De plus, lorsqu'il existe une association vase à parfum/vase à boire, ce dernier n'est pas spécifiquement en rapport
20. Une seule exception, la tombe « Bonjoan » 20 (ine-He siècles). 21. Inhumation « Marti » 64, qui renferme également une aiguille à coudre (nie siècle). 22. Le double si l'on prend en compte l'association du vase à parfum (généralement un unguenta-
rium) avec l'écuelle non tournée, qui représente une forme ouverte a priori « mixte », mais qui, ici, a très bien pu jouer le rôle de coupe à boire.
23. Dans ce cas d'un niveau social au-dessus de la moyenne : inhumations « Marti » 77 (début du Ve siècles), 84 et 103 (toutes deux de fin v«-début du IVe siècles) ; « Bonjoan » 23, 38, 43, 55 et « Granada » 12, toutes les quatre du début du Ve siècle.
38 ÉRIC GAILLEDRAT
avec la consommation du vin, qu'il s'agisse du gobelet gris (fin du VIe siècle)24, et surtout de Polpé à embouchure étroite (aux ive-me siècles) 25, voire de la chope grise catalane (pour les ille-lie siècles) 26. Tout cela conduit à considérer les sépultures avec vase à parfum comme étant globalement homogènes quant aux associations de mobilier qu'elles révèlent. Faut-il pour autant en faire uniquement des sépultures féminines? Apparemment non, car parmi les quelques tombes a priori féminines, telles celles possédant une aiguille à coudre, il n'en est qu'une seule qui possède un flacon à parfum27, tandis qu'une autre renferme une œnochoé italiote associée à un canthare, et que les quatre dernières ne possèdent enfin ni vase à boire ni vase à parfum28. . .
On ne peut dès lors établir de lien direct entre le sexe du défunt et la présence de vase à parfum, ce qui d'ailleurs reflète bien les comportements helléniques en la matière. De même, il est manifestement impossible d'établir un tel lien à partir du seul critère de présence/absence de matériel, ce qui nous oblige à recourir à d'autres arguments.
Des objets chargés de croyances
En se tournant vers les objets à valeur prophylactique ou rituelle, on peut ainsi espérer retrouver la trace d'une telle distinction. Dans ce cas, la combinaison entre ces éléments (clous, mollusques, amulettes) et le mobilier céramique pourrait aboutir à la définition de panoplies funéraires plus spécifiquement masculines ou féminines. Or, qu'en est-il réellement? On note en premier lieu qu'à l'image de l'apparente complémentarité vase à parfum/vase à boire (déséquilibrée du point de vue numérique en faveur des premiers), il existe une séparation relativement nette entre les tombes avec clous et celles avec coquillage, respectivement au nombre de vingt et de douze, tandis qu'on ne retrouve ces deux éléments associés que dans seulement cinq cas. Les deux premiers ensembles ainsi définis sont, on le voit, relativement équivalents, ce qui reflète en tout état de cause l'existence de deux types de compositions plus ou moins indépendantes l'une de l'autre. On constate par ailleurs que la majorité des ensembles avec clou(s) et/ou coquillage contiennent également un ou plusieurs vases à parfums, dont ils ne constituent pas alors un éventuel « substitut ». Les astragales, moins nombreux, se retrouvent quant à eux isolés à six reprises, et associés par deux fois au coquillage. La même remarque vaut en ce qui concerne leur association avec le vase à parfum.
24. Inhumation « Bonjoan » 48. 25. Inhumation « Marti » 36 et 40, « Bonjoan » 29, 72. 26. Inhumation « Marti » 25 et « Granada » 1. À l'inverse, la coupe monoansée présente dans une
tombe du début Ve (« Bonjoan » 43) semblerait plus directement liée à cette même consommation du vin, mais il s'agit ici d'une sépulture infantile! Enfin, la présence d'écuelles ou de tasses non tournées, dont a vu la rareté relative, ne peut guère être rattachée à cette pratique de consommation spécifique, du moins dans l'hypothèse d'une « grécité » des sépultures concernées.
27. Inhumation « Marti »101 (lécythe arybalisque attique, début du IVe siècle). 28. Inhumation « Marti » 43 (sépulture infantile), 64, 1 10 et 140 (rvMn6 siècles).
GRECS ET IBÈRES DANS LA NÉCROPOLE D'AMPURIAS 39
Bien plus, et sauf exception29, de tels éléments à valeur protectrice ne se rencontrent pour ainsi dire que dans des sépultures renfermant un mobilier d'accompagnement (quelle qu'en soit la nature), au sein duquel on retrouve généralement un ou plusieurs vases. Il est alors impossible de considérer comme aléatoire une telle répartition, qui reflète en tout état de cause l'existence de pratiques sinon codifiées, du moins intégrées à un système de valeurs et de croyances bien définies. La présence non seulement de clous, de mollusques et d'astragales mais aussi d'os percés, de figurines ou de monnaies est ainsi largement subordonnée à la présence d'autres types de matériels. Il n'existe alors pas d'exclusion entre ces objets et les diverses sortes de vases ; il n'y a pas non plus de substitution possible entre l'un et l'autre, ce qui exclut de fait l'hypothèse d'une discrimination sexuelle réalisée sur cette seule base. Leur association avec des éléments peu discriminants pose alors problème, et laisse en suspens la question d'une attribution préférentielle à l'un ou l'autre sexe des divers éléments venant d'être évoqués - ce à quoi pourrait renvoyer l'apparente exclusion entre clous et mollusque. Cette association reste en tout état de cause difficile à vérifier, et ne concernerait de toutes façons qu'une partie de la population. . .
C'est alors bien dans la combinaison de ces divers éléments que l'on doit rechercher les fondements d'une differentiation des rites entre hommes et femmes. Le vase à parfum est commun aux deux sexes ; de même le vase de consommation/ service de la boisson, lorsqu'il n'est pas spécifiquement associé au vin. Le vase à boire associé à la consommation de ce dernier produit relève alors du domaine masculin, mais reste ici finalement peu représentatif.
Hommes et femmes, riches et pauvres
Dès lors, plus qu'une improbable distinction sexuelle, la présence de mobilier funéraire, et plus spécifiquement de vases d'accompagnement, révèle donc un autre type de distinction. Cette dernière pourrait être d'ordre économique, et l'on parlerait alors de tombes « plus ou moins riches ». Toutefois, si un tel raisonnement peut fonctionner au vu de certains mobiliers, il ne peut à lui seul rendre compte de la réalité des pratiques funéraires ampuritaines.
Bien évidemment, on remarque en premier lieu l'existence d'ensembles particulièrement luxueux, marqués par la présence de vases fins, de flacons en pâte de verre et de bijoux. Par ailleurs, la déposition d'un vase à parfum (et de son contenu) renvoie inévitablement à une notion de « luxe » - disons plutôt de « confort » - qui n'a pas nécessairement été accessible à l'ensemble des individus. Sur un total de 1 12, un peu moins de la moitié possèdent au moins un vase d'accompagnement; celles qui sont dans ce cas renferment le plus souvent un ou plusieurs vases à parfum. Dans le même temps, moins d'une tombe sur cinq renferme un ou plusieurs objets à valeur prophylactique. Toutefois, ce dernier critère ne possède pas de signification
29. Inhumations « Marti » 127 (IVe siècle), avec un mollusque, et « Parking » 2062 OV-lir3 siècles), avec un clou.
40 ÉRIC GAILLEDRAT
10 -
| VIe-Ve S.
□ IVe-début IIIe s.
■ fin IIIe s. H 11e s.
i ,1 ,1 ni 5 6 7 Nombre de vases
10 11
Fig. 3. Répartition par périodes du nombre de vases dans chaque inhumation comportant du mobilier céramique.
économique réelle, en particulier dans le cas du coquillage. Cela pose alors le problème de non-apparition de ces objets dans la plupart des tombes dites « pauvres », dont on voit mal en fin de compte pourquoi elles n'auraient pas bénéficié de ce qui apparaît pourtant comme un des éléments essentiels de la panoplie funéraire grecque. De même, pourquoi des récipients céramiques de moindre qualité ou de moindre valeur marchande n'ont-ils pas « pris le relais » dans ces mêmes tombes?
Faut-il alors en conclure que seule la frange la plus aisée de la population grecque ampuritaine ait en quelque sort « accepté » ou encore « respecté » ce qui apparaît comme un véritable rituel? On pourrait imaginer qu'une partie du corps social se soit ainsi singularisée, voire que les sépultures dépourvues de mobilier correspondent à une partie spécifique - car inférieure - de la population, pourquoi pas les esclaves... Toutefois, une telle démarcation eût de toute manière été relative, dans la mesure où les inhumations ampuritaines apparaissent globalement « sobres », la norme, toutes périodes confondues, étant à la déposition d'un service funéraire restreint (fig. 2 et 3), et où la majorité des tombes renferment au plus deux vases et peu d'autres objets, si ce n'est quelques pièces de vêtement ou de parure 30.
30. Le parallèle peut alors aisément être fait entre les sépultures d' Ampurias et celles de la nécropole grecque des rv^-ll6 siècles d'Agde où, mises à part les inhumations infantiles en amphore, on retrouve d'une part des tombes dépourvues de tout matériel ou ne contenant qu'une fibule, et d'autre part des tombes contenant un vase (rarement plus), dans ce cas flacon à parfum ou chope bitronconique (André NICKELS, « Les Grecs en Gaule : l'exemple du Languedoc », Modes de contact et processus de transformation des sociétés anciennes, Pise-Rome 1983, p. 409-428).
GRECS ET IBÈRES DANS LA NÉCROPOLE D'AMPURIAS 4 1
Quoi qu'il en soit, on ne perçoit guère dans la nécropole d'Ampurias de différences à l'intérieur du corps social, si ce n'est par une plus grande richesse manifestée de manière occasionnelle. Cette impression est en outre apparemment confirmée par la simplicité générale des aménagements funéraires (fosses, dispositifs de surface, etc.), que dans l'ensemble nous connaissons malgré tout assez mal. Sans aller jusqu'à évoquer la possibilité de lois régissant les pratiques funéraires et leurs manifestations matérielles, on peut néanmoins souligner l'existence d'une idéologie funéraire particulière, sans nul doute liée à la structure spécifique de la société emporitaine.
Adultes et enfants
Face à cette apparente complexité, la prise en compte de l'âge présumé des défunts peut nous permettre de préciser un certain nombre de points. Les sépultures d'enfants (sûres ou présumées à partir de la taille des squelettes) sont en effet apparemment nombreuses31, soit environ une tombe sur trois. Ce chiffre ne doit pas surprendre si l'on accepte l'idée d'un taux de mortalité élevé chez les jeunes sujets. Il ne semble pas non plus que cela résulte d'un déséquilibre spatial au niveau de la nécropole, qui s'expliquerait par l'existence de secteurs réservés à telle ou telle époque : à titre de comparaison la zone du « Parking », chronologiquement homogène, a livré 7 sépultures infantiles sur un total de 20 inhumations. . .
Certains éléments caractéristiques peuvent être signalés : jouet et biberon, mais ils restent exceptionnels 32 et ne constituent pas un marqueur régulier.
À première vue, l'impression domine d'une assez grande pauvreté. Cette impression est dictée en particulier par le grand nombre d'ensembles dépourvus de tout vase d'accompagnement, en particulier de ceux qui sont relatifs à la boisson. Parmi les tombes infantiles « pauvres », on note l'importance des sépultures en amphore, qui comptent parmi les plus démunies de la nécropole. Toutefois, d'autres catégories de matériel sont assez fréquemment représentées, en particulier les éléments de parure (perles de collier, pendentifs) ou encore les amulettes. La proportion de tombes dépourvues de tout mobilier d'accompagnement est malgré tout assez élevée ; elle représente alors près d'une tombe sur deux (+/-45 %), et consiste essentiellement en des inhumations en amphore. L'écart est néanmoins faible avec les tombes d'adultes, ou présumées telles, ou l'on avoisine pour le même rapport les 40 %. De même, les sépultures infantiles renfermant au moins un vase à parfum représentent près d'une tombe sur cinq, ce qui n'est finalement guère éloigné du même rapport établi pour les adultes, qui s'élève quant à lui à un peu plus d'une tombe sur trois. À l'inverse, il est intéressant de souligner que parmi les sépultures les plus riches de la nécropole on retrouve des tombes d'enfants, en particulier aux vr5-^ siècles33-
3 1 . Entre 82 et 93, si on s'en tient pour la longueur des restes au seuil tout arbitraire des 1 ,30/ 1 ,40 m. 32. Inhumation « Marti » 85. 33. Notamment les sépultures « Marti » 77, « Bonjoan » 43, 55 et 69.
42 ÉRIC GAILLEDRAT
La prise en compte des objets à valeur prophylactique révèle plusieurs tendances intéressantes. La première d'entre elles est que tous les types d'objets présents chez les adultes sont ici aussi attestés : coquillages, clous, astragales. Toutefois, on remarque que la plupart des tombes contenant seulement un mollusque (soit 9 sur 12) sont des sépultures infantiles. Par ailleurs, les astragales seules (3 sur 6 occurrences) ou associées au mollusque (2 occurrences) montrent la même tendance. À l'inverse, les clous seuls sont moins bien représentés (6 occurrences sur 20), tandis que l'association clou/mollusque se fait de manière équivalente entre tombes d'enfants (3 occurrences) et d'adultes (2 occurrences). Dans ce dernier cas, toutefois, il est intéressant de noter qu'il s'agit a priori de sépultures féminines : le coquillage semblerait être alors un attribut plus spécifiquement infantile, et peut-être féminin, ce qui par symétrie ferait du clou un objet majoritairement déposé dans les tombes d'hommes et dans une moindre mesure d'enfants. Dans tous les cas, les inhumations infantiles qui possèdent un mobilier d'accompagnement révèlent de manière très nette la même association déjà évoquée entre vase à parfum et objet à valeur prophylactique.
Globalement, il ne semble donc pas qu'il y ait de traitement différencié entre sujets jeunes et plus âgés, si ce n'est peut-être dans le cas des nouveaux-nés, pour lesquels il est par ailleurs plausible d'évoquer une differentiation des rites et peut-être une exclusion partielle de la nécropole.
L'évolution dans le temps
Le détail chronologique de ce panorama fait ressortir entre le VIe et le IIe siècle av. J.-C. le peu de différenciation quant à la composition du mobilier funéraire, lequel révèle de manière continue les mêmes associations d'objets. Ainsi, en ce qui concerne le mobilier céramique, les tombes avec un ou deux vases sont régulièrement les plus nombreuses (abstraction faite, bien évidemment, de celles qui en sont dépourvues) et renvoient toujours à cette prépondérance déjà évoquée du vase à parfum (fig. 6).
Pourtant, au-delà de cette tendance générale, il est possible de mettre en évidence un certain nombre de phénomènes d'évolution. Ces derniers concernent tout d'abord la qualité des objets, puisque s'observe une propension à un certain « appauvrissement » des vases déposés dans la tombe : régression de la vaisselle fine importée parallèlement au développement des pièces plus communes. Le IVe siècle marque ainsi le début d'une préférence donnée aux unguentaria par rapport aux pièces de luxe, même si les pièces attiques (lécythe aryballisque) sont encore représentées durant cette période. On remarquera en outre que cette tendance ne s'accompagne pas encore d'une multiplication des vases présents dans la tombe, ce qui nous renvoie, si besoin en était, à cette impression déjà évoquée d'austérité volontaire, relativement indépendante du degré de richesse du défunt.
De ce fait, tandis que les v^-v* siècles révèlent malgré tout une certaine diversité quant aux nombres de vases par tombe (fig. 3), le siècle suivant donne
GRECS ET IBÈRES DANS LA NÉCROPOLE D'AMPURIAS 43
finalement une impression sinon de rupture, du moins d'évolution sensible 34 : rares sont alors les tombes avec plus de deux vases, et on n'en compte aucune avec plus de quatre vases. On s'aperçoit en revanche que ce changement s'accompagne d'une relative multiplication des autres catégories d'objets : si les boutons, fibules et anneaux divers demeurent en fin de compte peu significatifs, il n'en va pas de même des objets à valeur protectrice évoqués précédemment, qui voient leur nombre se multiplier, en particulier dans les tombes ne contenant qu'un seul vase.
Le IIIe, puis le IIe siècle voient le retour à une certaine disparité dans la répartition des vases par tombe, comme conséquence d'une multiplication (relative, il est vrai) du nombre d'unguentaria et, dans une moindre mesure, de la diversification des formes de vaisselle, moins limitées qu'auparavant à la seule catégorie des vases à boire. La présence de ces derniers demeure en tout cas essentielle, de même évidemment que celle des flacons à parfum.
Le pourcentage de tombes dépourvues de tout matériel, et donc pour la plupart indatables, semble en outre rester relativement stable tout au long de la période considérée. Cette impression résulte de la comparaison entre le schéma de répartition général et celui de la nécropole du « Parking », apparemment circonscrite aux Iv^-nr3 siècles av. J.-C, où l'on observe que treize des vingt inhumations repérées ne renferment aucun mobilier ; les 65 % que cela représente ne sont pas si éloignés des 44 % obtenus toutes périodes confondues35. Grosso modo, une tombe sur deux rentre dans cette catégorie dépourvue de tout mobilier. Qu'une variation chronologique soit intervenue, cela est possible, pour ne pas dire probable, mais elle reste en tout état de cause difficilement perceptible. Si malgré tout on accorde une valeur aux chiffres donnés par la nécropole du « Parking », faut-il alors y voir un indice supplémentaire pour parler d'une « rupture » au IVe siècle, alors synonyme d'austérité? Cela n'est pas certain, tant les vides demeurent nombreux pour pouvoir reconstituer de manière satisfaisante, c'est-à-dire sur une base statistique comparable, le schéma d'évolution de cette nécropole grecque.
LES TOMBES À INCINÉRATION
L'examen du mobilier déposé dans les sépultures à incinération soulève quant à lui un certain nombre de questions spécifiques, dans la mesure où se profile l'éventualité de la disparition sur le bûcher funéraire d'une partie du mobilier accompagnant le défunt. Il est également difficile, voire impossible dans le cas précis d'Ampurias, d'évaluer la part des restes effectivement prélevés après l'incinération du corps, puis déposés dans la tombe. De la sorte, il est vraisemblable que la part des petits objets, en particulier relatifs à l'habillement et à la parure, soit de
34. Il est vrai néanmoins que les VIe- Ve siècles sont largement sous-représentés, ce qui doit nous inviter à la prudence quant aux conclusions avancées sur la prétendue richesse accrue des tombes (dans ce cas lesquelles?) de cette période.
35. Les amphores des sépultures infantiles ne sont alors pas prises en compte comme vase d'accompagnement.
44 ÉRIC GAILLEDRAT
4 5 6 7 8 Nombre de vases par tombe
10 11 12
Fig. 4 : Répartition toutes périodes confondues du nombre de vases dans chaque sépulture par incinération.
fait sous-évaluée. Reste que ce matériel, de même que les amulettes ou encore divers objets métalliques retrouvés 36, présente fréquemment des traces de passage au feu, confirmant en cela la nécessité d'être prudent dans l'appréciation du mobilier funéraire de ces incinérations ampuritaines.
Il n'est alors pas surprenant qu'une fois encore ce soit le mobilier céramique qui retienne notre attention. On remarque en outre que ce matériel semble avoir été le plus souvent déposé directement dans la tombe sans avoir subi l'action destructrice du bûcher, qu'il s'agisse du feu proprement dit ou des éventuels gestes rituels (bris volontaire) effectués en cette occasion. Toutefois, certains vases semblent avoir accompagné le mort lors de la crémation ; Martin Almagro mentionne ainsi par trois fois sur des vases à parfum les traces d'un tel acte37.
Envisagée de façon diachronique, la composition du mobilier funéraire révèle à plusieurs niveaux une certaine diversité. C'est tout d'abord le cas des céramiques, que l'on est amené à diviser en deux catégories : les urnes cinéraires et les vases d'accompagnement. Parmi ces derniers, on relève une diversité plus fonctionnelle que formelle ; autrement dit, on se trouve face à une série de vases qui correspondent à des usages variés, qu'il s'agisse du conditionnement, de la boisson, de la consommation de nourriture ou encore des récipients à parfum. Si le matériel de ces incinérations est souvent peu abondant (fig. 4), il n'en demeure pas
36. Ainsi les simpula des incinérations « Muralla N/E » 2 et 9 (VIe siècle), ou encore les strigiles des incinérations « Mateu » 3 et 9 (IIe siècle).
37. Incinérations « Marti » 30 (VIe siècle), 17 et 20 (IVe siècle) ; cf. Almagro BASCH, Las necropolis,!,^. 122-123 et 127.
GRECS ET IBÈRES DANS LA NÉCROPOLE D'AMPURIAS 45
moins que les vases d'accompagnement témoignent dans l'ensemble d'une plus grande diversité que ce qui a été observé dans le cas des inhumations. Cela n'exclut pourtant pas une importance spécifique accordée aux vases à parfum et aux vases à boire, importance qui, nous le verrons, évolue sensiblement au cours du temps.
Parallèlement, on retrouve donc un certain nombre d'éléments de vêtements ou de parure, assez bien représentés. À côté des pièces finalement communes que constituent les divers anneaux et pendentifs, on note l'apparition plus fréquente de certains types d'objets, tels les fibules. Le même phénomène s'observe pour d'autres objets, tels les couteaux38. De plus, des éléments nouveaux font leur apparition, notamment les boucles de ceinturon, peu nombreuses il est vrai, et qui ne concernent que les VIe- Ve siècles 39. Les instruments de toilette sont quant à eux peu fréquents, de même que les objets à valeur prophylactique. On retiendra néanmoins le fait que se retrouvent à une échelle réduite les éléments déjà présents dans les tombes « grecques », à savoir les clous40, les mollusques, les astragales et diverses amulettes. Enfin, un des traits originaux des sépultures à incinération est la présence - limitée dans le temps - d'éléments de panoplie guerrière ainsi que d'objets à caractère somptuaire et exceptionnels, tels l'œuf d'autruche ou le simpulum, tous deux au cours du VIe siècle.
Indépendamment de l'évolution chronologique sur laquelle nous reviendrons, certaines tendances générales se dessinent au vu du mobilier et notamment de la céramique. Le calcul sur l'ensemble des sépultures fait ainsi apparaître que 35 tombes sur 98 (soit près d'une sur trois) sont dépourvues de tout mobilier. Bien plus, si l'on ne tient pas compte des sépultures qui ne contiennent en tout et pour tout que l'urne cinéraire sans mobilier d'accompagnement conservé, ce rapport passe à moins d'une sur deux. Une fois encore, cette observation générale peut être mise en parallèle avec l'observation d'un secteur synchrone de la nécropole, autrement dit la zone du « Parking », où sur un total de douze sépultures on en compte sept dépourvues de tout matériel, plus trois autres ne renfermant qu'une urne cinéraire. Que l'on accepte ou non l'idée - de plus en plus probable - d'une accentuation de la simplicité des tombes durant le IVe siècle, il n'en demeure pas moins que l'on a affaire à un panorama globalement austère : il suffit pour s'en convaincre de considérer la seule répartition du mobilier céramique (fig. 4 et 5).
De plus, la présence de vases à parfum et de vases à boire n'obéit pas exactement à la même logique que celle qui a été définie dans le cas des inhumations,
38. Incinérations « Marti » 1, « Bonjoan » 4, « Muralla N/E » 2, 9, 1 1 et 17. 39. Incinérations « Muralla N/E » 2, 8 et 1 1 ; incinération « Marti » 1. 40. Une fois encore, on ne peut procéder à une simple adéquation clous = objets à valeur protectrice,
alors que demeure la possibilité de l'existence de structures en matériau périssable assemblées à l'aide de ces mêmes clous. Dans le cas des incinérations, il n'est pas impossible que des « lits » funéraires aient servi à disposer le corps du défunt sur Yustrinum. À de tels aménagements pourraient en outre correspondre diverses pièces métalliques, retrouvées déformées, à l'image de ce que suggèrent les récentes découvertes d'Ensérune; (cf. Martine SCHWALLER et alii, « Cinq tombes du Deuxième Âge du Fer à Ensérune (Nissan-lez-Ensérune, Hérault) », Sur les pas des Grecs en Occident. Hommages à André Nickels, (Études massaliètes, 4), p. 205-230.
46 ÉRIC GAILLEDRAT
tout d'abord parce que le rapport entre ces deux catégories de vases se trouve inversé avant la charnière des rv^-in6 siècles. Globalement, on compte pour cette époque plus de formes parmi les vases à boire (en particulier ceux qui sont destinés à la consommation individuelle) ou parmi les vases « mixtes » (vases à boire ou à manger) que dans le groupe des contenants à parfums. Les associations d'objets diffèrent également, en ce sens que l'une et l'autre de ces catégories se trouvent aussi bien associées que séparées. Cette tendance trouve alors un aboutissement dans le panorama que nous livre la nécropole de « Las Coïts ».
Des traits spécifiquement indigènes
Ici aussi, et malgré un corpus d'étude moins important, il est possible de cerner divers traits du rituel funéraire qui peuvent être mis précisément en relation avec les pratiques en cours ou les objets utilisés dans le monde ibérique nord-oriental.
Cela se traduit tout d'abord dans la nature des productions céramiques retenues pour être déposées dans la tombe, à titre d'urne cinéraire ou de vase d'accompagnement. La part des céramiques non tournées, encore largement en usage dans l' Ampurdan jusqu'en plein Second Âge du Fer, apparaît ainsi significative. Cette part tend néanmoins à décroître régulièrement parmi le mobilier de la nécropole : de plus de 50 % des vases aux v^-v6 siècles à encore plus de 40 % aux ive-me siècles, pour tomber à moins de 5 % au IIe siècle av. J.-C.41. Qui plus est, la pratique de déposer les cendres dans une telle urne non tournée, forme essentielle du répertoire domestique indigène, se révèle ici être des plus constantes.
À l'inverse, il est intéressant de constater que ce trait « indigène » rentre en opposition quasi complète avec l'intégration de cet élément hellénique que constitue le vase à parfum. En d'autres termes, les tombes avec urne cinéraire non tournée, déjà fréquemment dépourvues de matériel d'accompagnement (environ huit fois sur dix), ne contiennent presque jamais de flacon à parfum, et ce quelle que soit la période considérée. En revanche, les formes liées au service de table sont plus facilement présentes, et dans ce cas régulièrement associées à d'autres types d'objets personnels (parures, amulettes).
Plusieurs catégories de sépultures peuvent donc être distinguées :
- tombes sans mobilier; - tombes sans urne cinéraire, avec vase à parfum ou/et vase du service de
table, et peu d'autres objets; - tombes à urne indigène (ou équivalent tourné) sans mobilier d'accom-
gnement; - tombes à urne indigène (ou équivalent tourné) avec vases du service de
table et autre mobilier relativement diversifié.
41. À titre de comparaison, les céramiques non tournées ne dépassent jamais entre le VIe et le IIe siècle le seuil des 5 % dans le mobilier des inhumations.
GRECS ET IBÈRES DANS LA NÉCROPOLE D'AMPURIAS 47
En l'absence de données anthropologiques, le sens qu'il faut accorder à cette diversité demeure difficile à préciser. Il l'est d'autant plus que les disparités chronologiques sont elles aussi imprécises, compte tenu du nombre relativement restreint de sépultures. Toutefois, une certaine forme de continuité au niveau des pratiques mises en œuvre semble émerger. Une analyse prenant en compte les variations d'ordre chronologique est donc indispensable pour préciser quelques- unes des questions venant d'être soulevées.
Une évolution dans le temps perceptible
Du VIe au IIIe siècle av. J.-C, les céramiques tournées, importées puis produites régionalement, font leur apparition au sein d'un mobilier où les pièces modelées jouent toujours un rôle essentiel. Celui-ci transparaît notamment par l'omniprésence de l'urne de type indigène, fréquemment utilisée comme réceptacle pour les cendres du défunt. Cette catégorie de céramiques est en outre représentée par diverses formes, qu'il s'agisse de vases miniatures ou de vases plus fonctionnels tels la tasse, le broc ou l'écuelle. Plus généralement, la céramique non tournée reste jusqu'au IIe siècle la catégorie la mieux représentée dans ces tombes ibères.
Le schéma de répartition du nombre de vases par tombe (fig. 5) n'est pas sans nous rappeler celui des inhumations. Il se caractérise en effet ici par une assez grande disparité durant les v^-v0 siècles, qui tranche en apparence avec la situation des rv^-nr5 siècles où plus de 70 % des tombes avec mobilier céramique ne contiennent qu'un seul vase, urne cinéraire comprise. D'un autre côté, la tendance se fait jour à une régression des formes liées au service de table, hormis celles qui sont plus spécifiquement liées à la boisson. Cette évolution se produit au bénéfice des vases à parfum, de mieux en mieux représentés, et avec un développement important après le IIIe siècle comme conséquence de la généralisation de Yunguentarium (fig. 6).
Par ailleurs, tandis qu'un « creux » est observé après 400 dans le volume du mobilier funéraire, il est d'autant plus intéressant de noter la tendance continue à l'appauvrissement des objets qui prennent place dans ce dernier. Ainsi, les sépultures des VIe- Ve siècles livrent, du moins pour une partie d'entre elles, des objets que l'on est tenté de qualifier de « luxueux » tels les vases fins grecs et étrusques. Ces vases se rapportent alors à deux domaines : le monde des parfums (lécythe attique, aryballe corinthien) et celui du vin (coupe attique ou ionienne, œnochoé et canthare en bucchero nero). À côté de ces céramiques, divers objets à forte connotation sociale apparaissent : simpula et enfin armes (pointes de lance, éléments de casque ou de cuirasse).
Les tombes de cette première période nous éclairent alors grandement sur les differentiations sexuelles à l'intérieur de la nécropole : sur les dix-sept incinérations du secteur « Muralla N/E », huit affichent des éléments discriminants permettant de les interpréter comme des tombes masculines42. Dans ce cas, le vase à boire grec
42. Incinérations « Muralla N/E » 2, 4, 8, 9, 1 1, 12, 13, 15 et 17.
48 ÉRIC GAILLEDRAT
Fig. 5. Répartition par périodes du nombre de vases dans chaque sépulture par incinération comportant du mobilier céramique.
80 " 70 ■ 60 ■
50 -
40 ■
30 -
20 ■ 10 o -
Vf-V* s.
| Incinérations Q Inhumations
^H i ^^^^^^■' - V '*
IV6-!!!6 s. IIe s.
Fig. 6. Proportion par périodes et par types de sépulture des vases à parfum par rapport au total des vases du mobilier funéraire.
GRECS ET IBÈRES DANS LA NÉCROPOLE D'AMPURIAS 49
ou étrusque est omniprésent, de même que les armes ou dans un cas Faryballe, qui se rapporte plutôt - du moins dans le monde grec - au domaine masculin. Le sim- pulum est rare et constitue un signe fort du point de vue social. On peut alors le rattacher avec vraisemblance à une certaine pratique du banquet, dans laquelle ont été introduits les objets du monde méditerranéen venant d'être évoqués. Notons que ces derniers ne sont pas nécessairement « luxueux », et l'œnochoé étrusque peut ainsi être avantageusement remplacée par celle en céramique grise monochrome43. Dans ces huit sépultures la présence de l'urne cinéraire est de règle (pot non tourné ou jarre ibérique) de même que celle d'autres objets, parmi lesquels on compte fr
équemment un ou plusieurs récipients ainsi que divers instruments de toilette, le couteau ou encore des éléments de vêtement tels la boucle de ceinturon. Le mobilier masculin de cette période est alors relativement abondant, ce qui permet en outre de mieux le caractériser. À l'inverse, on ne peut que présumer de l'identité féminine des autres sépultures, qu'elles soient dotées ou non d'urne cinéraire (celle-ci étant de même nature que chez les hommes), dont l'éventuel mobilier d'accompagnement se limite à de rares ornements ou éléments de vêtements, en particulier la fibule (qui se retrouve chez les deux sexes), l'anneau ou le bracelet. La présence de vases d'accompagnement semble alors marginale, et exclut en tout cas un rapport évident avec celle de vases à parfum.
Le panorama change durant les siècles suivants, période à laquelle se rapportent la plupart des incinérations connues. On s'oriente alors vers une raréfaction des tombes - définies comme masculines - comportant matériel ostentatoire et multiplicité de vases d'accompagnement. Les armes disparaissent, tandis que se dessine le schéma d'exclusion relative entre sépultures à urne cinéraire et sépultures avec vase à parfum. De la sorte, entre le IVe et le IIe siècle, on se trouve en présence des trois premiers types de tombes évoqués plus haut. Il est alors tentant, dans la mesure où vases à parfum et vases à boire se retrouvent aussi bien isolés qu'associés, de mettre en relation ces ensembles avec vases (de moins en moins luxueux) au compte de sépultures masculines. Un transfert des attributs typiques de la première période se serait alors produit, tandis que, pour des raisons encore indéfinies, la déposition des cendres dans une urne a été délaissée.
Dès lors, peut-on pour autant considérer comme à coup sûr féminines les tombes avec urne cinéraire, fréquemment non tournée, qui sont, comme on l'a vu, le plus souvent dépourvues de matériel d'accompagnement? Cela est possible, dans la mesure où cette interprétation correspondrait à un type déjà attesté aux époques antérieures. Une autre alternative consisterait à ne considérer comme féminines que les tombes sans urne cinéraire, largement dépourvues de vases d'accompagnement et ne renfermant le cas échéant que quelques objets de parure ou pièces de vêtement. La combinaison des deux hypothèses me semble en fait des plus probables. Notons enfin que les éléments à valeur prophylactique, qui sont, rappelons-le, parallèles à ceux du monde grec, se rencontrent indistinctement dans les divers types de sépultures.
43. Incinération « Muralla N/E » 2.
50 ÉRIC GAILLEDRAT
Le cas de la nécropole du « Parking » peut éventuellement nous éclairer, malgré le faible nombre de sépultures : sur un total de douze, il en est sept dépourvues de tout mobilier, trois avec seulement une urne cinéraire non tournée, une avec une coupe à boire (attique) et enfin une avec unguentarium, vase miniature et perle de collier. Il est bien évidemment impossible de tirer des conclusions d'un échantillonnage statistique aussi faible ; toutefois, et en supposant la présence conjointe de sépultures féminines et masculines, on ne peut que faire le parallèle avec la situation plus globale décrite à l'échelle de la nécropole. Un ultime problème se pose ici, à savoir celui des enfants, dont on voit mal comment distinguer la part qui leur revient. Il est néanmoins probable que les sépultures infantiles fassent partie des plus démunies et se différencient peu (pour autant qu'on puisse en juger) des tombes féminines.
Ces conjectures restent suspendues à la vérification d'un certain nombre de points fondamentaux. C'est le cas en particulier de la nécessaire mise en parallèle de ces associations de mobilier avec une argumentation anthropologique, qui seule peut autoriser le passage à une véritable interprétation donnée en termes sociaux.
UNE IMAGE DES RAPPORTS GRECS-INDIGÈNES
L'image des deux sociétés grecque et indigène cohabitant dans l'espace des nécropoles ampuritaines reste, on le voit, assez imparfaite. Un certain nombre de phénomènes ont cependant été mis en lumière, sur la base des observations réalisables sur les types et associations de mobilier, qui ne représentent en fin de compte qu'une partie de cet ensemble complexe de gestes, de croyances et d'objets constituant le monde funéraire.
Des divergences fondamentales existent alors entre ces deux mondes, en particulier cette dualité inhumation/incinération dont on a pu voir qu'elle correspondait bel et bien à l'existence de deux entités distinctes, et non à l'existence - toujours possible - d'une bipartition des rites à l'intérieur d'un même groupe humain. Ces divergences ont été entraperçues de manière plus ou moins nette lors de l'approche du mobilier funéraire, qui a en fin de compte révélé un rapport à l'objet qui, quoique différencié, n'exclut pourtant pas des phénomènes de convergence qu'il convient à présent d'analyser.
Continuité et ruptures, conservatisme et emprunts
Tant pour le monde grec que pour le monde ibérique, l'idée de « continuité » au niveau des pratiques funéraires est apparue incontournable. Cette notion a toutefois été nuancée par l'hypothèse d'une certaine rupture lors du IVe siècle, qui marque dans un cas comme dans l'autre une régression quantitative, et dans une certaine mesure qualitative, du mobilier déposé dans la tombe. La cause de cette évolution demeure malaisée à expliquer, mais ne peut en aucun cas être mise en
GRECS ET IBÈRES DANS LA NÉCROPOLE D'AMPURIAS 51
rapport de manière simpliste avec une quelconque répercussion d'une condition économique peu avantageuse, tant il est vrai au contraire qu'Emporion a alors connu une période de croissance économique importante. Les deux phénomènes sont ici indépendants, et montrent si besoin en était la complexité des enjeux culturels que révèle l'étude du monde funéraire. Plus intéressant est alors le parallélisme grec/indigène de cette tendance à l'austérité, qui pourrait aller dans le sens de l'existence de liens étroits entre les deux communautés. Du rapprochement mutuel au maintien de l'identité propre, on entrevoit alors une fois de plus cette situation d'ambiguïté qui constitue le leitmotiv du discours historique ampuritain.
Du côté hellénique domine l'image d'une société stable dans son rapport avec la mort, et donc dans ses croyances. Plus encore, les gestes apparaissent parfaitement codifiés et renvoient à l'existence d'un système de valeurs non seulement homogène, mais aussi continu. Les associations d'objets, les véritables panoplies funéraires que fait apparaître l'analyse du mobilier suggèrent bien l'accomplissement des gestes essentiels connus par ailleurs dans le monde grec.
On a vu par ailleurs combien il est difficile de cerner des différences sociales importantes, sauf dans quelques exemples appartenant dans leur très grande majorité à une époque ancienne. Les écarts perceptibles ne sont en tout état de cause guère importants et ont toutes les chances de renvoyer pour partie à des différences d'âge ou/et de sexe. Faut-il alors pour autant verser ces quelques remarques au dossier du « conservatisme » si souvent évoqué de cette société phocéenne d'Occident? Faut-il les mettre également en parallèle avec cette cohésion importante du corps social ampuritain que nous rappelle Tite-Live44, synonyme d'une distinction longtemps maintenue avec la population ibère?
Du côté de cette dernière, alors qu'un fort conservatisme s'exprime à travers l'utilisation cinéraire de l'urne non tournée, l'apparition dès le VIe siècle d'un élément exogène tel le vase à parfum signifie pour le milieu indigène un emprunt indiscutable au monde grec. S'agit-il d'un simple emprunt matériel ou bien du reflet d'un processus d'assimilation plus large? Le dépôt occasionnel de ces mêmes vases sur le bûcher funéraire pourrait refléter l'adoption de gestes de consécration empruntés au domaine hellénique, mais rien ne s'oppose véritablement à ce qu'il s'agisse plus simplement de la simple intégration d'un élément matériel nouveau à un rituel préexistant.
La même remarque vaut alors pour l'autre catégorie d'objets méditerranéens adoptés de manière précoce, à savoir les vases à boire ou à verser le vin. La consommation de manière simultanée du produit et des ustensiles est un phénomène très largement observé à l'intérieur du monde indigène comme conséquence d'un premier contact avec le commerce méditerranéen. Toutefois, le fait que ces éléments soient intégrés au rituel funéraire introduit une nouvelle dimension, plus spirituelle, et soulève alors la question de l'éventuelle intégration de croyances spécifiques inspirées par le monde grec. La prudence est ici de rigueur, tant la
44. Tite-Live, XXXIV, 9, 1-10.
52 ÉRIC GAILLEDRAT
présence de ces objets (qui présentent souvent un caractère ostentatoire) peut signifier plus simplement une intégration à un système de valeurs préexistant. Dans ce cas, le vase à boire grec ou étrusque aurait naturellement trouvé sa place dans un service funéraire encore « large », où prennent place - du moins dans une partie des tombes - diverses pièces du service de table. Du caractère « exotique » et luxueux d'un objet qui reflète avant tout une volonté ostentatoire à l'assimilation de croyances exogènes en rapport avec ce dernier, la distance est alors grande. La présence dans deux sépultures de louches à puiser ou simpula montre alors également cette importance du rite de la boisson dans les sociétés protohistoriques du Premier Âge du Fer, indépendamment des modèles véhiculés par le monde méditerranéen.
L'évolution postérieure des panoplies funéraires présentes dans les incinérations montre en tout état de cause que ces emprunts ont eu des conséquences durables, puisqu'on retrouve du IVe au IIe siècle des sépultures associant, presque à l'exclusion de tout autre matériel, vases à parfum et/ou à boire. Dans un cas comme dans l'autre, le luxe que revêtaient les ensembles des VIe- Ve siècles a cédé la place à un certain dépouillement. Cela n'empêche pourtant pas, encore au IVe siècle, la présence de quelques pièces importées assez exceptionnelles, telle par exemple cette péliké attique à figures rouges de la nécropole « Bonjoan »45.
On a vu par ailleurs que la représentation des vases à parfum au sein des mobiliers indigènes ne cessait de croître. Le rôle tenu par ce type de produit dans le rituel funéraire indigène s'est alors bien confirmé, mais cela laisse toujours en suspens la question des idées et croyances qui lui sont rattachées.
Peut-on alors parler d'une « hellénisation » des pratiques funéraires indigènes? Globalement non, et ce pour plusieurs raisons : à cause, tout d'abord, du maintien du même mode sépulcral, à savoir l'incinération (confirmé par un rapport différent entretenu avec l'objet funéraire), à cause, ensuite, de la survivance des grandes tendances liées au mode de dépôt des restes : on note alors en particulier cette habitude de déposer les cendres dans une urne, non pas quelconque, mais qui fait partie de préférence d'une production proprement indigène. La diversité plus grande des types de vases est enfin, toutes proportions gardées, une ultime différence de forme et de fond permettant d'isoler les incinérations. C'est alors une réponse nuancée que les Ibères ont donnée aux apports émanant de leurs voisins grecs, et on ne peut finalement s'empêcher de penser à cette situation d'ambiguïté permanente au niveau des relations entre les deux communautés.
Des Ibères dans une nécropole grecque?
Une question fondamentale doit alors être posée : dans quelle mesure la présence dans un même espace de sépultures grecques et ibériques reflète-t-elle le statut des terrains ainsi occupés? Autrement dit, doit-on raisonner en termes d'espaces
45. Incinération « Bonjoan » 5.
GRECS ET IBÈRES DANS LA NÉCROPOLE D'AMPURIAS 53
communs, et que signifie dans ce cas un tel partage, alors que les rapports entre les deux communautés ont longtemps été placés sous le signe de l'ambiguïté, entre la méfiance et l'intérêt commun?
Le schéma d'implantation des tombes grecques est des plus spécifiques, puisque ces dernières sont dans un premier temps disposées dans ce qui apparaît comme une véritable « projection géométrique » de la Néapolis. La nécropole se développe alors en particulier vers le sud, et ne commence qu'à plusieurs centaines de mètres de la limite présumée de la Néapolis aux vr3-^ siècles : secteurs « Mateu », « Granada », « Bonjoan » et « Portitxol ». En revanche, les sépultures les plus anciennes situées du côté ouest, autrement dit celles de la nécropole « Marti », ne sont situées qu'à quelques dizaines de mètres seulement du même espace urbain. S'il est vraisemblable que l'implantation de la ville d'époque romaine a grandement endommagé la partie occidentale de la nécropole, il n'en demeure pas moins qu'au Ve siècle il n'existe pas de ce côté-là d'espace libre entre habitat et nécropole.
Comment dès lors ne pas imaginer qu'il ait existé un « facteur limitant », qui ne peut correspondre ici qu'à l'existence d'un espace sous domination ibère, qu'il s'agisse ou non d'une zone d'habitat à proprement parler ? Au sud, l'existence révélée depuis peu d'un quartier suburbain à forte connotation indigène46 confirme (plus qu'elle n'explique) l'existence d'un vide entre les murs méridionaux de la ville grecque et les premières sépultures, situées un peu plus loin, comme on l'a vu. Il est alors vraisemblable que les Ibères aient profité d'une situation qui à l'origine correspondait peut-être au souci des Grecs de laisser libre une portion de terrain en vue d'une éventuelle extension urbaine et afin de ne pas avoir un jour à empiéter sur l'espace respecté des nécropoles. Il est en tout cas vraisemblable que l'implantation des tombes du VIe, puis du Ve siècle délimite bel et bien un véritable espace grec extramuros sur la frange orientale du Turô d'Empùries. Un tel espace reste en tout état de cause limité dans son extension, ce que confirme par ailleurs le « repli » des tombes durant les siècles suivants, tombes qui loin de s'éloigner de la ville s'en rapprochent au contraire, comme en témoigne la répartition des sépultures à l'intérieur des espaces déjà évoqués, auxquels se rajoute aux rvMir5 siècle la nécropole du «Parking»47. Outre le fait que se renforce alors l'impression d'une pression exercée sur l'espace funéraire (alors synonyme d'une tension plus générale?), cela nous amène bel et bien à considérer ce dernier comme étant principalement sous le contrôle des Emporites.
Dans une telle optique, qui permet sans doute de relancer en partie le débat sur la localisation de l'habitat indigène dont nous parlent les sources anciennes, il faudrait alors considérer les sépultures indigènes comme étant des éléments
46. Enric SANMARTt-GREGO et alii, « Las estructuras griegas de los siglos V y IV a. de J.-C. halladas en el sector sur de la Néapolis de Ampurias (campana de excavaciones del ano 1986) », Cuadernos de Prehistoria y Arqueologia Castellonense, 12, 1986, p. 141-217.
47. Tandis que le quartier indigène au sud de la Néapolis disparaît ou se voit englobé à l'intérieur de celle-ci.
54 ÉRIC GAILLEDRAT
associés au domaine hellénique de façon finalement partielle, sinon occasionnelle. Le faible nombre d'incinérations semble constituer un argument allant dans ce sens. Faut-il alors supposer l'existence de secteurs funéraires plus spécifiquement indigènes? Faut-il considérer d'une manière particulière les Ibères incinérés aux côtés des Grecs, à l'image peut-être de ceux établis dans le courant du Ve siècle au contact direct de la ville Néapolis? Rien n'interdit de penser que l'élément ibérique ait eu un comportement relativement diversifié face aux Grecs, en fonction d'intérêts personnels ou de sentiments inégaux qui nous échappent largement. Les deux communautés ont en tout cas cohabité dans la mort, comme en témoigne le respect mutuel des tombes, constaté de manière régulière dans les espaces fouillés. Reflet direct mais encore imparfait d'une situation de proximité physique dont les contradictions ont été évoquées, les nécropoles préromaines d'Ampurias constituent un élément clé pour pouvoir saisir l'évolution des sociétés ibériques du Nord-Est péninsulaire et du golfe du Lion.