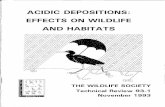Instructions de fonctionnement et manuel de pièces Scie à ...
Fonctionnement des habitats de plein air en Ile-de-France
Transcript of Fonctionnement des habitats de plein air en Ile-de-France
62 / Les Dossiers d’Archéologie / n°345
>>Fonctionnement des habitats de plein airen Ile-de-France
Aborder le thème du fonctionnement des sites du Paléolithique moyen est un exercice difficile.Cette période couvre un large champ chronologique et une zone géographique considérable.Les gisements ne sont, en général, pas limités d’un point de vue topographique et peuvent couvrirdes superficies de plusieurs milliers de mètres carrés. Ils se présentent sous la forme de vastesnappes de vestiges lithiques, parfois associés à des ossements animaux quand ceux-ci n’ont pas étédétruits par l’acidité des sédiments. Les seules structures identifiables sont des amas résultant de lafabrication d’outils en pierre, très rarement des zones où l’usage du feu est attesté.
FONCTIONNEMENT DES HABITATS DE PLEIN AIR EN ILE-DE-FRANCE
Par Jean-Luc LOCHT
>> Ingénieur de recherche à l’Inrap Nord-Picardie
Vue aérienne du gisement de Fresnoy-au-Val (Somme). Le niveau noir correspond à un sol humifère du début de la dernière glaciation (± 85000 ans) qui contenait un niveau moustérien. Cliché F. Lemaire, Inrap.
DARCH-345-62-67-Locht 14/04/11 15:03 Page62
LA CHRONOLOGIEe Paléolithique moyen est une vaste pé-riode qui débute vers 300000 ans et se ter-mine vers 40000 ans av. J.-C. Il est
contemporain de trois phases glaciaires, séparéespar deux épisodes interglaciaires. Les travaux récentsréalisés en France septentrionale démontrent l’étroiteinteraction entre le climat et les peuplements préhis-toriques. Lorsque que les conditions climatiques de-viennent trop rigoureuses dans le nord de l’Europe,ces régions sont désertées. Les populations humainesont dû migrer vers le sud, à moins qu’une partie d’en-tre elles n’aient disparu sur place. Il ne semble doncpas y avoir d’occupations humaines durant les pé-riodes les plus froides des phases pléniglaciaires.Le peuplement préhistorique prend ainsi place audébut et à la fin de ces phases climatiques rigoureuses,ou pendant les phases tempérées interglaciaires.
L’INDUSTRIE LITHIQUETous les systèmes de taille sont parfaitement
maîtrisés depuis le début du Paléolithique moyen,aux alentours de 300000 ans av. J.-C. Le débitage Le-vallois, qui constitue le bruit de fond des ensembleslithiques, coexiste, dans les assemblages archéolo-giques, avec la production de lames, de pointes et lefaçonnage de bifaces, dans des proportions variables.
Les outils retouchés sont assez rares, car leslames, les éclats et les pointes ont souvent été utili-sés bruts de retouches.
À l’inverse de ce qui se passera plus tard au Pa-léolithique supérieur, on ne note aucune évolutionou innovation technologique pendant cette période.
Cependant, au sein d’un même système techniquecomme le débitage Levallois, il semble y avoir desdifférences dans les objectifs derrière une apparentestabilité technique. Ainsi, le très beau débitageLevallois des sites de Therdonne (Picardie) et deBiache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) a produit degrands supports (éclats et pointes) dont la fonctiondifférait peut-être de ceux de taille plus modeste pro-duits au début de la dernière glaciation.
FONCTIONNEMENT INTERNE DES SITESPlusieurs facteurs conditionnent l’implantation
des gisements parmi lesquels les plus importantssemblent être la présence de matière première pourla fabrication des outils, d’eau et de troupeaux degrands herbivores.
L’interprétation des sites se heurte à plusieursobstacles. Tout d’abord, il convient de s’interrogersur l’état de conservation des niveaux archéolo-giques, en prenant en compte les évènements quiauraient pu les déformer (processus périglaciaires,érosion…), ou au contraire favoriser leur conserva-tion (sédimentation fluviatile fine non perturbante).Ce préambule est indispensable afin d’établir la va-lidité des informations recueilles, ce qui conditionneleur interprétation.
De plus, l’homme de Néandertal appartient àune espèce différente de la nôtre et possédait sansdoute un cerveau différent. Il est ainsi très possiblequ’il ait eu des conceptions et une perception de l’es-pace différentes, ce qui pourrait expliquer pour par-tie les difficultés rencontrées dans l’interprétation deson habitat et la reconstitution de son mode de vie.
n°345 / Les Dossiers d’Archéologie / 63
L
Biface provenant du site de Ploisy (Aisne), ± 55000 ans. Cliché St. Lancelot, Inrap.
DARCH-345-62-67-Locht 14/04/11 15:03 Page63
d’informations sur la durée de l’occupation d’un gisement et sur la taille du groupe humain concerné.Hormis sur le site de La Folie, à Poitiers, qui a livréles traces d’un possible aménagement d’un coupe-vent, aucune structure d’habitats (trous de poteaux,cabanes, etc.) ne nous est parvenue. Les seules struc-tures identifiables sont les amas de débitage, qui té-moignent de la fabrication des outils lithiques, et,dans quelques rares cas, de foyers. Ces derniers sontconstitués soit par des concentrations d’os longs brû-lés ayant servi de combustible (Beauvais), soit dezones où le sédiment a enregistré une forte actiondu feu (Therdonne, Caours).
Lorsque les restes osseux sont conservés, ce quiest rare sur les gisements de plein air, ils témoignentd’une chasse orientée vers l’abattage de grands her-bivores. L’étude des différents restes anatomiquesmontre que les animaux tels que le rhinocéros oule mammouth sont découpés sur le lieu d’abattage,alors que les animaux plus facilement transporta-bles (renne, cerf, chevreuil…) sont emmenés entiersjusqu’au site de boucherie (Caours, Beauvais). Lesossements portent souvent les traces de découpeslaissées par les outils de pierre. Les os longs sont frac-turés pour la récupération de la moelle, et peuventaussi servir de combustible.
Lorsque les restes fauniques ne sont pas conser-vés, l’interprétation du gisement repose alors uni-quement sur l’étude du matériel lithique et l’analyse
64 / Les Dossiers d’Archéologie / n°345
FONCTIONNEMENT DES HABITATS DE PLEIN AIR EN ILE-DE-FRANCE
Depuis une vingtaine d’années, des fouilles ex-tensives, qui peuvent atteindre 7000 m2, ont étémenées en contexte d’archéologie préventive, et per-mettent d’avoir une nouvelle vision des habitats deplein air du Paléolithique moyen. L’étude détailléede ces niveaux archéologiques révèle un espace or-ganisé par l’homme de Néandertal. Cependant, larépartition au sol des vestiges ne livre pas beaucoup
Angé (Loir-et-Cher), ± 80000 ans. Fouilled’un amas de débitage. Cliché J.-L. Locht, Inrap.
Caours (Somme, ± 123000 ans). Amas de débitage de silex. Cliché J.-L. Locht, Inrap.
DARCH-345-62-67-Locht 14/04/11 15:03 Page64
n°345 / Les Dossiers d’Archéologie / 65
de sa répartition au sol. Des plans par catégories devestiges sont réalisés afin de discerner des zonesd’activités spécifiques (aires dédiées à des activitésde débitage, concentrations d’outils retouchés…).
Des remontages sont également réalisés sur lematériel lithique. Cette activité consiste à raccorderentre eux les éléments provenant du débitage d’unmême bloc de matière première. Les premiers ap-ports de ce travail sont ainsi d’ordre technologique,car il permet d’observer et de comprendre l’en-chaînement des gestes techniques du tailleur pré-historique, et de reconstituer et d’assimiler lestechniques de taille de la pierre. En plus de leurapport technologique, les remontages jouent ainsiun rôle actif dans l’analyse spatiale des gisements.Afin d’interpréter de façon dynamique les ensem-bles lithiques, chaque remontage est traité de façonindividuelle, et est graphiquement représenté enpartant du premier éclat détaché du bloc jusqu’audernier élément obtenu ou, quand cela a été possi-ble, jusqu’au nucléus. Chacune des lignes (traitplein) raccorde la face inférieure d’un éclat à la facesupérieure de l’éclat suivant. La f lèche indique ainsil’ordre chronologique de la production. Lorsquecette méthode est appliquée à des ensembles com-plets, il est possible de visualiser la répartitionspatiale des éléments d’un même bloc et, parfois, leprélèvement de l’un de ces vestiges. Dans ce cas,le sens du mouvement est perceptible. Après avoirpris en considération les facteurs d’ordre taphono-mique propre à chaque gisement, les déplacements
d’objets observés peuvent dans certains cas être in-terprétés comme le résultat de la dynamique pri-maire des deux occupations, aucun agent extérieurne venant brouiller la compréhension de ces gestes.L’implication de l’étude dynamique des remontagesdans l’analyse spatiale des niveaux archéologiquesest donc l’un des moyens les plus fiables pour ledécryptage des niveaux du Paléolithique moyen.Les remontages permettent de mettre en évidencele déplacement, d’origine anthropique, de vestigesdepuis leur lieu de production jusqu’à celui deleur utilisation.
Caours (Somme, ± 123000 ans). Hémi-mandibule de rhinocéros de prairie en cours de dégagement. Cliché G. Jamet.
Bettencourt-Saint-Ouen (Somme), ± 85000 ans. Pointe portant des endommagements liés à une utilisation en tant qu’armes de hast pour la chasse. Cliché St. Lancelot, Inrap.
DARCH-345-62-67-Locht 14/04/11 15:03 Page65
66 / Les Dossiers d’Archéologie / n°345
FONCTIONNEMENT DES HABITATS DE PLEIN AIR EN ILE-DE-FRANCE
L’analyse fonctionnelle des vestiges au micro-scope (tracéologie) renseigne en outre sur le type defonction exercée par l’outil, et la matière qu’il a travaillée : découpe de la viande, raclage du bois…
Sur le site de Bettencourt-Saint-Ouen (Somme),l’étude combinée des remontages et des analysesfonctionnelles montre que des silex taillés ont étéprélevés par l’homme de Néandertal au sein desamas de débitage où ils ont été produits et ont étéutilisés à quelques mètres pour des activités de dé-coupe des carcasses animales et de raclage du bois.
À L’EXTÉRIEUR DU SITEIl est impossible d’étudier un site paléolithique
sans tenter de le comprendre au sein du territoiredont il est une des composantes. Certains vestigespeuvent témoigner d’activités extérieures au site.Il est assez fréquent de retrouver des vestiges réalisésdans une matière première qui ne figure pas dansl’environnement proche, témoignant d’un transportqui peut atteindre plusieurs dizaines voire centainesde kilomètres. Ces circulations de matériau attestentainsi de la connaissance et de la gestion d’un vasteterritoire.
Dans certains cas, la découverte de pointes, portant des traces spécifiques, démontrent qu’ellesont été emmanchées au bout d’un épieu de bois etont servi d’armes de hast. Elles témoignent d’activi-tés de chasse effectuées à l’extérieur du gisement oùelles ont été ramenées puis démanchées (ou alors lemanche a disparu).
Bettencourt-Saint-Ouen (Somme), ± 85000 ans. Prélèvement d’un couteau à dos naturel au seind’un amas de débitage. Il a ensuite été utilisé pour la découpe du gibier. © DAO St Lancelot, J.-L. Locht, Inrap.
Plan du gisement de Villiers-Adam (Val d’Oise),± 105000 ans. Les lignes matérialisent les raccords entre vestiges, provenant en partied’amas de débitage différents. La plus grande distance est de 63,5 m. © DAO Pascal Raymond, Inrap.
DARCH-345-62-67-Locht 14/04/11 15:03 Page66
D’un point de vue techno-écono-mique, certains types de vestiges (lames,pointes, etc.) peuvent être sur-représen-tés, ou au contraire sous-représentés, enregard des nucléus susceptibles de lesavoir produits, ce qui laisse supposer desimports et des exports d’un gisement àun autre. Ces observations démontrentainsi la mobilité des groupes néanderta-liens et introduit une notion de dyna-mique dans les études sur cette périodequi apparaissait encore à la fin du siècledernier stable, voire statique. Un de cestypes de vestiges « mobiles » est le bi-face. Sur plusieurs gisements, des amasde façonnage de pièces bifaciales ont étéretrouvés, mais celles-ci sont absentes.Elles ont été emportées, car, leur struc-ture volumétrique supportant de nom-breuses phases de réaffûtage, leur duréed’utilisation est plus longue que celled’un éclat ou d’une pointe.
La fonction des sites au sein d’un ter-ritoire est, elle aussi, difficile à appré-hender. En comparaison avec desanalyses menées dans le domaine eth-noarchéologique, deux modèles peuventêtre proposés :
– le premier est celui de la « mobilitérésidentielle ». Les groupes néander-taliens se déplaceraient ainsi tout aulong de l’année, abandonnant lecampement dès lors que les déplace-ments quotidiens dans l’environne-ment proche ne leur permettentplus d’assurer leur subsistance.– le second est celui de la « mobilité straté-gique ». Il suppose l’existence d’un camp de basede longue durée. Les Néandertaliens se déplace-raient alors en petits groupes vers des sites péri-phériques spécialisés pour y acquérir leursressources (haltes de chasse, gîtes de matière pre-mière) et les ramener au campement.
CONCLUSIONLes recherches récentes sur les habitats de plein
air ont donc permis de mieux appréhender la fonc-tion et le fonctionnement de ces gisements, et doncde mieux connaître le mode de vie des populationsnéandertaliennes. Les modalités d’acquisition desressources animales, minérales, voire végétales dé-montrent qu’il existe dès le Paléolithique moyen descomportements de subsistance et d’anticipationproches de ceux qui ont été mis en évidence pour lePaléolithique supérieur. n
n°345 / Les Dossiers d’Archéologie / 67
• BINFORD (L.-R.) — Willow smoke and dogs’ tails : hunter-gatherersettlement systems and archaeological site formation, American Antiquity, 45-1, 1980, pp. 4-20.
• DEMOULE (J.-P.) dir. — La France archéologique : vingt ans d’aménage-ments et de découvertes, Paris, Hazan, 2004.
• DEPAEPE (P.) — La France du Paléolithique, Paris, La Découverte, 2009.
• GOVAL (E.) — Définitions, analyses et caractérisations des territoires desNéandertaliens au Weichsélien ancien en France septentrionale : approchestechnologiques et spatiales des industries lithiques, élargissement au nord-ouest de l’Europe, thèse de doctorat, université des sciences et technolo-gies de Lille, 2008, 543 p.
• LOCHT (J.-L.) — Bettencourt-Saint-Ouen ; cinq occupations paléolithiques au début de la dernière glaciation, Document d’Archéolo-gie Française, n°90, 2002.
• LOCHT (J.-L.) et alii — Une occupation de la phase ancienne du Paléolithique moyen à Therdonne (Oise, France) : chronostratigra-phie, production de pointes Levallois et réduction des nucléus, GalliaPréhistoire, t. 52, 2010, pp. 1-32.
>> Bibliographie
Déplacement d’origine anthropique à partir d’un amas de débitage. Villiers-Adam (Val d’Oise). © DAO Pascal Raymond, Inrap.
DARCH-345-62-67-Locht 14/04/11 15:03 Page67