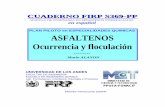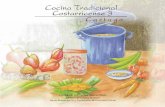Facultad de Filosofía y Letras Sponsorships Apoyos y patrocinios Universidad Autónoma de Madrid...
-
Upload
univ-lyon2 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Facultad de Filosofía y Letras Sponsorships Apoyos y patrocinios Universidad Autónoma de Madrid...
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Proceedings of the 5th International Congresson the Archaeology of the Ancient Near East
Universidad Autónoma de Madrid
Proceedings of the 5th InternationalCongress on the Archaeology of
the Ancient Near EastMadrid, April 3-8 2006
Edited byJoaquín Mª Córdoba, Miquel Molist, Mª Carmen Pérez,
Isabel Rubio, Sergio Martínez(Editores)
Madrid, 3 a 8 de abril de 2006
Actas del V Congreso Internacionalde Arqueología del Oriente Próximo Antiguo
VOL. III
Centro Superior de Estudios sobre el Oriente Próximo y Egipto
Madrid 2008
Colección Actas
©ISBN (OBRA COMPLETA): 978-84-8344-140-4ISBN (VOL. III): 978-84-8344-147-3Depósito legal: GU-129/2009
Realiza: Palop Producciones Gráficas.Impreso en España.Diseño de cubierta: M.A. Tejedor.
5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near EastV Congreso Internacional de Arqueología del Oriente Próximo Antiguo
Scientific Committee Scientific Steering CommitteeComité Científico Organizador Comité Científico Permanente
Joaquín Mª Córdoba Manfred BietakSergio Martínez Barthel Hrouda (honorary member)Miquel Molist Hartmut KühneMª Carmen Pérez Jean-Claude MargueronIsabel Rubio Wendy Matthews
Paolo MatthiaeDiederik MeijerIngolf ThuesenIrene J. Winter
Executive CommissionComisión Ejecutiva
Ana Arroyo, Carmen del Cerro, Fernando Escribano, Saúl Escuredo, Alejandro Gallego,Zahara Gharehkhani, Alessandro Grassi, José Manuel Herrero †, Rodrigo Lucía, MontserratMañé, Covadonga Sevilla, Elena Torres
Technical collaboratorsColaboradores técnicos
Virginia Tejedor, Pedro Bao, Roberto Peñas, Pedro Suárez, Pablo Sebastagoítia, JesúsGonzález, Raúl Varea, Javier Lisbona, Carmen Suárez, Amanda Gómez, Carmen Úbeda,Cristina López, José Mª Pereda, Rosa Plaza, Lorenzo Manso, Juan Trapero
Congress VenueSede del Congreso
Universidad Autónoma de MadridFacultad de Filosofía y Letras
SponsorshipsApoyos y patrocinios
Universidad Autónoma de MadridMinisterio de Educación y CienciaMinisterio de CulturaMinisterio de Asuntos ExterioresComunidad de Madrid
Themes of the CongressTemas del Congreso
1. History and Method of Archaeological ResearchLa historia y la metodología de la investigación arqueológica
2. The Archaeology and the Environment of the Ancient Eastern Cities and VillagesLa arqueología y el entorno de las ciudades y las aldeas antiguas
3. Arts and Crafts in the Ancient Near EastLa artesanía y el arte en el Oriente Antiguo
4. Reports on the Results from the Latest Archaeological SeasonsInformes sobre los resultados de las recientes campañas de excavación
Index - Índice
VOL. I
Á. Gabilondo Pujol, Prólogo...................................................................................... 17P. Matthiae, Opening Speech ........................................................................................ 21J. Mª Córdoba, M. Molist, Mª C. Pérez, I. Rubio, S. Martínez, Bienvenida........ 25
Opening Lectures to Main Themes - Apertura de las sesiones temáticas
N. Chevalier, Considérations sur l’histoire de l’archéologie, ses origines et son développe-ment actuel.............................................................................................................. 31
S. Mazzoni, Arts, crafts and the state: A dialectic process............................................ 37
Papers and posters - Comunicaciones y pósters
M. Abdulkarim, O. Olesti-Vila, Territoire et paysage dans la province romaine dela Syrie. La centuriatio d’Emesa (Homs) ............................................................... 55
G. Affani, Astragalus bone in Ancient Near East: Ritual depositions in Iron Agein Tell Afis ........................................................................................................... 77
A. Ahrens, Egyptian and Egyptianizing stone vessels from the royal tomb and palaceat Tell Mišrife/Qa7na (Syria): Imports and local imitations ................................... 93
B. Ajorloo, The neolithization process in Azerbaijan: An introduction to review............... 107C. Alvaro, C. Lemorini, G. Palumbi, P. Piccione, From the analysis of the archaeo-
logical context to the life of a community. «Ethnographic» remarks on the ArslantepeVIB2 village .......................................................................................................... 127
Sh. N. Amirov, Towards understanding religious character of Tell Hazna 1 oval ............. 137Á. Armendáriz, L. Teira, M. Al-Maqdissi, M. Haïdar-Boustani, J. J. Ibáñez, J. Gonzá-
lez Urquijo, The megalithic necropolises in the Homs Gap (Syria). A preliminaryapproach ................................................................................................................. 151
A. Arroyo, Akpinar.................................................................................................... 163
L. Astruc, O. Daune-Le Brun, A. L. Brun, F. Hourani, Un atelier de fabricationde récipients en pierre à Khirokitia (Néolothique pré-céramique récent, VIIe millénaireav. JC, Chypre........................................................................................................ 175
G. Baccelli, F. Manuelli, Middle Bronze Khabur Ware from Tell Barri/Kahat ..... 187B. Bader, Avaris and Memphis in the Second Intermediate Period in Egypt (ca. 1770-
1770-1550/40 BC)............................................................................................... 207F. Baffi, Who locked the door? Fortification walls and city gates in Middle Bronze Age
inner Syria: Ebla and Tell Tuqan .......................................................................... 225L. Barda, El aporte de los mapas y descripciones antiguas en el ensayo de reconstrucción
de sitios arqueológicos, periferias y rutas (con uso del SIG) ...................................... 245C. D. Bardeschi, A propos des installations dans la cour du Temple Ovale de Khafajah ..... 253C. Bellino, A. Vallorani, The Stele of Tell Ashara. The Neo-Syrian perspective............ 273D. Ben-Shlomo, Iconographic representations from Early Iron Age Philistia and their
ethnic implications ................................................................................................... 285A. I. Beneyto Lozano, Manifestaciones artísticas desde Oriente Próximo a Al-Andalus 305L. Bombardieri, C. Forasassi, The pottery from IA II-III levels of Late-Assyrian
to Post-Assyrian period in Tell Barri/Kahat .......................................................... 323B. Brown, The Kilamuwa Relief: Ethnicity, class and power in Iron Age North
Syria....................................................................................................................... 339A. Brustolon, E. Rova, The Late Chalcolithic settlement in the Leilan region of Nor-
theastern Syria: A preliminary assessment .............................................................. 357S. M. Cecchini, G. Affanni, A. Di Michele, Tell Afis. The walled acropolis (Middle
Bronze Age to Iron Age I). A work in progress..................................................... 383B. Cerasetti, V. A. Girelli, G. Luglio, B. Rondelli, M. Zanfini, From monument to
town and country: Integrated techniques of surveying at Tilmen Höyük in South-EastTurkey.................................................................................................................... 393
N. Chevalier, Fouiller un palais assyrien au XIXe siècle: Victor Place à Khorsabad....... 403L. Chiocchetti, Post-Assyrian pottery from the Italian excavations at Fort Shalmaneser,
1987-1990 ............................................................................................................ 417X. Clop García, Estrategias de gestión de las materias primas de origen mineral en Tell
Halula: primera aproximación................................................................................ 441A. Colantoni, A. Gottarelli, A formalized approach to pottery typology: The case of
some typical shapes from the Late Bronze Age in Northern Syria .......................... 455A. M. Conti, C. Persiani, Arslantepe. The building sequence of the EB3 settle-
ment ....................................................................................................................... 465C. Coppini, Mitannian pottery from Tell Barri ........................................................... 477J. Mª Córdoba, Informe preliminar sobre las últimas campañas en al Madam (2003-2006).... 493F. Cruciani, The atributes of Ishtar in Old Syrian glyptic and the Mesopotamian literary
tradition.................................................................................................................. 509A. Daems, Alternative ways for reading some female figurines from Late Prehistoric
Mesopotamia and Iran............................................................................................ 519
10 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
A. D’Agostino, Between Mitannians and Middle-Assyrians: Changes and linksin ceramic culture at Tell Barri and in Syrian Jazirah during the end of the 2ndmillennium BC ....................................................................................................... 525
A. D’Agostino, S. Valenti, N. Laneri, Archaeological works at Hirbemerdon Tepe(Turkey). A preliminary report or the first three seasons ......................................... 549
M. B. D’Anna, R. Laurito, A. Ricci, Walking on the Malatya Plain (Turkey): Pre-liminary remarks on Chalcolithic pottery and occupation. 2003-2005 ArchaeologicalSurvey Project ......................................................................................................... 567
I. de Aloe, A preliminary report on the 1995 Tell Leilan survey: The pottery fromthe Hellenistic to the Sasanian Period ..................................................................... 575
F. Dedeoglu, Cultural transformation and settlement system of Southwestern Ana-tolia from Neolithic to LBA: A case study from Denizili/Çivril Plain.................. 587
K. De Langhe, Early Christianity in Iraq and the Gulf: A view from the architec-tural remains .......................................................................................................... 603
T. De Schacht, W. Gheyle, R. Gossens, A. De Wulf, Archaeological researchand CORONA: On the use, misuse and full potential of historical remote sen-sing data ................................................................................................................. 611
C. del Cerro, Life and society of the inhabitants of al Madam (UAE). Interdisciplinarystudy of an Iron Age village and its environment .................................................... 619
G. M. Di Nocera, Settlements, population and landscape on the Upper Euphrates betweenV and II millennium BC. Results of the Archaeological Survey Project 2003-2005in the Malatya Plain .............................................................................................. 633
S. Di Paolo, Dalle straordinarie avventure di Lady Hester Stanhope alla «Crociata» archaeo-logica di Butler : la politica «religiosa» dei viaggi delle esplorazioni scientifiche nellaregione di Damasco tra XIX e XX secolo .............................................................. 647
R. Dolce, Considerations on the archaeological evidence from the Early Dynastic Templeof Inanna at Nippur.............................................................................................. 661
R. H. Dornemann, Status report on the Early Bronze Age IV Temple in Area E atTell Qarqur in the Orontes Valley, Syria ............................................................... 679
A. Egea Vivancos, Artesanos de lo rupestre en el alto Éufrates sirio durante la época romana.. 711A. Egea Vivancos, Viajeros y primeras expediciones arqueológicas en Siria. Su contribución
al redescubrimiento de Hierapolis y su entorno ........................................................ 731B. Einwag, Fortified citadels in the Early Bronze Age? New evidence from Tall Bazi
(Syria) .................................................................................................................... 741M. Erdalkiran, The Halaf Ceramics in Hirnak area, Turkey..................................... 755F. Escribano Martín, Babilonia y los españoles en el siglo XIX ................................. 767M. Feizkhah, Pottery of Garrangu style in Azarbaijan (Iran).................................... 775E. Felluca, Ceramic evidences from Bampur: A key site to reconstruct the cultural development
in the Bampur Valley (Iran) during the third millennium BC................................. 797E. Felluca, S. Mogliazza Under-floor burials in a Middle Bronze Age domestic quarter at Tell
Mardikh – Ebla, Syria ........................................................................................... 809
Index - Índice 11
VOL. II
S. Festuccia, M. Rossi, Recent excavations on the Ebla Acropolis (Syria).................. 17S. Festuccia, M. Rossi Latest phases of Tell Mardikh - Ebla: Area PSouth Lower
Town ...................................................................................................................... 31J.-D. Forest and R. Vallet, Uruk architecture from abroad: Some thoughts about
Hassek Höyük....................................................................................................... 39M. Fortin, L.-M. Loisier, J. Pouliot, La géomatique au service des fouilles archéologiques:
l’exemple de Tell ‘Acharneh, en Syrie ...................................................................... 55G. Gernez, A new study of metal weapons from Byblos: Preliminary work ..................... 73K. T. Gibbs, Pierced clay disks and Late Neolithic textile production.......................... 89J. Gil Fuensanta, P. Charvàt, E A. Crivelli, The dawn of a city. Surtepe Höyük excava-
tions Birecik Dam area, Eastern Turkey ............................................................... 97A. Gómez Bach, Las producciones cerámicas del Halaf Final en Siria: Tell Halula (valle
del Éufrates) y Tell Chagar Bazar (valle del Khabur) ............................................. 113E. Grootveld, What weeds can tell us Archaeobotanical research in the Jordan Valley ... 123E. Guralnick, Khorsabad sculptured fragments............................................................ 127H. Hameeuw, K. Vansteenhuyse, G. Jans, J. Bretschneider, K. Van Lerberghe,
Living with the dead. Tell Tweini: Middle Bronze Age tombs in an urban context... 143R. Hempelmann, Kharab Sayyar : The foundation of the Early Bronze Age settle-
ment ....................................................................................................................... 153F. Hole, Ritual and the collapse of Susa, ca 4000 BC ................................................ 165D. Homès-Fredericq The Belgian excavations at al-Lahun (biblical Moab region), Jordan.
Past and future ....................................................................................................... 179J. J. Ibáñez et al., Archaeological survey in the Homs Gap (Syria): Campaigns of 2004 and
2005....................................................................................................................... 187A. Invernizzi, El testimonio de Ambrogio Bembo y Joseph Guillaume Grelot sobre
los restos arqueológicos iranios ................................................................................. 205K. Jakubiak, Pelusium, still Egyptian or maybe Oriental town in the Western Synai.
Results of the last excavations on the Roman city ................................................... 221S. A. Jasim, E. Abbas, The excavations of a Post-Hellenistic tomb at Dibba, UAE ..... 237Z. A. Kafafi, A Late Bronze Age jewelry mound from Tell Dayr ‘Alla, Jordan ......... 255E. Kaptijn, Settling the steppe. Iron Age irrigation around Tell Deir ‘Alla, Jordan Valley .... 265C. Kepinski, New data from Grai Resh and Tell Khoshi (South-Sinjar, Iraq) collected
in 2001 and 2002 ................................................................................................. 285A. Klein-Franke, The site in Jabal Qarn Wu’l near %iziaz in the region of San5an
(Yemen) .................................................................................................................. 297G. Kozbe, A new archaeological survey project in the South Eastern Anatolia: Report of
the Cizre and Silopi region ..................................................................................... 323P. Kurzawski, Assyrian outpost at Tell Sabi Abyad: Architecture, organisation of
space and social structure of the Late Bronze settlement ......................................... 341
12 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
R. Laurito, C. Lemorini, E. Cristiani, Seal impressions on cretulae at Arslantepe:Improving the methodological and interpretative references........................................ 351
A. R. Lisella, Clay figurines from Tell Ta’anek ........................................................... 361M. Lönnqvist, Kathleen M. Kenyon 1906-1978. A hundred years after her birth.
The formative years of a female archaeologist: From socio-politics to the stratigraphi-cal method and the radiocarbon revolution in archaeology......................................... 379
K. O. Lorentz, Crafting the Head: The human body as art? ...................................... 415C. Lorre, Jacques de Morgan et la question de l’origine de la métalurgie dans le Caucase .... 433S. Lundström, From six to seven Royal Tombs. The documentation of the Deutsche
Orient-Gesellschaft excavation at Assur (1903-1914) – Possibilities and limits ofits reexamination .................................................................................................... 445
N. Marchetti, A preliminary report on the 2005 and 2006 excavations at TilmenHöyük.................................................................................................................... 465
O. Marder, I. Milevski, R. Rabinovich, O. Ackermann, R. Shahack-Gross, P. Fine,The Lower Paleolithic site of Revadin Quarry, Israel ............................................. 481
R. Martín Galán, An example of the survival of ancient Mesopotamian architectonicaltraditions in Northern Jazireh during the Hellenistic period .................................... 491
A. C. Martins, Oriental antiquities and international conflicts. A Portuguese epi-sode during the 1st World War ............................................................................... 515
K. Matsumura, Hellenistic human and animal sacrifices in Central Anatolia: Examplesfrom Kaman-Kalehöyük .......................................................................................... 523
P. Matthiae, The Temple of the Rock of Early Bronze IV A-B at Ebla: Structure,chronology, continuity .............................................................................................. 547
M. G. Micale, The course of the images. Remarks on the architectural reconstructionsin the 19th and 20th centuries: The case of the Ziqqurrat ........................................ 571
L. Milano, Elena Rova, New discoveries of the Ca’Foscari University – Venice Teamat Tell Beydar (Syria) ............................................................................................. 587
I. Milevski, Y. Baumgarten, Between Lachish and Tel Erani: Horvat Ptora, a newLate Prehistoric site in the Southern Levant ........................................................... 609
O. Muñoz, S. Cleuziou, La tombe 1 de Ra’s al-Jinz RJ-1: une approche de lacomplexité des pratiques funéraires dans la peninsule d’Oman à l’Âge du Bronze ancien 627
L. Nigro, Tell es-Sultan/Jericho from village to town: A reassessment of the EarlyBronze Age I settlement and necropolis ................................................................... 645
L. Nigro, Prelimiray report of the first season of excavation of Rome «La Sapien-za» University at Khirbet al-Batrawy (Upper Wadi az-Zarqa, Jordan) .................. 663
A. T. Ökse, Preliminary results of the salvage excavations at Salat Tepe in the UpperTigris region............................................................................................................ 683
V. Orsi, Between continuity and tranformation: The late 3rd Millennium BC ceramicsequence from Tell Barri (Syria) ............................................................................. 699
A. Otto, Organization of Late Bronze Age cities in the Upper Syrian EuphratesValley..................................................................................................................... 715
M. Özbaharan, Musular: The special activity site in Central Anatolia, Turkey................. 733F. Pedde, The Assur-Project. An old excavation newly analysed .................................. 743
Index - Índice 13
C. Persiani, Chemical analysis and time/space distribution of EB2-3 pottery at Ars-lantepe (Malatya, Turkey) ...................................................................................... 753
L. P. Petit, Late Iron Age levels at Tell Damieh: New excavations results from the JordanValley..................................................................................................................... 777
L. Peyronel, Making images of humans and animals. The clay figurines from the RoyalPalace G at Tell Mardikh-Ebla, Syria (EB IVA, c. 2400-2300 BC) ................. 787
P. Piccione, Walking in the Malatya Plain (Turkey): The first Half of the III millenniumBC (EBA I and II). Some preliminary remarks on the results of the 2003-2005Archaeological Survey Project.................................................................................. 807
VOL. III
F. Pinnock, Artistic genres in Early Syrian Syria. Image and ideology of power in agreat pre-classical urban civilisation in its formative phases...................................... 17
A. Polcaro, EB I settlements and environment in the Wadi az-zarqa Dolmens and ideo-logy of death........................................................................................................... 31
M. Pucci, The Neoassyrian residences of Tell Shekh Hamad, Syria............................ 49P. Puppo, La Tabula «Chigi»: un riflesso delle conquiste romane in Oriente ................ 65S. Riehl, Agricultural decision-making in the Bronze Age Near East: The development of
archaeobotanical crop plant assemblages in relation to climate change ....................... 71A. Rochman-Halperin, Technical aspects of carving Iron Age decorative cosme-
tic palettes in the Southern Levant .......................................................................... 93M. Rossi, Tell Deinit-Syria MEDA Project n. 15 (2002-2004). Restoration training
programs ................................................................................................................. 103M. Sala, Khirbet Kerak Ware from Tell es-Sultan/ancient Jericho: A reassessment in
the light of the finds of the Italian-Palestinian Expedition (1997-2000) ............... 111S. G. Schmid, A. Amour, A. Barmasse, S. Duchesne, C. Huguenot, L. Wadeson,
New insights into Nabataean funerary practices...................................................... 135S. Silvonen, P. Kouki, M. Lavento, A. Mukkala, H. Ynnilä, Distribution of
Nabataean-Roman sites around Jabal Harûn: Analysis of factors causing sitepatterning ............................................................................................................... 161
G. Spreafico, The Southern Temple of Tell el-Husn/Beth-Shean: The sacred ar-chitecture of Iron Age Palestine reconsidered ........................................................... 181
M. T. Starzmann, Use of space in Shuruppak: Households on dispaly ....................... 203T. Steimer-Herbet, H. Criaud, Funerary monuments of agro-pastoral populations
on the Leja (Southern Syria) ................................................................................... 221G. Stiehler-Alegría, Kassitische Siegel aus stratifizierten Grabungen........................... 235I. M. Swinnen, The Early Bronze I pottery from al-Lahun in Central Jordan: Seal
impressions and potter’s marks ................................................................................ 245H. Tekin, The Late Neolithic pottery tradition of Southeastern Anatolia and its vicinity ....... 257H. Tekin, Hakemi Use: A newly established site dating to the Hassuna / Samarra pe-
riod in Southeastern Anatolia................................................................................. 271
14 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
D. Thomas, The ebb and flow of empires – Afghanistan and neighbouring lands in thetwelfth-thirteenth centuries ....................................................................................... 285
Y. Tonoike, Beyond style: Petrographic analysis of Dalma ceramics in two regionsof Iran ................................................................................................................... 301
B. Uysal, The technical features of the Ninevite 5 Ware in Southeastern Anatolia ...... 313C. Valdés Pererio, Qara Qûzâq and Tell Hamîs (Syrian Euphrates valley): Up-
dating and comparing Bronze Age ceramic and archaeological data ......................... 323S. Valentini, Ritual activities in the «rural shirines» at Tell Barri, in the Khabur
region, during the Ninevite 5 period ........................................................................ 345K. Vansteenhuyse, M. al-Maqdissi, P. Degryse, K. Van Lerberghe, Late Helladic
ceramics at Tell Tweini and in the kingdom of Ugarit ............................................ 359F. Venturi, The Sea People in the Levant: A North Syrian perspective ........................ 365V. Verardi, The different stages of the Acropolis from the Amorite period at Tell
Mohammed Diyab .................................................................................................. 383V. Vezzoli, Islamic Period settlement in Tell Leilan Region (Northern Jazíra): The
material evidence from the 1995 Survey .................................................................. 393O. Vicente i Campos, La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en el yacimiento arqueológico de Tell Halula ....................................... 405N. Vismara, Lo sviluppo delle metodologie della scienza numismatica e la scoperta di
una nuova area di produzione monetale: il caso dell’identificazione della emissioni dellaLycia in epoca arcaica ............................................................................................. 417
T. Watkins, Natural environment versus cultural environment: The implications of creatinga built environment ................................................................................................. 427
N. Yalman, An alternative interpretation on the relationship between the settlementlayout and social organization in Çatalhöyük Neolithic site: A ethnological researchin Central Anatolia................................................................................................ 439
E. Yanai, Ein Assawir, Tel Magal and the peripheral settlement in the Northern Sharonfrom the Neolithic period until the end of the Early Bronze Age III ...................... 449
E. Yanai, Cemetery of the Intermediate Bronze Age at Bet Dagan .............................. 459E. Yanai, The trade with Cypriot Grey Lustrous Wheel Made Ware between Cyprus,
North Syrian Lebanese coast and Israel.................................................................. 483
Workshops - Talleres de debate
Workshop I
Houses for the Living and a Place for the Dead
N. Balkan, M. Molist and D. Stordeur (eds.)
Introduction: House for the living and place for the dead. In memory of JacquesCauvin ................................................................................................................... 505
P. C. Edwards, The symbolic dimensions of material culture at Wadi Hammeh 27.......... 507
Index - Índice 15
F. R. Valla, F. Bocquentin, Les maisons, les vivants, les morts: le cas de Mallaha (Eynan),Israël ...................................................................................................................... 521
E. Guerrero, M. Molist, J. Anfruns, Houses for the living and for the dead? The caseof Tell Halula (Syria)............................................................................................ 547
D. Stordeur, R. Khawam, Une place pour les morts dans les maisons de Tell Aswad(Syrie). (Horizon PPNB ancien et PPNB moyen).................................................. 561
I. Kuijt, What mean these bones? Considering scale and Neolithic mortuary variability...... 591B. S. Düring, Sub-floor burials at Çatalhöyük: Exploring relations between the
dead, houses, and the living ..................................................................................... 603P. M. M. G. Akkermans, Burying the dead in Late Neolithic Syria .......................... 621T. Watkins, Ordering time and space: Creating a cultural world ................................... 647
Workshop III
The Origins of the Halaf and the Rise of Styles
O Niewenhuyse, P. Akkermans, W. Cruells and M. Molist(eds.)
Introduction: A workshop on the origins of the Halaf and the rise of styles .................. 663W. Cruells, The Proto-Halaf: Origins, definition, regional framework and chronology.............. 671O. Nieuwenhuyse, Feasting in the Steppe � Late Neolithic ceramic change and the rise
of the Halaf ........................................................................................................... 691R. Bernbeck, Taming time and timing the tamed......................................................... 709M. Le Mière, M. Picon, A contribution to the discussion on the origins of the Halaf
culture from chemical analyses of pottery................................................................. 729B. Robert, A. Lasalle, R. Chapoulie, New insights into the ceramic technology
of the Proto-Halaf («Transitional») period by using physico-chemical methods........ 735H. Tekin, Late Neolithic ceramic traditions in Southeastern Anatolia: New insights from
Hakemi Use........................................................................................................... 753M. Verhoeven, Neolithic ritual in transition ............................................................... 769
Programme - Programa
16 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
New insights into the ceramic technology of theProto-Halaf («Transitional») period by using
physico-chemical methodsBéatrice Robert, Lyon - A. Lassalle, Bordeaux - R. Chapoulie, Bordeaux
AbstractCeramic classification and pottery technology are crucial issues in the discussions concerningthe transition from Pre-Halaf to Early Halaf («Proto-Halaf»). Within the general framework ofa multi-disciplinary research project concerning the origins of the Halafian culture, we havebeen investigating the ceramic technology of sherds from Tell Shimshara (Iraq) and Tell SabiAbyad (Syria), in particular the paste. We focused on the clay fabric, the selection of plant ormineral temper, the firing atmosphere and the temperature. In this paper methods used inphysics have produced analytical data. Hassunan-Samarran and pre-Halafian sherds from twodifferent geographical and cultural regions have been observed by Cathodoluminescence. Twosets of information were obtained: 1) an alternative way for classifying these sherds; 2) a betterunderstanding of the firing circumstances. These insights complemented the traditionalarchaeological and typological approaches, and they offer some hypotheses to explain certaintechnological properties of the ceramics.
Keywords: pottery technology, Proto-Halaf period, Near East, Archaeometry.
IntroductionBien que connue et étudiée depuis de nombreuses années, la question de
l’origine de la culture de Halaf ne trouve toujours pas de réponse satisfaisanteà ce jour. Si la zone géographique regroupant du matériel Halaf ancien est assezbien identifiée,1 grâce aux récentes découvertes archéologiques (notammentcelle de Tell Sabi Abyad), il n’en reste pas moins que sa filiation culturelle avecles communautés villageoises la précédant ou contemporaines, n’est toujourspas éclaircie.
C’est dans cette optique que s’inscrit cette contribution au Workshop. Nousn’aborderons pas ici les questions typologiques ou stylistiques, mais les caractéris-tiques intrinsèques du matériau céramique lui-même, en mettant en avant l’utilisa-tion de méthodes d’analyse archéométriques.2
Problématiques archéologiquesSi de nombreuses études ont déjà été effectuées sur le sujet, toutes n’apportent
pas des résultats équivalents. En effet, si la plupart sont complémentaires, il n’enreste pas moins que l’on note une relative inégalité dans la mise en œuvre des dif-
1 Syrie du nord.2 Méthodes développées au Centre de Recherche en Physique Appliquée à l’Archéologie de l’Univer-
sité de Bordeaux 3 – UMR 5060.
férentes disciplines et le traitement de la documentation associée. Examinons rapi-dement quelques exemples et leur limite.
Tout d’abord la fouille qui, au travers du dégagement de la stratigraphie et desobjets, permet d’établir une première chronologie et de mettre en évidence dessuccessions culturelles. Malheureusement, cette première étape, incontournable, nepermet que de constater l’état du site et d’émettre des hypothèses sur son fonc-tionnement. Tous les sites ne faisant pas l’objet des mêmes investigations de ter-rain (fouilles de sauvetage, campagnes programmées ou sondages), la documenta-tion associée ne peut être traitée à un niveau égal.
Fondée sur l’étude des styles, des types de pâtes, des décors et des formes, lacéramologie reste l’approche qui permet de déterminer au mieux des groupes cul-turels, des phénomènes d’influences, des circulations d’objets et d’obtenir unedatation relative des niveaux. Cependant, appartenant au domaine de l’observationà échelle macroscopique, elle ne permet pas de répondre aux questions relativesaux procédés techniques et aux provenances d’objets ou de matériaux.
L’accès aux analyses physico-chimiques permet désormais d’obtenir de nou-velles informations concernant la fabrication, la provenance des productionscéramiques et de répondre à des questions propres au domaine microscopique.Certaines méthodes comme la fluorescence X3 et l’activation neutronique4 ont déjàété exploitées dans le cadre de notre sujet. Cependant, celles-ci ne permettent d’ac-céder qu’aux compositions élémentaires des pâtes et restent insuffisantes pourexpliquer les aspects techniques.
Ces dernières informations, relatives aux procédés de fabrication, peuventêtre obtenues par l’emploi de méthodes archéométriques complémentaires.Dans le cadre de cette rencontre autour du thème du «proto-Halaf», nous nousproposons de présenter les résultats de plusieurs études de caractérisation,menées au Centre de Recherche en Physique Appliquée à l’Archéologie de Bor-deaux (France).
MéthodologieSans rentrer dans les détails méthodologiques, les différentes études se sont
articulées autour d’observations macroscopiques et microscopiques (à loupebinoculaire et en Cathodoluminescence),5 d’analyses cristallographiques (en Dif-
736 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
3 Le Mière M. et Picon M., 1987, «Productions locales et circulations des céramiques au VIè millénaireau Proche-Orient», Paléorient 13/2, pp. 133-147. Le Mière M., 1989, «Clays Analysis of the PrehistoricPottery: First Results», dans: P.M.M.G. Akkermans (ed.), Excavations at Tell Sabi Abyad. Prehistoric investiga-tions in the Balikh Valley, northern Syria, Oxford, BAR International Series 468, pp. 233-235. Le Mière M.,2000, «L’occupation Proto-Hassuna du Haut Khabur occidental d’après la céramique», dans: B. Lyonnet(ed.), 2000, Prospection archéologique du Haut-Khabur occidental (Syrie du N.E), Damascus, IFAPO, pp. 127-149.
4 Davidson T.E., 1981, «Pottery Manufacture and Trade at the Prehistoric Site of Tell Aqab, Syria», Journal ofField Archaeology 8-1, pp. 65-77. Davidson T.E. et Mc Kerrell H., 1980, «The Neutron activation analysis of Halafand Ubaid Pottery from Tell Arpachiyah and Tepe Gawra», Iraq 42, pp. 155-167. Davidson T.E. et Mc KerrellH., 1976, «Pottery Analysis and Halaf Period Trade in the Khabur headwaters region», Iraq 38, pp. 45-66.
5 R. Chapoulie, F. Daniel, 2006, Cathodoluminescence in Archaeometry through case studies: classification of Chal-colithic ceramics from Syria, English glass stems (XVI-XVIIth c.AD), and glass/paste interface of glazed Islamic ceram-ics (X-XIIth c.AD). Proceedings of 35th International Symposium on Archaeometry, Zaragoza, 3-7 may
fraction des Rayons X,6 méthode des poudres), d’analyses élémentaires (en micro-scopie électronique à balayage par spectrométrie de rayons X (MEB-EDX)7 et d’é-tudes de pigments (en Microspectrométrie Raman).8
L’utilisation de l’ensemble de ces méthodes a permis d’obtenir une carte d’i-dentité propre à chaque tesson et par la suite d’établir une nouvelle classificationau sein de chaque groupe archéologique. Les critères retenus concernaient la tex-ture (type de pâte, porosité, nature, granulométrie et répartition du dégraissant,modes de cuisson), le décor (style, motifs, couleur des peintures, type d’application,pigments utilisés) et le traitement de surface.
Sites et matériel d’étudeDans le cadre du Workshop intitulé «The Origins of the Halaf and the Rise of
Styles», notre choix d’étude s’est porté sur deux sites: Tell Sabi Abyad9 (en Syrie) etTell Shimshara10 (en Iraq) (Fig. 1). Bien qu’éloignés géographiquement, ces deuxsites d’horizon pré-halafien présentent un intérêt important. En effet, la séquencechronologique continue mise au jour sur le premier site, permet d’envisager uneévaluation de l’évolution technique intra-muros et du poids des influences venantde l’extérieur. Dans le cas du second site, une étude comparative du matériel Has-suna et Samarra présent sur le même lieu, permet de réfléchir sur les procédéstechniques propres à chaque culture.
Concernant le matériel mis à notre disposition, les tessons provenant deTell Sabi Abyad, correspondent à trois groupes issus des niveaux de transitionpré-Halaf (niveaux 6-4) et «Early Halaf» (niveaux 3-1).11 Ils ont été déterminésen fonction de critères macroscopiques et techniques par Olivier Nieuwenhuyse(céramologue rattaché à Mission de Tell Sabi Abyad-Université de Leiden). Lepremier groupe ou «Orange Fine Ware» (OFW) (Fig. 2) est caractérisé par une
New insights into the ceramic technology of the Proto-Halaf («Transitional») period... 737
2004. Livre électronique, pp. 433-438, http://www.dpe.es/ifc/libros/ebook2621.pdf. R. Chapoulie et F. Daniel, accep-té, à paraître «Cathodoluminescence: recherches sur une méthode d’analyse en archéométrie». Oxford, BARInternational Series. Bechtel F. et Schvoerer M., 1984, «La Cathodoluminescence. Application à l’étude dela texture des pâtes céramiques», dans: Hackens T. et Schvoerer M. (ed.), 1984, Datation-Caractérisation descéramiques anciennes, PACT 10, Presses du CNRS, Paris, pp. 247-260.
6 Mannoni T., 1984, «Analyses Cristallographiques», dans: Hackens T. et Schvoerer M. (ed.), 1984, Data-tion-Caractérisation des céramiques anciennes, PACT 10, Presses du CNRS, Paris, pp. 237-246.
7 Le Blanc M., 1984, «Microscope Electronique à Balayage», dans: Hackens T. et Schvoerer M. (éd.),1984, Datation-Caractérisation des céramiques anciennes, PACT 10, Presses du CNRS, Paris, pp. 261-270.
8 Guineau B., 1987, «L’étude des pigments par les moyens de la Microspectrométrie Raman», dans:Delamare F., Hackens T. et Helly B. (ed.), 1987, Datation-Caractérisation des peintures pariétales et murales, PACT17, Centre Universitaire Européen pour les biens culturels, Ravello, pp. 259-294.
9 Akkermans P.M.M.G., 1989 (ed.), Excavations at Tell Sabi Abyad. prehistoric Investigations in the Balikh Val-ley, northern Syria, Oxford, BAR International Series 468. Akkermans P.M.M.G., 1993, Villages in the Steppe.Later Neolithic Settlements and Subsistance in the Balikh Valley. Ann Arbor, Michigan. Nieuwenhuyse O.P., 2007,Plain and Painted Pottery. The Rise of Late Neolithic ceramic styles on the Syrian and northern Mesopotamian Plains.Turnhout, Brepols (PALMA III).
10 Mortensen P., 1970, Tell Shimshara: The Hassuna Period. Munksgaard, Copenhague.11 Akkermans P.M.M.G. (ed.), 1996, Tell Sabi Abyad: The Late Neolithic Settlement. Istanbul, Nederlands
Historisch-Archaeologisch Instituut.
pâte de couleur rose orange, un dégraissant presque exclusivement minéral etun décor peint géométrique ou uniquement engobé, de couleur rose ou orange.Le second groupe identifié comme «Standard Fine Ware» (SFW) (Fig. 3) se dis-tingue par une pâte beige à orange, compacte, comportant un dégraissantminéral et présentant un décor peint géométrique dont les couleurs variententre le orange, le violet et le noir. Le troisième groupe ou «Early Halaf» (EH)(Fig.4), est quant à lui caractérisé par une pâte orange chamois, à dégraissantminéral et un décor peint géométrique à motifs assez resserrés, de couleur som-bre, brun-noir.
Le matériel provenant de Tell Shimshara,12 a lui aussi été classé selon selontrois groupes. De même que pour Sabi Abyad, la classification a été effectuéepar les archéologues selon des critères macroscopiques, mais aussi en fonctiond’attributions culturelles. Le premier groupe correspond au «Hassuna StandardPainted Ware» (HSPW) (Fig. 5) et se caractérise par une pâte de couleur beige àgrisâtre. Le dégraissant peut être soit minéral ou végétal et généralement ledécor, peint, présente des motifs géométriques de couleur noire. Le «SamarraStandard Painted Ware» (SSPW) (Fig. 6) forme le second groupe et se distinguepar une pâte beige plutôt compacte et un dégraissant minéral. Le décor estgénéralement géométrique, peint en noir et peut être trouvé associé à des motifsincisés. Enfin, le troisième groupe, nommé «Samarra Fine Ware Painted» (SFWP)(Fig.7) est caractérisé par une pâte beige compacte comportant un dégraissantminéral. Le décor est peint en noir et représente des motifs géométriques par-fois disposés en registre.
Le matériel provenant de Tell Sabi AbyadLes résultats qui suivent sont issus de l’étude comparée des méthodes d’analy-
ses citées précédemment. Toutes les données physico-chimiques ont été croiséesentre elles, puis réexaminées en tenant compte des considérations archéologiques13
(contexte de découverte) et de la classification typologique élaborée par M. LeMière et O. Nieuwenhuyse.14
L’étude des pâtesConcernant le groupe «Orange Fine Ware», nos résultats d’analyses ont permis
de souligner la présence de trois catégories. La première est illustrée par unecéramique à pâte beige, compacte, comportant un dégraissant minéral de dimen-
738 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
12 Mortensen P., 1970, Tell Shimshara: The Hassuna Period. Munksgaard, Copenhague.13 Les travaux effectués au CRPAA ont été effectués en collaboration avec Audrey Lassalle (Lassalle A.,
2005, Caractérisation de céramiques peintes pré-halafiennes, Tell Sabi Abyad, Syrie, Mémoire de DESS n°656, Uni-versité Michel de Montaigne-Bordeaux 3) et Marie Le Men (Le Men M., 2006, Caractérisation du matérielcéramique Halaf ancien, Tell Sabi Abyad, Syrie), Mémoire de Master 2 n°709, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3).
14 Le Mière M. et Nieuwenhuyse O., 1996, «The Prehistoric Pottery», dans: Akkermans P.M.M.G. (ed.),1996, Tell Sabi Abyad: The Late Neolithic Settlement, Leiden, Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut,pp. 119-284.
sion moyenne égale à 500 µm, composé de grains colorés blancs et rouges (Fig.8a). La cathodoluminescence correspondante montre une pâte à luminescencerouge caractéristique des pâtes calcaires et des grains de couleur mauve et rougecorrespondant à des quartz et des calcites.
La seconde est caractérisée par des tessons à pâte beige compacte, à dégrais-sant minéral fin (inférieur à 100 µm) dont la luminescence correspondanteprésente une pâte calcaire (rouge) et des inclusions de quartz (mauves), de calcites(rouges) et de feldspaths plagioclases (verts) (Fig. 8b).
La troisième correspond à une céramique à pâte orange avec des porositéssituées le long d’inclusions minérales oranges de 1 à 3 mm, correspondant à destraces de dessication. La luminescence correspondante diffère des deux autres parune pâte violacée non calcaire et des inclusions sombres de la couleur de la pâte etidentifiées à de la chamotte (Fig. 8c).
Concernant le groupe «Standard Fine Ware», trois cas de figures ont aussi étédéterminés. Le premier cas est représenté par une céramique à pâte orange, com-pacte, comportant de nombreuses inclusions minérales colorées de dimensionmoyenne de 400 µm. La luminescence correspondante présente une pâte plutôtcalcaire (rouge) et des inclusions de quartz (mauves), des calcites (rouges) et desfeldspaths plagioclases (verts) (Fig. 9a).
Le second cas se rapproche du précédent (Fig. 9b). La nature de la pâte et desinclusions est similaire, en revanche la granulométrie et la répartition du dégrais-sant changent. En effet, on remarque encore la présence d’inclusions de 400 µm,mais aussi d’agglomérats de petites inclusions qui correspondent en fait à desgrains broyés, mal répartis dans la pâte. Ces agrégats pourraient témoigner d’unmauvais malaxage de la pâte.
Dans le troisième cas (Fig. 9c), la nature de la pâte et des inclusions estidentique aux deux premiers cas. La différence est seulement due à la présencede micro-inclusions de quartz, de calcites et de feldspaths plagioclases surl’ensemble de la céramique. Ces dernières résultent de l’ajout volontaire degrains préalablement broyés et dispersés de manière homogène dans la matriceargileuse.
Enfin, concernant le «Early Halaf», les premiers résultats de l’étude en coursmontrent de manière générale qu’il s’agit d’une pâte calcaire comportant de nom-breuses micro-inclusions de calcites, de quartz et de feldspaths plagioclases (Fig. 10).
L’étude des décors peintsL’étude comparée des trois groupes et plus particulièrement des décors peints
de différentes couleurs, n’a montré aucune différence entre le «Standard Fine Ware»,le «Orange Fine Ware» et le «Early Halaf». Que ce soit pour les décors peints noirsou rouges, ou les engobes polis, tous sont dus à la présence d’oxydes de fer sousdifférentes formes: hématite, goethite, martite et magnétite.
Pour chaque échantillon, plusieurs points d’analyses ont été effectués. Lesrésultats obtenus montrent que les oxydes de fer varient au sein du même tesson,ce qui peut s’expliquer par une mauvaise maîtrise de la technique de cuisson (tem-pérature et atmosphère). Par exemple, pour un même décor rouge on peut obtenir
New insights into the ceramic technology of the Proto-Halaf («Transitional») period... 739
de la goethite mais aussi de l’hématite. Ce phénomène est ordinaire et signale sim-plement que la température de cuisson n’est pas homogène sur l’ensemble de lacéramique.
Concernant les oxydes de fer, il ne s’agit pas de pigments particuliers rajoutés,mais sûrement d’éléments naturels présents dans l’argile. Dans le cas de nosdécors, soit ils résultent de l’ajout d’argile de même composition que celle de lapâte, soit il peut s’agir d’une argile plus colorée trouvée à proximité. L’utilisationd’oxydes de fer n’apparaît pas comme un fait nouveau, puisqu’elle est attestée pourpresque toutes les céramiques peintes de cette période15
Le matériel provenant de Tell Shimshara16
Concernant le matériel de Tell Shimshara, les trois groupes HSPW, SSPW etSFWP, déterminés selon la classification de Mortensen ont été examinés. Ensuivant le même protocole d’étude que pour Sabi Abyad, plusieurs textures ont puêtre distinguées.
L’étude des pâtesLe groupe «Hassuna Standard Painted Ware» (Fig. 11) s’est distingué par deux
types de pâte: une pâte calcaire beige à forte luminescence rouge diffuse, au cen-tre du tesson comportant des inclusions ajoutées de quartz, de calcites et defeldspaths plagioclases de dimensions comprises entre 500 µm et 2 mm (Fig. 11a).Une pâte calcaire orange grisâtre (avec phase réductrice), aérée à cause de laprésence de dégraissant végétal abondant (fait de paille hachée) et comportant desinclusions de quartz, de calcites et de feldspaths plagioclases d’environ 250 µm,naturellement présentes (Fig. 11b).
Les tessons du groupe «Samarra Standard Painted Ware» (Fig. 12) présententles mêmes caractéristiques que celles des tessons du premier groupe. La seuledifférence concerne la zone de luminescence rouge qui est moins marquée parendroits (notamment en bordure de la paroi externe). Les inclusions sont aussides quartz, des calcites et des feldspaths plagioclases de dimensions avoisinant500 µm.
Enfin, le groupe «Samarra Fine Painted Ware» (Fig. 13) est caractérisé parune pâte compacte de couleur plutôt chamois avec des inclusions minérales dedimensions moyennes comprises entre 250 et 500 µm (Fig. 13a), correspon-dant à des quartz, calcites et feldspaths plagioclases. Deux types de lumines-cences ont été identifiées pour ce groupe, la première est comparable à celle
740 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
15 Courtois L. et Velde B., 1984, «Recherches comparées sur les matériaux et les techniques de pein-tures céramiques de Mésopotamie VI-Vè millénaire BC», Paléorient 10/2, p. 90. Van As A. et Jacobs L.,1989, «Technological Aspects of the Prehistoric Pottery», dans: Akkermans P.M.M.G. (ed.), Excavations atTell Sabi Abyad. Prehistoric investigations in the Balikh Valley, northern Syria, Oxford, BAR International Series468, pp. 221-225.
16 L’étude en laboratoire a été effectuée en collaboration avec Audrey Lassalle (Lassalle A., 2004, Etudede caractérisation des céramiques provenant de Tell Shimshara, Irak, 7è millénaire av. J.-C., Mémoire de Maîtrise n°627,Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3).
de la «Samarra Standard Painted Ware» avec une luminescence rouge de faibleintensité, due à des carbonates de calcium. La seconde se distingue par uneluminescence plus vive due à une concentration de micro-inclusions de calcites(Fig. 13b).
L’étude des décors peintsDe même que pour la céramique provenant de Tell Sabi Abyad, les analyses
physico-chimiques portant sur les décors peints des tessons de Shimshara ont per-mis de mettre en évidence une contribution de l’élément fer, sous plusieurs formes.Qu’il s’agisse de peintures sombres ou claires, on peut obtenir de la magnétite, maisaussi de l’hématite, de la goethite ou des ocres.
Dans tous les cas, la décoration peinte est fabriquée à partir d’une baseargileuse consistant en un simple ajout d’argile de même composition que la pâte,ou un ajout d’ocres plus colorés. Nous pensons donc qu’il ne s’agit pas d’uncolorant particulier volontairement ajouté, mais bien d’un composé présentnaturellement. Comme pour le cas de Sabi Abyad, nous pensons que les variationsde couleurs sont étroitement liées aux températures et atmosphères de cuisson etplus particulièrement au type de four.
Bilan de l’étude des texturesEn nous appuyant sur les résultats présentés précédemment, que dire des pro-
ductions pré-Halafiennes? Au travers des deux exemples choisis (Sabi Abyad etTell Shimshara), existe-t-il de réelles différences techniques entre lesgroupes localisés en Syrie du nord et ceux situés en Iraq du nord?
Tell Sabi Abyad: bilan de l’étude des texturesLa classification obtenue par les méthodes physico-chimiques apparaît légère-
ment différente de celle proposée par les archéologues.Tout d’abord le groupe«Orange Fine Ware», ne forme pas du tout un groupe homogène (Fig. 14). En effet,on a pu reconnaître deux catégories distinguées par la composition de pâtes sug-gérant un lieu de fabrication différent, mais aussi élaborée selon des procédés tech-niques différents ou des matières premières différentes. D’un côté, nous avons misen évidence une production à pâte non carbonatée comportant de la chamotte eninclusions, alors que de l’autre, nous avons une céramique à pâte calcaire comportantun dégraissant minéral composé de quartz, calcites et feldspaths plagioclases de 500µm en moyenne, ou composé de micro-inclusions (dégraissant naturel ou rajouté).
Le groupe «Standard Fine Ware» quant à lui, peut être considéré commehomogène car la composition de pâte des tessons tout comme la nature des inclu-sions est semblable (Fig. 15). Les différences proviennent de variations dans lagranulométrie et la répartition des inclusions. En fait, au travers de ces trois exem-ples, il semble que ce groupe reflète le développement de procédés techniques ettémoigne d’un passage évolutif d’une production assez grossière à quelque chosede plus affiné.
New insights into the ceramic technology of the Proto-Halaf («Transitional») period... 741
Enfin, en l’état actuel de notre recherche le groupe «Early Halaf» paraît pourl’instant assez homogène (Fig. 16). Il présente une pâte carbonatée comportant denombreuses petites inclusions de quartz, de calcites et de feldspaths plagioclasesqui le rapproche du groupe précédent.
Ces premiers résultats confirment que les groupes «Standard Fine Ware» et «EarlyHalaf» présentent les mêmes caractéristiques techniques (compositions de pâtes,nature des inclusions, cuisson). Si, d’un point de vue stratigraphique, le «StandardFine Ware» apparaît comme un groupe local de transition vers le Halaf ancien, ilsemble aussi être le reflet d’une période d’expérimentation technique à l’origine du«Early Halaf». Entre les deux groupes, on peut observer une filiation directe, quitendrait à démontrer que l’origine du Halaf provient au moins de ce groupe et decette région. Pour le groupe « Orange Fine Ware», même si quelques tessons semblentse rapprocher de cette filiation, ils restent trop isolés pour en tenir compte. En effet,les autres tessons appartenant à ce groupe n’ont pas du tout les mêmes caractéris-tiques et pourraient provenir de zones géographiques différentes. En effet, d’aprèsla pâte plusieurs techniques de fabrication, mais aussi sources d’approvisionnementen argile peuvent être suspectées. La présence d’«Orange Fine Ware» sur le site de tellSabi Abyad ne fait, en fait, que témoigner de contacts entretenus entre groupeshumains présentant des acquis technologiques différenciés.
Tell Shimshara: bilan de l’étude des texturesComme pour Sabi Abyad, la typologie établie par les archéologues ne semble
pas correspondre à celle résultant des analyses. En effet, le groupe «Hassuna Stan-dard Painted Ware» (Fig. 11) apparaît assez hétérogène à cause de l’utilisation dedifférents dégraissants: minéral et végétal et de granulométries d’inclusions distinctes.
Le groupe «Samarra Standard Painted Ware» (Fig. 12) est quant à lui homogèneavec des variations uniquement perçues dans la luminescence des calcaires de lapâte. Le groupe «Samarra Fine Painted Ware» (Fig. 13) est aussi hétérogène etprésente deux types de luminescence rouge; une liée à la composition de pâte,l’autre aux inclusions minérales.
Concernant ces groupes deux points sont à souligner. En premier lieu, lephénomène de décarbonatation, mis en évidence grâce à la Cathodoluminescence.Ce phénomène résulterait de plusieurs paramètres liés à l’utilisation du four:
– soit l’atmosphère de cuisson: dans ce cas le phénomène est visible tant enlumière blanche réfléchie qu’en cathodoluminescence
– soit la température de cuisson, dans ce cas là le phénomène n’est visiblequ’en cathodoluminescence
– soit une association des deux.
En second lieu, on remarque nettement, tant en lumière blanche réfléchiequ’en Cathodoluminescence, que certains tessons ont été classés dans desgroupes culturels différents, mais que cela ne reflète pas leur réalité physico-chimique. Ainsi, tous les tessons présentant une décarbonatation liée à la tem-pérature, qu’ils soient «Hassuna Standard», «Samarra Standard » ou «Samarra Fine»
742 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
présentent exactement le même profil technique (Fig. 17). En effet, les compo-sitions de pâte, la nature des inclusions, leurs dimensions, ainsi que les conditionsde cuisson sont identiques. Par conséquent, ils pourraient être réunis en un seulet même groupe.
Aucune filiation technique entre groupes issus de la classificationarchéologique n’a pu être constatée; la grande majorité des céramiques présentantles mêmes spécificités. En fait, soit le site présente un seul et même groupe humainet culturel qui emploie la même technique de fabrication, avec un registre déco-ratif varié correspondant à un usage différencié. Soit, plusieurs groupeshumains fabriquent une céramique dont le style est propre à chaque communauté,mais tous appartiennent au même ensemble culturel.
Les quelques textures dont l’aspect apparaît différent (notamment avec laprésence de dégraissant végétal) sont certainement liées à la fonction17 de l’objet etnon à l’appartenance culturelle d’un groupe.
Bilan de l’étude des décors peintsLes conclusions de notre recherche montrent qu’aucune distinction technique
n’est observable entre les deux régions, ni entre les groupes culturels à la périodepré-Halaf. En effet, tous utilisent des oxydes de fer, naturellement présents dansune base argileuse rajoutée, soit de la même nature que la pâte, soit plus colorée.Que ce soit pour les décors rouges, bruns, noirs, plusieurs types d’oxydes con-tribuent à donner une couleur: il peut s’agir d’hématite, de magnétite, de martiteou de goethite. Parfois même, pour une même couleur, plusieurs oxydes ont étémis en évidence.
Trois raisons peuvent expliquer ce phénomène.Tout d’abord l’atmosphère de cuisson. Par exemple, une atmosphère réduc-
trice implique plutôt un décor noir sous forme de magnétite, alors qu’une atmosphèreoxydante un décor rouge sous forme d’hématite.
Les températures de cuisson créent aussi des transformations. Par exemple, lechauffage d’ocre jaune connu sous le nom de goethite, permet d’obtenir de l’hé-matite désordonnée à partir de 260°C, de l’hématite normale à 700°C et au-délà de1050° C la magnétite.18
Enfin les grains d’argile rajoutés pour le décor, selon leur dimension lors dubroyage ne réagissent pas de la même manière avec le chauffage et ne change pasde couleur en même temps.
En fait, toutes les teintes de couleur dépendent du type de four et on peutpenser que la plupart doit être obtenue de manière accidentelle.
New insights into the ceramic technology of the Proto-Halaf («Transitional») period... 743
17 Sestier C., 2005, «Utilisation du dégraissant végétal en contexte néolithique: hypothèses tech-nologiques et expérimentation», dans: Livingstone Smith A., Bosquet D., Martineau R. (ed.), Pottery Manu-facturing Processes: Reconstitution and Interpretation, Oxford, BAR International Series 1349, pp. 81-94.
18 Delamare F., 1987, «Les pigments à base d’oxydes de fer et leur utilisation en peinture pariétale etmurale», dans: Delamare F., Hackens T. et Helly B. (ed.), 1987, Datation-caractérisation des peintures pariétales etmurales, PACT 17, Centre Universitaire Européen pour les biens culturels, Ravello, pp. 334-344.
D’après ces résultats, il semble que les groupes humains habitant les deuxrégions, ne maîtrisaient pas la technique de cuisson et soient dans une phase d’ex-périmentation. Leurs fours étant peut-être de facture sommaire et assez peu aérés,la majorité des décors apparaissaient sombres ou noirs, et les exemples rougesdoivent être plutôt accidentels. Une exception est à noter avec l’ «Orange Fine Ware».En effet, le décor systématiquement rouge de ce groupe pourrait indiquer que celui-ci possédait des structures de combustion plus évoluées ou plus aérées. Ceci permetde souligner que le groupe qui produisait cette céramique ne maîtrisait pas encoreles mêmes procédés techniques et au-delà serait d’une filiation culturelle différente.
Concernant les autres productions, si d’après le seul décor peint, des dis-tinctions culturelles sont visibles, cela n’est en aucun cas lié à une technique spéci-fique, mais relève plutôt du répertoire décoratif. D’après des travaux récents19, ilfaut attendre les périodes Halaf récent avec l’apparition de la polychromie etl’Obeid avec l’utilisation de manganèse,20 pour mettre en évidence l’utilisation et lechoix volontaire de pigments ou de matières colorantes distinctes. Il semble que lacaractérisation d’une culture à partir des compositions de peinture puisse êtreenvisageable à partir de cette période. Malgré tout, que l’idée s’avère séduisante ouse révèle réalisable, il nous paraît nécessaire de continuer à étudier le matériau dansson ensemble, c’est-à-dire sans dissocier la matrice, du décor ou de la forme.
ConclusionEntre ces deux sites, aucune similitude n’apparaît dans la technique de fabrica-
tion pré-Halaf. Chaque groupe de chaque site expérimente des procédés différents.Seulement dans le cas de Sabi Abyad, la stratigraphie continue permet de montrerque le «Early Halaf» dériverait d’une technique propre à un groupe pré-halafienlocal. A cause de cette filiation on peut donc se poser la question de savoir si réelle-ment les productions céramiques halafiennes et la culture elle-même n’est pas issuede groupes locaux de Syrie du nord et si sa diffusion vers l’est et le sud ne s’est pasfaite par acculturation progressive?
Pour répondre à cette question, des études complémentaires sont à menerselon la même méthodologie avec une caractérisation systématique des produc-tions céramiques contemporaines de Sabi Abyad, localisées dans la même région.
RemerciementsNous tenons à remercier les membres organisateurs du Workshop sur le
thème de «The Origins of the Halaf and the Rise of Styles», pour nous avoir donné
744 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
19 Robert B., Blanc C., Chapoulie R. et Masetti-Rouault M-G., sous presse, Characterizing the Halaf-Ubaid-Transitional period by studying ceramics from Tell Masaïkh, Syria. Archaeological data and archaeometric investigations,Actes du colloque de Berlin (29/03/2004-3/04/2004)- 4ICAANE, à paraître.
20 Kamilli D.C. et Lamberg-Karlovsky C.C., 1979, «Petrographic and electron Microprobe analysis ofcermacis from Tepe Yahya, Iran», Archaeometry 21-1, pp. 47-59. Courtois L. et Velde B., 1987, «Observa-tions techniques sur quelques poteries de Tell el Oueili (Phases Obeid 0 à Obeid 3)», pp. 153-162,dans: Huot J.L. (ed.), Préhistoire de la Mésopotamie. La Mésopotamie préhistorique et l’exploitation récente du DjebelHamrin, Colloque International du CNRS, Paris.
l’opportunité de présenter nos travaux de recherche et plus particulièrementOlivier Nieuwenhuyse et Peter Akkermans (Université de Leiden-Hollande)pour nous avoir confié le matériel d’étude, et aussi pour leur soutien. Tous nosremerciements à Audrey Lassalle et Marie Le Men pour leur collaboration dansl’étude archéométrique et à Yann Leclerc (Centre Ausonius, Université Michel deMontaigne, Bordeaux 3) pour ses judicieux conseils apportés tout au long de cetravail.
New insights into the ceramic technology of the Proto-Halaf («Transitional») period... 745
746 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
PLAN
CHE
IFi
g.1:
Carte
géo
grap
hiqu
e pr
ésen
tant
les s
ites P
roto
-Hal
afde
Tel
l Sab
i Aby
ad (S
yrie
) et d
e Te
ll Sh
imsh
ara
(Ira
q).
PLANCHE II
New insights into the ceramic technology of the Proto-Halaf («Transitional») period... 747
Fig. 2: Tessons attribués au groupe Orange Fine Ware selon laclassification typologique.
Fig. 3: Tessons attribués au groupe Standard Fine Ware selon laclassification typologique.
Fig. 4: Tessons attribués au groupe Early Halaf selon laclassification typologique.
PLANCHE III
748 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
Fig. 5: Tessons de type Hassuna Standard Painted Ware(dimensions: 6.2 x 3.8 cm et 8.8 x 5.7 cm).
Fig. 6: Tessons de type Samarra Standard Painted Ware(dimensions: 6.4 x 4.5 cm et 8 x 6 cm).
Fig. 7: Tessons de type Samarra Fine Painted Ware(dimensions: 8.4 x 3.7 cm et 7.4 x 6.4 cm).
PLANCHE IV
New insights into the ceramic technology of the Proto-Halaf («Transitional») period... 749
Fig. 8 (a, b et c): Tessons du groupe Orange Fine Ware provenantde Tell Sabi Abyad. Clichés en Lumière naturelle et Cathodoluminescence
(Dimensions: 2,9 x 2,3 mm).
Fig. 9 (a, b et c): Tessons du groupe Standard Fine Ware provenantde Tell Sabi Abyad. Clichés en Lumière naturelle et Cathodoluminescence
(Dimensions: 2,9 x 2,3 mm).
PLANCHE V
750 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
a
b
Fig. 10: Tessons du groupe Early Halaf provenant de Tell Sabi Abyad.Clichés en Lumière naturelle et Cathodoluminescence.
Fig. 11: Tessons du groupe Hassuna Standard Painted Ware provenantde Tell Shimshara. Clichés en lumière naturelle et Cathodoluminescence
(10 x 7 mm).
PLANCHE VI
New insights into the ceramic technology of the Proto-Halaf («Transitional») period... 751
a
b
Fig. 12: Tessons du groupe Samarra Standard Painted Ware provenantde Tell Shimshara. Clichés en lumière naturelle et Cathodoluminescence
(19.2 x 14.2 mm).
Fig. 13. Tessons du groupe Hassuna Standard Painted Ware provenantde Tell Shimshara. Clichés en lumière naturelle et Cathodoluminescence
(10 x 7 mm).
Fig. 14: Deux types de pâtes (en CL) attribuées au groupe Orange Fine Ware:une pâte non calcaire et une pâte calcaire. La dernière pouvant être de même
nature que celle du groupe Standard Fine Ware.
752 Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East
Fig. 15: Le groupe Standard Fine Ware: les compositions de pâtes et lesinclusions sont les mêmes (en CL), les variations concernent uniquement
la granulométrie et la répartition des inclusions.
Fig. 16: Le groupe Early Halaf présente une composition de pâte et desInclusions (en CL) de même nature que la Fig. 15.
Fig. 17: Tessons attribués au Hassuna Standard Painted Ware, Samarra Standardpainted Ware, et Samarra Fine Painted Ware (images en CL). Tous ces tessonsprésentent en fait le même groupe physico-chimique, la même nature de pâteet les mêmes inclusions. Les différences observables concernent uniquement
les températures de cuisson.