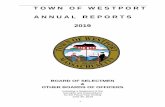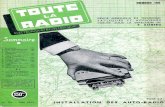F':-t' - retronik
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of F':-t' - retronik
Uù corvertissour triple bande I ulrc solutioû économique pouJ couvrir lestrois bandes TVSAT (ECS. TDF er TELECOM).
Centrale domotique 12 C : trois ûouveaux modules qui coûstituent uneétape supplémentaire vers un système opérationnel.
23 Interface logiciel I2C : nous savons, depuis le mois demier, écrte dans uncomposant I2C à paJtir du 8052Aï BASIC, iI est teeps mahteûantd'apprenùe à y lùe un octet.
27 Ure âlarme sans fil : ou corunent coupler ur détecteu! à inftarouge à unsystème tadio.
I Rack A/D : un système d'acquisition complet.
Un émùlateur d'f,PROM : au stade de Ia mise au point, il est plus facile detravailler sur une RAM sauvegardée pal pile que sul une EPROM.
Canal France Intelnational en barde C : une nouvelle chaine de TV pâ!satellite à destination des populations I'tancophones d'AfricJue.
IntgrphoÀ€ sectêut: Le LM 1893 est un très intérêssaît composant,développé par NS pour faùe ùansiter, via les lils du secteur, une fouled'infomations. Aulourd'hui, Ilous véhicdons la paJole.
A Las Vsgar : Ie NA! a tenu sa 67iûè conventioD. En vitrine, les techniqueset techrologies audio, râdio, TV et vidéo de demain.
Radio Plans 5oO 5
Oonvertiseurtriple bande pourTVSAT
on destinées- - r i -an+aman* a I n r r l - r l i r - : r - le rz r ,a ien t se s i t r te r C lanS la\ - l l l \JUL\=l I l \= l lL CrLl l . - - /LI L- . . r l l \ - \ , lçV I ot lg l lL \ )v !> l \L]ç l \J c- , t l l !> |
bande 11750 125OO n 4râ2. Dans la prat ique, avec desmoyens voisins de ceux nécessaires à la réceptiondirecte, i l est faci le de couvrir plusieurg bandes def r â r ' l t an r -êa a r r r l aq r r r ra l l aq l aq n r - - ^ ^^+
l \ ro9(J\Jrr \J. - .> r \ - / \> l . - ' - rUI Lt=Llùt=ù ùL-, r l lL
modulées par des signaux TV : vidéo - l- audio.
- La bande dite TELECOM occupée iail de programmes. Pour disposerpar les deux satellites TELECOM 1 A de ce vaste choix Ia station doit nota-êt TELECOM lc. blement se sophistiquer, surtout si
Nous éliminons volontairement Ia f'on désire que toutes Ies opérationsbande des 4 GHz - 370Q à 4200 - qui $oient automatisées.ne présente véritablement aucun En général la motodsation de I'an-intérêt avec des diamètres d'an- tenne n'est pas un problème, verinstenne raisonnables. L'intérêt majeu çlectrigues et posiiionneurs étantd'une station de réception est de d'un coût acceptable. Le véritablepouvoir choisir pami un vaste éven- froblème est plutôt Ie réglage de Ia
N rencontre trois bandes de
- La bande dite des satellitesde télécommunication, ou
bande dite ECS compdse entre10950 et 11750 MHz.- La bande destinée à Ia diffusiondirecte, bande dite TDF puisgueTDF1 est pour I'instant Ie seul satel-Iite occupant Ie terain.
o-..r i^ or-^-. qnn 7
monture éguatoriale qui peut s'avé-rer particulièrement pénible. Mais çac'est une autre histoire.
Le problème qui nous semble,mécaniguement êt financièremênt leplus important est celui de la multi-plicité des convertisseurs faiblebruit : LNC. Si I'on souhaite recevoirles émissions diffusées dans les trolsbandes citées précédement, I'an-tenne sera équipée au maximum deûois convertisseurs distincts asso-ciés à un système de sélection depolarisation.
Admettons que l'on dispose dedeux LNC, Ie premier adapté à Iabande 10950-11750 MHz et Iesecond couwant à la fois Ia bandeTDF 1 et TELECOM. La configura-tion de la station de réception seracelle de Ia figure 1. L'emploi de deuxLNC distincts débouche nécessaire-ment sur la présence d'un commuta-teur d'un type un peu spécial, som-mutation de signaux de 1 à 2GHz.On pourra par exemple utiliser unmodule DRAKE. Pour éviter I'adjonc-tion d'un second câble coaxial, dansIe cas où le commutateur est situéau voisinage immédiat du récepteur,le commutateur estplacé à proximitédes LNC, en général derrière l'anten-ne, fixé directement sur la monturede I'antenne. Ceci est probablementla meilleure solution mais cedaine-ment pas Ia solution idéale. te sous-ensemble commutateur devra êtreparfaitement étanche, ce qui n'estpas le cas du module DRAKE, d'autrepart un câble supplémentate liantle commutateur et le récepteur estimpératif. Pour véhiculer le signal decommutation des LNC une simplepaire téléphonique suffit mais cecâble est à prévoir et à instâ.ller.
te tNC 10950-11750 esr placé aufoyer de l'antenne paraboligue êt esten général associé à un système debipolarisation : Chaparal ou autre.Juste une parenthèse pour signalerqu'aujourd'hui la mode est plutôt auferrotor qui présente au moins deuxavantages : faible consommation etpas de pièces mécaniques en mouve-ment.
te tNC TDF ou TELECOM ou unLNC couvrant les deux bandes estplacé à côté du premier, légèrementdéporté. Si I'on dispose d'un LNCsoit TDF soit TETECOM Ia sélectionde I'onde n'est pas un problème.Pour un tNC double bande TDtr -rTELECOM on doit adopter un com-promis : TDF étant reçu en polarisa-tion circulaire et TELECOM en pola-risation rectiligne. Ce compromisconsiste à adopter une polarisationrectiligne adaptée à la réception deTELECOM. te tableau de la figure 2montre que dans ce cas la perte dûeà Ia désadaptation sera de 3 dB pourles émissions de TDF 1. Il est tout àfait certain que pour toute Ia Francemétropolitaine cette perte est accep-table. Les photos de notre installa-tion montrent le support principalrecevant le polarotor Chaparral et
un convertisseur. Sur Ie côté gaucheou suppo!Î on remargue un supportpouvant recevoir un tNC TDF ouTEI,ECOM.
La conJiguration que nous venonsde décrùe est assez compliguée etnécessite une modification assezconséquente d'une installation exis-tante prévue seulement sur la bandedite ECS. Cette modification com-porte cinq phases :- adjonction d'un support de LNC,- adjonction d'ul second polarotorpouvant être alimenté en parallèleavec le premier si le récepteur Iepermet,- mise en place d'un second conver-tisseur : tNC,- fixation et câblage du sélecteurde LNC,- passage du câble de sélêction deLNC,
Au coût matériel d'une telle modi-fication, il faut ajouter la main-d'æu-we si la modification est faite par unspécialiste. Si l'antenne est très éloi-gnée du récepteur, perchée sur untoit par exemple, I'intervention peutêtre compliquée et par conséquentlongue et d'un coût exhorbitant.
Oue I'on se rassure il existe uneautre solution, beaucoup pus rapide
FigLtre 7
Figure 2
deI'onde
Circulaire
I LtrcuratfeLtneatfe l-
20 log cos d (r)
(t) d est I'angle des deux directiots de polarisation
Fl eor i^ Dtôâe Ân^
et si simple qu'eUe ne nécessiterapas l'intervention d'un spécialiste.Nous avons expérimenté cette solu-tion et les résultats justifient ample-ment les quelques lignes que nousleurs consacrons.
En fait, quel est le problème etquelle est Ia fonction du LNC ? PourIa bande dite ECS le LNC reçoit desfréquences comprises entre Fmin etFmax avec Fmax = Fmin t 800 MHz,Pour la bande ECS Fmin =10950 MHz. Dans les idtiales LNC ily a LN pour low noise - faible bruit -et C pour converter - convertisseur -Grâce à cette fonction convertisseurIa bande de fréqunece Fmin et Fmaxest transposée en une nouvellebande Fmin-Fol à Fmax-Fol. Danscette relation Fol représente Ia fré-quence de I'oscillateur local : 10 GHzdans ce cas. Pour la bande ECS onobtient finalement une nouvelle ban-de : 950 à 1750 MHz en sortie duLNC. Cette bande de fréquence estenvoyée au démodulateur qui sélec-tionne un canal particulier et démo-dule Ie signal. Si nous nous trouvonsdans le cas d'un LNC combinant lesdeux bandes : TDF et TELECOM oncherche à couvrir Ia bande de fré-quence immédiatement supérieure,soit 11750 MHz à 12550 et I'on veuten outre que Ia bande transposée sesitue exactement entre 950 et1750 MHz. Noter que Ia valeur 12550n'est pas suffisante pour la bandeTELECOM mais nous aurons I'occa-sion de revenir sur ce point peuimportant pour Ia démonstration quisuit.
Pour répondre au problème poséla fréquence de I'oscillateur localsera décalée et passera10800 MHz.
En résumé deux convertisseurscouuant les deux bandes :10950 MHz-11750 MËtz,11750 MHz-12550 MFlz.
ne diffèrent que par leur fréquenced'oscillateur local. A ce stade Ie pro-blème est résolu ou presque. Il nereste plus qu'à concevoir un LNCunique muni de deux oscillateursIocaux. On mettra en service I'un ouI'autre des oscillateurs en fonctionde la fréquence à recevoir. Bien queI'idée soit simple en soi, la mise enpratique est plus complexe. Sharp àréussi à parfaitement maîtriser Ieproblème et ptopo"e donc un LNCcouvrant les trois bandes : ECS TDFet TELECOM et ceci en conservantun prix grand-public. En fait, touteIa performance est dans cette der-nière remarque. Il est probable queles photos de convertisseur Sharputilisé dans notre station dê récep-tion troublent quelque peu les initiésen leur laissant un ardère goût dedéjà vu. Ne jouons pas aux devinet-
c'est bien un convertisseur Sharpmais ce tNC est aussi diffusé par
Le plus curieux est que ceconvertisseur est plus connu et plusrépandu sous Ie Iabel Uniden quesous son label d'origine : Sharp.
C ARACTERISTIAUE S DU LNCCe LNC porte la référence Sharp
86. Le schéma synoptiquedu convertisseur est repré-
à la fignrre 3 où l'on distingueles deux oscillateurs
et leur commutation. Lais-provisoirement de côté les pro-
de commutation et exami-Ies peformances de ce conver-
. Les valeurs ci-dessous sontde la feuille de mesure
chaque LNC et lescorrespondent à l'exem-
dont nous disposons. Dans laECS Ie gain de conversion
entre 56 et 59 dB et Ie facteurbruit maximal vaut 1,4 dB. Dansbande TELECOM le gain vade
Radio Plans 5OO 9
Dail
Diverspout les p ''cipaux satellites.
1-2 - ASTRA.3 - E C S 4 -4 - TDE 7 ba'lde haute.5 -TELECOMlA .6 - TDF 7 ba')de basse.7 -TELECONT7C.
entre 55,5 dB et 58 dB et le facteurde bruit maximal vaut 1,41 dB. Cesrésultats doivent mettre un termeaux idées fausses trop répanduestelles que celle-ci: les convertis-seurs double bande ont un mauvaisfacteur de bruit.
VALEUR DES OSALLATEURSLOCAUX
Les deux oscillateurs valent res-pectivement 10000 et 10995 MHz,Ces valeurs diffèrent de celles quenous avons calculées précédernentet nous allons en donner Ia raison,Pour le premier oscillateu il n'y apas de surpdse et la bande 10950-11750 est transpostée dans Ia bande950-1750 MHz. Le deuxième oscilla-teur local transposte une bande com-prise entre 17945 et 12745 MHz versIa bande habituelle 950-1750 MHz.Ceci signifie donc que les fréquencescomprises entre Ia fréquence maxi-male .de la premJère bande:77750 MHz et la fréquence minimalede la seconde bande : 11895 MHz nepeuvent pas être reçues. Cette con-
1 O n..r l^ Plâhè Ânô
clusion est vraie si on limite stricte-ment les possibilités du récepteurdémodulateur aux valeurs 950-1750MH2. En fait, nous avons vuque Ia plupart des démodulateurs, àcondition qu'ils ne soient pas à syn-thèse de fréquence étaient capablede grimper jusqu'à 1900 MHz. C'estjustement cette caractéristique quinous pemettait de recevoir les deuxptemiers canaux de TDF 1 avec unLNC ECS.
Admettons que I'on puisse gagner150 MHz sur la plage de couverturedu récepteur. Avec le tNC précédentnous couvrons désormais deux ban-des larges de 950 MHz :- 10950 - 11900 MHz,- 11950 - 12895 MHz.
Çe qui doit pemettre de répondreà toutes les applications ECS, TDFet TELECOM. Les diverses photosdes spectres de sortie du LNC don-nent une bonne idée des résultatsobtenus pour les principaux satelli-
'tes. Pour les émissions ECS et TEIE-COM il n'y a aucune remarque pani-culière à faire, Ie seul intérêt de ces
photos réside dans la comparaisondes puissances reçues avec uneantenne de 1,2 m. Pour les émissionsde TDF 1 on remarquera que Ie pre-mier canal est r€çu lorsque le LNCest commuté en bande ECS, ledeuxième canal peut être reçu enmettant en service I'un ou I'autredes oscillateurs et les deux dernierscanaux ne sont reçus que si le LNCest commuté en bande TDF TELE-COM,
COMMUTATTON DESOSCILLATEURS LOCAUX
Le dernier paramètre importantest Ie signal de commutation desoscillateurs. Bien sûr cette commuta-tion poullait s'effectuer par unsignal supplémentaire mais ceciconduirait inévitablement à I'emploid'un câble additionnel et l'onretombe dans le cas précédementcité : modification de I'installationexistante.
Suprême astuce Ia commutations'effectue grâce à la valeur de Iatension continue d'alimentation du
tNC. Jusqu'à présent ce câble jouaitun double rôle, il est désormais tri-ple : alimentation du LNC, choix deIa bande, retour de la bande transpo-sée. ta commutation est régie de lamanière suivante : V alim = 14 Vbande, ECS V alim : 18 V bandeTELECOM/TDF.
Sur le LNC dont nous disposotsnous avons mesuré les valeurs sui-vantes : lorsgue Ia tension d'alimen-tation croît le LNC commute pourune tension de 17,40 V. Lorsque latension d'alimentation décroît Ia ten-sion de basculement vaut exacte-ment 17,00 V. Noter que le LNC fonc-tionne encore en bande ECS pourune tension voisine de 10 V mais legain chute fortement.
Dans le récepteur TV SAT, nousne disposons pas d'une sortie depuissance commutable mais simple-ment d'un niveau logique *5,0 Vdestinée à Ia commutation desentrées A/B dans le cas du moduleCB ffu572 Philips et libre dans lecas du module Sharp.
Le schéma de la figure 4 rendcompte des modifications qu'il fautapporter au récepteur pour l'éguiperdu système de commutation de ban-de. Noter que cette commutationainsi que la sélection de polarisationsont mémodsées par Ie circuit desynthèse de tension ITT et qu'il nesera plus nécessaire de choisù labande en utilisation normale. Lasélection s'effectue pendant laphase d'allocation des programmes :programme 1 bandê 1 fréquence f1polarisaiion H, programrne 2 bande2 etc...
Sur le schéma de la figure 4 onremarquera gue le régrlateur de ten-sion LM 7818 à été éliminé. La résis-tance collecteur base du transistordarlington BD 677 vaut 330 Ohms.Lorsque aucune tension n'est appli-quée sur I'entrée de commande dutransistor 2N2222 la tension d'ali-mentation du LNC devra dépasser leseuil 17,4V. On pourra choisû unetension compdse entre 18 et 19 V. Sicettê tension est trop importante,supérieure à 20 V, on placera entrela base du BD 677 er,la masse unerésistance Rx. Cette résistance Rxsera ajustée de manière à obtenir 18à 19 V. Lorsque la tension de com-mande vaut 5 V Ie transistor 2N2222est saturé et Ia tension d'alimenta-tion du LNC devra être inférieure auseuil bas : 17,00 V. On pourra pren-dre une valeur voisine de 14 Vcomme le précise la spécification
: cucula[e-[neaue.
ENRÉSAMÉVous êtes I'heureux prop étafe
d'une station de réception TV SATECS et vous déstez étendre votrechoix aux bandes TDF et TELECOM.
Que faut-il faire ? Très peu de cho-
Démonter le LNC ECS existant,Ne pas modifier le polarotor,Monter un LNC Sham BSCD 86le polarotor existant,
Equiper Ie récepteur du schémade bande,
Reprogrammer le récepteur surIes bandes et tous les satelli-
: ECS, ASTM, TELECOM, TDF,
Les émissions de TDF serontindifférement en Dolarisation
ou verticale avec unede 3 dB dûe à la désadapta-
technigue. Si besoin est on modifierala valeur de la résistance de 1,5 K.
François de DIEULEVEULT
Le LNC Sharp BSCD 86 est distribuépar :
SCIENTIFÏOUES127, rue de Buzenval 92 Garches
LA LIBBAIRIE TECHNIQUEDE TEXAS INSTRUMENTSS'ENRICHIT DE DEUXNOUVEAUX OUVRAGESD'APPLICATIONS ENFRANÇAIS
Rédigés par des experts en la matière, en l'occurenceles ingénieurs d'application des laboratoùes de TexasInstruments, ces deux volumes associent une courtepartie théorique à un ensemlle d'applications dans unsecteur particulier.
Consacrés aux applications des circuits linéaires, ilss'adressent tout particulièrement aux étudiants, auxingénieurs et aux techniciens de l'électronique. Les pro-
fesseurs d' y trouveront également matièreet leurs travaux pratiques.poù illustrer leurs
Les secteurs dans le volume 1 sont les sui-vants :- amplificateurs opérationnels et comparateurs,- amplificateurs vidéo,- régulateurs de iension,- conception d'alfunentation à découpage.Référence : ISBN 2-86886-020-6
Le volume 2 traite des :- commandes d'affichage (LED, plasma AC/DC, tubesà vide).- circuits de ligne, pour la transmission de données(RS232C, RS423, RS422A, RS485, IEEE488, etc.).Référence : ISBN 2-86886-021-A
Un troisième volume est en cours de préparation etsera disponible mi 89.
Ces ouwages sonl disponibles chez les libraires ou àdéfaut auprès de Editions Radio, 189, rue Saiat Jacques,téI. : 43.29.63.70.
Radio Ptans sOo 1 1
7.8Æ . l l l l l*
r1Èr(!U+'r+rJ1:f'.r ) l l l .r{f,' ; l : Ii f$rlrti t, I tYÈ{.
- - t -
CENTRALESDffi ENSEMBLE D'ALARMES
[ffisRéf. 1023- Pour appanement4 zones cha4eur n@rporé.
Bel.1001.Pourapparlementoupet pavilon. a3bouclesN/F,3boudesN/0. IChargeû incoeoré.Fé|.1007 ldealpourappailementoupavton. {4 zones éjeclab es el selectronnables I
Réf. 1019. AEeée par CÉs æsuances ^{APSAIFD).4 zones séleclionnables 3donl 3 zongs mixtes,
690 r200F950 F
250F
ouvREz L'ctL...SUR VOS VISITEURS
lHDsnrà'e élolulion lechio o hgffi:iJ'Jff,'f.i1i [Yde lallè iÉduire. Dùé€ de l:voouàs im ' lÉê ! l ' â s . l ; tsbe. ECFÀN DE CON- li-ànoLE nlMa, cmbre Ë1)liteFhme él bouon do!' J>-Etu'ederâsache.
d;4-PnlX ! IoUS CONUIIEi
DETECTEUR VoTUMETR|QUE o "|lifrîf,ËËûE*r,8ét 1 108. EtcspIionæ1, délecleu I n. à @mpteu. d mpurson, 8e! agè de s€nsibttité el de
24 iaiscæ0x sû 3 p ans 14Ce @venure hdiz. 5F ved ca €.
{pûrr rêsânmau) ...Fé|. I 111, oélærer infaouge agdèpa Es c es âsuaæs (APSA FD).Podée 1 2 n . . . . . . . . . .
8éI, 1105. MDÀ8 NYPIR FREQUENCC,Po.ræ 3 à 20 m. nsg ab eRél. 1107. DETECIEUR double rechnoloa e.Inllarcuge + Dél€clsi bns de glace.
'
locaux cûnmerciaLrx
680 F*.*,950 F*.*,980 F,**,
1150 F,,.,,,li,ilîl3""'iâi''450 r CtE ELECTROI{1OUECLAVIER et B0lTlER
DE C0MItlAt{DE pour ALABilEou P0RTIER D'IMilEUBLE
lLei;cersivi::FMa'rchs Æ'ér
390 F,"".u. à^s, .
if['rËi1i:Ë"" **"' 625'i; ry-::.fffi;,"dp',..".ffi'"ni:Ë**ru 580 F,".,,,r ffi
COIV!MANDE AUTOMAÏIOUE
TETEPHOiIIOUEDec lenchemenl au to e r
lon dès que le lélephoneesl dec.oche el aftal des
Per fn e l d enregrs l re rD aùtomalrquemenl,drscrènême en votre aosence loutes les
commun calrons teiphonques eiiectuées àpartrr de voùe téephone Eranchemenld une parl à la pnse muraie d arNée de votreh€ne PTT sort d| lectemeni . sof n larded une pnse grgogne €td aulre pana un en.eqslrelr slandnrd mun d une pr æ lelécom
DE ÏRANSMISSION D'URGENCE ET II Le compagnon frdèle des personnesseules, àgées, ouI nécessrtant uneaide médicale d urgence.I l) TBAt{SMlSSloil au vorsrnaqe oL au qard€n pdrI EMEIÎEUB RADTO iusou a 3 kmi.i 2) TRAi{SMETTEUR 0E MISSAGE Dêrsonnal6é à 4I numéros de téléohone diffé.ents ou à une cent.ale deI Télésurveillance.
Documenlatron complèle contre 16 Fen tLmbres
t f r l I I L t L L n t t v L u l l r l vXIT C0ttlPI"ET lacile à installeL SimDleà ulilisercom0renant l-- Ecnn de conrrôh 23 cm
CareraavecobFc1 oe t6l1m (eclatràoe8 uxmrl|mLnJ- suMr mta + :t0 m dê c$e liaM
rfficoilPlET 3590t",Pnxà lexponatmn 2 692,50 F- Expéd ronenportdù
;;::,':J[*iil ponær 449 FD'AIARTIE
ii;!'filfii I 4Eo F*^*,Réi 1311.4vo ies d en l rée :1 voie hlrusion - l voieTechnique1 voie Incêndie- l voied'Urgence.Efiegistremenl d'un message personnâlisé et repro-duclion lidè1ê de lâ voix ên synthèse vocale.
2 890 F",,,,,llombleq aulrcs modèles en slock NoUS CONSULTEB
Vous désrrez nslaller raprdemenl et sansbranchemenl un apparerld écoule lélépho-nque et lémeneur dotétre Lnesrbles nsra le sans bGnchemenlen clnq socondes (rl n Y aqu à changer la caPsu e)Les convercatmns lélêphonL-ques des deux Parienarressont lransmises à 1 00 m
PRIX: nous consulletloûliErl cûidel€ cqlt€ 10 F er{,flùes
lNon homoloaué) Venle à ltxûortatnn
PANASONICREPOI{DEURS EI{REGIST
Matéirelnon agréé desl ne à Iexporl"ârion æavec tnterrooaton a orstance- tÂl
firiiiiirfÊhtEl,ïfl t 250 F *"", IV{,.i'dl[JÉ'Ê I 460 F*.,., qssliHifiim:fli e5oF,,*, \10UïE t GAI|i E PÂtlÀSoillC disponible
REURS
ltlE 8t[rE ooiplErE DE GB0s 0lspoxr8lrNOUVEAU ! MICRO EMETTEUR
|jif*iffiî,,ifii;, 760F'35t -Ponæ5lm, rcsrabr de 80 à
| | 85 t
ALAHME ÙANI' FILÈasstE lutfls r2 ttLlta abne p& m sqnar €dio
780r 2503 '150
TELEPHOTiIES SAI{S FILMaiéiel non agréé dêstiné à fêxportâlion
I #isb,.r5û'F' PORTEE 300 à 600 nr| àvæ nrercommunroton' cT 505ll eonrte r r'
Pd a feroo'l 2 950 F llra s dê pon 50 F par anlc e)
PROMOTION D'ÉTÉCEI{TRALE BLX 06
lNE peù1e csrtâle pou appa.
i"1!'i,lJff'#liluo*.uo Qi$&:;,,'""mIflii:$Fii,',,',.. 590
réæOIeû.0 67 el ÊMEnÊURD22 A0u ETI kr
iùi[,y1;,g3;y'' 8st' o"""o,,
o'oo^nn. 1250 rot
COMMANDE A DISTAilCEPone de gæge, edairage, boulon pan-que. Télecomnund€ par EiTIETTEUi1 cânâ , Poriæ 40 à 80 m h chdp I brc.Fâ, 3014 oECOoEUF 3 erars. Codage
290 F,".,u,Fei 2836)
Ëil gffi#,nll,îty"
ffi#fr,e i"sô;",Pod 65 F ' Ma!,idel iÉsâllé à tdPod
TNTERRUPTEUR sANs FtL i-
À*"ïffï;:'Hâ;çli&fffiîri^",.,- 450' I EEMfltuF.alnenlâlicr pilegt.
,rro...uo,r5, I 1R
Oenlral edornotique12o:
f r /res entreessorlies
Avant de revenir à des considérations plustechniques, nous allons nous attarder quelquesinstants au sujet de la domotique et de sesapplications pour bien vous faire comprendre tour ceque soutend la " centrale ,, que nous vous proposons.Nous ne souhait ions pas réellement tomber dans cegenre d'explications mais i l nous a semblé nécessaired'y consacrer à nouveau quelques l ignes.Revenons donc sur le terme " domotique " quienglobe bien trop de choses pour vouloir direquelques chose de t rès déf in i . . .Parmi les nombreuses définit ions un peu plusélaborées, la seule qui, a notre sens, résumecorrectement cette idée est celle proposée par la FIEE(Fédération des Industries Electriques etElectroniques) :. . . c 'est . . . dans un cadre domest ique. . . é larg i . . . " I ' in ter-opérabil i té d'équipements dans des domainesd'activités différents ,'...
Radio Plans 5OO 1 3
\
l--JONNONS donc des exemplesvadés de domaines d'activi-tés différents :- la gestion d'énergie,
- lâ sécudté,- le confort,- lâ ^ôhm n i^âr i ^n
- Ie télé-paiement,et d'autres d'équipements :- chaudières, radiateurs,- portes, fenêtres,- â rY^câdê. i , , i . 'À ih
- postes téléphoniques, téléviseurs,- . ^ h h t ô r r r , h l ô r l !
- imprimante, fax grand public.et alors que vive l'inter-opérabilitéde tout ce beau monde et vive Ladomotique | ! !... et à vous de créervotre convivialité individuelle.
A ce propos donnons des exem-ples d'rr inter-opérabilité r :- ( ici le congélateur de Ia maisonde campagne, j'ai un problème. Ausecours on vient de me couper Iecourant I Je jette tout, j'attend unpeu ou vous vous dépéchez d'arri-v e r ? l ?- a bébé s'est endormi, on peutalors complètement éteindre laIumière de sa chambre et tirer unh ê , r h l , r ê e â h ô r t ô
et vous avez ainsi réuni de Ia mécanrque, i'EDF, Ie réseau téléphonique,deux minitels, un écran de télévi-sion, une caméra, un relais, unmoteur... et vous voguez en pleinedomotique.
Evidemment, comment satisfaireconcrètement tout cela ?
Grâce à I'électronique bien sûr IEn plus c'est notre métier, alors
profitons-en IUne grave question - comment ?Plusieurs solutions peuvent être
env$agees :a une structure centralisée (qui doittout faire) ? (il est permis de rêver;a un système à gestion centrale etsatellites intelligents ?,a un système sans gestion centrali-sée où chaque unité peut êlre consi-dérée comme un maître isolésachant communiquer avec d'autres.
Dars tous les cas, vous serez con-frontés tôt ou tard à des problèmesde liaisons (filaires, RF, IR,...) deconnexions, de connectiques, debus, etc.
De plus, chaque cas de fignne estparticulier et le Votre sera différentde celui du Voisin - donc pas deê ^ l , t t i ^ n , , n i m , ô
Alors que faire ?Pour notre part nous vous avons
proposé un système à gestion cen-
1 4 naoio Ptans soo
tralisée mais, comme il n'est pasdans nos habitudes de rêver, nousavons prévu de pouvoir disposer dessatelliies intelligents via différentsbus ( I2C, , , , D2B).
Pourquoi avoir choisi cela ?Notamment en pensant à vous au
niveau financier, car l unité proposéepeut satisfaire Ia plupart d'entrevous dans Ie cadre d'une complexité( raisonnable )) vue son aspectmodulaire.
De plus telle qu'elle a été conçue,de par son côté secable, on peutréaliser de multiples CPU et conce-voir de les dépo er pour en faire dessatellites intelligents que nous vousapprendrons à faire communiquerentres eux et à rendre autonomes.
De ce fait Ia CPU doit être capablede gérer tous (ou enfin presque) Iestlpes d'intedaces gui peuvent ouqui poufiaient se présenter pourassurer les fameuses ( inter-opérabr-lités... dans des domaines diffé-rents r.
Facile à dire, moins facile à réali-ser.
Réexaminons les Domaines et lesActivités et essayons de mettre enface des types de fonctions ou d'in-terfaces électroniques (modulaires sipossible).
Pour ce faire, dressons un tableau.De toutes ces applications de Sys-
tèmes et de Domaines, il ressort quebeaucoup de sous-fonctions stan-dards sont communes,
Entuées et/ou sorties numériques(par tout ou rien) :
A chaque fois qu'iJ. y a un( contact , soit pour saisir une infor-maaon :- instant de femeturc de volets,- débordement d'une cuve,soit pour commandet un contact,une LED...- couper une électro-vanne,- mettrc en marche ou arrêtet unmoteuLEnftée et/ou sorties analogiques :
Mesure d'une grandeur physique(tempénture, pression...) command.eproportionnelle.Conversions analogiques/numéri.ques
Transfomations de grandeutsphysiques en numè que pour cal-culs, pour garder un point de considna àD râférèn^À
Conversions numériques/analogi-ques
Création de signaux particuliersde commandes (triangulaires... ) pourcommander des moteus à courantcontinu... etc.Horloges temps réel et compteursd'évènements
Comptage du temps écoulé, chro-nomètrc, alarmes journalières, aprèsun laps de temps, ...poù des applica-tions de sécurité, d'économiesd' éneryie, de suweillance.
Maintenant, nous pouvons repren-dre de fil de I'histoire en vous propo-sant une famille de modules I2C
RAr'lrEPR0ll
sàlslés de vàteu.s
SAUlPE}IENTS
D'ACT]V|ÎE
Foaæ
t'9 l///6 éo oo oo oo oc co o
ccccco
t'))à 4o oc co oc cc co o
oooooc
c c cc c cc c cc c cc c co o o
o o oo o oo o oo o oo o oo o o
Figutè 7.
( actifs )) êt non plus de présentationou de mise en marche.
Encore bravo à ceux qui nous ontsuivi (bienvenue au Club pour lesautres évidemment l) et qui dèsmaintenant vont pouvoir s'attaqueractivement à leur installation spécifi-que.
Au menu d'aujourd'hui, en entrées(sorties) deux por(c) (t)s I bits,ensuite un plat de résistance (sansrr s r, sinon ça ferait copieux) nonpas de Ia cervelle mais des mémoiresRAM et en guise de dessefi unepetite E2PROM (qu'il faut toujours^^ -^ ' , ' l^ - .^ . . - r^ ^^] , \J e g d r u e r P v u r 1 4 è u r r / .
Autrement dit, nous allons Ecdreet Lire (surtout l'article de Mt CIBOT
dans ce même numéro concernantparticulièrement ce dernier point)des composants via le bus 12C.
Après cela vous saurez presquetout faire circuler sur le bus de façonsimple.
. ENTREES/SORTIESNUMERIOUES. LE PCF8574
Nous vous offrons figure 1 sché-ma, circuit impûmé, implantation detrois versions de modules uti.lisant lemême type de circuit intégré :- une version < numérique ldépouillée permettant de disposerde ports d'entrées/sonies logiques
sur 2 x 8 bits ou 16 bits,- une autre pemettant d'utiliser cemodule comme un module d'affi-chage d'infomations logiques àI'aide de LED,- enfin une troisième sur laquellevous disposerez selon votre bon vou-Ioir les composants servant d'inter-face entre une logique peu ( mus-clée D (côté milli-ampère) et unecommande de petite puissance.
Examinons plus en détails com-ment fonctionne ce module d'unecomplexité époustoufflante (il y a aumoins deux composants I nous vousavions prévenu I'12C ça réduit lenombre de composants et de bro-ches à Ia cuisson).
Radio Plans sOO 1 5
INT
'ss
scL
iEî
Figure 2.PCF8s74PCF8574A
Ê/Ù lit^rlsdlefm n*e
TO
Figule 3 a : Ifuode écriture (pott de Jotie).
t.v..ddré{PcF8574l
I
DATÀzX OATA 3
t r _I
IIIrrr- I
t l . l
Figure 3 b : Mode de lec+lu.te (pott d'entrée).
s o I o 0 a 2 a 1 a 0 0
PRIN CIP E DE F ONCTIONNEMENTDU PCF 8574
Le synoptique du PCF 8574 deRTC PHITIPS COMPOSANTS estdomé figure 2 et ses protocolesd'écriture et de lecture sont indiquésfigure 3 (a et b).
Comme vous venez de Ie remar-quer, bien gue ce composant ne soittoujours qu'un ESCLAVE, il peut soitêtre écdt pour afficher sur ses sortiesun octet, mais il est aussi possibled'aller lire le contenu du port desortie si on suppose que celui-ci a
' l 6i e..r i^ Prân< 6no
changé (au cas ou I'on ne saurait passupposer, Ie circuit est équipé d'undispositif capable de vous signaler siquelque ctrose a changé sur le port !)ce qui est bien pratique surtout sivous désirez un beau jour mettre(optionrellement) un petit clavier decommande, comme nous I'avons fait.
PARTTCULARITES DU PCF 8574 ETDES MODULES
Tout d'abord nous avons disposédeux circuits par module en vous
laissant la possibilité, à l'aide demicro-switchs, d'en déconnecter un.Adresses des circuits
Ici aussi vous avez Ie choix pour lebaptème des adresses des circuits.
Un jeu astucieux de trous a étéimplanté sur le circuit imprimé defaçon a pouvoir configurer jusgu'àhuits circuits identiques (soit 4 mo-dules de même nature) et dans lecas ou vous sedez gourmand, Ianature a pensé a vous en créant unfrère jumeau au PCF 8574 qui n'ha-bite pas tout a fait à la même adresse
( hard ,) Ie PCF 8574 A et qui pour-rait donc vous permettre de bonce-voir un systèrne à 8 modules (16circuits).
Adresses des :P C F 8 5 7 4 : 0 1 0 0 4 2 A 1 A 0 ( R / W )PCF 85744 : 01 1 1A2 A1 A0 (R/W)dans lesquelles A2, 41, A0 représen-tent les bits reconfigurables d'adres-ses bien connus.Remarques
Oue les cudeux soient satisfaits, ilest tout à fait possible d'en mettrebien d'avantage (100, 200,...) en mul-tiplexant dynamiquement et tempo-rellement les adresses A2. A1. A0par logiciel, via d'autres PCF 8574.Notre boîte à lettre reste ouvertepour leur répondre à ce sujet.Courant max de sortie
Le port de sortie quasi-bidirection-nel est verouillé (latché en bon fran-çais) et maintient donc les informa-tions qui lui sont présentées et deplus, est capable de foumir, Iorcqu'ilest à l'état bas, un courant apte àcommander directement des LEDs(Imax a ne das dépasser sur un port :24 mA, nominalement 10 mA)Remise à zérb
A la mise sous tension, un disposi-tif de remise à zéro positionne leport de sortie à fétat HAUT (11111111 = FF) permettant de pouvoirécrire directement Ie port si bon lesemble.
ECRTTURE/LECTURE DU PORT DESORTIEEcriture
Chacun des bits du port peut êtreconsidéré cornme un bit indépen-dant et servir soit en entrée soit ensonle.
En ce qui concerne l'écriture, lemaÎtre (notre micro-conûôleur8052 AH BASIC) adrêsse toutd'abord le circuit en positionnant ledemier bit de I'adresse à 0 (mode
d'écdtwe), attend l'âcquittement duPCF 8574 puis présente alors lesdonnées qu'il vient de recevoir sur leport.
Comme Ie montre la fignrre 3 a, cen'est que juste après 1'acquittementde réception (qui indique gue cesdonnées sont bien arrivées) qu'ellessont alors écrites sur le port de sor-tre.
A ce sujet, c'est en inscrivant unrr 1 r sur un des bits de données (JueI'on obtient (après I'acquittement ducircuit) un a 1 l sur le bit corespon-dant du port de sortie (data bit 5 -port de softie 5 par exemple), etdonc pour repositionner le port enattente d'informations (ou moded'entrée) il faut transmettre unedonnée de valeur FFH.
ta quantité de données que I'onpeut envoyer successivement lolsd'un même échange n'est pas, surson principe, limitée mais il est debon ton de s'occupet de temps entemps des autres circuits qui sinonpouraient faire plus tard des crisesde suceptlbilité aiguè si on lesdélaissait ! ! |
LectureExaminons maintenant la lecture
du port (fignrre 3 b).La philosophie est similaire à quel-
ques particuladtés près qui ontcomme d'habitude leurs importan-ces I
Bien sûr nous sommes en mode delecture et Ie demier bit de I'adresseest à 1, Bien que cela puisse paraitretdvial, on peui lire sur Ie port desinformations qui vont plus vite queIa musique I
Expliquons nous : Ies données surle port (devenu d'entrée maintenant)peuvent vader npidement, voùeplus râpidement que le bus n'estcapable de les lire. Comme Ie montlela fignrre, le PCF 8574 décide de
( lire ) ûaiment ce qu'il y a sw sonport au (demier) moment où il reçoitI'acquittement du maître gui est à cemoment-là ( récepteur r.
Ceci nous permet de conclurequ'en valeur moyenne, le port d'en-trée ne doit pas varier plus rapide-ment gu'au r,'thme de 10 kHz envi-ron, Iorsque le bus fonctionne à safréquence maximale de 100 kHz,sous peine de dsquer de manquerdes informaiions entrantes.
En ce qui concerne notre champd'applications, Ies choses vadentbien souvent lentement et nousaurons arnsi tout notre temps, poura1ler, par logiciel, examiner les diffé-rènts états des ports d'entrées,
En fin de lecture du port, Ie maîtreaprès le demier bit de la demièredonnées lue et pour signaler au cir-cuit PCF 8574 qu'il veut prendrecongé de lui, doit, pendant Ie neu-vième coup d'horloge SCL, envoyerun ( NON acquittement D (NACK)pour que celui-ci comprenne qu'onveut lui dire ri au revoir r puis effec-tue ensuite la procédure classiquede STOP.
InterruptionVoilà enfin un peu de vraie nou-
veauté IComme nous vous I'avions laissé
présentû, ce cùcuit est bien élevé. Ilsait vous indiquer, si vous Ie désirez,si I'on a modifié ses entrées. Mainte-nant, traitons-nous ou ne traitons-nous pas ? ceci est une autre histoiremais en tous cas nous avons eu Iechox d'être injormé.
Ceci offre deux possibilités de trai-tement par le logiciel d'applicationBASIC.
Solution 1 :On ne s'occupe pas du tout de ce
signal et périodiquement, on va véri-fier que rien n'a changé (méthodedite de ( pouing ))) et tant pis pour
t l6 ,
I
illr\,4-fl\-A_|6L-r^-Æ
Figare 4
scL
nous sr ça a changé deux fois aumême endroit pendaat I'intewalle detemps considéré et si on a mansuéquelque chose.
Solution 2 :On bénéficie de I'aubaine offerte
par la présence de ce signal. En effet,Iorsgue lê port est en mode de lêctu-re, dès que sur l'une des entrées ondétecte un flanc montant ou descen-dant, un signal d'interruption INTest créé (à la condition d'avoir dis-posé au moins une résistance demppel au + 5 Volts pour tous lescircuits car ces sorties sont en drainouvert et permettent donc de réali-ser un ri OU rr câblé pour I'ensembledes circuits/modules) voir figrure 4.
Ce signal d'INTerruption permetde dérouter le programme principalqui est en train de se dérouler pourauer voir ce qui vient de se passersur ces port récalcitrants.
Etant donné qu' peut y avoir plu-sieurs cùcuits qui ont simultané-ment foumi une INT, on scrute et onIit rapidement tout Ie monde a tourde rôle et ce n'est qu'au moment ouon a lu Ia valeur qui a changée sur lebon port et uniquement sur celui Ià,que ( sa propre contdbution a DI'INT disparait.
Comme toute Ies broches d'INTsonT momees en uu UABL.E; on lesachève une a une jusgu'à ce quetoutes disparaissent, puis lorsquel'on a terminé, on revient reprendreIe cours du programme principal ini-tial.
LES MEMOIRESDifférents types de mémoires exis-
tent dans la gamme de composantscompatibles au bus IzC :- mémoires RAM,- mémoires E2PROM,- mémoires d'images.etc... etc.
Pour nos applications, nous avonsdécidé d'utiliser pour Ia RAM Ie PCF8570 (etlou son jumeau 8570C) orga-nisé en 256 x I bits et pourI'E2PROM Ie PFC 8582 AP de mêmeorganisation.Les adresses des mémoires
Dans le même espdt que le PCF8574, l'adressage est aussi reconfi-
gurable. Les adresses respectivessont :RAM PCI ' 8570 : 1010 A2 A1A0 (R /W)
8570C : 10 1 1 A2A1A0(R^ t )E2PRoMPCI' 8582AP | 1 0 1 0 A2 A1A0 (R/!V)
A vous donc de choisù de disposerplusieurs circuits intégrés d'unemême famille sur un même moduleet de mettre de nombreux modulesidentiques en batterie.
PCF8570PCF8570C
I
1ÊL r-,bve ____l I
Éd..l4r
Figure 6.
Vss
Figure 7,
RAMLe synoptique du circuit est indi-
qué figure 5 et son protocole spécifi-que est donné figmre 6.
Mode d'éc tureOn adresse le composant en lui
indiquant que I'on souhaite l'écrirepuis, après son acquittement, on luiindique (et ce obligatoirement à cha-que fois que I'on reviendra à nou-veau vers lui pour l'écrire) I'adressedans laguelle on désire inscrile lapremière donnée qui va suivre. Tantque I'on ne quitte pas le composant,grâce à un dispositif d'auto- incré-mentation oui Dointe la valeur sui-
vante de l'adresse, il est possible derentrer ( au km rr des données quise rangent au fur et à mesure dansdes adrêsses successives croissan-tes et on temine l'échange par unecondition de stop.
Dans ce cas, lorsque l'on arnve àla dernière adresse, on recommenceet on repart à/de zéro.
Mode de lestureIci variantes et sous-vadântes !1è," solution: le maÎtre lit la
mémoire après avoir pré-positionnéI'adresse de départ de lecture.
On adresse le composant en moded'écriture pour lui indiquer à partù
de guelle adrêsse on veut commen-cer la lecture puis, sans s'arêter(pas de STOP), on effectue un RE-START en ré-indiquant I'adresse dece même composant en mode delecture (gui connaît maintenant I'en-droit d'où la lecture doit commencercar elle vient d'être chargée dans ]eregistre d'auto incrémentation) et, àpartir de ce moment, I'esclave (lamémoire) envoie en direction dumicro contrôleur les données tout enincrémentant les adresses commeprécédement jusqu'à ce que le maî-tre décide qu'il n'en veuille plus et lefasse savoir à la mémoire en rr en-voyant D un NoN-acquitement (pro-
a) /Mode effacer'lent (écriture).
ir:tnil:fiFl
{è- '_,bvr. _-l
!r.lffi iddda
b) Le tnaître lit Ia ,mét''oite après ptépositio,n,'.e!''e,'t de I'adresse.
*kno*r.dF no -k.dr.dF,.@ nrr.. lrom mrrù
Figute 8.c) Le ,r',aître tit 1a frtér',.oire directeûent aprèç I'ardre Rêad.
earl in Plan< ann ' l
I
ln
Autres fabrications :I\IIRES IV . CODEURS -
TRANSCODEURS
11, rue Pascal 75005 PARISTé1, : (1) 45 87 30 76Télex : 203 889 Fsideæ"
MAGNETIC FRANCE...MAGNETIC FRANCE...11, Pfrce d€ lr nrtlon ?5011 fARIS - Tél: 43 ?9 39 t8 - Tétet 216 32a î
Oùvcn dc t h 30 i t2h 30é de 14 h i l9 h Fcrmé te tundl
an lln ûrnlda dc la revii y cofip.la La drcdt| InFlr*a mn paréa.LES CIRCUIIS ITPRHES PEUVE}{I E1RE UVRES SEPAREI'ENT.
4N5 FL Flh.€ vidéo rscp, aâlsllils........487 Dlll Trâmc€tw' DT1rF.........._....
ÀL . AlarnE unn€rs. 6€@...,........COD. Cod€ur prol€......-.,.............W Cla.ilbu ry Sal........,,............
POT TOKO 707 vx 4042......_....,..,..,...493 CRY Cryplqr / Décryprer.......,...l9l CL +IEI+IE2 Conpo€€ur t6t .,.
2637r2216
u7r27ê17
â752
37t)
t5a
1g
IEL ConFo€€ur 161..-...................
495 S/P Conveniss€u S/P...,-..,.........
ELIS TEL Coûpo6û. tétéphonê....... a9F496 IRE+IRR Télécde donÉrhu€ tR r5r F
EL:197 REr RécQtôw 27Mhz FM........ 165 F|e7 RE2 RéE€pl€ur 27Mhz FM........ 196 Fri97ACOCkcuilA.cordTBB1469..... 86F497 EIE Érn€tt€ur 27 Mhz Ouaiz... .t?! FRéGlstancê prédslon 1% €î stod(
EL4S DOH Cdtt. domothus CIPPAL 9a8 FaA VHF Réc€C. VHF 3ens QTZ RX 2et F
EL4ae PC Codon Mhl€VPC................ 72 F499 SCA Cda Enr6g. SCANNER.... rr2 F
llrÉlel -lléocid' lotr hMcdmdâ. bounrle. HF . Bind.g. .
nandrl|. Co{p6ttaaYl. on Èrll
rorhu€€ : 1000 va 2 r 65 v................... zo F Seï6 d ârot H.F. dê 0,1 5!H à 4OqrH
dlrprlmanrâ (de mini) MTP 401-14drt F I conven|ssê|lr LNc 6raBrâr 550..a 2€o F
Le Dm2...... 22
T T L74{o t 7401 t 7445 | 74oa t 7410 t 7412 | z1t3 t 71?o I MACNETIC FRANCE !. p.ut ar..712 | 74æ | 7127 I 7433 I 7437 I 7440 | 742 t 7446 | l..u ntpotr{bt. du mi7150 I ?451 | 7453 t 74æ t 74a1 I 74A2 I 71a3 I 7491 | ron.rb!tr.E.ùr dé r.rl.r ont
3 F par'lo plàce. I v.rdud .r xrT
!or'hu6 :t50V42x27V............,..,....: 260lorhuæ :220 va 2 x 35 v.......,............. 2ao
S6lfe d anel H.F. d€ 1 mH à 100 mHl7 raleura - BUivanl pôt...............! à tE F
Anlenn€ pârâbolhue r 1.50 m.....5 æ(t FNou3 dlstrlbuons el,.sl
l.s KITS " ELV"L!. tlt d. rtrr! dG 6 motr
|'ær P.. !fil.ln.tochm.l. ré.llra., I l. rlêlrlrndb,
d.î. L. æ hêr't ,&r .impL |lp.l télétl|oolql|.
TIODU1ATEUR I.V. 8838
spéciar TÉLÉDtsrRtBUTtONBande latérale atténuée par F.O.S.Couplage de canaux adjacents possibleBandes couver ies : | - l l - l l l - lV-V- INTERBANDËSN o r m e s p o s s i b l e s : L f - B - G - H - l - K ' - C C E T TNiveau de sor t ie : 110 dB pVRéjection des parasites : 60 dBRapport signal/bruit : 55 dB
cédure de NACK comme dirait MLCIBOT),
2è." solution: le maître lit lamémoire directement après l'ordrede lecture.
Dans ce cas, on adresse Ie compo-sant en mode de lecture et sansautre fome de procès celui-ci envoieses données à partir de la demièreadresse incrémentée contenue dansle registre d'auto-incrémentation,que celui-ci ait été positionné précé-demment par une écriture ou parune lecture. Dans ce cas, il n'est pasnécessaire d'indiquer I'adresse dedépart et de ce fait on peut doncgagner du temps dans l'échange.
Une demière remarque avant dequitter ce composant.
Lors de sa mise sous tension (po-wer ou reset), le registre d'auto-incrémentation est initialisé et onpeut donc commencer à écrire si onIe désire à padir de I'adresse zéro.
E2PROIVIDe son vrai nom Electdc Erasable
PROM le PCF 8582AP va vous per-mettre de conserver vos chères don-nées (2 lôits organisés en 256 x 8)renfermart vos points de consignesde températures..., vos alames..., etce, pendanl une durée minimale derétention garantie de 10 ans, den'avoir Ia possibilité de ne changervos valeurs que de 10.000 fois et en
20 R"aio Plans 5oo
ne consommant qu'un énome cou-rant de 10 micro Ampère ! ! !
De plus son brochage est compati-ble avec Ia BAM précédente (au casou vous ayez des idées de vouloir unjour remplacer l'une par I'autre).
La philosophie de ce composantest très similaire a celle de la RAMque nous venon de décrire... à quel-ques exceptions près bien sûr | ! r
Le synoptique du ctcuit et sonprotocole spécifique sont donnésfigures 7 et L
Mode d'écritureLa technique d'écriture est en tout
point identique à celle utilisée pourécdre la RAM PCF 8570, SAUF queI'on ne peut envoyer au circuit que2 octets de données au maximum aulieu d'une infinité et ce n'estqu'après réception et acquitementde ces deux octets que commence lemécanisme (d'effacement/écdtu-re r de la mémoire qui prend environ30 ms par octet (60 ms pour deuxbien évidemment !). Ce mécanismeest mis en ceuûe a I'aide d'un oscilla-teur régi par un réseau RC extérieur.
Pendant ce temps, Ia mémote estiaabordable puisqu'elle travaille etd'ailleurs, pour bien vous le farresavoir, même si vous l'adressez pourvouloir lui recharger des octets ellevous monkera son vilain caractèreen ne vous renvoyant pas I'acquitte-
ment tant espéré et en vous faisantcroire qu'elle n'est là pour person-n e !
Bien que cela soit dit sur un tonhumodstique, ceci renferme unedeuxième notion fondamentale dubus I2C qui réside au fait qu'en plusde I'acquittement de ( bonne trans-mission ,) standard, nous disposonsici d'un acquittement ( en tempsréel de la fonction remplie par lecuculr ').
Mode de lectureMême motif même punition que
pour la FAM.Re-mêmes vadantes, Re-mêmes
sous-vadantes et Re-mêmes remar-ques L
1ère solution: le maître lit lamémoire après avoir pré-positionnél'adresse de départ de Iecture (voirfigure I b).
zène solution: le maître lit Iamémoire directement après I'ordrede lecture (voir figure I c).
Et dans cette deuxième hypothèseil est possiblê de supprimer le réseaude l'oscillateur si I'on ne veut ûueIire la mémoire.
La prochaine fois nous vous propo-serons un convertisseur 4 x A/D et 1D/4, des modules d'extensions etune synthèse d'applications des logi-ciels.
A bientôt. D. PARET
OornrTtentr l
SIOCKETet relire Lrn octet
L--ze mois , nous a l lons éLudier commenL s tocker e trel ire un octet ou une série d'octets en appuyant notreargumentation sur des exemples concrets deprogrammation de composants lz C que nouspouvons considérer comme cousins très proches : la
RAM PCF a57O, I 'EEPROIVI PCF A5B2 A et le por t
d'enIrée/sort ies numériques le PCF 857 4 lesquelscomposants sont très amplement décri ts dans cemême numéro par notre confrère D. PARET.
OUS avez appris Ie mois der-nier à écrire dans un compo-sant 12 C, à partir du 8052 AHBASIC aussi il semble tout à
fait logique de voir maintenant com-ment lire un composant (c'est Ia par-tie assembleur). Bien sûr, il vous fau-dra encore vous armer d'un peu depatience et de calme pour entrerdans Ia mémoire externe du 8052,les codes issus de notre assemblageavec ce si précieux programmeBASIC TRANSRAMROM I Maismaintenant, c'est un simple jeu d'en-fant !
Côté BASIC, nous enrichironsnotre < biliothèque D de modules( soft D, par un petit programme quinous permettrâ de lancer I'écrituredans ces composants 12 C puis de lesIire.
Côté utilitaire, il faut bien entenduavot d'orénavant, sous la main leprogramme de DUMP 12 C que nousne décrirons que peu (car conformeau précédent), mais dont nous don-
nerons Ie listing.( Mais, me direz-vous, une RAM
ou une ROM c'est bien beau maisaussi, faut-il encore que ça serve. IIexiste déjà de Ia mémoire dans Iacafie CPU, alors pourquoi en ajou-ter ? D. On peut par exemple envisa-ger d'utiliser ces petits composantsafin de stocker des poinLs de consi-gne (température de seuil, heure deréveil)... A vous de trouver I'utilisa-tion Ia plus adaptée à votre propreréalisation, car ne 1'oublions par cha-cun fait ce qu'il veut. Nous, lesauteurs, nous nous bomons à vousdonner les moyens de réalisation,I'imagination devant bien évidem-ment venir de vous.
Enfin, Ia grande nouvelle : Ie ( pa-ragraphe nouveau r est arrivé gràceà ces merveilleuses petites choses àquelques pattes : Ia gestion d'inter-ruptions car il peut ariver qu'ellesaient à nous dire par exemple:( coucou c'est moi le PCF 8574. J'aiquelque chose à vous envoyer, venez
me lire ! l.Nous avons encore ce mois-c! plein
de choses à nous dire, alors au tra-vail !
f PROGRAMMEDELECTURE
GÉNÉRALrrÉsCe programme se décompose en
deux parties : une écriture et unelecture. En effet, certâins esclavesnécessitent l'envoi et I'écriture préli-minaire d'un octet de contrôle oud'une adresse particulière avant laIecture proprement dite. Le proto-cole du bus 12 C pour un tel type deIecture combinée est précisé en figu-re 1.
Nous rappelons ici que l'espacecompris entre 3200H et 33FFH estréservé pour stockgr des octets enretour d'une lecture.
'
Les paramètres d'entrée à passerh ^ r f r r h ô l ô ^ t r r r ô ê ^ n t
- l'adresse du composant,- Ie nombre d'octets à lire.
IIs sont passés, comme en écdture,par le programme basic appelant.
L'adresse du composant à lire eststockée cette fois à I'adresse 3200H.En 3201H, on stocke un octet coûes-pondant au nombre de transmis-sions à eflectuer (ces transmissionssont des écritures). Dans les adres-ses suivantes, on trouve les octets àécdre (s'il y en a), Ie nombre delectures à recevoir, et les casesmémoires permettant de stocker cesréceptions.
Après chaque octet lu, le compo-sant receveur, qu'il soit maître ouesclave, doit envoyer un signal àl'émetteur pour lui dire rr Tu peuxcontinuer D ou ( Stop je n'ai plusfaim ! )). Dans notre procédure deIecture, c'est le micro-contrôleur quienvoie I'acquittement, d'où Ia pré-sence des appels au sous-pro-gramme ACK. La dernière lecture,elle, est suivie d'un non-acqultte-ment fabdqué par NACK.
DETAIL DU PROGRAMMEII existe des composants qui sont
activés uniquement en mode de lec-ture, et d'autres qui nécessitent uneécriture préalable (envoi d'un motde contrô1e,...). Le protocole dans cecas est particulier. Il est donc utiled'étudier un certain algorithme quipelmettra de passer ou non par uneécriture, suivant l'esclave considere.Nous nous servons, pour faire cetest, de la valeur du nombre detransmissions stockée en 3201H. Sielle est égale à zéro, il n'y a pasbesoin de passer par Ie moduled'écriture.
Ce test se deroule de la façon suivante :
L'adresse du composart, stockéedans I'accumulâteur A, est récupé-rée temporairement dans le regisLreR3, le temps de libérer A afin de lireIe nombre d'octets à transmeftre etde tester sa vâleur. Si le contenu deA est nul, Ie ptogrâmme poursuitson déroulement à partir de I'éti-quette LECTURE, sinon, l'adresserevient de R3 dans A et la procédured'écriture suit son cours commenous I'avions vu dans notre précé-dent adicle. Le protocole oblige alorsde libérer la ligne SDA pendant 4,7microsecondes entre deux transmis-sions en la laissant en haute impé-dance. Ce temps ( mort D est repré-senté par la série de NOP entre la finde Ia procédure d'éciture et le débutde celle de lecture,
Les octets lus sont récupérés dansI'accumulateur A lors de l'exécution
t4 a-À,^
CoMBIi|AISoN DES DEUX CASrECRM,'RElLECruRE
read or vnlte(nbytes+è€k.)
Figure 7
Figute 2
sous programme READ et transférésà I'adresse pointée par le registreDPTR. La retenue C récupère le bitenvoyé à chaque coup d'horloge etpar une procédure de rotation à gau-che de A, il est stocké à sa placedans I'octet en formation.
Le nombre d'octets à lire, suivispar un acquittement et stockés dansle registre R1, est égal au nombretotal moins 1 (décrémentation de Aaprès récupération du nombre detransmissions). Ia dernière lectureétant suivie d'un non acquittement(fin de transmission normale),
Il faut toujours fournir les rensei-gnements sur le composant à activercomme en écriture. Les données luessont récupérées et stockées dans lâRAM externe du 8052 AH BASIC envue d'une utilisation ultérieure.
L'organigramme de la figure 2représente notre programme de lec-ture bien mieux que quiconque I
SOUS-PROGRAMME READCe sous-programme récupère au
fil des 8 coups d'horloge, Ies bits
envoyés par l'esclave, chacun transr-tant par Ia rêtenue C de I'accumula-teur A et positionné à sa place parune rotation de ce dernier. La ligneSDA est en haute impédaûce (at-tente de réception). Nous retrouvonsI'organigramme de ce sous-pro-gramme en figure 3,
Paramètres d'entrée : néant.Paramètres de sortie : octet Iu et
stocké dans A.
SOUS.PBOGRAMMES ACK &NACK
Ce sont les sous-programmes d'ac-quittement et de non acquittementdu micro-contrôleur.
SOUS-PROGRAMME ACKComme tout receveur, le micro-
contrôleur doit envoyer un signald'acquittement après chaque récep-tion. L'esclave émetteur comprendce signal comme un ordre de retrans-mettre. C'est le sous-programmeACK qui joue ce rô]e. Cet acquitte-ment est donc ( soft D et non
r hard rr comme en écriture. t'orga-nigramme est décrit en figure 4.
Paramètres d'entrée : néant.Paramètres de sortie : néant.
SOUS.PROGRAMME NACKEn cas de défaillance dans Ia
transmission, ou, tout simplementaprès le dernier envoi, Ie 8052 AHBASIC envoie un non acquittementqui signale à I'esclave qu'il doitartrêter d'émettre.
Après Ie dernière réception, NACK(organigramme en figure 5) est doncutilisé pour faite comprendre aucomposânt qu'il doit arrêter d'émet-tre.
Paramètres d'entrée : néant.Paramètres de sortie : néant.
EXEMPLES DE SEAUENCES DELECTURES
TRANSMISSIONSû SDA, ot lit I'octet écrit, à partir
de Ia gauche: soit A1H, Dam cetexemple, c'est I'envoi de I'adressed'un composant : A0lI + 1 qui indi-que que I'on est en lecture. Les I bitssont transmis pendant I coupsd'horloge à raison d'un par coup. Legème coup d'horloge représente l'ac-quittement du composant receveur,Il se matérialise sur SDA par un zéroenvoyé par ce dernier. La ligne SDAest passée en entrée (haute impé-dance) avant l'acquittement : ce quiexplique son passage à 1. Le tempspendant lequel elle reste dans cetétat dépend de 1'architecture du pro-gramme assembleur. Voir photo 1.
PHO'TO N"7 :Bit de transmission.
NACK du micrcLorsque l'on est en lecture, c'esi
Ie micro-contrôleur qui envoie I'ac-quittement à la fin de chaque octet.Pour signaler au composant de neplus transmettre, le demier octetn'est pas suivi d'un acquittementdurant le gème coup d'horloge, La
r tRoc. DE
Figurc 2 (Fin)
n ô v d p t r , l l 0 x 3 2 0 0
n ô v d p t r ! * 0 x 3 2 0 1
n ô v d p t r , * 0 x 1 2 0 1
Râ. l iô Plânc , .oo 25
SOUS PRO6M E R€AD
sous PR06RA!1I{E A(X
r s/PRoc D.ÀcoùIî.
sûls PRom !{E rur(x
DEBUT
sDA.1
culo(
REn'RN
Flgute 3
DEBI'T
SDA=0
CLOCK
RMJRN
ligne SDA est alors stabilisée à 1puis le stop est transmis. Le coupd'horloge sur la gauche est celui du8ème lu. Voir photo 2.
PI'OTO NO 2 :NACK du ,nicro.
2€i c".ti., Plâns 5ôo
LECTURE + ACK + 1o bit de Ia zèneLECTURE
tes 8 premiers coups d'horlogecorespondent à la lecture soit : 00010110 = 22. Le composant rend lamain au micro-contrôleur et la ligneSDA repasse à 1. Le gème coup corres-pond à I'acquittement du micro-con-trôleur puis une nouvelle transmis-sion commence. tes temps entre le8èmê et le gème, le gèlûe et le ler de
Suite page 62.
l.Jne alarmesans fi l
t l
LJn svstème d'alarme vrairnenL eFficace ne peut guerese concevoi r sans de mul t ip les capteurs p laces auxpoints stratégiques du local à proteger, et raccordes aI r r . rô r -ê r r t râ lê q t t r - ^ ,^ , i - ^^+ l ' ^^^^ -nhr lo r . . la f .ac . rn n lus ouL ] | l ( = \ J ( : ] l l L l G . l ç r ) L r | . J t i l V l ù d l l t I t : t l l a ) ( = l I l L r l \ = \ - l ( J l O ' ç \ J l i V
moins sophis t iquee.La orincioale dif f iculté lors de l ' instal lat ion est le
/ . - -J ia-r , -+ r \ - r^^ ^.a.1-r^^ -al i .ant ceq r- : .a r : têu rs aI , Jd>ùdsJç \ ( l l ù ( J I t i l l , / L l t i ù ( ' d l J l ( t - l u c - r r r L v \ r ! > \ Jc r vL \ - i
la centrale.
de Ia
A liaison par infrarouges quenous avons récemment décdten'est utilisable que pour lescapteurs placés en vue directecentrale.
Nous avons donc étudié un sys-tème concurrent, basé à la fois surune transmission par radio et pari'exploitation des fils de I'installationélectdque.
I sonrowsotsSENTIERS BATTUS :
L'alarme sans fil n'est certes pasune nouveauté: on en trouve dansle commerce, et de nombreux sché-mas ont été publiés ici ou là. Engénéral, le principe utilisé est uneIiaison radio codée, puissance desémetteurs et sensibilité du récepteur
étant choisies de façon à obtenir uneportée de quelques dizaines demètres. Bien souvent, les schémasressemblent fortement à ceux utili-sés pour les télécommandes de por-tails.
Nos Iecteurs savent que nousaimons particulièrement remettre enquestion les solutions trop unanime-ment adoptées. voire même les nor-
Radio Plans sOO 27
\
l-J
mes et réglementations de toutessortes : de telles réflexions naissentsouvent des idées capables de faireleur chemin ...
Notre point de vue est qu'il n'y aqu'un fort lointain rapport entre latélécommande d'un appareil et ledéclenchement d'un système d'alar-me.
Dans le premier cas, le principalimpératif est une fiabilité totâle aunon-déclenchement : il ne serait pasadmissible qu'une porte de garagedonnant accès à toute Ia maisons'ouvre sur un simple parasite, maisen revanche, on peut accepter d'in-sister un peu si I'émetteur n'agit pasà la première sollicitation.
Dâns le second cas, c'est exacte-ment I'inverse : aucun déclenche-ment de capteur ne doit rester sanseffet, mais on peut tolérer de raresdétections intempestives. D'ailleurs,une centrale d'alarme performanteest capable de "filtrer" les déclen-chements invraisemblables, aux-quels la plupart des capteurs sonïnhr< ôrr ûôin< ê, , iôrc
Imag-inons qu'un "pirate" cherchepar tâtonnements le code ouvrantvotre porte: une bonne protectionexige un codage complexe : Dans lecas d'un système d'alarme, ce genrede tentative doit plutôt déclencherIe système que le bloquer ...
Ces quelques remarques nous ontconduit à "bouder" Ie classiqueMM 53200 utilisé par une majotiréde concepteurs : c'est un composantque nous aimons bien, notammenten matière de télécommande, maisnous avons pu constateT maintes fois
28 caoto ptans soo
qu'une simple porteuse ou un codeerroné suffit à inhiber complètementles meilleurs récepteurs du com-meïce. . .
Nous avons donc pris Ie partid'opérer en porteuse pure, commeaux temps héroTques de Ia rediocom-mande monocanal. Nous savons per-tinemment que ce choix va fairehurler tous les spécialistes : IaissonsIes faire et regardons y de plus près !
Remarquons tout d'abord gu'uneporteuse pure émise à très faiblepuissance ne peut pas causer deperturbations : nous pouvons doncnous permettre d'opérer sur des fré-quences "interdites", particulière-ment calmes. Et que I'on ne vieûrepas nous opposer la sacro-sainterèglementation, car il faudra alorcinterdire les générateurs HF de labo-ratoùe, Ies grid-dips, et même tousles récepteurs superhétérodynes,notamment FM.
Nous avons donc décidé d'opérer
dans la bande des 26 MHz (à ne pasconfondre avec celle des 27MHz).facilement accessible en interuertis-sant les quart "émission" et "récep-tion" habituellement employés éncB.
Cette bande extrêmement cahnen'est allouée ni aux radio-amateurs,ni à la radiodiffusion "ondes cour-tes", ni à la radiocommande : quel-ques canaux, que nous éviterons soi-gneusement, y sont affectés auxtéléphones sans fil agréés.
Pratiquement aucun déclenche-ment parasite n'est donc à craindre,surtout si le récepteur est à la foistrès sélectif et peu sensible.
Mais alors, comment recevoir àdistance suffisante un émetteur depuissance insignifiante avec unrécepteur de sensibilité médiocre ?Tout simplement en amenant l'an-tenne réceptrice à proximité immé-diate des émetteurs I
Les fils de I installation électriqued'une habitation constituent uneantenne très ramifiée qui se prête àmereille à un tel usage, qu'ils soientou non sous tension, Si nous utili-sons des capteurc à infrarouges pas-sifs, offtant une centaine liberté depositionnement, il sera facile de lesfixer à proximité d'une canalisationélectrigue, même encastrée dans lemur.
Mieux, leur voisinage permanentavec I'installation électrique pemetd'utiliser avec le même succès lescâbles de téléphone, d'anienne TV,d'enceintes HIFI, ou même les trin-gles à rideaux ou les tuyaux dechauffages et d'eau !
a UNEMETTEUR26MHzLe schéma de Ia figure 1 réunit un
capteur à infrarouge passif MS-02("best-seller" de SELECTRONIC) etun oscillateur 26 MHz dépouruu de
D3
Fig re 7
Figure 2 Figure 3
d'une lentiùe de Fresnel CE 24 (cesdeux pièces étant également dispo-nibles chez SELECTRONIC). La fixa-tion du MS 02 est prévue, exacte-ment au foyer de Ia lentille, par deuxqueues de résistances soudées dansIes pastilles réservées à cet effetpuis rabattues après passage dansIes oreiUes de fixation du capteur.On obtient ainsi une finition profes-sionnelle, et surtout une sensibilitéoptimale répartie en 48 zones. Lemontage peut aussi être utilisé nuou monté dans ut boitier ordinaire,mais Ia portée de détection tomberad'une douzaine de mètres à guèreplus de deux ...
t'implantation des autres compo-sants selon la figure 3 ne pose Pasde problème, sauf en ce qui concerne
Ia LED: i] faudra Ia souder "long",afin qu'elle affleure juste le trouménagé à l'avant du boîtier.
Les fils de la pile, pour leur part,traverseront Ia carte par un trou de3 mm avant d'être soudés normale-ment. La pile pourra alors se logerderrière le circuil imprimé, isolée parun carton mince. Dans certains cas,il peut être nécessaire de meuler lesrenforts du couvercle pour obtenirun bon encliqueÏage (selon les mâr-ques de piles).
. UNRECEPTEUR"PRISEDE COURANT"
Le récepteur dont le schéma appa-rait à la figrure 4 est expressémentprévu pour être relié à l'un des pôlesd'une prise de courant (neutre depréférence).
II est toutefois prévu qu'il tire sonalimentation (9 à 1 5 V.) de la cen-trale d'alarme, afin de bénéficier desa battede tampon (typiquement12 V). Sa consommation de 12 mAreste en effet très raisonnable, et nejustifie pas un bloc secteur séparé.
Le relais de sortie offre un contact"travail" et un contact "repos" indé-pendants, permettant le déclenche-ment de n'impolte quelle centrale àun ou plusieurs circuits de protec-tion.
Trois condensateurs de 47 pF ensérie (dont un au moins devra êtrespécifié pour 400 volts) prélèvent Iesignal d'antenne, directement appli-qué à l'oscillateur-mélangeur SO42P.Celui-ci est évidemment équipé duquartz "émission" cofiespondant aucanâl choisi, ei protégé par deux
tout réglage: un quartz "réception27 MHz" et une self moulée NEOCIDd,e 2,2 pt H garantissent une oscilla-tion immédiate sul la fréquence sou-haitée. Une va.leur possible est26,815 MHz, mais en fait, tout jeu dequartz pour I'un des 40 canaux de labande CB fera I'affaire.
Sans antenne, cet "émetteur" neporte guère à plus de 10 cm de Iaself moulée : c'est suffisant à proxi-mité immédiate d'un fil électrique,mais on peut I'augmenter de quel-ques dizaines de centimètres à quel-ques mètres en ajoutant un fil souplede 50 cm à 2,60 m.
Deux puissances d'émission com-mutables sont également prévues :R4 seule garantit une consommationminimale et une podée en généralsuffisante, mais mise en parallèleavec R5, elle permet de résoudre lescas un peu "limites" au prix d'unappel de courant supérieur.
Deux diodes zener, dont il estimpératif de respecter les valeurs,servent d'une part à alimenter lesMS-02 sous une tension convenableet avec une consommation minimale,et d'autre part à interdire I'allumagedu voyant de contrôle lorsque la pilecommence à faiblir, tout en restantencore capable d'assurer une émis-sion satisfaisante pendant quelquetemps.
Bien entendu, Ie schéma deI'émetteur peut être repris pouréquiper d'autres types de détec-teurs : contacts ILS, détecteurs dechocs, tapis sensibles, etc.
Le circuit impdmé de la figure 2est prévu poul entrer exactementdans un boitier GILBOX équipé
Radio Plans 5OO 29
Les dilférentes plrÉrses de ta( tnise en cofftet ,t-7) de la sortie détection/émission.2) de Ia partie réceptiot .Cette dernière pte,'.d place da''gun boîtier équipé d,u're prise dècourarrt.
La sortie du démodulateur audioest inutilisée, puisgue notre émls-sron n'est pas modulée : le relais estcommandé par la sortie normale-ment destinée au galvanomèuemesureur de champ. Ainsi, seul unsignal suffisamment fort sur Ia fré-quence exacte de réception fera col-Ier Ie relais.
Un choix peut-être fait à ce niveauentre sensibilité de déclenchement
diodes contre les transiioires sec-teur,
La très forte sélectivité indispen-sable (largeur de bande 3 kHz seule-ment) est obtenue pat I'associationd'un transfo FI et d'un filtre cérami-que de récepteur de trafic.t'amplification est assurée pat uncùcuit FI pour FM, le classique TDA1047, accordé par un second transfoFI.
(C14 pour de très grandes maisonsen zones radioélectriquement cal-mes, Rg dans tous les autres cas).En fait, il est préférable de commuterIes émetteurs les plus éloignés sur"forte puissance" etlou de les équt-per d'une antenne, que de donnertrop de sensibilité au récepteur.Selon la marque du relais utilisé, uncondensateur de valeur pouvantaller jusqu'à 470 pF poura remplacer
c14 R.t2
RL1
T2
l i î : l â t l 3â l ' . ' t
30 naoio ptans soo
t t
1rFigaûe 5 Figure 6
CondensateurCr : 100 pF Cro : 56 pF
C z : 3 3 p F C l : 1 0 p FCt:22rÊ Crz : 0 ,1 pFCq' .22 r f i Cr :0,1 pt r 'Cs : 47 pF 500 V Cu : 10 pF (ou Rc)Co : 47 pF Çts : 47 ;tFC t : 4 7 p F C r c : 2 2 0 p F
C e : 5 6 p F C n : 2 2 0 P FCs : 10 pF C1s : 470 pF (facultatif)
Transistors\ : 2N22191z : BÇ I07Circuits intégrésCh : MS-02Tz : SO42PT: : TDA 1047Autr e s s e m î c o ndu cteur sDr : zener 5,1VDz '. zener 6,2\'lDo : LED rouge 3 mmDa: 1N4148Ds : 1N4148Do: 1N4148Divers01 : guartz "réception" 27 MHz02 : quartz "émission" 27 MHzQ: : CFW 455 H MUFATAtr : self moulée 2,2 pHtz:transfo FI 455 KHz tMC 4101TOKOLs:transfo FI 455 KHz LMC 4100TOKORLr:V 23102 12V ou équivalentboîtiers, lentille, piles
DO aux bornes de Ia bobine si des"frétillements" devaient être consla-tés (réseau électrique véhiculantd'intenses parasites),
te circuit impdmé de Ia figure 5est prévu pour entrer exactementdans un boîtier "pdse de courantgrand modèIe".
t'implantatron selon Ia figure 6 sepasse de commentaire, et le réglageest extrêmement simple : dévisser àfond Ie noyau de L3, placer celui deL2 à mi-course puis ajuster sa posi-tion de façon à obtenir Ia meilleuresensibilité possible, c'est tout !
Le raccordement à la centrale nepose guère de problème non PIus:deux fils pour I'alimentation et deuxpour Ie contact. teur longueur n'estpas cdtique, mais Ie bon sens com-mande d'utiliser une pise proche dela centrale: sinon, à quoi bonemployer un système sans fil ?
Les résultats peuvent cependantvarier sensiblement d'une prise àl'autre, selon Ia topographie de I'ins-tallâtion électrique : en général, ilest avantageux de se servir d'uneprise reliée au tableau général parune canalisation aussi courte quepossible, donc de disposer la cen-trale non loin de celui-ci. Mais n'hési-tez pas à faire divers essais l
Patrick GUEULLE
,Nomenclatute.I| ̂ é"r"onr""l R ' : ' 1 0 0 k Q R r : 3 3 Ql R : 5 6 k Q R s : 3 9 0 QI R r : 1 0 k Q R g : 3 , 3 k Ql R a : 2 7 0 O R r o : 3 , 3 k Ql R 5 : 1 8 0 O R r r : 1 , 8 k Q
I R o : 4 7 9 R n : 2 2 0 k Q (ou Cu)
Radio Plans 5Oo 31
\
L-l -
tJNEOOI.JTELJRSUPPLEIVENTAIRE
\- luoi de plus habituel que de part iciper à uneconversation téléphonique en ut i l isant l ,écouteursupplémentaire ou le haut-parleur du poste principal ?
Hélas, i l n'y a pas d'écouteur supplémentaire surles "publ iphones" équipant les cab ines s i u t i les envacances ou en déplacement.
Ne renonÇons pas pour autant à la commodité dela conversation à trois, et emportons notre écoureurpersonnel dans nos bagages I
Bien évidemment, i l n'est pas question de brancherquor que ce soit sur le matériel appartenant à FRANCETELECOM, aussi devrons nous recourir au couplagemagnétique, qui dispense de toute nécessitéd'agrément.
32 aaaio ptans soo
. LECAPTAGEMAGNÉTIOUE
hacun connait les "amplifica-teurs téléphoniques" qui,munis d'un capteur magnétique, permettent I'écoute sur
haut-parleur des comrnunicationstéléphoniques sans aucun btanche-hôn+ é lô^ f r i ^ r ra
Le capteur, qu'il soit PIat ou àventouse, est une simple bobine ànoyau ouvert (noyau à fuites) placéeau voisinage du transformateur deligine du poste.
tes fuites magnétiques du transfosont captées par Ia bobine, qui déli-vre un niveau audio sensiblementéqal à celui d'un micro dynamique,sàur une impédance comParableLes mêmes capteurs sewent doncaussi à enregistrer les communica-tions sur magnétophone.
En fait, il n'y a Pas que le transfode ligne qui raYonne un chamPmagnétique et c'est heureux, ,carcelui des publiphones est entourdans les profondeurs d'un véritablecoffre-fort ! Avec un amplificateur atrès grand gain, on arrive Presque acomprendre une conversatlon enDosant une tête de magnétopnonesur le câble de ligne ou Ie cordon ducombiné, mais il Y a PIus Pratique
tes écouteurs équipant les combi-nés (de publiphones ou de Postesd'abonnés) comportent une bobinechargée de fâire vibrer une paletteaimantée attelée à Ia membrane. Làencore, le circuit magnétique n'estpas totalement fermé, et il se produit
des fuites qu'il est très possible d'ex-ploiter.
Mieux encore, Ies cabines Pourmalentendants, de plus en PIus nom-breuses et reconnaissables à un pic-togramme on ne Peut PIus explicite,sont équipées de façon très palticu-lière :
Dans Ie logement de I'écouteur ducombiné est ajoutée une bobine cir-culaire plate, sans noyau, montéecoaxialement avec I'écouteur etbranchée en para.llèle avec lui. Lechamp rayonné par cette bobine(disponible d'ailleurs chez les audio-prothésistes) peut être capté par lesaDpareils de surdité, et évidemmentauisi par un capteur à ventouse !
Figrure 7
L'affaire est donc entendue : danstoute cabine publigue, il est possiblede capter un champ magnétlqueplus ou moins intense au voisinagede I'écouteur du combiné, qu'il suffitd'amplifier fortement pour pouvoiralimenter un écouteur "sans fil".
On utilisera soit un capteur à ven-tousè du commercê (facile à faireadhérer sur le côté du combiné), soitcarément une bobine LEM Pourmalentendants (peu coûteuse) queI'on placera entre Ie combiné etI'oreille.
L'AMPUFICATEURETL'ÉCOWWR:
On peut songer à utiliser à Peuprès n'importe guel type d'écouteur,depuis Ie casque HIFI jusqu'à I'insertd'oreille en passant Par un Petrthaut-parleur sous-alimenté C'estcette demière solution, la plus éco-nomique, que nous avons chotsrd'utiliser sans pour autant condam-ner les autres !
La figure 1 montre avec quellesimplicité un unique LM 386 Peutjouer à la fois Ies rôles de préampliet d'ampli "de Puissance" : câbléavec un gain maxirnum (200 grâce àC2 qui shunte une résistance intemede contre-réaction), iI foulnit suffi-sammênt de puissance à un haut-Darleur de 5 cm (16 ou I ohms) Pouràffrir un son fort et clair dans toutesles situations. Dans certains cas,c'est même un peu trop fort, d'oil laprésence d'un potentiomètre ajusta-
Radio Plans 5OO 33
\l l
ble permettant d'adapter Ie gaindéfinitif aux performances du cap-teur utilisé.
L'alimentation se fait sous g volts,Ia consommation d'à peine 4 mAgarartissant de nombreuses heuresd'écoute avec une simple pile minia-IUIC.
. REALISATIONPRATIQUE:
La réalisation de Ia partie électro-nique est extrêmemert simple : ilsuffit de graver le circuit impdmé dela figure 2 et de le câbler conformé-ment à la figrure 3. Le clip de pilen'est pas un modèle du commerce,équipé de fils souples, mais doit êtrerécupéré en dessertissant une pileusée : on le soudera dgidement surla carte à I'aide de deux queues derésistances.
Cette petite carte et la pile tien-nent parfaitement dans le fond d'unboîtier plastigue RETEX POLIBOXRP 1, laissant au dessus une placetrès suffisante pour le HP de 5 cm. Ilsuffit de meuler légèrement les glis-sières intenes pour que Ie HP secornce entre Ie couvercle {préalable-
ment ajouré) et celles-ci. Un calagesupplémentaire pouna avantageu-sement être réalisé avec quelqueschutes de mousse de plaiique.
L'interrupteur unipolaire pourraêtre d'un type quelconque, de préfé-rence protégé contre les manæuvresmtempestlves : nous n'avons pasvoulu installer de voyant, dont laconsommation aurait dépassé cellede I'ampli lui-même !
Une bonne solution consiste à rac-corder Ie capteur pat une prise DIN :deux broches court-circuitées dansla fiche peuvent se charger de "met-tre le contact", et il suffit de Iadébrancher pour mettre la pile aurepos.
D'AUTRES APPT,ICATIONS :Parallèlement à l'écoute à deux du
combiné d'une cabine publique, cepetit appareil peut servir à mettreen évidence toutes sortes de champsmagnétiques audio-fréquence : ceuxrayonnés par les bobines mobiles dehaut-parleurs que I'on aimerait biencompter derière le tissu d'uneenceinte, ou par des transformateurs
soupçonnés au cours d,un dépanna-ge. La fréguence "secteur', de S0 Hzest égal.ement padaitement audiblesous la forme d'un fort bourdonne-ment : ou pouûa ainsi ,,sonder,, destransfos d'alimentation, desmoteurs, ou même des câbles par-coums par un courant qui n'a pas àêtre bien intense.
Enfin, en remplaçant Ie capteurpar un simple fil, on recevra fort bienIa bande FM au voisinage immédiatdes émetteurs un peu (ou beaucoup)trop puissants ! Un moyen efficacepour localiser les voisins gênantsavant de porter plainte à TDF !
Patrick GUEULLE
NomenclatureRésistances DiversR1 : pot ajustable Pile 9 VCondensateurs CIip de pile 9 V
cL : 100 pFradiat lll:'jl1Y::*:' : -1:..I!-axla]................ . Boî;ier RETExuJ ; ruu p[I raolar RP 1Circuit intégxé Capteur télépho-Ch : LM 3g6 nique à "ventouse"
ffiFigure 2
Figttè 3
34 Racio Ptans 5oo
lL Raok' car[e AD
La carte préparée le mois dernier (équipée de son
PIO) , va désormais pouvoi r s 'expr imer : nous a l lons lu i
ad jo indre un système d 'acquis i t ion complet ,nécessitant la mise en ceuvre d'un convert isseuranalog ique d ig i ta l .A ins i , à par t i r d 'une source audio c lass ique (pr ise
casque de magnétophone, l igne haut n iveau, e tc ' )noÙs t racerons en temps rée l , sur l 'écran d 'un CPC, la
courbe dynamique d 'une v ingta ine de secondes de
musique, avec deux gammes au choix . 25 oa 50 dB'
Ceux d'entre \. /ous qui réal iseront cette carte r isquent
de passer de longues heures à " regaroer se tracer
leurs morceaux favoris ' , et verront desormais cequ 'on nomme - dynamique - l
Fadio Plans soo 35
.rrt Hâi vous êtes I'heureux posses-seur d'un tlaceur de courbesgenre BRUEL & KJAER type3302 équipé d'un potentiomè-
tre 50 dB, et que vous avez eu unjour la curiosité d'y injecter vosmodulations les plus précieuses, cen'est sans doute pas I'intérêt desmesures qui vous a fair stopper, maisle défilement exagéré de la bobi-nertre,..
Pour un investissement minimum,vous allez pouvoir tracer des courbessans fin sur votre écran de CPC, etce à raison de 14 mesures parseconde (environ), soit 268 mesurespar écran.
Nous donnerons quelques exem-ples de résultats significatifs aumoyen de hard copies, mais elles neremplaceront jamais l'obseffation entemps réel que nous vous proposons.
. PRINCIPESDans les précédents numéros,
nous avons vu comment "sofiir" dessignaux de commandes du CPC pourqu'ils agissent en tout ou den surdes récepteurs extérieurs (32 t). Lamise en place du PIO 8255 permetd'envisager également de "sortir",mais aussi de "recevoir" des don"nées en provenance de périphéri-ques. C'est ce qui nous concerne ici.
Examinons ensemble le processus
liant nos deux entrées audio au8 2 5 5 :
Dans un premier temps, nousferons une 'monophonisation " deces deux entrées, ce qui conduira àtraiter la somme L * R comme nousI'avons précisé le mois demier. puisnous convertuons ce signal alternatifen un signal continu représentatifque nous soumettrons à un conver-tisseur analogique digital, lequel sechargera de Ie traduire en un MOTde 8 bits, direciement compréhensr-ble par un port du 8255 programméen entrée.
Ce sera au soft d'intercréter cesMOTS âfin d'en tirer des conclusionssul d'autres périphériques (dansnotre cas précis : l'écran du CPC),
Cet organisme simple conduit àprendre queques précautions dansla réalité, comme le prouve Ie sché-mâ.
. LESqHÉMANous avons isolé à la figure 1 la
podion de schéma qui nousconcerne aujourd'hui. II est à noterdès à présent gu'elle met en évi-dence les composants à ajouter surla carte AD, sauf le 8255 rappelépour mémoire dans un cadre en poin-tillés.
Les deux modulations audioenlrant en A et B sont immediate-
ment sommées dâns I'inverseur IC7dont Ia sortie est traitée par undétecteur RMS dbx 2252 qiri fo:d;trlitune tension continue (en brochen" 7), Racine de Ia Moyenne des car-réS (mnémonique douteuxl), J,esFidèles connaissent bien désormais
417
R3l
Figure 7
36 Raoto ptans 5oo
ce détecieur RMS parfaitementimpodé des USA par SCV AUDIOrdb, axee oes tsraDtes,ZI PARIS NORD 2, société qui "assu-re" depuis de nombreuses années ladistdbution de ces pièces pour laplus grande joie de nombreux lec-xeurs (dont nous sommes!!).
Les nouveaux venus pouffont seréférer à nos précédentes publica-tions ou encore à la NOTE D'APPLI-CATION 110 de dbx.
L'essentiel nous concemant ici, seIimite à savoir que ICrr promet destensions positives et négatives sursa broche 7 telles que pour desniveaux compris enI|e - 72 et
15 dB (dispersion maxi, 0 dB étantconsidéré comme 775 mV dans600 O) on obtienne 0 V dc, avec pourloi 6 mV/dB. Ouand un niveau eslinférieur au seuil du 2252, la tensronproduite est positive. Supérieure,elle est négative. Ce qui est padaitdâns certains cas, mais pas ici: Ieconvertisseur analogique digital quiva suivre ne veut traiter que destensions positives par rapport au0V, ce qui conduirail au premierabord à ne représenter que lesniveaux inférieurs à - 12 ou- 15 dB.
Ce serait vralment dommage dese limiter à cela, suftout qu'il estpossible aisément de gagner unevingtaine de dB grâce à I'artifice sui-vânt : la sortie de ICrl va transmettreson travail à ICro qui joue un tdplerôle :
1) il se charge d'inverser Ia pola-dté de Ia tension afin de Ia rendrecompatible avec Ie CAN (Converti-seur Analogique Numérique),
2) au moyen d'une paile de diodesdans la contre-réaction on s'assure
que Ia tension envoyée au CAN ne>cr4 laur4rJ ucvdLrv ç ,
3) il va servir également de som-mateur pour ajouter à la tensronissue de lCrr, une tension négativefixe injectéê pâr AJ? et Ra1.
Cette dernière mesure a pourconséquence de reconsidérer le 0 Vdu 2252 et de le décaler de tellesoÉe qu'on obtienne 0 V en sortiede ICro pour + 5 dB au lieu de - 15.
En effei, pour + 5 dB, Ie 2252 Yafournir environ * 120 rnV, si l'onadditionne - 120 mV par AJ7, onobtient bien 0 V en sortie de ICro.Ouand le 2252 rcçoit - 15 dB, ildonne environ 0 V mais comme nousadditionnons - 120 mV dans uninverseur, c'est + 120 mV qu'onretrouve en sortie de ICro. Dernierexemple, pour - 46 dB, le 2252 vafoumir - 186 mV auxquels on ajoute- 120 soit 306, inversés par ICrodonc 1 306 mV.
S il vous prend Ia curiosité de diviser 306mV par les 255 pas de
mesule d'un convedisseur I bits,vous obtiendrez 1.2 mV. Sachantqu'il nous en faut 6 pour rr définir rr1dB, vous constaterez que Pourcette gamme de 50 dB on arrive bienà une résolution de 2/10e de dB.
Faisons mâintenant Ie calcul Pourla gamme de 25 dB (25.5 très exacte-ment) : à 20.5 dB le 2252 Produit( 20.5 + 15) x 6 - -33 mV quiajoutés à Ia compensation de AJrdonnent (- 33) + ( 120) - 153,divisés par 255, on obtient 0.6 mVpar point, soit une résolution de 1/10e de dB dans cette gamme de25 dB.
Ces calculs se basent sur un 2252dont le seuil de basculement serait à- 15dB pile, mais ne sont pas àremettre en cause dans la mesureou AJr est chargé de compenserexactement le 2252 en circuit.
Ne quittons pas ICro sans mention-ner que nous avons implanté ici unLM 607 de NATIONAL SEMICON-DUCTOR, auquel nous avons fait I'in-jure d'ajouter un réglage d'offset...En effet, ce circuit se distingue parune Lension d'offset particulière-ment faible, et notre réglage a per-mis d'obtenir (sâns tirer la langue),un 000.0 mV STABLE sur un multi-mètre en gamme 200 mV. A retenirpour les cas délicats I
Après un lissage Par C24, nousvoici prêts à aborder Ia conversionproprement dite. Pour cela, nousallons vous convier à obsewer d'au-tres figures, nous reviendlons à Iafigure 1 plus tard.
LACONWRSIONADParmi Ies convertisseurs disponi-
bles sur Ie marché, nous avons faitun choix purement économique, quisatisfait néanmoins pleinement nosexigeances. Nous parlerons donc du
CLOCK
u]fTR
Figure 2
Radio Plans 5OO 37
ffiËÊcl.K RDOotD2D3D4D506o'lDt5.6N0
Figure 4
ADC 0804 en particulier, en signa-lant toutefois qu'il existe plusieursfamiiles de convertisseurs travaillantde façons différentes : à rampe (sim-ple, double ou guadnple), à comp-teur (décompteur), parallèle, àapproximations successives, etc.
Notre choix s'est porté ici sur unconvertisseur 8 bits à approxima-trons successives (malgré un amourfou pour Ies convertisseurs parâllè-les...), dont nous allons voir les pnn,cipes de fonctionnement.
Le synoptique du ADC 0804 esrvisible fignrre 2. La structure estaisément compréhensible: uneentrée différentieue attend le signalà convertir. Une tension de référence(Yref/2) va permettre de déterminerl'étendue des mesures et par voie deconséquence la résolution de chaquepas. une entrée cs (barre) s'impa-tiente de recevoir un état 0 indiquantau convertisseur que le "micro va luiparler". WR (baûe) enverra un signalpour débutêr une conversion, INTR(barre) enverra un signal en fin deconversion, et RD (ba e) permettrade transférer le résultat sur le port8 bits. Nous ne parlerons pas deI'horloge qui bat la mesure...
Mais comment fonctionne I'ap-proximation successive ?
C'est très simple comme va I'illus-trer la lignrre 3, mais ne perdez pasde vue la figure 2 !
On va décrire le mot correspon-dant à la tension analogique en8 passes successives, consistant à"remplir" I'octet bit à bit en com-mençant par le poids fort, Pour cela,on compare en premier lieu la ten-sion d'entrée avec la moitié de latension de référence totale, soitVref./z. Le résultat est-il > ou = ? Sic'est le cas, MSB (bit de poids forr)est porté à 1, et Ie convertisseurdigltal ana.logigue intégré à notreCAN va transmettre à la prochaineévaluation, une "charge" de Yrell2au comparateur intégré. Si le résultat
est <, MSB est polté à 0 et la ,,char-ge" est nulle.
Voyons cela simplement au moyende I'exemple donné figure 3. Imàgi-nons cnre Vref soit portée à 2b6 mVet que la tension à convertir sôit de205 mV. Examinons le chemine-ment : Vref/2 (128 mV) foumir d'em-blée au convertisseur D/A intégréune donnée permettant de comparerIe signal d'enrrée (20S) à 128. Laquestion est alors posée: 20S est-il) ou = à 728 ? OIJI, donc MSB = 1,A la passe suivante, on va effelctuerla comparaison entre le reste (20S-128) er (\,lre1l2)12 so1t77 et 64.
mais pourquoi nepour vérifier uneconversion binaire ?
profiterplus la
Le principe étant supposé com-pds, on peut retoumer rapidement aIa figure 1 et observer le changementde gamme offert par SWr qui com-mute deux tensions Vref/2 différen-tes, et prévient égâlement Ie port Cdu 8255 de la modif. Cefie demièreattention fera que le soft reconnaîtraIa gamme EX 25 ou EX 50 en fonc-tion de l'état de SW1 au moment du"RUN",
Un dernier regard sur le figu-re 4(brochage de IC12), et nous vorcrprêts à compléter notre carte AD.
I nÉausnrtowLa fignrre 5 présente I'implanta-
tion de la carte jusqu'à ce jour. Lesfonceurs initiés nous pardonnerontde leur forcer le pas au rythme dudébutant.La mise en place des composantssur circuit double face trous métalli-sés ne posera aucun problème er
pas enfois de
Pour ce faire, Ie convertisseur D/Ainteme sait déjà que 128 fait partiedu résultat, et il y ajoute (pour voir!)64, ce qui revient à dire 205 est-ilsupédeur ou égal à 192 ? Affimarif,donc le 2e bit passe également à 1.Pour Ia 3e passe, on cumule Ies résul-tats précédents et l'on ajoute ((Vref/2)12)12, ou \lrcfl8 = 32. Cette fois Iaréponse ) ou = est NON et le bit 3passe à 0, sans "charge" supplérhen-talle.
Nous n'allons pas passer en revueles huit approximations successivesmais nous vous convions à brenregarder l'évolution de la figure 3,avec la védfication incluse dans Iecadre en pointillés. Notre exempleVref = 256 mV n'est pas innocent,
demandera peu de temps. La figu.re 6 éclaircira le câblage du doubleinverseur SWr, la figmre 7 quant àelle, donnera une idée de Ia gravurede façade.
BÉGLAGE s P RÉLTMINAIRESIls sont au nombre de trois :1) Régler la symétrie dt 2252 au
moyen de AJ6 en procédant ainsi :injecter en IN (L +R) 100H2 à775 mV, et faire en sorte d'obtenirun signal à 200 Hz sur 7 de ICrr. Sivous n'avez pas d'oscilloscope, met-tez AJo à mi-course.
2)Mettre le curseur d'AJz côté 0 V,3) Mettre les enïrées A et B à 0 V
et ajuster AJe afin d'obtenir le zérole plus parfait sur TPr (offset de ICro).
, . t -
1 3 -
1 3 -
t t -
5 -
.13 >0
. - ! <0
. 128 .124
"^Figwte 3
38 naoio Plans 5oo
Figute 5
A ce stade, ies softs vont permet-tre de régler la calte en visualisantles résultats à l'écran du CPC.
LA VÉRIFICATION "SOFT"Un petit programme BASIC va
nous servir d'une palt à tester Ie bonfonctionnement de la chaîne deconversion, côté logique (adressagedu 8255, commande du converisseurA/D, lecture des données), et d'autrepart à pafaire les réglages audio decette même chaîne.
Tout d'abord, il convient de rappe-Ier les différentes phases nécessai-res à l'obtention d'une valeur en dB,représentant le niveau du signal enentrée :
1) Programmation du 8255 et ini-tialisation des ports.
2) Commande de début deconversion du signal analogique.
3) Attente de fin de Ia conversion.4) tecture de la donnée.5) Calcul de Ia valeur en dB. La
formule appliquée dépendra deI'échelle de la mesure (25 ou 50 dBd'excursion) .
pÀD
rll
2n
E X c
50
0uï
Figljre 7
Radio Plans SOO 39
ffiË(â
Bien entendu, Ia phase 1 ne sera àeffectuer qu'une seule fois, on bou-clera ensuite entre 2 et 5. Maisvoyons plus en détails chacune deces étapes.
La programmation du 8255consiste à écrire un mot de com-mande sur son port de contrôle. Ladéfinition de ce mot a été donnée lemois dernier, et si vous avez fait lepetit exercice proposé, vous avez duaniver à 1001 1000, c'est à dire 98 H(où H signifie hexadécimal).
Au demarrage (après un RESET),le 8255 initialise tous ses ports à 0,mâis ce n'est pas tout à fait ce quenous voulons; nous voulons mêmeexactement le contraire !
Voyons le port B : ii servira dès lemois prochain à piloter des VCAspar I'intermédiaire d'un conveftis-seur digital/analogique. Rappelonsque 0 V sur la broche de commandede ces VCAs (0 binaire en sortie duport B), correspond au gain unité. Iest beaucoup plus sage, dans unpremier temps de "couper" la modu-lation afin de ne pas assassiner uncasque imprudemment relié à la sor-tie, alors que I'entrée est encoreindéfinie. Le polt B recevra donc dèsmalntenant Ia valeur 255 (atténua-
40 n"oio Ptans 5oo
tion de 85 dB), en prévision desres liaison.
Au tour du port C : ces bits 0 et 1vont commandel
mande. Pour résumer: écriture deFDh sur Ie port C {bit 1 à 0) suiviimmédiatement de FFh (bit 1 à 1)pour démarrer une conversion,
Notre convertisseur signale la finde son travail en plaçant la brocheïNTR à 0 (eue passe à 1 en début deconversion). Le bit 4 du port C reçoitcette infomation (n'oublions pasque son quafet fort est programméen entrée). II nous faut donc "guet-ter" le basculement de ce bit. pourcela, on lit le poft C et on apphqueun masque à la donnée reçue : puis-que c'est le bit 4 qui nous intéresse,I'opération (polt C AND 16) est touteindiquée. En effet, 16 s'écdt0001 0000, donc tant que le résultatde notre opération est égal à 16, celasignifie que le bit 4 est à 1 et enconséquence que le conveftisseurest occupé à analyser notre signal.Ouand ce résultat sera différent de16, nous pourrons passer au paragra-phe suivant... Mais pas avant car ladonnée lue ne serait pas significati-ve.
Pour la lecture du résultat de notreconversion, les mêmes remarquesconcemant I'interfaçage de I'ADCavec un pP s'appliquent : il nous fautsimuler le signal RD (barre). C'est aubit 0 du port C que ce rôle est dévo-lu : on I'écrit à 0, on lit notre donnéesù Ie port A, et on replace Ie bit 0 à1, En fait Ia broche RD est une com-mande de haute impédance du busde donnée de notre convertisseur.Autrement dit : écriture de FEh surC (bus valide), lecture du port A,puis écriture de FFh sur C (bus enhaute impédance).
L'obtention de la valeur en dB àpartir de la donnée binaire lue cors-titue le demier maillon de Ia chaine.Admettons que notre excursion sortde 25 dB (+ 5 à - 20). Norons toutd'abord qu'un signal maxi de * 5 dBdonnera une donnée égale à 0, etqu'à I'inverse, un signal à - 20 dBrenverra 255. La formule comporteradonc un (255 - !a donnée) afin de"remettre tout cela à l'endroit".Ensuite, voyons l'échelle de mesu-re : nous avons donné 25 dB mais enfait, il est beaucoup plus pratique deprendre 25,5 dB car 25,5/255 -0,1 dB tout juste. Comme la limitesupérieure est fixée à + 5 dB, lalimite inférieure sera de5 - 25.5 = - 20.5 dB. Pour I'excur.sion de 50 dB, nous prendrons 51.En effet : 51/255 - 2/10e de résolu-tion et la valeur minimale passe à5 - 5 1 = - 4 6 d 8 .
signaux RD (baûe) et WRI'ADC 0804. Ces signaux étant 6lctifsà 0, il convient de les mettre à 1 pourne pas déma[er de conversion aiorsque nous ne sommes pas edcoreprêts à en lire Ie résuitat. Le pôrt Creçoit donc lui aussi ia valeur 2bb :tous ses bits sont à 1 (en fait, les bits4 et 7 ne sont pas concernés puisqueIe quârtet fort est configuré enentree).
Le port A, en entrée également,n'a pas à être initialisé.
Pour débuter une conversion, lesignal WR (barre) doit être activé.Celui-ci étant relié au bit 1 du pott C,on envoie Ia valeur binaire t 111 1101sur ce port. II est important de nbterque I'ADC 0804 est prévu pour êtreinterfacé directement à un micropro-cesseur: dans ce cas, le uP débuteIa conversion en effectuant simble-ment une écriture vers Ie convertis-seur. Cela corespond donc à uneIMPULSION sur WR, et non à unniveau 0 V constant. La consé-quence est que nous devons simulercette impulsion en forçant WR à 1aussitôt après notre première com-
; l e s) d e
l 0 I E S T - À O . B A S | À C S o f t r 9 g 9 *2 030 DEFINI A_Z
5 0 P o r L A = a d r o ' I N
60 Por tB=ad+1 , OUT70 Por tC=ad+2 , IN /OUT'a0 Pc t r l :ad+3 ' CONTROLE9 0 O U T P c l r t . E 9 S M o L d e c o n l r o t e100 OUT Por tB ,aFF ' In i t pôr t B : a l renuar ioh mâx imumt10
9UT po. tc ,aFF ' tn i t por t c : commande p" . O l " o -
1 3 0 O U T P o r t c , a F O : O U T p o r t c . & F F ' i m p u t s i o n d e b u t c o n v e r s j o n1 4 0 W H I L € ( I N P ( P o r t C ) A N O 1 6 ) = 1 6 : W Ê N D1 5 0 O U T P o r . C . ê F E : d : I N p ( p o r L À ) : O U T p o r t C , r F F , L e c ! u r e d o n n e e1 6 0 l F ( I N P ( P o r r C r A N D 1 2 8 ) : 1 2 A r H E N I A O1 7 0 P R T N T d , t t 2 5 5 - d ) / 5 ) _ 4 6 : G O T O 1 3 0 e { c u r s . o n ) o1 4 0 P R I N I d , ( ( 2 5 5 - d ) , / 1 0 ) - 2 0 , 5 : G O T O 1 3 0 ' e x c u r s i o n 2 51 9 0 '2 0 0 ' * ' + F j n d u r l s t i n g r * .
Figure I
r 0 ' o B . B À S * A C S ô f t 1 9 S 9 *2 0 '3 0 O U T - & F A € 3 . & 9 8 : O U T & F A E 1 , & F F : O U T & F A E z , & F F4 0 I F ( I N p ( & F A Ë 2 ) A N D 1 2 8 ) : 1 2 8 l H g N n U N t e X e s . e e s , , E L s Ê
R U N , , E X 5 O . S A S -
Figure g
1 0 E Y s O . B A S r A C S o . L 1 9 a 9 *4 0 D E F F N d B t = ( ( 2 5 5 - d ) / s ) - 4 68 o c L s , t 1 : x : t o 4 : M o v E 1 0 4 , 3 0 7 : D R A W 6 4 0 , 3 0 ?1 20 oldy=y :y=(2ss-d)+77? ! 9 I f ! . r T H E N s A v E s a v $ + R T G H T $ ( S T R $ ( n ) . 1 ) + , . E 5 0 , 8 , & c o o o , & 4 0 o o : n : n + r :3 4 0 r 4 o v E 3 9 , 3 5 0 : ô R A W R 1 6 . O : M O V E R ? , 6 : T A G3 6 0 R E S ï O F E 4 1 0 : F O R j i - 4 5 T O 5 S t E p 5 : M O V Ê 3 9 . 8 2 + ( 2 5 5 _ { { 1 + 4 6 ) ' 5 ) )370 '1 r 1 0 0 A T A " + 5 , ' , 0 d 8 " , " - 5 , " - 1 0 " , " - 1 5 " , " _ 2 0
"
" _ 2 5 , " _ 3 0 ' . " - 3 5 " , " _ 4 0 , . _4 4 0 L O C À T E ô , 1 : p R I N T C H R $ ( 1 8 3 ) + A D - 5 0 - , : W I N D O W * 1 , 1 4 , A O , 3 , 2 2
La formule générale s'écdt :I (255 - donnée) x résolutionl1 valeur minimale.
Dans chaque cas, et en simplifiant,on obtient :- Excursion 25 (+ 5 à - 20,5): ((255 - d)/10) - 20.6- EXCUTSIOn CU (+ C a +O)
: ((255 - d)i 5) - 46où d - donnée lue sur Ie port A.
Enfin Ia distinction entre les deuxéchelles se fait en lisant Ie bit 7 duport C, positionné par I'inverseur. Bit7 àL = EX25,b i t 7 à 0 = EX 50.
TEST.AD.BASVoyons maintenant le programme
de Ja figure 8, pour traduire cesconsidérations en langage informati-que. Ceci va être d'autant plus facileque nous savons exactement ce quenous devons faire.
La carte AD est adressée à partirde FAE0 et c'est pourquoi une vada'ble "ad" (pour ADresse) reçoit cettevaleur en ligne 40. N'oubliez pas dela modifier si vous avez choisi d'au-tres adresses poul la carte. Ensuite,nous affectons à 4 variables dont lesnoms sont significatifs, leurs valeursrespectives: FAE0 pour Ie port A,FAE1 pow le B, FAE2 poû le C etenfin FAE3 pour le registre de con-trôle du 8255. Nous sommes mainte-nant prêt à remplir Ie "cahier desn h a r a a c ' r w r r h l , i e h â , , t
On envoie Ie mot 98 h sur le Portde contrôle, Cela signifie pour le8255 : port A et haut du port C enentrée, port B et bas du Port C ensôrtie, le tout en mode 0.
Comme préw, on commande I'at-ténuation maximum en écrivant FFhen B, et on inhibe la conversion ParFFh en C (lignes 100 et 110), EnIigne 130, on provoque I'impulsionde début de conversion en passantbrièvement la broche WR (baûe) duconvertisseur à 0.
On en attend ensuite Ia fin; laboucle WHILE/WEND "tourne enrond" jusqu'à ce que le bif4 de Cpasse à 0 (broche INTR de I'ADC).
Arrivé en ligne 150, il faut validerIe bus de données du convedisseur(bit 0 de C à 0), Iire Ia donnée sur Ieport A, puis rétablir Ia haute impé-dance.
La lecture de l'échelle intervienten 160, où I'on passe directement enligne 180 si elle est égale à 25 (bit 7d e C à 1 ) .
Dans I'autre cas (échelle 50), I'exé-cution se poursuit en 170. La donneeIue est affichée, ainsi que sa cores-nanr lanno on r iR
Le programme reboucle alors en130, pour Iancer une nouvelleconversion. Vous pouvez basculerl'inverseut d'éshelles en cours defonctionnement, afin de vérifier queIa correspondance est réelle (dans lazone commune de - 20.5 à + 5dB,bien entendu).
Pour stopper I'exécution, utilisezESCAPE.
LES DERNIERS RÉGLAAîSIl est aisé âu moyen de TEST-AD
de régler coûectement AJr. Pourcela, il suffit de Iancer le soft, d'injec-ter + 5 dB (1.378 V, t kHz) en A + Bet de faire en sofie d'olltenir 0 àI'écran.
Injecter ensuite - 20,5 dB (72 mV),passer sul Ia gamme EX 25 (SWr enhaut) et obtenir grâce AJz 255 et- 20,5 dB à l'écran.
Fnisser l ' iniection à - 46 dB(3,88 mV), basculer SW1 et obtenir255 er - 46 dB à I'écran au moyende AJr.
C'est terminé.NOTA: Si vous voulez parfaire "au
petit poil" le 0 dB, c'est AJr qu'ilf . , , .1 ïâ ^ôâ , , f inêr
EX25-8X50Les programmes que nous allons
vot ont pour but de visualiser surl'écran de votre CPC un vu-mètre etla courbe dynamique du signal pré-sent sur I'entrée de Ia carte AD,
Nous disons LES programmes carils sont trois : un "lanceur commun"qui va reconnaître I'échelle demesure utilisée, et chargel le modulecorrespondant, EX 25 ou EX 50, Ras-surez-vous, tout ceci ne va pas vousprendre trop de temps. En effet, lelanceur DB.BAS est en figure 9.Comme vous pouvez Ie voir, il necompofie que 4 lignes (et encore, il ya deux BEMs) |
Vous aurez noté que les référencesaux ports du 8255 ne se font plus parI'intermédiaire de vadables, maisque I'on fournit directement }esadresses concetnées, En effet, I'undes objectifs à atteindre, outre laprécision, est Ia rapidité de traite-ment du siqnal. En évitant des
50 GoSUB 31 0 : savô= cou rbe : sav :o : n :0 : dmax :255 : dm in :0 : y :52 : o l dy=y60 k$=INKEYû: IF k$< >CHR${ 224 ) THÊN 607 08 0 c L S * 1 : x = l 0 4 : M O V E 1 0 4 , 2 8 2 ; D R A W 6 4 0 , 2 8 29 0 O U T & F A E 2 , & F D : O U T & F A E z , & F Fl O O W H I L E ( I N P ( & F A E 2 ) A N D 1 6 ) = 1 6 : W Ê N Ô1 1 0 O U T & F A E 2 , & F E : d : I N P ( & F À E o ) : o u T & F A E 2 , & F Fl 2 O o l d y = y : y : ( 2 5 5 - d ) + 7 a1 3 0 I F d > d m i n T H E N d m i n = d : P R I N T $ 2 , u s I N G ' â * + + . + ; F N d B I1 4 0 I F d : 2 5 5 T H Ê N y = 6 2 : d m i n = O1 5 0 I F d = 0 T H E N y : 3 5 0 : L O C A T E 7 0 , 1 : P R I N T " o v Ê R : G o T o 1 7 01 6 0 I F d < d m a x T H E N d , n a x : d : P R I N I * 3 . U S I N G + + * + . { : F N d B l1 7 0 M O V E 4 , O ] d Y + O : T A G : P R I N T ' ' " : : M O V E R 8 , 0 : P R I N T
' ' ' :
1 8 0 H O V E 4 , y . 6 : P R I N T c H R $ l 1 s 4 ) I : M o v Ê R a . O r P R I N T C H R S ( 1 5 4 ) ; : T A G O F F1 9 0 l O V E < , o l d y : \ : ^ + 2 : O R A W \ , y2 0 0 1 F l N h Ê Y ( 1 0 ) = 0 _ H E N G o s u a 2 a o2 1 0 I F I N K E Y ( 3 ) = 0 T H E N G O S U B 2 9 0? ? O I F I N K Ê Y ( 6 ) = 0 T H E N W H I L E I N K E Y { 9 ) < > o : W E N D : G O S U B 2 4 0 : G O Ï O 8 02 3 0 I F I N K E Y ( 0 0 ) = 0 l H Ê N s a v . - 12 4 o I F x < > 6 3 8 T H E N 9 0 I2 5 0 I F s a v Î H E N S A V E s a v $ + R l G H T $ ( s T R ô ( n ) , 1 ) + " , E 2 5 " , 8 , & C 0 0 0 , 4 4 0 0 0 : n = n + 1 : s a v : o260 GOTO a0
1 0 ' E X 2 5 . B A S * A C S o f i 1 9 4 9 *2 03 0 D E F I N T a ' z4 0 D E F F N d B ! = ( { 2 5 5 - d ) / 1 O ) - 2 O , 5
2 1 0 '2 8 0 d m i n : 0 : C L S + 2 : d m a x : ? 5 5 : c L s * 3290 LOCATE 70, 1 : PRIN' :RETURN3 0 0 '3 t o . M o D E 2
5 1 0 R E T U F N5205 3 0 , x x x F i n d u l i s t i n s * * *
3 2 0 M O V E 0 , 3 6 8 : D R A W 3 1 , 3 6 a : o R A W ' 3 1 , 4 6 : D R A W 0 , 4 ô : D R A W 0 , 3 0 8330 l ' lovE 1 03, 364 : DRAW 640, 364: MovÊ 640,46 :DRAW 1 03,46 : DRAW 1 03' 3683 4 0 t ' 1 O V È 3 9 , 3 5 2 : D R A W R 1 8 , 0 : M O V E R 7 , 6 : T A G3 5 0 P R I N T " + " ; : T A G O F F : M O V E R 5 , - 6 : D R A W R 1 a , 03 ô o R E S T o R Ê 4 1 0 : F O R i : - 2 0 T O 5 : M O V E 3 9 , 9 2 + { 2 5 5 - ( ( i + 2 0 . 5 ) * 1 0 ) )3 ? O I F i / 5 < > I N T { i / 5 ) T H E N r ' 1 O v E R 4 6 , 0 : D R A H R 1 o , 0 : G O T O 4 0 03 8 0 D R A W R 1 O , O : M O V E R ? , 6 : R E A D e c h $ : T Â G : P R I N T e c h $ ; : T A G O Ë Ê3 9 0 M O V E R 5 . - ô : D R A W R 1 0 , 0 E L S E M O V E R 4 6 , O : D R A W R 1 o , 04 O O N E X T : F O R i = - 2 2 T O 7 ; M O V E 1 4 , a 2 + ( 2 5 5 - ( ( i + 2 O - 5 ) * 1 0 ) ) : D R A W R 3 , 0 : N E X T4 1 0 D A T A " + 5 ' , ' 0 d 8 " , " - 5 " , " - 1 0 ' , " - 1 5 ' , ' - 2 0 "4 2 0 M O V E 3 9 , û 2 : D R A W R 1 8 , 0 : M O V E R 7 , 0 : T A G4 3 o P R I N T - ; : T A G O F F : M o v E R 5 , - 6 : O R A W R 1 a , o4 4 0 L O C A T E ô , 1 : P R I N I C H R $ ( l A 3 ) + : A O - 2 5 _ ; w I N D O l { + 1 , 1 4 ' 8 0 ' 3 ' 2 24 5 0 L O C A T E . 3 0 , l : P R I N T M I N : : W I N o o l { * z , 3 5 , 4 1 , 1 , 1 : P Ë N * 2 ' 0 : P A P Ê R * 2 , 1 : c L s * 24 6 0 L O C A T E 5 7 , 1 : P R r N l M A X : : W T N D O W S 3 , ô 2 , ô 4 , 1 , 1 : P Ë N * 3 , 0 : P A P E R * 3 ' 1 : C L S { 34 7 0 L o c A I Ë 2 0 , 2 4 : P R I N I c o P Y : D e b u t a c q u i s i t i o n " ; S P A C E $ ( 4 ) ; F 7 : R A Z4 8 0 L O C A T E 2 0 , 2 5 : P R I N T Ê N T E R : F i n a c q u i s i t i o n ' i S P A C E $ ( ô ) i ' F g : R â z O V E R4 9 0 L O C A T Ê 6 8 , 2 4 : P R I N T S . : S a u v e r " : L O C A T E 6 ? , 2 5 : P R I N Î E S C : Q u i t t e r "5 O O L O C A T E 5 , 2 4 : P R I N T A C : L O C A T E 7 , 2 5 : P R I N T " S o f t ;
Figutê 70
Radio Plans 5OO 41
ffiË{âI ' l - . -l : l - + s -l : l - o d x -t - tI : l - - 18 -l - - - , - - t c _
l : l - - a 8 -l : l - - 4 5 -I r l - - m -l : l - - 3 5 -I : l - - {s -l : I - - { s -t - t - - -
âc$oll
pûD -51- l$l: EII|I InXr llll
gff"dr ; 3iÏ":,ÊffiitiH"" Fl i fiH *r,E-nregistÈernent person'Jel de F.ia'io su.r I)ande : 42,6 dB dedynarnique !
-
tîD -50- lllt: E:ril rôr, rrlr
,L :SiTiiË.
d'exclamation, à ne pas oublier.Enfin, EX 50.BAS, en figure 11, est
à "merger". Expliquons-nous. Lesdifférences entre EX 25 et EX S0sont plutôt de suivre cette procédu-re : EX 25 étant sauvé, tâpez EX S0en respectant les numéros de Iignes,puls sauvez-le (sur CPC 464 avec dn,ve. uLilisez une cassette afin d avoirâccès au merge). Chargez EX 2b ettapez la iigne suivante: MERGE'EX50.BAS". Pour finir, sauvez ànouveau EX 50, maintenant compiet.
g8ïir i Bil':.ÊitÏitit,i"" FT !l*? ouuDire Straite Si'igle ha'nded sailor (Laser) 72,6 dB-
Ft}. -eS- ;Itlr lll*t
Sûft
IAX r -*l ol,DI
COMMENT çA MARCHE ?II convient de respecter les règles
données lors de nos précédenis arti-cles : allumez Ie rack, PUIS ie CpC.Tapez RUN "D8". En fonction dei'échelle choisie, EX 25 ou EX 50 secharge et semble attendre quelquechose. . .
Pour débuter une acquisition, ilfaut taper COPY. Le vu-mètre s,agi-te, Ia courbe se dessine : un grandmoment (si Ie signal injecté n,estpas hors gamme, sinon, vous ne ver-rez qu un VU au taquet et une lignedroite) !
Deux indicateurs en haut deI'écran vous renseignent sur lesmaxima et minima atteints. Il se peutque I'inscription "OVER" s'affiche àcôté du maximum, elie signifie queIe signal a dépassé les * 5 dB.
II est impodant d'ouvrir uneparenthèse à ce sujet ;
Nous savons que + 5 dB renvoreune donnée égale à 0. Au-delà ciecette limite, comme le convertisseurne peur fournir un résultaL jnférieurà 0, il est imposslble de faire Ia dis-tinction. + 5, + 6 ou + 15, c'esttou-jours 0 binaire, donc l'OVER s'affichedès que Ie signâl atteint + 5 dB. Ladernière valeur réellement mesura-ble est en faiL 4,90 dB en EX 25 (réso-Iution 1/10) ou 4,8 dB en EX 50 (réso,lution 2/10). Dans ces deux câs, ladonnée est égale à 1. L'indicateurMAX pourra donc afficher jusqu'à4,9 dB, toute valeur supédeure pro-voquant l 'appadtion de "OVER".
Notez que tout ceci reste vrai pourIes limites inférieures (à la différenceprès que l'OVER n'existe pas):- 20.5 ou - 46 et en dessous don-nent 255. Les dernières vaieurs"vraies " sont donc repectivement- 20.4 et, - 45,8 dB. Fin de la paren-thèse.
La ftappe de F9 efface i'indicateurde dépassemenL "OVER ' . I1 esL a ins ipossible de connaître le nombre depointes apparues pendant un tempsdonné, ou un morceau complet.
F7, elle, remet à zéro MIN et MAX.Ces limites étant calculées en per-manence, il y a peu de chance pourqu elle y restent longtemps, maiscela permet de débuter une mesurede dynamique. A noter que COPYeffectue la même remise à zéro,avant de commencer une nouvelleacquisition.
II se peut que vous désiriez conser-ver une courbe tnLéressanle. Uneoption de sauvegarde de I écran estdisponible en tapant "S" (majusculeou minuscule). La commande est
ffPÀ iiîi"ldÊlÏiïili"" tl iË#our* E$c iâîiTi[,J-ohnny.à Bercy (Laset). Début de ( Dans,nes nuits tt 18,9 dB dedynatnique.
appels aux variables, on accelèrel'exécution des programmes BASIC.Le listing suivant est plus complet :EX 25.BAS. figure 10. Ceiui-cj,comme son nom I'indique, est dédiéà I'échelle de mesure 25 dB. Tou-jours pour des raisons de rapidité,toutes les variables sonL défrniescomme entières en l_gne 30. Uneexception toutefois : la fonctionFNdB ! (notre formule de calcul) peutrenvoyer des valeurs réelles, et c'estpourquoi elle est suivie d'un point
42 aaaio plans 5oo
mémorisée mais la sauvegarde nesera effectuée qu'au moment où lacourbe atteindra I'extrémité droitede l'écran. Ne frappez donc pas "S"en répétition, pensant gue "ça nemarche pas " !L'acqursition est suspendue durantle temps nécessaire à l'écriture dufichier sur la disquette mais aucunnom n est demandé : Ie premierécran s'appellera COURBE 0, Iesecond COURBE 1, ainsi de suitejusqu'à COURBE 9. Après, on recom-mence avec COURBE 0 mais vous nedevez pas craindre d'écraser ainsivotre première courbe : chaqueimage occupe 17 Ko sur le disque, eide 0 à 9 on obtient 10 x 17 = 170 Ko,ce qui est pratiquement le maximumsur une disquette formatée enDATA. Aucun contrôie n'étant effec-tué par Ie programme, c'est à vousde vous assurer que Ia disquetteprésente dans Ie lecteur dispose desuffisamment de place.
Enfin, pour différencier les deuxéchelles de mesure possible, lesnoms des écrans seront suivis deI'extension ".E25" dans un câs et".E50" dans I'autre.
Vous pourrez ensuite incorporerces imâges dans d'autres Program-mes (LOAD "nom de I'écran",&C000), et les imprimer. Si vous pos-sédez CIAO, n'hésitez pas à utiliserZONARD pour faire des moniages:extraction de parties de courbes, rac-cords... Et PLUS se fera un plaisir decoucher tout ceci sur papier.
Enfin, la touche ENTER (êt nonRETURN), stoppe I'aquisition encours, f image se fige. ta seule com-mande disponible alors esi ÇOPY,qui efface tout et recommence unnouveau tracé.
Pour quitter Ie programme, tapezESCAPE deux fois. Un seul aPPut surESCAPE provoque une pause, et onredémarre avec une autre touche.
Et pour finir, rappelons que vousne devez pas changer d'échelle encours d'acquisition, Si cela ne posepas de probléme électronique, lesvâleurs affichées seraient complète-menT folles. Pour passer d'unegamme à une autre, après Ie bascu-Iement de I'inverseur, il faut relancer.DB.BAS".
AT]ELAUE S EXPLIC AT IO NS ?Pour ceux que la chose intéresse
- ce que nous souhaitons vivement- voici quelques éclaircissementssur le fonctlonnement des program-mes vus plus haut. De plus, sr une''bogue s'esL glissée dans votre sai-
sre, ces lignes vous permettronspeut-être de l'éliminer. Pas grandchose à dire sur "DB.BAS" : pro-grammation du 8255, initialisationde ces ports et choix du module àcharger, en fonction de Ia positionde I'inverseur d'échelles.
Avec "EX 25.845", çâ devientplus intéressant. Un premier pointimportant est que ce programmesuppose le 8255 prêt à travailler; ilest donc vital de passer par "DB"pour que "EX25" (ou "EX50") Puissei0urner.
Passons sur les lignes 30 et 40dont nous avons déjà parlé pouratieindre, en 50, l'appel auGOSUB 310. Celui-ci est chargé del'écran de présentation: dessin ducadre et du vu-mètre, tracé del'échelle et rappel des commandes.Si votre affichage paraÎt "bancal",c'est là qu'il faut aller voir.
Au retour de ce sous-programme,en ligne 50 donc, nous trouvonsSAV$ qui contient Ie nom de basedes écrans sâuvés sur disque. N quiservira à Ie compléter (COURBE 0,COURBE 1...), et SAV utilisée commevadable logique. EIIe pourra prendredeux valeurs, 0 (FAUX) et - 1(VRAI) ; si SAV est VRAIE, une sau-vegarde de I'écran sera effectuée àl â h r ^ ^ h â i n ô ^ ^ ô â e i ô n
Enfin, DMAX et DMIN permettrontde faire évoluer les indicateurs MAXet MIN. Y et OLDY serviront au tracéde Ia courbe, ainsi qu'au positionne'ment de I'index du vu.
En 60, on attend un appur surCOPY avant d'aller plus loin. Onefface alors Ia fenêtre qui contient lacourbe, et on trace la ligne horizon-tale de repère du 0 dB.
La procédure de conversions'étend entre 90 et 110, c'est lamême que dans "TEST-AD'.
Pour placer les points de la courbe,il est inutile de calculer la valeur endB : cela ne ferait que ralentir l'affi'chage. Comme le tracé est propor-tionnel aux données émanant duconvertisseur, on effectue un calculpius simple. Si d (la donnée) estégale à 254 (- 20.4 dB), Y reçoit lavaleur (255-254) - 1, auquel onajoute 78 pour recentrer la courbedans l'écran. A l' inverse, d =1.(+ 5 dB) correspondàY= 332.
L'indicateur MIN est réactuahséen ligne 130 si I'on enregistre undépassement vers Ie bas. Le signesupérieur ne doit pas vous surpren-dre puisqu'une donnée maximumindique un niveau minimum.
Un traitement spécial est appliqué
à 255 et 0. En effet, ces deux valeurssont les limites de la mesure, et pourbien les marquer, on affecte directe-ment à Y des coordonnées Plaçant lepoint de la courbe et I'index du vuen face des inscriptionsde l'échelle. Dans Ie cas du 0(> - + 5 dB), on affiche en plus"OVER", et on sauie I'évaluation duMAX. Rien ne sert, en effet, d'affi-cher * 5 dB alors que nous sommespeut-être bien au-dessus.
t'index du vu est constitué dedeux caractères alpha de code 154.Pour Ie déplacer, il faut dans un pre-mier temps effacer la dernière posi-tion ; c'est I'objet de la ligne 170, etvous comprenez I'util ité de OLDY:elle contient la coordonnée du der-nier point atteht. On ajoute 6 car lecurseur graphique se trouve en hautdu cara$ère à afficher. En 180, I' in-dex est redessiné, cette fois à laposition Y.
Ouant à la coulbe, on trace untrâit enire l'ancienne Posltlon(OLDY), et la nouvelle (Y). La varia-ble X est incrémentée de 2 Pourespacer chaque poini de 2 Pixels enhorizontal. Tant que le bord droitn'est pas atteint (ligne 240), on bou-cle sur une nouvelle converslon.
Entre temps, un test du clavier àpermis de détecter l'appui sur lestouches de commânde: en 200,remise à 0 de MIN et MAX (F7), en210, effacement de "OVER" (F9),ENTER entre dans une boucleWHILE/WEND qui attend COPYpour sorl,ir, et "S' bascule SAV à- t. Ouand Ie programme atteint IâIigne 250 (la courbe est maintenantcomplète), et si SAV est VRAIE, onconstruit Ie nom de I'écran et la sau-vegarde est effectuée. N est incré'menté en prévision de Ia Prochainedemande, SAV reprend Ia valeurFAUX,
Sauvegarde ou Pas, on retoumeâlors en ligne 80 pour effacer Iacourbe et enchaÎner sur un nouveautracé.
Nous ne parlerons pas de "EX50"puisque tout ce qui vient d'etre ditreste valable Pow ce Programme. àquelques détails près.
I coNcLUSIONAIIez, une petite demière: AJ7
permet, en plus, de Poser la règle demesure idéale "au centre de chaquemarche" et non sur leur cIète.
Rendez-vous Ie mois Prochain Pourla conversion digitale analogique.
Alain CAPO, Jean ALARY
Radio Plans 5oO 43
uN EVI l-J EIJRD'EPRO
Les EPROMS sont oes composan extrêmementleur ut i l isateur à
imple (voi r nosuti les parce que personnalisablesl 'aide d'un matériel oui ceut être fortprécédents adicles).
Leur usage principal est évidem nt le stockageoe programmes pour mlc!-oprocessassociant à un simple compteur binen faire d'excel lents séquenceurs (des cheni l la rds "haut de gamme") .
Leur gros inconvénient est la relatleur procédure d'effacement, qu'i l fa
urs, mais en lesire, on peut aussi
exempre pour
e lourdeur depourlant
- - J ^ i+ ^ l ' - anL l \ J l L \ J l l c - l l \ JU l I lU^ ^ ^ l i ^ ' ' ^ - i ^ + . < ^ - a l n m n n + . - J À ' c - r ' r ' ' , r l ' , - r
al. l-Jl.J||L.lt l( jr I rL(Jvr d.ltt l I l t i l lL Lr(=è \-1u (= | Lr
ô ^ - ^ i +ùt i t d. t L-L, t= t l ( l ( l t | èr=\Jt \_- , , vr | | .
Radio Plans 5Oo 47
.%^Ëâ
U stade de la mise au point, ilest infiniment plus confo$a-ble de travâiller sur de lamémoire vive (RAM), qu,il
raut par contre trouver le moyen derendre r non volatile r.
Nous allons donc étudier ici l,artet Ia manière de remplacer uneEPROM par une RAM CMOS a soute-nue r par pile.
. DESBRÙdHAGE|COMPATIBLES
La norme JEDEC, rebaptisée "By-TEWIDE' par MOSTEK, impose unelarge compatibilité de brochageentre Ia plupart des mémdires siati-ques RAM, ROM, ou EPROM : seuiesquelques broches bien précises dif-fèrent d'un type à l'autre en fonctiondes capacités et des technologies.
Il est par exemple possible d'inter-changer, sur un même support, une
EPROM 2716 et une RAM6116, abdtant toutes deuxoctets. Evidemment, il nepour autant espérer écrire dansI'EPROM en 200 nanoseconded avecune alimentation de 5 volts, et ilserâit très malsain d'appliquer du 25V à Ia 6116, mais en Iecture les deuxmemorres sont compatibles.
En phase de mise au poirlt, onaimerait que Ie programme destinéâ un microprocesseur puisse êtreIogé en RAM: en cas de nécéssitéde modification, mineure ou iinpor-tante, pas besoin d'effacer tout. maissimplement de surcharger les dctetsmcorrects.
Le problème se pose alors âe laconservation des données dahs IaRAM lors de ses transports entre lacarte à misroprocesseur et le sys-tème de développement sur l4quelon met au point Ie programme (typi-quement un micro-ordinateur).
t'idée de base consistement à maintenir la RAMsion pendant cespuisque c'est Iorsque l'est interompue que sondisparaît.
De par leur consommationment faible, Ies mémoiresÇMOS se prêtent bien à unetation de longue durée surCependant, des précautionslières doivert être prises pourque des étâts indésirables n'raissent sur les broches de
2048pas
mande pendant.les transferts, modi-fiant les données stockées !
. UNERAM,,PERMANENTE"
Des solutions toutes faites, et degrande qualité, existent pour ce pro-blème qui se pose guotidiennemenrdans I'industrie : divers fabdquantsont réussi à intégrer dans un mêmeboîtier une RAM CMOS, une ou plu-sieurs piles au lithium {rèDutéespour leur longévité), et des circuitsplus ou moins complexes de protec-tion des données.
Citons les GR2716,2732, et 2764de GREENIMCH INSTRUMENTS ersurtout la MK 48202 de MOSTEK,qui présente l'avantage d'être dispo-nible auprès des revendeurs appro-vrslonnant nos lecteurs,
La figure I donne une vue simDli-fiée (!) de son schéma interne, dânslequel on remarquera la présence dedeux piles au lithium de 3 V, alorsqu'une seule est théoriquement suf-fisante puisqu'il ne faut guère que2 V à une RAM CMOS en "standbypour consewel son contenu.
Associées à un circuit spécial choi-sissant à chaque instant Ia meilleuredes deux, ces piles en "redondance"pemettent d'atteindre une excel-lenre fiabiliré.
Il est important de noter que lessignaux de sélection de boîtier et devalidation d'écriture transitent par
I
48 Raoio ptans 5oo
7
3
I
powcr power oêseteclFai lurê Fal luro Chlp Swl lch
Detected Ênablc to 8âttert
T9
Figure 2
e,Ht,fj #
â
un circuit de contrôle qui les rendinopérants dès que Ia tension d'ali-mentation est suffisamment bassepour justifier un passage sur p es.
La figure 2 reproduit Ie cycle desauvegarde recommandé par CATA-LYST RESEARCH, fabricant améri-cain de piles au lithium de granderéputation: avant même que le 5 Vn'ait chuté de façon perceptible,toute défaillance de l'alimentationprincipale (non régulée) peut êtredétectée et mise à profir pour faireexécuter une roÛtine de sauvegardedu contexxe à l'unité centrale (celaest surtout utile en cas de pannecaôta , , r imnrÂr ' iê ih l l
Dès que Ia tensior régulée tombeà 4,5 V (valeur qui permet encore unfonctionnement parfait des mémoi-res), il faut bloquer toute possibiitéd'accès aux données, surtout en écrj-ture: pour ce faire, Ie plus simpleesl de forcer la broche de sélectionCE barre à un niveau ltaut.
EnJin, lorsque la tension réguléeatteint 2,8 V, il est temps de commu-ter Ia mémoire sur Ia pile de secours,d'une tension nominale de 3 V.
Pour ce faire, Ie schéma électroni-que de Ia figure 3, à base de compa-rateurs de précision, est suggéré.
Dans noire cas d'application, Iasauvagarde n'a pas besoin d'êtreautomatique : nous pouvons nouspermettre de la déclancher manuel-lement avant de retiier la mémoirede son support. Bien que la solutionla plus confortable et la plus sûre
La solution proposée est détailléeà la figure 4 : deux diodes germa-nium (à chute de tension bien plusfaible que des 1N4148, par exem-ple), assurent Ia commutation entreIe +5V aûivant par le support, etune pile de 3 V à 4,5 V qu'il va s'agirde loger à proximité de la mémoire,ou éventuellement au bout d'un^ Â + i i ^ À h l ô a ^ , , h ] ô
Trois résistances assurent le main-tien des entrées de commande à unniveau haut lorsque la mémoire estdéconnectée, mais ne peuvent
Figure 3
reste la MK48202, nous pouvonsréaliser de grosses économies enassociant par nos propres moyensune 6116 (environ quatre fois moinschère) à une pile de 3 V.
empêcher I'application d'états indé-finis lors du débrochage ou de I'em-brochage, ni même en cas de cou-pure intempestive de I'alimentationde I'unité centrale.
Nous avons donc ajouté un inver-seur "RAM-ROM" à commandemanuelle : lant que cet interrupteurest fermé, la ligne de validationd'écdture esi accessible et il est pos-sible de lire ou d'écrire librement enmémoire, comme dans n'importequelle RAM.
Ouvrons I'interrupteur, et Ia bro-che d'écriture de la mémoire est pla-cée au niveau haut de façon perma-nente: quoi qu'il afiive, l'écritureest impossible. Notre mémoire per-manente est devenue une ROM,capable "d'émuler" une 2716 dansn'impode quel montage utilisateur I
Suite page 60.
Radio Plans 5OO 49
D2
R1 R2
a E
i;
Figure 4
Oanal Tranoelnternational
ent - - l -
OANOE U
I
Les l ignes qu i su ivent sont par t icu l ièrement dest ineesà nos lecteurs français, francophones ou francophiles,demeurant sur le cont inent a f r ica in a ins i qu 'au procheorient, qui peuvent, enfin, capter directement à leurdomic i le la nouvel le chaÎne de té lév is ion . . CanalFrance International , , ou . CFI > au moyen d'unéquipement mi - lourd appor tant génera lemenfsatisfaction.1-ar o r r r r i r= rar r ran f r - , c ' \ t t r r ia ê t re a isémenL inSta l lé e t fég lé\ - - l \ = t ( = \ - . | l l l l , r v l I l v l l L l . J \ J l r l l c - - r \ J L l
par un lecteur averti qui devra investir environ1 .1 .5OO F HT (export) pour l 'acquisit ion d'une stationse composant d 'une parabole f ixe de 3,OO m dediamètre, d'une tête hyper-fréquence 3,7/4,2 (àâ2, eId 'un démodulateur manuel .
Radio Plans 500 51
uùuu A present, pour espererrecevoir une ou plusieurs chaî-nes de télé émises dans la lan-gue de Molière, il fallait être
principalement domicilié sur le conti-nent européen et dans le MaghrebIrancophone.
En effet, seuls ces sites sont des-servis par le satellite européenEUTELSAT I F4 distribuant auxrèseaux câblés, aux antennes collec-cives, aux télédistributions, maisaussi aux particuliers, la chaîne fran-cophone ( TV 5 Europe L
Cette chaîne est égalementrep se par des moyens herztiens -émetteurs et réémetteurs - auMaroc, en Grèce etc...
TV 5 est bien captée sur toutel'Europe avec des antennes ( legè-res ) comme par exemple en France,où au moyen d'une parabole de1,20 m de O nous mesurons un C/Nde 13 dB, soit une marge de 3 dBau-dessus du seuil pratique nominal(B : 27 MHzl. Outre I'Europe, TV 5peut être captée avec des équipe-ments plus lourds, par exemple
jusqu'à Marrakech voir Agadir, quisont réservés aux collectivités vu lecoût du réflecteur.
Puis, après une couronne d'ombredue au premier zéro de l,anterured'émission d'EUTELSAT I F 4, TV bapparaît de nouveau du côté du18è.e parallèle en s'appuyant sur lepremier lobe secondaire. Toutefois,l'image n'est pas trop bonne - quel-ques clics - malgré l'emploi d'uneantenne de 4,00 m de diamètre.
Force est donc de constater quedans des conditions normales d'ex-
52 nacio Ptans soo
ploitation (C/N > 12 dB, ciel clair)voir mêmes marginales (bande vidéoétroite), la réception de la seulechaîne TV en langme françaisen'était pratiquement plus possible,au-delè de I'Afrique du Nord, jusqu'àce jour.
Avant de développer Ie sujetconsacré à la réception de CFI nousouvrons une parenthèse.
Radio Plans s'est fait l'écho dallsdes numéros parus entre Juillet 88et Janvier 89, des possibilités deréception de chaines de télé françai-ses (et européennes), via satellite,an Â{riarro Àrr lrln'rl
Plusieurs cartes éditées mention-naient le diamètre approximatif pré-conisé par la source indiquée pourun démodulateur bien défini (seuilstatique 6,5 dB C/N à 24 MHz ou =5,5 à 18 MHz) et cela dans des condi-tions clairement énoncées,
t'auteur ne peut être aucunementtenu responsable au cas où la qualitéd'image captée ne correspond pas àI'attente de I'utilisateur, notammentlorsque sont employés des démodu-lateurs moins performants (seuil pro-che de 10 dB C/N), des têtes plusbruyantes que celles alors conseil-Iées.
De plus, sur place, nous avons mal-heureusement constaté que les ins-tallations êt réglages n'étaient pastoujours réalisés dans les règles deI'art; d'où un signal insuffisant.Analysons rapidement les pdncipa-Ies causes : Sur Télécom I C : anglede polarisation mal réglé sourcedesaxée. Sur I'ensemble des satellites : paraboles voilées ... ! et dépoù-tées. source mal placée au foyer,réglage approximatif des montures
équatoriales, têtes non protégéescontre Ie rayonnement solaire, dis-tance focale non respectée etc...
L'auteur rappele qu'il avait préco-nisé une parabole de 1,50 m à Algerou à Tunis permettant un C/N d'en-viron 12 dB, bien que 1,20 m apportetotale satisfaction à bon nombresd'usagers jouissant d'un équipe-ment conseiué padaitemeni installéet réglé...
A titre d'information, signalonsque Ia revue du bricolage et de laoecolauon ( JIslElvlE u n develop-pera au cours du second semestreun article pratique ( Comment ins-taller et régler son artenne satel-.I i te ) . .
Notons que les causes et effetsd'un mauvais fonctionnement peu-vent être également appliqués à laBande C et donc à I'objet qui suit.
ll C.F.I. ; DESPARA,METRES DEMODULATIONCONVENTIONNELS
Le programme Canal France esttransmis par TDF et RFO qui en sontIes prestataires techniques au sol, etde Ia liaison montante (6,130 GHz).En orbite, CFI est diffusé par le satel-lite INTELSAT 232,50, désignationofficielle, plus connu sous Ie nomd'INTELSAT VA F 11 positionné à27,5" de Iongitude Ouest. Ce satellitequi nous est familier en bande KU,est maintenu à poste avec une précr-sion de {/- 100 millidegrés en N/Ser E/O.
La zone de réception de CFI (surce satellite. il v a d'autres chaînes
Zones de couvettu'.e du satetliteINTELSAT VA F 77.
avec des couveftures pouvant êtredifférentes) est hémisphériques Est.Cette zone nous est indiquée par lesdifférentes illustrations produites,^âr tô ô t iê^ -n i roa
Le signal de CFI est transmis enmodulant en ftéquence une porteusepar le signal vidéo SECAM et unesous-porteuse audio. Voici pour lesgénéralité s.
Voyons maintenant les caractéris-tiques en commençant par Ia fré-quence vidéo d'émission, qui est à3,905 GHz, via Ie répéteur N" 5-6.Les signaux sont en polarisation cir-culaire gauche.
Les autres paramètres sont Ies sui-vants :- Préaccentuation : avis CCIR 405 /T .- Modulation de la porteuse : FM àpente posltlve.
Réception à awec ut e parabole de 3,OO t7,Réceptiob avêc .I'Je patabole de 2,4O n de et PIIiE :32 dBW à Sttasbo|lrg. de et. PIR'E - 30
Radio Plans 5OO 53
Dru- Excursion de Ia fréquence crête :2 2 M H z c à c p o u r 1 V o l t .- Bande de Carson : 32MHz.
Ouant aux caractéristiques pnncrpales audio, elles sont les luivântes :- Fréquence de Ia sous-porteuse:6,5 MHz.- Préaccentuation : conforme aI'avis CCITT No J 17.
Pour en teminer avec les caracté-nstrques, précisions à titre pratiqueque la -fréquence de réglage duoemodulateur est proche det230 MHz. La norme de diffusion deCFI est Ie SECAM.
.RECEPTTONETTRAITEMENT DE CFI
En se référant à Ia zone de couver- '
ture du faisceau hémisphérique Estprécisant les iso-pires, on s'aperçoitd'emblée que I'ensemble du conti-nent africain est dèsservi avec.unepùe de 31 dBW, exceptée la partiesud de I'Afrique, où au Cap Ia pireapproche les 27 dBW.
En Ethiopie et en Somalie, on noreune relative faiblesse puisque nousrelevons 30 dBW.
Nous remarquons aussi que I'Eu-rope et Ie Proche Orient sont padai-tement dessen/is, puisque la pùe estsupérieure ou égale à 31 dBW et pré-cisement de 32 dBW en Europe cen-rrale.
Pour une pire proche de 30 dBW,Bernard-Denis Laroque, directeur
technique de CFI nous précise quedans des conditions normalds d,ex-ploitation, il faut utiliser une stationde réception présentant un lacteurde mérite d'au moins 25 dB/o K Dourobtenir un rapport S/B de 48 dB. Cebut est réalisable avec une p{rabolede 6,00 m de O (c : 45,5 dBi)d'une tête hyperfréquence àrature équivalente de bruit 750 K.Dans les zones où la pire32 dBW, une parabole de 4,O permet un rapportgaranti d'au moins 1332MHz).
Ces caractédstiques sont cellesrecommandées pour Ie pilotage d'unémetteur TV ou bien pour Ia récep-tron communautaire et égalementnrn facc innno l la
Avec cet équipement (parabole ettête) nous avons mesuré ponctuelle-ment, un C/N proche de 10 dB àAbidjan (Côte d'Ivoire). Quant aurapport S/B il est estimé, par R.Schaeffer, à 44 dB ce qui est classifiéde ( bon , (voir photo),
UNE POSSIBILITE : 2,40 mEn France et notamment au sièqe
de Ia société PORTEX à Strasbouiq(et d'une façon générale sur toute;Ies zones à 32 dBW), une parabolede 2,40 m permet encore, mais c'estpratrquement sans marge, la récep-tion commerciale de CFL Le seuiipratlque est atteint puisgue le C/Nmesuré se situe autour des 10d8.Toutefois, sous un ciel d'orage, nousconstalons Ia présence de quelquescrcs.
Cependant, avec l'emploi dudémodulateur Drake ESR 4240 Ecomplété d'un filtre de bande ajusta-ble (voir photos), gui autorise, d'unemanière artificielle, I'abaissement duseuil de près de 3,5 dB (seuil nomiaal< 8 dB C/N à 27 MHz\,Ia réceprionde CFI s'avère toujours exploitablePour un Particulier.
Avec Ie démodulateur manuel EST3240 E, n est également possibled'ajuster la bande passante en agis-sant sur les 2 noyaux repérés sur laphoto de part et d'autre du toume-vis. Généralement, agir sur I'ajusta-ble de droite (vert) en vissant, puis
DétaiIa de bta'l.eher're'jt du fittredê bande.Détuodulateur ESR 3240 E.Réglage dê Ia ba'ide passa'ite.Démodutateur EsIi 4240 et. tiltre de bataiustabte.IMPORTAIIiI , après manipulation du .aiustabte procéder au réaiustagede ta fréquence de CFI.
m d e
En réception domestique (otr indi-viduelle) nous savons qu'un signalde 110d8 C/N est suffisant T dansles conditions les plusd'un moment. On s'que dans les sites jusqu'à 330 dBW de pire, une de3,00 m de diamètre (c : 4 dBÙpeut apporter encorelorsqu'est employé unde 35" K (comme il en existe sur lemarché) et Ie ESR3240 dont le seuil statique esb infé-rieur à 7 dB C/N pour unevidéo de 27 MHz, d'aprèsSchaeffer, directeursociété PORTEX.
doncvolle
54 e^ai^ Ptâna 4ôn
gauche (rouge) en dévissant lenoyau fe ite.
Sur ce démodulateur acceptantune douzaine de MHz de bande pas-sante, il était même possible de suivre à Strasbourg CFI - sans clics - surune antenne de 1,80 m ! (voir photo).
n s'agit là, reconnaissons Ie d'unecuriosité de labo purement citée àtitre anecdotique, qui ne peut aucu-nement refléter la réalité pratique
La société PORTEX, au vu dessignaux mesurés, tient à préciserque si une parabole de 2,40 m peutêtre effectivement installée danscertaines régions d'Afrique (32 dBW)parfois avec un filtre ou une bandeun peu plus étroite, il est vivementconseillé d'utiliser une antenne de3,00 m de O dans les zones ou Ia pireest inférieure à 31 dBW comme parexemple au Togo, au Bénin, auBourkina etc...
L'auteur quant à lui précise quepour obtenir un C/N de 12 dB cons-tant ou à peu près constant et unrappod S/B de = 45 dB, il faut auminimum 3.00 m à 32 dBW. attei-gnant 4,20 m en bordure de Ia zonenominale de couvefiure du faisceau]NTELSAT. (29 dBW).
cEr, wsou'o(t ?Contraûement à la Bande KU où
Ies moyens adaptés (lourds) définis-sent presque exclusivement la zonede couverture possible d'un fais-ceau, en Bande C la limite de récep-tion dépend souvent, et cela est véd-fié dans notre cas, par le phénomènede la rotondité de Ia Terre qui limitepuis interdit toute réception lorsque
I'angle d'élévation s'approche du 0o,malgré une pire locale qui peut êtretrès confortable,
C'est par exemple le cas à Téhéranoù Ia pire atteint encore 31 dBW,mais où I'angle de site est pratique-ment nul. Nous ne tenons pascompte des obstacles naturels ouartificiels locaux limitant Ia visibilitéimmédiate en direction de la positionorbitale retenue.
En pure théorie, signalons que surI'équateur, Ie satellite INTELSAT232,5" peut être ( visible rr jusqu'à80o de différence de longitude, soitici, à 52o de longitude Est.
La question est posée, jusqu'où,vers I'Est CFI pourra être encoreexploité, au Koweit et à Riyad ouI'angle d'élévation est encore positif,environ 5o, sachant que I'angle d'ou-verture d'une antenne de Ia Bande Cest plus élevé que celui de la BandeKu, captant âinsi d'autant mieux quel'angle de site est réduit, Ie bruit dusol {2930 K).
CFI, et de surcroît I'auteur ne peu-vent répondre à cette question, seulun essai sur un site à I'origine biendégagé, permettra d'y répondre.
. DES EIVSEMBLESCOMPLETS
Pour la réception directe de CFIchez l'usager (et bien d'autres chaines et certainement bientôt de ( TV5 Afrique r), la société PORTEX dis-pose de réflecteur de type ajouré (ouperforé) de 2,40 et 3,00 m de diamè-tre mais aussi de plus grandes tailles4,5 ou 6 m.
Récêtrttion avec une patabote de7,8O tn de O à Strasbourg. Ledénodulatêur utilisé eét le Es.R3240 E dont la bande vidéo a étératnenée à - 72 MEz-
tes montures sont, à la demandedu client, fixes, ou de type équato-rial. Dans ce dernier cas, des vérinset positionneurs sont proposés etadaptés aux nécessités des contrain-
mécaniques. Portex propose pourréception multi-programmes en
C un oolariseur. ( PolarotorChaparral ). Pour la petite histoùe
rappelons que ( Polarotor D estmarque déposée au même titren Walkman n dans le domainebaiadeurs. tes convertisseurs
GHz présentent une tempérâturede bruit de 600 K maxi,
40o K maxi. et sous Deu 30o K.'auteur déconseille la 60o K.Le convertisseur choisi est pré-
d'une source scalaire 4 GHz. taguide d'onde de cette dernièrela plaquette dialectrique en
Radio Plans 5OO 55
téflon (et non en époxy !) de dimen-sions compatibles, d'une part avecla fréquence, et d'autre part, c'estévident avec le diamètre de la cham-bre.
Nous rappelons que ce composantbi-réfrhgent est indispensable pourle traitement des satellites de I'orga-nisation INTELSAT travaillant entre3,7 et 4,2 GHz de même que lesTELECOM I A et I C er GHORIZONTetc. . .
A propos de TELECOM I A, lasociété ANTENNE 2 nous a signaléIa diffusion de son programme, viace satellite, en bande C. et cela enléger différé (4 heures).
Une parenthèse pour signalernotamment à nos lecteurs Maghre-bins qu'ils ont Ia possibilité de capter(ou suivre) sw le satellire TELECOM1 C Antenne 2 émise sur Ie répéteurNo 5. Des pourparlers sont en coursavec France Télécom pour Ia retrans-mission de la chaîne musicale EURO-MUSIOUE. Quant à CANAL +, il esttouiours en attente sur le répéteurNo4. ta zone de couverture deTELECOM 1 C à été précisée dansR.P. No 494 page 61.
Se seruice serait destiné à I'Amèrrque du Sud et une pafiie de I'Afri-
que.Revenons à Ia d,IN.
TELSAT, qui transmet soitsation circulaire gauche
polari-
soit droite, d'ou la detransfomer les sigratrx ention ]jnéaire.
Lors de l'instatlation du dialectri-que, on veillera à le positionher aufond de la source et de manièie qu'ilforme un angle de 45o avec la sondedu convetisseur. Se reporte! à I'il-lustration.
S'il est fait usage d'un pola[iseur,insérer le diélectrique en amont dela sonde rotative. Celle-ci dolt pou-voir pivoter de 45o de part et d'auûedu plan de la plaquette.
L'instalation et le réglage d'uneantenne fixe réceptionnant Ie satel-lite INTELSAT V A F 11, ne semblepas soulever de problèmes majeurs.L'assemblage du réflecteur e! de Iamonture fixe ne demande qu'ehviron2 heures.
Préalablement, le Iecteur auradéfini un site dégagé dans Ia direc-tion utile (ou les directions en égua-tofial) et érigé un pied, de diamètrecompatible avec la monture, sur uneer rYfâ^Â â ' i .n+ÂÂ
Aspect d.e Ia pldque dialectriquedans le fond du gwide d'ondes de7a source.
EUROMUSIOUE, LA SEPT et bientÔtTV 5 Afrique, il manque à la Franceet à la francophonie, et cela d'unemanière indubitable, une chaîne TVde I'info, une sofie de RFI ou France
)
Après TV 5 Europe, VOII
P0RI!I:;1.J.:p ffi:?iiiSiLïË#Ti:ifl 'î:,':iiJllJli:
iA11llu Le piorinier de l'hyper-tréquence. Nous disposonsflff I tl d'un prqgramme complet d'équipements de réceptionI tnlrtldes plub sophistiqués: antennes, supports, récep-teurs, positionneurs, moteurs et accessoires.
lltIIU Le sominet de l'innovation. Grâce à notre ServicetUIllI Recherche et Développement, nous mettons à votrer vI r rtr dispositiOn un matériel évolutif des plus performants,De la tête de réseau à la station individuelle nous sommes orésentsà tous les stades de Ia réception de signaux transmis pa; satellitepour toujours être à la pointe du progrès.
PO8IE( STRASBOURG . 3A, RUE DE oHEnBOURG . 67100 STMSBOURG FMNCE - TÉL 88,79,38,83 . TELEX 870 464 - Fr'J 88 79 28 64PORTEX ILE DE TRAI{CE . 9.11, BUE GUSTAVE EIFFEL . zA DU BEVEIL MATIN 912s MONTGERON . TÉ1, 116I) 6s,40,32.32 . FAX {1ôn) 69.40 94.14PORTEX ÊnEIAGNE - LA FETAUDA]S 35107 BEDEE . TÉ1, 99,07,1311 1PoRTE( paRts - I FUE DE LA pArx 7s002 pABts - TÉ1. (10-1) 42.61106.37 , TÉLg 213 6to
5€i n"ai. ' Prâne qnn
Info, en somme. Cette chaîne devantêtre transmise en clair via un satel-Iite de bande KU pour I'Europe etI'Aftique du Nord et bânde C pourl'Afrique.
Les américains disposent depuisbelle lurette, de CNN notamment,Ies anglais de SKY NEWS, et lesespagnols de GALAVISION qui sontcaptés âvec des moyens domesti
ques, ici en Europe et au Maghreb.Dans le paysage audiovisuel inter-
nationâl à dominante anglo-saxonne,précisemment américaine, il estimpératif que Ia France soit présentèet active, il y va de l'usage du fran-çais comme langue véhiculaûe.
Nous remercions CFI et Ia sociétéPortex qui peuvent être contactés 'SOFIRAD-CFI : 78, Ave. Ravmond
scalaite et convêrtisgeurK naxi.
75116 PARTSé1. : 45.01.95.80
RTEX : 3 A, rue de CherbourgOO STRASBOURG
é 1 . : 8 8 . 7 9 . 3 8 . 8 3rue de Ia Paix 75002 PARIS
:42.67.06.37
NUEFFER
Radio Plans 500 57
.z'ËcâSuite de la page 49.I REALISATIC'N
PRATTAWLe circuit imprimé de la figrr.rre 5 a
été dessiné en \,'ue de limiter autantque possible I'augmentation desdirnensions de la mémoire par I'ad-jonction du circuit de sauvegarde :le câblage selon Ia figrure 6 deman-dera par conséguent du soin et de lapatience, ainsi qu'un fer à souder àpanne très fine et de l'étain de 6/10.
Tous les composants secôté cuivre, à I'exceptionbaûettes sécables à 12la pile. Pour notreavons démonté une pile auRPX 27 (pour appareil photo,RAYOVAC), et prélevé deuxments interconnectés qu'ellenail: ils trouvent tout iusteentre les deux bafiettes àcondition de placer des calestes pour éviter tout courtIanguettes de contactéléments rendent leur
tes deux diodes et les troistances, plus les deux fils derupteur, seront soudés en" coiffés " avec la 6116,
Une amélioration possibleà monter celle-ci sur deuxbarettes sécables, à contacts " tuli-
deuxet denous
élé-
place)ts. à
tesdes
faci-
puls
pe" cette fois : les opérationsdure seront plus faciles et ondra ainsi un vérita-ble "à placer entre Ia 6116 et sonsans soudure.
Une autre variatrte consispe àcâbler tout cela sur un petit moiceaude plaquefie vERoBoARD, qili seprête fort bien à cet usage.
sou-
. MISEENoEUvRELa 6116 ainsi équipée (ou la
MK 48202 du commerce) peut pren-dre la place d'une RAM statique de2 K-octets dans n'importe quel mon-tage capable d'y écrire, puis celled'une 2716 dans tout montage utili-sateur,
En particulier notre "mini-pro-grammateur d'EPROMS' et le lec-teur qui le complète peuvent êtreutilisés pour la mise au point ducontenu: la figure 7 monlre com-ment configurer les cordons du pro-grammateur comme du lecteur, tan-dis que la figure 8 foumit un logicielde programmation 'PRO-
GRAM.BAS" pour compatible PC,destiné à remplacer "PRO-GROM.BAS" qui, destiné à desEPROMS, gère la tension Vpp et latempodsation de 50 ms inutiles ici.
Pour notre pan, nous avons utilisécette mémoire pour transférer desdonnées de notre vieux ZX 81 ànotre PC tout neuf: la 6116 à pileinstallée dans le "plan mémoire" duZX peut-être écrite et lue à loisir,puis après mise de son interupteursur "ROM", transportée sur le lec-teur d'EPROM connecté au PC. Dour
!;;Figure 5
bFo€h.48202
PF09.48202
12 .
20(18)22(20r.23(21',,26(?4)
I27 12 S i
Figure 6
6fl o-.rr^ orâna Âôô
10 REM ---- PROGRAI'{ *---2ô CLS: OUT SaS, ô3O PRI } I l "COUPËR LES ALIMENTATiONS' '4 0 F F I N T " r r o m d u f i c h i e r à é c r i r e e n R A M à p j l e ? "50 INPUT FSr F$=F$+" . ROI? 'ô0 OPEN" 1" , #1 , F$70 DI I i I M (4096 )É0 FRI l ' IT r PRiNTT ' - - - - LECTURË FICHIEA EN COURS - - - - "S 0 F = 01OO IF EOF(1) T I {EN 1401 1 0 I N P U T # 1 , M ( F )120 F=F +1130 GOTO 1OO140 CLOSE#1: CLS150 PRINT"côn$ecter une RAITI à p t le "1 6 0 F R I N T " d ' a u o E i n s " ; F ; " o c t e t 6 "17Q PRlNT"puts p resser ENTER"1BO I I.IPUT Z$190 PRINT"app l iquer le +5V, pu l6 p resser ENTERTI2OO INPUT Z$210 FOR G=0 TO F-1220 PR INT G, : D=I i { (G) : PX INT D230 OUT 848, D240 OUl 890, 125O OUT 490, 0260 I'IEXT G270 PRINT: PRITT: PRiNTT BEEP2aO PRIITT"COUFER LE +5V puLs presser ENTER"290 INPUT Z$300 CLS| PRINT"RETIRER LA RAI , ' A P ILË" iEND310 RE (c )19Ag Pat r l ck GUEULLEFigaûe 8
transfert de son contenu sur dis-queûe. . .
Terminons avec la fignfe 9, qui faitapparaître les différences entre Ia6116 et la MK48Z02: tant que latension d'alimentation est supé-deure à 4,5V il n'y en a pas. Parcorûre,la 48202 se met d'elle-mêmeen sauvegarde en dessous de 4,5 vtandis que Ia 6116, normalement,perd ses données. Notre montageest heureusement Ià Pour Y remé-dier : il suffit de basculer I'interup-teur sur "ROM" puis de couper sansarière-pensée I'alimentation princlpale. En état de "repos", la 6116consomme extrêmement Peu de cou-rant (nous n'avons même pas pu
idc18 (CS)20 {08) 21 (WE)Etat
I000
010
'I
00
repos
100 0
x01
reposag
r - r . . r . . | , , | . l IlTl À | À | À l,iwesar9 |
Figttre I
mesurer sa valeur I) et peut donc"viwe" sur ses deux petites pilespendant des mois s'il Ie faut. Pour IaMK 48202, on parle même d'unedizaine d'amées grâce à sa doublepile au lithium ... Dans les deux cas,c'est très suffisant pour d'innombra-bles usages IPatrick GUEULLE
NomenclatureRésistancesR r : : 8 , 2 k QR z : : 8 , 2 k QR g : : 8 , 2 k QCircuits intégrésCI1 : : 6116 ou TC 5517ou p PD 446Autr e s s emi - co n duct eu r sD r : : 4 4 1 4 3Dz : :AA 143ou autre diodes germaniumDiversbaûette sécable mâle-mâle (2 xpicots)p i l e 3 V à 4 , 5 Vinterrupteur unipolaire subminiat
Suite de la page 26.I autre. transmission ne sont paslmpo.ses par le bus mais proviennentoe I architecture du programmeassembleur.
avoll une capacité mémoire totalede 2048 x 8 bits. Pournous n'utiliserons qu'un seulsant et nous cablerons les bro-ches au 0 volt. Nous donc
AOH,le petit nom de notre EEpRdont le détail est donné en
entre deux sédes une attente de30 ms pour une écriture (et 60 mspour deux !). Nous allons donc créerun test d'attente de libération de|EEPROM en utilisant I'adresse3FFEH qui contient Ia valeur de I'ac-quittement (provenant de la retenueC de l'accumulateur A), après uneprocédure de STOP, En effet, n ou-blions pas qu'il y a touiours acquitte-ment positif de la part de I'esclavelors d'une écdture, bien sûr si rourse passe bien, alors qu'en lecture leqemrer acqutttement avant le STOPest négatif. D'où I'intérêt de ce resrque nous aUons maintenant vousdétailler.
Les lignes 140 à 190 permettenrd'effectuer ce test. La variable TESTet Ie contenu de I'adresse 3FFEHsont mises à zéro avant chaque écri-ture et TEST reçoit le contenu de3FFEH après dès la procédure d,écftture finie. Tant que TEST est mise àun, on sait que Ie composant n,estpas d'accord pour travailler à nou-veau. Il n'y a donc plus qu'à cons-truire ce test dans une boucle DOWHILE et l'affaire est jouée, Dèsque le programme sodira de cerreboucle, vous saurez non seulementque le composant était prêt maisaussi que l'écriture précédente s'estbien passée. Si votre programme nesort jamais de cette boucle, posez-vous des questions sur Ia santé du8582 et appuyez sur le bouton deRESET I
Voici le plus important à dire surce programme. Pour plus de détail, ilvaut mieux regarder le listing et l,or-ganigramme en figure 7, avant devous mettre devant votre clavler
Pour l'instant, nousécriture, le bit de poidsdonc à zéro.
6.
enest
P'IOTO NO 3 :Lecture + ACK + tô bit de Ia 2en€tecïute.
. LÙGIeIELD'INTERFACE 12 C
MODTNE BASIC DE DIALOGUEAVEC LES MÉMOIBES 12 C
Ce petit module de logiciel va vouspermettre d'écrire un octet à unecertaine adresse de la RAM pCF8570 et de I'EEPROM pCF 8S82 A,
PBOGRAMW D'ÉCRITTTRE DE LAROM PCF 8582 A
Ce petit programme va vous per-mettre de préparer celui de lecture,car pour I'instant notle composantest tout ce qu'il y a de plus vierge,
Nous allons charger en BASIC, parle SFO (XBY(te), Ies adresses nom-mées dans I'article précédent avecles octets nécessaires au réveil deI'EEPROM. Mais tout d'abord, rappe-lons guelques mots sur I'adresiâqede ce composant. Grâce aux tro,-isbroches A0, A1, A2, nous pouvonsadresser iusqu'à huit EEPROM soit
Pour écrire dans Ia PCFnous avons des valeurs à- I'adresse du composant,- Ie nombre de valeur à- I'adresse de début d'le composant,
dans
- le ou les deux octets àLes adresses de FAM
dépendant du p controleur rchargées avec leurs valeurs
alors
ves :- XBY (3000H) = AOHI'adresse du composant,- xBY (3001H) = 04Hnombre d'octets à tratsmettre.- xBY (3002H) = 80HI 'adresse de la E2 PROM àlaquelle vous voulez écrire,- xBY (3003s) = zonpremière valeur à écrùe,- xBY (3004H) = 12Hdeuxième valeur à écrûe.
Bien sûr I'adresse de débutture et les octets à écdre ne
ecn-
sentent ici qu'un simplenotre part.
Ce composant a uneil n'accepte que deux écrituresun START et UN STOP, dans Ie( raffraichissement/écriture r,
6? a^at^ l i râôê <r iô
pour adapter cet exemple à votrepropre réalisation (si toutefois, elleutùise ce type de mémoire l)
PBOGRAMME DE LECTURE DEL'E2PROM PCF 8582 A
Maintenant gue nous avons écntdes octets dans Ia PCF 8582 A, nousallons les faire relire par le 8052 AHBASIC, afin de tester le programmede lecture entré sous forme de codesen machine, et pour vérifier qu'il neIit pas n'importe guoi, nous en affi-cherons la valeur sur un écran,
Tout d'abord, il faut remarquerque I'EEPROM 8582 est très intelli-gente car elle permet deux tYpes deIectures :- Ie premier vous permet de lire uncertain nombre d'octets à partird'une certaine adresse que vouschoisissez. Pour cela, il faut d'abordconfigurer une procédure d'écrituredans laquelle sont envoyés I'adressedu composant en mode lecture,avant de passer aux lectures enelles-mêmes. te protocole 12 C de cetype de lecture est représenté enfigure 8.- le second vous permet de liretoute la mémoire en une seule fois.La lecture commence à I'adressezéro avec incrémentation automati-que de I'adresse. Le protocole cor-respondant est représenté en figu-re 9.
C'est Ie mode de lecture Ie plussimple aussi nous préférons utiliserle premier I Nous vous laissons librepour étudier le second et pourquoine pas en profiter pour faire unDUMP (un' vidage quoi !) de Iamémoire totale de ce composant ?
Pour commencer l'étude de ce pro-gramme, nous allons nommer les dif-férentes ( cases r mémoire de laRAM exteme du 8052 AH BASIC,utilisées en Iecture :- ADADC = 3200H contientI'adresse du composant,- ADNBR = 3201H contient le nom-bre d'octets à écùe (s'ils existent)ou à lire.- ADADR = 3202H contient Ie pre-mier octet à écrire ou à lire,
A partir de 3203H, on stocke lesoctets lus. ou bien, dans le cas d'unecombinaison écriture-lecture, on aIes octets à écrire puis le nombred'octets à lire qui seront bien sûrstockés dans les adresses suivantes.Ce qui conduit dans notre cas auxinstructions suivantes :
POUR LA PARTIE ÉCRITURE- XBY (3200H) = AoH représenteI'adresse du composant,
- XBY (3201H) = 01H représente Ienombre d'octets à transmettre,- XBY (3202H) = 80H représenteI'adresse de la ROM à partir delaquelle vous voulez lte,
POUR LA PARTIE LECTURE- XBY (3203H) = 02H représente
Ie nombre d'octets à lire.A partir de 3204H, nous obtien-
drons les octets provenant du PCF8582 A,
L'appel au sous programmeassembleur de lecture se fait par unCALL BE00H. Le tableau 1 vousdonne le résumé de tous les sous-programmes assembleurs que nousvenons de découvrir avec leuradresse de début de code.Sous-pm$amneAdresse de début Adresse de fiIIECRITURE BDOOH BD2FH
Attention cependant : la partie fixede son adresse est Ia même quecelle de I'EEPROM : AxH ou x repré-sente Ia valeur rr programmée ...
Aussi, si nous installons ces deuxcomposants ensembles, il ne fautpas câbler les bits programmablesde Ia même façon. Nous choisironspour Ia FAM I'adresse A2H (détailléeen figure 11), ce qui entraine A2 etA1 au 0 Volt et A0 au + 5 volts.
1 l 0 l 1 l 00 0 1 Rn
Figure 77
ta RAM PCF 8570 est un compo-sant qui accepte autant d'écritures àIa fois que vous ne le désirez. Aussi,il ne sera pas nécessaire de réaliserun test d'attente entre deux sériesd'écritures. Une fois l'adresse de tra-vail fournie, il y a auto-incrémenta-tion jusqu'à la dernière écriture.
PROGRAMME DE LECTURE DE LABAM 8570
En lecture, elle se comporte exac-tement comme I'EEPROM, aves Iaprésence des deux différents modes.
Aussi, il nous semble bien inutilede présenter un module BASIC Pource composant, car il seraii identiqueau précédent en écriture (une fois lapârtie test enlevée) et en lecture.
Aussi, avant de conclure pouraujourd'hui, nous préférons nousattarder un peu sur les différents
START-MTDAT BD3OHSTOP BDTOHLECTURE BEOOHRSAD BE6OHACK BXSOHNACK BEgOH
BD6FHBDSFHBE53HBE72HBESCHBE9BH
Enfin I'affichage de I'octet Iu sefait par la commande BASIC PH() quiécrit la valeur en hexadécimal. Riende plus simplê l
L'organigramme et le [sting sontreprésentés en figure 10.
PROGRAMME D'ÉCRITUBE DE LARAM PCF 8570
ta RAM PÇF 8570 n'est pas plussophistiquée que I'EEPROM quenous venons d'étudier. Nous pou-vons encore aligner facilementjusqu'à 8 RAM grâce aux bits 40,A1, A2 ri programmables r.
DEBUT
$CISIE DESDONNEES
\ LECruRE
AFFICHA6EOCTETS LUS
FIN
5060708090
100110720130140150160170180
RXM LECTT'RE DE 2 OCTETSM T O P = 2 F F F HADADC = 3200 HADNBR = 3201 HADADR = 3202 HREM CHARGEMENT DES VALEURSxBY (ADADC) = 0A0 HXBY (ADNBR) = 01 H)GY (ADADR) = 80 HXBY (A.DADR + 1) = 02 HREM APPEL A LA ROUTIM DECAI,L BE OO HXREM AFFICHAGE DES RESULTATSPRINT'PREMIERE VAIET'R"PHO. XBY (ADADR + 2)PRINT "DEUXIEME VALEUR'PHO. XBY (ADADR + 3)END
rapides que la première mais, pourvos applications, nous nous penche-rons, bien évidemment sur Ia pre-mière méthode !
ACCÈS AU TIMER OL'instruction CLOCK 1 programme
le TIMER 0 en horloge temps réelpouvant générer une interruptiontoutes les 5 ms. L'état du TIMEit estdisponible dans la variable spécialeTIME qui varie de 0 à 65535,995secondes avant de repasser à 0.
L'instruction CLOCK 0 inhibeI'horloge temps réel. La variableTIME n'évolue plus mais n,est pasremlse a zero.
L'instruction ONTIME (ONTIME
peuvent être annulées par logiQiel. au numéro de ligne précisé, Le sous-,La figure 12 donne le schénha du programme ainsi appelé doit se finirl
système d'interruptions, ains{ que parRETI (RETour d'Interruption).les différents niveaux auxgueld elespeuvent accéder. ACCÈS A I,INTERRIJ?TION INT I
::j^ :ï"_, 1"_ jlTTu est Fcdvé ;Ëi:?:i'"fi Ji,.t,l"'$?1"'i*"H:ap_resrne_rransmlsston, TIME_ devient supérieure ou égalè à;llIlER.2 Le OUlogique deEXF2 et la valeur de l,expression. Lj pro_'r.Ë'z genere des mterruptior4s qui gramme poursuit alors son exécution
modes d'interruption accessibles parle 8052 AH BASIC qui permettrontdans un prochain article de créer lemodule d'animation du pCF 8b74.En effet, s'il ressemble en de nom-breux point (en lecturê et écriture)aux composants précédemment étu-diés, il a cependant une particulantéque nous n'avons pas encore regar-dé : il. possède une broche (INT) trèsintéressante qui engendre une inter-ruption logique. Par logiciel, nouspouvons donc ne lire ce composantque s'il a quelgue chose à nous faireIire, plutôt que de suivre la traditlon-nelle méthode de rr polling r I
Pour l'instant, nous n'avons pasd'exemple ( inteUigent ') avec cecomposatt et ceux déjà étudiésaussi nous nous bomerons à parlerdes intenuptions côté 8052.
Nous allons donc reparler mainte-nant du 8052 AH BASIC et de sespossibilités d'htêrruptions. Car, il nefaut tout de même pas I'oublier, c'estlui qui pilote tout ce petit monde !
INTERRUPTIONS ( HARD t)La fami.lle du 8051 comprend cinq
sources d'interruptions pouvant êtreprogrammées à un niveau de pdoritéélevé ou faible. Le 8052 possède unesixième source : Ie TIMER 2.
Ces différentes sources sont lessuivantes :INT 0 demande exteme venue de labroche p3.2,TIMER 0 un overflow du TIMERactive un drapeau de demande d,in-teruption TF 0,INT 1 demande exteme venue de labroche p3.3,TIMER 1 un overflow du TIMERactive un drapeau de demande d,m-teruption TF 1,
64 p-a; Dtâno Ân^
__9_::--ill"rlu,prions peuvent s+ pro- L,instruction ONEX 1 (ONEX 1
glllt t "n
langage machine, mais numéro de ligne) fait poursulvrenous, nous allons. nous inlérelsel à I'exécution O-u
'programme auleur plogrammatron en BASfC ai - -
faire ia connaissance des "ooi,n"i-
numéro de, ligne.foumi dans I'ex-;;-";;;;;;;.;î*"
*" *"ï*" pression à la condition que l'enrrée' d,interruption INT 1 du g0S2 AHIIïIEBRuP-TIONS r SOIT tt BASIC soit mis à l,érat bas.
Les interuptions peuvent être Voici en quelques phrases untraitées par MCS BASIC-52 de heux aperçu de ce qu'il vous attend plusfaçons différentes tard : un système à interruption.- Ia première permet à des comlnan- Mais n'en disons pas plus et conti-des BASIC d'accéder aux sousfpro- nuons dans le droit chemin !grammes d'interruptions,. .] Voici maintenant le derruer pro_- la seconde passe par- le bia{s de gramme utilitaire que nous vous prc_I'assembleur. Cette méthode dhnne posons. Il permei d'impnmer undes temps de réponse beaucoup plus espace de la mémoire 12 C.
10 REI'| outlP ûE LA r'r€trolRE 12C
"O FTOP-zFFFH
30 01r . t a (16)10 0fi1 c(tê)50 BAUO 460060 AoaOC-3AOOH7Q AoNBRr3âO1HaO AoaDo-3ao2H90 at'H=3qosH95 a0RNSD354,O4H1OO PRINT *'OUIIP OE LA I '1EI'1O.IRE' '110 PRINT) " * * .+ r r r+ r+ r t t * r l r * ' '1!O TNPUT "AORESSE OE L'ESPâOI'I-".AT,RE150 XBY (AOAOC ) -ÀoRE14O INPUT "AORÊSSE OÉ OEPART-".AORO15O xBY ( AoNBR) .01160 xBY(A0AO0) iAOR0774 INPUI 'NOI' 'BRE O/OCTSTS A LIRE-".NSR'laO XBY (AOH ).NBR'190 caLL -. H1OO PHO. l " ou f rP 0E , "AûRD, . A , ' .AoRo+NBR!70 00:8O PHo . *AORo+ I .:9O FoR J.O TO 730O C ( J ) sXBY(A t RNBo+ I+J )3 0 5 t F C ( J ) < 1 0 P R T N T r " , ' , . C ( J ) .3 1 0 I F C ( J ) > . r O . A N O . C ( J ) < 1 0 0 P R r N T * " , , . C ( J ) .- 1 5 I F C ( J ) > 1 0 O . A N o . C ( J ) < 2 5 Ë P R I N T l , C ( J ) ,3:O NEXT J53O PRINT *34O I=I+A35O I.IHILE I. iNSR3êO ENO
Figure 73
OUIIP DEOOH 2lloât{ 1?108 0
?oH 4:8H O
3AH é2
1soo
3
A 48H9 1 0 1 9 1 0o 2 3 1 0 5 3 11 0 1 é A r t 7 2
o 5 2 0 r 2 22 0 2 7 I O a 2
3 0 0 1 0 0
PROGRAMMEDEIDWPIDELAMEMOIRE IZ C
Il permet de lister les donnéesstockées dans I'EEPROM 12 C. Lesoctets à lister sont récupérés dans lamémoire RAM DU 8052 par Ia procé-dure de lecture que nous venonsd'étudier. IIs sont en suite stockésdans Ie tableau C par Ie SFO XBY. IIfaut présenter ce tableau de la façonla plus lisible de façon à lùe Ie plusfacilement possible ce DUMP.
Les octets lus sont présentés par8 sur chaque ligne, Ia premièrecolonne représentant les cases destockage des premier octets. La pré-sentation se fait suivant trois cas,afin d'aligner correctement lesoctets dans des colonnes :- si C(J) < 70 tly a2 espaces avantc(J),- si 10 < C(J) < 100 il y a 1 espaceavanr c(J),- si 100 < C(J) < 255 il y a 0 espace
avant c(J(.Nous reconnaissons Ie CALL au
programme assembleur de lectureaprès initialisation des octets néces-saires à la lecture.
L'organigrâmme et le listing de ceprogramme sont représentés enfigure 13.
ML CIBOT
A PRCPOS DEL'EMETTEUR ry1 Gllz
Notre émetteur TV de faible purs-sance à apparemment rencontré uncertain succès auprès des amateursde vidéo et les connaisseurs ontapprécié la qualité de I'image trans-mise. Ce résultat a été obtenu aprèsguelques compléments d'irforma-tions et de précisions guant à Ianomenclature des composants et àf implantation dans Iesquelles deserreurs ou omission sont a relever .
- tes trous métauisés ne sont pasobligatoires mais, il est impératif derelier, par des queues de résistances -
par exemple, Ies deux faces (masse)tout le long de la ligne.- Sur le schéma de principe Rn et Rsont été inversés ainsin qu'en nomen-clature : Rc et Rs bien placées surIeur implantation font respective-ment 1.2 k et 6,8 kQ.
- La valeur de L2 est de 68 pH (selfsurmoulée).- La BB 225 Philips (CMS) n'est plusfabriquée, on peut sans inconvénientla remplacer par une BB 215 ouBB 219.- Sur le schéma C36 est inversé.
Radio Plans 5oO 65
Interphonesecteur en modulati
de fréquenceon
D-a," le numéro 493 de votre revue, nous avonsprésenté un système de transmission audio sur les f i lsdu secteur, bâti autour du LM1B93 de National-Semiconductor. Ce mois-ci, nous vqus proposons unjeu d' interphones économiques qui met en æuvre unprotocole de communication original.. '
.âl omme chacun le sait, pour blème majeur réside dans la diffi- que I'on actionne si l'on désire parler
I f ;eil.d"; àài Utot.atiotrr culté d'élirniner les parasites pré- et gue I'on relache afin d'entendre
I . nuÀé.tqo"r ou analogiques sents sur le secteur. Ce n'est pas son interlocuteur . s'exprimer. Il '
\., giâ"" ât conducteuis -
du une chose simple avec I'AM, car tout existe la commutation automatiqueréseauJit faut élaborer une porteuse parasite ou aiténuation intervenant parole/écoute mais nous l'avons lais-
fr"ute âu basse fréquence iapplica- iur I'amplitude de Ia porteuse se sée volontaùemenN de cÔté car peu
tions de I'EDF) et là superposer au trouve démodulé comme information pratique en milieu bruyant. Enfin, le
,to;"ftr. En modulant ia ft"qo"n." supplémentaire à celle transmise. système duplex représente le meil-
àu bien l,amplitude de notre por- On ïoit donc que la modulation de leur principe pour une communica-
i*.â G"niàtj, injectée grâce J un fréquence corréspond à la meilleure tion a$éable. Malheureusement, les
e*"tt"nr, on reôueille apès une solution si I'on recherche une trans- nombreux essais gue nous avons
aea1oarrtâtioo effectuée dans le dis- mision aisée sur un support perturbé effectués ont démontré sa difficulté
;;;itii d; iéception, les signaux que tel le secteur. de mise en ceuwe avec un démodula-
iion a transnis. Selon lè type de Diverses solutions existent afin de teut àPLL: te fait d'injeder deux
modulation utilisé, la qualité de communiquer entre les deux postes. fréguences sur le téseau revrent â
transmission varie. En fait, le pro- Citons le classigue bouton poussoir mélanger ces demières et produùe
Radio Plans 5oo Ci7
en conséquence des fréquencessomme et différences délicates à fil_trer de manière simple et accessibleA.tous. Peut-être y reviendrons-nousplus tard...
te procédé retenu consiste à libe-rer les mains de votre correspondantpour la réponse. Cela signifie qu'à lann de. votre transmission, le posteappele se commute en émetteur,durant un temps moyen de cinq àox secondes, afin qu.e la réponsevous parvienne. Ceci s,effectue demanière automatigue sans aucuneintervention de la personne contac_tée. On augmente ainsj considéra_blement le confort de communica-tion et nous espérons que vousapprécierez. Pour obterù une sensl-bilité de modulation optimale, nousavons associé au classique microelectret un contrôle auiomatigue degam gut permettrâ de transmettreles sons les plus farbles cat éloignésdu poste. Enfin, nous donnons lapossibilité au lecteur de transfomerses interphones en système mini-mum (sans compresseur et sansreponse automatique) ou encore deleur adjoindre un dispositif de com-mutation sensible à la parole. Ilserait néanmoins dom:nage de sepriver des divers perfectionnemenrsproposes, compte tenu du faible prixdes circuits utilisés.
I LEBESEAUED,FA la fignrre 1, nous a.vons repré-
senté un schéma simplifié du réseaude distribution. On y remarqueI unité de production, suivie d'unposte de transformation chargé dedellvrer une tension stable, et cesous une impédance (ruasi nulle.yurs apparaissent les c,âbles destinés à véhiculer I'énergie aux abon-nés. Ces câbles, de par leur lon-gueur, peuvent être assimilés à unfiltre à constantes réparlies Les élé-ments réactifs n'étant pas localisèspresrsemment sur toutre la ligne,mars repartts sur toute sa longueur,on parle de lignes à constantesréparties, équivalente à rnne infinitéde filtres passe-bas coDnectés encascade (voir RPEL N 453. p. 1S).
Si le 50 Hz franchit aisément cesfiltres, ce n'est pas le cas d'une por-teuse de fréquence assez élevée. Deplus, le compteur, schéjmatisé pardes bobines de forte valeur, consti-tue un obstacle supplémentaire. Letransformateur étant, lu.i, parfaite-ment infranchissable.
68 naaio ptans 5oo
sont des lignes à constantesties, il existe dans unedomestigue des constanteslocalisées qui s'aioutent aux
que engendré par les lignesfréquence fo, à une valeur depour une distance de 47mètres. Ceci conceme
pour permettre une bande passantemoyenne à la modulation et filtrercoûectement le 50 Hz.
olr9s L'onde délivrée lors de l'émission1^"_ doit être pure, guelle que soit I'impé-
)n- _ A{it d'injecter une porteuse dansde de .bonnes conditions, il est néces-
laut en aucun cas créer d'ces indésirables,gêner des appareils reliés au saire de connaître ou bien d,estimermoment sur le Iéseau. Une 4 la valeur de l,impédance du réseau.
la Durant les essais de fonctionnemenrété rédigée à cet égardnécessité de limiter le champ du tM1893, les ingénieurs de chez
Ia National-Semiconductor ont échan-V tillonné une va.leur d'impédance
caractérisant une ligne de puissanceIes utilisée en résidence ou bien en local
harmoniques, raison pourI'onde porteuse doit êtrement sinusoidale.
commercial (aux USA). Cette infor-mation fût extraite des travauxmenês par deux ingénieurs améri-cains (Nicholson et Malack) et des-quels on tira les courbes proposéesà la figure 2. Toutes les impédances
Le secteur est égalementDes mesures ont montré l,de transitoires d'amplitudement supérieure au kilovolt,superposent au 220 volts. Ilsviennent de gros moteurs,hacheurs ou plusd'orages.,.
L'impédance de ligne vue dprise de courant vade ennombre d'appareils connectésréseau ; il va falloir s'y adapterobtenir une injection coûecteporteuse. En bref, autant demes que I'on peut résumerimpératifs suivants :
Utiliser une fréquencement faible pour ne pas subir d'
se mêsurées sont représentées hâchu-ro- rees sur le plan complexede (ZL = RL + jXL). Ce sont des valeurs
de 3.5, 7.0 et 14 ohms, avec undéphasage de 45 degrés,qui seronrutilisées pour mener les calculs
du concemant Ie couplage du systèmeau avec Ie secteur.ur Si I'on veut éviter de poLluer lela secteur ou bien de court-cùcuiter la
lIê- porteuse par des impédances tropIes faibles, on poura rnstaller sur lei
appareils incriminés, un filtre telcelui proposé à la figure 2. Lesvaleurs sont données pour une por-teuse à 125 kHz.nuation exagérée mais assez
I ARCHITECTUREDEL'EMETTEUR/RECEPTEUR
Le synoptique de l'ensemble setrouve dessiné en figure 3. Ontrouve diverses sections que nousallons analyser une par une. Demanière générale, le LM1893 consti-tue Ie cæur de notre montage etnous lui avons adjoint un dispositifdétecteur de poûeuse reçue. Ce der-nier pilotera un système évitant lesouffle au repos dans le haut-parleur. ta section émission contientle bouton poussoir suivi d'un classi-que circuit anti-rebond puis la miseen forme de I'information < présenceporteusè D, destinée à commuter enémetteur durant un certain tempslorsgue celle-ci disparait. Enfin, lasection modulation comPrend unmicro, complété par un ctcuit com-presseur très efficace.
LE LM1893Ce circuit intégré pedormant de
National-Semiconductor a fait l'objetd'une description détaillée dansRadio-Plans No 442, A cette époque,il était employé dans un système detransmission de données numéri-ques sans fil, mais la transmissiond'information audio ne nécessite quepeu de modifications du schéma ori-giîal.
Afin de ne pas pénaliser les lec-teurs qui ne possèdent Pas lenuméro de la revue Précité, nousallons effectuer un rapide survol dece composant à la cùcuitede élabo-rée.
Il se présente sous la forme d'unboitier classique à 18 broches renfer-mant I'architecture proposée à Iafigure 4. te circuii travaillant en FSK(Frequency Shift Keying), modula-tion par saut de fréquence, il estnécessaire de disposer d'un oscilla-teur commandé en tension (ou cou-rant) ainsi que d'une PLL (PhaseLocked toop), boucle à verrouillagede phase. Dans notre cas, c'est unICO (Intensity Controlled Osciltator),oscillateur contrôlé par courant, quiest utilisé pour des critères de stabi-
lité mais aussi de simplicité. En effet,on élabore premièrement une ondetriangulaire puis grâce à un confor-mateur, on obtient une sinusoide.
Lorsque l'on applique un Potentielhaut en pin(s), Ie 1893 se commuteen mode Tx (Transmitter). Durant cetemps, les informations injectées enpin(17) pilotent un modulateur quiva produire une altemance du cou-rant de charge sur la capacité d'oscil-lation CO (0,978111,02211 destinée àcréer une déviation de I'ICO (typi-quement égale à 2,2 %). ta triangu-Iâire traverse un atténuateur diffé-rentiel ainsi gue le conformateur designal (sine shaper). La tension sinu-soidale obtenue arrive dans un cir-
cuit à contrôle automatique deniveau (AtC) et têrmine dans unamplificateur de courant possédantun gain de 20Q, Ainsi, Ie potentiel desortie, introduit sur Ie réseau par untransfomateur associé à une capa-cité de couplage (Cc), se trouvemaintenu à une valeur constantequelle que soit Ia variation d'impé-dance du secteur. Le courant estlimité à un valeur maximale de60 mA. Pas d'écrêtage Possible,donc peu d'inteférences radio. Ladistorsion typique, avec un circuitoscillant de facteur O égal à dix'vaut 0.6 %. De même, la stabilité deI'amplificateur de sortie est assureepour toute valeur de charge et de
Radio Plans 5oO 69
déphasage. Au cas oir Ia puissanceémise s'avérerait insuffisante pourpermettre une transmission collec-te, le constructeur a prévu I'adionc-tion d'un module amplificateur quimultiplie par 10 la prrissance déli-vrée,
Pour un niveau logi(lue bas appli-que sur la pin(S), le circuit intéqrépasse en mode Rx (Receiver), ne va_Li-dant plus la section émission. Laporteuse ainsi que tous les bruitsparasites (transitoires, composantesdu reseau...) se heui;ent au filtrepasse-haut réalisé par I'associationde T1 et Cc. La porteuse produit uneexcursion de signal aux bornes deCq qui sera amenée à I'entrée durecepteur proprement rdit. L,amplifi-cateur limiteur, à entrées Norton.suppdme les offset's continus, attélnue la fréquence du réseau, ioue Ierôle d'un filtre passe-bande, ei luniteIe signal afin de piloter symétrique-ment la PLL dans de bonnes condi-tions. te signal démodulé disponibleen sortte du iomparateur de phasecontient des composanles continueset altematives ainsi qu'une compo-sante de fréquence égale à deux foisla fréquence de la porteuse. Cêsignal traverse un filtre RC passe-bas composé de trois étages avantd'attaquer symétriquement Ie circurrd'annulation d'offset. L'informationfinale est disponible aF,rès passagedans un filtre destiné à éliminer lesimpulsions de trop courte durée. Apresent, passons en revue guelquescomposants spécifiques à notreapplication.
LE TRANSFOBUATEUII DECOUPLAGE
II assure f isolation galvanique ducircuit imprimé vis-à-vis de la phasedu réseau. C'est le composant Ie pluscritique à déterminer. En effet, il laurun circuit couplé dont I'accord estinsensible aux modificat:ions de l'ùn-pédance de charge. Le couplage doitêtre suffisamment élevri pour per-mettre la transmission de la por-teuse modulée mais assez lâche afind'atténuer au maxirnum les transitoi-res au spectre presque aussi étaléque celui d'une impulsion de Dirac.Ce compromis délicat pourrait êtresupprimé si I'on séparait l'entrée deIa sortie : C'est ce qui s€! trouve misen æuvre sur ]e LM2893. Dans notrecas, le ccefficient de quirlité retenuvaut entre t0 et 15 au maximumpour éviter toute variation d'ampli-tude due à Ia modulation de fréquen-ce. Le constructeur précise une self
70 naato ptans 5oo
pimaire de 49pH er 0,98pHsecondarre avec prise inten
modification, on strappera les pin get 9 d'ICr et surtout, on omerEaRG (R44) qui viendra.it en parallèlesur la réslstance interne de contre-réâction et augmenterait la dissiDa-tion du circuit jusqu'à sa destructiôn.
Notez que la puissance de dutransformateur (Tr, d'alimentationconvient pour une version demaquette n'incluant pas l'étage tâm-pon. Avec OB (Tu), I'ondulation surla capacité de filtrage de têteaugmente et I'alimentation généralerégule mal, entrainant un mauvaisfonctionnement de I'ensemble.
L'ÉTAGE DE PwssANcEFACULTATIF
Il s'articule autour de OB dont lechoix nous a, ici aussi, posé quelquesproblèmes. Ce trânsistoir doit possé-der un fort gain en courant (Ê = 100),une fréquence de transition élevée(fI > = 50 MHz) et supporter à Iafois une puissance compdse entre 1et 2 watts, avec également des ten-sions supérieures à 60 V.
Le seul composant disponible quiait le profil. requis est le BD 137,classe 16 de préférence. On utiliserace transistor à I'exclusion de toutautre type. Cela ne signifie pasqu'un BD 135 ou autre ne donneraitaucun résultat, mais Ia baisse d'am-plitude enregistrée compromettraitles performances de votre maguene.RB permet de bloquer OB rapide-ment. Sa rapidité de blocage consti-tue un paramètre important puisquele slew-rate atteint 200 V/[S. Unevaleur de RB inférieur à 24 ohmsconduirait un courant excessif et sur-chargerait I'amplificateur. RG vienten parallèle sur Ia t0 ohms interneet porte le courant maximum de sor-tie à 400 mA au lieu de 60.
PROTECTION DU CIRCUITII peut arnver quelques fois que
des potentiels de niveau importanttraversent le transformâteur de cou-plage et détruisent la puce du cù-cuit. Pour son auto-protection, le1893 intègre une zénel de 44 V enséde avec une résistance de 20 ohms.
le
dans Ie cas d'impédancesinférieures à t0 ohms. Lesdésireux de connaitre les
ligne
relatifs à la détermination dufomateur, se reporteront à ladu fabricant.
National préconise desmateurs Toko dont leest donné en figure 5. Il n,y adifficulté pour se lesnous vous expliqueronsdans le texte comment lesle cceur vous en dit.
CHOI:X DE LA FRÉOUENCEPORTEUSE
Pour le choix de celmportant, il faut tenirdivers facteurs :- Faible atténuation due auxtantes réparties et localisées.- Bonne réjection du b0 Hzcircuit couplé côté 1893.- Fâible rayonneinentpour un récepteur radio.- Bande passante de I'1,0 kÉz.
C'est une valeur de 125 kHzété retenue par National lorsessais. Rien ne vous empêchemodifier selon vos besoins,le circuit travaille de 50 à 300On veillera simplement àles éléments duchoisir en conséquence lesvaleurs des composants de I'teur. Sachez pour information guecertaines fréquences n traverserlt lesmurs r (Garou-Garou... ?) etdonc se retrouver chez votre
AMPLIFICATEUB AVANTINJECTION
Le 1893 possède son propreficateur, comme nous l'avons ditcédemment. Il convient
vousrs demaisIoin
;er si
I Ases) l a
majodté des cas deréseau. Néanmoins, si laentre postes se révèlent troplors d'essais (réception deamplitude), on peut adjoindreétage de puissance tel celuici-après. Si I'on ne désire pas
1 ^
suI
Ainsi une diode suppresseuse desurtension, montée en parallèle avecIa précédente, conduirait ( Ia partdu lion D de tout courart imposé parun potentiel élevé en entrée du chip.ZT doit être utilisée à moins que desprécautions soient p ses pourproté-ger Ie circuit des transitoire duréseau ou ceux causés par Iadécharge de Cc lors de Ia connectiondu cordon secteur. Le cas le plusdéfavorable se trouve lorsque Ccdécharge Ia tensior crête-crête duréseau dans Ie circuit accordé. Onpeut se passer de ZT en employantun autre circuit de couplage, enmatériau magnétique saturable,placé sur le chemin du signal (untore par exemple). Evidemment,cette solution coûte plus cher qu'unediode Transil.
La seconde diode DT protège lecircuit contre une éventuelle largeexcursion négative du circuitaccordé (deux fois Ia tension d'ali-mentation). Ce compôsant n'a pasIieu d'exister dans notre montage.
MODULATION ETDÊMODULATION AUDIO
I1 est possible grâce au 1893 detransmettre un signal audio. Ce der-nier, injecté en pin(18) via une résis'tance de forte valeur, contrôle la fré'quence centrale au rythme de lamodulation. Il s'avère primordial delimiter l'amplitude du signal audio àune valeur telle que Ie circuit ne soitpas saturé. La démodulation s'effec-tue de manière linéaire grâce au PLLdu récepteur. Comme la circuitedeplacée après Ie comparateu dephase ne traite que des signaux digi-taux, il faut adjoindre un filLre ainsiqu'un amplificateur externes. Nousrzor ranc no le nhr< in in
C'est avec ce paragraphe que nousachevons la descdption rapide ducircuit de National. Ce dernier abd-tant une électronique assez com-plexe, nous ne pouvons ici Ie décrirecomplètement. On se repoItera à labibliographie donnée en fin d'articlepour obtent davântage d'informa-f i ^nê À ê^n Ê, , iô t
Enfin, lâ place nous manque unpeu, ce mois-ci, pour entamer la des-cription du schéma retenu propre-ment dit. Nous développerons cettepartie, dans notre prochain numéro.
A bientôt.
QtrQ-fAl r/'\--r-r rr-r ^ --r-ll'\N II rL\J
" ,JL,., I Ul-1É\ | l \Jl \
La société éditrice de Radio Plans procède actuellement à une restructuraiionde ses rédactions.
Dans la réorganisation de cette société, Ie poste de rédacteur en chef deRadio Plans, entre autres, disparaît, et ce numéro de juillet 89, ]e 500", est doncIe dernier auquel je paÉicipe.
Je voudrais remercier ici les lecteurs qui, au cours des 11 années durantIesquelles j'ai occupé cette fonction, ont témoigné à I'équipe rédactionnelle leurconfiance et apprécié les sujets dévçloppés dans Ia revue.
Je salue en pafiiculier les autelurs qui ont, pendant toutes ces années,apporié leur précieux concours à I'élaboration du journal, Je salue aussi lesprofessionnels de l'édition, (joumaliËtes, imprimeurs, photocomposeurs..,) et deI'industrie électronique avec qui les échanges furent professionnels et amicaux.
Mes væux de réussite accompag4ent ceux qui désormais auront la charge depoursuivre Ia parution de ce titre.
Christian DUCHEMIN
SGS-THCMSCN DOUBLELA PUISSANCE DE SORTIE
DES EMETTEURS rySGS-THOMSON offre désormais un trànsistor de puissance linéaire RF pour toutes les
applications relatives aux émetteurs T\l/ délivrant une puissance de 150 W à 860 MHz,soit presque deux fois Ia puissance de tout autre composant de ce type actuellementdisponible sur le marché. Conçu pour leF bandes de télévision IV et v (470-860 MHz), lesD 1492 comprend une métallisation ol et un ballast diffusé permettant d'accroître salinéa té et sa robustesse. Les autles points forcs de ce tuansisior sont un réseaud'adaptation d'impédance d'entrée intégrée permettant d'optimiser les peformancesen bande large et un câblage autoûlatique permettatt d'assurer un niveau élevéd'unifomité entre composants.
Le SD 1492 est conçu pour être utilisq dans une configuration à émetteu! commun declasse AB, et fonctionne avec une alinlentation 28 V. Les modules émetteurs ont étéconçus en reliant en parallèle des dispositifs multiples jusqu'à ce que la puissance desortie requise soit obtenue. La puissênce de sortie (150W) qu'autorise le SD1492permet de limiter Ie nombre de composênts nécessaires pour obtenir une puissance desortie donnée, réduisant ainsi très sensi,hlement Ie coût du module émetteur.
Le SD 1492 a été conçu en faisant appel à des techniques de traitement et d'assem-blage développées au titre de contrat$ militailes, pour la production de composantsutilisés dans Ie cadre d'émetteurs radat à l'état solides, dans les bandes UHF et L. Lesprogrès technologiques découlant de cès développements ont permis de produire descomposants padaitement adaptés aux émetteurs TV, aux brouilleurs militaires etautres applications nécessitant des putissances de sortie élevées, dans la gamme defréquence 470-860 MHz.L'utilisation de compo-sants à l'état solidedans ces applicationspermet d'éliminer I'in-contoumable temps deréchauffement destubes d'émission etévite d'avot à faireappel à des tensionsélevées et à un refroidis-sement par liquide. Unefiabilité élevée est assu-rée, grâce à ce type detransistors à métallisa-tion or.
c. BASSO
Radio Plans 5OO 71
' ] :
L'EUROP]E
je désire recevoir: B.P. o7l89- DOC U i\4 ENTATIo N ljojndre 15 F en timbres ou chèque)E COI/IIVANDE fcrèg ue joint - pod en sus)
iilo t ia r dF N
ËgnE-u
Références* 'gtit-o
t . 9F T
Not\/ .........................,................. prénomAdresse
t
IIOUVEAU
1er labode pocheSERIE I50
I
Vous avez apprécié cette revue, suivez le guide et partagez les vôtres…
Comment faire le vide dans vos placards, contribuer à la collecte du vieux
papier et emmener votre bibliothèque (Et celle des autres) en vacances sans
payer de surtaxe à l’aéroport.
Chapitre I : Découpage.
Pas le choix, un bon massicot capable de couper 100 pages (Ca existe ?) ou une latte, de préférence
en métal, un bon cutter et un support pour épargner votre table de cuisine…
Chapitre II : Scannage.
Si vous ou votre patron avez un scanner recto-verso qui converti en pdf passez au chap. III.
Sinon il vous faut au minimum un scanner avec chargeur (Ou être insomniaque). Il est important que
le programme de gestion du scanner soit convivial. Pour éviter/réduire les images fantômes du verso
de la page qui apparaissent par transparence augmenter lumière et contraste de 10-15 %, ça aide
beaucoup.
Scannez toutes les pages (1 pdf par page) impaires dans la directory 1 et renommez le début du
fichier (FileRenamer fait ça très bien, increment, step 2, start from 1) : 001, 003, 005… 055. (Par
exemple). Retournez le paquet, scannez dans la directory 2 (A l’envers, la première page scannée
sera la dernière du livre!) et renommez à l’envers (FileRenamer : decrement, step 2, start from 56) :
056, 054, 052… 002. Transférez les deux directories dans une directory commune et fusionnez toutes
les pages en un seul fichier avec votre prg favori. (PDF Tools de Tracker Soft fait ça très bien).
Tous les prg cités sont en version d’essai sur eMule ;-)
Chapitre III : Partagez.
Sur Rapidshare & co c’est bien mais encore faut-il trouver les liens et avoir la chance que les fichiers
n’aient pas été effacés… à la demande des éditeurs ! Torrent faut chercher beaucoup aussi, eMule il
faut un peu de patience mais on trouve tout et tout de suite. Merci de soutenir eMule. Si vous avez
des (vieilles) séries genre : Bateaux, Voile Magazine, Motor Boat, Neptune… merci ôssi, ça se fait
rare.
Au boulot…
Pour lire les revues un programme léger et très complet : pdfXchange viewer (Pro). A configurer par
défaut dans « affichage » : Afficher 2 pages en vis-à-vis + Afficher la couverture en mode vis-à-vis.
Vous aurez ainsi à chaque fois les pages paires à gauche et impaires à droite + F12 = plein écran.
Pour feuilleter les couvertures sous forme de vignettes un explorateur pas mal : XnView (Affiche à
peu près tout ce qui existe.)
Un programme qui fait les deux : Koobit, mais nombre de vignettes limité à 2 lignes.
En ligne prochainement plusieurs centaines de Radio Plans & Elektor depuis les années ‘70.
Faite une recherche avec « index radio plans electronique maj » ou « index elektor electronique
maj » pour la liste complète des sommaires.