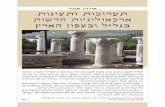Toute la Radio n°196 06/1955 - retronik
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Toute la Radio n°196 06/1955 - retronik
ffrnr.:Ttrt3y^yr?Tr£r:ji.ii±iid:rtrrt4trrrt
T‘3HtriTÎT^HS:lipSlpM^:rii:Pitrnit-ttHiltil-Üt:•
ESCM f
tMIVm* NUMÉRO 196ffft7Rf: m5 n; e mri mriffi ~r :ï :LrrrrHr Xj
H f Irrnrntilt 31 LILLii;
UH»t{
±i-3+nfcrplU
agi
rrfë+H-rgma
pn^P 1B *-rrrtT
gfoaiî ti]
REVUE MENSUELLE DE TECHNIQUEE X P L I Q U E E E T A P P L I Q U E EPUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE
E. AISBERG
Le progrès 189k Tube cathodique plat . 190k Les radars modernes . 191k Deux amplificateurs à
transistors . . /96 XNouveaux tubes 1955. 202
k Pièce Détachée àLondres 203Foire de Hanovre . . 204GUIDE DES TUBES . 206
k Le magnétron . . 209k Installation des auto-
hntflGradio 211 1571
T élé-Luxembourg . . 2 / 9 I roRevue de la Presse . 223 [niU
ZH&WJLTY 1.B. F. H
k LeT1.R.196,amplifica-teur 9 W économique. 215
k Lecteur moderne pourcylindres et disques àsaphir 221
CI-CONTREEncore un succès de FIRVOX ! Voicile récepteur "Radioauto RA 37-55",fabriqué cette année en grande série
par cette firme dynamique.Les qualités remarquables enparticulier la sensibilité — du RA 37 Mar v-.FIRVOX ont étonné tous les techni-
ciens français et européens.
PAGE 211 :
I N S T A L L A T I O N D E S A U T O- R A D I O\
L'INDICATEUR D'ACCORD#/
l
NOVALDE LA SÉRIE
Courbes indiquant la sensibilité de l'EM 80.^-j~ donne le pourcentage de variation de la partie
luminescente par volt CAG.donne le pourcentage de variation de la partie
ombrée par volt CAG.
Très grande luminosit é.
Peut être monté sur le châssis même : simpli-fication et économie dans le montage.Grande sensibil ité pour les signaux faibles.Large champ d'épanouissement de la surfaceindicatrice.
UN TUBE
LES TUBES QUI ÉQUIPENT LES POSTES MODERNES
LA RADIOTECHNIQUE - Division TUBES ELECTRONIQUES - 130, Avenue Ledru-Rollin - PARIS-XI'Usines et Laboratoires à CHARTRES et SURESNES
C OBG* 103
&/Zon&rosT o u j o u r s à S ?a v a n î - g a r d e d u p r o g rè s
P R E S E N T E
UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
R I O" Le /J /us petit Poste à Piles (lu Monde
r é u n i s s a n t à l a f o i s
* 4 TUBES SPECIAUX DE CONSOMMATION REDUITE (SERIE 96 ) .* 2 GAMMES D’ONDES ( P.O.-G.O.).* UN HAUT-PARLEUR SPECIAL 10 cm.
ir UNE PILE COMBINEE 1,5 volt - 67,5 vol ts, DE LONGUE DUREEUNE SENSIBILITE EXTRAORDINAIREPRESENTATION LUXUEUSE - COFFRET PLASTIQUE REHAUSSE
D’OR
Dimensions : 190 X 120 X 49 mm. Poids : environ 1 ki log
TOUTE UNE GAMME DE PORTATIFS PILES- SECTEURS
I L I PP ER h K Y- M A5T E R
PORTATIFS PILES-SECTEURS ACCUS8 Lampes américaines — 8 gammes dont 6 bandes O.C. étalées —Antenne télescopique à verroui l lage automatique — Musical i té et sensi-bi l i té exc:ptionnel les — Tonal i té, consommation sur pi les et sensibi l i tér églables par touches spéciales ( Cervo-matic) — Piles de t rès longue
durée — Châssis ent ièrement cl imat isé — Présentat ion de luxe
6 lampes ( valve sélénium incluse )( bande 49 m. étalée ) — H.P. el l ipt ique 19 cm.sensibi l i té extraordinaires — Cadre Ferr i loop et Antenne Télesco-
Pil:s de longue durée
H.F. accordée — 4 gammesMusical i té et
Présentat ion110-220 V .piquede grand luxe — Dim. : 33 X 23 > 12 — Poids avec pi les : 5 kg 500
R E G E N C YSUPER PLAYTIME NE W - C L O C KU N P E T I T P O S T E S E C T E U R
D E G R A N D E S P E R F O R M A N C E SP O R T A T I F P I L E S S E C T E U R S
A L A M P E S + V A L V E - 3 G A M M E S - A N T E N N E T E L E S C O P I Q U E
L E P O S T E D E C H E V E T
D E F O R M U L E M O D E R N E ( P O S T E R É V E I L:
et après plusieurs aimées d'études m m m
T E L E - K I N CUN T É L É VISEUR EXCEPTIONNEL
26 TubesEt pour la lr fois, le SON STEREOPHONIQUE donné par 2 H.P. avec canaux séparés pour graves et aiguës
P R ÉS E N T A T I O N S U P E R-L U X E
TOUS CES MODÈ LES SONT EXPOSÉS A LA FOIRE DE PARIS -
Ecran 54 cm — Multicanaux (12) — Comparateur de phase — Antiparasite incorporé
D E M I -C O N S O L E
GROUPE RADIO-TELEVISION STAND 11.723
S.A. CAPITAL 20.000.000wmÈÉÈÈmP U B L. R A P Y
III
Au service de l’ EIansUn amplificateurde la série 600Tous les perfectionnemeToutes les possibilités
Amplificateur 1Q àa 400 wattssans T.D. et avec T.D.3 vitesses ou 78 tours.Pick-upAmplificateur maQnétique.
avec radioAmplificateurAmplificateur valise
batteriePortable
3 à 10 watts
i-compres-et sem»
de compressionrectangulaire.Chambression circulaire et
microphoniquei.amplibcateur
Mélangeur presimple et électronique.
acoustiquendementColonnes à grand re
10 - 40 - 100 watts.
Tous accessoires :supports de microphone,
transformateurs de lignes,
Faders, fiches et connecteurs, etc-
Catalogue fechni/quegrataif sursimple demandec
Ma/lette*ourne-disques33-45-78 tours
colorisVneri OU go/dPrix de *'ectr°Pho„e33-45.78vente toursen France12 960 fr. Puissance 3
H• P- 170(T. L. watts
spécial •alternatif 50 per110/220
sus) ,r*corp0ré
vo/fs
' co/or,'s vertPrix de
ou bordvente en F28.500 fr. (T !
eau*fance
sus)L en
PARIS• PIC 53-84ornas
DAMS LE CADRE DE SES TRAVAUXSUR LES SEMI - CONDUCTEURS
LE DÉPARTEMENT DE RECHERCHES PHYSICO - CHIMIQUES
propose ses
iTO- CELLU LES
ERMAN1U]
U t i l i s a b l e s p o u r l a d é t e c t i o n d ef a i b l e s e t f o r t s é c l a i r e m e n t s! i
/ /
L E C T U R E D E S O N
REP É RAGE DE PI È CESE N M O U V E M E N T
MESURE D' INTENSITÉ SL U M I N E U S E S
C O M P T A G E
C O M M U T A T I O N
LECTURE DE CARTESOU BANDES PERFORÉ ES
P R O T E C T I O N
C O M P A G N I E G E N E R A L E D E T . S . F .DÉPARTEMENT DE RECHERCHES PHYSICO - CHIMIQUES
P U T E A U X - 12, RUE DE IA R ÉPUBLIQUE - ION. 28 - 86
PUBL . RAPY
UNE VOITUREVOITURESPARTICULIÈRESmm PROFESSIONNELS •••
Le matériel d'équipement de voituresautomobiles PAUL BOUYER et C°a été conçu spécialement pour vous
mP L A N I F L E X
0mm CAMIONNETTESF A C I L I T E R L A T A C H E
I N S T A L L A T I O N R A P I D EF O N C T I O N N E M E N T S I M P L EROBUSTESSE A TOUTE ÉPREUVECONSOMMATION TRÈS RÉDUITEGRANDE RÉSERVE DE PUISSANCEP R I X T R È S A B O R D A B L E SVENTE FACILE - PEU D'ENTRETIEN
Wl
H0CARS ETCAMIONS PUBLICITAIRES
C'est ce qui explique que notre matérielait été sélectionné par les firmes lesp l u s e n v u e p o u r l e u r s v é h i c u l e spublicitaires-.
p£Bÿj
mm,
[ E N S E M B L E U&JÔ)ETSmm.S. C. I. A. R. D(St. EXCLUSIF
7 ,RUEHENRI-GAUTIER - MONTAUBAN(FRANCE) - TEL = 8-80 -
: B U R E A U X D E P A R I S9 bis, RUE SAINT-YVES - PAftlS-14*
TEL : GOBELINS 81- 65M
S.A.R.l.ou CAPITAL de 10.000.000 de Frs
VI
HOMOLOGATION C. C. T.U. • CATÉGORIE III N° 54-01
CONDENSATEURSTYPE E.1500
MOULÉS DANS L ARALDITE * A CHARGE SPÉCIALEBrevet Fronç ais N° 642.559Normes Franç aises C.C.T.U.Normes Américaines JAN C 5
TEMPÉRATURES EXTR ÊMES -70° C + 1 20° C
L'étanchéité au vide est véri f iée pour chaquecondensateur sortant de nos atel iers.
Nous garantissons que ces condensateursrestent étanches après que tous les essais cl i-matiques prévus par les normes Françaises etAméricaines ont été effectués, ainsi qu'aprè s
nombre répété de cycles rapides deuntempérature.
Ces condensateurs sont à l’épreuve des moi-sissures et des broui l lards sal ins.
Le moulage, effectué à basse pression, nefait subir au mica nul le contrainte, ce qui as-sure la stabi l i té des condensateurs.
Grâce à leur surtension élevée en hautefréquence,i ls supportentune puissance réactivenotable, ainsi que des courants eff icacesimportants.
Ils s'emploient aussi bien sur les f i l t res de>haute quali té que sur des circuits d'émission. a.
. sur les radars de bord que sur les postes dès- crt inés à la brousse,aupôle comme à l'équateur,àla surface de la mer comme dans la stratosphère. CQ
3• Marque déposée de CIBA. Q.
17,RUE FRANCGEURP A R I S - 1 8 ?
TEL. MON.02-93.61*19
VII
°HMlc TOUTES LES RESISTANCES
RÉSISTANCES MINIATURES AGGLO-MÉRÉES ISOLÉES 1 /2 ET I WATT
RÉSISTANCES AGGLOMÉRÉES ORDI-N A I R E S 1 / 4, 1 /2. I, 2. W A T T S
dewattRESISTANCES BOBINEES CIMENTEES
1
69,r.ArchereauRÉSISTANCES BOBINÉES VITRIFIÉESP A R I S .1 9 eTYPE TRACTION
TÉLiCOMBAT 67-89
DOCUMENTATION TECHNIQUE DE TOUTES NOS RÉALISATIONS SUR DEMANDE
MATÉRIEL HOMOLOGUÉ CCTU (certificats n« 54 09 54 08ET CONFORME AUX NORMES MIL
54.14 - 54.19)
VIII
Crra/ joa CCR
m
Vous cherchez pour votre poste portatif une sourced’alimentation irr é prochable .Vous trouverez dans la gamme des fabrications Ledanche•Des batteries de tension à éléments cylindriques ou plats.•Des piles de chauffage à éléments cylindriques.•Des batteries combinées haute tension, basse tension
permettant d'é quiper tous les mod è les d' appareils etassurant sous un faible poids et un encombrement ré duitle moximum de capacité .
Renseignez-vous plus amplement sur nos fabricationsDemandez- rious notre documentation “ RADIO”
LA PILE
LECLANCHÉ 0.5
CHASSENEUIL (Vienne) SJ«v.v.v.v.v-
à
mm•V
RADIO • ÉCLAIRAGE • FLASH • SURDITÉ • INDUSTRIEIX
P O U R T O U S L E S E M P L O I S
aASi ,nte/i / teb4e.D A N S T O U T E S C O N D I T I O N S
cJtoleu/i,humtcMç.les condensateurs au micamétallisé sous gaine céra-mique moulée étanche de . .la série PRC se sont révélés ...H(/l4 CU244&•Tropicalisation intégrale.Tous les condensateurs aumica:imprégnés sous vide, cire,ou silicones.tous les traitements de pro-tection : polyesters, émail.
I!,V.V.
Mi&••••••••• i••••i ••• i••••••• i
\ i•••••••• ••• '
**•* •••\\V.••••t••i •.•••• • .••••• •• /Z^nr/?\• •• •
• •••• • # • •• • S• •••• ••
ANDRÉ SERF et CieJ/té&tUûfei défaits /925
127, Fg du Temple, PARIS. Tél. NOR. 10-17
lI 72.RUE DES GRANDS-CHAMPS.PARIS ( 20e)
TEL.: DID. 69- 45Les fngénieufisJimctccy fceusus
PADio AlRm
MATERIELtropica//sé 7;
Grâce a sa TechniqueEntièrement nouvelle,
le Poste ci-contreCapte les stations Mondiales
sans Antenne, sans Terre pSANS PARASITES
Musicalité incomparable àlÆ"R A D I O C A P T E"Ilest le Poste de demain È.
Il est équipé du célèbre SélecteurCAPTE
l* •!»»,PARASITES i )"* . ;
Qm m
!Ar FICHES DROITES OU COUDÉES6 Lampes.PRIX : 29.800 T.T.C.antiparasites intégral :
5
IPrtr/inrnpfo i 5 boî tiers de différentes di-mensions - 37 dispositions decontacts - 10-20-50 ampères. cmw =CAPTE, Roi des Cadres anti- £ r
I Demandez notred o c u m e n t a t i o n
parasites fait leTour duMonde SIl s'adapte sur tous les Postes a
Zde Radio pour en augmenterP u i s s a n c e — S é l e c t i v i t é
Rendement 2,AVe DE LA MARNEASNIÈRES (Seine)TÉ L : GR É 47- 10
Demandez notre documentation
' 32, COURS DEGRENOBLE LA LIBéRATION
TÉLÉPHONÉ 2-26
78. CH. - ELYSÉESTÉL. . ELY 99-90PARIS
X
mm®
STATIQUE
Les progrès de tatechnique acoustique sont considérables . . .Les émissions de la Radio, de la Télévision, la modulation de fréquence
en s o n t l a p r e u v e.Devenez exigeant pour votre Haut-Parleur
Réclamez un
y
IliSiill mm§ .
ma»mHS
ï 'mm*
'
ï.M
mi A U D A Xw<.r*
» , A/
: ,v
AUJDA9B OéP. EXPORTATION:SIJEMAR 62,R.DE ROMEPARIS~Ôf
45/ AV. PASTEURMONTREUIL (SEINE )
^R.57-03;{5 iigru groupées)S. A. au capLiai de62m/f /tons de francs
\ LAB. 00-76
XI
mm: '
BH
251.253 F.c S - MARTIN
La"Fièvre" du secteur est mortellepour vos installations
PROTEGEZ-LES>avec desrégulateurs de
\
m3(T. m
teqsiodS^S^automatiquesm
m
(Y ATRAPARIS 19e
0 Télé: NORD 32- 48
SURVOLTEURS-DEVOLTEURS > AUTOTRANSFORMATEURSLAMPEMETRES - ANALYSEURS
41,RUE DES BOIS,41
ps sz:ær,n «7.==ÎK Si,'S.'iS' 'c‘uS0" ”1°T'fV3- *»«»«
^ ers VMM LtK MtYDEN, 20, Rue des Bogards, BRUXELLES
XII
leest un n.o ne
É LÉGANT, PORTABLE ET DOT É DE LA HAUTE QUALITÉ QUI DEPUIS PLUS DE 50ANS A FAIT LA R ÉPUTATION DE TELEFUNKEN DANS LE MONDE ENTIER.
REPRODUIRA AUSSI FIDELEMENT LES GRANDS DISQUES DEMUSIQUE CLASSIQUE QUE LE JAZZ.
EST LE PRESTIGIEUX CHEF D ORCHESTRE DES GRANDS FESTIVALSET L’ANIMATEUR DES RÉUNIONS DE DANSE.la musicalité
TELEFUNKEN Mallette électrophone de luxepour courant alternatif comprenant :Un tourne-disques 3 vitesses (33 1 3, 45, 78 fours) à changement de vitesse par levier; brasde pick -up compensé avec cellule de grande fidélité, saphirs de longue dur ée.Un amplificateur incorpor é 3 watts modulés, à large bande de fréquences (35 à 12.000périodes), donnant une musicalité exceptionnelle. Equipement en tubes : I-6 AV 6, I- 6BM5;1 redresseur sec AEG E 220 C 50 L, voyant lumineux (lampe témoin 6,3 V O, 3 A.). Réglagede puissance avec interrupteur, réglage de tonalit é à variation continue. Commutateur de tensionsimultané pour le moteur et l ’ amplificateur.
Un haut-parleur 19 cm. monté sur baffle dans le couvercle; ce dernier est amovible et permetd'utiliser le haut -parleur à distance de la mallette. Possibilit é de branchement d 'un secondhaut -parleur ( impédance environ 3,5 à 5 ohms).
HtB FidélitéPuissance
3 vitesses
P R É S E N T A T I O N L U X U E U S EExtérieur : tissu-cuir bordeaux , serrures de luxe et garnituresmétalliques en laiton doré.Intérieur: façon parchemin.Dimensions extérieures : 435 x 340 x 195 mm.
: 7 k. 800 environ.Poids
39.000 FRPRIX :
Les radio - électr ic iens et les disquaires
pour don-
ner une sat isfact ion totale à leurs cl ients
doivent acheter le
Distr ibué par 1903-1953la M U S I C A L I T É T E L E F U N K E Navec
TELEFUNKEN-FRANCE S.A.s.a. au capital de 25 millions - 44, rue Alphonse-Penaud, Paris- XX* - MEN. 70-75
XIII
UNEPRESENTAT/ON .
DE GRAND LUXE/TOURNE-DISQUES
3 vitessesPick-up électromagnétique
Modèle HL5 - platine 400x310
364354
20 à 20.000 p. saphir ou diamant0 V,02 sans préampli — 2 V avec préamplificateur correcteur69
Modèle HL4B - 20 à n.000 P/ s.cm >û.
O V,25 saphir ou aiguille<aI M A G E S T A B L E E T C O N T R A S T É EB A N D E P A S S A N t E T R È S L A R G EB L I N D A G E S A N T I P A R A S I T E S
MODELES SP É CIAUX POUR GRANDE DISTANCE
-j PLATINE PROFESSIONNELLE type ECODa
P.CLÉMENTDUCASTEL FRERES FOURNISSEUR DE LA RADIODIFFUSION FRANÇAISE106,R.DE LA JARRY,VINCENNES (SEINE)-DAU.35-62208bis,rue Lafayette,PARIS lOMel:NORD 0174 w
Agent pour la région lyonnaise :M. J. TACUSSEL, 14, rue du Docteur-Mouisset - LYON
fcu/ouhi nette...
malgré lesvariationsdu secteur
Utiti&ei.RÉGLOVOLTREGLAGE TRES ETENDU QUELQUES O I T L E M O D E l E D E T E L E V I S E U R
Unefihésentation inédite!DOCUMENTATION SUR DEMANDE
TI 79, BOULEVARD LEFEBVREPARIS 15« - VAU. 20-03 4-
A.N.A.sMr PARIS.9i LAH. 77-72
XIV
195424.000-|—22.000—20.000—18 - 000-—
16.00014.000
2ème VAGUEOctobre 1954
10.000.000 frsTÉLÉVISION
112.000TÉLÉVISEURSVENDUS !
G R A P H I Q U E D E S V E N T E S M E N S U E L L E SC O M P A R ÉE S : 1 9 5 4 -1 9 5 3
12.00010.0008.0006.0004.0002.000
1 9 5 358.000TÉLÉVISEURSVENDUS
-
1*r« VAGUEJuin 1954
10.000.000 frs
O N DA SMF J
RADIOG R A P H I Q U E O E SV E N T E S T R I M E S T R I E L L E SC O M P A R ÉE S : 1 9 5 4 -1 9 5 3 3ème VAGUE
Décembre 19541 5.000.000 frs I954400.000
950.000POSTESVENDUS !
350.000
300 000 1 9 5 3850.000POSTESVENDUS
250.000
200.000
I50.000
L’APPUI TOTAL ET GRACIEUX DE LA R.T.F.Ces 3 vagues de publicité ont été puissamment soutenues par la Radiodiffusion-TélévisionFrançaise, dont les émetteurs des 3 chaînes diffusent depuis Juin 1954 des communiquéspublicitaires en faveur de la Télévision et de la Radio.UN MOUVEMENT D’OPINION !Notre campagne de propagande a déclenché dans la presse un trèsvif mouvement pour le développement de la Radio et de la Télévi-sion en France. Nous avons suscité ainsi de nombreux articles, re-portages, chroniques qui. obtenus gracieusement, renforcent encore ~ y ^ Snotre action - *
sr ^Y .LUs<4S
f%'A
"
l I » I gpm*mm0k %>% &^nrJ»i|- f?l fniafesftlil**liÿS
• . •mil
CANETTIftAéteufe, jâtni uurfekie£dec&iMepeidl
fRADIO-TÉLÉVISION-ÉLECTRONIQUE
les RESISTANCESisolées ERIEnégatives BRIMS5TORSles CONDENSATEURS
ImERIEcéramiques
électrolytiques DUCATIBELTON
' les LAMPES et TUBES CATHODIQUESBRIMAR
les POTENTIOMÈTRES
mpapier •FILS DE CABLAGE mM•CABLES COAXIAUX »(Normes françaises et américaines)
" FILS ET CABLES BLINDéS maluminisés •GAINES ET TRESSES CUIVRE m
•CABLES DE LIAISON H.F. & B F. $•CABLES MULTIPLES âmmRELIANCEbobinés
SSFIIOÎEXf/ /
S.A.R.L. au capital de 50 millions296, avenue Henri-Barbusse, DRAVEIL (S.-& O.)
Téléph.: Belle-Épine 55-87+55 PUBL kA»>
BOVELLI s?e T\v aANDES FILMS DISQUESM A G N É T I Q U E S
//m m’
.jsf _•
mm **:>- •i••• Zi--
SS rs*^lti<>*s i: MI La Bande Magnétique W.S.M.m
\ _;â*52ï * EXTRA -MINCE>v * :
•\ »iré
TRANSFORMATEURS“^ALIMENTATION sur support vinyl de 40 MICRONS permet,
avec votre matériel existant, d'augmenterde 30 % la durée de vos enregistrements.
m 118s v.f MCIMWk i
i M
I SELFS INDUCTANCETRANSFOS B. F.
TOUJ modèles pourRADIO - RÉCEPTEURSAMPLIFICATEURSTÉLÉVISION
# *::
:. f • TV fM; 1i1? •î» La W.S.M. se fait en
60 mètres sur bobine plastique de 75 mm (3")i
•Amm 125 90 mm (3,5”)
127 mm (5”)152 mm (6”)177 mm (7”)
> JfMatériel pour applicationprofessionnelles
Transfos pour tubes fluorescentsTransfos H. T et B. T.
pour toutes applications industriellesjusqu’à 200 KVA
RH 250V 340»
500m y Consultez votre Revendeur habituel.WH réJu J//////7/,il144.
7E2 VEDOVELLI.ROUSSEAU ïï A* /À
J /? A5,Rue JEAN-MACÊ , Suresnes ( SEINE) • LON.14-47,48 & 50 k
VENTES : 33, RUE DE IA FOLIE-MÉRICOURT - PARIS XI* - VOL. 23- 20 tt 23-21U S I N E : 3 5. R U E V I C T O R - H U G O - I V R Y ( S E I N E ) - I T A . 4 4*54Dép1 Exportation 1 SIÉMAR, 62, rua da Rom», PARIS-8* H» \
\
XVI
**%*£»•TÉLÉVISION
à
AMPLIXprésente F ^
son RÉCEPTEUR PILES-SECTEUR mm
CAPRI99
Portable à pilesi n corporées,p r é v u s u rdemande pourfonctionnementsur courantalternatif paradjonction ra-pide d'un socled'alimentation.
GENERATEURD ' I M A G E
DEUX MODÈLES1 - 625 LIGNESentrelacee*
2 - 8 1 9 LIGNESentrelacées
(sans socle)
4 lampes, H. P. ticonal 12 cm4 gammes : PO - GO - BE - OCCadre antiparasites incorporé
Antenne télescopique permettant lar éception desp r i n c i p a l e sstations OC et BEP r é s e n t a t i o ncoffret matièrep l a s t i q u e, 3coloris au choix :
ivoire,bordeauxou vert
R -
£3Modèle 819 I. entrelacées
•Contrôle de la bande passante jusqu'à 10 Mc /i•Signaux de synchronisation conformes au standard otticie•Porteuses H.F. SON et IMAGE stabilisées par quartz•Entrée pour modulation d'une porteuse H.F. extérieur»
'i - Ujj
Sh —»
1 •2 Sorties vidéo — 1 Sortie H.F. moduléey •Possibilité de montage en rack normalisé
Modèle 625 I. entrelacées
•Appareil identique auprécédent adapté aux normes CCI.R•Chaîne stabilisée par quartz - Synchronisation indépendant*du réseau d'alimentation.•Signaux de synchronisation conformes au standard C.C.I.R•Contrôle de la bande passante de 4 à 7 Mc /s•Entrée pour modulation d'une porteuse H.F. extérieur*Dimensions :
(avec socle)265 x 170 x 80 mm
SIDERONDYNEDOCUMENTATION SUR DEMANDESOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'ÉLECTROTECHNIQUEAMPLIX ET DE RADIOÉLECTRICITÉ
« 75 ter, RUE DES PLANTES - PARIS (14e)Tél.: LEC. 82-30a.
34, Rue de Flandre — PARIST é l é p h o n e : C O M . 6 6 - 6 0
AGENTS : LILLE Ets COLLETTE, 8, rue du Barbier-Maës •STRAS-BOURG:M. BISMUTH, 15. Place des Halles •LYON: M. G. RIGOUOY38, Quai Gailleton, •MARSEILLE: Ets MUSSETTA. 3, rue Nau. •RABAT: M. FOUILLOT. 9, rue Louis-Gentil.BELGIQUE:M. DESCHEPPER, 40, Av. Hamoir. UCCLE BRUXELLESPUBL. RAPY
XVII
Equipez vos fabrications avec MÉLODYNE
T y p e 3 1 5
ÊÊÊêSMWmmmàmZmMmmmmmmmm
IMNHMMMMMi
PLATINE TOURNE- DISQUESu*t4t/&ft&e££e,
à CHANGEUR ( 4 5 t o u r s )
WÊÊKÊÊÊÊP« r1MMP~P L A T I N E R É D U I T E3 v i t e s s e s 3 3 , 4 5 , 7 8 t o u r s
L a m e i H e u r e p l a t i n ee s t s i g née•••
PATHÉ-MARÇONIP r o d u c t i o n g a r a n t i e1
251 - 253, R. du Fg. SAINT-MARTIN - PARIS- X' - Tél. : BOT. 36-00
PUBL.RAPy
XVIII
LE PROGRESchevaliers du MoyenOUS autres
Age... ». La boutade est applicableà toutes les époques. Savons-nous dequel vocable la nôtre sera désignée dansles temps à venir ?
d'en déterminer et modifier à volontéles caractères. Et lorsque le même pro-fesseur aura décrit nos moyens de loco-motion (se situant surtout à la surface dela terre), nos appareils de télécommuni-cations, il aura du mal à faire admettreque nous n'étions pas moins intelligentsque nos arrière-petits-fils.
Le fait est que le progrès biologiquen'a point la vitesse du progrès matériel,si tant est que l'être humain s'amélioreau cours des siècles. On peut même af-firmer que le mathématicien contempo-rain d'Euclide ou de Diophante étaitdoué d'un esprit autrement souple quecelui qui, de nos jours, étudie la géomé-trie ou l'analyse pourvu du confort dessymboles économisant l'effort intellec-tuel.
NR E V U E M E N S U E L L E
D E T E C H N I Q U EEXPLIQUÉE ET APPLIQUÉE
Nous croyons vivre à l'ère atomique.Ce terme n'a guère de chance d'êtremaintenu, pensons-nous. Peut-être le mi-lieu du vingtième siècle sera-t-il plutôtconsidéré comme le début de l'ère dessemi-conducteurs. En effet, le remplace-ment progressif des dispositifs encom-brants et peu pratiques, nécessitant l'em-ploi d'une enceinte évacuée, par des so-lides de très faible volume, est un desfaits marquants de notre époque.
Il y a quelques années, Jules Romainsa affirmé que le progrès technique etscientifique, dont la cadence n'avaitcessé de s'accélérer depuis le début dusiècle, allait ralentir. Nous nous sommesélevés contre cette allégation et, inter-polant la courbe du progrès, avons crupouvoir dire que son allure ascendantene pouvait que s'accentuer.
Les récentes années semblent nousdonner raison. Dans tous les domaines,la science et la technique ont avancé àpas de géant. Le perfectionnement desmoyens d'investigation permet de péné-trer plus aisément les secrets les plus in-fimes de la nature, et leur connaissancefacilite à son tour la création de nou-veaux outils de recherche de plus en pluspuissants. C'est dire que la marche duprogrès peut être assimilée à la boule deneige qui grossit sans cesse et avancede plus en plus vite. Nous dirons qu'il ya une bonne réaction positive... maisgare à l'accrochage !
Pas plus que les chevaliers du MoyenAge ne parvenaient à réaliser le carac-tère de leur époque, nous ne parvenonspas à prendre nettement conscience del'aspect révolutionnaire de la nôtre. Biensouvent nous éprouvons la tentation deretracer ici ce que pourrait être, en l'ande grâce 2050, la leçon d'histoire consa-crée au milieu du vingtième siècle. Leprofesseur aura quelque peine à expli-quer à ses jeunes disciples que nousn'étions pas maîtres des conditions mé-téorologiques et que, passivement, noussubissions le temps qu'il faisait au lieu
Directeur : E. AISB ERGRédacteur en chef : M. Bonhomme
22e ANNÉE
PRIX DU NUMÉRO 150 Fr.
A B O N N E M E N T D ' U N A N(lO NUMÉROS)
- 1.250 Fr.- 1.500 Fr.
FRANCEÉTRANGER
Changement d'adresse: 30 fr.(Prilr* de joindre l'adresse imprimée sur nos
pochettes)
Tout le drame de l'homme moderne apour origine Ienorme décalage entreson évolution organique, extrêmementlente, et le changement de plus en plusrapide des conditions de son existence.Il est temps que la génétique, de simplescience d'observation méthodique, semue en une technique d'eugénisme per-mettant de mieux adapter l'homme auxconditions actuelles de l'existence grâceà une sélection dirigée de ces agentsd'hérédité que sont les gènes.
• /
• ANCIENS NUMEROS •On peut encore obtenir les anciens numéros à partir dunuméro 101 (à l'exclusion des numéros 103, 138, 150,151, 163,168, 174, 180, 181. 182, 183, 184, 188 et 194
épuisés).Le prix par numéro, port compris, est de :
No»No* Fr* Fr*124 à 128 . .129 à 139 . . 100140 à 151 . . 110*52 à 159 . . 130
85101 et 102 . . . 50104 •108 . .109 à 119 . . . 60120 à 123 . . . 70
N®> 160 et suivants . . . 160 FrsCollection des 5 "Cahiers de Toute la Radio":220 Frs
55
La courbe du progrès atteindra-t-elleun jour le palier horizontal de la satu-ration ? La science sera-t-elle un jour« complète » ? Il y a longtemps qu'HenriPoincaré a répondu à cette question.Plus nous étendons le cercle de nos con-
T O U T E L A R A D I Oa le droit exclusif de la reproduction
en France des articles deR A D I O E L E C T R O N I C S
naissances, a-t-il écrit, et plus grande estla frontière avec l'inconnu. Plus noussaurons de choses et plus il nous resteraà en apprendre.
Risquons-nous un jour, en rendant lesmoyens de production plus efficaces etplus automatiques, de produire trop debiens ou de condamner des ouvriers auchômage ? Ni l'un ni l'autre, assurément.En libérant l'homme, la machine lui per-mettra d'avoir de plus en plus de loisirs,c'est-à-dire d'avoir de plus en plus detemps et de moyens pour consommer.
Tout cela, à la condition, bien enten-du, que le cœur aide à orienter dans lebon sens les activités du cerveau.
l«a articles publias n'engagent que la respon-sabilité de leurs auteurs. Les manuscrits non
insérés ne sont pas rendus.Toui droits de reproduction réservés pour tous pays
Copyright by Editions Radio, Paris 1955
PUBLICITÉM. Paul Rodet, Publicité RAPY143. Avenue Emile-Zola. PARIS-XV®
Téléphone : Ségur 37-52
S O C I É T É D E S-, ' ::
EDITIONS RADIOA B O N N E M E N T S E T V E N T E :
k ':Rue Jacob - P A R I S - V I-:.O0£. 13-65 CC.P. Paris 1164-34|Ç
R É D A C T I O N4 2. R u e J a c o b
E.A.M*P A R I S - Y r
‘Mk UT. 43-83 et 43-84
ElectronicsTele'TechRadio-Electronics
RadarAviationTélévision
cathodiiqueh
Un tube cathodique assez extraordinaire vientd’être inventé aux Etats-Unis par les techniciensde la division électronique de Willys Motors. Dif-férentes revues d’Outre-Atlantique s’en sont faitl’écho ; nous tenons à citer notamment Electro-nics de février et mars 1955 ; Tele-Tech de mars1955 et Radio Electronics du même mois. Conçuau départ pour des applications militaires, le nou-veau tube, qui se caractérise principalement par lagrande réduction d’une de ses dimensions, nemanquera pas, s’il se révèle commercialement via-ble, de modifier profondément l’aspect de latechnique des récepteurs de télévision.
bre des principaux éléments de vol : al t i tude,vitesse , régime du moteur, combustible enréserve, etc. sans oublier, bien entendu, lesprécieuses indicat ions du radar, lesquellespourraient en part icul ier être présentées detel le sorte qu’une ligne ( pas forcément unedroite ) d'horizon lumineuse se superpose à lal igne d'horizon réelle. Ainsi, en cas de mau-vaise visibi l i té, le r isque de percussion d’unobstacle ne serai t s tr ictement pas plus grandque par temps clair.
Toujours en partant de cet écran-pare-brise, une forme nouvelle de tableau de borda été élaborée, dans laquelle les deux prin-cipaux instruments deviennent le tube lui-m ême, uti l isé comme il vient d’être dit , e t
res de précisions techniques. Tout au plusavons-nous pu apprendre que des tubes platsde 30 centim ètres avaient dé jà été construi ts,
dont la surface d’écran étai t équivalente àcelle des tubes classiques de 50 centimètres.Leur profondeur ne dépasserai t pas 3 pouces,
soi t 75 mill im ètres. Quant à la finesse d’ex-plorat ion, el le serai t t rès grande puisquenous avons vu citer le chiffre possible de2000 lignes.
Rien ne s’opposerai t donc, au contraire ,à l’ut i l isat ion de cette nouvelle pièce en té-lévision . D’ail leurs, on a dé jà parlé d’uneversion possible pour la couleur, laquellecomporterai t t rois écrans transparents res-ponsables chacun d 'une couleur fondamen-Les prophètes ont depuis longtemps prédit
la mort du tube cathodique classique, coû-teux, fragile et terr iblement encombrant. Lesdernières nouvelles des recherches fai tesdans ce domaine semblaient lui désignercomme successeur l’écran électro-luminescentdont nous avons déjà présenté le principe( N° 193, p. 54 et 55).
Sans que cela signif ie que ces écrans ultra-plats soient défini t ivement condamnés à nerester que curiosi tés de laboratoire , i l nousparaî t intéressant de signaler un sursautpour le moins spectaculaire du tube à vide.Il s’agit du tube spécial dont la f igure ci-contre essaie de donner une idée. Cette piè-ce est essentiel lement const i tuée d’un écranfluorescent logé sous vide dans une boîte deverre extrêmement plate. Un canon à élec-trons est scel lé à l’un des côtés, près d’ unangle. Le faisceau qu’il émet est at t i ré , puisdévié par deux séries de fines plaques con-ductr ices imprimées sur le verre. Suivant lespotentiels communiqués à ces plaques, lefaisceau avance plus ou moins loin le longde la part ie supérieure horizontale du tube,puis descend vert icalement jusqu’à une alt i-tude déterminée à laquelle i l percute enfinl’écran , l ibé rant la gerbe de photons queverra l’œil. Ce balayage en coordonnées car-tésiennes est ainsi effectué uniquement parat tract ion électrostat ique, d'où éliminationde tous bobinages et aimants.
Une version du tube a été construi te detel le sorte que l’ensemble , barres de dévia-tion comme écran , soi t t ransparent. La pièceobtenue, qui a d’ai l leurs l’aspect d’un demi-cercle plutôt que d’un rectangle , est dest inéeà être instal lée derriè re le pare-brise d'unavion. Le pilote de l’apparei l pourrai t ainsi,sans perdre des yeux la contrée qu'il survoleou l’avion qu’il poursuit , voir apparaî treen surimpression lumineuse un certain nom-
un second tube cathodique circulaire dontl’écran est placé dans un plan horizontal, àla base du premier, vers le pilote. Le pre-mier écran recevrai t comme précédemmentles informations relat ives aux instruments et,éventuellement, l’indicat ion en direct ion eten si te des obstacles fixes et mobiles placésà l’avant ; le tube horizontal, connecté à unradar du type P.P. I ., fournirai t un plan,avec échelles des distances, de la régionsurvolée. Associés de la sorte, les deuxécrans ram èneraient le pi lotage à des gestessensiblement aussi inst inct ifs que ceux despionniers qui se dir igeaient uniquement àvue.
taie, comme dans certains disposi t i fs de pho-tographie en couleur. Les tubes ainsi conçusseraient beaucoup plus simples, donc pluséconomiques de construct ion , que les tubesactuels pour la télévision en couleur.
Qui sai t enfin si ce nouveau tube, portéà une épaisseur de quelques décimètres, etmuni d' un assez grand nombre d'écrans, neserai t pas une solut ion possible pour la télé-vision en rel ief , le problè me devenant à cemoment celui de l’explorat ion plan par planau moyen d’une cam éra à focale variablepériodiquement . Mais nous nous garderonsbien d’émettre des pronost ics trop précisdans cette voie , d’autant plus que la surfacede cette page n’est pas infinie...Les premières informations que nous
avons eues sous les yeux étaient très ava- M. B.
Toute la Radio190
PREMI È RE PARTIE
J .- P . ΠH M I C H E Npar
Au cœur du sinistre automne 19-40, lors-que l’aviation allemande s’acharnait surl'Angleterre, alors presque sans chasse, laradio de Londres diffusa un soir un com-muniqué annonçant un nombre stupéfiantd’appareils abattus. Le lendemain, le nom-bre était presque aussi grand ; puis, lesjours suivants, la fréquence des raids des-tructifs se mit à décroî tre : la batailled 'Angleterre était gagnée, le monde librerespirait.
Ce miracle était dû à la mise en ser-vice du rvouveau système de radar auto-matique, pointant les canons de D.C.A.vers l’agresseur sans aucune interventionmanuelle : perçant le « fog » britannique,de fins pinceaux d 'ondes ultra-courtes dé-signaient, tels des doigts vengeurs, les ap-pareils ennemis, attirant sur eux le feumeurtrier des canons de défense:
Pour beaucoup, ce fut presque une ré-vélation : tout le monde avait entenduparler de la détection- des avions par ra-dio, mais bien peu se doutaient de l’ex-traordinaire efficacité du système.
Depuis 1940, la technique du radar aénormément évolué, l’étude des nouveauxensembles absorbe tout le travail de mil-liers d ’ingénieurs, de dizaines de milliersde spécialistes, et les prototypes se suc-cèdent à une cadence sans cesse accrue.
Aussi avons nous pensé qu’il pourraitêtre utile à nos lecteurs de prendre con-naissance des derniers perfectionnementsde la technique radar, tout au moins deceux que nous connaissons et que noussommes autorisés à révéler, car nous tou-chons ici un domaine où les techniciensdes diff érents pays sont en compétitionserrée, et on ne peut diffuser des infor-mations que lorsque l’on est sûr que cettediffusion ne risque pas de gêner l’activiténationale.
qu ’elles atteignent A, provoquent l’appari-tion d’un écho ; tout se passe comme siA devenait lui-même émetteur, renvoyantdans toutes les directions ( hélas !) un traind’ondes ayant sensiblement la même duréeque le train d’ondes de l’émetteur.
Un récepteur R , situé très près de E,capte une partie de ces ondes. Le tempsd’aller et retour de l ’onde, compté en mi-crosecondes et divisé par 6.66, donne ladistance en kilomètres qui sépare E (et R )de A.
Reste à trouver la direction de A. Pourcela , on utilise une antenne d’émissionet une antenne de réception directives, etl’on modifie l’orientation des antennes jus-qu’à ce que l’amplitude de l’écho reçu soitmaximum ; les antennes sont alors bra-quées sur l’objet A.
Signalons tout de suite qu’il ne s’agitlà que d’un processus purement théorique :la précision en direction serait très insuf -
Signalons que nous parlons ici des deuxantennes utilisées l’une pour l 'émission,
l ’autre pour la réception. Le plus souvent,
on peut utiliser la même antenne pour l'é-mission et la réception, nous verrons toutà l’heure comment. Nous parlerons doncmaintenant de « l'antenne », en sous-en-tendant qu’il s’agit de l’antenne d’émission-réception. L'emploi d ’une antenne com-mune permet de s’affranchir de la nécessi-té de coupler l 'antenne de réception à celled’émission pour assurer le braquage simul-tané des deux aériens vers l’objet.
Le diagramme de VantenneEnvoyons dans une antenne de radar
une puissance H.F. constante, et mesu-rons la puissance rayonnée dans chaquedirection. Nous pourrons tracer, sur cha-que demi-droite représentant une direction ,
un segment AP (fig. 2 ) dont la longueursera proportionnelle à la puissance rayon-née par l’antenne dans la direction decette demi-droite. Si on opère ainsi pourtoutes les directions possibles autour del ’antenne A, l’ensemble des points P obte-nus dessinera une surface qui est le dia -gramme de rayonnement de l ’antenne dans1 espace, dont l ’examen permet de se ren-dre compte immédiatement de la directi-vité du système rayonnant.
Un diagramme à trois dimensions étantdifficile à représenter, on pré f ère en re-produire les coupes par deux plans, engénéral perpendiculaires, contenant l ’an-tenne ; on utilise très souvent le coupledes diagrammes de rayonnement dans leplan horizontal (en supposant que l 'an-tenne est orientée de telle sorte que la di-rection de rayonnement maximum soit sen-siblement horizontale ) et dans le planvertical.
Dans la figure 3, nous reproduisonsl ’ensemble de ces deux diagrammes pourun radar dit « de surveillance ». On voitque le diagramme 3 a ( dans le plan hori-zontal ) étant très fin , l ’antenne ne per-mettra le repérage des avions que si ceux-ci sont situés dans une direction faisantun angle faible en projection horizontale(angle de gisement ou azimut ) avec unedirection Av déterminée. Par contre, lediagramme dans le plan vertical. 3 b. étanttrès évasé, on pourra détecter des obs-tacles situés à des angles de site très dif -f érents dans le faisceau. On di t qu’une
Fig. 1. — Principe du radar : Tonde émisepar l’émetteur E est réfléchie par l’objet A
vers le récepteur R.Les principes de base
fisante. Comme une fonction, au voisinagede son maximum, varie très peu, nous nepourrions apprécier que très approximati-vement le moment où les antennes seraientbraquées sur A.
Cependant, c’est toujours par mesure dela variation de l’amplitude ou de la phasedes échos en fonction du dépointage desantennes que l’on calcule la position del ’objet A.
Nos lecteurs ayant dé jà une idée d’en-semble assez poussée sur la question, nousne ferons que rappeler brièvement les prin-cipes de la détection électro-magnétique,universellement appelée « technique duradar ».
Pour déceler et situer un objet A, onutilise un émetteur E qui envoie, à inter-valles réguliers, des courts trains d ’ondesà très haute fréquence. Les ondes, lors-
191Juin 1955
bonne antenne, la puissance émise dans ladirection Ax' est inférieure d’au moins20 dB à celle émise suivant Ax.Utilisons nos diagrammes -
Maintenant que nous savons bien àquoi nous en tenir sur le compte de l'an-tenne et de sa directivité, nous allons uti-liser ce pouvoir directif pour localiserl’obstacle.
Nous avons dé jà fait remarquer quel’appréciation du moment où l’amplitudede l’écho passe par un maximum ne per-met pas un repérage précis ; nous n’allonsdonc pas braquer notre antenne exacte-ment sur l'obstacle à détecter.
Les premiers radars ont utilisé le sys-tème suivant : Supposons (fig. 5) que nousayons deux antennes d’émission-réception,dont nous avons dessiné les diagrammessur la même figure : en trait plein celuide l 'antenne n° 1, en pointillé celui dela 2. Nous avons supposé que ces deuxantennes étaient très voisines (confonduesdans le cas de la figure) et nous avonstracé les diagrammes dans le plan com-mun des deux axes Ax et Ax’.
Si l'obstacle est situé du même côté dela droite Ay que l’axe Ax, l’écho seraplus fort sur l’antenne 1, sinon c’est celuide la 2 qui aura la plus forte amplitude.
Braquons l’axe AP vers un obstacle(fig. 6 a ) de telle sorte que l’objet O àdétecter soit exactement sur l’axe AP ;au cours de la rotation du faisceau, l’an-gle de la direction AO avec l’axe dufaisceau étant constant, les échos ne chan-geront pas d’amplitude comme l’indique lafigure 6 a.
Si, maintenant, l’objet O est situé àdroite de l’axe AP (fig. 6 b ) , les échosvarieront périodiquement d’amplitude aucours de la rotation, passant par un maxi-mum chaque fois que Ax passe à droitede AP. La figure 6 indique cette modu-lation d’amplitude.
En détectant la tension d’échos, nousobtiendrons donc une tension basse fré-quence (souvent d’une trentaine de Hz)dont l’amplitude est proportionnelle à l’é-cart entre la direction de l’objet et cellede l’axe AP, la phase de cette tensiondépendant de la direction du dépointagede l’axe AP par rapport à O.
telle antenne est très directive en gise-ment, peu directive en site ; le faisceauhertzien .est mince et plat, allongé dansle sens de la hauteur.
Par ailleurs, dans la figure 4, nous ..avons reproduit le diagramme d’une an- :~tenne de radar dit « de conduite de tir » ;dans de telles antennes, le diagramme dansl’espace est sensiblement de révolution,c’est-à-dire que tous les diagrammes plansque l’on peut obtenir en le coupant pardes plans contenant un certain axe sontsensiblement identiques. Cet axe est ap-pelé axe du faisceau.
Nous voyons apparaître, dans la figure4, la bête noire de tous les ingénieursspécialistes des antennes radar : les iné-vitables « lobes secondaires ». Ces élé-gants petits pétales, qui décorent de partet d’autre la courbe de la figure 4, signi-fient que, dans la direction Ax’, notable-ment écartée de Ax (axe du faisceau ) ontrouve un second maximum d’émission (lapuissance émise avait commencé par pas-ser sagement par un minimum quasi-nuldans la direction Ay ) , et que l’on entrouve un troisième dans la direction Ax ”.
A quoi sont dus ces maxima secondai-res ? En général à la diffraction des ondesultra-courtes par les bords du réflecteurou de la lentitlle que l’on utilise le plussouvent pour concentrer dans une même
Voici les servo-mécanismesUn schéma-bloc simplifié d’un radar à
pointage automatique est reproduit dans lafigure 7. On voit que l’antenne A en-traîne, dans Son mouvement de rotation,un alternateur M (un aimant tournant fai-sant varier un flux dans deux bobines
Fig. 2. — Diagramme de rayonnement d’une antenne : dans chaquedirection de l’espace, on porte une longueur AP proportionnelle au
champ rayonné dans cette direction.
Fig. 3. — Diagramme d’un faisceau plat.Fig. 4. — L’antenne rayonne aussi dans des directions parasites : il y a
un lobe secondaire vers Ax’, un autre vers Ax”.
perpendiculaires Bx et By ) qui fournitles tensions de référence à la phase des-quelles on va comparer la phase de lamodulation des échos.
Ceux-ci sont prélevés à la sortie vidéodu récepteur R (comme en télévision, on .emploie ce terme en radar pour désignerla « basse » fréquence issue du récepteuraprès détection de la H.F.) . Ils sont dé-tectés, en vue de faire apparaître la mo-dulation des échos, et cette modulationest appliquée simultanément aux quatreamplificateurs Axi, Ax*, AyL et Ay >.
Ces amplificateurs sont du type à gaincommandé : les tensions en opposition dephase prélevées aux deux extrémités de
Toute la Radie
direction toute l’énergie hyperfréquenceémise par le cornet qui termine le guided’ondes, ou par le dipôle qui se trouveau bout du coaxial. Pourquoi sont-ils ca-tastrophiques ? Tout simplement parce que,si un obstacle proche se trouve dans ladirection Ax’, l’écho qu’il renverra pourraêtre beaucoup plus important que celuique renverra le vrai but, situé dans ladirection Ax, si ce but est éloigné. Pireencore : on pourra croire que cet obsta-cle est dans la direction Ax, puisquel’écho qui lui correspond passe par unmaximum quand la direction Ax passe parl’obstacle.
Aussi s’efforce-t-on de réduire ces lo-bes secondaires au minimum. Dans une
Les deux échos seront rigoureusementégaux lorsque l’obstacle sera dans la di-rection Ay, et, cette fois, un écart angu-laire même léger entre la direction deTobstacle et Ay sera parfaitement décelé.
De nos jours, on préfère le système del’exploration utilisant une seule antenne.
Soit une antenne donnant un faisceaufin et de révolution (du type de celui dela figure 4) ; faisons la tourner rapide-ment (2 000 tr/mn ) autour d’une directionAP, faisant un petit angle avec l’axe Axdu faisceau, de telle sorte que cet axedécrive un cône ayant AP pour axe, etun demi-angle au sommet faible (quelquesdegrés) .
192
Fig. 5. — L'utilisation de deux antennes visant des directions diff érentes,Ax et Ax’ permet de préciser la direction de l’objet qui renvoie leséchos : quand C £t objet est sur Ay, les intensités de réception des échos
sur les deux antennes sont égales.Fig. 6. — Si l’on fait tourner la direction Ax du maximum d’émissionsuivant un cône autour de AP, on constate que les échos sont constantssi l’objet O est sur l’axe AP (a ), modulés si O est hors de AP (b).
Fig. 7. — La modulation en amplitude des échos reçus est appliquée àquatre amplificateurs dont les gains sont commandés par des tensionsissues de deux bobines Bx et By d’un alternateur calé sur l’antenne. Lestensions issues de ces quatre amplificateurs, opposées deux à deux,commandent les rotations en site et gisement du bloc d’antenne, réalisant
ainsi la poursuite angulaire automatique.
l'enroulement B* bloquent alternativementAxi puis AX 2. Les tensions de sortie deces deux amplificateurs sont détectées, puisappliquées à un amplificateur différentielqui commande le servo-moteur de rota-tion en gisement de l’antenne.
D’une façon analogue, la rotation ensite est obtenue par le moteur de site,commandé par l’amplificateur diff érentielY dont la tension d’entrée est la diff érencedes tensions de sortie, préalablement dé-tectées, des deux amplificateurs Ayi etAy-2. recevant tous deux le signal de mo-dulation des échos et bloqués alternative-ment par les tensions de la bobine By del’alternateur.
Le fonctionnement est facile à compren-dre. Supposons que l’objet visé se déplacevers la droite ; les échos devenant plusimportants chaque fois que le faisceaupasse à droite, c'est-à-dire au moment oùle gain de Axi est minimum et celui deAx2 est maximum, l'amplificateur diff éren-tiel X va agir sur le servo-moteur de gi-sement, qui fera tourner l’antenne vers ladroite, jusqu’à ce que l'objet se trouveexactement sur l’axe de rotation de fais-ceau.
En réalité, au lieu de deux amplifica-teurs à gain variable, pour obtenir la ten-sion d’erreur du servo-mécanisme com-mandant le moteur de gisement, on utilisepar exemple un démodulateur, ou détec-teur sensible à la phase, montage com-portant deux entrées : l’une pour la ten-sion alternative de référence, l’autre dans
laquelle on envoie la tension plus ou moinsdéphasée par rapport à la première.
A la sortie de ce montage, on recueilleune tension proportionnelle au déphasagede la tension variable par rapport à latension de référence, elle aussi proportion-nelle à l’amplitude du signal de phasevariable. Le plus simple des montages dedémodulateur est le type « en anneau »schématisé dans la figure 8.
On voit qu’il s’agit d ’un montage enpont, utilisant des redresseurs en raisondes caractéristiques non-ohmiques de ceséléments. Le fonctionnement en est assezcomplexe ; nous allons en donner unaperçu sommaire.
Supposons d’abord que la tension ap-pliquée au primaire du transformateur Ti(c'est-à-dire le signal) soit en phase aveccelle qui est appliquée au primaire de T»
(tension de référence).Pendant une première alternance, c'est
l'extrémité A qui est positive par rapportà B, et D par rapport à E ; le courantpassera surtout par la diode D« et re-tournera en B suivant le parcours GHB,et ce courant sera important.
Pendant l’alternance suivante, B étantpositif par rapport à A, et E par rapportà D, le courant passera en suivant leparcours BHF Di DCA, et ce courantsera fort.
On voit que, pendant les deux alter-nances, le courant est passé de H vers Fou de G vers H. Dans les deux cas, l’effet
aura été de rendre le point G positif parrapport au point F qui est la masse.
Si maintenant nous supposons que latension appliquée au primaire de Ti esten opposition de phase avec celle qui estutilisée comme référence, en admettant enoutre que son amplitude est faible par • #
rapport à celle de la tension de référen-ce, tout va se passer différemment. Eneffet, lorsque le point A est positif parrapport à B, le point D est négatif parrapport à E ; la tension en E est doncplus positive par rapport à celle en Bque ne l'est la tension en D. Le courantva donc passer suivant l’itinéraire E D«FHB. On verrait de même qu’à l’alter-nance suivante, il passera par le cheminBHG D.t ECA. Pendant les deux alter-nances il aura rendu le point G négatifpar rapport au point F.
S’il n’y a pas de signal appliqué à Ti,ou si ce signal est déphasé de 90° parrapport à la tension de référence, on peutvoir qu’il n’y aura pas de tension en G.Bref , ce système de démodulateur en an-neau nous fournira en G une tension pro-portionnelle à la tension du signal et ausinus de son déphasage par rapport à latension de référence. Cette dernière estcelle de l'alternateur lié à l’antenne tour-nante, et c’est ainsi que l’on obtient latension d’erreur qui commande l’un desservo-mécanismes déplaçant tout le blocd’antenne.
Précisons à l 'attention de nos lectéursque le système que nous venons de dé-
Juin 1955 193
I
tanément à l’entrée de Gi et de G*, lessorties de ces deux gates étant appliquées,
après détection, aux deux entrées d’unamplificateur différentiel. La tension desortie de cet amplificateur attaque l’am-plificateur de servo-mécanisme qui com-mande le moteur M. celui-ci faisant tour-ner la commande de retard de l’impulsionde télémétrie dans le sens adéquat.
recopie approprié pour fournir au calcu-lateur qui entraîne les canons de D.C.A.l'information correspondant à la distancede l’objectif.
Le fonctionnement du radar peut com-prendre une poursuite automatique en dis-tance (les modèles les plus récents l’ontpresque tous) ou une poursuite manuelleen distance où l'opérateur doit maintenirsur l’écho un trait tracé sur un cadran.Cette dernière méthode est celle qu’utilisele modèle SCR 584 déjà cité et encoretrès utilisé actuellement.
Dans ce type de radar à poursuite ma-nuelle en distance, on fait en sorte quele rôle de l’opérateur chargé de la pour-suite en distance soit aussi réduit quepossible, aussi lui donne-t-on des manettesdites de « distance aidée » qui permet-tent de modifier la vitesse de défilementde la fenêtre de télémétrie, ce qui rend lapoursuite plus facile.
crire n’a plus rien de théorique : c’est àquelques détails insignifiants près celuiqui est employé dans plusieurs radarsmodernes à poursuite automatique, en par-ticulier dans le célèbre modèle- américain« SCR 584 » ainsi que dans des radarsplus perfectionnés fabriqués actuellementen très grande série par une grande so-ciété française.
Fonctionnement de la poursuiteen distance
Supposons qu’un écho se produise aumoment où UVi est basculé. A ce momentGi est débloqué ; il y aura donc une ten-sion à sa sortie, et l’amplificateur diffé-rentiel recevra de la tension sur son en-trée 1. Le tout est connecté de telle sorteque, dans ce cas, le moteur M provoqueune diminution du retard de l’impulsion detélémétrie.
La poursuite en distance
Un radar muni de deux chaînes depoursuite angulaires, soit de deux servo-mécanismes pointant sans cesse l’axe del'antenne en site et en azimut vers l’ob-jectif , n’est pas encore suffisant pour la« conduite de tir », c’est-à-dire pour poin-ter automatiquement les canons de D.C.A.vers l’ennemi. Il faut encore qu’il fournissed’une façon continue l’indication de ladistance radar-avion.
Ce problème peut sembler très simplecette distance -se traduit par un retardplus ou moins grand entre l’instant d’émis-sion du train d’ondes et celui de récep-tion de l’écho. Il suffira donc, semble-t-il,d’utiliser un système électronique classi-que de démodulation de phase, autrementdit un dispositif qui transforme une duréevariable en une tension proportionnelle àcette durée.
En réalité, le problème est beaucoupmoins simple qu’il ne le paraît. D'abord,il faut faire une sélection entre les diffé-rents échos qui apparaissent sur le tubecathodique : il y a toujours des obstaclesfixes proches du radar qui donnent sur letube des échos très importants, même sices objets ne sont pas situés exactementdans l’axe du faisceau. En effet, commenous le verrons plus loin, la puissance del’écho renvoyé au radar par un obstacledonné est inversement proportionnelle à laquatrième puissance de la distance radar-obstacle. Si deux objets A et B identiquessont situés tous les deux dans l’axe dufaisceau d'un radar, mais A se trouvantà 1 km du radar et B à 10 km, l’énergiede l’écho renvoyé par B sera 10 000 foisplus faible que celle de l’écho renvoyépar A. Dans ces conditions, si A se trouvesuffisamment en dehors du faisceau pourque, en ce qui le concerne, la directivitéde l'aérien apporte une atténuation de40 dB, tandis que B est en plein dans lefaisceau, les échos auront une amplitudeanalogue.
Un radar doit donc comporter une « fe-nêtre de télémétrie » que l’on place en unpoint du tube cathodique choisi par l’opé-rateur, et qui commande un jeu de « ga-tes » (ou interrupteurs électroniques com-mandés par un signal ) permettant de nefaire répondre les servo-mécanismes quepour les échos apparaissant sur le tubecathodique dans cette fenêtre.
Si l’objectif se déplace, la fenêtre doitsuivre la variation de sa distance, c’estce qu'on appelle la « poursuite en dis-tance ». Par la même occasion, le servo-mécanisme (si c’en est un ) qui assure cettepoursuite pourra entraîner tout organe de
DiADooOO C*Oc 2.. co icr.
</> OOFig. 8. — Démodulateur de phase
en annsau : la tension moyennede sortie est proportionnelle àl’amplitude de la tension de si-gnal et au sinus du déphasage decelle-ci par rapport à la tension
de référence.
oOe>. mQ*i
^ ' '
- f g
mTi A>ooO OOÛ
O£ o oo 11£ oo IfSortieesllp
P BOoc
aNéamnoins, la solution logique est de
rendre cette poursuite automatique, etnous allons indiquer comment cela se fait.
Un dispositif , sur lequel nous revien-drons, délivre une implusion dite « impul-sion de télémétrie », retardée par rapportà l’impulsion déclenchant le modulateur del’émetteur d’une durée fonction de la ro-tation d’un arbre (et, en général, propor-tionnelle à cette rotation ) . L’arbre en ques-tion peut être celui d’un potentiomètre quirègle la polarisation de grille d’un uni-vibrateur utilisé en retardateur.
L’impulsion de télémétrie provoque ledéclenchement d’un univibrateur UVi quifournit un signal rectangulaire de quel-ques microsecondes. L’univibrateur UVi,quand il rebascule, déclenche un autreunivibrateur UV2 (figure 9) identique auprécédent, fournissant une impulsion quisuit exactement la première. L’impulsionde UVi est utilisée pour débloquer le gâteGi , tandis que celle de UV2 débloque G».
La tension vidéo sortant du récepteur(contenant les échos) est appliquée simul-
L’univibrateur UV, va donc déclencherplus tôt, de même que UV2. tant quel’écho tombera toujours pendant la périodeoù il est basculé. Finalement, l ’impulsionde télémétrie se produisant de plus enplus tôt, il arrivera un moment où l’échoarrivera pendant la période où c’est UV2
qui est basculé; alors c’est l’entrée 2 del’amplificateur différentiel qui recevra dela tension, et le moteur tendra à fairediminuer le retard de l’impulsion de télé-métrie.
L’action combinée du système de gateset du moteur tend donc à amener l’impul-sion de télémétrie à un retard tel quel’écho arrive juste au moment où UVifinit son basculement et UV2 commencele sien. Si ces basculements étaient àfront infiniment raide, le servo-méca-nisme ne pourrait jamais se stabiliser ;mais, en fait, il y a un moment où G^commence à être débloqué avant que Gine soit entièrement rebloqué ; la tensionde sortie de l’amplificateur différentiel s’in-verse progressivement au moment où l’im-
Toute la Radio194
en effet, ce dernier doit transmettre aussifidèlement que possible la modulation del’écho due à l’exploration conique dufaisceau, modulation qui traduit le dépoin-tage du radar et actionnera la poursuiteangulaire comme nous l’avons vu.
Au contraire, cette modulation seraitgênante à la sortie des gates Gi et G2.Ceux-ci, chargés de la poursuite en dis-tance, n’utilisent que la phase de l’écho ;une modulation en amplitude de l'écho se-rait gênante pour le servo-mécanismequ’elle ferait « pomper » ou mal fonc-tionner. Aussi les gates Gi et G2 sont-ilsà la fois des interrupteurs à commandeélectroniques et des écrêteurs, fournissantà la sortie une tension indépendante de latension d’excitation, à condition toutefoisque cette tension soit supérieure à un cer-tain seuil.
Comme on n’a pas besoin d’une quan-tité d’informations considérable pour assu-rer la poursuite en distance, on peut se
pulsion de télémétrie se rapproche de laposition pour laquelle l 'écho arrive entrele déclenchement de UVi et celui de UV2.
Si le servo-mécanisme est convenable-ment stabilisé, le moteur s’arrête dans cetteposition (en supposant, bien entendu, qu’ils'agit d'un écho produit par un obstaclefixe ) , et Ion a réalisé 1 « accrochage endistance ». Si l’objet produisant l'écho estmobile, cet accrochage se maintient (tantque l’amplitude de l’écho est suffisante )et on peut lire la distance sur l’arbre decommande du retard de l’impulsion detélémétrie.
Les tensions des deux univibrateurs sontajoutées par un système à diodes pourobtenir une impulsion, somme des impul-sions de LIVi et UV2, qui sert à déblo-quer un troisième gâte G.-: se trouvant,par conséquent, débloqué pendant que Giou G2 est débloqué.
Ce gâte sert à transmettre la tensionde sortie du récepteur au système de pour-
BIBLIOGRAPHIETHEORIE DES RESEAUX I)E KIKUHHOFF.
par M. Bayard. — Un vol. cartonné de 414 p.( 210 X 293 ).que, Paris. — Prix : 3.200 F.Editions de la Revue d’Opti-
Si l’analyse et la synthèse des réseaux àdeux bornes offre, sous sa forme la plus géné-rale. pas mal de difficultés, que dire des qua - •
dripôles. ou réseaux à deux paires de bornes,
et d’une façon plus étendue des réseaux à npaires de bornes ? L’ étude de ces réseaux, quiest pourtant la base de tout travail sérieuxdans le domaine de l’électronique, n’a été entre-prise d’ une façon approfondie qu’au cours desvingt dernières années. De grands progrès ontété accomplis dans ce domaine, et notammentgrâce aux remarquables travaux du ProfesseurBayard qui, il y a vingt ans, a découvert larelation intégrale qui lie l’une à l’autre les par-ties réelle et imaginaire de toute fonction po-sitive réelle, qu’il s’agisse d’ une impédance oud’une admittance.
x\ujourd’hui, la théorie des réseaux fait ap-pel aux branches les plus modernes des ma-thématiques, telles que l’analyse matricielle,
la théorie des transformations, l ’analysis situs,etc. L’ouvrage de M. Bayard présente d’ unefaçon très complète et ordonnée l’état de nosconnaissances actuelles en la matière. Il cons-titue un résumé du cours que l’auteur pro-fesse à l’ Ecole Nationale Supérieure des Télé-communications.
vers le modulateur(déclenchement de rémission H.F. )m
LIGNES ET ANTENNES, par Elie Roubinc. -Un vol. de 172 p. ( 212 x 300). 135 fig. -Editions de La Revue d’Optique. Paris. -Prix : 1 600 Fr.MOTEURrRETARDATEUR
0£T É L É M É T R I E
Commande AMPLIFICATEUR DESERVOM é CANISME
Dans sa préface, Pierre Besson , directeur del ’E.S.E., rappelle à très juste titre qu’une cha înede transmission se compose d’ un générateur dehaute fréquence modulée, d’ une ligne d’alimen-tation de l’antenne, d’ une antenne radiatrice.du milieu transmissif , d’ une antenne réceptrice,de la ligne d’alimentation du récepteur et durécepteur proprement dit. On a écrit beaucoupd ’ excellents ouvrages sur tous les éléments decette chaîne en négligeant toutefois quelque peules lignes et les antennes. C’est cette lacune dela littérature technique que Elie Roubine, pro-fesseur à l’E.S.E. va désormais combler avecune véritable encyclopédie en quatre volumes,dont le premier vient de paraître.
Après un rappel des unités électriques ( unitéspratiques et système Giorgi rationalisé et nonrationalisé) , l’auteur étudie les propriétés duchamp électromagnétique, ce qui lui permet depasser plus facilement à l’étude des lignes enhaute fréquence. Après en avoir posé les équa-tions fondamentales et étudié lessecondaires, il analyse le comportement des li-gnes chargées, des lignes sans pertes ou avecpertes, et dresse les abaques d’ impédances. Lepremier volume se termine par deux chapitresparticulièrement originaux, dont le premier trai-te de l ' emploi des lignes dans les mesures enondes métriques et l’autre de leur emploi com-me modèles théoriques.
Tout en faisant appel aux théories les plusavancées, l’auteur ne perd jamais de vue l'as-pect pratique. Et c’est ce qui constitue l’ une desqualités primordiales de son ouvrage.
4-du retard \T
Impulsion —de tétémètri* M-uv5 Gi 1
4 AMPLI F.D l f f É R E N T I E L
flG 2 -f>|-UV2 ? 2
¥éch os ( du récepteur)
4—— -oPoursuite ^angulaire il 4-
constantes
Fig. 9. — Système de poursuite en distance : suivant la phase de l’arrivée de l’écho parrapport à l’impulsion de télémétrie, le moteur ajuste le retard de celle-ci.
suite en site et gisement dont nous avonsdé jà parlé, et, de cette façon, la pour-suite angulaire ne se fait que sur l’obsta-cle donnant l’écho qui correspond à lafenêtre de télémétrie. Ainsi, si deux avionsse trouvent à un moment donné alignésavec le radar, celui-ci poursuit impertur-bablement le même sans erreur possible,alors que, sans l ’emploi du gâte G.-?, onaurait pu voir le radar « lâcher » un desavions pour poursuivre l’autre. Mêmeavec le système à gâte, cet incident peutencore se produire si les deux avions sontpassés à une distance suffisamment faiblel 'un de l’autre pour que l’écho dû àl 'avion non poursuivi soit compris dans lafenêtre de télémétrie. Mais on dispose demoyens efficaces (système dit « d’extra-polation ») pour pallier cet inconvénient.
Les gates Gi et G2 ne sont pas exac-ment de la même nature que le gâte G;: :
permettre de réduire la bande passante deI amplificateur différentiel ainsi que cellede l ’amplificateur de servo-mécanisme, eton y gagne ainsi en rapport signal/souf -fle, ce qui est très important, car c’est cerapport qui détermine la sensibilité, doncla portée d’un radar.
Dans la figure 9, nous avons fait figu-rer un « pilote » sur lequel nous revien-drons plus tard : précisons seulement qu'ils'agit d’un oscillateur à fréquence basse,qui définit la cadence de fonctionnementdu radar, cadence déterminée par la dis-tance limite à laquelle le radar doit pou-voir porter. Si l’on veut aller à 100 km(666 LIS d’aller et retour ) , la période derécurrence doit être supérieure à 666 ps,la fréquence inférieure à 1 500 Hz.
J.-P. ŒHMICHENIng. à la C.F.T.R
WORLD RADIO TELEVISION HANDBOOKUn vol. de
Lindorffsallé 1. Helle-1955. par O. Lund Johansen.160 p. (166 X 210 ).rup, Denmark.
Cette neuvième édition de ce livre dont nousavons déjà eu l’occasion de parler ici. est en-core plus complète et mieux conçue que lesprécédentes. Elle donne des renseignements trèscomplets sur tous les importants émetteurs deradio et de télévision du monde, en indiquantleur adresse, les noms des principaux diri-geants. les longueurs d’ondes, l’ indicatif et lesprincipaux programmes. Celui qui aime faire letour du monde sur le cadran de son récepteurtrouvera dans cet ouvrage, très agréablementédité et abondamment illustré, de quoi satis-faire largement sa curiosité. C’est le meilleurguide du voyageur des ondes.( A suivre )
Juin 1955 195
2 amplificateurs B.F l
Déphasage par transformateurEn dépit de maints articles parus
dans la presse technique, nombreuxsont ceux qui considèrent encore lestransistors comme des « joujoux »peu utilisables dans la pratique, saufpour des puissances extrêmement fai-bles. On leur concède comme champd’application les appareils de prothè-se auditive et les récepteurs radio depoche.
Il est bien certain que, dans le do-maine des très faibles puissances d'ali-mentation, le transistor est incontes-tablement roi. On a pu voir et enten-dre au Salon de la Pièce Détachée, austand CSF, un oscillateur audio-fré-quence à transistor alimenté par unecellule au sélénium recevant simple-ment l’éclairage ambiant. Quel organeautre qu’un transistor pourrait s'ac-commoder d’une aussi faible puissanced'alimentation pour osciller ou am-plifier ?
Cet aspect, très intéressant d’ail-leurs, des transistors, ne doit pas faireoublier que ces organes, convenable-ment utilisés, peuvent développer despuissances appréciables et que, sansavoir recours aux transistors de puis-sance, on peut, avec des modèles nor-maux, faire entendre de la musique enhaut-parleur ou télécommander despetits moteurs.
Pour donner un exemple de ce grou-pe d’applications, nous allons décriredeux amplificateurs qui peuvent four-nir une puissance utile de 300 mWavec une distorsion de 8 0/0. La ten-sion d’alimentation est de 15 ou 30 Vselon le type. Le rendement de l’étagede sortie atteint 64 0/0.
Nous commencerons l’analyse desmontages par l’étage de sortie et ironsen remontant, car les exigences desétages se commandent dans ce sens.Et nous rappellerons pour n’avoir pasà y revenir que le gain de courantmaximum est obtenu avec les transis-tors jonction lorsqu’ils sont employésdans le montage dit « à émetteurcommun », la base étant l’électroded’attaque.
ETAGE DE SORTIE mateur de sortie (fig. 1) ou la mise ensérie des transistors (fig. 2) .
Dans le premier cas, classique de-puis longtemps, les organes amplifica-teurs (lampes ou transistors) sont enparallèle au point de vue de l’alimen-tation et en série au point de vue im-pédance de sortie.
Dans le deuxième cas, qui com-mence à se répandre avec les mon-tages à lampes, et qui se répandrabeaucoup plus avec les montages àtransistors, les organes amplificateurssont en série au point de vue de l’ali-mentation et en parallèle au point devue impédance de sortie.
On en déduit immédiatement que lesecond montage demande une tensiond’alimentation double du premier etque son impédance de charge est lequart de celle du premier, ramenée« plaque à plaque » ou « collecteur àcollecteur ».
Ces deux montages peuvent travail-ler en classe A, en classe AB ou enclasse B.
Pour « sortir » 300 mW utiles d’unjeu de 2 transistors TJN1 dont la dis-sipation « catalogue » est de 50 mW,il faut évidemment travailler en clas-se B (la classe C permettrait davan-tage, mais introduirait d’inadmissiblesdistorsions ) . Le rendement théoriquemaximum de la classe B est 78,5 0/0quand la tension de déchet est nulle.Les transistors permettent de s’appro-cher très près de ce maximum ; mais,dans notre cas, nous perdons un peude puissance dans les résistances pla-cées dans les émetteurs des transis-tors finaux. Ces résistances ont deuxrôles importants, que nous verronsplus loin, et n’entraînent qu’une fai-ble diminution de rendement, en ac-croissant la tension de déchet.
La classe B impose le fonctionne-ment en symétrie (push-push). Maiscette symétrie peut être obtenue par2 voies fort diff érentes : le transfor-
Fig. 1. — Ce premier schéma est celui d’un amplificateur complet équipé de 4 transistorsà jonction p - n - p avec étage symétrique de sortie alimenté en parallèle. Un transforma-
teur ( voir caracté ristiques dans le texte ) est nécessaire en sortie.
Toute la Radio196
à transistors jonction300 mW pour 8% de distorsion
Calcul de l’é tage final sible, pour diminuer Inl. Les transis-tors T JN1 que nous avons utiliséssupportent dans certaines conditionsune tension maximum de 30 V. Latension d’alimentation doit donc êtrelimitée à la moitié de cette valeur,soit 15 V, en raison du couplage destransistors finaux par le transfor-mateur de sortie.
Si nous admettons que le rende-ment du transformateur de sortie estde 75 0/0 (chiffre pessimiste ) , il fau-dra, pour obtenir 300 mW utiles, quel’étage de sortie fournisse en réalité400 mW.
Nous admettrons 2 V comme ten-sion de déchet à cause des résis-tances dans les émetteurs ; ce quinous permet de calculer l’intensitémaxima, la résistance de charge et lerendement :
4 X 136L5 X1Ô-®
(collecteur à collecteur ) ;
— 845 ïlR =Les équations classiques de la clas-
se B permettent le calcul de l’étagefinal, pris dans le cas de la figure 1.
Soient Va la tension d’alimentation,Vd la tension de déchet, Im le courantmaximum, W la puissance fournie, Rla résistance de charge (collecteur àcollecteur ) , ^ le rendement.
On sait que l’on a :
I,„ ( V:, — Vd)
2i1 - 67,5 0/0.il = 78,5 15
L’étage de sortie réalisé débitantsur une impédance un peu plus fai-ble ( 780 SI ) nous donna 415 mW et unrendement de 64 % (1).
L’accord avec la théorie était sa-tisfaisant.
Dans le cas de la figure 2, la ten-sion d’alimentation peut être égale àla tension maximum supportable parle transistor, soit 30 V. Le courantmaximum est le même. Le courantmoyen consommé sera la moitié decelui exigé par le montage de la fi-gure 1. La puissance et le rendementsont les mêmes. La résistance decharge est le quart de celle précé-demment calculée collecteur à collec-teur, soit 211 S2.
Une vérification expérimentale futfaite avec les mêmes transistors queprécédemment, dans ces nouvellesconditions. La résistance de chargeétait de 195 12. La puissance obte-nue fut également de 415 mW et lerendement de 65 0/0.
W2
4 < V;l — V(l )R
In,
v./7rh Va
Le gain en courant des transistorsdiminue lorsque l’intensité augmente.On a donc intérêt à travailler à la ten-sion d’alimentation la plus élevée pos-
2 W 0,8In,( V„ — V„ )
= 61,5 mA ;13
Résistances de polarisationet de protection
Voyons maintenant les rôles des ré-sistances situées dans les émetteurs.Le plus apparent est de faire unecontre-réaction d’intensité qui stabi-lise et linéarise le gain de l’étage etpermet de parfaire la symétrie dusystème grâce au petit potentiomètreajustable P,. L’autre rôle est spécialaux transistors, et nous allons nous
U ) Notons que la puissance perdue, soit2 -15 mW, est en bonne partie dissipée dans lesrésistances d’émetteur ; la fraction absorbéepar les transistors n’atteint guère que la moitiéde cette puissance. La résistance de chargeétait branchée aux bornes du primaire du trans-formateur ( secondaire ouvert » afin de n ’avoirpas à tenir compte du rendement du transfor-mateur.
Fig. 2. — Ici l’étage de sortie est alimenté en série. ATTENTION : les 2 résistances marquées68 9, dans le circuit de base du second TJN 1, sont en fait des 68 kfi, et la résistance
d’émetteur une 2,7 (et non 27) kü.
Juin 1955 197
Fig. 3 a. — Distorsion totale en fonction de la puissance, pour le pre-mier montage, avec transformateur de sortie.
Fig 3 b. — Distorsion totale en fonction de la puissance, pour le secondmontage et sans transformateur de sortie.
étendre un peu plus sur ce sujet.Pour que l’étage final ne déforme pasles signaux faibles, il faut que lesdeux transistors soient, au repos, lé-gèrement « débloqués » par un petitcourant de base. Ce petit courantest obtenu en donnant aux bases unelégère polarisation négative par lesrésistances Rt et Rj et les résistancesohmiques des enroulements secon-daires du transformateur « driver ».Une résistance R3 assure la symétriedes résistances de ces enroulements.
Si les émetteurs sont réunis di-rectement à la masse, et si les tran-sistors viennent à s’échauffer quel-que peu, le courant de fuite collec-
. teur-base croît ; comme il parcourt larésistance ohmique du circuit de ba-se, la polarisation négative de celle-ci croît également, d’où un plus grandéchauffement, etc ; l’effet cumulatifse déclenche et, en quelques secondes,le transistor peut se trouver « ouverten grand » et laisser passer un cou-rant de l’ordre de l’ampère... pas pen-dant longtemps, on s’en doute !
C’est pourquoi les règles suivantesdevront être observées si l’on veutéviter de coûteux déboires :
1° Dans tous les montages où lecourant peut devenir important, larésistance du circuit de base doit êtreaussi faible que possible ;
2° Dans tous les montages où lepoint de fonctionnement doit demeu-rer stable et bien défini, et particu-lièrement toutes les fois que le cou-rant est important, on doit polariserla base par un circuit peu résistantet insérer dans l’émetteur une résis-tance stabilisatrice. La stabilisationest d’autant meilleure que l’on peutperdre une plus grande partie de latension d’alimentation dans cette ré-sistance.
Dans les montages classe A, cetterésistance peut être shuntée et ne pasfaire perdre de gain. Pour les monta-ges classe B, on ne doit pas shunter,
sous peine d’introduire une distorsion( « clipping ») intolérable.
On remarquera que les résistancesqui assurent la polarisation des ba-ses produisent en même temps unecontre-réaction de tension, puisqu’el-les sont connectées entre base et col-lecteur et non entre base etCette disposition étant imposée dansle cas de la figure 2 pour le transis-tor supérieur, nous l’avons adoptéepour tous les cas. Cette contre-réac-tion améliore la linéarité, mais aug-mente la puissance demandée au« driver » ; il ne faudrait pas allertrop loin dans ce sens parce que le« driver » surchargé introduirait degrandes distorsions.
Les valeurs des résistances Rx et ILdonnant le point de fonctionnementcorrect dépendent du gain des tran-sistors.
Les valeurs indiquées conviennentpour des gains de courant nominauxcompris entre 20 et 30.
Liaison au driver
La liaison entre le driver et l’étagefinal est assurée par un transforma-teur. Pour la classe B 2, avec cou-rant grille (ici courant base ) , on nepeut utiliser de liaisons par capacités,qui introduisent un fort « clipping »Les liaisons directes étant assez délica-tes, le transformateur, malgré ses dé-fauts, reste l’organe de couplage leplus pratique pour l’attaque d’unétage classe B 2.
Cela ne veut pas dire que le trans-formateur soit facile à réaliser. Lestransformateurs classe B pour tran-sistors ne sont pas encore dans lecommerce en France. Il nous a falluconstruire nous-mêmes les transfor-mateurs nécessaires, et comme ccr.’est pas notre métier, nous avons ob-tenu des organes volumineux et mé-diocres. Lorsqu’un constructeur pro-fessionnel de transformateurs pren-dra ce problème, nul doute qu’il nefasse beaucoup plus petit pour desrésultats semblables ou supérieurs.
Le transformateur driver est bo-biné sur tôles standard 52,5X 43,5mm, empilage de 17 mm, tôles noncroiséees, mais sans entrefer volon-taire.
On a bobiné d’abord les secondai-res, qui comprennent chacun 800tours de fil 15/100, puis le primaire,qui comprend 1600 tours du mêmefil. Les résistances des enroulementssont : 65, 75 et 200 il. La résistanceR;t, de 10 il. est mise en série avec lemoins résistant des secondaires.
L’impédance au primaire, à pleinecharge, est de 1250 il et la puissancede commande est de 16 mW. Cettepuissance élevée est la conséquencedes consommations d’énergie dans lesrésistances de stabilisation et ausside la contre-réaction collecteur base.Un transistor classe A fournissant fa-cilement cette puissance, il n’y a làaucun inconvénient.
V.
T ransistors
Les transistors équipant l’étage desortie sont des TJN1 de la CSF ; ilssont appariés au point de vue gainde courant et au point de vue varia-tion du gain de courant en fonctionde l’intensité. Cet appariement n’apas besoin d’être rigoureux. Les TJN1, employés avec les précautions in-diquées, supportent sans inconvé-nient des dissipations nettement supé-rieures à celle indiquée sur le cata-logue (50 mW). Mais il faut alorsfaire bien attention à ce que l’on fait.Le fait d’interrompre le circuit debase d’un transistor un peu échauffépeut « l'ouvrir en grand », avec lesfunestes conséquences déjà exposées.Les deux TJN1 qui ont servi à nosessais avaient des gains de courantde 28 environ sous 1 mA et de 20environ sous 10 mA.
.198 Toute la Radio
Fig. 4 a. — Réponse, en fonction de la fréquence, du premier montage,avec transformateur de sortie.
Fig. 4 b. — Réponse, en fonction de la fréquence, du second montagesans transformateur de sortie.
Liaison à la chargeLa liaison à la charge se fait obli-
gatoirement par un transformatevtrsymétrique dans le cas du montage1. Pour avoir un rendement accepta-ble, ce transformateur doit avoir unetrès faible résistance ohmique. Lemodèle que nous avons réalisé estbobiné sur les mêmes tôles que ledriver, mais croisées cette fois, puis-qu’il n’y a plus de composante conti-nue. On a bobiné d’abord le primaire,soit 600 tours de fil 30/100 avecprise médiane, puis le secondaire,soit 150 tours de fil 50/100, pour uneimpédance de sortie de 50 fl.
Les résistances ohmiques des en-roulements sont de 5,5 et 6,5 fl pourles demi-primaires, et de 1,6 fl pourle secondaire. Le rendement en milieude bande est d’environ 78 0/0.
Dans le cas du montage 2, si lacharge est voisine de 200 fl, on n’apas à employer le transformateur desortie ; c’est dans ces conditions quel’on a la plus grande puissance utile,la plus large bande passante et lameilleure forme d’onde, parce qu’onpeut appliquer une contre-réactionplus énergique.
Si la charge est très diff érente, de200 fl, le transformateur de sorties’impose. On notera que, plus petit,il est beaucoup plus facile à cons-truire que le transformateur symé-trique.
quand même une stabilisation suffi-sante.
Les résistances R4 doivent être choi-sies en fonction du gain du transistorutilisé en driver. Les valeurs indi-quées conviennent pour un TJN1ayant un gain nominal de 28.
Dans le cas du montage de la fi-gure 2, on pourrait diminuer la con-sommation de puissance dans la ré-sistance d’émetteur en utilisant untransformateur driver de plus grandrapport d’abaissement : par exemple3/14-1 ou 3,5/14-1 au lieu de 2/14-1que nous utilisons dans les deux mon-tages. On augmenterait alors R4 jus-qu’à obtenir la polarisation correcte,permettant de sortir sans distorsion lapuissance nécessaire poiir conduirel’étage de sortie. La stabilisation dupoint de fonctionnement serait moinsbonne, mais encore bien suffisante.
Notons enfin que la dissipationdans le driver est assez élevée etqu’elle est plus forte au repos qu’àpleine excitation.
plification oblige à se montrer trèsmodeste quant au taux de contre-réac-tion de la boucle englobant le driveret l’étage final. L’affaiblissement ap-porté par cette contre-réaction est de8 dB dans le cas du montage 2 (unseul transformateur) et de 4,8 dBseulement dans le cas du premierschéma (deux transformateurs ) .
Ces faibles valeurs de contre-réac-tion procurent cependant une amélio-ration très nette de la forme d’ondeet de la réponse en fréquence, commel’indiquent les courbes que nous repro-duisons. Il faut toutefois noter que,pour les fréquences dépassant 8 kHzrla contre-réaction modifie la formed’onde sans toutefois réduire nette-ment la distorsion. Cela tient aux ro-tations de phase dans le ou les trans-formateurs. Ces fréquences ne se pré-sentant à peu près jamais avec unegrande intensité dans le spectre audiocourant, l’inconvénient est de peud’importance.
ALIMENTATIONETAGE D’ENTREEComme tous les montages classe B,
ceux-ci demandent à être alimentéspar une source de faible impédance etde faible résistance ohmique. Sinon, ils’ensuit un écrasement de la dynami-que. Ne pas oublier que la consomma-tion de l'étage final varie dans le rap-port de 1 à 10 entre l’état de repos etla pleine excitation. La consommationdu montage 1 entier, sous 15 V, est de13,5 mA au repos et 55 mA à pleineexcitation. Celle du montage 2 entiersous 30 V est de 10 mA au repos etde 31 mA à pleine excitation.
C’est encore un transistor TJN1,toujours monté en émetteur à la mas-se et stabilisé par résistance d'émet-teur. Cet étage d’entrée, n’étant pasinclus dans la boucle de contre-réac-tion, est muni d’une contre-réactiond’intensité : résistance de 330 fl nondécouplée dans l’émetteur. Cette con-tre-réaction élève l’impédance d’entrée.Avec le transistor utilisé (gain nomi-nal : 23) , l’impédance d'entrée est de10 kfl environ, ce qui est très bienadapté derrière une détection à diodegermanium. Si l’on désirait entrer surune impédance beaucoup plus élevée,
11 conviendrait de monter le premiertransistor en collecteur à la masse.
ETAGE DRIVERC’est un transistor TJN1 travail-lant en classe A. Les principes de
stabilisation du point de fonctionne-ment précédemment exposés sontégalement appliqués ici, et avec uneparticulière efficacité dans le cas dela figure 2, puisqu’on peut se per-mettre de perdre la moitié de la ten-sion d’alimentation dans la résis-tance d’émetteur. Le cas de la figure1 est moins favorable, mais assure
MISE AU POINTCONTRE-REACTION La mise au point se réduit à l’ajuste-ment des résistances R4 et R* pour ob-
tenir le point de fonctionnement cor-rect du driver et de l’étage d’entrée.La présence d’un ou même de deux
transformateurs dans la chaîne d’am-Juin 1955
199'i
U,
Où trouve-t-on des TRANSISTORSen France ?
On suppose les transistors finaux ap-pariés et dans la gamme convenablede gain.
On s’efforcera, en ajustant Pi, d’ob-tenir un signal bien symétrique etécrêtant simultanément en haut et baslorsqu’on fait croître l’amplitude,
d’attaque. On vérifiera que l’étage dri-ver n’apporte aucun écrêtage avant lasaturation de l’étage final ; si le casse présentait, on retoucherait la pola-risation du driver. Tous ces réglagesdoivent être faits en milieu de bande(vers 1000 Hz) .
On peut souvent améliorer nette-ment la forme d’onde en permutant lestransistors de sortie ; en effet, cestriodes ne peuvent être rigoureuse-ment identiques et leur déséquilibreproduit une distorsion par harmoni-ques pairs. Le driver produit égale-ment une distorsion par harmoniquespairs. Suivant la phase, ces distor-sions peuvent s’ajouter ou se retran-cher.
( Suite du N° 194 )
On a pu trouver, à la page 94 de notre nu-m éro de mars-avri l , une première l is te defournisseurs de tr iodes à cris ta l - I l convientd’y ajouter les sources suivantes :
Le Laboratoire Central de Télécommunica-t ions ( L.C.T.) , 46, avenue de Breteui l , Par is-VIIe, té l. SEG. 90-00, qui fabrique les t ransis-tors à pointes type 3698, é tudié pour la com-mutat ion et type 3768, à grande stabi l i té élec-tr ique, conçu pour l’amplif icat ion et l’usagegén é ral , a insi que les modèles à jonct ions ty-pe 3604. Ces derniers sont des n-p-n, alorsque la plupart des tr iodes actuel lement cou-rantes sont des p-n-p. Cela leur permet deprésenter une fréquence de coupure d’aumoins 500 kHz ( 2 MHz en moyenne ). Lapuissance maximum dissipée sur le col lecteurest de 50 mW à 25°C. pour une tension l imite
de 40 V et un courant de 5 mA. Le gain decourant a est au minimum de 0,95 et de 0,97en moyenne. En émetteur commun , ces va -leurs correspondent à des «' respect i fs de 2« ) .e t 33. Le facteur de brui t es t de 25 dB à1000 Hz .
Radio Télévis ion Française, 29, rue d 'Ar-tois. Paris-VII Ie, té l. BAL. 42-35, importe lest ransis tors Sylvania ( U.S.A. ), dont les prin -cipaux modèles sont : 2 N 32, modèle à pointes— 2 N 34, modèle jonct ion p-n-p, diss ipat ionmaximum de col lecteur : 50 mW ; alimenta -t ion maximum 25 V. — 2 N 35, modèle jonc-t ion n-p-n , l imité également à 50 mW et25 V. 2 N 68, modèle jonct ion p-n-p depuissance, diss ipat ion maximum collecteur1 ,5 W ; tension maximum d'al imentat ion 25 V ;courant col lecteur maximum 1.5 A -
Le " cas Détectron "RESULTATSLes principaux résultats ont déjà
été annoncés en tête ou dans le coursde l’article. Groupons-les ici : Puisque nous parlons « Transis tors », le
moment est venu de répondre à plusieurs cor-respondants nous ayant demandé ce qu’il fa l-lai t penser des pièces offer tes par la maison« Détectron », de Bordeaux.
Ayant remarqué, dans quelques prospectusal léchants bien que curieusement rédigés dansune langue étrangère vois ine de l’anglais, desprétendus transis tors jonct ion offer ts au prixétonnamment modique de 800 F ( moins 25 0/0de « discount » pour toute commande compriseentre 5000 et 10 000 pièces ! ) , nous avonsposé notre modeste candidature pour une pairede 2 N 38 D = CK 722.
Le facteur nous amena d’abord... une prièred’envoyer le mandat à la commande. Laconfiance règne ou ne règne pas. Envoi de1600 F. Récept ion... d’une demi-paire ! Récla-mation et, enfin , sat isfact ion , du moins côtéquant i té. Restai t à voir la qual i té. Notre amiSchreiber venai t justement de mettre au pointle pont qui fut décri t dans notre num éro 194.Nous raccordâ mes donc à l’apparei l l’ un des2 N 38 D = CK 722, qui se présentai t sousl ’aspect d’une sphè re rose de la grosseur d’ unpois, sor te de « pilule Dupuis » d’où dépasse-raient 3 fi ls.
Nous avouons humblement n’avoir jamaismesuré le gain en courant, en branchementavec é metteur commun , d’une vé ri table pi luleDupuis. Mais si cela nous arr ive un jour, noussommes prêts à parier que les chiffres serontcomparables, car celui qui mesura le gain encourant du premier échant i l lon Détectrons’épel le « z-é-r-o ».
Reportant tous nos espoirs sur l’autre2 N 38 D alias CK 722. nous le plongeâmesdans le support du pont , sans plus de succès,hélas... Mais peut-être ledi t pont étai t-i l enpanne ? Un authent ique CK 222 Raytheon vintfaire le juge de paix - Malheureusement pourl’industr ie l bordelais, i l accusa un honnête ade 38. Nous devons à la véri té d’ajouter quecet te pet i te his toire , racontée à certa ins denos amis ayant expé rimenté de leur côté cessemi-conducteurs girondins, n’eut pas l’air deles surprendre.
Mis au courant, le directeur des immensesEtabl issements Détectron le pri t de haut , cequi nous inci ta à faire répéter les mesures
pa » un laboratoire off ic ie l. Ce ne fut d 'ai l leurspas chose faci le, e t nous passons ici sur lesdiverses « erreurs d’expédi t ion » qui retardè-rent le grand jour où le Laboratoire Centraldes Industr ies Electr iques se trouva enfin enpossession de 4 soi-disant t ransis tors à jonc-t ion Détectron. L’ un , du type 2 N 38 D, futdirectement envoyé par la maison de Bor-deaux ; les 3 autres, des 2 N 37 D furent ac-quis par M. E. Jourdan-Laporte et t ransmispai lui au L.C. I .E. Le tableau suivant résumeles résul ta ts de mesure, te ls qu’ i ls sont consi-gnés dans le Cert i f icat N° 92 605 délivré le 28avri l 1955 par le L.C.I.E. à Toute la Radio.
Les mesures ont été fai tes suivant le sché-ma avec émetteur commun ; on trouve succes-sivement entre émetteur et base : une bat ter iede 4 V ( négat i f vers la base ) ; une résis-tance de 20 kli ; un rhéostat de 200 klf ; lemicroampèrem ètre mesurant le courant IBEntre émetteur et col lecteur : une bat ter ie de10,7 V ( négat i f vers le col lecteur ) ; le mil l i-ampèrem ètre mesurant le courant Ic : unerésis tance de 500 Sï.
PUISSANCE DE SORTIE :Sans transformateur de sortie
(charge de 200 Q et montage N" 2seulement ) : 400 mW ;
Avec transformateur de sortie ( pourles 2 montages ) : 300 mW au moins.
NIVEAU D’ENTREEPour la puissance maximum : 70
mV dans le cas de montage 1 ; 100mV dans le cas du montage 2, où lacontre-réaction est plus énergique.
IMPEDANCE D’ENTREE10 kQ.
GAIN EN PUISSANCE59 dB pour le montage Nu 1 ;56 dB pour le montage N° 2.
2 N 37 D2 N 38 DDISTORSION TOTALE pour la puis-
sance maximum : inférieure ou égaleà 8 % ( mesure faite à 1 kHz) .
Les courbes de la figure 3 indiquentla distorsion en fonction de la puis-sance de sortie dans différentes con-ditions (mesures faites à 1 kHz) .
N° î N° 2 N » 3
I c ( m A ) I c ( m A ) Ic ( mA ) Ic ( mA )
11 ! 0.2IB (M)
< 0.05 0.8< 0,05 0.8< 0,05 0.8< 0,05 0.8< 0,05 0.8< 0.05 i 0 .8
200,240 1 I0,250 110,2100 110,2150 11
300 0 ,211REPONSE EN FREQUENCE
Voir les courbes de la figure 4.
Ces résultats sont valables pour unetempérature ambiante normale. Si latempérature ambiante dépassait 35 °C,il y aurait sans doute lieu de diminuerla tension appliquée aux transistors ;mais nous n’avons pas étudié sur cesmontages la loi selon laquelle il con-viendrait de diminuer la tension enfonction de la température.
On ne saurai t prouver plus mathématique-ment que, pour chacun des pseudo-transis tors,
l 'amplif icat ion est r igoureusement nul le !
Nos lecteurs savent maintenant à quoi s’entenir e t comprendront pourquoi Toute laRadio refuse catégoriquement la publ ic i téDétectron ! Nous remercions d’ai l leurs àl ' avance ceux d’entre eux qui auraient desinformations intéressantes à nous communiquerau sujet de cet te maison ou de ses pro-duct ions.
M. BONHOMMEJ. RIETHMULLER.
Toute la Radio200
MONSIEUR MÉTICULEUXFABRIQUE AUTOMATIQUEMENT
LES TRANSISTORS
De nos jours, la fabrication des tubesélectroniques est considérablement auto-matisée en dépit de la complexité de leurarchitecture et de la nécessité d y pra-tiquer un vide poussé. Pourquoi, dès lors,ne ferait-on pas d’une façon automatiquedes transistors, dont la composition esttellement plus simple ?
Tel est sans doute le raisonnement qui• germa dans l’esprit des gens des Bell T é-
léphoné Laboratories , le berceau du tran-sistor. Une première machine qui, à titreexpérimental, fabrique automatiquement lestransistors, a été réalisée par les techni-ciens de cette grande maison américaine,lesquels, non sans humour, l’ont baptiséeMonsieur Méticuleux. Ce faisant, ils ontvoulu surtout souligner que la qualité destransistors fabriqués sans l’interventionhumaine est supérieure à celle que- produi-sent les ouvriers soumis à toutes les dé-faillances de la matière vivante.
En moins d’une minute, Monsieur Mé-ticuleux procède à une quinzaine d’opéra-tions avec un automatisme parfait et sansmanifester la moindre fatigue. Pour com-mencer, un opérateur place dans une pin-ce une barre de germanium ou de sili-cium ayant la longueur d’une tête d’allu-
\a au
Quand les techniciens unissent leurs ef -forts pour les mettre au service de' l ’art,le résultat peut être d’une beauté surpre-nante. Tel a été le cas du spectacle « sonet lumière » intitulé « Nocturne et Sor-tilèges » qui nous a été présenté par leComité « Arts et Lettres » de Chantilly.Ii a permis de retracer le passé de cejoyau de France qu’est le château deChantilly, avec ses chasses, sa magnifi-cence et les silhouettes légendaires qui1 ont animé (le Prince de Condé, le Ducd’Aumale, etc...) .
Les magnifiques éclairages commandéspar des jeux d’orgue de la compagnie C/é-mançon étaient assurés par dix projecteursMazda « Infranor P 1 000 » d ’ouvertureoptique variable, dont certains en couleur,
ainsi que par d autres projecteurs Mazda,y compris les lampes « Mazdasol » inten-sives, éclairant la fontaine et la gerbed’eau. La puissance totale nécessitée parles jeux de lumière atteignait par moments40 kW fournis par un groupe électrogèneinstallé sur place.
Quant à la sonorisation , absolument re-marquable, elle a été assurée par quatresources donnant une sensation de mouve-ment et de relief remarquable. Chacuneétait constituée par deux conques Elipsonde grand modèle contenant des haut-par-leurs Ge-Go (fabrication Gogny) et ali-mentée par un amplificateur de puissanceà haute fidélité. Chaque amplificateurpouvait fournir 110. W modulés au maxi-mum, le taux de distorsion à 80 W étantir.f éreur à 2 %. La bande passante, droiteentre 20 et 50 000 Hz, n’accusait qu'unaffaiblissement de 4 dB à 120 000 Hz.Musique et parole étaient enregistrées surune bande magnétique standard de 6,35mm comportant deux pistes et défilant à38 cm/s. Tout l ’équipement de reproduc-tion sonore et d 'amplification était réalisépar Pathé-Marconi, ce qui explique saqualité parfaite.
Nous avons pu apprécier le résultat re-marquable de cette sonorisation de pleinair réalisée dans des conditions particu-lièrement difficiles. A un moment, nousavons pu entendre des phrases chucho-tées... avec une puissance de pas mal dewatts. L'illusion était parfaite.
Il convient de féliciter sans réserve tousceux qui ont contribué à cette réalisationvenue s’ajouter à la chaîne des fééri-ques spectacles qui ont conf éré une vienouvelle aux plus belles bâtisses séculairesde notre pays en ressuscitant leur glorieuxpassé, grâce aux applications les plusmodernes de l’électronique.
Dans le premier cas, le fil continue àavancer jusqu’à l 'autre extrémité de lacouche centrale et mesure ainsi son épais-seur totale. Ayant atteint l’extrémité, lefil revient vers une position intermédiaireet là, une impulsion de courant électriquele soude au germanium. A ce moment, labarre est retournée et un deuxième fil estsoudé de la même manière à un autrepoint de la couche centrale, puisque letransistor résultant doit être un tétrode etpar conséquent être pourvu de quatreconnexions.
De la même manière, des fils d 'or sontsoudés aux extrémités de la barre. Puisà chacun des fils dTor est soudé un fil deconnexion plus fort qui servira au bran-chement du transistor. Et, pour terminer,de nouvelles opérations de contrôle déci-dent dans quelle mesure le transistor ré-pond au cahier des charges, assez sévère.
mette et à peine plus épaisse qu’un che-veu humain. La machine promène alors lelong de ce minuscule cristal un fil d’ord ’ une finesse extrême. Ce fil se déplacepar bonds d’un millième de millimètre, etdans chaque position des mesures sontfaites, toujours automatiquement, pourdéterminer si le semi-conducteur présenteles qualités électriques voulues. Lorsquele fil atteint la couche centrale, dontl’épaisseur est de l’ordre de 2 mil-lièmes de millimètre, la machine dé-cide si la barre donnée est utilisable ounon. Dans ce dernier cas, elle est rejetée.
Juin 1955 201
NOUVEAUX TUBES 1955KJONJ
1 1 . i- “
Intensitéanotfique
Résistance RésistancePolarisation interne
R ésistance(l’Anode
tensionEcran
TensionPolarisation
Hautetension
TensionfilamentRéf érence Fonction Pente OBSERVATIONSType Culot
6,3 (0,2) HF-MF 1 MÛ 51 kQ série sur écran250 9 100 — 2 160EF89 5V 345 3,85Les caractéristiques con-
densées dans cette pagesont présentées de façonque le tableau comme lesculots puissent être décou-pés et collés éventuellementdans les pages de la 13* édi-tion du « Lexique Officieldes Lampes Radio » deL. G a u d i I I a t. Précisonsqu ' un tableau analogue, pu-blié à la page 178 de notrenuméro 185 ( disponible ) , estrequis également pour lamise à jour de cette 13e
édition. Pour ce qui con-
cerne la disponibilité com-
merciale des tubes cités ci-contre, se reporter au GUIDEDES TUBES, publié dans lespages centrales du présentnuméro.
— 20 0,240,22 MQ
0,1 MQ0,68 MQ série sur écran0,27 MQ série sur écran
BF 250 0,92 1200250 2,05 560
6,3 (0,3) TV 150 12,5 0.1 MQR150 346 150 120 Amplif. large bande5 16ECC85 6,3 (0,435) FM 250 10 Amplificateur FM
Oscillateur-Mélangeur FM3-3 347 — 2 9000 6
12 kQ 20 kQ250 5,2 2,36.3 (0.4) TV-FM Montage Cascode6BQ7A 347 150 9 — 10 2203-3 6100 6,48,4 (0.3) TV-FM Montage Cascode9BQ7A 347 150 — 10 2203-3 9 6100 6,4
6U8-TV6,3 (0,45) 150 Elément triode
Elément penthodeECF82 348 18 56 5000 8.53-5
0.4 MQ110250 10 68 5,29U8-
9.45 (0,3) TV 150 18 56 5000 Elément triodeElément penthode
PCF82 3-5 348 8,50.4 MQ10 110250 68 5,2
TV — 2 Elément triodeElément penthode
6,3 (0,43) 100 14348 5ECF80 3.50,4 MQ170 10 170 — 2 8,2
Elément triodeElément penthode
9 (0,3) TV 100 — 214348 5PCF80 3-50,4 MQ170170 10 — 2 6,2
0,4 à 0,5 MQ — 0 a— 163 MQ série sur grille6.3 (0.3) I 250349EM80 3-4
0,10.5 à 0,5 MQ — 1 à— 20
3 MQ série sur grille6.3 (0.3) I 250EM85 3503-40,12
6.3 (0,9) 300 Pour 2 tubes2 351 R 2 X 280EY82
PIÈCE DÉTACHÉE A onL importé pour 375 millions. l'Afriquedu Sud pour 1 (30 millions, la Suède pour125 millions, la Nouvelle-Zélande pour110 ’ millions. Du côté des enregistreursmagnétiques, la Nouvelle-Zélande et l'Ar-gentine en ont acheté pour 45 millionschacune, les Etats-Unis pour 30 millionset l 'Italie pour 25 millions.
Il est aisément possible de dégager, dece salon, quelques tendances généralesqui montrent l’orientation de la techni-que radioélectrique britannique.
D'abord, la plupart des fabrications vi -sent à la classe professionnelle, de sorteque le standard de qualité est générale-ment très élevé. Dans le môme ordred’idées, la miniaturisation, particulière-ment applicable dans certains cas d’ordremilitaire, fait des progrès de plus en plusnets chaque année et les techniques sem -blent être maintenant solidement établies.Les semi-conducteurs reçoivent des appli -cations de jour en jour plus variées ecplus étendues, et constituent une partimportante de la fabrication de certainsdes plus importants constructeurs.
La télévision occupe toujours une placed’honneur, et l’ouverture de la bande 3(notre bande actuelle en télévision) n’estpas sans susciter quelques problèmes, demême que le démarrage prochain des sta-tions en exploitation commerciale, quiimposent pratiquement l’utilisation de ro-tacteurs pour plusieurs canaux.
Les circuits imprimés font une entréeremarquée dans le domaine pratique etsemblent bien avoir pris fermement piedoutre-Manche. Touchant à tous les do-maines de la technique, leur applicationpermet de résoudre de graves problèmesde fabrication en grande série et d’éli-miner une bonne partie des difficultésassociées. C’est ainsi que l’on trouve chezA.B. Métal des commutateurs spéciauxpour circuits imprimés ; chez Bak éliteLimited les feuilles nécessaires en isolantrevêtues de conducteur sur une ou deuxfaces ; des fiches imprimées chez BellingLee ; la soudure et les compléments indis-pensables chez Multicore et Enthoven ;les supports spécialement établis chez MrMurdo ; des transformateurs à sortieadaptée chez Permeco : des applications
\
*ISIDRESLe Salflrtcliée a tfiair
à Londres,
i 10 exposants occupaient les stands et desvisiteurs de plus de 30 pays étrangers dé-filèrent dans les allées spacieuses de l 'ex-position .
Le nombre des exposants est le plusélevé qui ait été enregistré jusqu’à pré-sent, et représente une augmentation de30 % en quatre années.
Quelques chiffres ne sont pas sans inté-rê t , et c’est ainsi que l 'on relève que plusde 1 millions de pièces sont fabriquées enGrande-Bretagne par l’industrie radioélec-trique chaque jour. Il est à noter cpic laproduction a augmenté de plus de 30 %cette dernière année et quelle continue àaugmenter régulièrement. La comparaisonavec l’avant guerre fait ressortir une aug-mentation de cinq fois en faveur de 1955,et , de plus, témoigne d 'un changementd 'activités extrêmement sensible. C’estainsi qu'avant la guerre, 90 % de la fa-brication étaient dévolus à la radio do-mestique, alors que maintenant le pour-centage consacré aux récepteurs de radioet de télévision n’atteint plus cpie 45 %.Il est à souligner qu’en valeur absolue, ilreprésente tout de même trois fois pluscju 'avant guerre.
Autre chose remarquable, la moitié dela production est exportée, soit directe-ment, soir sous forme d’équipements com-plets. Les exportations directes pour l ’an -née dernière atteignaient sensiblementIl milliards de francs, en augmentationde 30 % par rapport à l’année précédente.Elles représentaient plus du tiers de lavaleur totale des exportations de l 'indus-
unique de la Pièce Déta-les à Grosvenor House,
'au 21 avril. Plus de
trie radioélectrique, qui joue sur 30 mil-liards de francs environ.
Les exportations indirectes étaient esti-mées à 8 à 10 milliards et les accessoiresà 2 à 3 milliards.
Le plus gros client de la Grande-Breta-gne est bien entendu le Commonwealth ,qui prend 45 % de l’exportation, suivi deprès par l ’Europe qui absorbe 35 %. Lereste est partagé dans l’ordre entre l’Amé-rique du Nord, l’Amérique du Sud. l'Asieet l’Afrique.
Si les exportations vers l’Europe ontaugmenté en cinq ans de 250 %, il estencore plus remarquable que les ventesvers la zone dollar, c’est-à-dire vers leCanada et les Etats-Unis, ont augmentéde 400 % dans la même période. Le pre-mier client est le Canada, qui en un ana plus que doublé la valeur de ses achatsà l’Angleterre, atteignant un chifrre de850 millions, alors que l’Australie le suitde près avec 835 millions et les Etats-Unis avec 712 millions. Il ne faut pas nonplus oublier l ’Inde qui est un gros ache-teur avec 700 millions pour la dernièreannée. Dans l’ordre viennent ensuite laSuède avec G00 millions, la Hollande etl ’Afrique du Sud avec 550 millions cha-cune et la Nouvelle-Zélande avec 427millions.
Du côté des gramophones et des enregis-treurs, pour lesquels la Grande-Bretagnejouit d 'une solide réputation de qualité,le meilleur marché pour 1954 a étél’Australie, qui a importé pour 410 millionsde gramophones et pour 105 millionsd’enregistreurs sur bandes magnétiques.
Il est remarquable qu’en ce qui con -cerne les gramophones, les Etats-Unis en
Circuits appliqués et soudure au trempé ( Plaquette Baké li te Limited ;châssis Invicta ) .
Transistor H . F. à pointes, diode jonction de puissance moyenne ettransistor jonction ( G . E . C . ) .
Juin 1955 203
aux antennes et à la télévision (circuitsmultiplex pour bandes 1 et 3) chez /.Beaux ; et, enfin, un stand où les circuitsimprimés sont à l’honneur et où se pressela foule, celui de T .C.C., où Ton trouvedes modèles complets pour des récepteursde radio, des amplificateurs de haute qua-lité, des récepteurs portatifs, des filtresd’antennes, des transformateurs M.F. pourradio et télévision et des panneaux dedistribution téléphonique.
En ce qui concerne la miniaturisation ,
elle est poussée à l’extrême dans certainesapplications militaires, et on note l 'appa-rition de montages complets dans lesquelstout un étage, avec les supports de lampesassociés, a été coulé dans une résine ther-mo-plastique, ce qui conduit à un volumeminimum. Des potentiomètres miniaturesde fabrication extrêmement simple et éco-nomique ont également fait leur appari-tion chez Fgen , et toute la série de lam-pes subminiatures est naturellemet dis-ponible.
Les semi-conducteurs ont atteint le sta-de industriel et c’est ainsi que les re-dresseurs de puissance au germanium sontdisponibles chez General Electric, avec unencombrement extrêmement réduit et desperformances qui ne stupéfient guère plusque ceux qui n'ont pas l’habitude depenser semi conducteurs.
En ce qui concerne la basse fréquence,elle est largement représentée, tant ducôté reproducteurs que du côté amplifica -teurs ou haut-parleurs. Bon nombre dehaut-parleurs anglais jouissent d’une répu-tation mondiale en ce qui concerne laqualité, et on note l'apparition de nou-veaux modèles à peu près dans toutesles séries. La tendance semble être à lacombinaison de plusieurs haut-parleurspour obtenir une fidélité maximum.
Les gramophoncs existent en une trèsgrande variété de types, allant du modèlesimple aux modèles professionnels, à per-formances et prix également élevés. Lesamplificateurs eux-mêmes ont bénéficiédes perfectionnements de la technique descircuits imprimés, et ccst ainsi que l'ontrouve, chez T.C.C., des amplificateursétablis selon le schéma publié par Milliardil y a quelques temps et en passe dedevenir célèbre, mais entièrement réalisésen circuits imprimés. Le montage en estextrêmement facile et les erreurs de câ-blage sont évitées dans une grande me-sure. De plus, la disposition et le câblageont été étudiés de telle façon que les per-formances de l'amplificateur en circuitsappliqués sont encore meilleures que cellesde l’amplificateur original, en particulieren ce qui concerne le ronflement et lebruit de fond.
Dans l’ensemble, ce salon donne uneexcellente idée de la vigueur et du dy-namisme de l'industrie radioélectrique bri-tannique. et les chiffres précédemmentcités concernant les exportations devraientporter à quelques réflexions salutaires.Nous ne saurions terminer sans remerciernos amis Andrew Reid et Joan Cuttingde l ’excellent accueil qui nous a. commetoujours, été réservé à notre arrivée àLondres.
Radio età la Foire
Du 24 avril au 3 mai a eu lieu, à Hano-vre, la plus grande exposition annuelle dela production industrielle allemande. Sonimportance peut se comparer à celle denotre Foire de Paris. Toutefois, la* radioet l’électronique y occupent une placerelativement plus large ; et cela pour lasimple raison qu’on ne conna î t pas en-core d’exposition de pièces détachées enAllemagne, et qu 'un salon de la radio,ouvert au grand public, ne se tient qu’unefois tous les deux ans. La prochaine deces manifestations aura lieu cette année,entre le 26 août et le 4 septembre, àD üsseldorf.
Au parc des expositions de Hanovre,
quatre bâtiments abritaient une surfacede 58 000 m2 où 850 exposants del ’industrie électrique et électroniqueavaient aménagé leurs stands. De la cen-trale électrique jusqu’à l’appareil électro-domestique, l ’électronique était partoutprésente ; et il serait pratiquement impos-sible de dire combien d’exposants il yavait dans chacun des domaines électricité,radio cl électronique, d 'autant plus quecertains d’entre eux exposaient des pro-ductions extrêmement variées.
Le visiteur français était surpris du fai-llie nombre d’exposants de pièces déta-chées radio. Les constructeurs allemandsde récepteurs fabriquent, en effet, unegrande partie des pièces détachées eux-mêmes. Cela est particulièrement valablepour les bobinages ; les « blocs » précâ-blés. comme les exposait , par exemple,Gôrler, sont pratiquement réservés auxamateurs et constructeurs de récepteursspéciaux. Une autre particularité du mar-ché allemand de la pièce détachée : unfabricant de supports de tubes fabrique156 modèles différents de cette pièce.Souvent, la différence réside simplementdans la largeur ou la hauteur d’une seulecosse. Celte profusion de variétés s’expli-que du fait que le modèle « standard »
n’existe, pratiquement, que pour l’ama-teur. Le constructeur commande quelque-fois un support spécial pour chaque tubed 'un appareil ; les cosses de ce supportsont calculés pour que le nombre de filsy puisse être fixé a\ cc le minimum detemps et de soudure.
Restons aux variantes multiples, et par-lons des antennes. Du dipôle simple àl 'antenne de quarante éléments, Fuba pré-sente toutes les formes d’aériens imagina-bles. Pour la télévision sur la bande IV.,actuellement à l’étude en Allemagne, ceconstructeur a créé un dipôle à largebande avec réflecteur, assurant un gain
de 10 (IB et un rapport avant-arrière de100. Hirschmann présente des antennesdont réflecteur et directeurs sont accor-dables sur un canal T.V. choisi en re-pliant les extrémités. Signalons égalementles antennes multiples de Kathrein. per-mettant d’alimenter, par un simple câble,
jusqu’à 12 locataires d’un immeuble ensignaux radio, F.M. et T.V.
Dans le domaine de la basse fréquence,
la gamme des amplificateurs exposés allaitde l’appareil de surdité à transistors pré-senté par Blaupunkl (consommation despiles : 0,1 franc/ heure) jusqu’au modèlede sonorisation de 1 000 W (Philips) . Par-mi les autres, nous nous contenterons designaler un amplificateur de haute fidé-lité ( Klein et Hummel ) , muni d’un ré-glage de réaction positive permettantd’annuler l’impédance de sortie. Au standPhilips , on pouvait voir un amplificateurcomportant un cadran sur lequel appara î tune courbe de réponse stylisée commandéepar les réglages de tonalité. Ce dispositifnous rappelle fortement 1 « Audioscope ».décrit dans le N° 180 de Toute la Radio.
Enfin, au stand Telefunken, un excel-lent meuble pour studios équipé... d'unIonophone. Tous ceux qui ont suivi avecsymphathie les travaux de S. Klein se ré-jouiront de voir le haut-parleur ioniqueadopté par l’une des marques mondialesles plus prestigieuses du domaine B.F.
Des enregistreurs sur fil et sur bandesont présentés, entre autres, par Friedrichet Grundig ; les bandes sonores Tefi sontmaintenant fabriquées pour une durée dereproduction de -1 heures. En plus desmicrophones nouvellement développés parPhilips et Telefunken. signalons un mo-dèle « anti-Larsen » de Labor-W . Isophonprésente un nouveau haut-parleur excen-trique dont la membrane possède approxi-mativement la forme d’une conque. Dualexpose le « changeur de disques quipense » , où toutes les manœuvres ma -nuelles sont réduites au strict minimum.
Les fabricants de tubes présentent troisnouveautés dans la série tous-courants(100 ni A) : UL 83. penthode finale d’unedissipation plaque de 12 W, UY 85. valveà fort débit, et L’M 80. indicateur d’ac-cord. La série batterie 25 mA se trouvecomplétée par les types DC 96 (conver-sion additive O.T.C.) et DF 97 (ampli-fication H.F. et M.F.). Parmi le grandchoix de tubes professionnels, citons unesérie de tubes subminiature à chauffageindirect et de caractéristiques très pous-sées, des tubes à longue durée, une triodeEC 56 capable de travailler au delà deA.V.J. MARTIN
204 Toute la Radio
électroniquede Hanovre
leur présentation , leurs performances etleur variété de types. On ne peut quedifficilement imaginer un procédé de me-sure pour lequel on n’aurait pas trouvéun appareil spécialisé à la Foire de Hano-vre. Rohde et Schwarz annoncent un mi-crovoltmètre sélectif , capable d’apprécier0,1 pY entre 20 kHz et 30 MHz. Un gé-nérateur U.H.F. 1 000 à 2 400 MHz de cemême constructeur délivre un signal con-tinuellement variable entre 1 uV et 4 V.Un appareil pour l’analyse spectrale enB.F., toujours fabriqué par Rohde etSchwarz, est basé sur le principe du chan-gement de fréquence. II est conçu pourdes mesures entre 30 et 20 000 Hz, lalargeur de bande pouvant être commutéesur 6 ou 200 Hz. Si vous devenez clientde cette maison, vous pouvez recevoir unerevue d’un fort volume, luxueusementprésentée et contenant des articles essen-tiellement techniques écrits par des au-teurs renommés et consacrés à l'utilisationdes appareils de mesure Rohde et Schwarz.
Une gamme complète d’appareils deservice était présentée par Grundig. Nousavons remarqué, notamment, un généra-teur-mire pour T.Y. permettant des ima-ges en grille ou en damier. Un distorsio-mètre à transistors était exposé parl'ekade ; Lahor-W présentait un voltmètreI ».F. (3 inV a 300 Y en fin de gamme) ,également utilisable comme signal- tracer.
Les appareils de mesure de quelques
4 000 MHz, et une cellule photo-conduc-tive au sulfure de plomb. Deux nouveauxtubes cathodiques de 7 cm à fond plat nedemandent qu’une tension d’alimentationde 500 Y.
Le nouveau transistor OC 72 de Philipsadmet une dissipation moyenne de 50mW ; son amplification de courant restelinéaire jusqu’à des intensités de collec-teur de 50 niA. D’autres transistors de50 mW sont présentés par l'ekade et Jn-termetall. Une diode au germanium n’estcertes pas une pièce encombrante ; malgrécela, Valvo a éprouvé le besoin de la mi-niaturiser. Les diodes de la série 0 A 70possèdent un diamètre de 3 mm et unelongueur de 13 mm. Les tvpes de la série) \ 80 sont légèrement plus grands ; unmodèle admet une tension inverse de115 Y.
Parmi les contacteurs. nous avons par-ticulièrement remarqué un modèle à tou-ches exposé par Rudolf Schadow. Du typeminiature, ce clavier est particulièrementdestiné aux récepteurs portatifs et d’auto.On peut libérer une touche non seule-ment en enfonçant une autre, mais aussien appuyant une seconde fois sur lamême. Au jeu normal de contacts, onpetit ajouter des contacts d’impulsionsfermés seulement aussi longtemps que ledoigt reste sur la touche.
Les appareils de mesure présentés im-pi essionnaient à la fois par leur nombre.
Voltmètre électronique Labor W.
grandes marques françaises furent très re -marqués à Hanovre. Ajoutons, à l’actifde ces exposants français, qu’ils ont suéviter — à une exception près — la mau-vaise impression que peut créer une no-tice qui n’est pas correctement rédigéedans la langue du pays.
On aurait facilement pu prendre pourdes condensateurs électrolytiques type car-touche les accumulateurs étanches nickel-cadmium présentés par Deac. Au standPreh, on pouvait voir des pièces ressem -blant à des potentiomètres mais quiétaient en réalité des atténuateurs conti-nus, permettant un affaiblissement dequelque 60 dB. et cela encore à 1000MHz ! Construits comme des potentiomè-tres à piste moulée, ces atténuateurs pos-sèdent un curseur blindé et une piste trèslarge dont la circonférence extérieure estreliée au boî tier.
Les Ets S.A.F. ont mis an point une fer-rite dont la perméabilité est de 4 000,
valeur qui n'a pas encore été atteinteavec ce matériau. Steatit-Magnesia fabri -que des plaques de ferrite (110 x 6 X 50mm) destinées aux cadres de réception.Plus facilement logée que le bâtonnet, laplatjue paraî t également donner une sensi-bilité et une surtension plus élevées.
Un nombre impressionnant d’appareilsélectroniques étaient présentés. Il s’agis-sait et d’appareils conçus pour la mesureindustrielle, et de dispositifs destinés aucontrôle et à la commande automatiquede la fabrication. Un compte rendu sur lesnouveautés que nous avons remarquéesdans ce domaine sera publié ultérieure-ment dans la revue « Electronique Indus-trielle ».
H. SCHREIBERWattmètre pour ondes t rès courtes type NAK de Rolule und Schwartz
205Juin 1955
GUIDE Dr- wap*
C O D E P O U R L E S F O U R N I S S E U R S :X Fabrication courante
A) Fabrication à l'étude
Livraison jusqu'à l’épuisement du stock RECEPTIOP(Fournisseurs et références
TUBES A CULOT OCTALTUBES A CULOTi cra o 5 -5 *-
E 2
O 3 ,
ï îc: 33
TJ
RÉFÉ R E N C E SNT U8E S o
C•SJ2 3 OZ 5 aNT U B E S c
52- -OJEL 34EL 38 M/5 P 29EL 39EM 34GZ 32UM 45 U 4 G5 U 4 GH5 Y 3 G5 Y 3 GH5 Z 46 AF 76 A 86 BG 6 G6 E 8fi F 5fi H 6fi F 66 H 8fi J 5fiJ 76 K 76 L 66 M fifi M 7fi N 76 Q 7fi SK 7fi SQ 7fi V 6fi X 5 G25 L 625 T 3 G25 Z 6
X R - 177R - LR - L
5 2 2XX
1 AC 6/DK 92I AJ 4/DF 9fiI A 3! L 4/DF 921 R 5/DK 911 S 5/DAF 911 T 4/DF 911 U 42 D 21/RL 213 A 4/DL 933 A 5/DCC 903 Q 4/DL 953 S 4/DL 923 V 46 AH 4/EC 92fi AK 5/EF 95fi AK 6fi AL 5/EH 91fi AM 6/EF 91fi AQ 5/EL 90fi AT 6/ERC 906 AU 6/EF 946 AV 4/EZ 916 AV 6/EBC 916 RA 6/EF 936 HE 6/EK 906 CR 66 J 6/ECC 916 P 9/6 BM 56 X 4fi Z 4/6 BX 49 AH 4/UC 929 J 69 P 9/9 RM 512 AT 612 AU 612 AV 612 HA 612 HE 635 W 450 B 5I 17 Z 3
XXX X X R XXX X R - L - 147 - 170 X X( ) R X XX X XX R - I. - 147 X X XX 147 XX X( )X X X R - L - C2 - 147L - 147R - I- - 147R - L - C2R - L - C2
* R - LR - L - C2R - L - C2 - 158R - L - C2R - L - C2R - L - C2R - L - C2 - 158R - L - C2R - L - C2R - L - C2R - LR - L - C2R - L - C2R - L - C2 - 158R - LR - LR - L - C2R - L - C2 - 147R - LR - LR - L - 147
X XXX X X X
*( )X XX X( ) ( ) ( )X XX X ( ). X
XX XX XX XX XXX XX X X X0X X X XXXX X X X X
AX X X X XX X X X XX X X XX X X X X X
IX X X X < ) X •X XXX XX X X
( )X X X X XX X X X X YXX X XXXX X X X X X XXXX X X X X X XX X X XX X X X
X
XTUBES A CULOT TRANSCONTINENTAL X X XX X >X X >X X >X X Xc<3 X X Y.2 =
TJ >Q CUcr ce
o nQ
X X XRÉFÉRENCESNT U B E S oo -eu5 z 2
TUBES A CULOT ILAF 3AF 7AK 2AL 4
X X R - LR - LR - LR - LR - LR - LR - L - 147R - L - Cl - 158R - L - ClR - L - ClR - L - ClR - LR - L - ClR - L
X XX X X XX X XX X X
AZ 1 cX X X X a o -:CBLfiCY 2EBC 3EBF 2EBL 1EB 4ECF 1ECH 3EC 50EEP 1EF 6EF 9EL 2EL 3 NEM 4EM 34EZ 3EZ 4R 120
aX X X X T U B E S NO 3X X X X T
1•c-i5( )X z 2* XX XX X 2 X 2/879/70 VE 35
5 Z 3 G5 Z 3 GB
X XX X X X
1X X X X XX X X X 80 X XIXR( )
TUBES A CULOT EURC( ) R - L - ClR - L - ClR - L - ClR - L - ClR - L - CI
X XX X X X
( ) X 'X X X XX X XX c ••<1RX PX X 3 JX U î:( ) R - L
R - L - 147NT U B E S o ::. r j
Z 2X •CJX X X 2 z 2 •X1883 R - L - Cl - 147
R - LR - L
X X X X1875 A X 50X1876 1877X
206 Toute la Radio • N 1
()
m TUBES C O D E P O U R L E S R E F E R E N C E S :R : Radio-Tubes — L : Lexique Officiel desLampes Radio — C : Caractéristiques Offi-cielles des Lampes — Chiffres : Numéros deT o u t e l a R a d i o — En gras : documents
comportant des courbesDN COURANTSnces des caractéristiques)
TUBES A CULOT NOVAL.OT MINIATURE c«J
O >O 11
-E Q
•ORÉFÉRENCESNTUBES ore -CJ5U
imTi i.13
Z SRÉFÉ RENCES
EABC 80/6 AK 8EBF 80/6 N 8ECC 81/12 AT 7ECC 82/12 AU 7ECC 83/12 AX 7ECC 84ECC 85/6 AQ 8ECF 80ECF 82/6 U 8ECH 81 /6 AJ 8ECL 80/6 AB 8FX 80/6 Q 4EC 81/6 R 4EF 80/6 BX 6EF 85/6 BY 7EF 86EF 89EL 81/6 CJ 6EL 83/6 CK 6EL 84/6 BQ 5EM 80EM 85EQ 80/6 BE 7EY 81 /6 Y 3 PEY 82EY 86/6 AX 2EZ 80/6 V 4PCC 84PCF 80/8 A 8PCF 82/9 U 8PL 81/21 A 6PL 82/16 A 5PL 83/15 A 6PY 80/19 W 3PY 81/17 Z 3PY 82/19 Y 3UC H 81/19 AJ 86 BA 76 BQ 7 A9 BQ 7 A1 2 AJ 812 BA 7
X X X R - L - C7 - 175 - 178R - L - C8 - 178R - L - C6 - 154 - 158R - L - C7 - 158 - 165R - L - C7 - 158 - 165R - 185R - 196R - 196
2X X X XX X X XX R - L - 165
R - 185R - L - C4 - 138R - L - C4 - 138R - L - C4 - 138R - L - C4 - 138R - L - C4 - 138R - L - C4R - LR - L - C4 - 138R - LR - L - C4 - 138R - L - C4 - 138R - L - C4R - 178 - 185R - L - C4 - 138R - L - C4 - 138R - I. - C4 - C6 - 138 - 158R - L - C4 - 138R - L - C4 - 138R - L - C4 - 138 - 158R - L - C4 - 138
XX - X X XX
XX X XX XXX XXX XXXX ) ( ) ( 196X X
X X R - L - C7 - 165 - 178R - L • C6 - 154 - 158R - L - C7R - L • C7 - 194R - L - C6 - 154R - L - C7 - 175 - 178R - 184 - 185R - 196R - L - C7R - L - C7R - L - C7 - 175 - 178R - 189 - 196R - 189 - 196R - L - C6
X XXX X X XX X
XXXXX
X X X XX X X X XX XX( )XX X X XXX X X XX
X X X XXX
) ( ) (X( )( )
X C7X XX 196X( ) C4 RX XXR - L - 154 - 165R - L - C4 - 138R - L - C4 - 138R - L - 154 - 165R - L - C4 - 138 - 158R - 165R - L - C4 - 138 - 147R L - C4
X xR - L - C7 - 160 - 170R - 185 - 190R - 196
X X X XX XXX XXX ) ( ) ( 196X X R - L - C6 - 154
R - L - C6 - 154R - L - C6 - 154R - L - C6 - 154R - L - C7 - 175R - L - C6 - 154R - C7R - L - C7 - 175R - 185 - 196
X XX XX X X X XX X ) (X X XX ( ) ( )185XX X X XR - L
R - L - 165R - L - C4 - 138 - 158R - L - C4 - 138R - L - 154 - 158R - L - C4 - 138R - L - C4 - 138R - L - C4 - 138 - 147R - L - C4 - 138R - L - C4 - 138 - 147
X X X X XXXX X ( ) XX X ) ( XX X ) ( ) ( 196X X ( )X 185XX X ( ) R - L - C7 - 175XX X
X XX TUBES A CULOT RIMLOCK-MEDIUMX
U S A. 4 BROCHES cr: O I!n
is~o
RÉFÉRENCESNTUBES ora •ut2 2 5
IIO O£ m
.!I-E 3
AZ 41DK 40DL 41EAF 42EBC 41ECC 40ECH 42EF 40EF 41EF 42EL 41EL 42EZ 40GZ 41UAF 42UBC 41UB 41UC H 42UF 41UF 42UL 41UY 41
X X R - L - C3 - 137 - 147R - L - 173R - L - 174R - L - 152R - L - C3- 137 - 152 - 158R - L - C3 - 137 - 158R - L - C3 - 158R - L - C3 - 137 - 159R - L - C3 - 137R - L - C3 - 137R - L - C3 - 137R - L - C3 - 137R - L - C3- 137 - 147L - C3 - 159R - L - 152R - L - C3 - 137 - 158
XRÉFÉRENCES ( )5 ( )
X X XX R - L
R - L - 147X X X
i ( ) x x( ) XX X( ) R - L - 147 X X
X XXX X XJRjbPÉEN 4 BROCHES X X XX X X
) (X XX X X
XX Xo =E û i
XX X--c Oc: Cû
R ÉFÉRENCES RXR - L - C3 - 137R - L - C3 - 137R - L - C3R - L - C3 - 137R - L - C3 - 137 - 147
XX X2X X X
XRX X X XRX X X X
N° 196 • Juin 1955
TRANSISTORS DE PUISSANCEA U N E V I T E S S E P R O D I C I E U S ELes transistors courants ont une dissipa-
tion maximum collecteur de l'ordre de50 mW. Quelques rares modèles de puis-s a n c e, principalement disponibles, auxU.S.A., supportent une dissipation comprise ,
suivant le mode de refroidissement, entre1,5 et 5 W. Enfin, différents lobcratoires ontannoncé la mise au point de transistorsd'une vingtaine de watts. Les figures ci -dessous donnent une idée de ce que pour -rait être la constitution de ces modèles lesplus puissants.
Le matériau de base est une plaquettef taillée dans un monocristal de germanium
L' I C O N U M E R A T E U Rcompte de petits objets
Il est difficile d imaginer une besogneplus fastidieuse que le comptage de pe-tits objets. Ht pourtant nombreuses sontles personnes qui consacrent à cette oc-cupation une bonne partie de leur vie.Tel est notamment le cas des gens quitravaillent dans des laboratoires d’analy-ses et qui sont astreints à compter lesglobules du sang ou les micro-organis-mes cultivés dans une boî te de Pétri, oubien les bactéries se trouvant dans deseaux plus ou moins polluées si ce ne sontpas les poussières contenues dans l’air.Ceux qui s’occupent des maladies profes-sionnelles sont obligés de compter lesparticules de métal , de silice, de charbonou de farine suspendues dans l’air et quele travailleurs de la métallurgie, les per-ceurs de tunnels, les mineurs et les meu-niers aspirent pour le plus grand pré-judice de leur santé. Et nous ne mention-nerons que pour mémoire les magasiniersqui perdent les plus belles heures de leurvie à compter les minuscules pièces dedécolletage.
Tout ce qui vient d être énuméré ci-dessus appartiendra bientôt au passé. Eneffet, là encore l’électronique vient pro-diguer ses bienfaits en libérant l’hommedes besognes les plus fastidieuses.
Deux ingénieurs des laboratoires DuMont. Cari Berkley et H. P. Mansberg.ont créé une dispositif qui, sous le nom del’Iconumérateur, est capable de compteren une seconde jusqu’à un million de pe-tits objets. Il n ’est pas obligatoire que ces
objets aient une forme tout à fait régu -lière ni qu ils soient absolument séparés1 un de l’autre. L'essentiel est qu’ilssoient disposés à peu près dans le mêmeplan et sans être absolument recouvertsles uns par les autres. C’est ainsi, parexemple, que si une pièce de monnaie setrouve à l’intérieur ou à l ’extérieur d’unanneau, l ’Iconumérateur comptera deuxobjets. Mais si deux pièces de vingtsous sont rigoureusement superposées.1 Iconumérateur ne distinguera qu’un seulobjet.
Bien entendu, le nouveau dispositif faitappel au principe de la télévision et no-tamment de l’analyse dit par « flyingspot ». Un mince faisceau lumineux ex-plore, par transparence ou par réflexion,1 ensemble des objets à compter et tom-be sur une cellule photoélectrique. L’ex-ploration se fait à haute définition : 1 000lignes ! Les Américains finissentvenir, mais pour des buts un peu parti-culiers...
Le courant de la cellule est , après am-plification, appliqué à un montage spé-cial qui constitue le « cerveau » de l’ap-pareil et qui contient notamment unemémoire électronique inscrivant la for-me du courant de chaque ligne.
De la sorte, si un objet couvre la hau-teur de plusieurs lignes, il ne sera comp-té qu une seule fois. Il est très probableque le dispositif fait ici appel aux mê-mes principes que ceux qui servent àl ’élimination des échos fixes dans lesradars.
Nous n avons pas de données techni-ques exactes concernant ITconumérateur.Mais nous pouvons faire confiance auxingénieurs qui l ’ont conçu et réalisé pourconsidérer qu’il s'agit là d 'un dispositifvraiment pratique. Les résultats apparais-sent sous la forme de chiffres lumineuxformant le nombre résultant du comptage.Une variante est prévue où les résultatssont imprimés directement sur une bandede papier.
On prévoit des applications extrême-ment variées pour ce nouveau dispositifdont notre photographie montre l ’aspectgénéral. Il faut notamment tenir comptede la nécessité d 'effectuer de très nom-breuses analyses du sang lorsqu 'on étudie1 influence de la radioactivité sur l’orga-nisme humain où les pernicieuses radia -tions détruisent les globules du sang. Letravail d ’analyse extrêmement lent par desméthodes classiques peut être accélérédans des proportions prodigieuses grâceà riconumératcur.
par y
pur (donc susceptible de supporter destensions élevées, de l'ordre de 500 V parexemple). L'une des grandes faces ducristal a été contaminée d'un corps accep-teur, comme l'aluminium ; elle devientune couche de germanium type p. L'autrecouche est transformée en type n par diffu-sion d'un corps donneur comme l 'antimoine.Ajoutons deux connexions, et nous obtenonsle redresseur que montre la figure 1 .
Pratiquons maintenant des saignées dansla couche n, et relions de deux en deuxles bandes de type n, comme le montre lafigure 2. Nous obtenons un transistor depuissance du type n-p-n capable d 'ampli-fier des courants extrêmement importants.
Il est évident que les rainures peuventêtre taillées dans la couche p, auquel casle transistor obtenu est un p-n-p. Le typen-p-n présente en principe l'avantage d'of -frir aux électrons un temps de transit pluscourt, donc de fonctionner à des fréquencesplus élevées. D'autre part , l'association d'untransistor p-n-p et d'un transistor n-p-n per-met, au moyen du montage dit « à symé-trie complémentaire » , de réaliser une sortede push-pull dont on ne connaît, et pourcause, aucun équivalent dans la techniquedes tubes à vide.
Les renseignements que nous venons defournir sont extraits du brevet U.S.A.n° 2 689 930, déposé par Robert N. Hallpour le compte de la General Electric Co.Nous en avons trouvé mention dans lenuméro de marsElectronics (New-York ).
1955 (p. 143) de Radio
Toute la Radio
CE QU'IL FAUT SAVOIR DES HYPERFRÉQUENCES :
Le magnetron P h i l i p T H I R K E L Lp a r
Précédents articles : Les guide-ondes (N° 193) ; Les cavités résonnantes (N° 194) ; La lampe phare et le klystron (N° 195)
Revenons à notre magnétron à cavités.Ces cavités sont toutes identiques, accor-dées sur la fréquence désirée et en nombrepair (fig. 3). Pour expliquer le phénomène,nous sommes obligés d'admettre que l’oscil-lation existe pour montrer ensuite que l’ap-pareil est capable de l’entretenir. Il règnedonc dans les cavités et dans l’espace ano-de-cathode un champ électro-magnétiquealternatif à très haute fréquence. Chacundes électrons émis par la cathode va êtresoumis à trois forces : une due au champélectrique radial créé par le potentiel con-tinu d’anode, une autre due au champmagnétique et enfin une troisième, variable,due au champ électromagnétique H.F. Onconçoit que cette troisième force peut, soits’ajouter, soit s’opposer à la résultante desdeux premières selon la position de l’élec-tron et l’instant choisi. Il y aura doncéchange d’énergie entre le champ électro-magnétique et le faisceau d’électrons (nousavons déjà vu, à propos du klystron, uncouplage du même genre entre cavité etfaisceau électronique). Le champ hautefréquence est une fonction sinusoïdale dutemps et, d’autre part, sa répartition dansl’espace, tout autour de la cathode, estsinusoïdale. C’est pourquoi les électrons nesubiront pas tous le même sort. Un électrondonné, puisqu’il se déplace, ne va donc pas
rapport au champ magnétique, l'électronatteindra l’anode ; dans le cas contraire,il retombera sur la cathode (fig. 2).
Pour un magnétron de dimensions don-nées et un champ magnétique déterminé, ilexiste donc un potentiel minimum, appelépotentiel de coupure, à donner à la plaquepour qu’il y ait un courant anodique.
Un tel appareil ne peut évidemment ser-vir à amplifier un signal ; mais il peut,dans certaines conditions, entrer en oscil-lations.
Le magnétron. qui est à la base de tousles radars ou plus exactement des postesde détection électromagnétique, est assezcélèbre. II mérite d’ailleurs ce succès decuriosité et nous ne pouvons pas faire moinsque de consacrer un chapitre entier à cetengin aussi curieux par ses possibilités quepar son principe de fonctionnement.
Caractéristiques généralesLe magnétron se présente comme une
diode placée dans un champ magnétique.11 est de forme cylindrique, la cathodeétant entourée par une anode concentrique( fig. 1 ).
Les lignes de force du champ magné-tique dans lequel baigne l’ensemble sontparallèles aux axes des électrodes.
Le potentiel positif de l’anode accélèreles électrons, mais la présence du champmagnétique vient courber leurs trajectoires.En effet, un champ magnétique exerce surun électron en mouvement une force quiest. à chaque instant, perpendiculaire à lafois au champ magnétique et à la traiec-toire de l’électron. Cette force est. de plus,proportionnelle à la vitesse de l’électron.
Si la tension anodique est grande par
Principe de fonctionnement
Le magnétron ne peut être comparé àaucun montage oscillateur classique : il estcependant nécessaire, comme toujours, defavoriser une fréquence aux dépens desautres. Cette sélection est réalisée dans lesmagnétrons actuels par des cavités tailléesdans la masse métallique de l’anode.
Nous laisserons en effet de côté les pre-miers types de magnétrons à anode pleineet à anode fendue — pour deux raisons :d’une part, ils ne sont plus guère utiliséset d’autre part, l’explication de leur fonc-tionnement est difficile sans mise en équa-tions des trajectoires électroniques.
Fig. 3. — Vue en coupe d 'un magnétron àcavités. Le prélèvement d 'énergie a lieu parboucle de couplage sur une seule cavité etla sort ie sur coaxial ( dans le cas présent ) .
Fig. I — Le magnétron se compose d ' uneanode et d ' une cathode, toutes deux pla -cées dans un champ magnétique axial créé
par un aimant extérieur au cylindre.
Fig. 2. — Vue en coupe du magn étronmontrant 3 trajectoires électroniques cor-respondant à 3 valeurs de la haute tension
pour un champ magnétique identique.209Juin 1955
les radars où il n'oscille que pendant debrèves impulsions. On ne lui applique, eneffet, la haute tension que pendant untemps très court, de l’ordre de la micro-seconde. La fréquence de répétition estvariable, mais de l’ordre du kilohertz. Lapuissance moyenne est alors le millième dela puissance réelle d’émission dite « puis-sance de crête ». C’est ainsi que des ma-gnétrons peuvent émettre des puissances decrête considérables : plusieurs centainesde kilowatts à plusieurs mégawatts.
Citons pour fixer les idées quelques ca-ractéristiques d’un magnétron utilisé surJO cm (3 000 MHz) :
Champ magnétique : 2 500 oersteds ;Haute tension : 25 000 volts ;Puissance crête : 250 kilowatts ;
Rendement : 50 %.11 se présente sous forme d'un boîtier
cylindrique de 10 cm de diamèLre et 5 cmde hauteur (ailettes de refroidissement com -prises).
11 est bon de signaler qu'en pratique cen’est pas l'anode qui est portée à des ' ten-sions positives, mais la cathode à laquellesont appliquées des tensions négatives. Eneffet, l’anode constituant l’enveloppe mêmedu magnétron est reliée au coaxial ou auguide de sortie. Cet ensemble ne peut, pourdes raisons de sécurité entre autres, êtreporté à des tensions élevées par rapport àla masse.
Le champ magnétique est fourni par unaimant permanent, lequel est dans certainscas inséparable du magnétron.
Les magnétrons sont généralement fabri-qués pour osciller sur une fréquence don-née et une seule. 11 existe toutefois desmagnétrons à fréquence variable, le réglagese faisant par déformation des cavités ouintroduction de plongeurs ajustables.
La gamme d'utilisation va de 1 000 à35 000 MHz, à l'heure actuelle.
le champ magnétique perpendiculaire àtoutes les trajectoires exerce une force,mais n’accomplit aucun travail.
obligatoirement céder et recevoir successi-vement la même quantité d'énergie. Cer-tains électrons vont être ralentis plusieursfois consécutivement : ce sont les électronsutiles ; tandis que d'autres, les électronsnuisible, seront accélérés. Mais, et c'est cequi permet le fonctionnement du magné-tron, les électrons utiles tourneront pendantun certain temps autour de la cathodetandis que les électrons nuisibles aurontune trajectoire très courte, soit en attei-gnant immédiatement l’anode, soit en re-tombant sur la cathode où ils provoquerontune émission secondaire (fig. 4). Cette
Modes du magnétronOn peut considérer l’oscillation à l’inté-
rieur d’un magnétron comme une onde sepropageant sur une ligne artificielle for-mée d'autant de cellules qu'il y a de cavitéset qui serait refermée sur elle-même. Pourcette raison, le déphasage (p de l'onde entredeux cavités doit être tel que, si le nombredes cavités est égal à 2n, nous ayons :2n cp = 2k TT { k étant un nombre entier).A chaque valeur de k correspond un« mode » du magnétron. L'onde tourne au-tour de la cathode et l'on peut considérer,pour se faire une idée dit phénomène, quele faisceau d’électrons s’accroche dessus,
le rotor d’un moteur àun peu commechamp tournant. La présence simultanéede plusieurs modes est gênante ; il fautdonc en favoriser un. Le mode généralementchoisi est le mode TT appelé ainsi parce quele déphasage cp entre deux cavités succes-sives est égal à TT. Les cavités se trouventêtre en phase deux à deux, et l'éliminationdes autres modes se fait alors en court -cir-cuitant les cavités de deux en deux pardes fils, ou « straps ». Ce procédé estappelé strapping à défaut d'autre appella-tion plus française (fig. 5). En fait, lesfils ne réalisent pas, à ces fréquences, unvéritable court-circuit, mais le résultat cher-ché est cependant obtenu.
Utilisation du magnétronIl a été employé, à ses débuts, comme
oscillateur entretenu mais a ét é détrônépar le klystron.
11 est utilisé en modulation d'impulsionsen télécommunications. Mais il est prin-cipalement employé à l'heure actuelle dans Philip THIRKELL
UN MAGNÉTRON FRANÇAIS RÉCENTFig. 4. — Différentes trajectoires électroni-ques dans un magnétron où règne unchamp haute fréquence : I et 3 sont lesdeux types de trajectoires d’électrons nui-
sibles ; 2 est celle d ’un électron utile.Fig. 5. — « Strapping » du magnétron. Ceprocédé consiste à obliger , au moyen descourts-circuits, les cavités à résonner deuxà deux en phase afin d ’ éliminer les modes
parasites.
On voit ci-contre, partielle-ment coupé et démuni deson aimant, le magnétron MC
101 ( S.F.R.) , pouvant dé-livrer 450 kWsions dans la10 cm. Les fils sous perlessont les connexionsment ; à la partie diamétra -lement opposée se trouvel ’antenne de sortie, reliée àla boucle de prélèvement del ’énergie. La coupe permetencore de voir les cavités,dont les alésages cylindri-ques constituent la partieinductive du circuit oscillant,les fentes correspondant àla partie capacitive. On re-marquera aussi les « straps »( voir figure 5 de l ’articleci-dessus ) . Enfin, des ailettesaméliorent le refroidissement.
en impul -gamme des
fila -
émission secondaire est telle que, dans cer-tains cas, le chauffage du magnétron peutêtre supprimé quand le régime normal defonctionnement est atteint.
L'expérience confirme que le champ élec-tromagnétique reçoit du faisceau électro-nique plus d’énergie qu’il ne lui en cède.L oscillation non seulement s'entretient,mais permet un prélèvement importantd’énergie. Ce prélèvement s’effectue dansune des cavités, généralement par l’inter-médiaire d’une boucle de couplage.
L’énergie n’est finalement fournie quepar l’alimentation haute tension. En effet.
210
TOUTE LA RADIOa dé jà consacré de nombreux articles
aux AUTO-RADIO :
N° 181 (épuisé) : Généralités
182 (épuisé)N 1 83 (épuisé) L'alimentation\
ELes étagesH.F.,changeurs et
M.F.
N° 188 (épuisé) : Détection et B.F.
N° 194 (Épuisé) : S c h é m a s d erécepteurs industriels
N° 195 (mai 1955) : Prototype deconstruction (modèle économique)
mN° 184 (épuisé)N° 1 85 (mai 1954) \
(
p a r E .- S . F R E C H E TDe toute les voitures françaises, la « Versailles » est certainement celle qui a fait
le plus beau sort au récepteur auto-radio ( document Philips ).
2° Préparation des différents élémentspour le montage;
3" Montage de chaque élément ;
4° Raccordements électriques et essais;
5° Déparasitage (nous reviendrons ulté-rieurement sur ce point important ) .
Il est à noter que, selon la marque del 'ensemble récepteur, le type de la voitureet l 'expérience de l’installateur, l ’ordre deces opérations peut être modifié. C’est ain-si que, dans bien des cas, il sera intéres-sant de poser les diff érents câbles de rac-cordement immédiatement après le per-çage des trous (il faudra alors, évidem-ment. prévoir un certain « mou » pourque les connexions ne se révèlent pastiop courtes lorsque les éléments serontmis en place ) .
certaines des parties composant l 'ensembleà installer. Cet ensemble est généralementconstitué par le récepteur proprement dit,sa boî te d’alimentation, son ou ses haut-parleurs et son antenne. Nous allons étu-dier séparément ces divers éléments en dé-crivant pour chacun d’eux les principalesopérations à effectuer, en indiquant aussiquels sont, sur les voitures actuelles, lesemplacements possibles.
Si nous avons adopté ce classementpour plus de clarté dans notre exposé, ilest bien évident que l’installateur aura in-térêt à ne pas opérer élément par élé-ment. mais à concevoir, dans les grandeslignes, son plan de travail de la façonsuivante :
1 " Perçage de tous les trous nécessairesdans la carrosserie et les autres partiesde la voiture;
L installation des récepteurs auto-radio,
effrayant généralement ceux qui n’ont pasencore eu l’occasion de pratiquer ce gen-re de « sport », ne présente cependantaucune difficulté et peut être menée àbien par tous ceux, amateurs ou profes-sionnels, qui savent manier une perceuseet n’ont pas peur d’un peu de cambouis.
Nous dirons tout d’abord quelques motsde l’outillage nécessaire. Il est plus prochede celui du mécanicien que de celui duradio-technicien, et comporte, outre unepetite perceuse à main ou « chignolle »avec un jeu de forets, des limes, un choixce clés, tournevis, pinces, une pointe àtracer, une balladeuse. des chiffons, et...un bleu de travail.
On opérera dans un garage très bienéclairé, dans une cour, une impasse, etc...Un travail préparatoire sera à effectuer sur
Deux solution pour l' équipement d'une « traction » nous sont offertes par Grandin ( à gauche) et Are! ( modèle Séduction, à droite ) .
de bord. etc... Dans l’impossibilité d’exa-miner tous les cas possibles pour tous lesappareils et toutes les voitures, nous al-lons citer quelques cas choisis parmi lesplus courants.
Mais, auparavant, nous désirons déga-ger quelques règles générales concernantle choix de l’emplacement :
Le récepteur doit être aussi éloigné quepossible des fils de câblage du tableau debord et. principalement, de la clé de con-tact. L’ensemble de ce câblage se trou-vant généralement du côté du volant, onaura donc intérêt à disposer le récepteuraussi loin que possible de ce dernier. Onest toutefois limité dans cette voie par lanécessité, fréquente, de permettre l’usagedu récepteur au conducteur de la voiture.Signalons que certains dispositifs de com-mande à distance concilient dans une cer-taine mesure ces deux impératifs opposés.
Il est souvent très pratique d'utiliser,pour la fixation arrière du récepteur, dela bande perforée que l 'on peut se procu-rer facilement et que certains fabricantsfournissent d'ailleurs avec l'auto-radio.
L’appareil ne doit subir aucun effortde traction susceptible de provoquer unedéformation. Il faudra notamment prendresoin de calculer exactement la longueuret le pliage de l’éventuelle bande de fixa-tion arrière.
Dans de nombreux cas, l'installationsous le tableau de bord est plus rapide etplus facile que l 'installation « en encas-tré ». Mais elle est moins élégante, leréglage est moins accessible et, de plus,elle risque de causer une gêne aux passa-gers possesseurs de jambes du type « deGaulle ». Faisons une mention spécialepour le récepteur «Firvox RA 37 » (décritdans le numéro 194 de Toute la Radio )qui, grâce à une conception très originale,peut prendre l’aspect d'un appareil encas-tré (avec tous les avantages de ce genrede montage ) sans que son installation soitplus compliquée ni plus longue que lapose sous le tableau de bord.
Voici maintenant, pour quelques voitu-res, les différents emplacements où l’onpeut placer le coffret « récepteur » :
2 CV Citroën : Ici, pas de tableau debord ; le montage encastré est donc im-possible. Mais le récepteur peut très bientrouver sa place au-dessous de l étagère-filet, soit au milieu (sous le levier dechangement de vitesse ) , soit tout à fait àdroite. La fixation sera effectuée très faci-lement au moyen d'équerres ou d'entre-toises vissées sur l’étagère, l’arrière ducoffret étant immobilisé à l’aide d’un mor-ceau de bande perforée vissée sur le ta-blier paroi formant cloison et séparant letableau de bord du moteur.
4 CV Renault : Il y a quelques années,on trouvait couramment des récepteursspécialement étudiés pour être logés dansla boîte à gants de la 4 CV. Ils sont de-venus maintenant fort rares, mais presquetous les appareils modernes peuvent êtreinstallés dans cette voiture à d'autres em-placements.
Comme la plupart des voitures récentes, la « Frégate » comporte, au centre du tableaude bord , un emplacement spécial pour le récepteur et le haut-parleur. — Au-dessous :Sur le tableau de bord en matière plastique de la « Dyna 54 », un emplacement a étéprévu pour l'auto-radio. Le haut-parleur, invisible ici, trouve sa place dans la baie de
lunette arrière ( documents Philips ) .
Il n ’est pas dans nos intentions de faire dans le tableau de bord ou fixé au-des-cours de perçage ou de découpage.
Nous signalerons seulement que pour ef -fectuer ces opérations dans la tôle de lacarrosserie sans écailler sa laque, il estprudent de coller à l 'endroit voulu un mor-ceau de papier kraft qui sera donc percéen même temps que le métal. D'ailleurs,pour le découpage du tableau de bord,certains fabricants fournissent avec le ré-cepteur un plan de découpe grandeur na-ture qu’il suffit de coller à l’emplacementdésiré. Cela rend impossible toute erreur.
sous de celui-ci.La première opération à effectuer sur le
récepteur est la commutation sur la ten-sion voulue (généralement 6 ou 12 V ) ;cette commutation est souvent opérée parle moyen de connexions soudées qu’ilconviendra de déplacer si l 'on désire uti-liser l 'appareil sur une tension différentede celle pour laquelle il était prévu initia-lement. Les notices des constructeurs don-nent toutes indications à ce sujet.
Selon l'emplacement choisi et le typedu récepteur, il peut être nécessaire dedémonter le démultiplicateur et les bou-tons pour rendre possible l’encastrement,ou encore de réaliser une fixation préa-lable sur une platine spéciale qui sera en-suite fixée elle-même de façon à obturerl’ouverture d’une boî te à gants (exemplevalable, entre autres, pour la « SimcaAronde » ) , ou aussi, sans aucun démon-tage, de fixer sur les côtés du coffret« récepteur » de petites équerres qui per-mettront une adaptation sous le tableau
Pour le découpage, il est très pratiqued’utiliser une lime-scie « Abrafile ».
Récepteur
Dans la majorité des cas, le récepteurse. présente sous la forme d’un boîtier as-sez plat comportant, soit la totalité desétages, soit une partie de ceux-ci ( jus-qu'à l’amplification de tension, par exem-ple ) , et pouvant être à volonté encastré
Toute la Radio212
'
TIGE DE FIXATION ARRIÈRE»
HAUT-PARLEUR ALIMENTATION FUSIBLE 10 A. ANTENNEr\
RECEPTEURTONALITÉ
ALLUMAGE PUISSANCE |COMMUTATEUR DE GAMMES
RECHERCHE DES STATIONS
Exemple de montage d ' un récepteur Firvox sur une « Vedette » ( reproduit avec l 'aimable autorisation du « Bulletin service Ford »).
Le plus fréquemment , le récepteur estfixé au-dessous du tableau de bord, aucentre de celui-ci.
« Dyna 54 » Panhard : Cette voiture,
très récente, est pourvue d 'un tableau debord en matière plastique prévu spéciale-ment en vue de l’installation d’un récep-teur auto-r^dio. Tout le perçage est ébau-ché. et il suffit de crever le « voile » de
gantiers, l’emplacement central étant ce-pendant le plus souvent retenu, car leposte demeure ainsi à la portée du con-ducteur.
Pour l’installation sur « Aronde », uncache-support est nécessaire. C’est unepetite platine découpée dans laquelle s’en-castre le récepteur. Elle est ensuite vis-sée aux lieu et place du gantier dont leboîtier métallique aura été supprimé. Se-lon le modèle de récepteur adopté, il yaura peut-être lieu de pratiquer à la limecertaines échancrures dans la bakélite dutableau de bord.
« Vedette » Simca : Dans la plus ré-cente des voitures françaises, un emplace-ment de choix a. évidemment, été réservéà la radio :' le récepteur trouve4 sa placeau centre bas du tableau de bord (découpefaite en usine ) ; une élégante grille deforme trapézoïdale, située au-dessus, estdestinée à abriter Te haut-parleur. Regret-tons toutefois que, sur le modèle « Tria-non ». cette grille soit remplacée par unpanneau de tôle, ce qui ne facilite pas letravail de l’installateur.
« 203 » Peugeot : Sur ce type de voi-ture, le récepteur est généralement encas-tré dans la porte du gantier central, soitau centre de l’enjoliveur chromé, soit au-dessus de celui-ci (cas où l’emplacementjitué au-dessous de l’enjoliveur est occupépar la grille du haut-parleur ) . On peut,
soit découper soi-même cette porte aprèsavoir collé dessus le gabarit en papierfourni avec le poste, soit se procurer chezcertains constructeurs une porte dé jà dé-coupée aux cotes du récepteur, et la sub-stituer à la porte d’origine.
Si la forme et les dimensions de l’appa-
matière plastique subsistant pour encastrertrès facilement un appareil.
« Aronde » Simca : Le tableau de bordde cette voiture a également été prévupour l ’installation d’un auto-radio. Il com-porte deux gantiers, l ’un au centre et l’au-tre à droite, tous deux munis d’un couver-cle escamotable. Le récepteur peut êtrelogé à la place de l’un ou l’autre de ces
Récepteur Grandir! installé sur 4 CV Renault
213Juin 1955
Exemple de montage d 'un récepteur « Séduction » Arelsur une « Vedette » (reproduit avec l 'aimable autorisation
du « Bulletin service Ford »).permettre, si on le désire, d 'y loger côteà côte récepteur et haut-parleur.
On peut également se procurer la portedu gantier découpée à l'avance.
« Colorale » Renault : La grande di-mension du vide-poche central permet dele remplacer par une platine spéciale danslaquelle on encastre, l'un au-dessus del 'autre, récepteur et haut-parleur.
« Frégate » Renault : Dans cette voi-ture, l ’installation d’un récepteur a étéprévue. De ce fait, la disposition, univer-sellement adoptée, est fort heureuse. Lerécepteur est encastré dans le haut dutableau de bord , au centre. Au-dessous,
une élégante grille galbée masque le haut-parleur.
« Vedette » Ford : Dans cette voiture,
le récepteur s’installe généralement aucentre du tableau de bord , soit au-dessous,
soit au bas de celui-ci (encastré dans la« moulure » où se trouvent dé jà les bou-tons de commande du moteur ) , soit aumilieu (encastré dans la grille marquée« Vedette »).
« Comète » Ford : Une présentationélégante peut être obtenue en encastrantle récepteur dans le tableau de bord, àdroite des compteurs.( A suivre )
Heureuse association d ' unrécepteur Grandin et
d ’une 203 Peugot.
reil se prêtent mal à l'encastrement dansle gantier, il est possible de faire l’instal-lation sous le tableau de bord, soit aucentre, soit à droite.
11 et 15 CV Citroen : Plusieurs empla-cements sont également possibles dans ces
voitures, soit que le poste soit encastrédans la porte du gantier (à droite sur letableau de bord ) , soit qu’il soit placé au-dessous du tableau de bord, à droite ouau centre. Dans le premier cas, la portedu gantier est suffisamment grande pour E. S. FRECHET
H P ÉLECTROSTATIQUE SYSTÈME S. KLEINnues avec un matériel encombrant. Lesrecherches furent alors orientées vers lapossibilité d’utilisation de tensions d’atta-que de l'ordre de 15 V et d’une tension depolarisation de 200 à 250 V. Et la mem-brane en matière plastique métallisée na-quit , excellente pour la reproduction desfréquences élevées , mais aussi , commenous l’avons vu. génératrice d’indésirablesharmoniques.
C’est à un retour à la réalisation pri-mitive. indiscutablement fidèle et suscep-tible d’accepter des tensions d’attaque éle -vées. que S. Klein convie les utilisateurs
du haut-parleur électrostatique. La possi-bilité de mouvements de grande amplitudede sa membrane permet d’atteindre unelimite inf érieure en fréquence voisine de700 Hz. L’alimentation, 2 000 à 3000 Vde tension continue de polarisation et500 V de tension B.F. d'attaque, est obte-nue avec une déconcertante simplicité.
L’originale conception de S. Klein au-torise donc dans ce domaine tous les es-poirs, et il est vraisemblable que, toutcomme l' Ionophone. elle est appelée àfaire parler d’elle dans un très procheavenir.
Dans notre précédent numéro. page 17*4 ,nous avons exposé l’idée originale deS. Klein, le père de l’Ionophone, pourl’utilisation rationnelle du haut- parleurélectrostatique. Précisons, afin d’évitertoute confusion dans l’esprit de nos lec-teurs. que le système proposé s’appliqueau haut-parleur à membrane libre et nonau type à membrane en matière plastique,métallisée appliquée sur l'électrode per-forée.
Ainsi que nous l’avons rappelé, le haut-parleur électrostatique originel, d’une fidé -lité remarquable, exigeait des tensionsd’attaque et de polarisation élevées , obte-
Toute la Radio214
ILIin/AUir N° 28IE
BASSE FR éQUENCEENREGISTREMENT ET REPRODUCTION • SONORISATIONCIN ÉMA SONORE • AMPLIFICATEURS DE QUALIT ÉPI È CES DÉ TACH É ES B. F. • NOUVEAUX MONTAGES
irLE TLR 196IE
AMPLIFICATEUR/
economique
de construction facile9 W modulésDistorsion totaleinférieure à 5 %
Contre-réaction corrigéeCommandes de tonalité
L’amplificateur que nous allons dé-crire permet d’obtenir une puissancemodulée de 9 W avec une distorsionde 5 9c . Cette puissance est large-ment suffisante pour de grandes piè-ces d’habitation ou des petites sallespubliques. Il est équipé de tubes clas-siques EF 40 et deux EL 41 en push-pull (fig. 1) .
L’ensemble peut être divisé en deuxparties :a ) L'amplificateur proprement dit, quicomprend un étage d’attaque pentho-de, un étage de déphasage du type
cathodyne avec penthode montée entriode puis les étages de sortie. Unechaîne de contre-réaction non sélec-tive est établie entre le secondairedu transformateur de sortie et le cir-cuit de cathode de la penthode d’at-taque ;b ) Un étage de correction dont le gainpeut être relevé dans la zone des fré-quences basses et dans celle des fré-quences élevées, sans que le niveaudu médium soit modifié. On sait com-bien est néfaste pour la qualité de lareproduction le procédé qui met enœuvre un dispositif de contre-réactionsélective dont la propriété est de sup-primer ou de réduire considérable-ment le taux de contre-réaction pourles fréquences extrêmes du registremusical. En effet, la contre-réaction,qui agit favorablement dans la zonedu médium pour réduire la distorsion,se trouve supprimée pour les fréquen-ces basses et les fréquences élevées,l’importante réduction de la résis-tance interne du tube final qui amortitl 'équipage mobile du haut-parleur,augmente de valeur, la résonance pro-pre de la membrane apparaît forte-ment, l’absence du facteur de correc-tion de distorsion dans les fréquencesélevées fait que la distorsion est plusgrande et que les harmoniques indési-rables indisposent l’oreille.
Contre-ré action et phaseOn a beaucoup discuté et on discu-tera encore sur la sensibilité de l’o-
reille aux distorsions de phase. Des
Juin 1955 215
EL 41 EL. 41E F 40 EF 40
Lh) 6|j , 1 h) jÇlLJ h) txÿ i i l: :
50 nF50 nF500 X1-VAAAtttt rm
500 X1g Id: CiZ1OesCSJ , «O
Ci50 nFCiJtc
o~*OJ
16S C 40055 kXl
AWW^550 kft 8
6,3v r j-o+ go
5 Y 3 GB40 yFl=J
o Ooo >o ooD 400 &o oo oo oo oo goVCP' o400 X1—VS/WA ooo+ + o40 tFra 1=140 y F l=J40 J.F
350/400
Fig.2 Fig.1
Fig- 1- — L’amplificateur TLR 196, dont le schéma n’a rien de révolutionnaire, a le mérite de fournir des résultats très honnêtes pour un prixde revient minimum. •
Fig. 2. — L’ajustage du condensateur placé dans le circuit de contre-réaction sera fait de sorte qu’un signal rectangulaire de 1000 Hzapparaisse aussi « propre » que possible sur l’écran d’un oscilloscope.
Fig. 3. — Tension efficace du signal d’entrée Ve et taux de distorsiontotale en fonction de la puissance de sortie. Remarquer que la distorsionn’est que de 1,5 0/0 pour la puissance déjà très appréciable de 4 W.
essais subjectifs ont été faits et ontmontré que celle-ci a tout de mêmeune importance ; certains auteurs nesont toutefois pas convaincus. Maissi les avis sont encore partagés surce point, personne ne discute l’effetnuisible de la rotation de phase dansune chaîne de contre-réaction. Qui ditcontre-réaction dans un amplifica-teur B.F. dit injection en phase oppo-sée par rapport à la tension d’atta-que d’une fraction de la tension desortie dans le circuit d’entrée, phaseopposée s’entendant par décalage de180°. On conçoit que si celui-ci estdifférent, le taux de contre-réactionsera différent aussi, donc la réduc-tion de l’amplification sera plus fai-ble. Quand des éléments réactifs sontintroduits dans la chaîne pour corri-ger la courbe de réponse, il est trèspossible que la tension réinjectée soiten phase avec la tension d’entrée,pour une certaine fréquence et qu’a-lors l’amplificateur entre en oscilla-tion (1). Pour d’autres fréquences,les harmoniques sont amplifiés d’une
façon exagérée. On arrive à une tona-lité dans les aiguës désagréable àl’oreille (on dit parfois que le son est« vrillé » ).
Si l’emploi de la contre-réactionsélective est admis dans les appareilscourants où elle peut donner desrésultats acceptables, traitée avec dis-cernement, il est préférable, quand leprix de revient n’intervient pas partrop, de construire un amplificateuravec contre-réaction non sélective etde placer devant cet amplificateur undispositif de correction de tonalité.C’est ce qui a été fait dans l’appareildont la description fait l’objet du pré-sent article.
Bien que la chaîne de contre-réac-tion ne comporte que des élémentspassifs, il a été nécessaire de placerun condensateur parallèle sur la ré-sistance du diviseur de tension derenvoi, car la source de tension, elle,est réactive. Les enroulements dutransformateur ont une self -inductionpropre, une capacité propre et ilexiste une self -induction de fuite ; latension aux bornes du secondaire n’estpas toujours en phase avec celle quiest appliquée 'au primaire. Le cas se
complique encore du fait que l’am-plificateur e^t à sortie symétrique,que la self -induction de fuite est engénéral différente entre le secondaireet chacun des enroulements primai-res ; c’est là qu’apparaît la difficultéde la construction de bons transforma-teurs de sortie pour push-pull, et ledéséquilibre est d’autant plus marquéque la fréquence est élevée.
Le contrôle de l'appareil en signauxrectangulaires a permis de faire rapi-dement la correction nécessaire ; pourun signal à 1000 Hz, on observait surl’écran une oscillation. L’adjonctiond’un condensateur de 1000 pF en pa-rallèle sur la résistance de 1000 Q'. afait disparaître cette oscillation(fig. 2). La valeur donnée pour cecondensateur est correcte pour untransformateur déterminé ; l’examenen signaux rectangulaires permet untravail très rapide. Plus difficile estcelui de la mesure du déphasage. Quece soit pour la B.F. ou pour la télé-vision, la construction d’un ensemblepour la reproduction de signaux rec-tangulaires est très utile ; elle demandepeu de temps, les services rendus sonttrès grands.
fl ) Voir à ce .sujet les articles de J. Zakheimet de R. Deschepper, Toute la Radio n° 173.
216 Toute la Radio
dB+18+16
+14 A+12
+10
+ 8
+ 6
+ 4
+ 2 C0
D- 2
- 4
- 6
- 8-10
-12
-14
-16
-18
-2010 100 1000 10 000
F ( Hz)Fig. 4
nNe cherchez pas les potentiomètres de réglagede puissance et de tonalité... Ils sont fixessur le meuble et seront réunis au châssis par
des cordons blindés et un bouchon octal.
Fig. 4. — Action despotentiomètres dosantindividuellement
ves et aiguës.S0 Hz 600 Hz
gra-
L’amplificateur proprement dit5 000 Hz 10 000 HzLes circuits sont très classiques. La
polarisation des deux tubes EL 41 estobtenue par la chute de tension queproduit aux bornes d’une résistancebobinée placée entre cathodes et massele courant des deux penthodes. Onréglera la valeur de cette résistancepour que le courant d’anode soit del’ordre de 35 mA par tube. H est rarede tomber sur deux tubes identiques ;si l’écart n’est pas bien grand, l’im-portance du déséquilibre est petite etne se fait sentir que pour des puis-sances assez grandes demandées àl’amplificateur. Si l’on dispose d’unecertaine quantité de tubes, il est évi-demment préférable de les sélection-ner par paires.
Pour mesurer le courant d’anodesur l’amplificateur, il est prudent deplacer un fort condensateur entreplaque et masse car la longueur desfils de liaison au milliampèremètrepeut amener l’entrée en oscillation del’étage d’où erreur de mesure. Biensouvent on place, à demeure, en paral-lèle aux bornes du primaire du trans-formateur de sortie un ensemble con-densateur - résistance monté en série,quelques millièmes de microfarads etquelques milliers d’ohms. L’action dece dispositif ne se fait pratiquementpas sentir en haut de la plage de fré-quences utile, mais son efficacité appa-raît pour les fréquences élevées cor-
Fig. 4 bis. — Réponseà des signaux rec-tangulaires de diffé-
rentes fréquences.Fig.4 bis
respondant aux oscillations sponta-nées ou provoquées dans les régimestransitoires.
quence. La pente statique étant S, lapente dynamique Sd a pour valeur :
1S.. S1 + RS
R étant la résistance placée entre ca-thode et masse. Cette résistance a iciune valeur de 25 000 Q' plus 1 600 O.M a i s , en parallèle, on a p l a cé uncondensateur, puis une inductance. Onsait que la capacitance diminue quandla fréquence augmente et que l’induc-tance toL diminue lorsque la fréquencediminue ; on conçoit donc que l’effetde contre-réaction sera d’autant moinsprononcé que la fréquence sera ouélevée ou basse. La pente augmentera,l’amplification aussi, pour les deuxextrémités du registre musical. L’am-plification passe de 0,83 à 5,8 à 50 Hzet à 6,6 à 10 000 Hz. Deux potentio-mètres de 50 kQ placés en série avecles charges variables permettent dedoser les corrections.
De plus, le potentiomètre « aiguës »est monté de telle façon qu’il agit enaffaiblisseur pour les fréquences éle-vées vers une des extrémités de lacourse du frotteur.
L’étage dé phaseurLe déphasage est obtenu par un
étage à charge cathodique équipéd'une penthode EF40 montée en triode.
L’é tage d’attaqueL’étage d’attaque ne présente au-
cune particularité. Si l’on désire uti-liser l’amplificateur sans l’étage decorrection, on peut prévoir un dispo-sitif d’inversion qui fera passer lepotentiomètre d’entrée au point p, etcoupera la liaison de ce point à l’a-node du tube de l’étage de correction.
L’é tage de correctionOn sait que le gain d’un étage est
lié à la résistance interne du tube, àsa pente et à la charge d’anode. Dansle dispositif utilisé, c’est la pente dutube qui varie en fonction de la fré-
J u i n 1955 217
relèvement ou de l'affaiblissement dela puissance aux extrémités du regis-tre. La dénivellation, entre les cas lesplus différents, mesurée sur l’étage decorrection seul est de 3 dB.
La figure 4 bis représente, calquéssur l’écran de l’oscilloscope, les oscillo-grammes correspondant à des signauxrectangulaires appliqués à l’entrée del’amplificateur. Le relevé est fait surcharge ohmique et au secondaire dutransformateur de sortie ; il n’a qu’unevaleur indicative, car il correspond àune position bien déterminée des po-tentiomètres de correction ; nous avonspensé qu’il était malgré cela intéres-sant de le publier.
Voici quelques résultats de mesures :%
Alimentation à la sortie du filtre :260 V.
Polarisation des deux EL41 : 6,8 V.Courant d’anode des deux EL41 :
35,5 mA X 2.Courant d’écran des deux EL41 :
5,7 mA X 2.Polarisation EF40 déphaseuse :
1,75 V.Tension cathode-masse EF40 dépha-
seuse : 60 V.
Remarque importanteLçs résultats de mesures donnés et
les valeurs indiquées pour le diviseur' de tension du circuit de contre-réac-
tion sont valables pour une bobine mo-bile de 12 Q. Le taux de contre-réac-tion est ici :
Performances
La mesure de la sensibilité puis cellede la distorsion ont été faites à partirdu point p ; l’étage de correctionn’étant pas dans la chaîne d’amplifi-cation, la puissance a été contrôlée auxbornes du secondaire du transforma-teur de sortie chargé par une résis-tance dont la valeur correspond à l’im-pédance de la bobine mobile du haut-parleur utilisé. La figure 3 représenteces deux caractéristiques en fonctionde la puissance. On voit que l’on peutobtenir une puissance de 6,5 W avecune distorsion de 2 % et cela avec unetension de 200 mV appliquée à l’entréede l’étage EF 40 penthode. L’amplifi-cation de l’étage de correction étantde 0,8 il faudra 250 mV à l’entrée del’amplificateur pour obtenir 6,5 W àla sortie. Mais cela n’est vrai que pourla fréquence 800 Hz ; pour atteindrecette puissance à 50 Hz, comme l’am-plification de l’étage de correction estde 5,8, il suffira de 34 mV et de 30 mVà 10 000 Hz, l’amplification de l’étageétant, pour cette fréquence, égale à
30 X 100 soit 2,9 % ou 3 %.1000 + 30
Avec une bobine mobile de 2 &, latension développée pour une même
/ 12 = 2,45 fois pluspuissance serait^ ^faible. Si l’on désigne par n le rapportdu diviseur de tension pour les valeurscorrespondant au schéma, le nouveaurapport doit être n/2,45. Nous avons
1000 4- 30 — 34,33n 30et n/2,45 = 14.
Soit Ri la résistance placée dans lecircuit de cathode, R2 la résistance de
Ri+R,.liaison : le rapport n — . Nous
6,6. Riconnaissons Ri que nous gardons égaleà 30 Q, puis la valeur à donner à n,Comme avec tous les appareils mu-
nis de dispositifs de correction, l’uti-lisateur ne doit pas se laisser influen-cer par le volume sonore qu’il obtientlorsque seulement la zone du médiumdu registre musical est transmise. Lescourbes de sensibilité de l’oreille tra-cées en fonction de la fréquence et dela puissance montrent qu’au niveaunormal d’écoute dans un appartementil faut une puissance acoustique beau-coup plus faible dans le médium quevers les extrémités du registre pourdonner une même sensation de puis-sance à l’oreille. Les circuits de cor-rection sont destinés à rétablir, à vo-lume sonore réduit, une sensation nor-male pour l’oreille et à compenser ladéfaillance des éléments de reproduc-tion. L’utilisateur doit donc, s’il veutobtenir une reproduction de qualité surtoute la plage des fréquences du regis-tre musical, consentir à un faible ni-veau dans le médium pour que la puis-sance limite pour une distorsion accep-table ne soit pas dépassée lors d’uncoup de grosse caisse par exemple. Ily a là une éducation à faire de la partdes constructeurs dans les noticesd’emploi des appareils.
La figure 4 représente différentescourbes de réponse relevées pour qua-tre combinaisons des positions des po-tentiomètres :
A : Les deux corrections au maxi-mum ;
B : Les deux corrections au mini-mum ;
C : Les deux corrections assurant unniveau à peu près constant.
D : Correction basses sans effet,correction aiguës au niveau zéro.
Ces courbes montrent le peu d’influ-ence sur le niveau dans le médium du
Fig. 5. — La bobine L de correc-tion des fréquences basses, trèssensible aux champs magnétiquesparasites, est installée hors duchâssis, loin du transformateurd’alimentation. Le bouchon octalest utilisé pour le raccordement
des potentiomètres.
soit 14 ; il est aisé de calculer la valeurà donner à R« à l’aide de la relationsuivante : R« = Rt (n—1), ce qui donnedans notre cas :Ri = 30 (14 — 1) = 390 Q.
Nous attirons spécialement l’atten-toin sur ce point : quand une réalisa-tion d’amplificateur B.F. est donnée,si l’on utilise un transformateur desortie et un haut-parleur différents deceux qui ont été employés pour la miseau point, il faut modifier le rapport dudiviseur de tension du circuit de con-tre-réaction et aussi la valeur de lacapacité placée en parallèle sur la ré-sistance de liaison, car les caractéris-tiques des transformateurs au pointde vue rotation de phase aux fréquen-ces élevées peuvent être très diff éren-tes d’un type à un autre. La mise aupoint sera faite en signaux rectangu-laires très rapidement.
Tension anode-masse EF40 dépha-seuse : 200 V.
Polarisation EF40 attaque : 1,7 V.Polarisation EF40 correction : 3 V.Tension cathode-masse EF40 correc-
tion : 44 V.Tension anode-masse EF40 correc-
tion : 230 V.Tensions nécessaires en diff érents
points pour obtenir 9 W de sortie :Au point p : 0,42 V eff.Grille EF40 de déphasage : 14 V eff.Grilles EL41 : 13,2 et 13,5 V eff .Anodes EL41 : 2 x 130 V eff.Aux bornes du secondaire: 10,4 V eff.Aux bornes de la résistance de 30 Q :
335 mV eff.Sans contre-réaction, il suffit de
46 mV au point p pour obtenir 9 Wde sortie, mais la distorsion atteint16 %. ( Fin au bas de la page 219 )
Toute la Radio218
»Depuis le 14 Mai i
ÉMISSIONR ÉGULIÈ RE de
TÉLÉLUXEMBOURG
encore clans des villes telles que Epernay,Reims, Mulhouse et, en Belgique, Mous etLa Pinte, cette dernière localité se trou-vant à 250 kilomètres de Dudelangc.
Le standard adopté est la haute défini-tion française de 819 lignes. Cependant, ila fallu tenir compte des règlements en vi-gueur en Belgique et dans le Grand-Duché.Aussi la largeur de la voie TV est -elle de7 MHz, la bande vidéo étant ramenée à5 MHz et l'intervalle entre les fréquencesimages (189, 2(5 MHz) et son (194,75 MHz)
( Suite page 220 )
En effet, l’expérience montre que cetémetteur est particulièrement bien placépour avoir une portée considérable. Erigésur le plateau de Ginsterberg tpii surplom -be la petite cité industrielle de Dudelange,à proximité immédiate de la frontière fran -çaise, il est facilement reçu dans un rayonde 100 kilomètres, et de nombreuses lettresémanant de téléspectateurs se trouvant àdes distances beaucoup plus grandes, mon-trent que sa réception peut être effectuéesans trop de difficulté non seulement enMeurthe-et-Moselle, dans la Meuse, laMarne, les Ardennes et les Vosges, mais
La mise en fonctionnement régulier del’émetteur de té lévision luxembourgeoisconstitue un événement de première im-
portance qui ne manquera pas de stimulerconsidérablement le développement de latélévision dans notre pays. Télé- Luxem-bourg a émis pour la première fois le 23janvier de cette année pour l’anniversairede S.A.R. la Grande Duchesse. Depuis le14 mai, il a commencé les émissions régu-lières de programmes dont la variété et laqualité ne manqueront pas d’attirer versla télévision un grand nombre de télé-spectateurs, tant en France qu’en Belgique.
très tubes de l ’amplificateur. Une pla-que est alimentée par la prise 245 Vl ’autre par la prise zéro du primairedu transformateur (le zéro est la prise3 25 V ) . On obtient une tension conti-nue de 120 V sous 50 mA.
La figure 6 montre la combinaisonqui a été adoptée pour la liaison auhaut-parleur et au moteur. Celui-ci estalimenté à partir de la prise 110 Vdu transformateur ; le primaire de cedernier joue le rôle d’auto-transforma-teur d’adaptation au réseau. Les po-tentiomètres sont reliés au châssis pardes cordons blindés.
Un dispositif d’excitation du hautparleur a été établi à l’aide d’une valveEZ80 dont le filament est chauffé parle même enroulement 6, 3 V que les au-
TLR 196 ( Suite )
Dispositifs accessoiresA titre d’indication, nous donnons la
description des systèmes de liaison auhaut-parleur, au moteur et à la bobinede correction pour les fréquences bas-ses. Celle-ci est reliée au châssis parun cordon blindé. Elle doit être placéeloin du transformateur d’alimentationet du moteur.
Matériel utiliséLe matériel d’alimentation est des
Ets Manoiiry.
Transformateur d’alimentation type120/730 ;
Bobines pour le filtre C 400 et D 400.
La bobine de correction pour les fré-quences basses a été réalisée de lafaçon suivante :
Circuit magnétique tôles standard60 X 50, épaisseur 20 mm, ce qui donneune section de 20 X 20 ; tôles croisées ;3 000 spires de fil 20/100 émaillé : va-leur de L = 6 H ; R =r 160 Q.
Le transformateur de sortie a étéconstruit sur un circuit magnétique faitde tôles 62,5 x 74, épaisseur 25 mm :enroulement primaire 2 x 1500 spiresen fil 20/100 émaillé en quatre frac-tions verticales, le secondaire en fil de6/10, nombre de spires selon bobinemobile, bobiné en couches horizontales,
entre deux fractions du primaire. Undes enroulements primaires est bobinéen sens inverse par rapport à l’autre.
R. GONDRY.
Traûsform'eur 0'àü/rrwtefm6,5 V
6,5 VIgg
B LZ 80 5Y3GB
o
gm/»
110 —5Y3CBW M + O150 /
: <§> iio JL
F,g 6O ReseauO-
Fig 6. — Adjonction d’une valve pour utilisation d’un haut-parlsur à excitation. Le bouchon Aest réservé au H.P. ; le bouchon B alimente le moteur du T.D. par ses broches 3-4/5-6 ;
l’interrupteur général, fixé sur le meuble, est raccordé aux broches 1-2/7-8.Juin 1955 219
piésente sous la forme d 'une tour métal -lique de 200 m de haut supportant à sonextrémité l 'antenne proprement dite, hautede IG m. Cet aérien est constitué par unensemble de 12 panneaux rayonnants ré-partis sur quatre faces. Le rayonnementest omni-directionnel. Compte tenu de lahauteur de la station au dessus de niveaude la mer, l’antenne de Télé-Luxembourgse trouve donc à 640 m d’altitude, ce quiexplique, pour une bonne partie, lagrande portée de l’émetteur.
Deux plateformes, aménagées à 73 m età 102 m du sol sont destinées à recevoirdes relais hertziens qui permettront d’assu-rei la liaison entre l’cmetteur et les studiossitués à Luxembourg ou bien les liaisonsnécessaires aux reportages ou, éventuelle-ment. une liaison avec Metz, le point depassage du faisceau hertzien des P.T.T.Paris - Strasbourg, qui. depuis décembre1953, achemine les programmes parisiensde télévision vers la capitale de l’Alsace.
Si les principaux studios de prises devues sont installés dans la Villa Louvigny ,siège de la Compagnie luxembourgeoise deRadiodiffusion, le bâtiment de l’émetteurn 'en contient pas moins un grand studio
étant de 5,5 MHz. Les autres caractéristi-ques de l’émission y compris la forme dessignaux de synchronisation, sont identiquesà celles des émetteurs français ; la polari-sation est horizontale.
Le bâtiment qui abrite tout l 'appareil-lage de l’émission a été érigé en un tempsrecord. Commencé en août 1954, il étaitterminé au début de l ’année courante.Pour son équipement, la Compagnie Lu -xembourgeoise de Radiodiffusion a fait ap-pel à plusieurs constructeurs européens. Leplus « gros morceau » que constitue l ’émet-teur proprement dit et son antenne a étéréalisé par le grand spécialiste mondialqu’est la Compagnie Générale de TS.F.L'émetteur est du même modèle que ceuxque cette société a fourni à la R.T.F. pourParis, Lille, Marseille, Strasbourg et ceuxqui sont prévus pour le Mont - Pilat, Caenet Nice.
On sait que la C.S.F. anime le groupeindustriel auquel appartient la S.F.Ii . qui,
depuis 22 ans, n 'a cessé d’accroî tre la puis-sance de Radio-Luxembourg.
C’est la maison anglaise Pye qui a étéchargée des installations des studios pourles transmissions directes et des installations
LecteurC Yr
e t D I S Q U E S
En matière de reproduction musicale, ontend sans cesse vers la plus grande fidé-lité. Les lecteurs sonores se perfection-
nent continuellement, la courbe de réponsedes amplificateurs s’élargit, respectant lesharmoniques, les haut-parleurs transfor-ment de plus en plus parfaitement lestensions électriques en vibrations sonores.L'enregistrement de son côté gagne cha-que jour en qualité. En face de cette ten-dance vers la perfection, on reste songeurlorsqu’on évoque les premiers enregistre-ments phonographiques, et mesure le che-min parcouru depuis.
Il est certainement plus d'un lecteur,
dont le grenier recèle parmi les souvenirsdu temps jadis, un vénérable phonogra-phe à saphir et une collection de cylin-dres ou de disques recouverts de leurpoussiéreux manteau d’oubli. S il prend àhamateur d’enregistrements la fantaisie depasser sur son moderne tourne-disquesquelques unes de ces anciennes cires, iln ’entendra qu’une voix épouvantablementdéformée ou une musique odieusement mu-tilée. Et cependant ceux qui chantèrentdevant un petit cornet, dans un modestestudio, possédaient des voix magnifiques ;
et les musiciens de l 'époque ne le cédaienten rien à ceux d’aujourd’hui. Ne pourrait-on entendre encore, dans les meilleuresconditions, les étoiles qui brillèrent auciel de l’art musical ? Après une indis-pensable rétrospective technique, nousallons voir que la chose est parfaitementpossible.
Sal le de té l écinéma comprenant des projecteurs « flyng spot » pour f i lms de 35 et de16 mm avec pis tes sonores photographiques ou magnétiques. Retour sur le passé
Les premiers lecteurs pour cylindresfonctionnaient à la manière d’un piston.Ainsi que le représente la figure 1 , unreproducteur se composait d'un boî tier cy-lindrique plat A. fermé sur une face etdont l'autre face était constiuée par unefeuille de mica formant le diaphragme.Au centre de celle-ci , était fixé le porte-saphir C. Un manchon B était soudé surle boî tier, en face d’une ouverture, etpermettait le raccordement au pavillon.Le fonctionnement de l’ensemble était trèssimple : les vibrations inscrites sur le cy-
Toute la Radio
d’émission de 150 m -, outre la salle de larégie, la cabine de speakers, la salle de télé-cinéma, le laboratoire, ainsi que la filmo-thèque et la salle des vérifications desfilms.
Grâce à l’amabilité de la CompagnieLuxembourgeoise de radiodiffusion, quenous tenons à remercier ici, nous avons eula possibilité de visiter en détail ce belensemble d’émissions qui, nous le répétons,ne manquera pas de contribuer grande-ment à l’essor de la télévision en France.
de la partie vidéo proprement dite. Quantau télécinéma qui servira pour les émis-sions enregistrées, c’est la maison allemandeFernseh qui en a installé l’appareillage.
La puissance actuelle de l’émetteur télé-vision est de 4 kW, celle de l’émetteur son,modulé en amplitude, étant de 1 k\V.Compte tenu du gain de l’antenne, lapuissance rayonnée est de 30 kW pourl 'image.
A elle seule, l 'antenne constitue un véri -table morceau de bravoure, puisqu’elle se
220
modernens
LINDRESA SAPHIR
JIB
périeure à celle de 78 tr/mn ultérieurementadoptée. Il conviendra donc que la vi-tesse du moteur utilisé puisse être va-riée, ce qui était le cas pour les tourne-disques antérieurs à l 'apparition du mo-dèle 3 vitesses.
Par ailleurs, certains disques à saphirétaient enregistrés à partir du centre. Ilssont reconnaissables à la légère surépais-seur de leur bord extérieur, évitantl ’échappement du lecteur hors du disque.Cette technique, toujours utilisée, permetde remédier dans une certaine mesure àla déficience des fréquences élevées enfin de gravure, provoquée par l’usure duburin, et d 'améliorer le rapport signal/bruit de fond.
Nous n’insisterons pas sur les diffé-ces résultant du mode d'enregistrement, laqualité de gravure des disques modernesrendant la comparaison pour le moins dé-licate. Cependant, certains enregistrementsà saphir, mis à part un bruit d ’aiguille
par J.-C. HENIN
Très nombreux sont les disques, enregistrés au début de siècle,sur lesquels demeurent gravées les « grandes voix qui se sont tues ».Mais les collectionneurs — et même quelques grands artistes encorevivants — ne peuvent « passer » sur leur moderne tourne-disquesles cires pieusement conservées au musée du souvenir. Respectueuxd'un passé si proche et cependant si lointain , l 'auteur — dont nousne pourrions trop louer l'ingéniosité — s'est attaché à réaliserlecteur permettant de reproduire , avec la meilleure qualité possible ,les enregistrements des artistes de la « belle époque ». Nous sommespersuadés que son article intéressera vivement les amateurs debonne musique.
un
lindre étaient transmises au diaphragmepar le saphir. Celui-ci produisait des com-pressions et dépressions de l’air inclusdans le boîtier et celles-ci amplifiées parle pavillon , restituaient l’enregistement.Lorsque le disque fit son apparition, laposition du lecteur passa de l’horizontaleà la verticale (fig. 2 ) et il lui fut ajoutéun bras de levier attaquant le diaphragmeet pourvu, à son extrémité opposée, duporte-saphir. Le lecteur des phonographesactuels comporte un diaphragme en alumi-nium plissé, et travaillant suivant un planperpendiculaire au précédent.
*UANCIENNEMETHODE
wVL/TV^/—Rotûbion du disque!_ Profondeur
uanableVAiguille iM *
/ . Fond ,_ inattaque/METHODEACIUEILE -
Flancsvariables
Fig. 2. — Cylindres et disques à saphir étaient gravés en profondeur. Les disques modernes,eux, ont un sillon de section constante mais dont le trajet présente des sinuosités dans
le plan du disque.Cires d’ hier ,
disques d’aujourd’huiLa diff érence entre l ’enregistrement des
cylindres et disques anciens et celui des disques modernes réside dans le fait que.pour les premiers, le saphir pénétrait plusou moins profondément dans la cire alorsque pour les seconds, il grave un sillondont la largeur et la profondeur sontconstantes, mais dont le tracé s’écarteplus ou moins de la position moyennesuivant les sons émis. Dans le procédéprimitif , la largeur du sillon était cons-tante tandis qu’avec les disques actuels, laprofondeur est constante. La figure 2 illus-tre les deux modes de gravure, que l’ondifférencie aisément à l’œil nu.
La vitesse de rotation primitive étaitde 80 tr/mn, c’est-à-dire légèrement su-
prononcé, sont très acceptables et per-mettent d ’excellents duplicata, à la condi-tion d’éliminer ce bruit grâce à un filtre.L unique avantage du cylindre fut incon-testablement la gravure suivant une hé-lice, donc à diamètre constant ; ce quipermettait une inscription rationnelle desfréquences audibles et une reproductiondans laquelle l’attaque du saphir avaitlieu sous l’incidence idéale.
Afin de pouvoir reproduire les anciensdisques à saphir avec un reproducteurmoderne, deux solutions sont possibles,étant entendu qu’il en existe bien d’autres.
( Fin page suivante )
IA B
é , 'Spui/ illun
verAYT \c Mica tendu
Fig. 1. — Dans les anciens phonographes, lesaphir, solidaire d’une membrane de mica,
se déplaçait verticalement.
Juin 1955 221
Fabriquons notre lecteurLa première suppose que l’on est en
possession du lecteur 78 tours de l 'épo-que. Elle consiste à exécuter, suivant lafigure 3, une petite pièce métallique enforme de T (en corde à piano ou en lai-ton écroui, par exemple ) . Sur la branchede gauche est soudé un petit manchonde laiton ou d ’acier constituant le porte-saphir. La branche de droite est recour-bée à son extrémité et fixée — suivant lafigure 4 — dans un bloc de caoutchoucmousse, ce qui assure sa souplesse etévite au T de pivoter lors de la rotationdu disque. La lecture des anciens disquesgravés en profondeur sera donc facileavec un pick-up moderne, les vibrationsayant lieu suivant un plan perpendicu-laire à celui de l ’enregistrement. Bienentendu, afin d ’éviter au maximum lesvibrations parasites de la palette, cettepièce doit être réalisée dans les plus pe-tites dimensions possibles. A titre indica-tif . ce système a été adapté, avec succès,
à un ancien pick-up push-pull CHARLIN,
muni d’un filtre destiné à relever les fré-quences basses et — détail intéressant —pourvu d’une vis de réglage de la pa-lette dans l’entrefer. Si l’on ne recherchepas le maximum de qualité, ce procédétrès simple donnera satisfaction pour lareproduction des cires anciennes.
La deuxième solution consiste à recons-tituer le lecteur de l 'époque, mais en lemodifiant de telle sorte qu’il convertisseles vibrations mécaniques du diaphragme
Fig. 6. — Exemple de construction d’ un bras de lecture avec le pick-up de la figure 5.
cautions sont nécessaires pour éviter leronflement induit par le moteur du tour-ne-disques.
Réalisé avec soin suivant ces indica-tions, ce lecteur « home made » — commel ’on dit en français — donnera une excel-lente reproduction , compte tenu de laqualité des enregistrements de l’époque.Peut-être ne permettra-t-il pas de décou-vrir quelque CARUSO dans la collectionde cires exhumée du grenier, mais il ren-dra la vie à d’émouvants souvenirs etrappellera , s’il en est besoin, que l’art dela « belle époque » brilla d ’ un éclat aumoins aussi vif qu’aujourd’hui.
vant la figure 6 — à l ’aide d 'un anneauet d’un axe en acier (la bague des bou-tons grand modèle pour récepteurs con-vient parfaitement ) . La réalisation dusupport ne soulève aucune difficulté. Lesmouvements devront être très souples etsans jeu. afin d ’éviter les sauts intempes-tifs du lecteur et les vibrations parasitesdu bras. Il convient de se rappeler quela « modulation » — si l’on peut s’expri-
4 BobineTête tfeftf.6 vorioblesuivî’TU utilisé . ^wm
5 isuas Texte et dessins deCollé -TIf J.-C. HENIN:
AimantCooulchuuc éventuelVisdeserrage3 Bloc caoutchouc
U . S . - H U M O U RColle ou cire
Soudé SadiTunf
H T • ÆI UBoî tier [ Ancien clips blindé pourbéton de lampeJ
MAC‘siRADIO \
Fig. 3 et 4. — Une tête de lecteur classiquepeut être adaptée à la lecture de vieuxdisques au moyen d’une pièce en T fixée
à la place de l’aiguille.
Fig. 5 Un lecteur peut être construitde toutes pièces autour d’un écouteur mi-niature sur la membrane duquel est collé
le saphir d’un vieux phonographe.
en tensions électriques variables ; quelquesmillivolts suffisent pour l ’attaque d’unamplificateur moderne. L’organe principalest la partie électrique d ’un écouteur mi -niature, du type magnétique, destiné auxappareils de surdité. Déjà ancien , ce mo-dèle est à basse impédance (10 Q ) . Surla plaque vibrante, on colle à la « secco-tine » un porte-saphir, qu’il est assezfacile de se procurer encore au « marchéaux puces ». On loge cet écouteur dansun boî tier métallique sur lequel est soudéun tube de laiton de 0 8 mm, formantbras. Le pivot peut être exécuté — sui-
mer ainsi — des premiers enregistrementsétait particulièrement forte. Un transfor-mateur adapte l ’impédance du lecteur àcelle de l’entrée de l’amplificateur. A ti-tre indicatif , le modèle E. 80 MELODIUM.d’impédance secondaire 80 000 Q convientparfaitement. La liaison lecteur/transfor- |mateur est effectuée sous câble blindé demodèle courant, la ga î ne métallique é tant .reliée électriquement au bras. La longueurdu câble peut, sans inconvénient, attein-dre plusieurs mètres. Le transformateurdoit être fixé le plus près possible del ’entrée de l ’amplificateur. Toutes ces pré-
C’est Jean qui termine la mise au point
d’un ampli de 500 watts ...
( D' après Radio-EIcctror.ics )
Toute la Radio222
wm&ùMkmêzhik mmâkà.ble d’uti l iser l’ interphone en ayant la l ibertéentiè re de ses mains, ce qui est extrêmementcommode.
Une autre possibi l i té du montage est le fonc-t ionnement en téléphone. On remarque en ef -fet que, si le sélecteur à 4 circuits est orientévers T, le secondaire du transformateur decathode va vers la l igne téléphonique. Pournous Français, cet te possibi l i té restera sur-tout une curiosi té, car on sai t que l’Admi-nistrat ion des P.T.T. s’oppose géné ralementau raccordement à son réseau d’un apparei lnon agréé par ses services techniques.
Examinons pour terminer quelques circuitsauxil iaires. Nous voyons une lampe témoin L*,dont le voyant, blanc ou vert , s ignalera quel’apparei l est sous tension. L’autre ampoule,Lo, qui pourra être munie d'un cabochon rou-ge, s'al lume chaque fois que le sélecteur estsur 1 ou T. Elle s'é teint en posi t ion médiane.Son rôle est donc de rappeler à l’opé rateurqu'il doit , après chaque uti l isat ion , ramener lesélecteur sur cet te posi t ion m édiane, corres-pondant à la posi t ion « Ecoute », pendant la-quelle on peut être appelé par l’autre postesans que ce dernier ai t la moindre possibi l i téd’espionnage... C’est la raison pour laquelle
Lorsque le proprié taire du poste parle de-vant le micro, les tensions amplif iées appa-raissent en opposit ion de phase aux bornesdu potentiom ètre de 100 kQ. II existe doncune posit ion du curseur pour laquelle le signalenvoyé au haut-parleur est , s inon nul , car ledéphasage sera rarement égal à 180° du fai tque la charge de cathode est en part ie in-ductive, mais du moins suffisamment faiblepour qu’une réact ion par couplage acoust iquene puisse avoir l ieu. Par contre, une tensionuti l isable apparaî tra aux bornes du peti t en-roulement du transformateur de cathode. Sile sélecteur à 4 circuits est orienté sur I( Interphone ) cet te tension , par la l igne, ga-gnera l’enroulement équivalent de l’autreposte. Dans le second apparei l , o ù elle appa-ra î t d’un seul côté du potentiom ètre de 100 kQ,el le sera reprise par la 6 V 6 et pourra ac-tionner le haut-parleur.
Inversement , s i c’est l’opé rateur du secondposte qui parle , son propre haut-parleur res-tera muet et le signal sera transmis par la li-gne au transformateur de cathode du premierposte, dont le haut-parleur à son tour fonc-tionnera . On voit qu’on a ainsi él iminé touteclé « Ecoute-Parole » et qu’il est donc possi-
INTERPHONE SANS COMMUTATION
Richard H. DorfRadio and Télévision News
Chicago, novembre 1954
Richard H. Dorf est un journalis te techniqueaméricain réputé pour ses analyses de brevets.Nous avions dé jà , dans le numéro 99 de RadioConstructeur ( p. 164 ), signalé une de ses trou-vail les : le brevet U.S.A. N° 2 655 557, relat ifà un interphone sans commutation uti l isantune lampe à déphasage cathodique et un po-tentiom ètre d'équil ibre entre plaque et ca-thode pour annuler la tendance à l'effet Lar-sen. L’idée étai t s i inté ressante que M. Dorffut tenté d’expérimenter le disposi t i f en ques-tion. L'apparei l ainsi construi t lui donna en-tiè re sat isfact ion et c’est sa descript ion, com-plète cet te fois, alors que la premiè re présen-tat ion ne mentionnait pas la valeur des élé-ments, que nous allons condenser ici.
En nous reportant au schéma ci-dessous,d’après lequel seront construi ts 2 postes iden-tiques, nous trouvons tout d'abord une pré-amplif icatr ice 6 SJ 7, dest inée à être at taquéepar un microphone piézo. La faible résistancede gri l le (68 kQ ) a pour effet de réduire laréponse aux fréquences basses, ce qui aidel'équil ibrage et, par ai l leurs, faci l i te le rac-cordement à une ligne téléphonique, car cetinterphone peut encore servir de té léphonepar haut-parleur. A l'autre extrémité de lacha îne, nous voyons aussi un haut-parleur pré-cédé d’une 6 V 6 employée de fa çon bienclassique.
C'est entre ces deux tubes que se trouve lalampe-clé du montage. C’est une 6 V 6, carelle aura à fournir une certaine puissance,mais une 6 V 6 connectée en tr iode, de façonà servir de déphaseuse. A cet effet , on a in-séré dans son anode une résistance de 6,8 kQet , dans sa cathode, une autre charge cons-ti tuée , el le , par l’élément à grande impédancedu transformateur de ligne ( un Stancor A-3250dans le montage am éricain ; les expérimenta-teurs français devraient se t irer d'affaire avecun simple transformateur de sort ie ). La résis-tance de 1 ,5 kQ, également présente dans lecircuit de cathode, ne joue qu’un rôle de po-larisat ion , puisqu’el le est shuntée par un con-densateur de forte valeur. Les tensions al ter-natives apparaissant aux bornes des deuxcharges de ce tube sont appliquées au po-tentiom ètre d’équil ibrage (100 kQ) dont lecurseur al imente la 6 V 6 finale , après inter-posi t ion d’un potentiom ètre dest in é à doserle volume.
05V
5Z4
IQJDoO
OO
§6,3 V
40HF oh
11COlO>450V o u.
3 ca 100 nFO mmm (M25 VO117 VA» mOo
6V6 (2) hWA
G G 40 fiF150 V
6V 6 (1) oon
L~Jr° O °"j -o% O r-O V On rO O-l jo2nF
6SJ7 r@) M NOTAIjiF,lOOOnF1 nF= iOOOt>FINTERPHONE TELEPHONE
L’interphone sans commutation exige deux postes conformes à ce schéma.
Juin 1955 223
P.S. — Le num éro de mars de Radio-Elec-tronics, analysant le brevet U.S. A. 2 685 608,déposé par un citoyen allemand , indiquequ’une chute de température de 27 °C a puêtre obtenue à la jonction de deux barreauxcomposés respectivement de : bismuth 90 0/0 ;antimoine 9,9 0/0; argent 0,1 0/0 et : antimoine52,1 0/0 ; cadmium 47,3 0/0 ; nickel 0,6 0/0.
la seconde section du sélecteur supprime enposit ion médiane la haute tension d 'anode etd ’écran de la 6 SJ 7. L’interrupteur I2 n’estut i le que si l’on envisage le raccordement autéléphone. Il est normalement ferm é et doitêtre ouvert si l’opé rateur désire que son cor-respondant n'entende pas pendant quelquesinstants ce qui se dit dans la pièce (on nepeut plus, en effet , se servir du sélecteurprincipal , qui, s’i l étai t manœuvré, interrom-prai t la continuité en courant continu de lal igne té léphonique, donc correspondrai t au« raccrochage » ).
Nous espérons que nos lecteurs seront ten-tés par ce sympathique schéma , qui n’exigequ’un nombre raisonnable de pièces couranteset qui procure un apparei l certainement moinsdélicat à mettre au point que les disposi t i fsà transformateurs hybrides ou autres. Descombinaisons à plus de deux stat ions sontpossibles ; nous faisons confiance aux expéri-mentateurs pour dessiner les circuits de com-mutat ion nécessaires.
B I B L I O G R A P H I EAMPLIFICATION BASSE FREQUENCE, par
le Dr N.A.J. Voorhoeve. — Un vol. relié de530 p. (155 X 235), 479 fig. et 18 tableaux. —Bibliothèque Technique Philips, Eindhoven. —Prix : 3.100 F.Voici enfin le manuel complet de la basse
fréquence qui manquait à une époque où lesdiverses applications des amplificateurs de sons’étendent de plus en plus. Le sujet est traitéde façon exhaustive par un des meilleurs spé-cialistes mondiaux de la question. Le texte estbourré de renseignements pratiques. L’auteurn’ hésite pas à faire appel aux artifices du cal-cul chaque fois que cela permet de préciser sapensée, mais sans pour cela faire preuve d’un« sadisme mathématique ». L’illustration trèsabondante et très claire contribue encore à fa-ciliter l’assimilation des riches enseignementsde ce livre.
On aura une meilleure idée de la variété deson contenu, si nous citons les titres desprincipaux chapitres : principes ; tubes am-plificateurs ; la préamplification ; amplifica-tion de sortie ; la réaction ; adaptation, ré-glages et limitations ; pièces détachées ; tubesredresseurs et redresseurs secs ; blocs d’alimen-tation ; quelques principes d'acoustique et leursapplications dans les installations sonores ;transducteurs d 'entrée ; appareils reproduc-teurs ; aspects généraux de l’amplification B.F. ,amplificateurs et systèmes d’amplification, sys-tèmes de distribution de radio ; les mesuresdans les installations sonores ; termes,boles, nomenclatures, abréviations.
Comme tous les volumes de la BibliothèqueTechnique Philips, celui-ci est très agréable-ment présenté et , ce qui est encore mieux, bé-néficie d’ une traduction absolument impeccable,due à la plume de notre excellent ami et col-laborateur Henri Piraux. Le fait est loin d’êtrefréquent et méritait d’être souligné.
ment 50 mA/V. Dans ces condit ions, i l estfaci le de t irer une amplif icat ion de tension de10 000 d’un étage équipé d’une paire de tran-sistors compl é mentaires, et cela avec unetension d’al imentat ion de quelques volts seu-lement.
Il est impossible d’at teindre de tel les per-formances avec des tubes é lectroniques ; eton ne peut même pas concevoir un montageà lampes dont le fonctionnement serai t ana-logue ou seulement comparable. — C. C-
M. B.
UTILISATION DES TRANSISTORSREFRIGERATEUR ELECTRONIQUECOMPLEMENTAIRES
Radio MentorN* 4/1955, p. 216
Berl in, avri l 1955
Deux revues américaines de mars dernier ,Electronics et Tele-Tech, nous apprennent queM. Nils E. Lindenblad, des LaboratoiresR.C.A. , aurai t mis au point un ré frigé rateuruti l isant l’effet Pelt ier . On se souvient queJean-Charles Pelt ier fut un physicien françaisqui découvri t en 1834 que les jonctions decertains m étaux diff é rents, comme bismuth etantimoine, pouvaient, suivant le sens du cou-rant continu qui les traverse, s'échauffer ouse refroidir. Cet effet é tai t t rop faible pourpouvoir être uti l isé à des fins industr iel les. Ilsemble que les chercheurs américains aientmis au point d’autres m étaux ou all iages danslesquels l’absorption de calories est net te-ment plus importante. Mais pourquoi diableavoir fourré le mot électronique dans cetteaffaire ? Jusqu 'à preuve du contraire , l’effetPelt ier est un ph énom ène concernant unique-ment l’électr ici té.
On sait que la principale diff érence entreles transistors à jonction n-p-n et p-n-p ré-side dans la polari té des tensions d’alimen-tat ion. Jusqu'ici, cet te part iculari té n’a é téuti l isée que pour des amplif icateurs à liaisondirecte et pour des é tages de sort ie sym é-triques.
Une nouvelle applicat ion , i l lustrée par leschéma ci-contre, a été brevetée récemmentpai W. Shockley. La résistance de sort ie d’untiansistor p-n-p est ut i l isée ici comme résis-tance de charge d’ une tr iode n-p-n. On saitque la résistance de sort ie d’un transistor àjonctions peut ê tre de plusieurs centaines dekilohms et que sa « pente » atteint faci le-
sym-
TÉLÉCOMMANDE DE LA LOCOMOTIVE DB 9003 joncteur, le desserrage du frein et. la miseau zéro de l’arbre à cames. Lorsque ensuitele relais B était enclenché à son tour par lamodulation de la porteuse, la locomotivedémarrait et atteignait progressivement lavitesse d’équilibre préalablement fixée parla position donnée au manipulateur. D’ail -leurs, un contact de l’appareil Flaman limi-tait la vitesse maximum à 120 km/h. Unnouvel enclenchement commandait le retourde l’arbre à cames au zéro. Si à ce momentle signal de commande disparaissait, le dis-joncteur se trouvait ouvert et les freinsarrêtaient progressivement le convoi com-posé, outre la locomotive BB 9003, d’uncertain nombre de voitures de voyageurset d’une voiture destinée au contrôle descaténaires, sur laquelle était installé l’appa-reillage de réception avec ses sources decourant.
Tel est, décrit dans son principe, l’appa-reillage qui a permis de réaliser avec suc-cès ces premiers essais hautement specta-culaires. En analysant leurs résultats, onpourra tirer de cette première expériencedes enseignements utiles qui permettrontnon pas de substituer des robots aux hom-mes, mais de rendre moins fastidieuse latâche de ceux qui conduisent les ultra-ra-pides locomotives actuelles, tout en aug-mentant considérablement la sécurité desvoyageurs qui leur confient leur vie.
Le 13 avril dernier, la presse du mondeentier a relaté les impressionnants essaisde télécommande d’un train électrique effec-tués par la S.N.C.F. entre Connerré et laFerté-Bernard, avec la collaboration de laSociété Française de TélécommunicationsN.O.R.
Il nous est particulièrement agréable designaler que le directeur de cette Société,Jean Topin, ainsi que l’ingénieur ClémentVerfaillie qui a pris une part très active àla conception et à la réalisation du maté-riel utilisé, sont tous lés deux anciens élè-ves de l’Ecole Centrale de T.S.F. et d’Elec-tronique. Notre photo les représente d’ail-leurs, en compagnie de M. Eugène Poirot,directeur, et de M. R. Laurier, secrétairegénéral, de l’E.C.T.S.F.E.
Grâce à l’obligeance de ces deux diri-geants de la grande pépinière de techni-ciens de la radio et de l’électronique, nousavons pu obtenir quelques détails sur l’ap-pareillage de télécommande qui a été uti-lisé. L’émetteur, établi à la sous-station deSceaux-Boesse, permettait d’envoyer soit desondes entretenues pures qui enclenchaientun relais A, soit des ondes modulées à1000 Hz environ, qui enclenchaient un relaisB. Chacun de ces relais primaires permettaitd’enclencher des relais de travail secon-daires installés sur la locomotive.
L’enclenchement du relais A par l’ondeporteuse déterminait la fermeture du dis-
Toule la Radio
La ligne de 44 signes ouespaces : 150 fr. (de-mandes d’emploi : 75 fr.).
PETITESANNONCES* VIE PROFESSIONNELLE Domiciliation à la revue :
Mettre la150 fr. PAIEMENT D’AVANCE,réponse aux annonces domiciliées, sous enveloppeaffranchie ne portant que le numéro de l’annonce.
l’excellent livre qu’il a consacré aux lignes etantennes. Roger Chambrillon, ingénieur de l’ Ins-titut Electrotechnique de Grenoble, est directeurdes Ets Merlin et Gerin.
L’émetteur provisoire deNancy a démarré le 14 mai. Il fonctionne sur lecanal VII en polarisation verticale.
T.Y. NANCY. Date limite de remise des petites annoncesle 13 du mois précédant la publication.
f OFFRES D’EMPLOI #Notre excellent ami etcollaborateur Jean Dussailly, ingénieur à laCompagnie des Lampes, a fait une très intéres-sante conf érence sur la cybernétique, le 18 mai,à l’Association philotechnique de Neuilly. Unfilm intitulé « Cerveaux d’Acier », réalisé parla Compagnie des Machines Bull a agrémentéson exposé.
DEMONSTRATIONS DE HAUTE FIDELITE.— G. A. Briggs, auteur du livre « ReproductionSonore à Haute Fidélité » , récemment traduit enfrançais, a fait deux nouvelles démonstrationspubliques, l’une le 1er avril à Bradford, l’autrele 21 mai au Royal Festival Hall de Londres.L’auditoire enthousiasmé a pu constater qu’au-cune différence ne pouvait être notée entre lamusique directe et la reproduction des enregis-trements effectués sous les yeux du public. Nuldoute que cette excellente propagande n’augmen-te le nombre des fanatiques de la haute fidé-lité.
CYBERNETIQUE.EXPORTATIONS EN EGYPTE. — La maison
Hassoun et Mieli, 6 Batal Ahmed Aziz, au Cairevoudrait importer des transistors et des diodesau germanium de haute qualité. Les fabricantsfrançais sont priés de s’adresser directement àcette maison.
RECHERCHONS POURAFRIQUE OCCIDENTALE ANGLAISE
SPÉCIALISTE RADIOconnais, parfait, réparât, dépannage. Célibat, depréf . Lang. angl. indisp. Adress. C.V. A n°63.197 Contesse & Cie, 8, Sq. Dordogne, Paris-17«, q. tr.
O.N.I.M. — L’Organisation Nationale des In-dustries Magnétiques qui se cache sous cesigle a eu un stand au Salon de l’EquipementSonore, qui s’est tenu du 31 mars au 7 avril àla Porte de Versailles. Elle y a montré les dif -f érentes possibilités que l’enregistrement magné-tique met à la disposition des pédagogues. PuisrO.N.I.M. s’est manifestée à la Biennale de laPhoto et du Cinéma qui a eu lieu au GrandPalais du 4 au 16 mai. Son stand a revêtu uneampleur exceptionnelle et a fait une excellentepropagande en faveur de l’enregistrement ma-gnétique.
Compagnie I B M FRANCERecherche :
1° INGÉ NIEURS ÉLECTRONICIENSayant plusieurs années de références.
2° AGENTS TECHNIQUESELECTRONICIENS, 3* catégorie. Ecr. aveccurric. vit. 20, av. Michel-Bizot, 12®.
Pour répondre aux demandes qui nous sontfaites concernant les calculateurs à tirettesADDIATOR cités dans l’article de Ch. Guilbert,numéro 195, page 147, nous signalons que leurprix est de 4 200 francs et qu’ils sont fabriquéspar la Sté Addiator, 114, rue Malbec à Bor-deaux.
MEDAILLE BLONDEL 1955. — Cette année,la médaille Blondel a été décernée à un savant,M. Elie Roubine, et à un ingénieur, M. RogerChambrillon. Ancien élève de l’Ecole NormaleSupérieure et docteur ès sciences, Elie Roubineest maître de conférences à la Faculté desSciences de Lille. Nous parlons par ailleurs de
•DEMANDES D’EMPLOIS £Artisan maquettiste cherche câblage, Lebat, 18,rue Linois, Paris-lâ®.Dame 40 ans, Ingénieur E.S.E. licenciée ês-sciences, sérieuses références en électronique,
cherche situation mi-temps. Ecr. Revue m» 774.J H. 24 a. C.A.P. radio, radar, marine mil. lib.sept. 55, ch. place stable agent techn. labo. Ecr.Revue n» 775.LES PRODUCTIONS
F I R V O XDANSLINDUSTRIE
•ACHATS ET VENTES £Belle station 100-150 Mc/s tout matériel U.S.comprenant émetteur pilote crystal 10 W -H.F. Récepteur super 10 lampes. Accessoires :alimentation générale toute oxymétal» poids60 kg. H.P. aimant permanent. Micro généra-teur modulé 100/150 Mc/s, hétérodyne et cris-tal. Mesureur de champ. Polymètre. Antenne.Schémas, tout parfait fonctionnement. Cède100 M ou échange contre oscillo ou téléviseurou voiture ou machine à laver. Ecr. Revuen» 777.
La Compagnie F.I.R., qui fabrique en Francesous licence AUTOVOX, s’est spécialisée dans labranche des récepteurs radio pour autos et despostes portatifs piles-secteur, qui nécessite unetechnique tout à fait particulière.
La production F.I.R. comprend en récepteursradio pour autos :
1°) Le récepteur RA 23, 5 gammes d’ondesexplorées dont 3 O.C. , présélection automatiquepar poussoirs sur 5 stations ;
2°) Le récepteur R.A. 37/55, dont la photo-graphie figure en page de couverture et dontles qualités électroniques sont étonnantes pourun récepteur 4 lampes. Il dispose de 2 gammesd’ondes et d’une commande manuelle de re-cherche de stations ;
•Dans notre dernier num é ro, nous avons in-diqué la nouvel le adresse de Sfernice (87,avenue de la Reine , à Boulogne ) . Le numérode téléphone défini t i f de cet te maison est.MOL. 35-35.
•Le Radio Laboratoire Jaubert , S.A.R.L. aucapi ta l de 14 mil l ions de francs, qui construi tle matérie l é lectronique professionnelQuai Lyautey à Nice , annonce la nominat ionau poste de directeur technique de AL J. Ro-sier, ancien ingénieur à la S. I .F. et à la sec-t ion Etudes au Service Radio d’Air France
•M. Duvauchel, agent géné ral du pis tolet-soudeur et de la soudure Engel a transféréses bureau, depuis le 1" mars, G4, rue deAliromesni l, Par is-8<\ Tél. LAB. 59-41.•Abandonnant tournevis, fers à souder et on-demètres au profi t de pel les , pioches et vibro-pondeuses, 83 employés de la S.F. R. ont cons-ti tué un groupe de castors. I ls ont démarré ily a deux ans et demi la construct ion de 83pavi l lons de 3, 4 ou 5 pièces répart is sur unterrain boisé de 5 hectares appelé La Cerise-raie qui est s i tué en plein centre de la vi l led’Eaubonne (S.-et-O.) . L'é tude et la direct iondes travaux étaient assurées par AL Pré vert,archi tecte , e t l’on aura une idée de l’impor-tance des travaux en indiquant qu’ il a fal lucouler 2.000 m3 de béton , confect ionner130 000 parpaings et hourdis, remuer 10 000 m3
de terre, toutes act ivi tés très éloignées del’électronique.
Le 7 mai 1955, les castors de la S.F.R .é taient récompensés de leurs effor ts. En effet ,au cours de l’inaugurat ion qui eut l ieu sousla présidence de AL Alorel , At taché au Cabi-net du Minis tè re du Logement et de la Re-construct ion, et de AL Tabouis, Président duConsei l d’ Adminis t ra t ion C.S.F./S.F. R., les 25premiers heureux propriéta i res recevaient lesclés de leur pavi l lon . La total i t é des castorshabi teront chez eux avant la f in du mois deseptembre.
Vends millivoltmètre électronique 6 gammes3 mV-10 V décrit d£#is T.L.R. n« 167. Prix26 000 F. Haas. Tél. GUT. 01-25, le soir (ouécr. Revue n° 776).
154,
Vends 80 000 Fr générateur H.F. et B.F. Métr»9 300 parfait état ; révisé par Métrlx, F. Pradi-nes, St-Palais-S/Mer (Ch. Mar.).3°) L’amplificateur AL 10, avec ou sans
radio. C’est le seul appareil du marché françaisissu de la technique radio-auto et adapté pourla sonorisation de tous véhicules. £ DIVERS •Outre ces fabrications de récepteurs radiopour autos, la Cie F.I.R. fabrique des accessoi-res tels qu’antennes, et en particulier, l’antenneà commande manuelle à distance SA 47, seulede ce genre sur le marché français.
La deuxième spécialité de la Compagnie F.I.R.est le portatif piles-secteur VOXSON « Dinghy ».Tout le monde a vu ou entendu parler de cerécepteur étonnant qu’est le VOXSON « Din-ghy ». Malgré un volume extrêmement réduit,sa musicalité est proverbiale, sa consommationen piles particulièrement réduite. Enfin, sonfonctionnement sur secteur est remarquable carson schéma électrique a été conçu par un desmeilleurs spécialistes mondiaux en la matière( Faret à Rome). Le VOXSON « Dinghy »dispose de 3 gammes d’ondes (G.O.O.C. 49 m étalée). L'adaptateur secteur estséparé, permettant ainsi d’alléger au maximumla récepteur portatif.
Quant au VOXSON « Starlet », il s’agit làd’ un bijou de haut luxe d’un format encore pluspetit que celui du VOXSON Dinghy, ayant lesmêmes qualités électriques et radiophoniques, etcomme lui, portatif et piles-secteur. Il sera bien-tôt disponible sur le marché français chez lesmeilleurs radio-électriciens spécialisés en piles-secteur. Il constitue le « clou » 1955, en matièredeportatifs piles-secteurs.
La qualité du matériel que l’on vend et îes prixprouvent l’expérience. Voyez L. Duhamel, Radiod’Antin, 12, rue de la Chaussée-d’Antln, Parls-9®. PRO. 85-25.Amateurs faites v. nids d’abeilles sur mach.Spec. 200 sp. c 150 F t. p. Central Renseigne-ments BP. 117, Châteauroux Indre.
TOUS les appareils de mesure sont ré-parés rapidement. Etalonnage desgénér. H.F. et B.F.
Le Pré-Saint-Gervals. —CCD ki C 1, aven, du Belvédère.W C I X. f r i W Métro : Mairie-des-Lilas.
VIL. 09-93.P.O. -RECTIFICATIF
Les Laboratoires de Physique Appliquée(LEGPA) nous signalent que l’appareil quenotre rédacteur a appelé « Structocontrû-leur » dans le récent compte rendu duSalon de la Pièce Détachée a en fait étédénommé « Structograph » et est apte à ladétection des défauts internes aussi bienque des défauts de surface. Nous nousexcusons de ne le signaler que maintenant.(Communiqué.)
Juin 1955 225
ENFIN UNE ALIMENTATIONà self de filtrage ettransfo 110 à 240 v.alternatif fournissantun courant BT de 1,4 v.
et HT de 90 v.Ce coffret est destinée àalimenter sur secteur desPostes à Piles Portatifsou d'intérieur de toutes
marques.DOCUMENTATION SUR DEMANDE
CONSTRUCTEURS
LES RESISTANCES BOBINEES
UMBrC'EST UNE CREATION
fabriquées à l'aide d'un outil-lage ultra-moderne atteignent
remarquable continuitéunede qualité C. E. R. T.
•Fil soudé sur les colliers 34, rue des Bourdonnais, PARIS-1er
d'extrémité LOU. 56-47PUBL. RAPY•Etalonnage précis
•G r a n d e m a r g e d esécurité
•Protection tropicale
Ces trois livres techniquesfont-ilsp a r t i ede votrebiblio -
thèque
Modèles fixes - Typesréglables par colliers mobilesRésistances " chutrices" pour
SCHÉMATHÈQUE 55récepteurs tous courantsValeurs 4 à 50 watts Album de 96 Pages (275 x 210)
Prix : 720 fr. — Par poste : 792 fr.Documentation TR sur demande
VOLTMÈTRES ÉLECTRONIQUES
/aceéPar F. HAAS
VoUme de 88 Pages (135 x 210)Prix : 360 fr. — Par poste : 396 fr.
MULTI-TRACER par H. Schreiber58.FèsPOISSONNIÈRE‘PARIS-Xe PRO.82-42&7838 Volume de 68 Pages (155 x 240)
Prix : 360 fr. — Par poste : 396 fr.ÉDITIONS RADIO, 9,r. Jacob,PARIS-Ô© - Ch.P - 1164-34
?
mâsm /MACHINES A BOBINERN^ pour le bobinage
électriquepermettant tousles bobinages
0F&19 7.
a
f
en>.& FILS RANGÉS
et
NIDS D'ABEILLESC O U R S D U J O U RC O U R S D U S O I R
(EXTERNAT INTERNAT)C O U R S S P É C I A U XP A R CORRESPONDANCEA V E C T R A V A U X P R A T I Q U E S
ü 'IJ
%\ £ VrDeux machinesen une seuleK x
SOCIÉ TÉ LYONNAISEDE PETITE MÉCANIQUEchez soi
Guide des carrières gratuit Nc TR 56
Els LAURENT Frères|89-28
ECOLE CENTRALE DE TSFET D'ELECTRONIQUE
2, rue du Sentier, LYON-4* - Tel. : BU.12, RUE DE LA LUNE, PARIS-2* - CEN 78-87
MARCONI INSTRUMENTS LTD
FM/AM SIGNAL GENERATORType TF.995-A/1- 2 à 216 Mc/s.
Ce générateur permet d'obtenir une tension HFcomprise entre 2 et 216 Mc/s, modulée soit
amplitude, soit enfréquence. Un quartzde référence étalonné à2.10-4 permet d'obtenirun réglage très précissur 14 points de cha-cune des 5 gammes.
C A R A C T É R I S T I Q U E SPrécision : ± I °/Q.Tension de sortie : I uV à 100 mV.Impédances de sortie : 52 ohms et 75 ohms.Excursion de fréquence : 0 — 25 Kc/s et 0 — 75 Kc/s. Ces chiffres
pouvant être multipliés par 2, 4, 6 ou 8 pour les gammes supérieures.Modulation : I 000 p/s. zt 5 %.Modulation d'amplitude de 0 à 50 % avec une distorsion inférieure
à 5 % pour un taux de modulation de 30 %.
F MA M K /(>
Miy
!LELAND RADIO MPORTCO- *OJ
Z U
- co —E 2E M. BAUDET, 6, RUE MARBEUF, PARIS 8e - TEL. É LY. 11.25= 2- Oz u
XIX
109R A D I OTOUTE NOMCONSTRUCTEUR& D ÉPANNEUR
(Lettres d'imprimerie S.V. P. !) PRIX : 120 Fr.Par poste: 130 Fr.LA ADRESSE
I ; FA1 11 I Vous trouverez dans ce numéro, copieux etvarié comme d’habitude :if La description d’un excellent magnétophone
( Capitole H.F.).Tous les détails sur la construction d’un
récepteur portatif piles-secteur (Reporter ).if L’étude pratique d’un générateur B.F. à
résistances-capacités, couvrant la gamme de20 Hz à 1 MHz ( Heathkit AG-8) .
if L’amplification M.F. image dans les télé-viseurs modernes.
if La construction de quelques antennes TVsimples.
if L’étude et la réalisation d’un récepteur O.C.très simple, dans le cadre de la rubriquel’Emission d’Amateur.
^ Les interf érences, sifflements et brouillagesdans les superhétérodynes.
+ Le dépannage de la partie M.F. image d’untéléviseur.
if La façon d’utiliser les caractéristiques ei
les courbes des lampes
souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéros) à servirà partir du N°au prix de.1.250 fr. (Etranger 1.500 fr.)
BULLETIND'ABONNEMENT
(ou du mois de )
s découper et à adresser à laMODE DE R ÉGLEMENT (Biffer les mentions inutiles)
•MANDAT ci- joint •CHÈQUE ci- joint • VIREMENT POSTALde ce jour au C.C.P. Paris 1.164-34
SOCIÉTÉ DESEDITIONS RADIO9, Rue Jacob, PAP.JS-6e
DATE :ABONNEMENT R ÉABONNEMENTT.R. 196
NOMI (Lettres d'imprimerie S.V. P. !)
ADRESSE7-TÉLÉVISION|üépcLMjeAÜi N° 54UI PRIX : 120 Fr.souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéros) à servir
à partir du N°,BULLETIN
D'ABONNEMENTPar poste : 130 Fr.
if Petits écrans, grandes distances, par A. Fa-vin. Trois montages éprouvés de préampli-ficateur H.F. pour réception à grande dis-tance. Tous les détails sont donnés pourfaciliter la construction par l’amateur,même peu outillé.
if La pratique des antiparasites son et ima-ges, par A. Six. Le problème des parasitesest très gênant dans les agglomérationsurbaines ou à grande distance. Cet articledonne une quantité de montages éprouvésde mise au point facile.
if Mire électronique, par F.M. Bien que pré-vue pour 625 lignes, cette description d’unappareil de mesures fondamental ne man-quera pas d ’ intéresser les lecteurs.
if Notes de laboratoire , par A. Six. Toujoursfort goûtées, ces notes donnent une quan -tité de tuyaux pratiques intéressants etdirectement utilisables.
if Technique moderne, nouveaux schémas, parA.V.J. Martin. Les dernières acquisitionsde la technique et les schémas les plusrécents sont analysés et expliqués.
if Montages pour télévision en couleur. Latechnique de la transmission des imagesen couleur fait appel à des montages quisortent quelque peu de l’ordinaire et quidemandent à être étudiés de près.
if Salon britannique de la Pièce Détachée,
par A.V.J. Martin.
(ou du mois do
au prix de 1.000 fr. (Etranger 1.200 fr.))
à découper et à adresser à la
SOCIÉTÉ DESÉDITIONS RADIO9, Rue Jacob, PARIS-6e
MODE DE REGLEMENT (Biffer les mentions inutiles)
• MANDAT ci- joint •CHÈQUE ci- joint • VIREMENT POSTALde ce jour au CCP. Paris 1.164-34
DATE :ABONNEMENT REABONNEMENTT.R. 196 *
MB NOM(Lettres d'imprimerie S.V. P. !)
ADRESSE
BULLETIND'ABONNEMENT
souscrit un abonnement de 1 AN (10 numéros) à servirà partir du N° (ou du mois deau prix de 980 fr. (Etranger 1.200 fr.)
)à découper et à adresser à la
SOCIÉTÉ DESÉDITIONS RADIO9, Rue Jacob, PARIS-6®
MODE DE RÉGLEMENT (Biffer les mentions inutiles)
• MANDAT ci- joint •CHÈQUE ci- joint • VIREMENT POSTALde ce jour au CCP. Paris 1.164-34
ÉLECTRONIQUEINDUSTRIELLE
DATE: N° 2T. R . 196 * ABONNEMENT REABONNEMENT
PRIX : 300 Fr.Par poste : 310 Fr.
if Panorama de l’électronique, par E. Aisberg ;
ir Les radioéléments artificiels. 1. — La fabri-cation, par C. Fisher, Rappel des notionsde base indispensables à l’ utilisation desradio-isotopes ;
if La mémoire magnétique, par J. Garcin. Toutce qu’il est possible de faire dans l’indus-trie à partir de l’enregistrement magné-tique, y compris l’analyse ralentie ou ac-célérée des signaux ;
if Les autotransformateurs à rapport variable.Principe et applications des transformateursà charbons tournants ou coulissants ;tableau sypnotique de tous les modèles dis-ponibles ;
if Les détecteurs de. métaux, par J.-F. Du-sailly. recherche et localisation dans lesol , les minerais, le papier, les tissus, etc.,par amorçage d’ une oscillation , battementou induction.
•jf Les amplificateurs magnétiques, par W. So-rokine.
if Un amplificateur à diodes if Base de tempsdéclenchée et déclenchante if Détecteurs despires en court-circuit.
if Copieuse revue de la presse mondiale.
NOM(Lettre* d'imprimerie S. V. P.!)
ADRESSE
>••••••••••••••••••••••*
BULLETIND'ABONNEMENT
souscrit un abonnement de 1 AN (6 numéros) à servirà partir du N° (ou du mois deau prix de 1.500 fr. (Etranger 1.800 fr.)
)
à découper et à adresser à
SOCIÉTÉ DESÉDITIONS RADIO9, Rue Jacob, PARIS-6G
MODE DE R ÉGLEMENT (Biffer les mentions inutiles)
• MANDAT ci- joint •CHÈQUE ci- joint • VIREMENT POSTALde ce jour au C.C.P. Paris 1.164-34
DATE :T. R . 196
IPour la BELGIQUE et le Congo Belge, s'adresserè la StéBELGE DES ÉDITIONS RADI0,204a,chausséede Waterloo, Bruxelles ou à votre libraire habituel
Tous les chèques bancaires, mandats, virementsdoivent être libellés au nom de la SOCIÉTÉ DESÉDITIONS RADIO, 9, Rue Jacob PARIS-6e
OFFREZ A VOS CLIENTS#
DES SONSDES FORMES
Seul MARTIAL LE FRANCtraite cet aspect de votre" problème- vente" et vousaide par une gamme trèsétendue de modèles irré-prochables à satisfaire lesacheteurs les plus exigeants.
POTENTIOMETRES - BOBINESTYPE R.T.
êIëmc-r,t.s Les amateurs de beaux meubles de style, ancien, rus-tique ou moderne, tout comme les musiciens, serontconquis par les incomparables "meubles qui chantent"
dépendants
S) SOCIETE FRANÇAISE ELECTRO-RESISTANCE MARTIAL LE FRANCR A 0 i 0Siège Social et Usine : 115. Boul. de la Madeleine, NICE A .-M. • Tel. 758 60
Bureau et Dépôt : 9. Rue Falguière, PARIS {-XV* Tel. SlGur . 76 35
4, Av. de Fontvieille, Principauté de Monaco
XXI
i
Un Potentiomètre BOBINÉ TECHNOSLA LIBRAIRIE TECHNIQUE
de qualitépour Télévisiontm le BOBINÉ 4 watts
Diamètre : 44 mmÉpaisseur : 25 mm
Série : 5.000Séries STANDARDSéries MINIATURE
3 5 , R u e M a z e t( M ÉTRO : ODEON )
Ch. Postaux 5401-56 - Téléphone: DAN. 88-50
P A R I S - V I eMod è les graphite :mEts DADIER & LAURENT
J 8, Rue de la Bienfaisance, VINCENNES (Seine) - DAU. 28-33P U B L. R A P Y TOUS LES OUVRAGES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
SUR LA RADIO CONSEILS PAR SPÉCIALISTELibrairie ouverte de 9 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30Frais d’expédition : 10 % avec maxim. de 150 fr. (étranger 20 % )Envoi possible contre remboursement avec supplément de 60 fr.Librairie de détail , nous ne fournissons pas les libraires
RÉCEPTEUR PORTATIF TRABANTPILE-SECTEUR
Importé d'ALLEMAGNE EXTRAIT DU CATALOGUEPrésentation originale et soignée
• NOUVEAUTES •DISPONIBLE PARISDIA-ELEKTROTECHNIK
LIGNES ET ANTENNES, par E. Itou bine. —Tome I : Introduction générale, lignes en hautefréquence. 172 pages grand format
ACOUSTIQUE APPLIQUEE, par L. Conturie. — Lathéorie des phénomènes sonores appliquée aux haut-parleurs, microphones, procédés d’enregistrement,ultrasons, etc. 240 pages
APPAREILS ELECTRO-MENAGERS, par E. Bonna-fous. — Installation, utilisation, entretien et dépan-nage de tous les appareils électro-ménagers. 326 p.
RECEPTION DE LA TELEVISION (Traité de) , parL. Chrétien. — Nouvelle édition, augmentée et miseà jour, d’un cours d’enseignement bien connu.240 pages
LES RESISTANCES, par M. Douriau. — Technologieet applications en électricité, radio et électroniquedes résistances linéaires et non-linéaires. 232 pages.
TECHNIQUE ET APPLICATIONS DES TRANSIS-TORS, par H. Schreiber. — Cours détaillé et essen-tiellement pratique sur la technique des transistorsà jonctions et à pointes et leurs applications dansles montages amplificateurs, récepteurs et électro-niques. 160 pages
CONSTRUCTION DES RECEPTEURS DE T.V.,par P.A. Neeteson (Bibliothèque Technique Phi-lips).de volant des générateurs de balayage. 156 pages. 1.150 »
AMPLIFICATION BASSE FREQUENCE, par N.A.J.Yoorhoeve (Bibliothèque Technique Philips). —Etude pratique très poussée sur les amplificateursB.F., leurs composants et accessoires. 516 pages .. 3.200 »
SCHEMATHEQUE 55, par W. Sorokine. — Schémaset descriptions des principaux récepteurs en serviceen 1955. 96 pages grand format
REPRODUCTION SONORE A HAUTE FIDELITE,par G.A. Briggs. — Technique des liaut-parleurs.baffles, pick-ups et procéd és d’enregistrement ;acoustique architecturale. 368 pages
CINEMA SONORE, par R. Miquel. — Traité essen-tiellement pratique sur la mise au point, l’entretienet le dépannage des installations sonores de cinéma.450 pages
L.6Q0 fr.51, Avenue Roosevelt, PARIS-8e — Tel. ELY. 68-36
1.300 »
«75 »
(PERENA)l .500 »
525 »
720 »
Tome II : La synchronisation avec effet
720 »CABLES H.F- H.T.COAXIAUXMICRO -CABLAGE
GAINE1.800 »
<SS/Sur dev/s 450 »W GAMME
C O M P L È T E DEFICHES COAX/AlESDE QUALITÉ/
:3
PERIODIQUESV eELECTRONIQUE INDUSTRIELLE. — Revue bimes-
trielle de technique moderne destinée aux promo-teurs des méthodes et appareils électroniques. Le N°Abonnement un an (six numéros)
CAHIERS D’ETUDES DE RADIO TELEVISION. —Aspects physiologiques, psychologiques et artisti-ques de la technique de transmission de sons etimages.
300 »1.500 »
PERENA 48 B*VOLTAIRE 48PARIS 11V Tel V0L 48-90+ Le N° 350 »1 r
XXII
le ruban magnétiquePROFESSIONNELS I CONSTRUISEZ VOS TELEVISEURS 43-54 cm
AVEC LES PIECES DETACHEES OU ELEMENTS D’ORIGINE
KODAVOXr
PATHE-MARCONICes montages spécialement étudiés et mis au point pour vous, vousdonneront la certitude d’offrir à votre clientèle des réalisations de
haute qualité, signées d’un nom prestigieux.
e*t puilU à* de sécurité
* de haute fidélité
* incontestablement le moins cher
parce qu'il est
parce que la Publicité Kodak vous aide sans relâche par
* ses annonces dans la presse
* ses dépliants
* ses affiches
* ses semaines magnétiques
DESIGNATIONPlatine LD, MF et HF câ blée et
réglée.Balayage (champ fort ) .Balayage (champ faible ) .Tôle de base.Pièces pour bobinages HF :Platine t ôle nue.Mandrin fileté pour bobinage.Embase moulée .Capot alu.Plaquette fibre arrêt de fil .Noyau laiton.Fiches coaxiales :Prolongateur complet.Douille mâle.Douille femelle .Douille femelle montée avec câ-
ble coaxial , long. 50 cm.Douille femelle, fixation sur
châssis.Clip de blocage.Fiches coaxiales, sans soudure:Fiche complète.Douille mâle.Douille femelle.Atténuateurs :10 décibels.20 décibels.Sangle fixation tube cathodique,
en ébénisterie et tube 43 cm
DESIGNATIONBoîtier de concentration (sans
bobinage).Support de concentration.Semelle support - Concentration
déflexion.Ensemble déflexion.Ensemble concentration , bobin é .Transfo sortie lignes THT.Transfo sortie image.Self correction amplitude lignes.Transfo blocking lignes.Transfo blocking image .Self filtrage polarisation .Self filtrage HT.Transfo chauffage tube.Berceau réglable.Transfo alimentation pour GZ32
avec pattes (champ fort ).Transfo pour oxymétal (champ
faible ).Platine HF (champ faible ) câ-
blée et r églée.Platine MF (champ faible ) câ -
blée et réglée.Platine HF (champ fort ) câ-
blée et réglée.Platine MF (champ fort ) câ -
blée et réglée.LE POSTE COMPLET (champ fort )
parce que...
Kodak* ne signe que des produits de
haute qualité
94.50091.500avec coffret CD .. Palissandre ou noyer„ _._ LE CHASSIS, câ blé
_ _ ...77.600 n‘ îui'eé sans. !ampes 55.000LE MEME sans ébé-
nisterie ni cache . .
Ii PLATINE MÉLODYNE PATHÉ-MARCONI
D É PÔT GROS PARIS et SEINE. Notice technique et conditions sur demande
GROUPEZ TOUS VOS ACHATSL' INCOMPARABLE SERIE DES CHASSIS « SLAM »vous permettra de satisfaire toutes les demandes de votre clientèle
Récepteur alternatif , 4gammes, 6 lampes.
Châssis câ blé et réglé, avec lampes et HPSLAM 46 AF 15.500SLAM 46 AH 4
Châssis câblé et réglé, avec lampes et HPQT AM A.ÇI A LJ R écepteur alternatif , 4
“O *V11 gammes, 8 lampes push-pull. Châssis câ blé et réglé, avec lampes et HP
16.50022.100
SLAM 47 AG - CADRE H.F20.700Récepteur alternatif 4 gammes. Châssis câ blé et réglé
avec lampes et HPRemise habituelle à MM. les Revendeurs
LE MATÉ RIEL SIMPLEXtkunuN muent K ü ü A K4, Rue de la Bourse. PARIS-2 Tél. : RIO. 62-60e
xxiii
.v.v.v.v.v.v.v..V.V.V.V.ViUi Toutes ÉTUDES et RÉALISATIONS deM A TÉR I E Lélec t ron ique
r
• ENSEMBLESDE LABORA-TOIRE
1
a v e c l e s 7• TABLES DEMESUREP I L E S »s rj-ss ss Cfcss• BANCS
D'ESSAISMAZDA • APPAREILSDE CONTROLEAUTOMATIQUE
dont la gamme complète permetd’équiper tous les postes de radio,qu ’ ils soient portatifs ou fixes.
• TABLES DERAPPORT DE
t .
VIDEIyN’oubliez pas
Que £on acKete une PILEmais (Juan kac&ëtèune MAZDA Ets Pierre FONTAINE
39, Rue Louis -RollandMONTROUGE ( Seine ) ALE. 02 -98
C I P E L ( COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PILES ÉLECTRIQUES)125, Rue du P r é s i d e n t •WiI* o n - Leva l l o i s - Pe r re t ( Se ine )
POTENTIOMÈTRESMachines à bobinerG R A P H I T E : S t a n d a r d e t
miniature.
A. MARSILLIB O B I N E S : 4 W a t t s e t1 Watt 1/ 2.S P E C I A U X : D o u b l e s o u
11, Via Rubiana, TORINO (Italie)
Modèle " UNIVERSEL''itriples, combinés graphite-
bobinés.S U B M I N I A T U R E S p o u rappareils de surdité et appli- pour bobinages en fil rangé
et nid d'abeilles:
cations diverses. /-,
Rense ignements, no t i ces e t ta r i f s : i
^ITDC 30,r.des Acaciasvl KC/ PARIS-17e
Tel. : ETO. 76-19 et ETO. 26-99 B.P.124,PARIS-17e
"Duft/M /éqet*au;ft/utftuiaaaut
Pabh SARP
7sINSTANTANÉSTYLO, poids 65 g 1 160 fr
SUPERSTYLO3 <.6.7 mjm
1.360 fr 2 900 fr. yAgaranti I an.
T)
<r /¥
RADIO, gai 1 an. 1.160 fr.. ORIENTABLERADIO C B.A . panne
anti-calamine. gar . I an. 1.300 fr.53
1 100 f rgaranti I an.ir *
& V
INDUSTRIEgar. I an /50 w. 1.700 fr.
200 w.. 2.180 fr.855 fr.SIMPLET :
Tél. : GRA. 27-60127, Rue GARIBALDI St-MAUR (Seine)En vente dans toutes les bonnes maisons d'outillage et de radio
XXIV
SORANIUMPOTENTIOMÈTRESGRAPHITÉS OU BOBINÉSÉTANCHES ou STANDARDSA PISTE MOULÉE
Variohm Î3 PLAQUES ET ÉLÉMENTSREDRESSEURS AURue Charles-Vaparaau, RUElL-MALMAlSON (S.-&-0.) - Tél. MAL. 24-54
AdVd n a n d
TOUTES TENSIONSTOUTES INTENSITÉSPAR SA QUALITÉ ET SA PRÉSENTATION “ LE TOURISTE 54 ”
V O U S A A S S U R É S U C C È S E T T R A N Q U I L I T ÉL' A M É L I O R A T I O N A P P O R TÉ E D A N S
LE T O U R I S T E 5 5fera progresser vos ventes
POSTE PILES ET SECTEURTrès jolie présentation
4 Gammes avec cadre Ferroxcube et AntenneTélescopique. Alimentation par transfo à prisesmultiples variant de 110 à 240 v. qui assure la sécurité
des filaments par un montage en parallèle.
RADIO « TÉLÉVISION •CHARGEURS •ÉLECTROLYSE * CLOTURES ÉLECTRIQUES *REDRESSEURS D'ARC •FLASHES etc
Æ
mm. { Livraisons rapides - Prototypes sous 10 jours
L E C A M P E U R V"P O S T E S P I L E S S E U L E S *
Élégan t, Robus te e t bon marché
«tu*%
4,Cité Grise!PARIS XIe - OBE 24-26 V250 x 210 x 100
Ets R.L. C, 102, rue de TOurcq - PARIS-198 - Nord 11-29PUBL. RAPY
Terrasse R - Hall 118 - Stand 11.819
R E C L A M E Z D O C U M E N T A T I O N A U X
FOIRE DE PARIS TOUS LES GAINAGES POUR LA RADIOPURL . RAPY Postes portatifs •Valises P.U. •Valises électrophones
Coffrets pour H. P. supplémentaires • Amplis, etc...MALi.6RYTous travaux de luxe
Qualité et Prix
Ets R. CHAUVIN '.SF
Groupet tiosV I B R E U R S S Y N C H R O N E S6 - 1 2 - 2 4 Volts
5 5 0 S - 5 3 8 C - M 5 5 0 SV I B R E U R S A S Y N C H R O N E SSis
6 - 1 2 - 2 4 Volts6 7 3 - 6 5 9 - 6 4 0 C - M 6 5 0 C -
1 5 0 1 - 1 5 0 4 CPILES MALLORY RM1- RM3
RM4 - RM12, etc.CONDENSATEURS ELEC-TROLYTIQUES au TANT ALEC O N T A C T E U R SPOT EN TI O M ET R E SBLOC ACCORD TELEVISION
• r
E-MOUSSIERPROFESSIONNELS PATENTÉS
DE IA RADIO
CL<TD i s t r i b u t e u r E x c l u s i f l
MÉTOXl r86,r.Villiers del'isle AdamP A R I S . 20e
Tél: MEN.51-10 ef 11
t r 3 2 , R U E T H I E R S • A V I G N O NTÉL .: 2 8 - 3 3m ( VAUCLUSE )
XXV
R ÉS I S T A N C E SB O B I N É E S
PETIT APPAREILLAGE JE V I T R I F I É E SN O R M A L I S E E S
DOCUMENTATION T 55 SUR DEMANDE
Demandez Notice AG 13 36, AV. GAMBETTA, PARIS - 20” - ROQ. 03 02
SOCIÉTÉ FRANÇ AISE ÉLECTRO-RÉSISTANCESiège Social : NICE (A.-M.) - 115, Bd de la Madeleine - Tel. 758-60
Bureau à PARIS (XV ) - 9, rue Falguière - Teléph. SEGur 76-35
ELV.TT709
),
''.'«tiPHlUpIl il
siS . e. D. G.A
U U b RELAIS5 SUBMINIATURE
de mesure s e l
à 50 gammesi f- Tensions alternatives: 100 m Veff
à 300 Veff, de 20 c :s à 100 Mc : s( 6 gammes )
- Tensions continues : 20 m V à1000 V ( 7 gammes )Sonde HT pour desjusqu’à 30 kV ( 3 gammes ) .
- Intensités alternatives : 10 UAeffà 1 Aeff de 20 c:s à 100 kc:s( 7 gammes )0,1UAeff à 1 Aeff de 20 c: s à1 kc:s ( 5 gammes )
- Intensités continues : 10/JLA à 1 A ^( 8 gammes )- Résistances : m à 1000 MO(8 gammes)
- Capacités : 30 p F à 3UF ( 5 gammes )
Demandez notre documentation N* 558
*41»s5V té
GRANDEURRÉEllt
mesuresm
m
• POUVOIR DE COUPURE 24 V. - 0,5 A ^• TROPICALISÉ (soudures métal-verre)
• MONTAGE A VOLONTÉ sur supportsubminiature rond normal ou fils à souder
• H. F. 0,7 PF !
PHILIPSINDUSTRIE
rwiIMT M
BOBIGNY
A.V
PHILIPS- INDUSTRIE LE PROTOTYPE MECANIQUE16 Bis RUE GEORGES PITARD - PARIS (15*) - VAU. 38-03
I05‘. R DE PARIS. BOBIGNY Seine - Tel. VILLETTE 28- 55 (lignes groupées)
XXVI
L é&ffttt.qui résoudra avec précision, sécurité et
aux moindres frais, vos problèmes deDétection de surépaisseurpermettant d'éviter la super -position de pièces alimen-tant une machine, un postede contrôle automatique. - Modèle spécial
établi pour un constructeurde machines-outils.RËFLEXE INSTANTANE
La plus large gamme européenne d'interrupteursà action brusque,"préfabriqués" ou "sur mesure" .
Contrôle et régulation auto -matique d'un appareil dechauffage par thermostatutilisant la dilatation d'unetige calibrée- Procédé ACRO Mfg C° — Production CEM - Modèle spécial
à deux Microcontacts créépour un constructeur devariateurs mécaniques devitesse.Quelques domaines d' appl icat ion :
— Équipement électrique de véhicules— Matériels radio-électriques— Appareils électro-acoustiques et optiques— Appareils de mesure, signalisation, contrôle— Machines comptables, statistiques,d'imprimerie— Machines-outils, machines textiles— Appareils électro-domestiques— Jeux électriques etc...
m
• Modèle spécialadopté par un constructeurde tourne-disques.
Mise en route et orrè f auto -matiques d'on appareilreproducteur de sons. Lemicroconfact est actionnépar le plongeur servant desupport au bras de pick up.
COHTAOEMIL S’AGIT D' ... FIEZ-VOUS A
... FIEZ-VOUS AIL S’AGIT DE
C- Electro-Mécanique3 7 . R U E D U R O C H E R . P A R I S ( 8 £ )
Renvoyez - r tous ce BON apres l'avo i r agraf é à votre papier a let t res,et pr écisez, s i poss ib le, l'ut i l isa t ion de ce matér ie l.
Je suis intéressé, sans engagement de ma part :•par votre documentat ion •par une vis i te •par une démonstrot iooRoyer lo mention inutile. CM-58-0I
XXVII
MODULATION DE FRÉQUENCEBLOC FMBloc HF oscillateur pour FM, à noyauplongeur avec entrainement coupléau CV du récepteur.Bande de fréquence : 87 à 100 Mc/sFonctionne en coopération avec nosblocs pour modulation d amplitudedu type Hermès à davier, ou Dauphina commutateur rotatif.Transfos Moyenne fréquence AM-FM
CADRESà air ou à ferrite ,fixes ou tournants .Longueur : de 100 à 200 m/m
HERMESBlocs à touches - nombreux modèlescomportant ou non :
- étage HF accordé- cadre à ferrite ou à air• modulation de fréquence- arrêt secteur .
TRANSFOS MFDimensions réduites,diamètre 22 m/m .Fixation rapide, sans vis ni écrou .
ET MÉCANIQUE
106, rue de la Jarry, Vincennes - Tél. DAU 43- 20 +PROCUREZ -VOUS LE GUIDE OREGA
XXVIII
L ACï
EL' OSCILLOSCOPE LE PLUS PRATIQUE DU Û
MONDE AUX PERFORMANCES POUSSÉES 2TJtube orientable à volonté bonne transmission des o
Zfronts raidesgrande finesse de spotsignaux carrés à 50 c / s S
eexcellente stabilité d'image transmis sans déformation «
<notablebande passante constanteindépendante des réglagesde niveaux
expansion du balayagehorizontal
C A R A C TÉ R I S T I Q U E S Diamètre utile du tube 80 mmA m p l i v e r t i c a l : s e n s i b i l i t é = l O m V e f f / c m
i m p é d a n c e d ’ e n t r é e = 1 mb a n d e p a s s a n t e = 500 Kc/s à 3 dB.
Ampli horizontal: s e n s i b i l i t é = 1 0 0 m V e f f / c mb a n d e p a s s a n t e * 300 Kc/s à 3 dBi m p é d a n c e d 'e n t r é e = 5 0 K a.
B a s e d e t e m p s : l i n é a i r e d e 10 c / s à 40 Kc/s.DE MÉTROLOGIE
DE SERV/CEcouvre tous les standards TV: 5 à 230 Mc / spermet les mesures de sensibilité: atténuateurà piston de précision de mode H 11extrême simplicité d'utilisationoscillateur VHF de conception professionnellegammes usuelles TV (20 - 40, 100 - 230 Mc /s)de développement maximumfaible encombrement.
C A R A C TÉR I S T I Q U E S -CuF r é q u e n c e : 5 à 230Mc/sen 6 gammesprécision = I % E
oOTension de sortie: 10 pL V à 100 mV sur une
charge de 75 O. u
M o d u I a t i o n : 0 et 30 % — 800 c / s 5A l i m e n t a t i o n: 1 1 0 - 1 3 0 - 160 - 220 - 250. -O
Z5COMPAGNIE G ÉN ÉRALE DE M É TROLOGIE 5M
<
A N N E C Y - F R A N C Em A G E N C E S : PARIS, 16, Rue Fontaine ( 9 ) TRI. 02.34 • STRASBOURG, 15, Place des Holles. Tél. 305-34 - LILLE, 8, R. du Barbier -Moës, Tél. 482-88 - LYON, 8, Cours Lafoyette, Tél. Moncey 57-43MARSEILLE,3,Rue Nau (6*) Tél. Garibaldi 32-54 - TOULOUSE, 10,Rue Alexandre-Cabanel - CAEN,A.Liois, 66,Rue Bicoquet - MONTPELLIER.M. Alonso, 32, Cité Industrielle - NANTES, Porte, 10, Allée Duquesne -TUNIS, Timsit, 11.Rue Al-Djozira•ALGER, M. Roujos, 13, Rue de Rovigo •LIBAN : Anis E. Kehdi, BEYROUTH•ARGENTINE : Grahom & Co,‘BUENOS- AIRES•BELGIQUE : Druo, BRUXELLES•BRESIL : Staub.5AO-PAULO•EGYPTE : G.Zangorokis & Co, ALEXANDRIE•ESPAGNE : Geîco Electrico. BARCELONE•FINLANDE:O. Y.Nyberg, HELSINGFORS•ITALIE:U. de Lorenzo,MILAN•NORVÈGE: F.Ulrichsen.OSLO•PORTUGAL t Rualdo Lda, LISBONNE•SUÈDE : A. B. Palmblad, STOCKHOLM•SUISSE -. Ed. Bleuel. ZURICH •TURQUIE : A. Sigalla, ISTANBUL •URUGUAY : Loewenstein, MONTEVIDEO •GRÈCE sK.Koroyannis & Ci«.ATHENES•MEXIQUE : Y. A. Le Levier,MEXICO •CANADA : G. P.I. Ltd,MONTRÉAL •SYRIE : Estefone & Cie, DAMAS •NOUVELLE - ZELANDE : Hamer Electrical Co Ltd., CHRISTCHUSCH
XXIX
UnprogrèsMPttCOTHBLE
POTSFERMÉSFERROXCUBEGRANDE SURTENSIONG R A N D E S T A B I L I T ÉM O N T A G E D ' U N ES E U L E P I È C E E NPOLYSTYR ÈNE MOUL É
P o u r R i m l o c k 1 H l e t H2Pour lampes Miniatures : M H I e t M H2Pour lampes Batteries : B H I e t B H 2
DOCUMENTATION SUR DEMANDE A
OUPERSONIC22/ AVENUE VALVEIN, MONTREUIL-S BOIS (SEINE)
Téléphone : AVRon 57-30XXX
2 9 6 . R U E L E C O U R B E - P A R I S X V e - T E L L E C 5 0 - 8 0 ( 3 l i g n e s)>•21
IIL ..£4ïs. —
XXXI
NOUVELOSCILLOSCOPE
0-10A CIRCUITSIMPRIMÉS
r»
GENERATEUR TV
TOUS ENSEMBLES COMPLETSpièces détachéesen
42 modèles pour les besoins dulaboratoire et de la fabrication
Décrit dans
RADIO-CONSTRUCTEURNuméro deFévrier• Voltmètre amplificateur •Wattmètre B. F. •Distorsiomètre
d intermodulation • Sources de signaux sinusoïdaux et
rectangulaires •Fréquencemètre électronique •Signal Tracer• Généra teu rs H. F. e t T. V . • Con t r ô leu rs, E tc ...
Q-MÈTRE
VOLTMÈTREA
LAMPES CATALOGUE KL3 et TARIFS sur demande
ROCKE INTERNATIONALmm i Bureau de Liaison : 113, rue de l'Université, Paris-7e - INV. 99-20 +Pour la Belgique : ROCKE INTERNATIONAL, 5, rue du Congrès,
BRUXELLES PONTD'IMPÉDANCES
mmil r
f^> CKE "1ER^lFlE
PUBL. RAPY
mm '
/ENTIÈREMENTVous trouverez chez miUtoiéeJBk rNEOTRON rv 42,R.NOLLET-PARIS 17e
TÉLÉPHONE •MAR.26 35lÆlL rtous les anciens types de
tubes européens,américains,les rimlock, les miniatures,
TOUTES PIECES ISOLÉESW- *U\ RAPY
les types suivants :
6 G 56 L 7
2 A 32 A 52 A 62 A 72 B 76 B 76 B 86 C 66 D 66 F 7
814650 B 2
10 56 8324 57 8425 A 6 58 8926 76 156127 77 185135 78 E 446
E 44780 B4143 80 S
/
S. A. DES LAMPES NEOTRON. .
3, RUE CESNOUIN - CLICHY (Seine)TÉl. : PEReire 30 87
3* \
Dépôt légal 1955 : Editeur, 152Le Gérant : L. GAUDILLATlmp. de Montma:tre — LOGIER & Cie — 4, pl. J.-B.-Clément, Paris
x ÆXSV.J'rx;:-§#HjÆM ««tir >#
SÜMiï«
CONSTRUISEZ VOUS- MÊMEVOS FICHES
10-15-20-30 BROCHES, etc•••EN PARTANT D'UN É L ÉMENT DEQUALITÉ, PRODUIT EN GRANDE SÉRIE
il 111
C A R A C T É R I S T I Q U E SIsolement min. 2000 MJ1
1500 V. Résistance de contact:0,01011o des broches : 1,5 X,
Intensité max. . . . 5 Amp.RigiditéS
OP -, - '
:Wr«
ÉTS SOCAPEX - PONSOT191, Rue de Verdun - SURESNES - Seine
LONGCHAMP 20-40 >