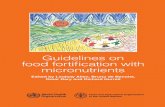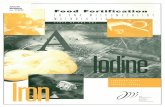Voorwoord Dit is het eindresultaat van mijn afstudeerthesis welke ...
Etude archéozoologique de la fortification dite de l'Oppidum d'Olloy sur le lieu-dit du Plateau des...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Etude archéozoologique de la fortification dite de l'Oppidum d'Olloy sur le lieu-dit du Plateau des...
Universite de Liège
Faculté de Philosophie et Lettres
Section Histoire de l’art et archéologie
Etude archéozoologique de la fortification dite de
l’« Oppidum d’Olloy » sur le lieu-dit du « Plateau des
Cinques » (Olloy-sur-Viroin/ Viroinval)
vol. 1 : Texte et figures
Loïc François
Travail de fin d’études en vue de l’obtention d’un diplôme de Master en
Histoire de l’art et archéologie, orientation archéométrie
année académique 2013-2014
Alors oubliez vos rêves de cités perdues, d’explorations exotiques et de fouilles de par le monde.
Nous ne déchiffrons pas de cartes pour exhumer un trésor, et un « X » n’a jamais, jamais marqué
son emplacement. 70 % de toute l’archéologie se fait en bibliothèque, en étude, en lecture.
- Indiana Jones et la dernière croisade
Remerciements
Je remercie en tout premier lieu mon promoteur, Pierre Noiret, d’avoir accepté de prendre ce
mémoire en charge mais également de m’avoir initié à l’archéologie préhistorique. Je le remercie
particulièrement pour ses conseils avisés et sa disponibilité de tous les instants.
Je remercie Jean-Marie Cordy, Annick Gabriel et Eugène Warmenbol d’avoir accepté d’en être les
lecteurs. Ils ont chacun à leur façon contribué à mon travail.
En dehors du jury, j’aimerais également remercier des personnes sans qui ce mémoire n’aurait sans
doute pas abouti. Jean-Luc Pleuger pour avoir mis à disposition nombre de documents, et m’avoir
accueilli à Olloy-sur-Viroin. Grégory Abrams, qui m’a supporté, dans les deux sens du terme, au
laboratoire de Scladina et m’a ainsi initié aux traitement post-fouille des ossements. Et enfin Justin
Coppe qui a réalisé les photographies et mis à disposition un microscope du Service de Préhistoire
de l’Université de Liège pour quelques clichés.
Ces remerciements sont aussi l’occasion de remercier les acteurs, parfois involontaires, qui ont
jalonné ma vie d’étudiant et qui m’ont amené, chacun à leur manière, au terme de mon cursus :
Le Cercle d’Histoire de l’Art, Archéologie et Musicologie et à ses membres, pour la confiance
qu’ils m’ont accordé, le réconfort que j’y ai trouvé, et les rencontres que j’y ai faites.
L’Ordre de la Questure Raymaldienne, l’Ordre du Grand Séminaire, le CB Philo & Lettres, le CB
GDL et toutes les autres associations grâce auxquelles j’ai pu rencontrer des étudiants de tout
horizons et de tous pays.
Laure, Simon, Marie, Julien et Julien, Justin, Michael, Laura, Manon, Romain, Anne-So et tous
ceux que j’oublie : merci, les études ne sont rien sans ceux qui les suivent avec vous.
Vincenzo Celiberti et l’équipe de la Caune de l’Arago, Emmanuel Delye, Rebecca Miller,
Dominique Bonjean et l’équipe de Scladina, Véronique van der Stede, François Valotteau et Laurent
Brou : là où mes professeurs m’ont appris la matière théorique, je vous dois le travail pratique.
Enfin, merci à Lyse Walraet d’être là en toutes occasions. S’il ne fallait retenir qu’un seul bienfait
de mes études, ce serait elle.
3
1 Introduction
Ce travail de fin d’études a pour sujet l’étude des restes osseux mis au jour sur le site
protohistorique d’Olloy-sur-Viroin. Cette étude m’a été confié lors de la recherche d’un sujet, sujet
que je souhaitais lié au domaine de l’archéozoologie, malgré la faible importance de cette spécialité
au sein de l’Université de Liège. Après quelques recherches infructueuses, Emmanuel Delye, alors
attaché au Service de Préhistoire, m’a mis en contact avec Eugène Warmenbol pour faire l’étude de
la fortification d’Olloy-sur-Viroin. Cela me permit de mêler ma passion pour l’archéozoologie avec
celle de la Protohistoire.
L’objectif de ce travail est la détermination et l’interprétation des ossements mis au jour sur le site
depuis les débuts de la fouille programmée actuelle, en 2004, à la campagne 2011 comprise et ses
implications sur le site, mais aussi par rapport à l’ensemble de nos connaissances aux époques et
dans la région concernée. Différentes problématiques seront abordées : la détermination des genres
et espèces présents, bien entendu, mais aussi la gestion des ressources alimentaires par la
détermination des âges d’abattage et la différentiation entre les souches sauvages et domestiques, ce
qui mènera à une réflexion sur le rôle de la chasse. La répartition spatiale des restes sera également
abordée, afin de déceler différentes aires d’activités liées aux animaux et à leur restes osseux.
Certains biais liés à l’activité humaine ou aux phénomènes post-dépositionnels seront mis en avant.
Enfin, la synthèse dressera le bilan des informations fournies par le site, mais également des
perspectives de recherches futures.
4
Fig. 1. La position du site par rapport au territoire belge
2 Le « P lateau des Cinques » et l’« Oppidum d’Olloy-sur-
Viroin »
2.1 Présentation du site
La fortification protohistorique d’Olloy-sur-Viroin est un éperon tronqué se situant dans la
commune de Viroinval, en province de Namur (fig. 1). Le lieu-dit est le « Plateau de Cinques » (ou
Cinkes), qui chevauche les divisions cadastrales d’Olloy-sur-Viroin et de Dourbes.
Géologiquement, il se situe sur la bande calcaire de Calestienne occidentale (Coordonnées
Lambert : 165,994.832 est/ 85,148.523 nord ; Z = 215,106). Le Viroin l’entoure, formant une boucle
de 1100 m, quelques 70 m plus bas (WARMENBOL & DOYEN, 1981, p. 9 ; WARMENBOL &
PLEUGER, 2009 (b), p. 197) (fig. 2).
Deux remparts couronnent le plateau et délimitent un espace habitable d’environ 3 ha. Le premier, à
l’est, verrouille l’accès au plateau tandis que le second, occidental, le sépare du promontoire du
plateau, sans doute à cause de la trop faible déclivité, empêchant une défense efficace. Cette
particularité, ainsi que celle d’être entouré d’une boucle formée par la rivière, se retrouve dans
d’autres sites de la région : Vireux, Presgaux, Couvin et Lampret pour n’en citer que quelques-uns
(WARMENBOL & PLEUGER, 2014, p.1 ; WARMENBOL & DOYEN, p. 9). La fortification
renferme non seulement une nécropole (plus de 150 « marchets », ou tertres, ont été recensés) mais
la problématique principale réside dans l’étude de l’occupation humaine et pas seulement dans
l’étude du système défensif, ce qui rend le site particulièrement important (WARMENBOL &
PLEUGER, 2005, p.4, WARMENBOL & PLEUGER, 2014, p. 4).
5
Fig. 2. Topographie du « Plateau des Cinques »(d’après WARMENBOL & PLEUGER, 2009 (a))
2.2 Historique des fouilles
Le site a fait l’objet de fouilles pour la première fois en 1885, par l’archéologue namurois Alfred
Becquet, affilié à la Société archéologique de Namur. Si la publication qui en a résulté porte son
nom, c’est Jean-Jacques Godelaine, le fouilleur attitré de la Société, qui entreprit les travaux ;
Becquet les supervisant de loin et se chargeant du rapport d’une quinzaine de lignes au sein d’autres
rapports concernant d’autres sites fouillés la même année1. C’est à partir de cette époque que
l’endroit se fait connaître localement sous le nom d’« Oppidum d’Olloy ». Ce sont ensuite tour à
tour un instituteur de l’école de Couvin2, Paul van Gansbeke3 et enfin un habitant d’Olloy4 qui
reprendront ponctuellement des fouilles, sans aucune publication (WARMENBOL & DOYEN,
1981, p. 9).
Ce n’est qu’en 1979 que le site entre à nouveau dans le giron d’une archéologie méthodique et
scientifique. Dès 1973, le Club Archéologique « Amphora » a étudié la région de la Calestienne en
faisant de nombreux sondages. Le but de ces prospections était de rechercher des sites issus de
l’époque de La Tène et les influences et survivances de sa culture matérielle jusqu’au Haut Moyen-
Âge. La toponymie a également été très utile dans cette recherche, par la mise en évidence de
l’origine préromaine de certains noms de la région : Viroin, Vireux-Molhain, Vierves, mais aussi
Nismes. (WARMENBOL & DOYEN, p. 1)
Ainsi, du 25 juillet au 3 août 1979 le Club Archéologique « Amphora » procède à un sondage . Les
études faites suite à ces sondages furent publiées en 1981 par le Club et comprennent entre autres
une première étude de la faune, effectuée par Achilles Gautier, sur un échantillon d’un peu moins de
200 ossements. (GAUTIER, 1981, p. 53 ; in : WARMENBOL & DOYEN, 1981)
La fouille programmée actuelle a débuté en juillet 2004 et se poursuit tous les ans depuis lors,
toujours au mois de juillet. Elle est supervisée conjointement par le Centre de Recherche en
Archéologie (CreA) de l’Université Libre de Bruxelles et par l’ASBL « Forges Saint-Roch », basée
à Couvin. Le site est dirigé par Eugène Warmenbol5 et Jean-Luc Pleuger, respectivement issus de la
première et de la seconde institution. Il est important de noter que les sédiments évacués ne font pas
l’objet d’un tamisage systématique. La méthode a été appliquée pendant la compagne de 2004 mais
1 L’ouvrage qui en a résulté s’intitule simplement « Nos fouilles en 1885 », et a été publié en 1888 dans les Annales de la Société archéologique de Namur.
2 De 1940 à 19423 Qui creusera une nouvelle tranchée en 1952, découvrant un squelette « presque complet »4 Au début des années 70, mais malheureusement décédé au moment de la publication de 1981.5 Qui avait déjà participé aux sondages et à la publication de 1981.
6
a été abandonnée en 2005 suite à un manque de résultats6.
2.3 Chronologie du site
La fouille et les datations C14 ont permis de discerner plusieurs occupations du site, allant du
Néolithique moyen à l’époque moderne. Parmi celles-ci, deux grandes occupations sont avérées, au
Néolithique final et à La Tène finale (WARMENBOL & PLEUGER, 2014, pp. 3, 19-25). Les
autres occupations jouent un rôle mineur dans le matériel mis au jour (fig. 4). La faible épaisseur de
sédiments du site et son importante érosion dû à l’absence de végétation sur le plateau a amené une
importante perturbation mais également une importante perte d’informations. Cependant, de l’avis
de M. Warmenbol, l’essentiel des vestiges datent de La Tène finale7. La répartition des ossements
au sein des différentes US couplées au datation C14 effectuées permettra de s’en assurer.
6 Communication personnelle avec Jean-Luc Pleuger, courrier électronique du 27 novembre 2012, situé en annexe.7 Communication personnelle avec Eugène Warmenbol, courrier électronique du 23 janvier 2014, situé en annexe.
7
Fig. 3. L’état des fouilles après la campagne de 2009 (d’après WARMENBOL & PLEUGER, 2009 (a))
3 Cadre de l’étude et méthodologie de travail
Le présent travail étudie les restes animaux mis au jour dès le début des fouilles en 2004 jusqu’à la
campagne de 2011, dernière campagne à avoir été effectuée avant que le sujet ne soit confié.
Le matériel a été transféré du CReA, sur le campus du Solbosch de l’ULB, vers les locaux situés au
Quai van Beneden où se trouvaient les collections de référence de l’ULg. L’étude s’est terminée
dans le musée d’anatomie de la Faculté de Médecine Vétérinaire de l’ULg, sur le campus du Sart-
Tilman, suite au transfert des collections.
Le prélèvement des restes in situ ayant été fait à l’aide de gants pour éviter toute contamination,
la totalité de l’étude a été faite en portant des gants de latex, conformément aux consignes de MM.
Warmenbol et Pleuger. Il ne faut cependant pas exclure une contamination par l’air, et ce dès la
mise au jour.
L’étude consiste essentiellement dans la détermination des taxons représentés sur le site ainsi que
des différentes traces anthropiques présentes sur les restes.
Elle se limite aux méthodes de l’archéozoologie dite « classique », à savoir l’anatomie comparée et
l’ostéométrie pour les restes où cela était possible et utile. A cause de la fragmentation des restes, il
n’y a pas eu de tentative de détermination du sexe des animaux.
Les mesures ont été effectuées avec un pied-à-coulisse, à l’exception des dents de Suidés qui ont été
mesurées à l’aide d’un mètre de couture.
Des tentatives de remontage des différents ossements au sein des lots ont été réalisées sans pour
autant procéder à des recollages, toujours dans une optique de non-contamination. Les différents
restes appartenant à un même élément ont simplement été reconditionnés dans le même sachet.
Aucun reste n’ayant de marquage, il n’y eut aucune tentative de réassemblage d’ossements de
différents lots afin d’éviter des confusions et des pertes, à l’exception de trois lots provenant d’ un
ovicaprin, ce que je détaillerai dans le chapitre dédié (infra – 3.2.11. Ovicaprins).
Lors du présent travail, il sera plus souvent fait référence à la notion d’« élément » que de « reste ».
Le nombre d’élements correspond au nombre d’ossements différents après réassemblage. En effet,
l’utilisation du nombre d’élements dans les statistiques évite une surreprésentation des éléments
fracturés.
En dehors de l’identification à proprement parler des restes, l’analyse du matériel comporta
9
quelques étapes, généralement effectuées parallèlement :
➢ Le tri des différents lots en sous-lots regroupant des catégories cohérentes ou dignes
d’intérêt : ossements identifiables, trace de traitement thermique, traces anthropiques, divers
fragments d’un même élément, ou différents ossements d’un même individu. Tous ces sous-
lots et isolats ont été ensachés séparément puis regroupés dans un sachet plus grand
représentant leur lot d’origine.
➢ Le reconditionnement de la plupart des lots : certains sachets étaient déchirés ou simplement
non-indiqués à la conservation des restes tels de petits sachets plastiques fermés à l’aide
d’agrafes. Ils ont tous été remplacés par des sachets de type Minigrip® de format adapté.
Toutes les informations présentes sur les sachets originaux ont été conservées sur le sachet et
annotées dans l’inventaire.
➢ Le lavage de la majorité des restes : les restes avaient directement été stockés dès leur mise
au jour et n’ont fait l’objet d’aucun lavage systématique. Les restes dont l’état gênait la
lisibilité ont ainsi été lavés avec une brosse à dents à poils souples et un peu d’eau afin de
rendre possible leur identification, leur taphonomie et les éventuelles traces de boucherie de
manière optimale. Ceux dont l’état était satisfaisant pour l’étude n’ont pas été lavés, afin
d’éviter de les endommager inutilement.
➢ La confection d’une base de données, reprenant différentes informations : l’US d’origine, le
nombre de fragments, le nombre d’éléments, les déterminations anatomiques et spécifiques,
les traces de chauffe, les traces physiques (percussions et traces de boucherie notamment),
les caractéristiques liées à l’âge, la taphonomie ainsi que d’autres annotations ponctuelles ou
les informations supplémentaires figurant sur le sachet. Une hypothèse de travail consista à
considérer que dans un lot dont les restes sont taphonomiquement et taxinomiquement
homogènes, les restes indéterminés du lot sont considérés comme appartenant au même
taxon que les restes déterminés.
➢ L’écartement de restes non-osseux de l’étude. Ceux-ci ont été répertoriés mais n’ont bien
entendu fait l’objet d’aucune analyse, car dépassant le cadre du présent travail. Ont
également été écartés trois fossiles d’origine tertiaire, pour des raisons évidentes. Ces
fossiles se retrouvent parfois en contexte archéologique suite à la dissolution des roches
dans lesquels ils sont contenus.
10
4 D étermination des restes
4.1 Introduction
Ce chapitre est dédié à la description des genres - mais aussi parfois la famille, ou la classe, faute de
mieux - dont la présence a été confirmée, des différents éléments se rapportant à ceux-ci, mais aussi
la description d’éléments particuliers présentant des particularités dignes d’intérêt (os entiers,
cutmarks, os brûlés, etc.). Dans un même temps, je poserai la question de la distinction entre les
souches sauvages et domestiques au sein des genres cités. Réunir ces deux démarches en un même
chapitre alourdit certes le texte, mais elle est essentielle dans l’approche faite ici, car cette
différentiation se fera à la fois sur base des restes mis au jour, mais aussi de la bibliographie et des
connaissances en la matière. La différentiation entre espèce/forme sauvage et domestique est un des
enjeux majeurs de la détermination des restes osseux à partir du Néolithique et le début de
l’élevage. Si la différence entre un mouton et un mouflon - ou un porc et un sanglier - est évidente
si on compare les animaux vifs, les différences au niveau osseux sont plus subtiles, et nécessitent
des mesures prises sur des ossements entiers : crânes, os longs et bassin dans le cas idéal (VON
DEN DRIESCH, 1976, p. 7). De plus, il ne faut pas comparer les animaux domestiques de l’Âge du
Fer (ni d’aucune autre époque d’ailleurs) à nos animaux domestiques actuels. La zootechnie
moderne a crée des races qui n’ont pas la même morphologie ni la même taille que les races
anciennes.
La quantification des espèces sauvages et domestiques a pour intérêt de se faire une idée des
moyens de subsistance d’une société. Bien entendu, nous savons qu’à l’Âge du Fer l’Homme se
repose depuis longtemps sur l’élevage d’animaux domestiques, mais la proportion d’animaux
chassés reste une donnée utile, car elle nous renseigne sur le statut de la chasse à cette époque, mais
aussi la nature des espèces chassées, le contexte d’une telle chasse (Privilège de la noblesse ?
Opportunisme ? Protection des cultures ?) et l’usage des animaux (Tannage ? Consommation ?).
Enfin, en fin de chapitre, je mentionnerai les ossements indéterminés et les informations qu’ils
peuvent nous livrer.
11
4.2 Identification des restes
L’inventaire se compose de 1157 fiches, totalisant 7661 restes. Certains restes étant des fragments
d’un seul et même élément, des remontages ont été faits, ce qui ramène le chiffre à 7057 éléments
différents. Ce chiffre important ne représente pas la réalité, mais une limite supérieure. La plupart
des restes sont des esquilles de moins d’un centimètre, aux bords émoussés, dont le remontage avec
d’autres restes dans le même état est impossible. C’est également cette profusion de petits
fragments qui explique le grand nombre de restes indéterminés : 6268 restes (82%), regroupés en
6003 éléments (85%). Les 1393 restes (1054 éléments) déterminés se répartissent comme suit :
4.2.1 Av ifaune
Les restes d’oiseaux sont représentés par 10 restes correspondant à 9 éléments différents. Parmi eux,
5 sont des os longs déterminés (4 humérus et 1 fémur) et 4 restes (3 éléments) sont des os longs
indéterminés mais dont la gracilité indique avec une quasi-certitude des restes aviens. Enfin, le
dernier reste est un fragment de coquille d’oeuf. Le nombre minimum d’individus a été estimé à 3.
Bien que les restes d’oiseaux n’aient pas été déterminés avec exactitude, on peut néanmoins faire
plusieurs constatations préliminaires à leur sujet. Par la suite, ces os devront être confiés à un
archéo-ornithologue, en particulier pour le diagnostic de la coquille.
12
Fig. 5. Vue de la coquille d’oeuf (référence inventaire : 17014/0017-1)
Parmi les éléments déterminés, deux classes de taille sont observables :
➢ 3 éléments de petite taille : 2 humérus ainsi qu’un reste indéterminé. Ces restes ne sont sans
doute pas le fait de l’Homme (voir infra – 3.2.10. Microfaune) : Leur taille est trop réduite
pour faire l’objet d’une chasse.
➢ 5 élément de grande taille, comparable à l’oie (Anser anser) ou au poulet (Gallus gallus
domesticus) : 2 humérus, un fémur et deux os longs indéterminés. Ces ossements pourraient
appartenir à des oiseaux dont la consommation (élevage ou chasse) par les Celtes nous est
connue.
Parmi les espèces possibles l’oie cendrée (Anser anser) et le canard colvert (Anas platyrhyncos)
sont connus, bien que rares8 (MENIEL, 1984, pp. 13-14). Leur morphologie ne permet pas de dire
s’ils sont domestiqués, mais les auteurs antiques, comme César ou Pline l’Ancien, parlent
d’élevages d’oies, et Pline plus précisément cite les exportations d’oies élevées par les Morins
(peuple de l’actuel Pas-de-Calais) et des plumes venant de Germanie. Il faut néanmoins avoir un
léger recul par rapport à ce qui est écrit : à l’époque où Pline écrit son Histoire naturelle, la Gaule
est romaine depuis un siècle9. Le coq (Gallus gallus domesticus) est paradoxalement un des
animaux les plus connus et dont les traces sont les plus faibles. Le coq fut représenté dans l’artisanat
gaulois et popularisé comme l’animal gaulois par excellence, à cause de l’homonymie latine entre
gallus « gaulois » et gallus « coq ». Il nous est effectivement connu à La Tène par quelques restes
épars mais c’est grâce à des découvertes exceptionnelles, comme le squelette d’Epiais-Rhus, que la
description de l’espèce a été possible. C’est grâce à cela que nous pouvons nous faire une idée plus
précise du coq gaulois : un animal petit, proche de nos coqs nains (MENIEL, 1987, p. 24).
Le cas particulier des restes aviens sur un site archéologique est un exemple modèle du passage de
la thanatocénose à la taphocénose. Contrairement à une idée reçue, les ossements d’oiseaux ne sont
pas plus fragiles que les os de mammifères de taille comparable, mais tous les ossements partagent
la caractéristique de se préserver d’autant moins que leur taille est réduite. Cela se manifeste avant
tout dans les processus intervenant après l’enfouissement : pression du sol, acidité, bioturbations,
etc, soit la taphonomie de manière générale. Mais elle se manifeste aussi lors de la consommation :
les oiseaux sont de petits animaux, et leurs os seront plus facilement concassés que ceux d’un bœuf
ou d’un cerf. Chacun qui a déjà mangé un poulet sait à quel point il est facile d’en casser l’os de la
8 Respectivement 2 et 3 restes à Compiègne, datant de La Tène ancienne, 2 et 7 restes à Pont-à-Chin (Halstatt) et 1 reste d’oie à Villeneuve-d’Ascq-Les-Prés (La Tène ancienne) (GAUTIER, 1990(b), pp. 200-201). ()
9 CESAR, La Guerre des Gaules, Livre 5,16 et PLINE, L’Histoire naturelle, Livre 10,27. Les passages traduits sont situés en annexe.
13
cuisse d’un coup de dent, et les restes donnés aux chiens ou aux porcs accentuent ce concassage,
sans compter qu’ils sont susceptibles d’être ingérés et entièrement gastrolysés. C’est d’autant plus
vrai pour les individus encore jeunes, dont l’os est encore grandement constitué de cartilage. Ainsi,
s’il y a un endroit où chercher les os d’oiseaux, c’est dans la majorité d’esquilles d’os indéterminées
qui composent un site, mais aussi, plus pragmatiquement, dans les sédiments non-tamisés, car nous
serions bien naïfs de penser que l’oeil du fouilleur, même du plus expérimenté, ne rate aucun objet.
Tous ces paramètres ne permettent pas de trancher sur le rôle des oiseaux dans l’alimentation de la
fin de La Tène, et en particulier à Olloy-sur-Viroin. Tout ce qui peut être avancé, c’est qu’ils sont
présents, et certainement en plus grand nombre que ce que les seuls restes laissent supposer.
4.2.2 Bos ( Bos primigenius, Bos primigenius f. taurus )
123 éléments sont identifiés comme appartenant au genre Bos. Les ossements suggèrent qu’ils
proviennent presque exclusivement issus d’individus domestiques (Bos primigenius f. taurus) car
de petite taille, à l’exception de la dent 1007/0010-1, qui est une prémolaire de très grande taille et
qui pourrait appartenir à un auroch (Bos Primigenius) mais j’y reviendrai lors du détail des
éléments. Le nombre minimum d’individus a été estimé à 4, sur base des différents tibias gauches
mis au jour.
La différentiation entre souche sauvage et domestique est ici une problématique bien réelle. À la
différences des autres bovidés domestiques européens (ovicaprins), l’aire de répartition de l’ancêtre
de notre bœuf, inclut l’Europe, ce qui n’était pas le cas des ancêtres du mouton et de la chèvre.
Des études se sont penchées sur la présence de foyers de domestications (autonomes ou
secondaires) de l’auroch en Europe et le rôle de celui-ci dans le bagage génétique de nos bœufs
actuels, par analyse de l’ADN mitochondrial. Celles-ci ont prouvé l’origine proche-orientale du
bœuf domestique et l’absence d’aurochs européens dans le processus de domestication – en tout cas
l’absence de femelles10. Des croisements sporadiques avec des mâles ne sont cependant pas à
écarter (TRESSET & VIGNE, 2007, p. 192).
La cohabitation entre bœuf domestique et auroch n’est pas un fait à remettre en question.
Le premier arrive en Europe avec les premiers néolithiques. Le second disparaît dans nos régions au
Moyen-Âge11 (MENIEL, 1987, pp. 92-93). Les textes historiques font mention de l’animal,
notamment César qui parle de l’« Urus » qui habiterait la « forêt Hercynienne » qu’il situe « chez
les Germains ». Il faut néanmoins savoir garder du recul par rapport aux textes car César ne fait que
10 L’étude de l’ADN mitochondrial met en évidence les lignées maternelles uniquement.11 Et disparaît définitivement en Pologne au XVIIe siècle.
14
rapporter des témoignages, et décrit l’auroch « de taille un peu moindre que celle d’un éléphant ».
Il cite aussi l’élan, qui selon lui n’a pas d’articulations aux pattes, ainsi que le renne, qu’il présente
comme un bœuf à corne unique !12
La présence de l’auroch dans la faune chassée est ainsi une question que l’on est en droit de se
poser. La différentiation au niveau ostéologique est aisée du fait de la différence de taille
considérable entre auroch et boeuf gaulois : 150 cm au garrot pour l’un13, 110 cm en moyenne pour
l’autre. Les données archéologiques font état d’un animal globalement absent de la faune de l’Âge
du Fer. Le seul site de Belgique ou du Nord de la France où il est fait mention de l’animal est celui
de Choisy-au-Bac, un site Hallstatt où un seul reste a été mis au jour (MENIEL, 1984, p. 13). Selon
Patrice Méniel, sur l’ensemble de l’Âge du Fer en Gaule, seuls deux fragments d’aurochs ont été
déterminés, sur 60000 restes (ARBOGAST, MENIEL & YVINEC, 1987, p. 66). Bien que cette
étude ait près de 30 ans et que les chiffres aient sans doute évolués, l’ordre de grandeur subsiste.
Cette quasi-absence ne permet pas de se faire une idée sur l’ampleur de la chasse de l’animal ni sur
la population existante à l’époque.
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans cette faible présence de l’auroch :
➢ La présence du « Schlepp-Effect »14. Ce concept se réfère au comportement de chasseurs qui
ne ramènent que les portions essentielles d’un animal à l’habitat pour ne pas s’encombrer
des morceaux inutiles. Contrairement à l’habitude, ce sont ici les animaux les plus grands
qui sont sous-représentés. Pour un animal chassé pour sa viande, on ne transportera que ses
parties les plus charnues, alors qu’un animal d’élevage sera tué et ses parties inutiles jetés
dans une fosse à déchet à proximité des parties utilisées. (GAUTIER, 1990 (a), p. 108)
➢ Le rôle délaissé de la chasse par rapport à l’élevage, cette première constituant un faible
pourcentage des restes.
➢ Une réduction apparente de la population qui ferait de l’auroch un animal rare, peut-être
cantonné à des forêts ou autres endroits à distance des installations anthropiques.
Le faible signal offert par l’auroch à l’Âge du Fer passe donc par plusieurs cribles : Un animal rare,
peu rencontré, encore plus rarement abattu dans une société où la chasse devient marginale, et qui
n’est pas emmené en totalité sur le site d’habitat en raison de sa taille.
Ainsi, pour en revenir à la prémolaire 1007/0010-1, il s’agit d’une première prémolaire inférieure
gauche dont la taille est hors du commun pour un bœuf de l’Âge du Fer (fig. 6). Après mesure de
12 CESAR, La Guerre des Gaules, Livre 6,26 à 6,28, Les passages traduits sont situés en annexe.13 L’estimation de la taille de l’auroch a fortement varié. Si certaines sources en ont fait un animal de 180, voire
200cm au garrot, les estimations récentes voient plutôt un animal de 150 cm, proche de nos charolais.14 En français, on utilise, quoique rarement, le terme de « transport différentiel ».
15
celle-ci et des prémolaires des différents crânes de référence présents au Musée d’Anatomie de la
Faculté de Médecine Vétérinaire, il s’est avéré qu’elle possède une taille sensiblement égale aux
espèces actuelles. La rareté de l’auroch au sein de la documentation archéozoologique ne me permet
cependant pas d’être catégorique sur sa présence à Olloy-sur-Viroin sur base d’une simple dent. Il
pourrait s’agir d’un taureau de grande taille, ou d’un croisement.
Concernant les 122 éléments restants, ils sont indubitablement issus de bœufs domestiques de petite
taille, conformes à ce qui nous est connu.
Les dents et fragments de mâchoire sont au nombre de 58, soit près de la moitié des restes, dont une
hémimandibule presque complète d’individu pré-adulte (17001/0023-1). Cette proportion
s’explique bien entendu par la grande résistance des dents, moins sensibles à la désagrégation et à la
pression du sol. De plus, les os sont généralement fracturés en résultat de l’activité humaine, pour
en récupérer la moelle, ou la confection d’outils en os. Cela explique donc également que seuls 26
éléments soient entiers à plus de 50 %. 22 éléments appartiennent à des os longs provenant des
membres (Humérus, Ulna, Radius, Tibia et Fémur).
Seules les extrémités sont conservées, ce qui les rend déterminables mais empêche toute
ostéométrie. Les diaphyses de ces os sont sans aucun doute à trouver dans les nombreuses esquilles
d’os longs dont la fragmentation est telle qu’elle ne permet pas la détermination.
8 restes appartiennent à des métapodes ou à des phalanges. En dehors de 10003/0156-2, qui est une
phalange appartenant à une patte avant, aucun de ces éléments n’a pu être localisé avec plus de
16
Fig. 6. Prémolaire inférieure gauche de grande taille (référence inventaire :1007/0010-1)
précision.
10 éléments de basipodes ont été déterminés et sont très bien conservés : 6 sont complets ou
presque complets et seul 1 fragment est conservé à moins de 50 %. Cela s’explique de la même
manière que pour les phalanges : ce sont de petits ossements très denses et l’homme ne les fracture
pas. Parmi ceux-ci, un talus (17001/0023-1) présente une trace de percussion ancienne et serait
peut-être trace de désossage.
4 côtes sont conservées, mais le sous-lot B4031/0001-4 pourrait n’être qu’une seule côte et non
deux. Cependant, aucune reconstitution avec certitude n’a été possible et je considérerai ce lot
comme contenant 2 côtes séparées.
1 seul reste de vertèbre a été déterminé. Il s’agit d’environ 1/8e de vertèbre cervicale, sans plus de
précision.
Les 5 fragments d’os coxal, tous fragmentaires, n’ont pas permis la détermination du sexe des
individus.
Seuls 2 restes sont indubitablement crâniens : il s’agit d’un os temporal et d’un condyle occipital
gauche.
Il y a un unique fragment de scapula (au niveau du collum).
Un reste a été déterminé comme étant un os hyoïde, avec toutefois des réserves. Il présente une
trace de boucherie qui, chose étrange, se situe sur la partie interne de l’os.
Enfin, 8 fragments sont indéterminés, mais ont été rapportés au genre Bos car ils se trouvaient dans
un lot ne contenant que ce taxon.
4.2.3 Cani dés ( Canis lupus lupus , Canis lupus familiaris , Vulpes vulpes )
Je parle ici volontairement de « canidés » et non d’un taxon en particulier. En effet, les 30 éléments
sont soit des éléments isolés, soit des ensembles de quelques restes, comme l’hémimandibule dotée
de 6 dents du lot 17014/0029 et les phalanges du sous-lot C10006/0002-5. En conséquence le
facteur discriminant sera dès lors la taille. Les espèces à prendre en compte sont le loup (Canis
lupus lupus), le chien (Canis lupus familiaris) et le renard roux (Vulpes vulpes). Tant le loup et le
renard ne peuvent être confondus en raison de leurs tailles respectives, la grande variabilité des
différentes races de chien entraîne une confusion avec le renard pour les plus petits représentants, et
plus rarement avec le loup pour les plus grands. La grande diversité d’espèces de chiens est mise
clairement en évidence sur le site de Variscourt (ARBOGAST, MENIEL & YVINEC., 1987, p.14) ,
où des chiens de grande et de très petite taille ont été retrouvés dans des couches contemporaines
17
(fig. 8). En conséquence je me limiterai à décrire avant tout des catégories de taille avant de les
interpréter. Dans un second temps, j’apporterai certains éléments de réponse sur base de recherches
déjà effectuées.
Ainsi, sur 30 éléments :
➢ 5 appartiennent à de grands canidés. Il s’agit principalement d’un fragment
d’hémimandibule droite avec 3 dents, qui était initialement composée de 6 restes
(C10006/0020-1).
Le sous-lot C4001/0024-4 contient 3 dents dont 2 ont été déterminées avec précision. Elles
étaient de taille semblable et leur présence au sein d’un même lot amène à penser qu’elles
font partie d’un même individu. La 3e dent a été également attribuée à cet individu, car
provenant d’un animal de taille comparable. Enfin, un fragment d’humérus (B4001/0280) se
range également dans cette catégorie.
➢ 8 appartiennent à des canidés de petite taille. Il s’agit d’éléments résistants du corps :
Phalanges (4), Dents (2) et Talus (1) ainsi que l’hémimandibule 17014/0029 précitée (fig. 7).
A l’exception du sous-lot C10006/0002-5, qui contient 3 phalanges d’un même individu
ainsi qu’une dent, les éléments sont tous isolés.
➢ Les 17 éléments restants proviennent de restes dont la taille n’est marquée vers aucun
extrême. Les 13 restes non identifiables C10006/0020 ont été néanmoins considérés comme
appartenant également à un canidé. Ils ont en effet été retrouvés avec l’hémimandibule
C10006/0020-1 et bien qu’aucun réassemblage n’ait été possible, il est raisonnable de les
considérer comme faisant partie du même individu. Les autres fragments sont plus
reconnaissables : il s’agit d’un fragment d’axis, d’une partie proximale d’ulna et de
fragments de deux humérus – l’un une partie mésiale, l’autre une partie distale.
18
Fig. 7. Hémimandibule de petit canidé, probablement renard (référence inventaire : 17014/0029 )
Le groupe intermédiaire est celui qui prête le moins à confusion : la taille des restes confirme qu’il
s’agit d’ossements de chiens, dont la caractérisation des races a cependant été abandonnée car les
restes sont trop peu nombreux et devraient contenir une plus grande proportion d’os crâniens et d’os
longs pour permettre une caractérisation.
Le nombre minimum d’individus pour l’ensemble des canidés a été estimé à 3 : un seul individu par
catégorie de taille.
Si, comme dit précédemment, les restes sont isolés et que la différentiation chien/loup et
chien/renard n’est pas évidente, les éléments retrouvés donnent des indices sur l’origine de l’animal
et son utilisation.
Le loup, animal de grande taille, est proportionnellement plus sujet au « Schlepp-effect ». Ainsi on
retrouve les phalanges plus que toute autre partie, ces ossements étant emportés avec la fourrure lors
du dépeçage de l’animal et le reste de la carcasse laissé sur place.
Sur les quelques restes de canidés de grande taille, aucune phalange n’a été retrouvée.
De même, si la chasse au loup a été mise en évidence, notamment par des parures dans des canines
et des restes de tannerie (MENIEL, 1987, p. 93), on ne le retrouve pas dans nos régions (GAUTIER,
1990 (b), pp. 200-201 ; MENIEL, 1984, p. 13). Ces informations, ajoutées au fait qu’aucun
ossement ne soit assez grand pour être avec certitude celui d’un loup, amène à penser que le
carnivore serait totalement absent d’Olloy-sur-Viroin.
Concernant le renard, le constat est moins catégorique. D’une part parce qu’un renard roux (Vulpes
vulpes) peut atteindre 40 cm au garrot, et les chiens de l’Âge du Fer qui nous sont connus ont des
tailles comprises entre 23 et 60 centimètres. (MENIEL, 1987, p. 25) ; d’autre part parce que le
« Schlepp-effect » est moins important pour un animal de cette taille, bien plus facile à transporter.
On aura tendance à retrouver plus d’ossements – mais toujours issus des extrémités du corps - qui
ne seront définitivement écartés que lors du traitement de la fourrure. Dans le cas présent, les 4
phalanges (dont 3 du même individu) et le talus de petite taille entrent dans cette catégorie, mais les
dents et l’ hémimandibule peuvent l’être également, car l’hémimandibule, complète à 80 %, ne
montre pas de raccourcissement comme c’est le cas pour les chiens de petite taille, ce qui validerait
plutôt son appartenance à un renard. De plus, aucun reste d’os long ou de parties axiales n’ayant été
mis au jour, ce qui est caractéristique d’un animal soumis au « Schlepp-effect ». Il faut néanmoins
garder à l’esprit qu’en l’absence de traces anthropiques sur les ossements, l’origine intrusive du
renard, animal occupant des terriers, n’est pas à exclure.
19
Pour en conclure avec les canidés, malgré les difficultés dues au faible nombre de restes (30
éléments, dont 13 sont des esquilles), certains éléments de réponse peuvent donc être apportés :
➢ La présence du loup est peu probable.
➢ Les ossements de grande taille et de taille intermédiaire sont
issus de chiens, sans qu’une race homogène puisse en être
décrite. La disparité des tailles au sein d’un même site nous
est connue et laisse simplement supposer un manque de
sélection lors de l’élevage. (MENIEL, 1987, p.25)
➢ Des ossements de petite taille confirment la présence soit de
petits chiens, soit de renards, avec une préférence pour ce
dernier étant donné la présence d’extrémités de membres
(phalanges, talus) et des restes crâniens.
L’usage du chien par l’homme est variable, et chaque variété a pu connaître un destin différent, que
ce soit lors de la vie de l’animal, mais aussi dans son traitement post-mortem.
Chiens de chasse, de guerre (MENIEL, 1987)15, de garde, de compagnie, mais aussi chiens de
boucherie ou chiens dépecés (GAUTIER, 1994, p.124); tout cela nous est connu, mais impossible à
mettre en évidence dans le cas particulier d’Olloy-sur-Viroin.
15 Méniel cite Pline qui mentionne des croisements entre chien et loups chez les Gaulois (MENIEL, 1987, pp.26-27, 147) et qui seraient de féroces chiens de guerre. Mais Pline mentionne également dans le même chapitre que les Indiens font de même avec chiennes et tigres, chose que l’on sait pourtant impossible. Il convient ainsi de considérer Pline avec recul. Cependant, l’utilisation des chiens à la guerre est connue depuis les Egyptiens.
20
Fig. 8. Comparaisons de différentes mandibules de chiens mis au jour à Variscourt. Tous les individus sont adultes. ( d’après ARBOGAST, MENIEL & YVINEC, 2002)
4.2.4 Cervidés ( C apreolus capreolus , C ervus elaphus )
Je considérerai les cervidés de manière globale, d’une part parce qu’ils représentent un pourcentage
très faible des restes et d’autre part parce que la détermination des différentes espèces à partir
d’ossements isolés est rendue malaisée par les chevauchements de taille entre les différentes
espèces, taille qui reste le facteur déterminant principal lors du diagnostic car les différentes espèces
ont une morphologie très proche, et ce sont les proportions du crâne et les bois qui présentent le
plus de différences. Or ce sont des éléments complètement absents ici. Heureusement, cette tâche
est rendue plus facile par l’absence du daim (Dama dama) lors de la période de La Tène. En l’état
de nos connaissances, ce cervidé ne s’est implanté dans nos régions que pendant le Moyen-âge
(MENIEL, 1987, p. 94). Les ossements les plus grands ont donc été attribués au Cerf (Cervus
elaphus) et les plus petits au chevreuil (Capreolus capreolus).
Ainsi, sur les 19 éléments :
➢ 8 semblent appartenir au chevreuil. Il s’agit d’un fragment de tibia, composé de 4 restes,
d’un fragment de scapula, d’une prémolaire inférieure, d’un fragment d’humérus, d’une
phalange ainsi que d’un fragment de radius qui était accompagné de 2 esquilles qui semblent
faire partie du même individu. Hormis la dent et la phalange, il s’agit toujours de fragments.
Le fragment de radius n’est complet qu’à 1/10e de sa totalité, en plus d’être carbonisé. Le
nombre minimum d’individus pour cet animal est de 1.
➢ 10 éléments ont été déterminés comme appartenant au cerf. Il s’agit de 2 dents, de deux
phalanges isolées dont une a été cassée de manière anthropique, d’un fragment articulaire de
vertèbre lombaire. 6 fragments de côte ont permis un réassemblage en 2 éléments distincts,
et sans la certitude d’un réassemblage entre ceux-ci, je ne me risquerai pas à les considérer
comme un seul élément. Enfin, 3 éléments sont des tibias, dont un n’a conservé aucune de
ses extrémités et dont le diagnostic a été fait sur base de la taille et de la gracilité de l’os, ce
qui le rapprochait du cerf. C’est cependant le fragment de tibia le plus intéressant car il
présente une marque de percussion sans ambiguïté. Le nombre minimum d’individus est de
2.
➢ Enfin, un fragment de bois animal très altéré a été retrouvé, sans qu’on puisse en dire plus
sur son possesseur.
Le statut des cervidés ne laisse aucun doute : ils font partie d’une faune chassée. L’élevage du cerf à
grande échelle est un phénomène récent, pour contrôler la demande en viande, et le chevreuil fait
21
seulement l’objet d’apprivoisements anecdotiques. Les Romains élevaient le cerf, mais rien
n’indique que les Celtes en faisait autant (BRELURUT, PINGARD & THERIEZ, 1990, p. 11). Les
restes mis au jour en contexte archéologique sont assez rares, ne représentant jamais plus de 1 % de
restes déterminés. Les données archéozoologiques d’Olloy-sur-Viroin vont en ce sens : les 10
éléments de cerf et 8 de chevreuil représentent une proportion bien trop basse pour représenter une
ressource alimentaire de première importance.
La chasse au cerf et au chevreuil relèverait plutôt d’une tentative de régulation des populations, ces
animaux évoluant en lisière des bois et donc aux abords des champs. Leur consommation ne serait
alors qu’un rôle secondaire, le rôle primaire étant la protection des cultures.
4.2.5 Equus ( Equus ferus , Equus ferus caballus )
Le cheval (Equus caballus) est représenté par 48 éléments. Il est à noter que contrairement aux
canidés et cervidés, il n’y a quasiment aucune confusion possible pour le genre Equus. En effet, les
recherches de Eisenmann ont montré l’absence de l’âne (Equus asinus) chez les Celtes, à
l’exception de l’extrême fin de la période de La Tène (MENIEL, 1987, p. 34). Dans nos régions et
le Nord de la France, l’âne n’apparaît qu’à la période gallo-romaine et reste excessivement rare. Ce
n’est qu’en Gaule méridionale que les Celtes l’ont utilisé dès le 3e siècle avant notre ère, par contact
avec les Romains et les colonies grecques (ARBOGAST et al., 2002, p. 8). Encore avant cela, l’âne
restait limité au pourtour méditerranéen. Les chances d’en retrouver à Olloy-sur-Viroin sont donc
nulles.
Parmi les éléments retrouvés, tous ou presque sont isolés. Seuls un talus et un tibia sont en
connexion, et deux os métacarpiens de la même latéralité ont été retrouvés ensemble.
Parmi ces éléments, 16 sont des esquilles indéterminées qui accompagnaient un métatarse
fragmenté (12001/0048). Une proportion importante des éléments est issus de fragments
épiphysaires d’os long, résultant soit d’une fracture, ou, pour les individus plus jeunes, des
épiphyses non-soudées au corps de l’os. En tout, 16 éléments ne sont représentés que par des
épiphyses. De manière étonnante, seuls 4 éléments dentaires ont été retrouvés. En sus du métatarse
12001/0048, un autre métapode, un métacarpe plus précisément, est présent. Il est constitué de 6
fragments et n’est conservé qu’à 1/8e de sa taille d’origine. Mis à part les 4 fragments de basipodes
retrouvés (Talus, scaphoïde, pyramidal et semi-lunaire), ainsi que 3 dents et un fragment de
vertèbre, aucun élément, même après réassemblage, n’est conservé à plus de 50 %. Bien plus
fréquemment, la fraction conservée est de l’ordre du 1/10e. Le nombre minimum d’individus a été
22
estimé à 3, sur base de 3 radius proximaux, de même latéralité.
S’il a déjà été énoncé que l’âne ne pouvait faire partie du cheptel d’Olloy-sur-Viroin, laissant le
cheval seul équidé sur place, il reste à déterminer si ce cheval est d’élevage (Equus ferus caballus)
ou sauvage (Equus ferus). La 1re observation à faire est la présence moins marquée - en
comparaison avec d’autres espèces – de modifications morphologiques entraînées par la
domestication. Les chevaux celtes sont certes plus petits que nos races actuelles, mais ils sont
comparables à leur ancêtre sauvage (qu’on rapproche morphologiquement et génétiquement du
tarpan) : leur taille au garrot se situe majoritairement entre 115 et 135cm, mais certains cas
extrêmes ont été retrouvés, que ce soit d’un côté (les chevaux de Soissons situent entre 100 et 120
cm) ou, plus rarement, de l’autre (de rares spécimens à Beauvais faisaient près de 150cm). Ils sont
robustes, au crâne court et large. Il faut donc les imaginer morphologiquement comme certains
grand poneys ou petits chevaux actuels, comme le cheval islandais. A titre de comparatif, la
Fédération Equestre Internationale dresse la limite entre cheval et poney à 148cm (MENIEL, 1987,
pp. 34, 36 ; FSSE, 2007, p. 11).
Une fois de plus, les fragments retrouvés à Olloy-sur-Viroin ne nous renseignent pas sur la taille et
la stature des animaux. Ils sont trop peu nombreux et fragmentés pour cela.
Il faut s’en référer aux études faites sur la diffusion du cheval (sauvage et domestique) pour mieux
trancher la question. Les recherches archéozoologiques montrent une abondance du cheval au
Paléolithique, où il était une des ressources alimentaires les plus importantes. C’est avec l’Holocène
que le cheval sauvage se fait de plus en plus rare en Europe. Au Mésolithique et Néolithique, et
jusqu’à l’Âge du Bronze, il se raréfie au point que certains l’ont cru éteint (EISENMANN, 1992,
p. 75). En vérité, quoique rare, il reste systématique et il est plus probable que les troupeaux
sauvages aient survécu de manière relictuelle, leur déclin étant proportionnel à l’augmentation du
couvert forestier. Le rôle de moins en moins important de la chasse est également à prendre en
compte. Si l’on met peu de cheval à jour dans les sites néolithiques, c’est parce que le bœuf, le porc
et les ovicaprins - domestiques - l’ont remplacé ! (ARBOGAST, MENIEL & YVINEC, 1987, pp.
65-66 ; ARBOGAST et al., 2002, p. 52)
Aucune étude ne fait état d’une cohabitation entre cheval sauvage et domestique dans nos régions.
L’animal étant rare et ne devenant systématique sur les sites archéologiques qu’à l’Âge du Fer on
s’en tient généralement à considérer qu’au Néolithique, le cheval est un animal sauvage et chassé,
car sa forme domestiquée n’arrive en Europe de l’Ouest que plus tard (EISENMANN, 1997, p.86),
23
et qu’à l’Âge des Métaux, il est domestique. Ce consensus est le résultat d’un manque de données,
une poignée d’ossements répartis sur plusieurs sites ne permettant pas de décrire les animaux.
(ARBOGAST et al., 2002, p. 43)
Le cheval domestique apparaît à l’Âge du Bronze en Gaule (MENIEL,1987, p. 33) mais pourrait
déjà être présent à la fin du Néolithique, sur le site de Chalain (EISENMANN, 1997, p. 86). À ces
époques, c’est plutôt la découverte d’éléments de harnachement, plus que les modifications
morphologiques, qui permettent de mettre en évidence la domestication (ARBOGAST, MENIEL &
YVINEC, 1987, p. 33).
C’est avec l’Âge du Fer que notre connaissance du cheval devient plus claire. Avec La Tène finale,
la période qui nous intéresse, la proportion en cheval connaît un pic qui ne sera dépassé qu’à la fin
de l’époque romaine, puis au Moyen-âge (ARBOGAST et al. 2002, p. 12).
S’il n’est pas toujours clair quel rôle les chevaux sauvages européens ont joué dans le patrimoine
génétique du cheval domestique, il semble qu’une évolution se dégage comme suit :
chassé au paléolithique, l’animal se fait plus rare au Néolithique à cause du réchauffement
climatique et du changement d’environnement pour ne rester qu’un animal rare - d’où son absence
sur les sites archéologiques - et finalement disparaître. Il refait son apparition en Europe occidentale
- sous forme domestique cette fois - avec la culture campaniforme ou un peu avant, avant de se
généraliser dans toutes les populations (GAUTIER, 1990 (a), p. 152)
Le cheval d’Olloy-sur-Viroin – et par extension, à l’Âge du Fer de nos régions – est donc d’origine
domestique assurée.
4.2.6 Felis ( Felis silvestris , Felis silvestris cattus )
Le chat (Felis silvestris) est représenté par un seul élément : une calotte crânienne (5008/0007). Les
os de la face (maxillaires, zygomatiques, nasaux) sont absent, à l’exception de la majeure partie du
frontal, laissant intact le plafond orbitaire. Les différents os ne sont pas encore entièrement soudés
entre eux.
Trouver des restes appartenant au chat avant l’époque romaine est un fait exceptionnel et ce seul
reste pose une problématique en soi. Le chat domestique (Felis silvestris cattus) n’est importé
qu’avec les légions romaines, comme animal de compagnie, et reste longtemps marginal, peut-être
même inconnu dans nos régions et limité au Sud de la Gaule et dans les vallées de la Saône et du
Rhône (ARMAND-CALLIAT, 1953, p. 88). Ce n’est qu’au Moyen-âge, avec les premières
migrations des rats noirs (VIIIe siècle), qu’il prospère. Le chat sauvage, lui, est chassé au même
24
titre que le lynx (Lynx lynx) mais ses restes sont rares et ne permettent pas de préciser l’usage précis
qu’en fait l’homme : est-ce pour sa fourrure ou pour sa viande (MENIEL, 1987, p. 94) ? Dans nos
régions, il semble même absent de la documentation archéozoologique : aucun des sites consultés,
que ce soit en Belgique ou le Nord de la France, ne fait mention de découvertes de chats. Des restes
se retrouvent à une période plus ancienne, au Bronze final, et encore ne sont-ils que deux,
respectivement sur les sites de Nanteuil-sur-Aisne et de Catenoy (MENIEL, 1984, p. 13 ;
GAUTIER, 1990 (b), p.203). Au vu de ces éléments, ma première intuition a été de considérer
l’animal comme intrusif. Cependant, la pauvre fréquence de l’animal sur les sites archéologiques ne
permet pas d’établir de statistiques sur sa présence ou non dans nos régions, et son absence jusqu’ici
peut s’expliquer par le hasard des découvertes.
J’ai ainsi pris plusieurs possibilité en compte :
➢ L’animal est un chat domestique récent et sa présence est effectivement intrusive.
➢ L’animal est un chat sauvage chassé datant d’une occupation plus ancienne du site où les
restes de l’animal sont avérés, quoi que de manière exceptionnelle.
➢ L’animal est un chat sauvage tué par un prédateur et sa présence est également intrusive.
➢ L’hypothèse la moins probable est que l’animal est un chat domestique contemporain de
l’occupation du site et serait par là même le premier chat domestique de nos régions, ce qui
ouvrirait une nouvelle problématique, à savoir la diffusion de certains animaux domestiques
avant l’époque romaine.
➢ Enfin, l’animal est un chat sauvage, contemporain de l’occupation et sa présence est la
résultante de l’action humaine.
Afin de pouvoir aller plus avant dans l’interprétation de cet élément, j’y ai attaché une plus grande
attention qu’à la plupart des autres restes, celui-ci présentant l’avantage d’être une calotte crânienne
complète et peu altérée. La photographie ci-après (fig. 9) montre une comparaison entre le chat
d’Olloy-sur-Viroin, au centre, et le chat domestique, à gauche, ainsi que le chat sauvage, à droite,
ces derniers étant issus des collections de référence de la Faculté de Médecine Vétérinaire. Le
spécimen d’Olloy est sensiblement plus petit que le chat domestique, mais il faut noter qu’il est plus
jeune : ses os ne sont pas encore soudés. La simple anatomie comparée ne suffit pas à trancher.
25
Plusieurs mesures de référence ont été prises, chose rendue possible par la bonne conservation de
l’élément :
• Largeur du mastoïde: 39,1mm
• Largeur entre les os zyogmatiques16 : 62,4mm
• Constriction intraorbitale : 16,7 mm
• Constriction post-orbitale : 32,8 mm
• Hauteur de la boîte crânienne: 34,9 mm
• Longueur totale du crâne17 : 72 mm
16 Légèrement extrapolée du fait d’une prise de mesure à l’extrémité de l’os temporal et non de l’os zygomatique, manquant.
17 Extrapolée du fait de l’absence des os de la face.
26
Fig. 9. Comparaison entre un chat domestique à gauche le chat d’Olloy-sur-Viroin au centre et un chat sauvage à droite.
Ces mesures ont ensuite été comparées à celles du chat sauvage (hypothèse la plus probable)
(MILLER, 1966, p. 466). Notre individu s’avère être globalement légèrement plus petit que la
moyenne, surtout au niveau de la longueur du crâne, mais c’est là un résultat à écarter étant donné
l’approximation de la mesure. Il se rapproche en taille des individus juvéniles recensés dans le
tableau des mesures, ce qui est cohérent avec la fusion incomplète des os crâniens.
Les proportions entre les différents paramètres ont également été calculées et notre spécimen se
situe dans les mêmes proportions que les individus recensés, à l’exception une fois encore de la
longueur du crâne, qui est de toute évidence sous-évaluée.
Un examen minutieux a mis en évidence deux marques parallèles très nettes de 4,5mm sur le
pariétal gauche. Elles sont situées près du sommet du crâne, à une distance de 3mm de l’axe mésial.
D’autres petites traces, moins nettes, parsèment la partie proximale du frontal. Une photographie au
microscope optique des ces marques montre malheureusement que malgré leur grande régularité,
elles ne montrent pas le profil caractéristique de traces de boucherie ou de dépouillement (fig. 10).
Malgré l’incrustation de sédiments, il a pu être observé qu’elles n’étaient pas profondes et présentait
un profil en U, alors que les traces de boucherie présentent un profil plus tranchant, en V.
Néanmoins, un outil en silex a été mis au jour avec cet élément (5008/0008), ce qui confirme a
priori une occupation humaine contemporaine malgré l’absence de traces anthropiques sur le
specimen.
27
Fig. 10. Photographie au microscope des marques sur le sommet du crâne. Malgré les sédiments incrustés, on voitque les traces sont peu profondes et que leur profil n’est pas assez incisif
L’hypothèse du chat sauvage chassé semble donc être la plus probable. Une analyse de l’outil en
silex ainsi qu’une datation au Carbone 14 permettrait de dater l’animal avec plus de précision.
Dans tous les cas, à moins que l’animal ne date de l’époque moderne, ce qui est improbable du fait
de la présence d’un outil en silex à proximité mais aussi de sa stratigraphie, qui le date de La Tène
finale18, ce seul reste constitue une découverte exceptionnelle, et mérite le plus grand intérêt.
4.2.7 Homo ( Homo sapiens )
Je cite ici les 2 éléments humains retrouvés à titre indicatif bien qu’ils doivent être étudiés par un
anthropologue.
Il s’agit d’une diaphyse d’humérus originellement retrouvée en 6 fragments qui n’a pas été reconnu
lors de la fouille ainsi que d’une clavicule.
4.2.8 Léporidés ( Lepus europaeus , Oryctolagus cuniculus )
Les léporidés sont représentés par le lièvre (Lepus europaeus) et le lapin (Oryctolagus cuniculus) :
➢ La présence du lapin de Garenne pose problème, car il est introduit par les Romains qui
l’élèvent en enclos et sa domestication n’a lieu qu’au Moyen-âge (MENIEL, 1987, p.94).
Auparavant, il n’est présent que dans le Maghreb et la Gaule méditerranéenne, endroits où il
s’est propagé à partir de la péninsule ibérique dont il est originaire19. Cependant, parmi les 5
éléments de lapin déterminés avec certitude, 3 sont d’aspect récents (17019/003-1 : un os
coxal ; 17019/003-2 : un humérus proximal et 17019/003-3 : un humérus distal). Ayant été
retrouvés ensemble et ayant la même taphonomie, ils font sans doute partie du même
individu. Pour les 2 éléments restants, un coxal et un fémur en connexion anatomiques, leur
statut récent est moins catégorique, mais ils ne peuvent être qu’intrusifs. Ces intrusions en
contexte archéologique ne sont pas rares, dû aux habitudes fouisseuses de l’animal
(GAUTIER, 1990 (a), p. 160).
➢ 4 éléments appartenant au lièvre ont été mis au jour. Il s’agit de 2 fragments distaux
d’humérus (un gauche et un droit, donc peut- être du même individu), d’un fémur complet
ainsi que d’un fragment de coxal. Le nombre minimum d’individus est estimé à 1.
Contrairement à son parent méridional, le lièvre ne connaît pas de forme domestiques, mais
18 Communication personnelle avec Eugène Warmenbol et Jean-Luc Pleuger, courrier électronique du 26 janvier 2014, situé en annexe.
19 L’origine du lapin dans la péninsule ibérique a laissé des traces dans l’Histoire. Ce sont les marchands phéniciens qui ont nommé l’endroit « I-shepan-im », soit « la côte aux damans », du nom qu’ils donnaient aux lapins, les comparants aux damans (Hyrax syriaca) qu’ils connaissaient. « I-shepan-im » devint en latin « Hispania » (GAUTIER, 1990 (1) ; MENIEL, 1987)
28
il a été - et est encore - élevé. Cependant aucune donnée archéologique, archéozoologique
ou historique ne nous renseigne sur de telles pratiques à l’époque qui nous concerne. Les
études de grande ampleur montrent que le lièvre est un des animaux chassé de prédilection
des Celtes. (MENIEL, 1987, p. 91) Selon Méniel, il s’agit du gibier le plus présent,
devançant grandement le cerf et le chevreuil. Des synthèses ont montré que cerf et lièvre se
retrouvent en quantités presque égales, suivis du chevreuil qui est nettement moins présent.
(GAUTIER, 1990 (b) , pp. 200-201). À Olloy-sur-Viroin, les cervidés sont majoritaires. Il
faut tenir compte dans ces études – et y compris dans celle-ci – du biais taphonomique lié à
la petite taille du lièvre et la fragilité de ses ossements (MENIEL,1987, p. 91). Ses os se
conservent moins bien que ceux du chevreuil, qui eux-mêmes se conservent moins bien que
ceux du cerf. Le lièvre devait donc être plus présent à la table des Celtes que ce que la
taphocénose ne nous laisse entrevoir. Cette présence s’expliquerait d’une manière analogue
à celle des cervidés, c’est-à-dire comme une chasse opportuniste plutôt qu’organisée. Le
lièvre étant un animal de milieu ouvert, milieu propice aux cultures et pâturages , il devait
côtoyer les agriculteurs et en faire régulièrement les frais.
➢ 1 élément n’a pas pu être déterminé avec précision : c’est un tibia de léporidé, mais il ne
peut être rattaché à un genre avec certitude. Sa taphonomie montre également un âge assez
récent, et il est sans doute intrusif.
4.2.9 Malacofaune
Les restes de malacofaune ont été répertoriées mais je ne les cite ici qu’à titre indicatif. Ils auront
besoin de l’avis d’un spécialiste pour déterminer les espèces ainsi que d’analyses pour confirmer
leur datation.
L’absence de détermination précise n’empêche pas certaines conclusions quant à leur statut.
L’héliciculture est un apport romain dans nos régions, mais rien ne s’oppose à la consommation
d’escargots sauvages, en dehors de tout élevage. Cependant, les restes de malacofaune sont tous de
petites tailles et il est peu probable qu’ils furent consommés, ni d’ailleurs qu’ils soient
contemporains de l’occupation humaine.
4.2.10 Microfaune
La microfaune est également citée à titre indicatif. Tout comme l’avifaune et la malacofaune, elle
aura besoin de l’étude d’un spécialiste. Parmi les 9 restes mis au jour, un semble venir d’un
amphibien, et parmi les 8 autres, tous de mammifères, un maxillaire appartient au genre Arvicola.
29
La présence de ces animaux de petite taille n’est pas le résultat d’une action directe de l’homme. Il
sont probablement présents sur le site pendant l’occupation humaine comme commensaux ou dans
les périodes postérieures à l’abandon du site, par l’action de prédateurs : renards, blaireaux, pelotes
de réjections de rapaces etc.
4.2.11 Ovicaprin s ( Ovis a ries , Capra h ircus )
Les ovicaprins sont les animaux les plus présents sur le site, après les Suidés. Près de 367 restes ont
été déterminés, ramenés après remontage à 294 éléments. Le nombre minimum d’individus est
d’ailleurs plus élevé que pour les espèces rencontrées jusqu’ici : 9 individus, dont 1 presque
complet et donc il sera question lors de la description des restes. Il convient cependant de bien
rappeler qu’il s’agit de deux espèces : Le mouton (Ovis aries) et la chèvre (Capra hircus). Les
archéozoologues eux-mêmes regrettent que ces espèces soient si souvent regroupées dans les études
mais la ressemblance anatomique entre les deux est si proche que la simple comparaison avec des
collections de référence ne suffit pas, mais que le recours à l’ostéométrie devient indispensable, si
tant est que les restes le permettent. La confusion est telle que la plupart des spécialistes ne tentent
pas la distinction en l’absence de crânes ou de chevilles osseuses (CORNWALL, 1956, p. 73) et les
rangent d’office dans une catégorie commune, comme il sera fait ici. Les études qui ont permis la
différentiation concluent toujours une prédominance du mouton par rapport à la chèvre, l’ovin étant
plus docile et exploité pour sa laine (MENIEL, 1984, pp.14, 25 ; GAUTIER, 1990 (a), p. 131),
voire une totale absence de celle-ci, comme sur le site de Haccourt (LÓPEZ BAYÓN, 1997, p. 2).
Comparé aux autres espèces du site, un nombre appréciable de restes sont bien conservés : 52 restes
complets et 24 restes presque complets. La majorité de ces restes complets viennent de 3 lots :
5002/0001, 5002/0002, 5004/0003. Ces lots contiennent chacun plusieurs dizaines d’ossements,
essentiellement de l’ovicaprin. (Le lot 5002/0001 contient également deux os d’oiseaux et des
esquilles indéterminées). En plus d’être homogènes dans leur contenu, les ossements se sont avérés
provenir d’un même individu. C’est par hasard, en proie à la difficulté de détermination de deux
restes issus des lots 5002/0001 et 5002/0002, que cela a pu être mis en évidence. Il s’agissait
respectivement d’un os basioccipital et d’un os basisphénoïde20, deux ossements crâniens
habituellement soudés ensemble dès le plus jeune âge et qui ici se correspondaient parfaitement.
Une fois la puce à l’oreille, un remontage a été tenté avec le lot 5004/0003 qui contenait également
exclusivement de l’ovicaprin et provenant de la même zone de fouille. Il s’est avéré que des
20 Je remercie particulièrement M. Cordy de m’avoir aidé dans ce diagnostic, sans quoi la découverte serait passée inaperçue, faute de détermination.
30
fragments de métapodes se correspondaient également.
Après vérification, il s’agit bien d’un unique individu de très jeune âge, au point qu’on peut
qualifier sa mort de périnatale. Aucune fusion osseuse n’est amorcée, même pas celle des corps
vertébraux, qui se soudent pourtant très vite, et les épiphyses sont toutes séparées des diaphyses.
Elles ont dû faire l’objet de remontages.
Le lot 5002/0001 contient l’essentiel des restes : Les membres inférieurs (à l’exception de quelques
ossements compacts et épiphyses), l’essentiel des côtes et des vertèbres, ainsi que l’ensemble
Scapula-Humérus-Radius-Ulna droit. Le lot 5002/0002 contient les restes crâniens, dentaires, ainsi
que le membre antérieur gauche. Le lot 5004/0003 quant à lui ne contient que quelques fragments et
des épiphyses.
L’ensemble compte 185 éléments (234 restes), ce qui signifie que cet individu unique représente
63% des ovicaprins présents sur le site !
Près de 80 % du squelette est conservé, malgré certaines difficultés :
➢ Tous les fragments costaux ne se remontent pas entre eux, et sont difficiles à replacer avec
précision sur l’animal. Cependant 18 articulations sur les 26 côtes que possèdent un
ovicaprin ont été déterminées.
➢ De même, 17 vertèbres ont été reconnues mais la plupart des fragments sont des
articulations inexploitables ou des corps vertébraux non-complets. Cependant au vu du
nombre (13 fragments de corps, 12 épiphyses, 10 articulations), on peut légitimement
affirmer que la quasi-totalité de 35 vertèbres est conservée.
Plusieurs entailles ont été décelées, sans qu’il s’agisse avec certitude de marques de boucherie : une
entaille sur l’intérieur d’une côte, une entaille sur le pubis qui semble récente et a sans doute été
occasionnée à la fouille, ainsi qu’une marque sur un métatarse.
La stratigraphie des restes pose également problème. Ces restes ont été retrouvés avec du matériel
moderne (douilles de fusil). L’US 5002 est un remblai humifère, reste de la tranchée des fouilleurs
du XIXe siècle. Elle coupe l’US 5004 qui jouxte le rempart occidental. L’hypothèse avancée par
Jean-Luc Pleuger serait que l’ovicaprin serait un reste de repas laissé par les fouilleurs de la fin du
XIXe siècle21. Cependant la taphonomie des ossements indique un âge déjà avancé et est cohérente
21 Communication personnelle avec Eugène Warmenbol et Jean-Luc Pleuger, courrier électronique du 26 janvier 2014, situé en annexe.
31
avec le reste du site. Ils sont de couleur grise légèrement brunâtre, alors que le sédiment est de
couleur noire.
L’hypothèse élaborée avec Eugène Warmenbol tendrait plutôt vers une offrande de fondation, liée
au rempart22. On peut imaginer le cas de figure d’une offrande, originellement conservée et laissée
en connexion anatomique, sans consommation de la viande ce qui expliquerait le faible nombre de
fractures. La perturbation serait due à l’action des fouilles de la fin du XIX e siècle, qui auraient
disséminé les restes et provoqué la perte des quelques éléments manquants, essentiellement des
basipodes et des phalanges, qui ne se retrouvent ni dans les lots concernés, ni dans le reste de la
zone de fouille.
Le reste des ossements est constitué de 109 éléments (133 restes), majoritairement des dents (75
éléments). 2 molaires sont légèrement brûlées. 1 dent est une molaire déciduale.
En dehors des dents, les autres parties du squelette sont représentées en faible nombre et
généralement fragmentés.
4 phalanges ont été identifiées : 3 1res phalanges et une seule 2de phalange . Celle-ci ainsi qu’une des
1res phalanges sont complètes. Les autres sont conservées à moins de 25 %.
3 fragments de scapulae sont présents. Celles-ci sont conservées à moins de 20 %, et uniquement
dans leur partie proximale, plus dense. Ce sont toutes des scapulae gauches et l’une d’entre elle
porte des marques de boucherie.
Les vertèbres totalisent 3 fragments : une dorsale, une lombaire ainsi qu’un corps vertébral
indéterminé.
Il y a 2 parties coxales, respectivement complètes à 25 % et 10 %. Il y a une partie gauche et une
partie droite mais rien ne permet d’affirmer qu’il s’agisse du même individu, d’autant plus que les
os proviennent de deux zones différentes.
Malgré la résistance de ces parties, les basipodes sont peu nombreux : on ne retrouve qu’un scapho-
lunaire complet ainsi qu’un talus qui ne l’est qu’à moitié.
Deux humérus ont été déterminés, mais seule leur partie distale est conservée. Un de ceux-là
présente de légères traces de brûlure.
Les ossements déterminés restants ne se présentent qu’en un seul exemplaire : un fragment de
cheville osseuse, une diaphyse de fémur, un fragment de côte, une extrémité proximale de radius et
un tibia.
22 Communication personnelle avec Eugène Warmenbol, courrier électronique du 28 janvier 2014, situé en annexe.
32
Enfin, 5 fragments de mandibule ont été déterminés comme restes d’ovicaprins car retrouvés avec
des dents, et il en est de même d’un fragment de diaphyse dont le reste du lot était de l’ovicaprin.
La raison dans cette faible représentation des os par rapports aux dents tient peut-être dans la petite
taille et la gracilité des premiers face aux os de bœufs ou même de porcs. On peut également
imaginer que leurs restes étaient donnés aux chiens et concassés, concassage auquel échappaient les
os plus grands.
Ces restes isolés nous montrent que les statistiques concernant les ovicaprins sont biaisées et
comment la présence d’un seul individu peut sur-représenter un groupe au sein d’un site. Ce cas
particulier nous amène à avoir du recul par rapport à la simple prise en compte du nombre de restes
ou d’éléments dans les statistiques et que le recours au nombre minimum d’individus se révèle
indispensable.
La problématique de la différentiation entre forme sauvage et domestique est ici absente. Mouton et
chèvre font partie des animaux domestiques à avoir été importés des foyers initiaux de
domestication proche-orientaux au début du Néolithique. Les études génétiques sur le sujet ont
prouvé la descendance directe entre la chèvre (Capra hircus) et la chèvre bézoar (Capra agreagus)
d’une part et entre le mouton (Ovis aries) et le mouflon asiatique (Ovis orientalis) d’autre part
(TRESSET & VIGNE, 2007, p. 190).
Il n’y a pas d’ovicaprins chassés à l’Âge du Fer car l’aire de répartition des souches sauvages
n’inclut pas l’Europe. (TRESSET & VIGNE, 2007, p. 190) Le bouquetin des Alpes (Capra Ibex)
pourrait être confondu avec la chèvre, et il a parfois été avancé comme ancêtre de celle-ci mais son
aire de répartition se limite à l’arc alpin. Il n’y a donc pas eu de domestication ni d’hybridation sur
le continent européen.
Le cas est le même pour le mouton. Le mouflon tel qu’on le rencontre dans le Sud de l’Europe n’est
pas issu d’une souche sauvage mais d’animaux domestiques néolithiques marrons23 (TRESSET &
VIGNE, 2007. p. 190 ; TRESSET et al., 2009, p. 72).
Les ovicaprins d’Olloy-sur-Viroin, sont donc domestiques à 100 %.
23 Revenus à l’état sauvage. Le phénomène est bien connu et ses exemples sont nombreux : « Mustangs » américains, pigeons de ville, le dingo australien, etc.
33
4.2.12 Su s ( Sus scrofa , Sus s crofa f. domestica )
Les suidés sont les animaux les plus représentés sur le site, avec 462 éléments identifiés dont 280
sont des éléments dentaires ou mandibulaires. On peut ici se pencher sur les biais taphonomiques
qui expliquent cette surabondance des dents par rapport aux autres éléments. Comme
précédemment, la raison principale de leur conservation est double : Leur dureté et leur densité qui
les conserve préférentiellement ainsi que l’inutilité des dents en terme de nutrition qui entraînent
leur rejet immédiat lors du traitement de la carcasse.
Mais la répartition des différents types de dents indique également un biais. Sur les 230 dents
isolées identifiées, 38 sont des canines ce qui représente 16,5 % alors que les canines ne
représentent que 9 % des dents au sein d’une mâchoire. De plus, parmi celles-ci, 33 sont des canines
inférieures de mâle, c’est-à-dire les défenses, et seule 1 canine est une canine inférieure de femelle.
Il y a ici une sélection manifeste de dents conservées pour leur intérêt esthétique au détriment
d’autres. Le contexte de découverte le montre : un certain nombre de ces canines ont été retrouvées
isolées, sans aucun autre reste à proximité. Citons notamment le lot 1007/0008 qui présente deux
canines inférieures droites (fig. 11). Il s’agit donc de défenses, qui ont peut-être été jugées
remarquables par leur taille ou leur aspect, qui sont issues de deux individus différents.
Les autres dents se répartissent comme suit : 65 Incisives (28%), 42 Prémolaires (18,2%) et 85
Molaires (37%). Je n’ai pas pu expliquer la surreprésentation des molaires et la sous-représentation
des prémolaires autrement que par une plus grande fragilité des prémolaires.
Certaines dents présentent des traces de chauffe. 7 dents ainsi qu’un fragment de mandibule sont
légèrement brûlées. 3 autres présentent des signes de chauffe plus avancé : une dent a la couleur
noire caractéristique d’une carbonisation, une dent est de couleur blanche suite à une calcination et
enfin une dent présente les deux caractéristiques: elle est carbonisée et a amorcé sa calcination.
En dehors des dents, on retrouve 32 éléments crâniens, dont seuls quelques-uns sont identifiés avec
certitude (par exemple, deux condyles occipitaux). 2 fragments sont issus de côte, dont un est une
première côte. Il n’y a que 3 éléments vertébraux, tous des atlas. La faible proportion de côtes et de
vertèbres s’explique sans doute par la fracturation qui rend ces éléments difficilement
reconnaissables une fois réduits à une fraction de leur taille d’origine. De nombreux fragments de
vertèbres et de côtes sont à classer parmi les ossements indéterminés.
12 phalanges ont été déterminées, ainsi que 6 métapodes. Une phalange et un métacarpe sont en
connexion ont été tous deux été carbonisés. Une autre phalange a été carbonisée et une 3e phalange
34
vestigiale (soit l’orteil II ou V) a été calcinée. Il est à noter également que deux métacarpes
présentent des traces de boucherie.
Certaines disparités sont étonnantes : 12 talus sont attribués au porc (quoique trois ne le soient pas
avec certitude à cause des cassures qui rendent les os moins lisibles) tandis que seuls 2 calcanéums
seulement ont été mis au jour. Il s’agit ici sans doute d’un écart due à la différence de densité de ces
ossements, quoique le calcanéum soit également un os résistant.
De même, il est étonnant que seul une diaphyse de fémur, la partie la plus charnue de l’animal, ait
été retrouvé, alors que les autres os longs sont plus nombreux : 6 humérus (dont un présentant une
trace de percussion), 2 radius, 2 tibias et 4 ulnas.
6 scapulas différentes ont été retrouvées : 3 gauches et 3 droites.
Enfin, une patella et 3 scaphoïdes ont été déterminées.
69 éléments restent indéterminés, dont un fragment provenant peut-être d’un bassin qui présente
une marque de boucherie. 9 restes sont calcinés.
Le nombre minimum d’individus a été estimé à 19.
Le porc (Sus scrofa f. domestica) présente un certain nombre de modifications anatomiques par
rapport au sanglier (Sus Scrofa). Ces changements dus à la domestication sont visibles sur les restes
osseux : raccourcissement de la face avec modification du profil de plus en plus concave,
allongement du corps, réduction globale de la taille et gracilité importante. Les deux premiers
facteurs ne font cependant que s’amorcer à l’époque qui nous concerne : certains crânes ne
35
Fig. 10. Canines inférieures droites de mâles retrouvées ensemble. (référence inventaire : 1007/0008)
présentent aucune modification de profil, ou alors est-elle discrète. Le corps ne s’est pas encore
distinctement allongé. En dehors de la taille, le porc celte devait ressembler aux porcs tels qu’on en
trouve encore au Moyen-Orient, ou tels qu’ils étaient avant la révolution agricole du XIXe siècle
(fig. 11).
Pour les estimations de gracilité, les estimations de poids vif oscillent entre
50 et 100 kg. L’imprécision est importante, mais reste bien loin des 300kg
atteint par nos porcs actuels (MENIEL, 1987, p. 11 ; ARBOGAST, MENIEL & YVINEC, 1987, p.
29). Cependant, à l’image des autres restes, peu d’ossements sont dans un état assez complet pour
prendre des mesures optimales et aucun crâne n’a été retrouvé complet à Olloy-sur-Viroin.
Quelques canines sont de belle taille, mais ce n’est pas là une preuve permettant de statuer sur la
présence du sanglier. Après mesure des canines complètes des plus imposantes, il s’avère que leur
taille est plus ou moins homogène, aux alentours de 12 cm. Il ne s’agit donc pas de défenses
exceptionnelles servant de trophées, mais leur regroupement (plusieurs canines retrouvées
ensemble) ou leur isolement (canine retrouvée seule, en l’absence d’autres restes) tend néanmoins à
considérer leur conservation à des fins esthétiques, peut-être dans le but de créer des parures, ou à
d’autres fins cultuelles ou symboliques.
En tous les cas, il semble improbable qu’il s’agisse là de défenses de sangliers, d’abord en raison de
leur taille, mais aussi parce que l’étude des suidés sur d’autres sites de La Tène et plus largement de
l’Âge du Fer ne va pas en ce sens. Dans son article « Hommes et Animaux pendant l’âge du Fer »,
Achilles Gautier dénombre 1 seul reste - probable! - de sanglier sur les 25 sites étudiés. A titre de
comparaison, il dénombre 796 restes de porc (GAUTIER,1990 (b), pp. 200-201). Dans un autre cas,
l’éperon barré de Pont-de-Bonne recense également 1 reste probable de sanglier pour 225 restes de
porc dans les couches de La Tène finale. (GILSON, 2008, p. 21). D’autres sites sont plus
36
fig. 11. Deux gravures issues de deux éditions différentes de l’Histoire
naturelle de Buffon. En haut des porcs du XIXe siècle, proches de nos
porcs actuels. En bas un porc du XVIIIe siècle, avant la révolution agricole (d’après ARBOGAST, MENIEL & YVINEC, 1987)
catégoriques quant à la détermination, mais toujours en petits nombres : 1 reste à Beauvais, 2 à
Variscourt, 8 à Choisy-au-Bac (mais il s’agit d’un site Hallstatt) et ne représentent que 0,1 % des
ossements déterminés. Les cas « probables » seraient probablement de gros verrats, issus de
l’hybridation entre un sanglier mâle et une truie domestique lors de la glandée, bien que cette
pratique reste discutée parmi les spécialistes. Elle est défendue par Achilles Gautier (GILSON,
2008, p. 21, GAUTIER, 1990 (a), p. 140) mais Patrice Méniel pour sa part pense que la glandée ne
se généralise que plus tard, au Moyen-Âge (MENIEL, 1987, p. 91).
Une interprétation personnelle serait simplement l’apport sporadique de souches sauvages aux
élevages domestiques, soit par hybridation involontaire lors de la glandée, mais aussi de
domestications nouvelles, par capture. Contrairement aux autres espèces du « quatuor néolithique »,
l’origine multiple, européenne et asiatique, de nos porcs européens a été prouvée par des analyses
génétiques sans que l’on connaisse les différentes occurrences de ce brassage (TRESSET &
VIGNE, 2007, p. 193). Les spécimens de taille importante seraient ainsi des sanglochons incorporés
au cheptel.
Quoi qu’il en soit, la mention du sanglier dans les études de site est exceptionnelle et si les auteurs
s’accordent pour dire qu’il est présent (en considérant une large échelle), ils s’accordent également
pour dire qu’il est très peu chassé.
Je conclurai donc qu’aucun reste mis au jour à Olloy-sur-Viroin ne permet de confirmer la présence
du sanglier, et on peut s’avancer à déclarer que l’ensemble des restes porcins sont des porcs
domestiques.
4.2.13 Les ossements indéterminés
Ce serait une erreur de négliger les ossements indéterminés. Il s’agit d’ossements dont la
détermination spécifique n’a pas été possible, mais dans de rares cas le segment anatomique a pu
être déterminé. S’ils ne donnent pas d’informations sur la faune en présence, ils en fournissent
d’autres. Par leur nombre d’abord. Les restes indéterminés totalisent 6268 restes, soit près de 82 %!
Quelques remontages ont été possibles ce qui réduit ce nombre à 6003 éléments (85% du nombre
des éléments). Devant un tel nombre, on se rend bien compte de l’approximation que représente la
quantification des espèces déterminées. Comme je l’ai déjà évoqué, les animaux plus petits, aux os
plus fragiles se conservent moins bien et c’est dans les milliers d’esquilles indéterminées qu’ils se
trouvent, se retrouvant ainsi sous-représentés dans les statistiques. Ensuite, cela nous montre la
grande différence entre la taphocénose identifiée et la thanatocénose du site, dans une proportion
37
qui n’est pas quantifiable.
Mais en dehors de ces informations méthodologiques, il y a d’autres constations à faire sur les
restes indéterminés :
➢ Il s’agit essentiellement d’esquilles, à savoir des fragments de si petite taille en comparaison
à leur segment anatomique d’origine qu’il est impossible de déterminer leur indice de
fragmentation par rapport à celui-ci. Seule parfois la forme ou la courbure de l’esquille
permet de donner une observation très générale : fragment d’os long, fragment crânien,
fragment costal. Ainsi, j’ai dénombré 5929 esquilles (5872 éléments) soit près de 95 % des
restes indéterminés (98 % des éléments), dont l’essentiel est composé de fragments
n’atteignant pas la longueur d’un centimètre (fig. 12). Plusieurs esquilles de plus grande
taille ont été mis au jour, permettant de donner une approximation de taille des animaux. Le
nombre absolu de restes indéterminés est donc à relativiser, car leur volume est bien
moindre.
➢ Le nombre de ces restes est surévalué et ne correspond pas à la fragmentation des ossements
lors de leur ensevelissement, ni même à la fragmentation lors de leur mise au jour. On peut
énumérer les différentes raisons de fragmentation, dans l’ordre de leur occurrence :
Les fractures sur os frais immédiates, comprenant les actions anthropiques (récupération
de la moelle, isolement de parties utiles à l’élaboration d’un outil) mais aussi les actions
animales (os concassés par les chiens ou les porcs), qui ont lieu peu après l’abattage de
l’animal.
38
Fig. 12. Exemple de fragmentation. Il s’agit d’ossements indéterminés provenant du lot 4001/0288. Sur cette photographie figurent 312 esquilles.
Les fractures sur os frais tardives, involontaires, comme le piétinement, qui ont lieu si
les ossements restent à l’air libre un certain temps avant leur enfouissement.
Les fractures relatives à l’enfouissement, induite par la pression du sol ou d’autres
objets (y compris d’autres ossements).
Les fractures relatives à la mise au jour. Il s’agit d’ossements fragilisés par l’excavation
et la soudaine libération de la masse de sédiments qui les recouvrait, causant dilatation et
fissures. Une mauvaise manipulation lors de l’extraction de l’objet peut également
résulter dans sa fragmentation.
Enfin, le cas des fractures dues au conditionnement. Les frictions et les chocs entre les
restes emballés au sein d’un même sac peuvent créer des fractures supplémentaires, tout
comme le poids qu’exercent les ossements au sommet d’un sachet sur ceux du fond.
Les trois premiers cas sont qualifiés de fractures anciennes – archéologiques : la section de
l’os a une taphonomie semblable aux faces. Les deux derniers cas sont qualifiées de
fractures récentes : la section et les faces de l’os ont des taphonomies différentes. Dans une
catégorie à part, il faut également citer les fractures des os brûlés, mais ceux-ci feront l’objet
d’un chapitre ultérieur.
➢ Le nombre d’éléments est également surévalué. Seuls quelques remontages d’esquilles ont
été possibles, et n’ont donné comme résultat que d’autres esquilles, plus grandes mais tout
aussi indéterminables. Le autres restes demeurent isolés car les surfaces de contact entre les
ossements étaient trop réduites et les bords trop émoussés.
Quelques éléments indéterminés le sont en cause de l’érosion qui rend illisible les parties
diagnostiques ou parce que la partie conservée ne porte pas de critères caractéristiques qui
permettent la détermination, comme c’est le cas avec un fragment du lot C4001/0328, qui contient
une diaphyse entière de petite taille, mais sans caractéristiques utiles.
Deux restes méritent une attention particulière. Le premier, référencé 10003/0057-1, est une esquille
calcinée longue de 11 mm qui présente 5 stries de boucherie régulières et profondes. La
photographie au microscope confirme un profil incisif, caractéristique de cutmarks, bien qu’ici
encore, les sillons soient incrustés de sédiments (fig. 13).
39
Le second, référencé 17029/0002-1, est un fragment rectiligne de 62,8 mm, poli et appointé. Il est
intéressant non du point de vue de l’étude de la faune, mais de la difficulté et de la confusion que
peuvent présenter certains objets. A première vue, j’ai pensé à un poinçon mais sa forme et ses
dimensions ne coïncidaient pas. Il s’est révélé, après quelques recherches, qu’il s’agissait d’un
fossile de bélemnite, un céphalopode disparu à la fin du Tertiaire, et qu’il est donc à écarter, tout
comme les autres fossiles (fig. 14).
40
Fig. 14. Fossile de belemnite ressemblant à un os effilé et poli (référence inventaire : 17029/0002-1)
Fig. 13. Esquille non-déterminée calcinée et présentant de profondes cutmarks (référence inventaire : 10003/0057-1)
Des cutmarks ont été décelées sur 18 restes, dont une est présent sur une vertèbre cervicale et une
sur un reste crânien. Les autres sont présentes sur des os longs. En outre, j’ai décelé 3 traces de
percussion bien qu’ une ait l’air d’une cassure récente. Enfin, deux esquilles, du sous-lot
5006/0072-2, ont mis en évidence ce qui semble être un poinçonnage de l’os qui aurait conduit à la
fragmentation de celui-ci.
Malheureusement, les informations que livrent ces traces de boucherie sont réduites sans la
détermination des ossements qui les portent.
Certains fragments ont néanmoins permis de donner une approximation de la taille des animaux, et
de les classer en 3 grandes catégories :
➢ Petits mammifères : renards, mustélidés, chevreuils ou ovicaprins juvéniles, etc.
Seuls 5 éléments correspondent à cette catégorie. Il s’agit des ossements les plus difficile à
assigner à une classe de taille, car il faut reconnaître une portion suffisante de l’os pour en
estimer la taille approximative.
➢ Mammifères de taille moyenne : ovicaprins, chevreuils, jeunes cerfs, porcs, etc.
J’ai recensé 128 éléments se rapportant à cette catégorie. La détermination anatomique d’un
grand nombre de ceux-ci a été possible, mais sans éléments diagnostics qui permettraient
d’en préciser le genre.
➢ Mammifères de grande taille : boeufs, chevaux, cerfs. Il s’agit de 120 éléments, avec peu de
de segments anatomiques déterminés. L’estimation est plus aisée pour les plus grands
animaux car même en présence d’esquilles, la grande taille de celles-ci permet de donner
une approximation par élimination des espèces trop petites.
Les informations apportées sont limitées, mais sont cohérentes avec les déterminations : la majorité
des éléments provient d’animaux de taille moyenne, dont les ovicaprins et le porc, qui sont
majoritaires parmi les espèces déterminées.
A l’inverse du peu d’informations que nous fournissent les ossements indéterminés intacts,
l’analyse des os brûlés indéterminés mérite plus d’attention. Tout d’abord parce que leur nombre est
important : 604 restes que quelques remontages ont permis de réduire à 580 éléments, ce qui
représente 95 % des os brûlés du site. Ce résultat n’est pas étonnant car la fracturation puis la
pulvérisation des os soumis à de hautes températures est systématique, et c’est la conservation qui
41
fait figure d’exception. Le manque d’informations quant à leur provenance est d’une importance
moindre car dans le cas de combustions, c’est du rôle de l’os en tant que matériau qui présente
l’intérêt principal, et non de l’animal dont il provient. Mais j’y reviendrai dans le chapitre dédié.
42
NR % NR NE % NE NMI % NMIAvifaune 10 0,72% 9 0,85% 3 6,38%
190 13,64% 123 11,67% 4 8,51%Canidés 35 2,51% 30 2,85% 3 6,38%Cervidés 48 3,45% 19 1,80% 3 6,38%
87 6,25% 48 4,55% 3 6,38%1 0,07% 1 0,09% 1 2,13%
Homo 8 0,57% 2 0,19% 1 2,13%Léporidés 11 0,79% 10 0,95% 1* 2,13%
47 3,37% 47 4,46%Microfaune 9 0,65% 9 0,85%
367 26,35% 294 27,89% 9 19,15%Sus 580 41,64% 462 43,83% 19 40,43%
Total déterminés 1393 100,00% 1054 100,00% 47 100,00%Indéterminés 6268 6003
Total 7661 7057
Bos
EquusFelis
Malacofaune
Ovicaprins
* lepus uniquement
Tableau 1. vue d’ensemble de la collection, en fonction du nombre de restes, du Nombre d’éléments et du nombre minimum d’individus pour les espèces non-intrusives
5 Âge d’abattage
5.1 Problématique
La détermination de l’âge de la mort de l’animal a son importance. Elle donne l’âge d’abattage de
l’animal et nous informe sur la gestion en ressources carnées, qu’elles soient issues de l’élevage ou
de la chasse. Pour les individus jeunes, on s’en réfère à la soudure des épiphyses des os, notamment
des os longs, ainsi qu’à l’éruption dentaire. Ces deux méthodes permettent de donner une
approximation en âge absolu, surtout si l’on dispose de plusieurs ossements d’un même individu, ce
qui permet de croiser les données. Pour les individus matures et séniles, on s’en réfère à l’usure des
dents. Cette méthode donne des résultats relatifs : l’usure dépend en effet de l’alimentation de
l’animal, selon la nature abrasive de celle-ci. Il ne fait nul doute que nos porcs et nos chiens, pour
ne citer que ces exemples, ont un régime qui ménage bien plus leurs dents que celui qu’avaient leurs
ancêtres. Il sera donc fait mention ici d’individus « matures » et « séniles », pour ne pas se risquer
dans des suppositions infondées.
5.2 Détermination des âges d’abattage
5.2.1 Av ifaune
Dans le cas des os longs déterminés, la détermination de l’âge des individus est moins aisée que
pour les mammifères, car il n’y a pas de soudure des épiphyses, mais une calcification progressive
des extrémités, jusqu’à atteindre la forme définitive. La convention veut alors d’appeler l’oiseau
« adulte » bien que cela ne corresponde pas à une réalité biologique, renvoyant à la maturité
sexuelle24(GOURICHON, 2004, p.117-118). Selon cette convention, les 5 os longs déterminés
présents à Olloy-sur-Viroin sont donc des individus adultes.
24 Chez l’oiseau, l’ossification définitive apparaît généralement avant la maturité sexuelle, alors que chez les mammifères c’est l’inverse : certaines parties sont encore en cours d’épiphysation alors que l’individu est sexuellement mature. A titre d’exemple, chez l’Homme le radius distal se soude entre 20 et 25 ans.
43
5.2.2 Bos
Plusieurs dents mises au jour présentent des traces d’usure, signe d’animaux déjà murs. Le lot
B4031/0001-10 a fourni 4 dents avec 3 stades d’usure différents. En tout 7 dents présentent une
usure moyenne, d’un animal mature, et une molaire provient d’un individu sénile. Pour les
individus juvéniles, le diagnostic est plus difficile car le hasard des découvertes nous a
malheureusement laissé comme ossements déterminables des radius distaux et des phalanges. Ces
ossements se soudant assez vite dans la vie de l’animal, aux alentours d’un an.
Un reste de mandibule (17001/0023-1) donne une estimation d’âge de 18 mois. Des restes distaux
d’humérus, de radius et de tibias, qui se soudent plus tard (respectivement vers 18, 45 et 25 mois),
m’amènent à penser que l’abattage des animaux se pratiquait jeune, juste après la maturité sexuelle,
ou peut-être même avant, ce qui expliquerait le faible nombre de dents usées. Seuls certains
animaux auraient été gardés pour une utilité autre que l’alimentation : production laitière, travail des
champs et reproduction (MENIEL, 1987, p. 70).
5.2.3 Canidés
Le faible nombre de restes de Canidés n’a pas permis de donner d’estimation d’âge : tous les os sont
épiphysés, mais aucune dent ne présente d’usure. Cette absence d’usure semble être un phénomène
généralisé, et une théorie avancée est que l’espérance des chiens devait être courte et que leur mode
de vie, en semi-liberté, ne devait pas les ménager (MENIEL, 1987, p. 27).
5.2.4 Cervidés
Aucun signe particulier n’a pu être déduit sur base des ossements de cervidés. Les extrémités
présentes sont toutes fusionnées, et renvoient à des individus formés. Les dents ne présentent pas
d’usure. Il peut s’agir d’individus dans la force de l’âge, plus intéressants en terme de nourriture que
les jeunes. Je reste cependant prudent quant à l’interprétation à avoir sur un si petit échantillon, qui
ne permet en rien d’affirmer quels paramètres déterminaient le choix des animaux chassés.
5.2.5 Equus
Peu de paramètres liés à l’âge ont été décelés sur les restes équins. Une molaire supérieure montre
une usure moyenne, se rapportant à un individu mature. Deux restes, une scapula et un humérus
distal, ne sont pas soudés, or ces ossements se soudent respectivement vers 1 an et 18 mois. Il s’agit
44
donc d’individus encore jeune. Un radius distal sans épiphyses a également été mis au jour, mais cet
os se soude vers 42 mois, à l’âge adulte. Les autres ossements donnent également des os soudés.
Hormis la dent usée, les différentes sutures font état d’animaux âgés entre 1 et 4 ans, âge auquel le
rendement carné est maximal. L’absence de bêtes d’âge avancé pourrait signifier que les habitants
d’Olloy-sur-Viroin pratiquaient l’hippophagie.
5.2.6 Felis
En l’absence d’autres ossements ou de dents, l’approximation de l’âge du seul reste de chat sauvage
mis au jour doit se faire par la suture des os crâniens. Aucun reste crânien n’est entièrement soudé,
renvoyant à un animal encore relativement jeune, ou pré-adulte. Il ne saurait être juvénile car la
fusion est assez avancée pour donner une cohésion complète au crâne, sans éléments labiles.
5.2.7 Lepus
Les restes de lièvres, peu importants, sont tous des ossements entièrement soudés, renvoyant à des
individus matures. L’âge du lapin n’est pas traité, l’animal étant intrusif.
5.2.8 Ovicaprins
Les restent ovicaprins offrent une majorité d’ossements issus d’individus juvéniles, par la présence
de l’agneau/chevreau de l’US 5002 et 5003. Il faut veiller à ne pas fausser les statistiques et mal
interpréter les habitudes alimentaires des habitants de la fortification, et voir en eux des amateurs
d’ovicaprins très jeunes. Il s’agit là d’un ensemble exceptionnel, se démarquant clairement des
autres restes du site.
Excepté ce cas particulier, seule une molaire déciduale ainsi que deux phalanges peuvent être
rapportés à des individus juvéniles. Les phalanges se soudant assez tôt dans la vie de l’animal, leurs
propriétaires étaient très jeunes (entre 6 et 8 mois).
A l’autre extrémité de la pyramide des âges, une molaire et une prémolaire présentent une usure
moyenne, venant d’animaux matures, et deux prémolaires appartiennent à un individu sénile : les
figures d’usures ne sont presque plus discernables.
Le reste des ossements quant à lui – avant tout représenté par des dents – renvoie à des individus
adultes, aux épiphyses fusionnées, et sans usure dentaire. Il est possible que les ovicaprins, en
particulier les moutons, majoritaires, ne soient pas tués dès leur maturité mais gardés en vie un peu
45
plus longtemps, pour leur laine et leur lait.
5.2.9 Sus
Grâce à leur abondance, les restes de porcs ont donné plus de résultats. Plusieurs restes de
phalanges et métacarpes fusionnés récemment avant la mort de l’animal donnent un âge
approximatif de 1 an à celle-ci. Deux hémimandibules, dont la dentition a été conservée, a permis
également de déterminer un âge approximatif d’une année. Parmi les quelques dents déciduales, une
incisive présentait une forte usure, indiquant qu’elle devait bientôt être remplacée, remplacement
qui survient aux alentours d’une année25. La majorité des dents n’a aucune trace d’usure, y compris
les défenses dont les tables d’usure sont réduites, ou inexistantes26.
Une douzaine de dents présentent une usure moyenne, correspondant à un animal mûr, dont une
défense. Six de ses dents ont été retrouvées ensemble et appartiennent peut-être au même individu.
Près d’une dizaine de dents présentent une forte usure, avec disparition des cuspides.
La règle serait donc à l’abattage très jeune, dès la maturité sexuelle de l’animal27, pour ne garder
que quelques bêtes, en vue de la reproduction. C’est ce qui ressort d’autres études (MENIEL, 1987,
p.65). Aucune autre raison ne justifie la survie d’individus si ce n’est celle de la reproduction :
l’animal ne fournit ni lait, ni laine, ni force de travail.
25 La dent en question n’a pu être déterminée avec précision, et les différentes incisives sont remplacées aux alentours d’un an, avec des variations de l’une à l’autre.
26 Quand celles-ci sont visibles. Plusieurs défenses sont érodées, ou fragmentées dans le sens de la longueur, masquantla table d’usure.
27 Qui est d’environ un an pour les sangliers, et 6 mois pour nos porcs actuels. La maturité sexuelle des porcs de l’Âgedu Fer devait se situer entre ces deux valeurs.
46
6 Les ossements brûlés
6.1 L’os en tant que combustible
L’analyse des ossements mérite la plus grande attention car même s’ils sont généralement
inutilisables du point de vue des déterminations, ils portent d’autres informations utiles – comme
l’utilisation de l’os comme combustible ou les traces d’incendie – et leur répartition spatiale nous
informe également de la dispersion et des remaniements éventuels.
L’os a été utilisé depuis le paléolithique comme combustible, mais contrairement à une idée trop
répandue, il ne s’agit pas d’un combustible « par défaut », seulement utilisé quand le bois se fait
rare, mais il semble avoir été utilisé peu importe le couvert forestier (THERY-PARISOT &
COSTAMAGNO, 2005, p. 236). Différentes études ont été menées sur la valeur de l’os en tant que
combustible, par le recours à l’expérimentation. Il s’est avéré que l’os a une faible inflammabilité
comparable à celle du bois vert, qui demande obligatoirement un initiateur ainsi qu’un peu de bois
sec pour atteindre le point d’inflammation28 situé vers 380°C. Petite précision à apporter : c’est
avant tout la graisse de l’os qui se consume, ainsi que ses parties organiques29. Les expérimentations
ont montré que l’os spongieux a le potentiel calorique le plus efficace, tandis que l’os compact est
d’un intérêt limité : il cesse de se consumer dès que la flamme est éloignée.
Les expérimentations ont également montré qu’à masse égale, plus la proportion d’os par rapport au
bois est grande, plus la durée des flammes sera élevée, mais se refroidira très vite une fois les
flammes éteintes, tandis que le bois se consumera plus longtemps sans flammes (formation de
braises) (THERY-PARISOT & COSTAMAGNO, 2005, pp. 236-239).
Tous ces paramètres étaient sans doute connus dès le paléolithique et les Celtes également ont dû les
prendre en compte pour utiliser l’os en fonction de leurs besoins. (THERY-PARISOT &
COSTAMAGNO, 2005, pp. 248)
28 Ou « flux incident critique »29 Collagène notamment.
47
6.2 L’influence du feu sur les ossements et sa conséquence en archéologie
L’exposition au feu d’un os aura différentes conséquences sur l’aspect de celui-ci en fonction de la
durée et de la température.
L’os va d’abord noircir par la consomption de ses parties organiques, puis blanchir du fait de la
disparition totale des éléments organiques. La structure cristalline va également changer, ce qui peut
être mis en évidence par des études cristallographiques et ainsi déterminer la température
approximative de chauffe (PERINET, 1969, p. 143).
On conçoit généralement 7 phases de chauffe de l’os archéologique, en fonction de sa couleur30 :
0
1
2
3
4
5
6
Not burned La couleur de l’os due au séjour en terre (crème ou gris, mais peut prendre d’autres couleurs en fonction du milieu)
Slightly burned Brûlure localisée avec brunissement ou début de noircissement
Lightly burned Brûlure généralisée mais non complète ; brunissement et noircissement sur tout la surface
Fully Carbonized Carbonisation complète ; l’os est uniformément noir.
Localised < half calcined L’os blanchit par endroit, l’interface entre le noir et gris aura une couleur grise ou bleutée
Localised >half calcined L’os est majoritairement blanc
Fully calcined L’os est entièrement blanc
En outre le feu entraîne une grande fragmentation due à la perte de la matière organique, qui donne
à l’os sa souplesse et en l’absence de laquelle l’os devient cassant et perd de sa cohésion. Les
fragments mis au jour sont majoritairement de petite taille, réduits à des esquilles. Trois causes de
fragmentation ont été identifiées :
➢ Par l’action de la chaleur seule, qui provoque des dilatations que l’os ne peut assumer sans
éléments organiques31.
30 Je garde ici volontairement les termes anglais, pour garder la nuance « slightly » et « lightly », qui est moins facile àexprimer en langue française, étant donné que ces mots se traduisent tous deux par « légèrement »
31 L’os, devenu une structure presque exclusivement minérale, se comporte alors comme les roches qui éclatent à cause de chocs thermiques trop importants.
48
Tableau 2. différents stades de combustion de l’os (d’après STINER, KUHN, WEINER & BAR-YOSEF, 1994)
➢ L’agitation de l’os déjà fragilisé, comme l’attisement du feu, ou la dispersion des cendres
froides.
➢ Le piétinement et les phénomènes post-dépositionnels liés à la pression.
En quelques heures au sein d’un foyer, l’os peut ainsi être réduit en poudre, et la conjonction de
plusieurs facteurs à l’issue de centaines ou milliers d’années ne fait qu’accentuer ce fait (STINER &
al. pp. 224, 229).
Les transitions entre les phases 1 et 2, ainsi qu’entre les phases 4 et 5 ayant été peu visibles sur le
site, les ossements d’Olloy-sur-Viroin ont été décrits comme suit (fig. 15) :
6.3 Les os brûlés d’Olloy-sur-Viroin
Les restes mis au jour à Olloy-sur-Viroin totalisent 638 restes ayant subi les dégâts du feu, qui après
divers réassemblages sont réduits à 609 éléments. Comme dit précédemment, 95 % de ces os brûlés
sont des ossements indéterminés, dépassant rarement le centimètre. Seuls 29 éléments déterminés
présentent des traces de chauffe, dont essentiellement des esquilles qui n’ont été rendues
déterminables que par le contenu restant du lot, des dents et des phalanges, ainsi que deux
fragments d’humerus et de radius.
Si tant de fragments de diaphyses sont présents, c’est à cause de leur faible inflammabilité, qui les
empêche de se consumer entièrement, comme je l’ai expliqué plus haut. A l’inverse, on remarque
une totale absence d’os spongieux, qui est la partie la plus inflammable et la plus fragile, qui aura
tôt fait d’être pulvérisé.
Retrouver des ossements brûlés déterminables tient de l’exception, et il s’agit presque toujours
49
0 nul aucune trace de chauffe
1légèrement brûlé brunissement et noircissement localisé
2carbonisé os noir
3carbonisé – calciné
4 calciné os blanc ou bleuté
os blanc et noir (généralement le cas d’ossements dont une face est noire et l’autre blanche)
Tableau 3. échelle des stades de combustion de l’os utilisée dans le cadre de l’étude
d’éléments denses : principalement des dents et des phalanges. Il ne fait aucun doute que les os
brûlés mis au jour ne représentent qu’une infime fraction de ce qui a été brûlé sur le site, mais dont
la pulvérisation a rendu impossible leur sauvegarde jusqu’à nous.
Les restes se répartissent comme suit :
• 1 : L égèrement brûlé
36 restes (34 éléments) présentent de légères traces de brûlures. Il s’agit de carbonisation (couleur
noire) localisée. Parmi ces éléments, 10 sont des dents déterminées, et un 11e est une dent
indéterminée. En outre, une partie d’humérus d’ovicaprin est également présent. Si la proportion
d’éléments déterminés est ici si élevée, c’est bien entendu grâce à la faible emprise du feu qui n’a
pas endommagé les ossements assez longtemps.
La présence d’autant de dents est ici un facteur intéressant. Celles-ci ont tendance à se fissurer et à
éclater plus vite à température élevée en raison de leur composition plus minéralisée, mais ont pour
cette même raison une inflammabilité moindre.
La présence de dents légèrement brûlées permet de mettre en évidence la pratique de cuisson à
même la flamme où l’animal entier est tenu au-dessus du feu, à la broche, brûlant ainsi la pilosité de
l’animal. Les dents, seul élément minéral exposé, seraient alors atteintes par les flammes. La preuve
semble ici un peu mince étant donné le peu de dents déterminées mais il s’agit de 11 dents sur les
13 dents brûlées mis au jour, et près d’1/3 des ossements brûlés déterminés.
• 2 : Carbonisé
Il s’agit de 45 restes (38 éléments), dont une molaire éclatée en deux fragments d’ovicaprin, un
fragment de phalange et de métapode en connexion de porc, ainsi qu’une phalange isolée, de porc
également. Les phalanges sont parmi les os brûlés les plus représentés, à cause de leur densité, qui
les rend difficilement inflammables.
• 3 : Carbonisé-calciné
Ce stade de chauffe comprend 94 restes (89 éléments), dont seul un fragment de molaire de porc est
identifié. Les autres fragments sont des esquilles dont une face est noire et l’autre blanche,
traduisant la face la plus exposée au feu.
• 4 : Calciné
Il s’agit de la catégorie la plus représentée, avec 463 restes (448 éléments). Il n’y a de déterminé
qu’un fragment de radius de chevreuil, ainsi qu’une molaire et une 3e phalange vestigiale de porc.
Un olécrâne d’ulna et un fragment qui semble provenir d’un fémur font également partie de cette
50
catégorie, mais la détermination de l’espèce n’a pas été possible. Trois ossements indéterminés
portent des traces de boucherie. Il ne faut pas s’étonner du grand nombre d’os calcinés par rapport
au total. Bien qu’il y ait des variations dépendantes de la densité et de l’épaisseur de l’os, les études
ont montré qu’aux alentours de 600°C, les os commencent à présenter des traces de calcination et
entrent dans le stade 3 « carbonisé-calciné ». Aux alentours 700°C, la calcination est totale. Les
expérimentations ont montré que les mélanges os/bois produisent des températures maximales
situées entre 600°C et 825°C, en fonction des proportions et de la nature de l’os. Il ne faut donc pas
de dispositif particulier pour blanchir et même pulvériser des os (PERINET, 1969, p.144 ; THERY-
PARISOT & COSTAMAGNO, 2005, p. 242). L’expérience personnelle m’a montré qu’après une
nuit dans le feu, un os aussi massif qu’un coxal de bœuf – brisé en plusieurs fragments afin de
faciliter l’inflammation – se désagrège au simple contact.
51
Fig. 15. de gauche à droite : os non brûlé, légèrement brûlé, carbonisé, carbonisé-calciné, calciné. En haut, dent légèrement brûlée
7 Les traces anthropiques
7.1 Quand le geste humain se lit sur l’os
Le site a livré très peu de traces sur les ossements qui puissent être attribuées sans ambiguïté à une
activité anthropique. La plupart des ossements ont été évoqués dans le chapitre sur la détermination.
L’identification définitive de ces marques demande de recourir à des appareils de grossissement afin
d’en voir le profil et éliminer les traces d’origine naturelle. Ce fut le cas pour l’esquille calcinée
10003/0057 ainsi que pour le crâne de chat, qui se sont révélés respectivement concluant et non-
concluant.
Il serait réducteur de ne tenir compte que des « cutmarks », les traces de boucherie, bien que celles-
ci fassent l’objet de nombreuses études. Leur répartition et leur spécificités permettent d’affirment
si un animal a été consommé ou dépouillé, mais aussi dans le premier cas de connaître les habitudes
de boucherie des populations. Leur analyse minutieuse par la tracéologie permet de mettre en
évidence le type d’outils qui ont entamé l’os.
Mais d’autres traces ont également été observées, à savoir celles de fracturation sur os frais. Ces
traces interviennent lors de la confection de bouillons ou de récupération de la moelle, mais aussi
lors du façonnage d’outils. Parfois, des marques de percussions peuvent également être décelées,
marquant l’endroit à partir duquel l’os fut fracturé.
Ce sont là les deux grandes catégories de traces anthropiques laissées sur les ossements. La
combustion en fait également partie, dans une certaine mesure.
Les archéozoologues se heurtent à plus de difficultés pour la mise en évidence d’autres
comportements, comme la cuisson à l’eau (CHAIX & MENIEL, 2001, p. 99).
52
7.2 Description
7.2.1 Traces de boucherie
Ce sont les traces les plus représentées. 42 ont été dénombrées, dont 28 proviennent d’ossements
indéterminés. Ces informations ne sont malheureusement d’aucune utilité : elle ne nous disent pas
quel animal a été dépecé.
Heureusement, certains ossements ont pu être déterminés. Ainsi 5 éléments provenant de bœufs
portent des cutmarks : un os crochu, la partie distale d’un humérus, une côte et un condyle occipital.
Le 5e reste plus ambigu car c’est un os hyoïde et la trace se situe sur la face interne de l’os.
Malheureusement, le condyle occipital provient d’un sachet dont le marquage a été effacé. Une
interprétation possible serait que les marques sur le condyle et l’hyoïde soient le résultat de la
séparation de la tête de l’animal du reste du corps, d’abord en séparant la tête de la colonne
vertébrale, puis en découpant les tissus et endommageant l’os hyoïde lors du processus. L’étude des
bœufs mis au jour à Beauvais ont permis de se faire une idée de la boucherie à La Tène, sur un
échantillon plus nombreux (plus de 2000 restes déterminés de bœuf) et mieux conservé. Les traces
d’Olloy-sur-Viroin correspondent à cette découpe : traces à la base du crâne, sur les carpes et tarses
pour découper les extrémités moins riches en viande, sur l’humérus pour la découpe des pièces
d’épaule, et fractionnement des côtes (MENIEL, 1987, pp. 71-73 ; MENIEL, 1984, p. 14).4
ossements de porcs montrent également des cutmarks. Il s’agit de 2 métacarpes dont la fusion n’est
pas achevée, ce qui confirme l’abattage d’animaux jeunes (fig. 16 et fig. 17). Une cutmark est
également présente sur une partie distale d’humérus. Bien plus profonde, elle scie l’os en partie,
sans doute par l’action d’un couperet. Ce même os présente également une trace de percussion qui a
résulté en sa fracturation. Ainsi, une chaîne opératoire se dessine sur ce seul os : la patte du porc est
découpée, décharnée, et l’os est réutilisé pour un bouillon, ou pour en récupérer la moelle. Un
dernier os de porc présente une trace de boucherie, mais il a été identifié par rapprochement avec les
autres restes du lot, et le segment anatomique est inconnu.
Concernant les ovicaprins, 3 marques sont présentes sur l’individu juvénile : une sur la face
intérieure d’une côte (sans doute un reste issu d’une éviscération), sur le pubis (mais la marque ne
semble pas contemporaine de la mort de l’animal. Il pourrait s’agit d’un coup provoqué par un outil
moderne, soit par les fouilleurs du XIXe siècle... ou du XXIe!) ainsi que sur une articulation de
53
métapode, malheureusement isolée. Un 4e os, une partie proximale de scapula gauche, issue d’un
individu adulte, présente également des marques autour de l’articulation. Enfin, la dernière marque
déterminée provient du crâne de chat sauvage dont il a déjà été question et nous avons déjà constaté
que l’origine anthropique des marques était remise en cause.
7.2.2 Percussion et fracturation
Les traces de fracturations sont moins nombreuses, pour des raisons de taphonomie. Si une cassure
intervient lors de son séjour en terre, elle masquera la cassure originelle. Ainsi, il n’y a que 9
cassures sur os frais, dont deux sont déterminées : une 1re phalange de cerf et un radius proximal de
bœuf. La fracturation volontaire d’une phalange est curieuse, car l’os ne présente aucun intérêt
nutritif. Parmi les ossements indéterminés, une esquille présente une trace de fracturation fraîche
ainsi qu’une percussion.
Les percussions sont au nombre de 8 : en sus de l’esquille et de l’humérus de porc déjà cités, un
tibia de bœuf et un tibia de cerf ont clairement été fendus dans le sens longitudinal. Aucun de ces
ossements ne présente de taphonomie particulière qui pourrait indiquer un traitement particulier,
comme la cuisson à l’eau. Une étude sur de plus grandes séries, spécialement ciblée sur
l’identification de la cuisson à l’eau, donnerait sans doute plus de résultat.
54
Fig. 16. Métacarpe de porc présentant une marque de boucherie (référence inventaire 10003/0039-1)
8 Répartition spatiale
La répartition des ossements au sein du site est essentielle pour comprendre celui-ci. Le comptage
des restes en les regroupant par US permet la mise en évidence d’un certain nombre
d’informations :
➢ Les fosses à déchets ou d’aires de consommation, repérable grâce aux concentrations
globales des ossements.
➢ Des aires d’activités spécialisées comme la manufacture d’outils en os ou des espaces de
tannerie, par la concentration d’ossements ou d’espèces particulières.
➢ Zones exposées au feu : foyers, de fours de cuisson ou hauts-fourneaux mais aussi de zones
ayant subi des incendies.
➢ Des restes très dispersés montreront l’ampleur de la perturbation d’un site.
Ce sont avant tout ces axes que je vais développer. Il convient de préciser que la répartition des
ossements seuls ne fait pas tout et que la synthèse des différentes études permettra de recréer au
mieux le site lors de son occupation.
8.1 Répartition générale
Il s’agit ici de regrouper tous les ossements en fonction de l’unité stratigraphique dans laquelle ils
ont été découverts. Tous les restes ont été pris en compte, indépendamment de leur détermination.
L’inventaire des restes a déjà montré qu’ossements déterminés et indéterminés se mêlaient au sein
du même contexte, à l’exception de cas particuliers dont il sera fait mention.
Les résultats ont été regroupés dans un tableau et classés par nombre croissant d’ossements présents
dans l’unité stratigraphique. Pour plus de lisibilité, une seconde colonne reprend les pourcentages
par rapport au total des ossements du site. Un petit écart est visible entre le total des ossements
présentés sans le tableau ci-dessous et celui présent dans l’inventaire. Cet écart est dû aux lots
illisibles sur les sachets.
56
57
US % du Total
2001 1 0,01%4010 1 0,01%5003 1 0,01%5007 1 0,01%6005 1 0,01%
10007 1 0,01%10009 1 0,01%17017 1 0,01%17027 1 0,01%17030 1 0,01%B4003 1 0,01%B4019 1 0,01%B4028 1 0,01%
1011 2 0,03%7008 2 0,03%7013 2 0,03%
18003 2 0,03%B4017 2 0,03%C4061 2 0,03%
1004 3 0,04%4006 3 0,04%5001 3 0,04%
B10003 3 0,04%1002 4 0,05%1003 4 0,05%4002 4 0,05%6001 4 0,05%
17019 4 0,05%18002 4 0,05%B9002 4 0,05%
C12001 4 0,05%4022 5 0,07%
17001 5 0,07%B4018 5 0,07%10005 6 0,08%17000 6 0,08%17009 6 0,08%B4026 8 0,10%
5008 9 0,12%7009 9 0,12%1006 10 0,13%4023 11 0,14%
17032 11 0,14%7004 12 0,16%6002 15 0,20%
17002 16 0,21%B4022 16 0,21%17024 18 0,24%1008 19 0,25%
Nombre de Restes
B10002 19 0,25%7010 22 0,29%
11002 22 0,29%17012 22 0,29%17008 24 0,31%18001 24 0,31%1007 25 0,33%
17005 25 0,33%17031 29 0,38%17004 30 0,39%17007 33 0,43%17026 34 0,45%5004 37 0,48%7003 51 0,67%
17015 56 0,73%C1006 57 0,75%
5006 62 0,81%6004 72 0,94%1001 74 0,97%7002 75 0,98%1005 84 1,10%1010 84 1,10%
17013 87 1,14%17020 89 1,17%B4031 123 1,61%B4030 153 2,00%17006 192 2,51%17014 232 3,04%5002 257 3,36%
12001 313 4,10%4001 433 5,67%
C10006 562 7,36%B4001 1223 16,01%10003 1341 17,56%C4001 1416 18,54%
Total 7638 100,00%
Tableau 4. Répartition des restes en fonction de l’US
Le tableau montre que les restes sont dispersés au sein de 84 unités stratigraphiques différentes.32
On se rend vite compte que 69 de ces unités contiennent peu d’ossements et participent
individuellement à moins d’1 % du total. Additionnées, ces unités contiennent 13,73 % du total.
Les 12 unités suivantes, dans l’ordre croissant du nombre de restes, participent individuellement à
une valeur située entre 1 % et 8 % des restent totaux et pour 34,16 % une fois additionnés.
Les 3 dernières unités totalisent ensemble le restant – et plus de la moitié - des os du site : 52,11 %.
Ce chiffre se répartit entre les US B4001 (16,01 %), C4001 (18,54%), et 10003 (17,56%).
L’US 10003 a été datée par C14 et est attribuée à La Tène finale, et les US B4001 et C4001 sont
situées au abord du « marchet M1 », lui aussi daté de La Tène finale.
Il est à noter que certains os ayant servi au C14 sont absents de l’inventaire étudié alors qu’ils datent
des fouilles antérieures à 2011. C’est le cas notamment des lots 7007/0001 et B4020/0008. Plus
inquiétant encore, le lot 2007/0003, qui a servi à dater le « marchet M1 », est représenté par un
sachet vide !
Les attributions chronologiques disponibles confirment bien l’appartenance de la majorité des
unités stratigraphiques à La Tène finale. En plus des trois unités précitées, les US C10006, 12001 et
17014, respectivement 4e, 6e et 8e US contenant le nombre le plus important d’ossements ont été
datées de cette période également. A l’inverse, les unités stratigraphiques clairement attribuées à
d’autres époques sont des unités ne contenant que des ossements épars.
Ainsi, les répartitions montrent clairement que les restes osseux sont localisés à quelques fosses
spécifiques, et que la plupart des unités stratigraphiques ne comportent que quelques ossements.
Cela amène à penser que ces rares ossements soient des ossements « oubliés », restés au sol, alors
que les autres étaient jetés dans les fosses, où les fouilleurs les ont mis au jour.
8.2 Répartition des os brûlés
La répartition des os brûlés a montré la concentration de ceux-ci sur quelques unités
stratigraphiques en particulier. On en a mis au jour dans 26 unités, mais en des proportions inégales.
Ainsi on en retrouve principalement dans les US 10003, B4001 et C4001, pour un total de 60,97 %
de l’ensemble des os brûlés du site. Ensuite, on en retrouve un certain nombre dans les US 4001 et
32 La différence du nombre de restes avec le total de 7661 provient de la présence de plusieurs sachets dont les annotations ne sont plus visibles.
58
C10006. Ensuite, les os sont plus disséminés, et certaines US ne contiennent qu’un seul os brûlé.
A priori, l’on pourrait voir là des concentrations intenses dans ces US et y voir des zones de foyer.
Cependant si l’on y regarde de plus près, on peut se rendre compte qu’il s’agit là des mêmes US
dont il a été question dans la répartition générale des ossements. En effet si l’on compare les
ossements contenant des os brûlés par rapport aux nombre d’ossements de leur US, le résultat est
plus nuancé. Il y a une évidente corrélation entre la proportion en os brûlés et la proportion en restes
osseux, brûlés ou non : les trois unités stratigraphiques totalisant le plus de restes sont les mêmes
dans les deux cas, quoi que dans un ordre différent, et les US 4001, C10006 et 17008, riches en
restes, contiennent également un nombre important d’os brûlés. Ainsi s’il y a beaucoup d’os brûlés
dans ces zones, c’est avant tout parce que celles-ci ont révélé beaucoup d’ossements, et la
proportion en os brûlés par rapport au total des ossements n’est pas très importante. Seuls quelques
US s’écartent de ce schéma, mais ce sont des zones contenant un nombre assez faible de restes.
59
US Nbre de Restes Pourcentage total os brûlés4002 1 0,16%4023 1 0,16%
B4026 1 0,16%5008 1 0,16%6002 1 0,16%
B10002 3 0,47%17013 3 0,47%1001 4 0,63%1006 5 0,78%
B4018 5 0,78%7002 5 0,78%7003 5 0,78%
B4030 6 0,94%B4031 6 0,94%
1007 7 1,10%17026 11 1,72%12001 14 2,19%5006 18 2,82%6004 20 3,13%1005 22 3,45%
17008 23 3,61%C10006 37 5,80%
4001 50 7,84%C4001 99 15,52%B4001 117 18,34%10003 173 27,12%
Total 638 100,00%
Tableau 5. Répartition des os brûlés
Ainsi l’US B4018 contient uniquement des os brûlés : 5 esquilles indéterminées. De même l’US
17008 contient 23 os brûlés sur un total de 24 restes. Mais ces cas particuliers sont difficilement
interprétable dans la mesure où le nombre de restes n’est pas assez conséquent pour en tirer de
réelles conclusions.
Concernant les zones à forte concentration, il s’agit sans doute de cendres et de braises jetées dans
les fosses à déchets, ce qui explique le mélange d’ossements brûlés et non-brulés au sein des mêmes
lots.
8.3 Répartition particulières
La répartition de chaque espèce en particulier, afin de mettre en évidence des zones de traitement
spécialisées, ne sera pas détaillée ici car les résultats ne se sont pas montrés pertinents. Le cas des os
60
US NR NR brûlés4002 4 0,05% 1 0,16%
B4018 5 0,07% 5 0,78%B4026 8 0,10% 1 0,16%
5008 9 0,12% 1 0,16%1006 10 0,13% 5 0,78%4023 11 0,14% 1 0,16%6002 15 0,20% 1 0,16%
B10002 19 0,25% 3 0,47%17008 24 0,31% 23 3,61%1007 25 0,33% 7 1,10%
17026 34 0,45% 11 1,72%7003 51 0,67% 5 0,78%5006 62 0,81% 18 2,82%6004 72 0,94% 20 3,13%1001 74 0,97% 4 0,63%7002 75 0,98% 5 0,78%1005 84 1,10% 22 3,45%
17013 87 1,14% 3 0,47%B4031 123 1,61% 6 0,94%B4030 153 2,00% 6 0,94%12001 313 4,10% 14 2,19%4001 433 5,67% 50 7,84%
C10006 562 7,36% 37 5,80%B4001 1223 16,01% 117 18,34%10003 1341 17,56% 173 27,12%C4001 1416 18,54% 99 15,52%
NR % NR brûlés % du total
Tableau 6. Comparaison des proportions entre os brûlés et ossements totaux, par US
brûlés se répète : la concentration en ossements de boeufs, par exemple, dans les US B4001 et
C4001 n’est importante que parce que le total des ossements de cette zone est important lui aussi.
Le seul cas vraiment intéressant est celui de l’US 5002, qui contient 78 % d’os d’ovicaprins par la
présence de l’unique individu juvénile. En dehors de cet individu particulier, la zone est faible en
ossements, peut-être à cause des fouilles du XIXe siècle, étant donné que cette US se rapporte à la
tranchée faite à cette époque.
61
9 Synthèse
9.1 Un site riche, mais mal préservé
Le site d’Olloy-sur-Viroin est un site riche en restes animaux. Le site totalise un nombre
impressionnant de restes osseux, même en ne prenant en compte que les 1393 restes identifiés.
C’est un nombre assez faible en comparaison des grands gisements laténiens de la France du Nord,
tels que Beauvais ou Variscourt, mais il se situe dans un même ordre de grandeur que d’autres sites
bien documentés tels que Gournay-sur-Aronde et Compiègne. Un grand nombre de sites se
contentent de bien moins de restes osseux : plusieurs centaines (Haccourt, Pont-de-Bonne), ou
mêmes dizaines (Orp-le-Grand, Lompret) de restes identifiés! Cela s’explique par les « mauvais
traitements » faits aux ossements, dès les premiers instants suivant leur utilisation : fragmentation
lors de l’abattage et dépeçage d’un animal, de la préparation, de la consommation, mais aussi sous
les dents des chiens, des porcs et des carnivores qui fouillent les déchets humains. Une fois enfoui,
les conditions extrêmes ne cessent pas, car à la décomposition des parties organiques s’additionne le
poids des sédiments et d’autres paramètres physiques et chimiques dépendant de l’humidité, des
bactéries, etc. C’est pourquoi le site d’Olloy-sur-Viroin revêt une importance particulière.
Cependant, le grand nombre de restes déterminés ne doit pas nous faire oublier les 85 % de restes
non-identifiés, beaucoup trop fragmentés pour en tirer une quelconque information d’ordre
archéozoologique, bien qu’ils représentent une bien moindre proportion en terme de volume et de
masse.
9.2 Un spectre faunique diversifié, dominé par le « quatuor néolithique »
Si on ne prend en compte que les espèces liées à l’occupation humaine et non intrusifs, à savoir en
écartant la microfaune, la malacofaune, l’avifaune de petite taille et le lapin, le site d’Olloy-sur-
Viroin a révélé 10 espèces différentes en plus de l’avifaune de grande taille, non différenciée :
62
On retrouve en tête du nombre d’éléments le « quatuor néolithique », c’est-à-dire bœuf, porc,
mouton et chèvre (même s’ils sont ici regroupés), suivi du cheval et du chien. Il s’agit
majoritairement d’animaux abattus jeunes dont la croissance n’est pas achevée.
Il est intéressant de noter qu’il est possible de tracer une démarcation entre les effectifs du chien et
du cerf, avec d’une part les espèces d’élevage, plus nombreux, et d’autre part les espèces chassées,
en nombre plus restreint. Cette prédominance du porc avait déjà été mise en évidence par Achilles
Gautier dans le sondage de 1979 (GAUTIER, 1981, p. 53, in : WARMENBOL & DOYEN, 1981).
Elle est constante à travers l’âge du Fer (Variscourt, Beauvais, Dompierre-sur-Authie, Pont-de-
Bonne, etc.), bien que parfois ce soient les ovicaprins qui prédominent (Fontaine-notre-Dame,
Gournay-sur-Aronde (occupation Tène finale), Haccourt). Le bœuf est le moins présent à Olloy-sur-
Viroin, comme il l’est sur d’autres sites (Vimy, Compiègne, Haccourt), bien qu’il puisse être
majoritaire (Gournay-sur-Aronde (occupation Tène moyenne), Meldert, Villeneuve-d’Ascq-les-
Près). Aucune corrélation n’existe entre les types de site et la présence préférentielle d’une espèce.
Seuls les sanctuaires semblent contenir préférentiellement du porc : c’est le cas à Bennecourt ou
Ribemont (près de 80 % des restes), et dans une moindre mesure à Dompierre-sur-Authie (62 % des
restes), et pourtant le sanctuaire de Gournay-sur-Aronde contient en majorité de l’ovicaprin, loin
devant le porc. Il est plus probable que les variations soient dues à des facteurs locaux, dépendant
de l’aire de captage (GAUTIER, 1990 (b), p. 204) et de l’environnement immédiat du site. Les
espèces sauvages tiennent un rôle mineur, et même négligeable : le cerf ne représente qu’1 % des
éléments identifiés, et les autres espèces sont encore en dessous de ce chiffre.
63
Avifaune 5 0,51% 2 4,44%Renard 8 0,81% 1 2,22%Chevreuil 8 0,81% 1 2,22%Cerf 10 1,02% 2 4,44%Chien 22 2,23% 2 4,44%Cheval 48 4,87% 3 6,67%Bœuf 123 12,49% 4 8,89%
294 29,85% 9 20,00%Porc 462 46,90% 19 42,22%
Total 985 100,00% 45 100,00%
Tableau 7. Récapitulatif des espèces non-intrusives
Ovicaprins
9.3 Des animaux élevés, mais pas nécessairement consommés : les limites
d’interprétation des « cutmarks »
Si la consommation du porc, des ovicaprins et du bœuf ne fait aucun doute de par leur nombre, mais
aussi par la mise en évidence de traces de boucherie et de fracturation sur certains de leurs restes, il
en est tout autre du cheval et du chien. D’une part parce qu’aucun des ossements identifiés n’a
présenté de marques anthropiques et d’autre part parce que leurs restes sont trop peu nombreux pour
être un élément important des stratégies d’alimentation.
La consommation de la viande de chien ainsi que le travail de sa peau ont été attestés sur d’autres
sites (MENIEL, 1987, p. 29), mais rien ne dit que ce comportement est systématique. Le tannage
n’est pas davantage attesté à Olloy-sur-Viroin, en l’absence de concentrations d’ossements de chien.
L’hippophagie a quant à elle divisé les auteurs. Au début du XXe siècle, Salomon Reinach
interprétait un passage de la « Guerre des Gaules » décrivant Vercingétorix renvoyant la cavalerie
lors du siège d’Alésia comme un signe de non-consommation de la viande de cheval, sans quoi il
aurait été plus avisé de garder les chevaux à l’intérieur des murs afin qu’ils servent de réserve de
nourriture33(ARBOGAST et al., 2002, p. 55). Depuis, les connaissances ont évolué et nous savons
aujourd’hui que le cheval était consommé, mais les avis divergent encore, certains pensant voir une
consommation systématique, bien que moins importante que celle du « quatuor néolithique »
(MENIEL, 1987, pp. 40, 43-45) tandis que d’autres la voient plutôt comme occasionnelle
(GAUTIER, 1990 (b), p. 204).
A Olloy-sur-Viroin, aucune trace de découpe n’a été découverte sur les restes équins. C’est plutôt
les restes d’individus jeunes qui indique un abattage précoce, où le rendement en viande est
optimal. C’est le cas ici, où plusieurs ossements se sont avérés provenir de jeunes individus, entre 1
et 4 ans, âge auquel les chevaux atteignent leur poids maximal (ARBOGAST et al. 2002, p. 57). En
outre, l’extrême fragmentation des restes de chevaux mis au jour est cohérente avec une
consommation.
On touche ici à la limite de l’interprétation des traces de boucherie. La présence de marques de
découpe ne prouve pas la consommation d’un animal. Elles peuvent être des marques liées à
l’écorchement si elles se situent aux extrémités. Elles peuvent également être la preuve de
désossages non-liés à la consommation, mais à l’équarrissage des carcasses. Inversement, leur
33 CESAR, La Guerre des Gaules, Livre 7,71. Les passages tradtuis sont situés en annexe.
64
absence ne signifie aucunement que l’animal n’a pas été consommé. D’une part parce que l’os
portant la marque peut avoir été fracturé, concassé ou non-conservé, d’autre part parce que leur
surface a été trop altérée par des phénomènes physiques ou chimiques et que la marque n’a pas été
conservée. Ensuite, la viande peut être détachée sans qu’aucune marque ne soit visible, si le boucher
n’entame pas l’os. Dans le cas d’une cuisson à l’eau, la viande se détachera d’elle-même.
9.4 La chasse, une activité marginale
Toutes les données archéozoologiques à notre disposition, à Olloy-sur-Viroin ou ailleurs, nous
confirment que les Celtes n’étaient pas des chasseurs de sangliers, malgré tout ce que les idées
reçues ont bien pu véhiculer, et ce jusqu’à nos jours par l’intermédiaire d’une bande dessinée au
succès bien connu. Cette vision est peut être issue d’une mauvaise interprétation des sources
antiques, en particulier Strabon qui dépeignait des porcs énormes, dangereux et sauvages, qui
devaient être différents de ceux qu’il connaissait34. La vérité est toute autre. Le sanglier est presque
absent de la documentation archéozoologique de l’âge du fer et quand il est présent, il est tellement
rare que son signal se perd complètement dans les statistiques, comme à Beauvais ou Variscourt où
il contribue pour 0,01 % du total (GILSON, 2008, p. 21 ; GAUTIER, 1990 (b), pp . 200-201 ;
MENIEL, 1984, p. 14). Les Celtes lui préfèrent le cerf, le chevreuil et le lièvre, régulièrement
présents quoi qu’en faible nombre, et Olloy-sur-Viroin nous en donne un bel exemple. Si l’on
additionne les espèces sauvages chassées par l’Homme35, ils ne représentent que 3,66 % des
éléments.
Le statut sauvage de l’avifaune fait toujours débat, entre autres à cause de la sous-représentation de
leur reste due à la conservation différentielle. La littérature archéozoologique ne tranche pas sur leur
statut. Les modifications morphologiques ne permettent pas de différencier l’animal sauvage de
l’animal domestiqué, plaidant au mieux pour une domestication récente. La faible proportion
d’oiseaux sur les sites de l’Âge du Fer a amené à penser que leur élevage était dû à des motifs
religieux, sans consommation. Dans la « Guerre des Gaules », il est effectivement fait mention
d’élevages d’oies bretons, dont la consommation était taboue36, et nous connaissons la place qu’ont
les oiseaux aquatiques dans l’art celtique. L’identification d’une coquille d’œuf ne nous aide pas
34 STRABON, Géographie Livre 4,4,3. Les passages traduits sont situés en annexe.35 En écartant donc toujours la malacofaune, l’avifaune de petite taille, la microfaune et le lapin.36 CESAR, La Guerre des Gaules, Livre 5,16. Les passages traduits sont situés en annexe.
65
davantage, car l’acquisition d’œufs peut se faire à la source, dans le nid des animaux.
Les espèces sauvages ne devaient pas toutes être consommées. Le renard (si tant est qu’il soit
effectivement présent) ainsi que le chat devaient plutôt avoir été utilisés pour leur fourrure.
Le faible effectif d’animaux chassés confirme que la chasse a perdu toute son importance dans les
stratégies d’alimentation. Elle ne serait dès lors plus qu’une activité ponctuelle, non-organisée. Les
espèces présentes le confirment : les cervidés sont des animaux de lisière et non de forêts profondes,
et le lièvre est un animal d’espaces ouverts, tels les champs, mais il pouvait aussi s’aventurer aux
abords des occupations humaines et en faire les frais. Quant au renard, c’est un animal opportuniste
qui devait profiter de la présence des commensaux. Cela expliquerait également l’absence du
sanglier qui est un animal des forêts, où il ne côtoie que rarement l’Homme.
9.5 Les autres ressources animales
L’alimentation n’est pas le seul but dans lequel les animaux peuvent être utilisés. La fourrure a été
citée, mais la fabrication de cuir devait également battre son plein. L’utilité du bétail devenait ainsi
double. La présence de traces de boucherie sur des parties comme les phalanges, les métapodes ou
les basipodes pourrait en être la confirmation. Dans le cas des animaux sauvages, c’est justement la
présence de ces parties sur le site qui plaide en faveur de la présence du renard plutôt qu’en celui
d’un chien de petite taille, dont on aurait retrouvé plus d’éléments.
La production de lait devait également faire partie du quotidien des habitants de l’éperon tronqué,
au vu de l’importante présence de bovidés. Malheureusement l’étude n’a pas permis de déterminer
les sexes des individus, auquel cas la présence de femelles âgées aurait été un indice vers la
production de lait.
La production de laine n’est également pas à négliger. Celle-ci ne peut pas être mise en évidence par
des méthodes ostéologiques, mais par la mise au jour d’outils de tissage ou de forces pour la tonte,
quoi que le simple arrachage soit également de mise (MENIEL, 1987, p. 80).
Le façonnage d’outils n’est pas à exclure. Il y a peu d’espoir de jamais retrouver des objets en
cornes, mais l’os devait également être travaillé, comme la fracturation de certains ossements peut
le suggérer. Seule la mise au jour d’objets finis ou de marques liées au façonnage permettra de
définitivement trancher la question.
Enfin, une ressource à ne pas négliger mais pourtant de première importance, est la force de travail.
66
Celle-ci se met en évidence par la mise au jour d’éléments de harnachement ou de mors pour les
chevaux. Au niveau osseux, seules des déformations ou des fractures de stress, absentes sur les os
d’Olloy-sur-Viroin, permettent d’observer l’exploitation de la force d’un animal. Mais à l’époque
qui nous concerne, l’utilisation du bétail de grande taille, à savoir le cheval et le boeuf, ne fait aucun
doute. Ils peuvent servir au travail des champs, bien entendu, mais également comme bête de
somme et moyen de transport. Les animaux plus âgés d’Olloy-sur-Viroin devaient être de ceux-là.
9.6 Et le poisson ?
Il est tout aussi intéressant d’évoquer, en plus de ce que contient un site, ce qu’il ne contient pas.
Aucun reste de poisson n’a été identifié à Olloy-sur-Viroin. Cet état de fait semble s’appliquer à
tous les sites, à l’exception de rares restes : 4 restes de poisson d’eau douce à Pont-à-Chin, 1 reste
de poisson de mer à Bray-Dunes et une vertèbre de brochet (Esox Lucius) à Pont-de-Bonne,
probablement récent.
C’est d’autant plus étonnant que la fortification, comme nombre d’autres sites du même type,
surmonte une rivière, qui devait être plus poissonneuse à l’époque qu’elle ne l’est aujourd’hui. En
outre, le gibier d’eau est attesté sur plusieurs sites : Beauvais (Castor (Castor fiber)), Villers-Saint-
Paul (Loutre (Lutra lutra), Héron (Aerda sp.)), bien qu’en nombre restreint également. Il serait
étonnant que le poisson ait ainsi été négligé.
Cette absence tient sans doute plus de la taphonomie et de la méthode de fouille plutôt que de
l’absence réelle de consommation de poisson. Les os de poisson constituant un squelette sont bien
plus nombeux que ceux des mammifères ou des oiseaux, mais aussi plus petits, et on en
conséquence le plus à souffrir de la conservation différentielle. En outre, sur les sites
archéologiques non-tamisés, ce qui est en partie le cas ici, ces petits ossements ont de grandes
chances de passer inaperçu, peu importe l’implication du fouilleur.
9.7 Perspectives de recherches futures
Je vais aborder ici certains points nécessitant une étude ultérieure et qui n’ont pas été rendus
possibles ici. La plupart nécessitent des techniques physico-chimiques et dépendent d’un tout autre
67
domaine que l’archéozoologie.
➢ La datation du crâne de chat (5008/0007) ainsi que du jeune ovicaprin (5002/0001,
5002/0002 et 5004/0003), soit par datation directe au C14, ou, faute de mieux, en fonction
de l’attribution culturelle de l’US. Cela permettra de définitivement lever le voile de
l’incertitude quant à leur origine, écartant leur possible origine moderne
➢ Il serait utile de faire une analyse tracéologique des marques laissées sur les ossements, afin
de confirmer leur origine anthropique, et également, si la conservation le permet, de
déterminer le type d’outils ayant causé les marques.
➢ Les restes d’avifaune, de microfaune et de malacofaune devront être confiés à un spécialiste
afin que la détermination du site soit complète.
➢ Les os brûlés devraient faire l’objet d’une étude cristallographique afin de déterminer la
température à laquelle ils ont été chauffés. De très hautes températures pourraient mettre en
évidence des ossements brûlés dans des zones d’artisanat comme les hauts-fourneaux ou des
fours de potier.
➢ Enfin, un marquage ou l’étiquetage des ossements permettra une plus grande liberté dans
leur manipulation, et permettra d’opérer des remontages entre différents lots, mettant ainsi
en évidence la dispersion d’ossements initialement complets, mais aussi les éventuelles
perturbations si certains ossements venant d’unités stratigraphiques d’époques distinctes
venaient à s’assembler.
68
10 Conclusion
Le site d’Olloy-sur-Viroin s’est révélé être un site fascinant, non seulement dans la composition de
ses restes, mais également dans les problématiques taphonomiques qu’il soulève. Il a fait preuve
d’une certaine richesse en ossements, et ce malgré une intense fragmentation qui a rendu
l’identification difficile et laissé un grand nombre de restes indéterminés, quoique ceux-ci soient
majoritairement de petite taille. La grande difficulté réside dans l’attribution chronologique et
culturelle des restes, rendue malaisée par la forte érosion du site. La grande proportion d’ossements
issus de La Tène n’a pas permis de dresser une évolution des stratégies alimentaires au sein du site,
mais a permis un compte-rendu assez fin des habitudes de la fin de l’Âge du Fer. Les quelques
découvertes inhabituelles, telles que le crâne de chat et le jeune ovicaprin presque complet
nécessitent la plus grande attention et permettront de mieux connaître le rapport entre ces animaux
et l’Homme dans la région.
Les interprétations présentées ici sont susceptibles de changer dans un futur proche, avec l’étude
des campagnes suivantes, qui apporteront leur lot de nouvelles informations. Il faut espérer la mise
au jour d’ossements complets, qui permettraient de déterminer avec plus de précision la taille de
animaux, plutôt que de s’en tenir à la simple constatation qu’ils sont de petite taille. Les restes de
canidés ainsi que ceux d’oiseaux revêtent également une grande importance, et davantage de restes
permettraient de trancher plus définitivement la question de la présence du renard et de la
domestication de certains oiseaux.
En conclusion, malgré les risques de perturbations des couches et les attributions chronologiques
parfois sujettes à débat, il faut considérer le site d’Olloy-sur-Viroin comme un site de référence en
matière d’archéozoologie de l’Âge du Fer en Belgique, permettant une analyse statistique pertinente
du fait du nombre de restes, chose qui manque aux autres sites de la région.
69
11 Bibliographie
Ouvrages pratiques et méthodologiques
➢ BARONE, Anatomie comparée des mammifères domestiques, Tome 1 : Ostéologie, Paris,
1976
➢ CHAIX & MENIEL, Archéozoologie : Les animaux et l’archéologie, éditions Errance,
Paris, 2001
➢ CORNWALL, Bones for the Archaeologist, Londres, 1956
➢ DJINDJIAN, L’analyse spatiale de l’habitat pré- ou protohistorique : Perspectives et limites
des méthodes actuelles, in : Espaces physiques espaces sociaux dans l’analyse interne des
sites du Néolithique à l’Âge du Fer, 119e Congrès CTHS, Amiens, 1994, pp. 13-21
➢ MILLER, Catalogue of the Mammals of Western Europe, New York, 1966 (2e édition)
➢ MENIEL, L’Apport des restes animaux à l’analyse spatiale des sites fossoyés du Second
Âge du Fer, in : Espaces physiques espaces sociaux dans l’analyse interne des sites du
Néolithique à l’Âge du Fer, 119e Congrès CTHS, Amiens, 1994, pp. 89-99
➢ SCHMID, Atlas of Animal Bones for Prehistorians, Archaeologists and Quaternary
Geologists, 1972
➢ VON DEN DRIESCH, A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological
Sites, Peabody Museum Bulletin, Harvard University, 1976
Os brûlés
➢ PERINET, Etude cristallographique des ossements brûlés de la cabane acheuléenne du
Lazaret, in : DE LUMLEY, Une cabane acheuléenne dans la Grotte du Lazaret, 1969, pp.
143-144
➢ STINER, KUHN, WEINER & BAR-YOSEF, Differential Burning, Recrystallization, and
Fragmentation of Archaeological Bone, in : Journal of Archeological Science 22, 1994, pp.
223-237
➢ THERY-PARISOT & COSTAMAGNO, Propriétés combustibles des ossements : données
expérimentales et réflexions archéologiques sur leur emploi dans les sites paléolithiques, in :
Gallia préhistoire, Tome 47, 2005, pp. 235-254
70
Olloy-sur-Viroin
➢ DOYEN & WARMENBOL , La fortification protohistorique d’Olloy-sur-Viroin, publication
du club archéologique Amphora vol. XI, Bruxelles, 1981
➢ WARMENBOL & PLEUGER, La fortification protohistorique d’Olloy-sur-Viroin 2005 [en
ligne]. http://www.archeolib.com/3-013-publications-rapports.php
➢ WARMENBOL & PLEUGER, La fortification protohistorique d’Olloy-sur-Viroin 2006 ]en
ligne]. http://www.archeolib.com/3-014-publications-rapports.php
➢ WARMENBOL, PLEUGER & DEHOGNE, La fortification protohistorique et le site
néolithique d’Olloy-sur-Viroin 2007 [en ligne]. http://www.archeolib.com/3-015-
publications-rapports.php
➢ WARMENBOL & PLEUGER, La fortification protohistorique et le site néolithique d’Olloy-
sur-Viroin 2009 (a) [en ligne]. http://www.archeolib.com/3-016-publications-rapports.php
➢ WARMENBOL & PLEUGER, Viroinval/Olloy-sur-Viroin : fouilles 2007 sur la fortification
protohistorique du « Plateau des Cinques » in : Chroniques de l’archéologie Wallonne 16,
2009 (b), pp. 197-199
➢ WARMENBOL & PLEUGER, Viroinval/Olloy-sur-Viroin : fouilles 2008 sur la fortification
protohistorique du « Plateau des Cinques », in : Chroniques de l’archéologie Wallonne 17,
2010, pp. 187-188
➢ WARMENBOL & PLEUGER, La fortification protohistorique du « Plateau des Cinques » à
Olloy-sur-Viroin : bilan 2004-2014 (en ligne)
Autres
➢ ARBOGAST, MENIEL & YVINEC, Une histoire de l’élévage, éditions Errance, Paris, 1987
➢ ARBOGAST, CLAVEL, LEPETZ, MENIEL & YVINEC, Archéologie du cheval, éditions
Errance, Paris, 2002
➢ ARMAND-CALLIAT, Une stèle de Montceau-les-Mines montrant un chat domestique, in :
Gallia. Tome 11, 1953. pp. 85-89
➢ BRELURUT, PINGARD & THERIEZ, Le cerf et son élevage: alimentation, techniques et
pathologie, Paris, 1990
➢ EISENMANN, Les Equidés, in : Les Animaux de la Préhistoire entre Provence et Toscane,
II , pp. 74-77, Avignon, 1992
➢ EISENMANN, La domestication du cheval : nouvelles découvertes, nouvelles approches,
23ème journée de recherche équine, Paris, 1997, pp. 79-86
71
➢ FSSE (Fédération suisse de sport équestre), Réglement Général, édition 2007
➢ GAUTIER, La domestication : Et l’homme créa ses animaux, éditions Errance, Paris, 1990
(a)
➢ GAUTIER, A., Hommes et animaux pendant l’Âge du Fer » in LEMAN-DELERIVE (éd.),
« Les Celtes en France du Nord et en Belgique, VIe- Ier avant J.-C., Bruxelles, 1990 (b)
➢ GAUTIER, Les restes d’animaux du quartier gallo-romain de Margeroux à Saint-Mard
(Virton), in : Etudes et documents : Fouilles 1 : un quartier de l’agglomération Gallo-
Romaine de Saint-Mard (Virton), Namur, 1994, pp.117-126
➢ GILSON, Étude archéozoologique de l’Éperon barré, au lieu dit (sic) « Le Rocher du Vieux
Château », à Pont-de-Bonne, Liège, 2009
➢ GOURICHON, Faune et saisonnalité : l’organisation temporelle des activités de subsistance
de l’Epipaléolithique et le Néolithique précéramique du Levant nord (Syrie), Lyon, 2004
➢ LÓPEZ BAYÓN, Étude archéozoologique du gisement de Haccourt (âge du fer), in :
Bulletin des Chercheurs de la Wallonie, XXXVII, 1997, pp.175-185
➢ MENIEL, Contribution à l’histoire de l’élevage en Picardie, du Néolithique à l’Age du Fer,
Revue Archéologique de Picardie (numéro spécial), 1984
➢ MENIEL, Chasse et élevage chez les Gaulois, éditions Errance, Paris, 1987
➢ TRESSET & VIGNE, Substitution of species, techniques and symbols at the
Mesolithic/Neolithic transition in Western Europe, in : WHITTLE & CUMMINGS (éd.),
Going over: the Mesolithic/Neolithic transition in NW Europe, Proceedings of the British
Academy 144, Londres, 2007, pp. 189−-210.
➢ TRESSET, BOLLONGINO, EDWARDS, HUGHES & VIGNE, Early diffusion of domestic
bovids in Europe: an indicator for human contacts, exchanges and migrations?, in :
HOMBERT & D'ERRICO (dir.), Becoming Eloquent : Advances in the Emergence of
Language, Human Cognition, and Modern Cultures. Benjamins Publishing Company,
Amsterdam, 2009, pp. 73−92
Sources antiques
➢ CESAR, La Guerre des Gaules, Collection des Auteurs latins publiés sous la direction de
M. NISARD, Paris, 1865
➢ STRABON, Géographie, traduction nouvelle par Amédée Tardieu, Paris, 1867
72
➢ PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, traduction en français par Émile Littré, Collection
des Auteurs latins publiée sous la direction de M. Nisard, Paris, 1855
73
12 Tables des matières : Vol. 1
1 Introduction......................................................................................................................................4 2 Le « Plateau des Cinques » et l’« Oppidum d’Olloy-sur-Viroin »...................................................5
2.1 Présentation du site ..................................................................................................................5 2.2 Historique des fouilles .............................................................................................................6 2.3 Chronologie du site...................................................................................................................7
3 Cadre de l’étude et méthodologie de travail.....................................................................................9 4 Détermination des restes.................................................................................................................11
4.1 Introduction.............................................................................................................................11 4.2 Identification des restes..........................................................................................................12
4.2.1 Avifaune..........................................................................................................................12 4.2.2 Bos (Bos primigenius, Bos primigenius f. taurus)..........................................................14 4.2.3 Canidés (Canis lupus lupus, Canis lupus familiaris, Vulpes vulpes)..............................17 4.2.4 Cervidés (Capreolus capreolus, Cervus elaphus)............................................................21 4.2.5 Equus (Equus ferus, Equus ferus caballus).....................................................................22 4.2.6 Felis (Felis silvestris, Felis silvestris cattus)...................................................................24 4.2.7 Homo (Homo sapiens)....................................................................................................28 4.2.8 Léporidés (Lepus europaeus, Oryctolagus cuniculus)....................................................28 4.2.9 Malacofaune....................................................................................................................29 4.2.10 Microfaune....................................................................................................................29 4.2.11 Ovicaprins (Ovis aries, Capra hircus)...........................................................................30 4.2.12 Sus (Sus scrofa, Sus scrofa f. domestica)......................................................................34 4.2.13 Les ossements indéterminés..........................................................................................37
5 Âge d’abattage................................................................................................................................43 5.1 Problématique.........................................................................................................................43 5.2 Détermination des âges d’abattage.........................................................................................43
5.2.1 Avifaune..........................................................................................................................43 5.2.2 Bos..................................................................................................................................44 5.2.3 Canidés............................................................................................................................44 5.2.4 Cervidés..........................................................................................................................44 5.2.5 Equus...............................................................................................................................44 5.2.6 Felis.................................................................................................................................45 5.2.7 Lepus...............................................................................................................................45 5.2.8 Ovicaprins.......................................................................................................................45 5.2.9 Sus...................................................................................................................................46
6 Les ossements brûlés......................................................................................................................47 6.1 L’os en tant que combustible..................................................................................................47 6.2 L’influence du feu sur les ossements et sa conséquence en archéologie................................48 6.3 Les os brûlés d’Olloy-sur-Viroin............................................................................................49
7 Les traces anthropiques..................................................................................................................52 7.1 Quand le geste humain se lit sur l’os......................................................................................52 7.2 Description..............................................................................................................................53
7.2.1 Traces de boucherie.........................................................................................................53 7.2.2 Percussion et fracturation................................................................................................54
8 Répartition spatiale.........................................................................................................................56 8.1 Répartition générale................................................................................................................56
74
8.2 Répartition des os brûlés.........................................................................................................58 8.3 Répartition particulières..........................................................................................................60
9 Synthèse..........................................................................................................................................62 9.1 Un site riche, mais mal préservé.............................................................................................62 9.2 Un spectre faunique diversifié, dominé par le « quatuor néolithique »..................................62 9.3 Des animaux élevés, mais pas nécessairement consommés : les limites d’interprétation des « cutmarks »...................................................................................................................................64 9.4 La chasse, une activité marginale...........................................................................................65 9.5 Les autres ressources animales...............................................................................................66 9.6 Et le poisson ?.........................................................................................................................67 9.7 Perspectives de recherches futures.........................................................................................67
10 Conclusion....................................................................................................................................69 11 Bibliographie................................................................................................................................70 12 Tables des matières : Vol. 1..........................................................................................................74
75