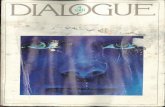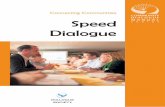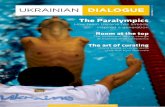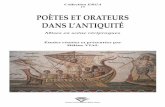Dialogue des devises et devises en dialogue à l’occasion des premières Guerres d’Italie
-
Upload
paris4-sorbonne -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Dialogue des devises et devises en dialogue à l’occasion des premières Guerres d’Italie
�
Dialogue des devises et devises en dialogue à l’occasion des premières Guerres d’Italie
Laurent Vissière
« sire, fet li vavassors, n’avez vos point d’escu� ? »
À la fin du XVe siècle, quand débutèrent les premières Guerres d’italie, la mode des devises existait depuis longtemps dans les cours européennes. Mais elle semble avoir alors brillé d’un éclat particulier, dont témoignent assez tardivement les premiers recueils de devises chevaleresques – les Devises héroïques et emblèmes de Claude Paradin �, et le Dialogo dell’imprese militari et amorose… de Paolo Giovio (tous deux datés de �55�) �. Le succès euro-péen de ces ouvrages, du second en particulier, marqua l’apothéose de cette mode, mais tendit également à figer l’art de la devise et à en faire un jeu savant ou, pour mieux dire, un parfait exercice de cuistre. en théorisant l’art de la devise, Giovio allait en effet imposer quelques règles jugées essentielles, comme, par exemple, le rapport juste entre l’âme et le corps – toute bonne devise se composerait ainsi de deux parties : une sentence et une figure devant réciproquement s’éclairer.
�. La Mort du Roi Arthur, éd. e. Baumgartner et M.-T. de Medeiros, Paris, �007, i, 7 (p. 58).�. Claude Paradin, Devises heroïques, Lyon, �55�. L’édition la plus intéressante reste cependant
celle, commentée et augmentée par François d’amboise (Devises héroïques et emblèmes de M. Claude Paradin, Paris, �57�), qui sera, sauf mention contraire, notre référence pour le présent article.
�. Paolo GioVio, Dialogo dell’imprese militari e amorose, éd. M. L. doglio, rome, �978. achevé au cours de l’été �55�, l’ouvrage ne fut publié qu’en octobre �555, à rome. La première édition illus-trée (Lyon, �559) a été reproduite en fac-similé : The Worthy Tract of Paulus Iovius, translated by Samuel Daniel, together with Giovio’s Dialogo dell’Imprese Militari et Amorose, textes présentés par n. K. Farmer Jr., new York, �976. sur l’histoire du texte, a. noVa, « dialogo dell’imprese : la storia editoriale e le immagini », Paolo Giovio, il Rinascimento e la memoria, Actes du colloque de Côme (3-5 juin 1983), Côme, �985, p. 7�-9�. sur le personnage lui-même, T. C. PriCe ZiMMerMann, Paolo Giovio, The Historian and the Crisis of Sixteenth-Century Italy, Princeton, �995.
LAuRenT vISSIèRe
�
Paolo Giovio peut cependant passer pour le « Vasari de la devise » : son traité propose en effet un exceptionnel catalogue des devises au temps des Guerres d’italie. L’humaniste affirme bien avoir observé de visu la plupart des devises qu’il décrit, ce qui donne encore plus de prix à son témoignage. Malheureusement, le Dialogue est aussi rempli de préjugés, d’a priori et d’ana-chronismes, qui en faussent la lecture, car Giovio manque de profondeur historique : il ignore tout de la genèse de ces devises, n’en connaît somme toute que la signification immédiate et, ce qui s’avère plus gênant, cherche à les comprendre en appliquant ses propres règles de manière rétrospective.
il ne s’agit pas ici d’entreprendre une nouvelle et ambitieuse théorisation de la devise, mais d’offrir quelques réflexions sur cet art, tel qu’on pouvait le percevoir des deux côtés des alpes, à la charnière des XVe et XVie siècles. on n’évoquera en fait que les devises chevaleresques et politiques, celles qui font le plus sens, car, à l’occasion des premières Guerres d’italie, les aristocraties française et italienne dialoguèrent par l’intermédiaire de belles images et de bons mots : les devises, loin d’être un jeu futile, participèrent aux échanges culturels et politiques qui liaient alors les deux pays par des rapports de fascination, de rivalité et de haine.
La devise héroïque au miroir de l’Italie
Parler des devises françaises dans le cadre des Guerres d’italie permet de revenir d’emblée sur le problème méconnu des modes et des influences françaises outre-monts dans la première moitié du XVie siècle. on ne peut en effet parler des images sans savoir ce qu’elles reflètent et représentent.
Traumatisme italien et mode française
Les interventions militaires françaises qui débutèrent à la fin du XVe siècle, avec le Voyage de naples en �494, et la conquête de Milan en �499, ont profondément perturbé les contemporains. Guicciardini et Machiavel, notamment, allaient s’interroger sur la ruine subite des puissances de la Péninsule – comment l’italie avait-elle été si facilement transformée en champ de bataille par les grands États européens ?
À lire les humanistes italiens, les Français servent de boucs émissaires. Violents et mal dégrossis, ils ont saccagé l’italie avant de s’incliner devant les rusés espagnols 4… Ces stéréotypes, qui ont la vie dure, ne doivent pas masquer une autre réalité tout aussi importante : le prestige de la culture chevaleresque française dans les cours italiennes, en particulier à Florence,
4. M. sMiTh, « Émulation guerrière et stéréotypes nationaux dans les Guerres d’italie », Les Guerres d’Italie. Histoire, pratiques, représentations, Actes du colloque international de Paris (9-11 décembre 1999), d. Boillet, M.-F. Piéjus (dir.), Paris, �00�, p. �55-�76.
DIALoGue DeS DevISeS eT DevISeS en DIALoGue…
�
à naples, à Ferrare et à Milan 5. À partir de �494, les armées royales, très chamarrées, qui parcouraient la Péninsule, fascinèrent les italiens. dès l’automne �499, à l’occasion de la première conquête de Milan, on vit des seigneurs italiens « s’habiller à la française 6 ». Pendant une vingtaine d’années, les Français occupèrent la Lombardie et, s’ils montrèrent beaucoup de goût pour les modes locales, ils acclimatèrent aussi sur place les modes de France – au moins chez les élites 7. Contrairement à ce que l’on répète trop volontiers, les flux culturels et artistiques ne furent jamais à sens unique.
Devises et parade
Cette question de la mode permet de mieux appréhender le discours de Paolo Giovio. Le Dialogue s’ouvre en effet sur un souvenir de jeunesse, un souvenir émerveillé :
« À notre époque, après la venue du roi Charles Viii et de Louis Xii en italie, tous ceux qui suivaient le métier des armes, imitant les capitaines français, cherchèrent à s’orner de belles et pompeuses devises, avec lesquel-les resplendissaient les chevaliers, répartis compagnie par compagnie, avec diverses livrées, parce qu’ils brodaient d’argent doré au marteau les sayons et les casaques, et sur la poitrine comme sur le dos, étaient les devises des capitaines, en sorte que les montres des gens d’armes faisaient un spectacle très pompeux et très riche, et dans les batailles, on connaissait l’ardeur et le comportement des compagnies 8. »
Qu’a-t-on retenu de ce texte ? Que les italiens auraient découvert l’art de la devise en observant les troupes françaises. absurde. dès la fin du
5. L’influence de cette culture française variait sans doute assez considérablement selon les zones géogra-phiques. Le royaume de naples demeurait le plus proche de la France par ses origines normandes et angevines. Florence entretenait des rapports plus ambigus, mais que Louis Xi avait revivifiés. Quant aux cours princières d’italie du nord, elles manifestaient un goût très ancien pour la culture chevaleresque d’outre-monts.
6. Francesco Gonzaga, marquis de Mantoue, découvrit avec stupeur la francisation du clan Trivulce au service du roi, qu’il décrivit ainsi à sa femme isabelle d’este : Arivati che fussimo hozi al’hostaria per disnare a Piasenza, ne vene a visitare uno nepote dil Signore Jo. Jacobo da Triultio, gubernatore di quella cita et dipoi ne accompagnò dal’hostaria per tutta la terra fino di fuora molto amorevolmente ; et un altro nepote dil predicto Signore, per nome M. Ambroso da Triultio, gubernatore di questa cita, n’è venuto in contra piu de uno miglio cum certi zentilhomini a riceverce et accompagnarne fino a lo allogiamento cum grande dimonstratione di amore et riverentia. Dicti gubernatori hanno habito et chiera de Francesi et parlano in parte a quella guisa, quasi como fusseno di quello paese (Lodi, �7 septembre �499. Mantoue, arch. Gonzaga, �908, lib. �6�, ff. �7 r°-�8 r°.) La mode française exprimait évidemment en l’occur-rence une appartenance politique.
7. o. renaudeau, « Le costume français à la renaissance : italianisme ou internationalisme ? », De l’Italie à Chambord. François Ier et la chevauchée des princes français, C. arminjon, M. Chatenet (dir.), Paris, �004, p. �09-���.
8. A questi nostri tempi, dopo la venuta del re Carlo vIII e di Lodovico XII in Italia, ognuno che seguitava la milizia, imitando i capitani francesi, cercò di adonarsi di belle e pompose imprese, delle quali rilucevano i cavalieri, appartati compagnia da compagnia con diverse livree, perciò che ricamavano d’argento, dil martel dorato i saioni e le sopraveste, e nel petto e nella schiena stavano l’imprese de’capitani, di modo che le mostre delle genti d’arme facevano pomposissimo e ricchissimo spettacolo, e nelle battaglie si conosceva l’ardire e il portamento delle compagnie (P. GioVio, Dialogo…, p. �6-�7).
LAuRenT vISSIèRe
4
XiVe siècle, cet art courtois fleurissait dans toutes les cours européennes, y compris en italie. Comment Giovio aurait-il pu l’ignorer ? en fait, son texte confirme ce que les miniatures des manuscrits français contempo-rains, comme les Chroniques de Jean d’auton ou les œuvres de Jean Marot, illustrent parfaitement, c’est-à-dire l’extraordinaire parade de l’armée royale outre-monts (figure 1). hommes d’armes et archers portent par dessus la cuirasse de luxueux sayons, des cottes d’armes en brocart, en velours, en toile d’or ou d’argent, avec parfois l’écu, mais le plus souvent la devise et les couleurs de leur capitaine. Ce qui fascina Paolo Giovio et ses contemporains, ce sont moins les devises elles-mêmes que ces « livrées » (il emploie d’ailleurs le terme français) ; il ne manque jamais de dire qu’il a vu telle devise sur le sayon de tel personnage 9. C’est en réalité cette mode de la devise brodée et de la livrée que les italiens vont se mettre à imiter au contact des Français.
9. À propos de Louis Xii, Giovio explique par exemple : Mi ricordo […] aver visto in più luoghi questa impresa dipinta con un breve di sopra : Cominus et eminus, il che quadrava molto (ibid., p. 49). en fait, tout le dialogue fictif entre Paolo Giovio et Lodovico domenichi repose sur les souvenirs personnels du premier.
Figure 1 – Jean Marot, Le voyage de Gênes, BnF, F. fr. 509�, fol. �5 v° (cliché BnF).
DIALoGue DeS DevISeS eT DevISeS en DIALoGue…
5
Les paladins de France
Giovio, en bon historien, aimerait définir l’origine exacte des devises, mais, dès qu’il remonte au-delà de ses souvenirs personnels, il commet une série d’erreurs tout à fait significatives. il mentionne par exemple le porc-épic de Louis Xii �0, le cerf ailé du connétable de Bourbon �� et le fusil (ou briquet) de Charles le Téméraire ��, sans avoir conscience qu’il s’agit de devises familiales héritées – on y reviendra. Les plus anciennes devises qu’il cite ne remontent d’ailleurs pas au-delà du XVe siècle finissant, et il doit pallier les lacunes de sa documentation en recourant au mythe. Comme il s’agit d’une pratique chevaleresque, il se sent obligé de remonter au temps de Charlemagne :
« nous voyons (par ce qu’en disent les écrivains) que chacun d’eux eut particulière devise et enseigne, comme roland, le quartier, renaud, le lion barré, [ogier] le danois, le degré, salomon de Bretagne, l’échiquier, olivier, le griffon, astolphe, le léopard, et Ganelon, le faucon ��. »
en cela, Paolo Giovio ne se distingue pas de ses contemporains qui, au passage des armées françaises, évoquaient volontiers celles de Charlemagne �4. Mais son savoir s’avère purement livresque : l’essentiel de son information vient du Roland furieux (achevé en �5��). Giovio continue sa démonstration avec les chevaliers de la Table ronde et les héros de romans espagnols, comme Amadis de Gaule et Tiran le Blanc. dans cette préhistoire de l’emblème, l’hu-maniste confond visiblement écu et devise. Pourquoi ? Parce qu’à l’origine, l’image servait à distinguer le héros : au temps des paladins, l’héraldique n’était pas encore héréditaire (à vrai dire, elle n’existait même pas du tout !), mais au temps des Guerres d’italie, elle l’est devenue, et désormais, seule la devise permet encore de reconnaître l’individu exceptionnel, le héros des temps modernes �5.
�0. Ibid., p. 49.��. Ibid., p. �9-40.��. Ibid., p. 48.��. veggiamo (per quel che gli scrittori accennano) che ciascuno di loro ebbe peculiare impresa e insegna, come
orlando il quartiere, Rinaldo il leone sbarrato, Danese lo scaglione, Salamon di Bretagna lo scacchiero, olivieri il grifone, Astolfo il leompardo e Gano il falcone (ibid., p. �5-�6).
�4. sur la légende carolingienne en italie, voir les analyses très stimulantes d’a. denis, Charles vIII et les Italiens : Histoire et Mythe, Genève, �979, p. �9-�0. Lors de la retraite de Charles Viii, un Ferrarais, Bernardino dei Prosperi, qui accompagnait le roi, pouvait écrire au duc ercole d’este au sujet des chevaliers français : Me parono tuti palladini tanto sono grandi et grossi (Viterbe, 7 juin �495. Modène, arch. estense, ambasciatori in Francia, �, n° �6-ii (�) ; éd. L. Vissière, Louis II de La Trémoille ou la découverte de l’Italie (1480-1525), thèse dactyl. de l’École des Chartes, Paris, �000, 4 vol., t. i, p. �05-�06).
�5. L’idée qu’une chose aussi noble que la devise n’ait pas pris naissance dans l’antiquité parut très vite insupportable aux auteurs italiens. C’est ainsi qu’au XViie siècle, emanuele Tesauro pouvait affir-mer : Grande sciocchezza è dunque di credere che da’cavaglieri inglesi ne’secoli vicino l’uso delle imprese ritrovasse principio…, et de citer tous les emblèmes des Grecs (Idea delle perfette imprese, éd. M. L. doglio, Florence, �975, chap. ii, p. ��). C’est par principe que Tesauro rejette l’idée d’une origine anglaise de la devise, qu’ignore Giovio, et qui est pourtant sans doute exacte.
LAuRenT vISSIèRe
6
Devises vivantes
Les devises constituent bien un art de la parade, mais au-delà des appa-rences, elles possèdent aussi une histoire et une vie que Paolo Giovio, Claude Paradin et leurs successeurs ont en général parfaitement ignorées.
Héritages
Pour commencer, il convient de dire un mot des devises héritées, et si l’on peut dire, « héraldisées ». un certain nombre de devises sont en effet entrées dans le « capital emblématique » d’une famille ; mais il faut les traiter avec prudence : au contraire de l’écu qui ne signifie rien en soi, la devise fait sens, et l’on ne reprend pas une devise fortuitement et sans lui accorder une signification personnelle. La fameuse ceinture d’espérance, étudiée par Laurent hablot �6, constitue de ce point de vue un cas d’école. inventée par le duc Louis ii de Bourbon en ��66, elle subsiste comme marque identitaire chez tous ses descendants jusqu’au XVie siècle. imitant dans sa forme la Jarretière anglaise, il semblerait qu’elle ait à l’origine un sens plutôt courtois ; Charles iii, le futur connétable, qui l’arbora lors du voyage de Gênes, en �507, lui prêtait sans doute un sens similaire (figure �) ; mais à la même époque, Gabrielle de Bourbon, femme de Louis de La Trémoille, l’utilisait dans une acception strictement religieuse – elle l’assimilait sans doute à la ceinture de la Vierge, dont on vénérait un exemplaire au Puy-notre-dame, une abbaye proche de Thouars où résidaient les La Trémoille. rien n’empê-chait en fait plusieurs membres d’une famille d’utiliser la même devise en lui donnant des sens différents.
Le porc-épic de Louis Xii présente l’un des plus beaux exemples de réappropriation connus, ainsi que l’a fort bien analysé nicole hochner �7. La devise remontait à l’ordre du porc-épic et du camail, fondé en ��94 par son grand-père, Louis d’orléans : elle possédait déjà la sentence Cominus et eminus (« de près et de loin »), référence à la mythique combativité de l’ani-mal qui utiliserait ses piquants pour se défendre et… pour attaquer, en les lançant comme des viretons d’arbalète. Ce n’est pas la seule devise agressive qu’ait imaginée Louis d’orléans, mais celle-ci continua à être utilisée par son fils Charles et son petit-fils Louis, qui la réactualisa. avant même son accession à la couronne, le porc-épic devint le symbole de ses prétentions sur le duché de Milan, et Louis inscrivit sa devise absolument partout. Paolo
�6. L. haBLoT, « La ceinture espérance et les devises des Bourbons », espérance : le mécénat religieux des ducs de Bourbon, exposition du musée municipal de souvigny (juin-novembre �00�), F. Perrot (dir.), souvigny, �00�, p. 9�-�0�.
�7. n. hoChner, Louis XII. Les dérèglements de l’image royale (1498-1515), seyssel, �006, p. �9-4�, et 9�-95 ; « Louis Xii and the Porcupine : Transformations of a royal emblem », Renaissance Studies, �5, �00�, p. �7-�6.
DIALoGue DeS DevISeS eT DevISeS en DIALoGue…
7
Giovio, qui ignore tout de cette histoire, approuve le roi d’avoir choisi une devise incarnant si bien ses vertus chevaleresques �8.
dans le cadre de la monarchie française, les devises tendent d’ailleurs à s’agréger les unes aux autres : ainsi le soleil de Jean ii, le cerf ailé de Charles Vi (repris aussi par les Bourbons �9) demeurent dans l’emblémati-que de leurs successeurs. Les étendards qui apparaissent par exemple dans le voyage de Gênes �0 de Jean Marot constituent un véritable patchwork emblé-matique (figure 2) : on reconnaît l’archange saint Michel, protecteur du royaume, le soleil royal, le rouge et l’or, qui sont les couleurs de Louis Xii, ainsi que son porc-épic.
�8. P. GioVio, Dialogo…, p. 49. Cf. aussi C. Paradin, Devises…, p. �4-�6. La devise connut d’ailleurs un beau succès posthume puisqu’emanuelle Tesauro la commente en conclusion de son traité (Idea…, p. ��5-��6).
�9. F. auTrand, Charles vI. La folie du roi, Paris, �986, p. ��7-��9 ; L. haBLoT, « La ceinture… », p. 99.�0. Jean MaroT, Le voyage de Gênes (BnF, F. fr. 509�), éd. G. Trisolini, Genève, �974.
Figure 2 – Jean Marot, Le voyage de Gênes, BnF, F. fr. 509�, fol. �7 v° (cliché BnF).
LAuRenT vISSIèRe
8
Inventions
Paolo Giovio met beaucoup de soin à expliquer les règles qui président à la création d’une belle devise ��. Pour illustrer son propos, il mentionne à de nombreuses reprises les devises qu’il a imaginées pour lui-même ou pour ses relations – en italie, on commandait souvent à des intellectuels ce genre de travaux ��. Purement gratuites, ces devises érudites ne font d’ailleurs guère plus sens que les devises courtoises, en vogue dans les cours d’angleterre, de France et de Bourgogne à la fin du XiVe siècle ��.
or l’adoption d’une nouvelle devise pouvait, dans certains cas, dépas-ser le simple amusement aulique et marquer un véritable choix de vie. La genèse de telles devises, bien que très difficile à élucider, comporte alors une véritable épaisseur historique et sémantique.
Prenons en premier lieu l’exemple de Charles Viii. au printemps �495, alors qu’il séjournait à naples, il imagina une nouvelle devise, qu’il conser-verait jusqu’à la fin de ses jours : l’épée palmée. inconnue de Giovio, cette devise est longuement décrite par un ambassadeur italien, qui a vu passer les archers de la garde : ceux-ci arborent « un soleil au milieu duquel il y avait une croix blanche que traversait une épée nue entourée d’une palme, qui signifie victoire et justice �4 » – aucune sentence n’est indiquée. on recon-naît les emblèmes monarchiques traditionnels : le soleil et la croix blanche �5, auxquels s’ajoutent donc l’épée de justice et la palme de la victoire – des symboles universels et immédiatement compréhensibles pour les italiens. À cette époque, le capitaine de la garde écossaise, Bérault stuart d’aubigny, reçut un pourpoint orné d’épées palmées en fil d’or et d’argent �6.
Ce personnage, qui portait alors la livrée du roi, apparaît de manière tout autre au frontispice d’un manuscrit qu’il avait commandé – un Gouvernement des Princes. il s’est fait peindre à cheval, dans la classique
��. P. GioVio, Dialogo…, p. �7-�8. sur l’évolution de ces normes, r. KLein, « La théorie de l’ex-pression figurée dans les traités italiens sur les Imprese, �555-�6�� », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, �9, �957, p. ��0-�4�.
��. P. GioVio, Dialogo…, p. �09-��0, ��4, ��8, ���-���, ��� et ��6. r. KLein, « La théorie… », p. ���-���.��. Ces anciennes devises étaient tantôt courtoises – « a la belle dame » (Jean de Beaudricourt),
« Vostre plaisir » (Ghillebert de Lannoy) –, tantôt énigmatiques – « Je le doy » (Louis ier d’anjou), « Plus deuil que joie » (Pierre de Bauffremont, seigneur de Charny). exemples cités par Philippe ConTaMine, La noblesse au royaume de France, Paris, �997, p. ���-��5.
�4. un sole in mezzo del quale era una croce bianca, laquale traversava una spada nuda advolta da una palma et che significa victoria con justitia (cité par Y. LaBande-MaiLFerT, « L’épée dite “flam-boyante” de Charles Viii, Bulletin monumental, �08, �950, p. 9�-�0� : p. 99, n. �). Le tombeau de Charles Viii, aujourd’hui détruit, mais connu par une gravure ancienne, portait une frise d’épées palmées (BnF, est. Va �06, reprod. dans Y. LaBande-MaiLFerT, Charles vIII et son milieu (1470-1498), la jeunesse au pouvoir, Paris, �975, pl. XX).
�5. Cf. P. ConTaMine, infra…�6. Traité sur l’art de la guerre de Bérault Stuart, seigneur d’Aubigny, éd. e. de Comminges, La haye,
�976, p. xvii-xviii ; P. ConTaMine, « entre France et Écosse : Bérault stuart, seigneur d’aubigny (vers �45�-�508), chef de guerre, diplomate, écrivain militaire », The Auld Alliance, France and Scotland over 700 years, J. Laidlaw (dir.), Édimbourg, �999, p. 59-76 (p. 6�-64).
DIALoGue DeS DevISeS eT DevISeS en DIALoGue…
9
posture chevaleresque, mais avec sa propre emblématique (figures 3 & 4) �7. Paolo Giovio, qui s’intéresse au personnage, explique qu’il porte en devise « un lion rampant, rouge sur fond d’argent avec de nombreuses boucles semées dans les broderies des sayons et casaques, et peintes sur les étendards avec la sentence latine : Distantia jungit, signifiant qu’il était le moyen de tenir unis le roi d’Écosse et le roi de France �8 ». La miniature confirme à peu près cette description : le lion de gueules sur fond d’or (et non d’argent), qui rappelle sa parenté avec le roi d’Écosse, le semis de boucles d’or, mais pas de sentence – ce qui rend ces boucles incompréhensibles. L’écu de Bérault, avec pour cimier, la licorne écossaise, et pour tenants, les cerfs ailés de France, confirme en tout cas le choix de sa devise : une boucle qui unit les deux royaumes face à l’ennemi commun anglais.
�7. Paris, Bibl. de l’arsenal, ms. 506�, fol. �0� v°. Cf. F. aVriL et n. reYnaud, Les Manuscrits à peinture en France (1440-1520), Paris, �994, p. ��5 ; et P. ConTaMine, « découverte et conquête. Le roi de France, les Français et le “voyage de naples” (�494-�495) », De l’Italie à Chambord…, p. 9-�� (p. �5).
�8. un leone rampante, rosso, in campo d’argento con molte fibbie seminate ne’ricami de’saioni e sopraveste e dipinte negli stendardi col motto latino : Distantia jungit, significando ch’egli era il mezzo da tener uniti il re de Scozia e il re di Francia (P. GioVio, Dialogo…, p. �05).
Figure 3 – Bérault stuart d’aubigny, Paris, Bibl. de l’arsenal, ms. 506�, fol. �0� v° (cliché BnF).
Figure 4 – devise de Bérault stuart d’aubigny, Paolo Giovio, Dialogo
dell’imprese militari e amorose, Lyon, �574, p. �04 (cliché de l’auteur).
LAuRenT vISSIèRe
�0
autre devise à marquer un choix de vie : la roue de Louis ii de La Trémoille (�460-�5�5). une roue qu’accompagne la sentence : Sans poinct sortir hors de l’orniere. « Pour signifier, explique Paolo Giovio, qu’il marchait par droit chemin au service de son roi, sans se laisser dévoyer par aucun intérêt �9. » La riche documentation iconographique, dont on dispose pour le personnage, montre qu’il apposa sa devise partout : sur ses vêtements �0, la livrée de ses hommes, ses étendards ��, les monuments qu’il fit construire, son tombeau enfin �� (figures 5 & 6). Que la roue ait symbolisé pour Louis ii l’ornière du service royal ne fait aucun doute, et l’on peut même dire qu’en mourant à Pavie, en �5�5, il est allé jusqu’au bout de cette ornière. Mais le symbolisme de la roue s’avère plus subtil encore : la famille de La Trémoille semble avoir voué une dévotion ancienne à sainte Catherine d’alexandrie, et si la roue de Giovio est lisse, d’autres représentations la montrent munie des rasoirs du supplice – ce qui ajoute une connotation religieuse à l’emblème. enfin, cette roue qui suit une ornière s’oppose en tout point à la capricieuse roue de la Fortune, et il n’est pas exclu que Louis ii, en choisissant cette maxime de vie, y ait mis une légère provocation ��…
�9. Per significar ch’egli caminava per camin dritto nel servir il suo re, senza lasciarsi deviare da alcuno interesse (P. GioVio, Dialogo…, p. �0�). sur le personnage, L. Vissière, « Sans poinct sortir hors de l’orniere ». Louis II de La Trémoille (1460-1525), à paraître aux éditions honoré Champion.
�0. Les comptes de son hôtel montrent qu’il arborait un pourpoint avec « des roues ste Katherine à ung bort » lors de l’entrée royale à Milan, en septembre �499 (� aP ��77). C’est la première mention connue de cette devise.
��. L’étendard à la roue apparaît en deux occasions : sur une miniature des Chroniques de Jean d’auton, qui représente le siège de novare en �500 (Paris, BnF, F. fr. 508�, fol. 49 r°) ; et sur la tapisserie qui commémore le siège de dijon par les suisses en �5��. sur la même tapisserie, on voit Louis ii en tenue de cour, suivi de deux archers qui portent sa roue en livrée (dijon, Musée des Beaux-arts).
��. d’innombrables roues sculptées sont toujours visibles dans l’église notre-dame du Château à Thouars, ainsi que sur le portail de l’église de la Madeleine à dijon, reconstruite sur l’ordre de Louis ii. en revanche, son tombeau, détruit à la révolution, n’est plus connu que par des dessins anciens (cf. L. Vissière, Sans poinct sortir…).
��. Les subtilités de cette devise n’étaient en tout cas plus comprises un siècle après la mort de Louis ii. au XViie siècle, un certain elie Brackenhoffer, qui visite Thouars, apprend que cette roue munie de rasoirs, omniprésente, « veut dire qu’il [Louis II] a tout taillé en pièces en toute hâte, comme tourne une roue, sans aucun reproche (voyage en France (1643-1644), trad. h. Lehr, Paris, �9�5, p. ��9).
Figure 5 – devise de Louis ii de La Trémoille in P. Giovio, Dialogo…, p. �00 (cliché de l’auteur).
DIALoGue DeS DevISeS eT DevISeS en DIALoGue…
��
À l’égard de toutes ces devises, on pourrait employer l’expression « devise de vie », tant l’image et l’idée exprimée revêtent d’importance pour un individu, et parfois même ensuite pour son lignage �4.
Devises en dialogues
Malgré la majesté de ces devises chevaleresques, et parfois une certaine grandiloquence, celles-ci n’étaient pas figées, et, comme on l’a vu, elles pouvaient vivre et évoluer. d’où l’intérêt d’examiner à présent le cas parti-culier des devises éphémères.
Devises et imprese
À côté des « devises de vie », il existe en effet des devises de circonstance, qu’on appelle en ancien français « emprises �5 » – le même mot qu’impresa. en italien comme en ancien français, le mot permet une confusion intéres-
�4. Cette idée est d’ailleurs fort bien exprimée par Claude Paradin : « Chacun d’eux [les princes] selon la particuliere affection qu’il avoit en son idée, vint à figurer certaine chose, que icelle idée representoit, quoy que ce fut par sa forme, nature, complexion ou autrement. Telles figures ainsi inventees, ilz appell[e]rent leurs devises, […] qu’ilz […] peingnoient en leurs armes […]. Prenans plaisir à en decorer la chose en laquelle estoit posee leur totale esperance et dernier refuge, et ou aussi estans en la guerre, avec apprehension de mort, desiroient porter telles devises devant leurs yeux, comme se promettans vivre et mourir en l’objet du mon[u]ment et vraye memoire de vertu » (Devises héroïques, Lyon, �55�, p. 4-5).
�5. M. PasToureau, « “Arma senescunt, insignia florescunt.” note sur les origines de l’emblème », Studi in onore di Leopoldo Sandri, r. Grispo, a. Pratesi (dir.), rome, �98�, � vol., t. iii, p. 699-706 (p. 704) ; J. huiZinGa, L’automne du Moyen Âge, trad. J. Bastin, Paris, �99�, chap. 6.
Figure 6 – devise de Louis ii de La Trémoille in Tapisserie du siège de dijon (détail) : dijon, Musée des Beaux-arts (cliché du musée).
LAuRenT vISSIèRe
��
sante, puisqu’il signifie à la fois « devise » et « entreprise ». de fait, pendant les Guerres d’italie, on note la présence de devises liées à telle ou telle action particulière, à telle entreprise.
La plus célèbre de ces emprises est celle que Louis Xii utilisa lors de l’expédition de Gênes, en �507 : il abandonna son porc-épic pour une ruche et des abeilles, avec la sentence : non utitur aculeo rex cui paremus (« Le roi auquel nous obéissons n’a pas besoin d’aiguillon ») �6 (figure �). La minia-ture, tirée du voyage de Gênes de Jean Marot, montre que les gentilshommes de sa garde ont conservé la livrée au porc-épic agressif, mais le roi, pour l’occasion, arbore un symbole de clémence et de consensus – pas de révolte dans les sociétés d’insectes !
Lors de la guerre du Milanais en �500, les deux partis opposés adoptè-rent chacun une nouvelle emprise. d’après Jean d’auton, Ludovic sforza, qui entra en campagne en plein hiver, adopta un tambourin, avec pour sentence : « Je sonneray l’yver pour danser l’esté �7 ». Quant à Louis de La Trémoille, qui conduisait l’armée française, il arborait sur son étendard une épée sanglante, une torche et un fouet �8. Pas de sentence, mais les objets parlent d’eux-mêmes �9.
Ces « emprises » constituaient bien les éléments d’un dialogue, et n’avaient de ce fait qu’une portée limitée dans le temps.
Devise et dérision
aux yeux des aristocrates français, la bonne devise devait énoncer clai-rement un choix de vie ou une volonté particulière, leur moi profond ou une manifestation officielle de leur personnage. Peu importe dans cette optique les jeux de cuistres dont se repaissaient les humanistes italiens, et leurs références à Virgile, à horace ou aux néo-platoniciens.
si l’on considère que la devise exprime bien le caractère ou la mission du personnage qui la porte, elle peut être commentée avec ironie dans un cadre guerrier : à travers sa devise, c’est l’ennemi qu’on tourne en déri-sion. il existe un précédent célèbre lors de la Guerre civile, quand Louis d’orléans adopta pour devise le bâton noueux avec le mot : « Je l’ennuie » (sous-entendu : le duc de Bourgogne), et que Jean sans Peur répliqua par le rabot ; à l’annonce de l’assassinat de Louis, les Parisiens ricanèrent : « Le
�6. À cette époque, on croit en effet que les abeilles ont un roi (cf. hoChner, Louis XII…, p. �85-�9�).�7. « de nouvelle divise voulut user et, l’eau et le feu de sa premiere divise veoyant assechez et estainctz,
prist un tabourin, disant : “Je sonneray l’yver pour danser l’esté” » (J. d’auTon, Chroniques…, t. i, p. �4�).
�8. Monsignor di La Trimolia passò verzeli con 8 000 cavali et. XI. milia fanti, e uno stendardo con una spada sanguinosa pynta suso col focho, et una scova (Marino sanuTo, I Diarii dal 1496 al 1532, éd. F. stefani et alii, Venise, �879-�90�, 58 vol., t. iii, col. �89).
�9. La Trémoille aurait aussi utilisé comme devise de circonstance, mais dans un contexte inconnu, un feu brûlant dans un marais, avec pour légende : Ardet in hostes (L. et s. de sainTe-MarThe, Histoire généalogique de la maison de La Tremoille…, BnF, F. fr. 8 �00, livre V).
DIALoGue DeS DevISeS eT DevISeS en DIALoGue…
��
bâton noueux est plané 40. » Premier exemple de devises en dialogue donc, mais il en existe d’autres, que Giovio a notées avec une curiosité évidente. ainsi, après la bataille de nancy en �477, on présenta à rené de Lorraine, victorieux, la bannière de Charles le Téméraire – « la pierre à feu avec le fusil et deux tronçons de bois » (on reconnaît ici la croix bourguignonne, compo-sée de deux bâtons noueux). « Pour vrai, cet infortuné seigneur, quand il eut besoin de se réchauffer n’eut pas le temps d’employer son fusil », s’amuse le duc de Lorraine. et Giovio d’ajouter : « et cette parole fut trouvée d’autant plus mordante que ce jour-là, la terre était couverte de neige rougie de sang, et qu’il faisait le plus grand froid qu’on puisse se rappeler de mémoire d’homme 4�. » il rapporte ensuite des épisodes plus proches dans le temps comme la prise d’eboli, en septembre �495 ; François d’alègre plaisante sur l’étendard de son ennemi vaincu, le comte de Maddaloni, qui avait pour devise une balance, avec la sentence évangélique Hoc fac et vives : « Par ma foy, dit-il, que mon ennemi n’ha pas faict ce qu’il a escrit à l’entour de son peson, pour ce qu’il n’ha pas bien pesez ses forces avec les mienes » (figure 7) 4�.
dans la même veine, on voit le duc de Guise, qui, en �55�, défendit victo-rieusement Metz contre les impériaux, railler la devise « Plus oultre » de Charles Quint. C’est à Metz, déclare-t-il, que « le destin avoit son outre limité 4� ».
40. enguerrand de MonsTreLeT, Chroniques, éd. J.-a.-C. Buchon, Paris, �8�6, p. 54. Voir notam-ment s. sLaniCKa, Krieg der Zeichen, die visuelle Politik Johanns ohne Furcht und der armagnakisch-burgundische Bürgerkrieg, Göttingen, �00�.
4�. « Per certo, questo sfortunato signore, quando ebbe bisogno di scaldarsi, non ebbe tempo da operare i fucili. » e tanto più fu acuto questo detto quanto che quel dì la terra era coperta di neve rossegiante di sangue e fu il maggior freddo che si ricordasse mai a memoria d’uomo… (P. GioVio, Dialogo…, p. 48).
4�. Cité en français par P. GioVio (Dialogo…, p. �08-�09).4�. C. Paradin, Devises…, p. ��. Le bon mot est également cité par Brantôme, dans sa vie de M. de
Guise (Grands Capitaines françois, dans Œuvres complètes, éd. L. Lalanne, Paris, �864-�88�, �� vol., t. iV, p. �9�). Les deux textes se réfèrent en fait à La harangue que fit monseigneur le duc de Guise aus soudars de Mez le jour qu’il pensoit auoir l’assaut, de ronsard, publiée à Paris, en �55�, avec le Cinquième Livre des odes. sur la devise de Charles Quint, e. rosenThaL, « Plus ultra, non plus ultra, and the Columnar device of emperor Charles V », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, �4, �97�, p. �04-��8.
Figure 7 – devise du comte de Maddaloni in P. Giovio, Dialogo…, p. �09 (cliché de l’auteur).
LAuRenT vISSIèRe
�4
Devise et prophétie
Le plus étrange, c’est que la devise, image souvent programmatique, peut devenir prophétique. La trahison et la fuite du connétable de Bourbon semblent ainsi annoncées par l’une de ses devises ancestrales, le cerf ailé 44. C’est du moins ce qu’aurait expliqué au pape un ambassadeur français, juste après Pavie : « Bourbon, encore qu’il semble avoir trahi son roi et sa patrie, mérite quelque excuse pour avoir dit, longtemps auparavant, ce qu’il pensait faire, puisqu’il portait sur sa casaque le cerf-volant, voulant clairement dire qu’il avait le courage de fuir en Bourgogne ; pour ce faire, les jambes ne lui auraient pas suffi, s’il n’avait eu aussi les ailes » (figure 8) 45.
Ludovic le More avait eu la curieuse idée de faire peindre au château de Milan l’italie en forme de reine, vêtue d’une robe où étaient brodées les cités de la Péninsule, et à côté d’elle un petit écuyer noir, une balayette à la main (figure 9). À un ambassadeur florentin étonné, le duc déclara que ce valet noir était là pour épousseter et nettoyer les villes de toute saleté, ce qui signifiait clairement que le More se prenait pour « l’arbitre de l’italie ». et le Florentin de répliquer : « Prenez garde, seigneur, que ce valet, en maniant la balayette, ne se jette toute la poussière sur lui-même ! » Parole que Giovio estime tout à fait prophétique, vu l’effondrement du duché de Milan 46.
enfin, toujours dans le domaine des prophéties et de l’humour, il faut citer César Borgia : Aut Caesar aut nihil, avait-il fièrement pris pour devise. sa carrière fulgurante et sa mort brutale autorisent tous les traits d’humour, car au fond, César et rien, « il fut les deux 47 ».
44. Giovio affirme avoir vu ce cerf ailé sur les livrées de la compagnie de Charles de Bourbon, notam-ment à l’occasion de la campagne d’agnadel, en �509. il ignore qu’il s’agit d’une devise familiale et lui prête un sens tout chevaleresque, volendo dire che, non bastando il correr suo naturale velocissimo, sarebbe volato in ogni difficile e grave pericolo senza freno (Dialogo…, p. �9). sur le personnage, d. CrouZeT, Charles de Bourbon, connétable de France, Paris, �00�.
45. Borbone, ancora che paia essere stato traditore del suo re e della patria, merita qualche scusa per aver detto molto avanti quel ch’ei pensava di fare, poiché portava nella sopraveste il cervo con l’ali, volendo chiaramente dire che aveva animo di fuggire in Borgogna, al che fare non gli bastavano le gambe se non avesse avuto anco l’ali, e perciò gli fu aggiunto il motto Cursum intendimus alis (P. GioVio, Dialogo…, p. �9-40).
46. Avvertite, Signore, che questo servo maneggiando la scopetta vien a tirarsi tutta la polvere adosso (ibid., p. 6�). il semble que cette histoire ait été extrêmement populaire. Jean Marot la met en vers : « Jadiz [le More] fist paindre une dame embellie/Par sur sa robe des villes d’Ytallie,/et luy auprés, tenant des espoussetes,/Voullant dire, par superbe follie,/Que l’Ytallie estoit toute souillie/et qu’il voulloit faire les villes nettes./Le roy Loys, voullant ravoir ses mettes,/Par bonne guerre luy a fait tel ennuy/Que l’Ytalie est nettoyé de luy… » (Le voyage de Gênes, p. ��6-��7, vv. ��6�-��7�). Marco Tremosano reproduit la même image dans sa Galleria d’imprese, arme ed insegne de’varii regni, ducati, provincie, città e terre dello stato di Milano, et anco di diverse famiglie d’Italia (ms. aux arch. de Milan, p. �4�. Mention donnée par LaBande-MaiLFerT, Charles vIII…, p. �09, n. �6�).
47. Lors de sa chute, un certain Fausto Maddalena improvisa le dystique : Borgia Caesar erat factis et nomine Caesar/Aut nihil aut Caesar dixit, utrumque fuit (P. GioVio, Dialogo…, p. �8).
DIALoGue DeS DevISeS eT DevISeS en DIALoGue…
�5
••Pour conclure, on pourrait dire que la devise est avant tout un devis, un
jeu d’esprit, un bon mot, un plaisir pour l’œil. Mais qu’elle participe aussi d’un dialogue aristocratique, amoureux ou guerrier. Car la devise est vivante, elle parle, elle invite à la réaction – éventuellement à la rédaction – et surtout à la réflexion. À tous les sens du terme, car elle réfléchit l’image de celui qui la porte, et donne à réfléchir à celui qui la voit.
si la devise est là pour donner un sens à sa vie et à son action, la mort donne rétrospectivement son véritable sens à la devise. La roue de La Trémoille, le cerf ailé de Bourbon ou le néant de César Borgia illustrent aussi bien leur vie que leur destin. en ce sens, la devise est dialogue entre les vivants, mais aussi dialogue entre les vivants et les morts.
Figure 8 – devise du connétable de Bourbon ibid., p. �4 (cliché de l’auteur).
Figure 9 – devise de Ludovic sforza ibid., p. 4� (cliché de l’auteur).