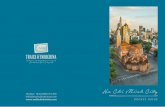Décider et agir : L'intrusion japonaise en Indochine française (juin 1940) (To decide and to act....
Transcript of Décider et agir : L'intrusion japonaise en Indochine française (juin 1940) (To decide and to act....
c"|ƒ~¡‒?¡‡?\£ƒ‒?kFƒ‹‡‒·†ƒ›‹?§\fi›‹\ƒ†¡?¡‹?h‹~›|⁄ƒ‹¡?¢‒\‹ \ƒ†¡?G§·ƒ‹¹PXSOH??o‒¡††¡†?~¡?r|M?o›M?…?uƒ‹£‡ƒ!«¡?rƒ!|“¡M?q¡¶·¡?~F⁄ƒ†‡›ƒ‒¡?QOOSNR?L?‹›?WRfi\£¡†?VT?Ÿ?WRhrrm?OQXSLPVTX
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL`‒‡ƒ|“¡?~ƒ†fi›‹ƒ‘“¡?¡‹?“ƒ£‹¡?Ÿ?“F\~‒¡††¡Y
⁄‡‡fiYNN•••M|\ƒ‒‹Mƒ‹¢›N‒¡¶·¡L¶ƒ‹£‡ƒ¡«¡L†ƒ¡|“¡L‒¡¶·¡L~L⁄ƒ†‡›ƒ‒¡LQOOSLRLfi\£¡LVTM⁄‡«
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLo›·‒?|ƒ‡¡‒?|¡‡?\‒‡ƒ|“¡?Y
??Ac"|ƒ~¡‒?¡‡?\£ƒ‒A?kFƒ‹‡‒·†ƒ›‹?§\fi›‹\ƒ†¡?¡‹?h‹~›|⁄ƒ‹¡?¢‒\‹ \ƒ†¡?G§·ƒ‹¹PXSOHK?uƒ‹£‡ƒ!«¡?rƒ!|“¡M?q¡¶·¡?~F⁄ƒ†‡›ƒ‒¡K??QOOSNR‹›?WRK??fiM?VTLWRM
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
cƒ†‡‒ƒ‘·‡ƒ›‹?"“¡|‡‒›‹ƒfl·¡?b\ƒ‒‹Mƒ‹¢›?fi›·‒?o‒¡††¡†?~¡?r|M?o›MMÅ?o‒¡††¡†?~¡?r|M?o›MM?s›·†?~‒›ƒ‡†?‒"†¡‒¶"†?fi›·‒?‡›·†?fi\„†M
k\ ‒¡fi‒›~·|‡ƒ›‹ ›· ‒¡fi‒"†¡‹‡\‡ƒ›‹ ~¡ |¡‡ \‒‡ƒ|“¡K ‹›‡\««¡‹‡ fi\‒ fi⁄›‡›|›fiƒ¡K ‹F¡†‡ \·‡›‒ƒ†"¡ fl·¡ ~\‹† “¡† “ƒ«ƒ‡¡† ~¡†|›‹~ƒ‡ƒ›‹† £"‹"‒\“¡† ~F·‡ƒ“ƒ†\‡ƒ›‹ ~· †ƒ‡¡ ›·K “¡ |\† "|⁄"\‹‡K ~¡† |›‹~ƒ‡ƒ›‹† £"‹"‒\“¡† ~¡ “\ “ƒ|¡‹|¡ †›·†|‒ƒ‡¡ fi\‒ ¶›‡‒¡"‡\‘“ƒ††¡«¡‹‡M s›·‡¡ \·‡‒¡ ‒¡fi‒›~·|‡ƒ›‹ ›· ‒¡fi‒"†¡‹‡\‡ƒ›‹K ¡‹ ‡›·‡ ›· fi\‒‡ƒ¡K †›·† fl·¡“fl·¡ ¢›‒«¡ ¡‡ ~¡ fl·¡“fl·¡ «\‹ƒ!‒¡ fl·¡|¡ †›ƒ‡K ¡†‡ ƒ‹‡¡‒~ƒ‡¡ †\·¢ \||›‒~ fi‒"\“\‘“¡ ¡‡ "|‒ƒ‡ ~¡ “F"~ƒ‡¡·‒K ¡‹ ~¡⁄›‒† ~¡† |\† fi‒"¶·† fi\‒ “\ “"£ƒ†“\‡ƒ›‹ ¡‹ ¶ƒ£·¡·‒ ¡‹e‒\‹|¡M h“ ¡†‡ fi‒"|ƒ†" fl·¡ †›‹ †‡›|¤\£¡ ~\‹† ·‹¡ ‘\†¡ ~¡ ~›‹‹"¡† ¡†‡ "£\“¡«¡‹‡ ƒ‹‡¡‒~ƒ‡M¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
?P?N?P
75Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 83,juillet-septembre 2004, p. 75-93.
DÉCIDER ET AGIRL’INTRUSION JAPONAISE EN INDOCHINE FRANÇAISE
(JUIN 1940)
Franck Michelin
En 1940, le Japon émettait des revendica-tions sur l’Indochine française que le pou-voir vichyste devait, contraint et forcé, ac-cepter. Plus que la conquête d’un territoiredont Tokyo rêvait de s’emparer, l’affairerévèle surtout les processus décisionnels ausein des cadres dirigeants japonais. On asouvent coutume, pour décrire ce pro-cessus, d’opposer colombes et faucons. Lacrise de l’été 1940 suggère que ce schémaest pour le moins réducteur.
uestion centrale de l’histoire desrelations internationales, la prisede décision constitue, dans le casdu Japon de la seconde guerre
mondiale, un problème épineux à traiter,et ceci pour au moins trois raisons. La pre-mière est de nature culturelle : la culturejaponaise contemporaine a tendance à fa-voriser la prise de décision collective et àdécourager les prises de décision indivi-duelles. La deuxième d’ordre historiogra-phique : dans un Japon qui n’a pasencore réussi à ce jour à assumer le passéde la seconde guerre mondiale, la re-cherche historique a tendance à seconfondre avec la recherche des respon-sabilités et des responsables. Rechercherla nature du processus décisionnel serévèle pour le moins délicat dans ce cadreculpabilisant et moralisateur. Enfin, latroisième et dernière raison renvoie auxcaractéristiques politiques et sociales duJapon entre la deuxième moitié desannées 1920 et 1945. En effet, le Japonmanquant le virage vers la démocratieentamé après la première guerre mon-
diale 1 entre alors dans une période deforte instabilité marquée par une série degraves incidents 2. De plus en plus divisées,les élites ne parviennent à effectuer unesynthèse qu’à travers la marche à la guerre.Mais cette marche à la guerre est un pro-cessus où le rôle individuel de tel ou tel di-rigeant est difficile à cerner.
Malgré ces difficultés, la question de laprise de décision occupe, bien évidem-ment, une place de choix au sein desouvrages portant sur le Japon et la secondeguerre mondiale. Néanmoins, la plupartd’entre eux aborde la question sous unangle général, et rares sont ceux qui repla-cent ce problème dans le cadre concret del’application de ces décisions au niveaulocal. Une telle approche oblige en effet àeffectuer d’incessants « changements defocale » entre les sphères locale et centraleafin de montrer comment les décisionsprises à Tokyo ont été appliquées surplace. Elle oblige également à interpréterces applications dans le cadre général duJapon de l’époque. Ardue, cette démarcheoblige à étudier en profondeur tant lesévénements locaux que le fonctionnement
1. Prenant place durant le règne de l’empereur Taishô,cette période fut nommée « Démocratie de Taishô » (TaishôDemokurashii). Dans cet article les mots japonais ont ététranscrits suivant le système Hepburn modifié. Les voyelleslongues sont marquées par un accent circonflexe. Pour lesnoms propres japonais et chinois, suivant l’usage de cesdeux pays, le patronyme précède le prénom.
2. On peut citer, entre autres, l’assassinat en Mandchouriedu seigneur de la guerre Chang Tso-lin par l’armée japo-naise (1928), la conquête de la même région sur une initia-tive des forces japonaises locales (1931), l’assassinat du Pre-mier ministre Inukai Tsuyoshi (1932), la tentative de putscheffectuée à Tokyo par de jeunes officiers (1936), les heurtsentre les forces japonaises et chinoises qui mènent peu àpeu à une véritable guerre entre la Chine et le Japon (1937).
Q
Franck Michelin
76
politique, militaire, social, voire culturel duJapon. Elle est néanmoins indispensable sil’on veut examiner la réalité de la questionde la prise de décision dans le Japon de la« guerre de quinze ans 1 », car l’intensité desrivalités se déchaînant parmi les différentsgroupes dirigeants japonais envelopped’un halo de brume lesdites décisions. Eneffet, le prétexte est difficile à distinguer dela véritable intention. Seule, une étude del’application au plan local des politiquesadoptées à Tokyo permet de démêler levrai du faux, ainsi que de déceler la véri-table nature des conflits internes.
Au mois de juin 1940, le Japon pose lepied en Indochine ; il n’en repart qu’aprèsla défaite de 1945. Cette intrusion, provo-quée en bonne partie par l’effondrementfrançais de juin 1940, est à rattacher toute-fois à la politique menée par le Japon enChine, à ses problèmes économiques, etsurtout à son projet d’expansion vers leSud – projet dont l’Indochine va constituerla première pierre. La décision de profiterde la situation de la France est toutefoisprise en hâte, dans la confusion, et va êtreappliquée dans un désordre indescrip-tible 2. L’analyse du processus décisionnelqui mène à la première étape de l’intrusionjaponaise en Indochine française – l’envoien Indochine d’une mission militaire japo-naise chargée officiellement de vérifier lafermeture de la frontière sino-indochi-noise, mais dans les faits de négocier l’oc-cupation par l’armée nippone du Tonkin –constitue l’objectif de cette publication 3.
Après avoir retracé brièvement le début del’intrusion japonaise en Indochine au moisde juin 1940, nous expliquerons la naturedes dissensions existant au sein dessphères dirigeantes japonaises avant deproposer un essai d’explication de la poli-tique étrangère japonaise à la veille de laguerre du Pacifique.
� L’INTRUSION EN INDOCHINE FRANÇAISE(JUIN 1940)
Quelle place l’Indochine tenait-elledans les relations franco-japonaises entreles débuts de la deuxième guerre mon-diale et le mois de juin 1940 4 ? Peu aprèsl’éclatement de la seconde guerre sino-ja-ponaise (en japonais nicchû sensô, 1937-1945), la France décide de fermer la fron-tière sino-indochinoise aux matériels stra-tégiques. Cette mesure semble avoir étéappliquée bien mollement, la France dési-rant à la fois enlever au Japon un prétexteà des mesures de rétorsion et aider laChine à freiner le Japon dans son expan-sion vers le Sud du pays. Tokyo cherche àimposer un blocus à la Chine dès l’annéesuivante, en 1938, demande à la Francede fermer la frontière et d’accepter unemission d’observation japonaise afin devérifier la bonne application de la mesureréclamée. En effet, la route que les Japo-nais nomment « route d’Indochine » (Fut-suin rûto), qui relie le port tonkinois deHaiphong à la capitale de la province chi-noise du Yunnan, Kunming 5, constituealors la principale artère reliant encore laChine au monde. La France rejette ces de-mandes tout en affirmant sa sincéritéquant à la fermeture de la frontière indo-chinoise au transit de matériels straté-giques. Mais le Japon réagit en étendant
1. Nom que l’on donne souvent aujourd’hui à la périodede guerre presque ininterrompue que connut le Japon de1931 à 1945. En japonais, jû-go nen sensô.
2. En témoigne le coups de force mené par les forces ja-ponaises locales contre les troupes françaises à Langson le23 septembre, malgré la conclusion à Tokyo d’un accordentre l’ambassadeur de France, Charles Arsène-Henry, et leministre japonais des Affaires étrangères, Matsuoka Yôsuke,accord général suivi d’une convention militaire locale signéeà Hanoï le 22 septembre.
3. Cet article tire l’essentiel de sa substance de notre mé-moire de DEA (cf. Franck Michelin, Le Japon à la croisée deschemins. L’intrusion en Indochine française, 1er-29 juin1940, mémoire de DEA d’histoire du Japon contemporain,sous la direction de Pierre-François Souyri, INALCO,décembre 2000).
4. Pour plus de détails, cf. notre article : « La rencontre dedeux destins. L’expansion vers le sud du Japon et l’Indo-chine française au mois de juin 1940 », in EBISU/Études ja-ponaises (revue de la Maison franco-japonaise), n° 30,septembre 2003, p. 5-31.
5. Dans les archives françaises, cette ville apparaît sous lenom de Yunnanfu, ce qui signifie « chef-lieu du Yunnan ».
Décider et agir
77
son champ d’action à proximité de l’Indo-chine : il s’empare de l’île chinoise deHainan, sise à l’entrée du golfe du Tonkin,le 10 février 1939, puis de l’archipel desSpratly, situé au large de l’Annam, le31 mars suivant. L’Indochine n’est plusalors qu’à une portée de fusil de l’arméenipponne.
La signature du pacte de non-agressionentre l’Allemagne et l’Union Soviétique,ainsi que la défaite face à cette dernière àNomonhan détournent le Japon de l’al-liance allemande et de son rêve d’expan-sion septentrionale à l’automne 1939. Lesrelations avec la France s’améliorent nette-ment 1, mais très brièvement car le Japon,de plus en plus isolé diplomatiquement 2,tourne son attention vers le Sud-Est asia-tique, et donc vers l’Indochine. Dès le moisde novembre, Tokyo demande de nou-veau à la France de fermer la frontièresino-indochinoise et d’accueillir une mis-sion d’observation japonaise 3. Le 24,l’armée prend la ville chinoise de Nanning,située non loin de l’Indochine 4. Puis unesérie de raids aériens japonais contre lechemin de fer du Yunnan 5 accroît la ten-sion entre les deux pays et culmine, le1er février 1940, avec la mort de quarantepersonnes, dont cinq Français. Dès le mois
de mars s’ébauche un projet visant à en-voyer des troupes à proximité de la fron-tière de l’Indochine 6.
Vers la fin du mois de mai 1940, l’inten-sification de la guerre en Europe met enébullition l’armée japonaise 7. Il est impos-sible de savoir précisément à quel momentles plans visant à exploiter la situation dé-sespérée de la France ont vu le jour 8. Lepremier document que nous avons puconsulter date du 1er juin 9. L’importance dutrafic de marchandises, et surtout de maté-riel militaire en direction de la Chine via leTonkin semble avoir joué un grand rôledans le désir de l’armée japonaise d’inter-venir dans la colonie, bien que les évalua-tions japonaises de ce trafic de contre-bande soient contestables 10. Alors que lasituation de la France est désespérée,l’armée de terre japonaise prépare une in-tervention en direction de l’Indochine.L’entrée dans Paris des forces allemandes ycrée un immense émoi. Incitée par la sec-tion des opérations de l’état-major 11, la22e armée, stationnée dans le Sud de la
1. Franck Michelin, La France face au Japon en Asie dusud-est 7 juillet 1937 - 22 juin 1940, mémoire de maîtrised’histoire des relations internationales du monde contempo-rain, sous la direction de Robert Frank, université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, septembre 1996, chap. 9.
2. Outre la défection allemande, le Japon doit affronterl’intransigeance croissante des États-Unis qui désirent dis-suader le Japon de s’en prendre aux possessions britan-niques en Extrême-Orient. Le 26 juillet, ceux-ci dénoncentle traité de commerce nippo-américain, première étape versl’application de sanctions économiques contre le Japon.
3. Cf. Franck Michelin, mémoire de maîtrise, mémoirecité, chap. 11.
4. Hata Fumihiko, « Futsuin shinchû to gun no nanshinseisaku » (L’occupation de l’Indochine française et la poli-tique d’expansion vers le Sud de l’armée), in Nihon kokusaiseiji gakkai taiheiyô-sensô gen.in kenkyûbu (Société d’étudede la politique internationale du Japon, groupe derecherches sur les causes de la guerre du Pacifique), Tai-heiyô-sensô he no michi (Vers la guerre du Pacifique),tome 6 : « Nanpô shinshutsu » (L’avancée vers le Sud),Tokyo, Asahi Shinbunsha, 1963, p. 160.
5. Voie ferrée construite et exploitée par les Français entrel’Indochine et Kunming, constituant la principale artère re-liant alors la Chine au monde extérieur.
6. Document du Bureau d’histoire militaire, Centre derecherches sur la défense, Agence de la Défense (BôeichôBôei-Kenshûjo Senshishitsu), Daihon.ei rikugunbu (GrandÉtat-Major, section de l’armée de terre), tome 2, Tokyo,Asagumo Shinbunsha, 1975, p. 44.
7. Ibid.8. En effet, la documentation est lacunaire, et ce pour
deux raisons : le quasi vide juridique concernant l’ouverturedes archives au public, et la destruction de la plus grandepartie de ces archives par le Japon avant l’arrivée destroupes d’occupation alliées à la fin du mois d’août 1945.
9. Document intitulé « Manière de résoudre l’Incident ennous servant de la France » (Futsukoku wo ridô suru jihenshori yôryô), in Tsunoda Jun (dir.), « Nicchû-sensô (III) » (Laguerre sino-japonaise, tome 3), in Gendaishi shiryô (Docu-ments d’histoire contemporaine), tome 10, Tokyo, MisuzuShobô, 1964, p. 365.
10. Selon celles-ci, la route d’Indochine aurait tenu alorsla première place devant celle de Birmanie. Mais l’évalua-tion d’un trafic de contrebande est toujours difficile à faire.De plus, « gonfler » ces chiffres a pu servir à justifier une in-tervention contre l’Indochine. Enfin, ils ont légitimé la posi-tion de ceux qui réclamaient une action musclée contre lacolonie. Pour les évaluations chiffrées de l’armée de terre ja-ponaise, cf. Daihon.ei rikugunbu, op. cit., p. 44 ; pourcelles de la marine, cf. Yoshizawa Minami, Sensô kadai noKôzu, Nihon-gun no « Futsuin shinchû » (Un aspect de l’ex-tension de la guerre, l’occupation de l’Indochine françaisepar l’armée japonaise), Tokyo, Aoki Shoten, 1986, p. 26.
11. Hata Fumihiko, « Futsuin… », op. cit., p. 160. Sectionla plus puissante de l’état-major de l’armée de terre, la sec-tion des opérations est alors la plus encline à Tokyo à inter-venir contre l’Indochine.
Franck Michelin
78
Chine, envoie, le 16, un détachement sousles ordres du général Okamoto en direc-tion de la frontière indochinoise 1. ÀTokyo, l’usage de la force contre la colonieest débattu au sein de l’armée de terre 2.
À partir du 15, la question semble avoircommencé à être débattue au sein dugouvernement japonais 3. Un plan est pré-paré qui vise à demander fermement à laFrance d’interdire le ravitaillement de laChine par sa colonie. Ledit plan estadopté le 17, et il est décidé de l’adresserà l’ambassadeur de France dès le lende-main. Mais ce dernier annonce le mêmejour que le général Catroux vient de pro-hiber le transit vers la Chine des armes,munitions, camions et carburants 4. Cetembargo, ainsi que la nouvelle de la de-mande d’armistice faite à l’Allemagne parla France ne font toutefois qu’exciter lesappétits du Japon. Le 18, l’usage de laforce à l’encontre de l’Indochine est dé-battu au sein de l’armée de terre et dugouvernement 5. Il est prévu d’y recourir siCatroux rejetait les demandes japonaises.En outre, l’importance propre de l’Indo-chine française aux niveaux politique etéconomique est affirmée. Enfin, la néces-sité de prendre en compte l’environne-ment international – prendre garde auxréactions anglo-saxonnes et rechercher lesoutien de l’Axe – est admise. L’empereur
intervient dans le débat le 20, sans claire-ment manifester son opinion 6.
Bien qu’il ait été prévu de n’utiliser laforce qu’en cas de rebuffade des autoritésd’Indochine, la section des opérations del’état-major de l’armée de terre préparel’intervention 7 : le détachement commandépar le général Okamoto marche en direc-tion de la frontière le 18 juin 8. Le Japon re-cherche le soutien, au moins de principe,de l’Allemagne afin de tenir en respect lespuissances anglo-saxonnes 9. Mais Berlinfait la sourde oreille 10. L’ultimatum japonaistombe le 19 : l’Indochine doit interdire letransit des armes, munitions, carburants,camions et du matériel ferroviaire, ainsiqu’accueillir une mission d’observation ja-ponaise. Catroux, dans l’impossibilité de ré-sister militairement au Japon 11 et non sou-tenu par les États-Unis 12 obtempère dès lelendemain en fermant la frontière 13. Il ac-cepte d’accueillir une mission d’observa-tion japonaise afin de vérifier la réalité de lafermeture de la frontière.
Il ne se résigne pourtant pas, en recher-chant par exemple l’appui britannique,impossible cependant en raison de la pré-paration de la bataille d’Angleterre et de ladétérioration rapide des rapports franco-britanniques. Pendant ce temps, le Japonforme sa mission d’observation, communé-ment appelée « mission Nishihara » du nomde son chef, le général Nishihara Issaku. Sacomposition provoque de nombreux heurtsparmi les militaires japonais. Composée de1. Daihon.ei rikugunbu, op. cit., p. 45 ; Nakamura Aki-
hito, Futsuin shinchû no shinsô (La vérité sur l’occupationde l’Indochine française), Bôei kenshûjo senshishitsu,Kaigun (marine), Daiichi bakuryô kanbu (1 re section del’état-major des forces d’autodéfense), Futsuin shinchû 1(L’occupation de l’Indochine française), 1940, p. 49.
2. Bôeichô Bôei-Kenshûjo Senshishitsu, Daihon.ei riku-gunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit., t. 1, p. 56.
3. Kido Kôichi, Kido Kôichi nikki (Journal de KidoKôichi), Tokyo, Tokyo Daigaku Shuppankai, 1966, p. 794.
4. Bureau d’histoire militaire, Centre de recherches sur ladéfense, Agence de la Défense, Daihon.ei rikugunbu,Daitôa-sensô kaisen keii, (Grand État-Major, section del’armée de terre, historique de la guerre de la grande Asieorientale), t. 2, Tokyo, Asagumo Shinbunsha, 1975, p. 55.
5. Bibliothèque du Centre de recherches sur la défense(Bôei Kenkyûjo Toshokan Shozô), Daihon.ei rikugunbusensô shidôhan, Kimitsu sensô nisshi (Groupe de directionde la guerre de la section de l’armée de terre du Grand État-Major, Journal confidentiel de la guerre), Tokyo, Kinseisha,1998, p. 794.
6. Hata nikki, Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisenkeii, op. cit., p. 58. Il faut toutefois remarquer qu’il est alorsde coutume que l’empereur ne manifeste pas clairement sonopinion en public.
7. Ibid., p. 58.8. Nakamura Akihito, op. cit., p. 49.9. Daihon.ei kaigunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,
p. 26 ; Nihon gaikôshi, op. cit., t. 22, p. 82.10. Ibid., p. 83-84.11. Jean-Baptiste Duroselle, L’abîme, 1939-1944. Poli-
tique étrangère de la France, Paris, Le Seuil, 1982, p. 320.12. Philippe Devillers, Histoire du Viêt-Nam de 1940 à
1952, Paris, Le Seuil, 1952, p. 75.13. Ibid., p. 81 ; Tsuchihashi Takeyasu, Gunpuku seikatsu
yonjû-nen no omoide (Souvenirs de quarante années pas-sées sous l’uniforme), Tokyo, Keisô Shobô, 1983, p. 354-355 ; Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii,op. cit., p. 64.
Décider et agir
79
30 membres des forces armées ainsi quedes diplomates en poste à Hanoi, cette mis-sion aura le statut d’une mission militaire ausein de laquelle les toges céderont auxarmes. Les instructions, préparées par lecommandement de la Marine et de l’Arméede terre, émettent clairement le dessein dene pas se limiter à une tâche d’observationqui deviendra vite inutile, mais au contrairede négocier avec les autorités indochinoisesl’obtention de bases dans la colonie 1. Le 26,Nishihara décolle de Tokyo en compagniede l’attaché militaire français à Tokyo, lecommandant Thiébaud et, au cours d’uneescale forcée par les intempéries, expose àce dernier la teneur des demandes japo-naises : fermeture complète de la frontièresino-indochinoise, coopération écono-mique, utilisation à des fins militaires duchemin de fer du Yunnan et d’aérodromesau Tonkin 2. Les deux hommes atterrissent àHanoi le 29 juin : le Japon pose le pied enIndochine.
Cette question ayant déjà été traitée 3, oninsistera guère sur ce point sinon pour re-tracer les mécanismes de la prise de déci-sion dans l’affaire indochinoise. Considérépar les contemporains comme par la plu-part des historiens français comme un alliévéritable de l’Allemagne nazie, l’interven-tion en Indochine semble aller de soit 4.Mais la fragilité de l’alliance nippo-alle-mande interdit de tracer un lien direct entreRethondes et Hanoi – siège des négocia-tions nippo-indochinoises en juillet 1940 5.
Pourquoi avancer en Indochine ? Laconsultation des archives japonaises révèletrois raisons : utiliser le Nord de l’Indochinepour mettre un terme au conflit sino-japo-nais, exploiter les ressources indochinoisesafin de renforcer l’économie de guerre japo-naise et préparer l’expansion vers le Sud-Estasiatique. Le premier motif représente lacause la plus communément avancée.Néanmoins, la plus grande partie du hautcommandement japonais ne croit guère àl’efficacité d’une telle offensive ni à une dé-faite rapide de la Chine 6. Afin de préparerun futur conflit contre l’URSS ou les puis-sances anglo-saxonnes, les dirigeants japo-nais commencent à pencher en faveur d’undésengagement progressif de la Chine 7. Leconflit sino-indochinois n’est donc plusguère qu’un prétexte dans les discussionsentre les autorités d’Indochine et le Japon,et ce d’autant plus que ce dernier mesure,dès la fin du mois de juin 1940, l’efficacitéde l’embargo décrété par Catroux 8.
L’économie explique-t-elle par ailleursl’intrusion japonaise ? Prompt à tirer lesleçons de la défaite allemande de 1918, leJapon cherche à édifier une économie deguerre. Se libérer de sa dépendance enmatières premières à l’égard des États-Unisconstitue un objectif prioritaire auquel l’In-dochine française pourrait contribuer 9.Cette nécessité est d’autant plus impé-rieuse qu’en juillet 1939 le gouvernementaméricain lève le dernier obstacle à l’appli-cation de sanctions économiques contre leJapon en dénonçant le traité de commercenippo-américain de 1911 10. Trois mois plus1. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,
p. 63-65 ; Daihon.ei rikugunbu, op. cit., p. 76.2. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,
p. 70.3. Cf. Franck Michelin, Ebisu, op. cit.4. Prouver le lien entre l’Allemagne et le Japon dans l’in-
trusion japonaise en Indochine sera d’ailleurs un des objec-tifs de la France au procès de Tokyo.
5. Le pacte de non-agression germano-soviétique avait éténégocié et signé par l’Allemagne sans même que l’allié japo-nais n’ait été prévenu. Le Japon avait essayé de se rapprocherde nouveau de son allié allemand à la nouvelle de ses victoiresen Europe, mais nous avons vu précédemment que la de-mande de coopération adressée à celui-ci dans le cadre de l’af-faire indochinoise avait été ignorée (cf. supra, p. 78). L’annéesuivante, l’offensive allemande contre l’URSS aura elle aussiété préparée et exécutée sans que le Japon en soit averti.
6. Daihon.ei rikugunbu, op cit., p. 44 ; Daihon.ei riku-gunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit., p. 52, 67. L’idée del’opération sera, semble-t-il, définitivement rejetée le10 juillet en raison de la préparation d’opération en direc-tion du Sud.
7. Michael A. Barnhart, Japan prepares for total war. Thesearch for economic security, 1919-41, Ithaca, Cornell Uni-versity Press, 1987, p. 153.
8. Yoshizawa Minami, Sensô kakudai no Kôzu, Nihon-gun no « Futsuin shinchû », Tokyo, Aoki Shoten, 1986, p. 23.
9. Tabuchi Yukichika, « Daitôa kyôeiken to Indoshina,shokuryô kakutoku no tame no senryaku », in Tônan-Ajia,rekishi to bunka, n° 10, 1981, p. 49.
10. Michael A. Barnhart, Japan prepares…, op. cit.,p. 144-146.
Franck Michelin
80
tard, le Conseil de la Planification, Ki-kakuin, parle de la nécessité d’importerd’Indochine française un certain nombrede matières premières nécessaires à l’in-dustrie 1. Le Japon enquête également,durant l’année 1940, sur les ressources in-dochinoises 2, minières et surtout rizicoles.En effet, l’armée japonaise entend à toutprix écarter le spectre de la pénurie ali-mentaire que l’Allemagne avait connuependant la première guerre mondiale.Dans cette optique, assurer un ravitaille-ment suffisant en riz est primordial,d’autant que des pénuries touchent le paysdepuis 1938. Importer du riz de Thaïlandeet d’Indochine française est envisagé dèsl’année suivante 3. Durant l’année 1940,l’Indochine exporte ainsi jusqu’à 30 % desa production vers le Japon, en partie enraison de la perte du marché métropoli-tain 4, mais surtout à cause des demandespressantes du Japon. Mais si le problèmealimentaire et économique joue, à compterde 1941, un rôle non négligeable dans lapolitique japonaise à l’égard de l’Indo-chine, tel n’est pas encore le cas en 1940où les considérations de nature politique etstratégique l’emportent encore largement 5.
En effet, c’est le projet d’expansion versle Sud (en japonais nanshin) qui joue alorsle premier rôle dans la décision d’inter-venir en Indochine. Soutenu par la plusgrande partie de la marine, ce projetcontredit l’option de sa rivale terrestre,l’expansion vers le Nord (hokushin) – laMandchourie et la Sibérie. Il est pourtant
réactivé. Il faut en effet trouver des res-sources pour pallier les conséquences dudurcissement américain et l’impossibilitéde réaliser l’expansion vers le Nord face àla puissance croissante de l’URSS 6. Lamontée du protectionnisme économiquedes puissances occidentales dans leurs co-lonies au cours des années 1930 provoquel’échec d’une expansion commerciale duJapon en Asie du Sud-Est. C’est alors laperspective d’une expansion militaire quise dessine. La défaite de Nomonhan et l’al-liance germano-soviétique détournent leJapon du Nord vers le Sud. La défaite fran-çaise et l’éventualité d’une invasion desîles britanniques rendent alors cette expan-sion méridionale possible. Jusque lors fa-vorable à une expansion septentrionale,l’armée de terre se convertit donc à l’ex-pansion vers le Sud. En signant l’armistice,la France, croit-on, ne pourra plus comptersur le soutien britannique. Un consensusse dégage peu à peu au sein des sphèresdirigeantes japonaises – l’empereur inclus– en faveur de l’occupation de l’Indochineet de son utilisation afin de renforcer lamachine de guerre du pays 7. La dernièrepomme de discorde touche à l’utilisationde la force : aux intrépides, qui ne croientpas à une réaction des Anglo-Saxons, s’op-posent les prudents, qui la redoutent.
� LES DISSENSIONS AU SEINDES SPHÈRES DIRIGEANTES JAPONAISES
L’instauration progressive d’un consen-sus concernant l’expansion vers le Sud nese fait pas sans heurts opposant principale-ment l’armée de terre et la marine. La riva-lité entre les deux armes remonte à 1872,moment où le ministère des forces armées,Heibushô, fut démembré, entraînant lafondation des ministères de l’Armée et de
1. Gendaishi shiryô, op. cit, t. 43, « Kokka sôdôin »,p. 172.
2. « Rapport sur la situation générale des ressources miné-rales de l’Indochine française et des Indes orientalesnéerlandaises » (Futsuryô Indo narabini Ranryô Indo nokôsan shigengaikyô hôkoku), document du Bureau deRecherches sur l’Histoire de la Guerre de l’Agence de la Dé-fense (Bôei kenshûjo senshishitsu), section « Marine »(Kaigun), L’avancée en Indochine, 1 (Futsuin shinchû 1),mai 1940 – juin 1941, « Documents en rapport avecl’avancée en Indochine » (« Futsuin shinchû kankeikiroku »).
3. Tabuchi Yukichika, « Daitôa… », op. cit., p. 43-48 ;Michael A. Barnhart, Japan prepares…, op. cit., p. 143.
4. Le blocus appliqué par les Britanniques en constitue lacause principale.
5. Yukichika Tabuchi, « Daitôa… », op. cit., p. 45-50.
6. La supériorité militaire soviétique est consacrée lors dedeux affrontements non déclarés : à Changkufeng en 1938,à la frontière coréenne, et à Nomonhan, en 1939, à la fron-tière entre la Mongolie et la Mandchourie.
7. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,p. 58.
Décider et agir
81
la Marine. Les rapports entre ces deuxarmes restent, jusqu’à la deuxième guerremondiale, conflictuels mais stables. Eneffet, à une armée toute puissante qui ac-capare la majorité des crédits et pèse sur laconduite de la politique étrangère en pous-sant à l’expansion vers le Nord s’opposeune marine qui ne peut guère que s’atta-cher à la défense de ses intérêts 1.
À mesure que les victoires allemandes sesuccèdent, l’armée de terre japonaise sou-haite de plus en plus une alliance avec leTroisième Reich 2. Tel n’est pas le cas de lamarine qui refuse une alliance risquant del’entraîner dans un conflit prématuré avecles États-Unis. En son sein, une faction quidésire une alliance lâche, en arrière-planavec l’Allemagne, s’oppose à une autre quidésire le maintien d’une liberté d’actiontotale pour le Japon. Cette opposition nerelève pas de la doctrine mais renvoieavant tout à des choix stratégiques. Toutesles composantes de la marine, enrevanche, s’unissent pour souhaiter qu’uneguerre longue en Europe affaiblisse leRoyaume-Uni et la France. Elles craignentégalement qu’une victoire de l’Allemagneprovoque une intervention américaine afinde protéger les possessions occidentales.Par-dessus tout, c’est la perspective d’uneaction des États-Unis en direction desIndes orientales néerlandaises – jugées vi-tales en raison de leur richesse en pétroleet de leur position stratégique – qui lui estinsupportable 3.
La victoire allemande contre les Pays-Bas et la France, ainsi que la perspectived’une prochaine chute de l’Angleterre ap-portent de l’eau au moulin de l’armée deterre – qui pense pouvoir profiter du videlaissé en Asie –, alors que la marine re-doute toujours plus une réaction hostiledes Américains. La reconversion de
l’armée de terre à la stratégie traditionnel-lement défendue par la marine, l’expan-sion vers le Sud, n’apaise pas tout à fait larivalité entre les deux armes. Car si l’arméede terre considère l’occupation des posses-sions françaises et néerlandaises commeune simple promenade militaire, la marineestime qu’un conflit contre les États-Unisdeviendra alors inévitable 4.
Cependant, au moment de l’armisticefranco-allemand, le clivage armée/marinecommence à s’estomper. En effet, c’est lacrainte d’une intervention américaine quidétourne la marine de se prononcer enfaveur d’une intervention rapide contre lescolonies françaises et néerlandaises. Or,cette crainte est due essentiellement à lafaiblesse de l’aviation japonaise. Yama-moto Isoroku, le créateur de l’arme aéro-navale au Japon pense que, au stade oùcelle-ci en est en 1939, le Japon n’a aucunechance de remporter la victoire. Mais lamarine commence, au cours de l’année1940, à prendre confiance dans sa capacitéà contrôler les marines britannique et amé-ricaine en raison des progrès rapides ac-complis par sa force aérienne 5. En outre,l’attaché naval allemand à Tokyo, lecontre-amiral Paul Wenneker, déclare àdes responsables du haut commandementde la marine japonaise que le risque d’uneintervention de la part des États-Unis en di-rection de l’Asie du Sud-Est est réduit vul’impréparation de leur marine 6. Ainsi, lamarine, rassurée, s’accoutume donc àl’idée d’une intervention militaire rapide endirection du Sud au moment où le Japon seprépare à se jeter sur l’Indochine. Laconversion de l’armée à la stratégie d’ex-pansion méridionale équilibre peu à peules rapports de force entre les deux armeset apaise leur rivalité. De fait, l’armée deterre, structure jusque lors orientée vers lapréparation d’une guerre contre l’UnionSoviétique, dépend alors de sa rivale pour1. Mori Shigeki, « Sûjiku-gaikô oyobi nanshin-seisaku to
kaigun, 1939-1940 » (La diplomatie de l’Axe, l’expansionvers le Sud et la marine, 1939-1940), in Rekishigaku Kenkyû(Recherches historiques), n° 727, septembre 1999, p. 2.
2. Hata Fumihiko, « Futsuin… », op. cit., p. 154.3. Mori Shigeki, « Sûjiku-gaikô… », op. cit., p. 4-9.
4. Michel Vié, Le Japon et le monde au XXe siècle, Paris,Masson, 1995, p. 9.
5. Mori Shigeki, « Sûjiku-gaikô… », op. cit., p. 3.6. Ibid., p. 10.
Franck Michelin
82
de nombreuses questions relatives à lanouvelle stratégie 1.
Soulignons également que les innom-brables conflits qui éclatent au sein dessphères dirigeantes japonaises, l’arméecomprise, ne se réduisent pas à un conflitarmée de terre – marine. La vision sim-pliste d’une armée de terre va-t-en-guerreface à une marine plus modérée est uneséquelle du procès de Tokyo 2. Elle n’estpourtant acceptable que dans ses trèsgrandes lignes. En effet, la lecture attentivedes sources montre que les oppositionssont transversales, et que les partisans dela manière forte comme les adeptes de laprudence se retrouvent à tous les niveaux.Où se situent dès lors les lignes de fractureopposant faucons et colombes au sein desautorités japonaises ?
Ceux qui ont conservé, souvent jusqu’àce jour, l’image de bellicistes lors de la pé-riode ici étudiée se trouvent au sein dedeux structures distinctes : l’état-major del’armée de terre, à Tokyo, et les armées ja-ponaises qui évoluent dans le Sud de laChine, non loin du Tonkin. Ces dernièressont au nombre de deux : l’armée deChine du Sud, basée à Canton, et la22e armée, à Nanning. Nous venons de voirqu’elles avaient joué un certain rôle dansles prémisses de l’intervention japonaiseen Indochine du Nord 3. Bien que nomina-lement placées sous l’autorité de l’état-major du corps expéditionnaire de Chine,ces armées jouissent d’une autonomie im-portante 4. Leur objectif consiste à occuperl’Indochine afin de l’utiliser dans le cadrede leur stratégie contre la Chine 5, et no-tamment, comme l’écrit le chef d’état-major de la 22e armée, Wakamatsu Tada-kazu, de lancer une offensive contre Kun-
ming, capitale du Yunnan et point d’ar-rivée de la route d’Indochine 6.
Satô Kenryô, vice-chef d’état-major del’armée de Chine du Sud, est à la tête deces activistes 7. Le 21 juin, il rend visite àl’état-major de l’armée où il expose sesvues. Il insiste sur la nécessité d’effectuerl’opération de Kunming et, à cette fin,d’obtenir des bases dans le Nord de l’Indo-chine ainsi que cinq divisions supplémen-taires 8. La marine soupçonne lesdits acti-vistes de projeter, en occupant le Nord del’Indochine, de jeter les bases de la futureexpansion vers le Sud-Est asiatique et lePacifique, et à cette fin, d’entraîner lesautorités centrales de l’armée de terre surce chemin 9. Mais la marine ignore ce quise trame chez sa rivale, et il est bien diffi-cile de déterminer qui, des armées localesou des autorités militaires centrales, a en-traîné l’autre en raison du caractère engrande partie informel de leurs relations.
On peut néanmoins supposer que seforme un axe que constituent d’une partces armées locales, de l’autre de la pre-mière section de l’état-major de l’armée deterre, la section des opérations. Cette der-nière, décideuse en matière stratégique,joue un rôle éminent dans les événementsqui marquent l’Indochine en juin 1940.Selon les propos du colonel Arao Oki-katsu, responsable des opérations contre laChine de la section des opérations del’état-major de l’armée, son service sectionaurait souhaité occuper l’Indochine fran-çaise dès la fin de l’année 1939 10. Alors quela situation ne s’est pas encore décantée enEurope, la 1ère section de l’état-major del’armée se prépare et encourage les forces
1. Ibid., p. 1.2. Les représentants de l’armée de terre y furent les prin-
cipaux coupables, alors que les marins et les civils étaientpour la plupart absous ou condamnés à de faibles peines.Cf. Franck Michelin, « Le procès des criminels de guerrejaponais », in L’Histoire, n° 271, décembre 2002, p. 61.
3. Cf. supra, p. 77-79.4. Daihon.ei rikugunbu, t. 2, op. cit., p. 455. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,
p. 54
6. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,p. 50.
7. Il fera partie de la mission Nishihara (cf. supra, p. 8),au sein duquel il sera le représentant officieux des arméesbasées en Chine du Sud.
8. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,p. 51.
9. C’est ce qu’écrit le chef d’état-major de la 2e flotte deChine dans un rapport daté du 19 juin (Daihon.ei riku-gunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit., p. 54).
10. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii,op. cit., p. 50 et 54.
Décider et agir
83
japonaises de Chine du Sud à se tenirprêtes à saisir toute occasion favorable.
La fermeture de la frontière par Catroux,obtenue sous la pression diplomatique, nela satisfait pas entièrement puisqu’ellecontinue de prôner l’occupation de la co-lonie, par la force si nécessaire 1. Elle vajusqu’à manœuvrer de façon quasi clan-destine lorsqu’elle craint de ne pas être ap-prouvée par les autres organes décision-nels militaires et civils. Ainsi, c’est son chef,Tominaga Kyôji, qui, le 10 juin, aurait dé-pêché le lieutenant-colonel Takatsuki afinde communiquer les vues de son service àla 22e armée. Il ne s’agit pas d’une directivedu Grand État-Major (Daihon.ei), maisseulement de l’avis du chef de la 1ère sectionde l’état-major de l’armée que formule Ta-katsuki dans une « communication aux of-ficiers d’état-major » (bakuryô renraku),communication qui n’est d’ailleurs paspassée par le commandement général ducorps expéditionnaire de Chine 2. La collu-sion entre les forces locales et le service deTominaga est évidente lorsque l’on saitque cette communication officieuse suffit àfaire envoyer des forces par la 22e arméeaux abords de la frontière indochinoise.Tominaga désire d’ailleurs retirer le com-mandement des armées de Chine méridio-nale au corps expéditionnaire pour ledonner au Grand État-Major – c’est-à-dire àlui-même 3.
En effet, il a besoin d’un moyen depression direct sur l’Indochine afin d’ac-célérer le mouvement à un moment oùune grande partie de l’état-major del’armée, le commandement du corps ex-péditionnaire de Chine, la marine et le mi-nistère des Affaires étrangères, refusentune politique de force. Comme le mon-trent les souvenirs de Nemoto Hiroshi,ancien chef de l’armée de Chine du Sud,les forces de Chine méridionale devien-nent ses alliées objectives en juin 1940,même s’il semble que leur objectif soit
distinct du sien 4. Cela est dû à l’originalitéde la position du Tonkin : situé à la fron-tière chinoise et point de départ de la prin-cipale route de ravitaillement chinoise, ilintéresse ceux qui désirent faire plierChiang, c’est-à-dire les armées de Chine duSud ; se prolongeant, par le reste del’Union indochinoise, en direction du Sud,il pourrait devenir le point de départ idéald’une action contre les Philippines ou laMalaisie, but visé par la section des opéra-tions. En juin 1940, il tend à devenir lecentre de gravité de la politique étrangèrejaponaise, celui qui fait des armées deChine du Sud et des « faucons » de Tokyodes alliés car il semble constituer à la foisla porte de sortie du conflit chinois et lepoint de départ d’une nouvelle aventure,celle de l’expansion vers les régions méri-dionales.
Même après la formation de la missionde surveillance qui doit se rendre en In-dochine, la section des opérationscherche à provoquer l’entrée des troupesjaponaises au Tonkin en prétextant laprésence à la frontière d’un détachementde la 5e division qui serait en mauvaiseposture et dont l’évacuation par l’Indo-chine serait nécessaire. Nommé à la têtede la délégation de l’armée au sein de lamission d’observation, le colonel Ko.ikeRyôji contacte, le 23 juin, son ancien ca-marade de promotion, Okada Jûichi, chefdu bureau des opérations de la 1ère sectionde l’état-major de l’armée. Ce dernier dé-clare que le travail principal de Ko.ikeconsiste à obtenir le passage des troupesjaponaises par le territoire indochinois,que la date limite est fixée au 29 juin, etque l’on n’hésitera pas à utiliser la force sinécessaire 5.
Existerait cependant au sein de l’arméede terre, un parti modéré principalementconstitué de la 2e section de l’état-major etdu ministère. Au sein de ce dernier, c’est laquestion de l’usage de la force à l’encontre
1. Daihon.ei rikugunbu, op. cit., p. 46.2. Daihon.ei rikugunbu, op. cit., p. 45.3. Ibid., p. 79.
4. Daihon.ei rikugunbu, op. cit., p. 46.5. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,
p. 66.
Franck Michelin
84
de l’Indochine française qui constitue laligne de fracture entre les deux tendances.Le 18 juin, une réunion conclut au nonusage de la force, mais les débats ont étédes plus vifs 1. La position majoritaire ausein du ministère consisterait, semble-t-il,à tirer progressivement les marrons du feusans se brûler les doigts 2. Ne sachantquelle position adopter, le ministèresemble en fait chercher à gagner dutemps. Ce jour-là, c’est l’usage sans condi-tion de la force qui semble avoir été rejeté,et non son recours en cas d’échec des né-gociations.
Au sein de l’état-major, la 2e division –qui s’occupe essentiellement des activitésde renseignement – joue un grand rôledans la question indochinoise par l’inter-médiaire de son chef, Tsuchihashi Ta-keyasu. Celui-ci intervient dans la questionde la route d’Indochine, ainsi que dans ladécision d’envoyer une mission d’observa-tion en Indochine. Dans ses mémoires, ilaffirme que, partisan de la négociation, ilaurait cherché à respecter l’accord oralconclu avec l’attaché militaire françaisselon lequel ne serait envoyé en Indochinequ’un nombre restreint d’observateurs 3. Cetype d’écrit, ceci dit, offre surtout une légi-timation a posteriori de la part d’un desplus hauts responsables de l’armée. Dansun rapport envoyé le 30 juin à ses supé-rieurs, Yanagisawa, chef de la délégationde la marine au sein de la mission Nishi-hara, nous révèle un Tsuchihashi moinsdoux, pratiquant tour à tour la menace et lapersuasion pour convaincre l’attaché mili-taire français de fermer la frontière sino-in-dochinoise 4. En fait, l’opposition entreTsuchihashi et Tominaga relève plus d’unequestion de moyens que de fins. Au lieud’utiliser directement la force, Tsuchihashiutilise les moyens dont il dispose, et qui se
révèlent, semble-t-il, extrêmement efficaces :un contact direct avec l’attaché militaireThiébaud lui permet ainsi d’exercer unepression quasi-invisible sur le général Ca-troux.
La marine a, jusqu’à présent, conservél’image d’une institution à la fois modéréeet rationnelle. Partagée entre les partisansde l’alliance avec l’Allemagne et ceux del’indépendance décisionnelle du Japon,elle s’oppose, dans l’ensemble, à touteaction violente intempestive contre l’Indo-chine française. Elle craint en effet de voirles États-Unis prendre des mesures de ré-torsion contre le Japon. Le 29 juin, le vice-chef d’état-major, Kondô, précise à l’at-taché naval allemand Paul Wenneker qu’ilcraint la détérioration des relations nippo-américaines au cas où son pays occuperaitl’Indochine 5. La marine envoie, le 25 juin,un dragueur de mines à Haiphong, enthéorie pour envoyer sept observateurs enIndochine avant l’arrivée de la missionNishihara 6. Or, l’historien Mori Shigekinous apprend que le but réel est de testerles réactions anglo-saxonnes à un éventuelcoup de force en Indochine. De fait,Kojima Hideo, chef du 7e bureau de la3e section du haut commandement de lamarine, déclare à Wenecker, le 25 juin,avoir ainsi agi pour tester les réactions bri-tanniques et américaines 7.
Bien que la marine laisse à l’armée l’es-sentiel de la charge du problème indochi-nois – alors qu’elle prend en main celuides Indes orientales néerlandaises –, elleenvoie malgré tout une délégation en In-dochine. Les directives que, le 24 juin,reçoit le chef de cette délégation, Yanagi-sawa, de son vice-chef d’état-major, nousdonnent la substance des objectifs pour-suivis par la marine, puisqu’il s’agit icid’instructions particulières de la marine àson représentant, et non des instructionsgénérales rédigées en commun par les1. Entrée du mardi 18 juin du Sensô kimitsu nisshi,
op. cit., p. 10.2. Daihon.ei rikugunbu, op. cit., p. 46.3. Takeyasu Tsuchihashi, Gunpuku…, op. cit., p. 357.4. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,
p. 64.
5. Mori Shigeki, « Sûjiku-gaikô… », op. cit., p. 12.6. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,
p. 65.7. Mori Shigeki, « Sûjiku-gaikô… », op. cit., p. 12.
Décider et agir
85
chefs d’état-major des deux armes 1. L’am-bition de la marine consiste bel et bien àattirer l’Indochine dans l’empire japonais.Sa méthode est nettement plus subtile quecelle de sa rivale : elle cherche notammentà favoriser les sentiments nippophiles ausein de l’ensemble de la population indo-chinoise – c’est-à-dire parmi les commu-nautés autochtones, française et chinoise.Si sa crainte d’un conflit anticipé avec lespuissances anglo-saxonnes l’amène à re-jeter l’usage de la force, le fait qu’elle pré-voit un conflit long contre les États-Unisl’incite à exploiter les territoires que leJapon occupera afin de pallier les défi-ciences de l’économie japonaise, en ma-tières premières notamment. À cette fin, illui paraît nécessaire d’obtenir la collabora-tion, tant politique qu’économique, desautorités coloniales 2.
Quelle est la position des diplomates, ré-putés modérés ? Comme l’écrit YoshizawaMinami, ces derniers vont être en grandepartie écartés, en 1940, du problème indo-chinois 3. En effet, l’aspect stratégique val’emporter sur le côté politique de l’affaire,la question touchant à la guerre avec laChine, au projet militaire d’expansion versle Sud ainsi qu’au problème de l’acquisi-tion de matières premières stratégiques. Enoutre, l’ascendant de l’armée sur les pro-blèmes de politique étrangère s’accentue.Il n’est donc guère surprenant que nousn’ayons guère pu trouver de document ex-
primant clairement la position des Affairesétrangères à cette date.
En revanche, nous avons trouvéquelques pièces concernant les vues del’empereur sur la question. Celui-ci, nousl’avons dit, interroge, le 20 juin, les diri-geants de l’armée sur la nécessité d’en-voyer ou non des troupes dans les coloniesfrançaises et néerlandaises, mais il neprend pas alors position 4. En fait, si l’em-pereur déteste l’idée d’une expansion duJapon à des fins purement égoïstes, il semontre malgré tout favorable à l’expansionde son pays à la condition que celle-cis’appuie sur des principes moraux commele suggère le journal de Kido 5 : « Au coursde l’audience d’aujourd’hui, alors que nousabordions la question de l’Indochine fran-çaise, sa majesté a déclaré qu’elle ne dési-rait pas que notre pays adopte une attitudecomparable à celles de Frédéric le grandou de Napoléon – pour tout dire, une atti-tude machiavélique –, mais qu’elle aime-rait au contraire que nous n’oubliions pasl’esprit juste de la maxime qui constitue lavoie que nous suivons depuis le temps desdieux : “Les huit coins du monde sous unmême toit 6.” »
Comme l’écrit l’historien Yamada Akira,l’empereur pense que l’une des tâches dusouverain consiste, si l’occasion s’en pré-sente, à agrandir le territoire de son pays.C’est la raison pour laquelle il révère songrand-père, l’empereur Meiji – le Japonayant alors acquis sous son règne Taïwanet la Corée. Bien qu’il possède alors unbuste de Napoléon – qu’il avait achetélui-même lors de son voyage en Europe –,il semble qu’il s’oppose à l’idée de réa-liser des conquêtes par la seule puissancemilitaire. Lors de l’incident de Mand-
1. Daihon.ei kaigunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,p. 39.
2. La marine suit d’ailleurs cette ligne de conduite àl’égard des Indes orientales néerlandaises. En effet, non seu-lement une intervention violente à l’encontre de cette co-lonie risquerait d’entraîner le Japon dans un conflit préma-turé avec les Américains, mais elle pourrait égalementamener les autorités néerlandaises à mettre le feu aux puitsde pétrole tant convoités (ce qu’elles feront lors de l’inva-sion japonaise de 1942). L’objectif de la marine consiste àexploiter les ressources de ce territoire avec le maximumd’efficacité, c’est à dire sans avoir recours à la guerre, et sipossible en collaboration avec les autorités néerlandaises,voire britanniques (cf. Mori Shigeki, « Sûjiku-gaikô… »,op. cit., p. 9).
3. Op. cit., p. 21. Les diplomates faisant partie de la mis-sion Nishihara vont être placés sous l’autorité de ce dernier,et par conséquent soumis à l’autorité des militaires.
4. Cf. supra, p. 78.5. Kido Kôichi, Kido Kôichi nikki, op. cit., p. 794.6. Cette expression, tirée du Nihon Shoki (ouvrage datant
du début du 7e siècle, qui constitue l’histoire officielle duJapon écrite en chinois afin notamment de justifier l’auto-nomie du Japon par rapport à la Chine), servit de slogan auxpartisans de l’expansion afin de justifier les visées impéria-listes d’un Japon qui prendrait la direction du monde pourle bien de tous les peuples.
Franck Michelin
86
chourie 1 et pour la guerre avec la Chine, ils’était au départ opposé à l’usage de laforce pour ensuite reconnaître les exten-sions territoriales et louer ceux qui avaientagi de leur propre chef. Plus que l’usage dela force en tant que tel, c’est d’y avoir re-cours de façon désordonnée et impulsivequi le dérange. Il privilégie en effet les pré-parations minutieuses, ce qui semble avoireu une influence sur l’accélération de l’éta-blissement de plans d’opérations rigoureuxpar les militaires dans les années précédantimmédiatement la guerre 2. Dans l’affaireindochinoise, il ne prend donc pas posi-tion contre l’idée d’utiliser la force. Mais ilréagira vigoureusement contre les respon-sables des incidents créés à la frontièresino-indochinoise en septembre 1940, cesderniers ayant agi de façon impulsive, sansordre de Tokyo, alors qu’un accord venaitd’être conclu avec la France 3.
� LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE JAPONAISE,UN ESSAI D’EXPLICATION
Quoique cette opposition soit réelle etacerbe, deux points importants méritentd’être soulignés. Le conflit entre faucons etcolombes, tout d’abord, ne se situe guèrequ’au niveau du choix des moyens de l’oc-cupation de l’Indochine, la nécessité d’oc-cuper la colonie fixant un quasi-consensusparmi les dirigeants japonais dès juin 1940 4.C’est donc, deuxième point, l’usage de laforce qui sépare les deux camps. Les fau-cons prônent la manière forte contre uneFrance qui, selon eux, finira par céder à lamenace. En leur sein, les membres desarmées locales ne perçoivent guère l’opéra-tion que dans le cadre étroit de la guerre
avec la Chine, et cette dernière a pu êtremenée depuis trois ans par le Japon sansconséquence majeure sur le plan interna-tional. Quant aux officiers de la 1ère sectionde l’état-major de l’armée, ils pensent que niles Britanniques – menacés d’une invasionallemande – ni les Américains – pas encoreprêts à entrer en guerre – n’interviendrontpour aider une France défaite et défaitiste.Les colombes, en revanche, redoutent uneréaction des États-Unis qui pourraient réagirafin de protéger leurs possessions et leurallié britannique. Ils préconisent donc unepression diplomatique et une occupationqui prendrait la forme d’un accord présen-tant toutes les apparences de la légalitéentre le Japon et la France.
L’accent porté sur le conflit opposant ex-trémistes et modérés constitue la vision laplus répandue de l’histoire de la deuxièmeguerre mondiale, tant au Japon qu’auxÉtats-Unis. Le procès de Tokyo avait d’ail-leurs épargné la marine 5. Cette « histoireofficielle » distingue, à chaque étage du sys-tème politique nippon, un parti modéré etun parti extrémiste : les civils et les mili-taires, la marine et l’armée, le ministère del’armée et l’état-major, ce dernier et lesarmées locales, et, au sein de l’état-major la2e section et la 1ère. Elle se fonde sur unethéorie des meneurs : en cherchant quelsindividus ou quels groupes ont joué le plusgrand rôle dans le processus d’expansion,elle construit leurs opposants en résistantsà l’extension de la guerre.
Comme l’écrit Yoshizawa Minami, cer-tains ouvrages (ceux écrit par Hata Fumi-hiko 6 ou par le Département d’histoire dela guerre du Centre de recherche sur la dé-fense de l’Agence de la défense (BôeichôBôei Kenshûjo Senshishitsu) 7) visent à dé-1. Incident de Mandchourie : en japonais Manshû Jihen.
Coup de force, en 1931, des troupes japonaises basées enMandchourie qui mène à l’occupation et à satellisation duNord-Est de la Chine. Déclenché sans l’accord des autoritéscentrales par des officiers supérieurs – notamment IshiwaraKanji – mais avalisé par la suite, il mène, devant la condam-nation du Japon par la Société des Nations, au retrait decelui-ci de l’organisation internationale.
2. Yamada Akira, Daigensui, Shôwa Tennô, Tokyo, ShinNihon Shuppansha, 1994, p. 111.
3. Cf. note 2, p. 76.4. Cf. supra, p. 80.
5. Cf. supra, p. 82.6. Hata Fumihiko, « Futsuin… », op. cit.7. C’est ce département de l’Agence de la Défense qui a
compilé la « Collection sur l’histoire de la guerre » (Senshisôsho) qui a constitué la principale source de documents denotre travail, sous le titre de Daihon.ei rikugunbu etDaihon.ei kaigunbu. Si les documents cités sont fiables, l’in-terprétation qui en est donnée est généralement à lire d’unœil vigilant.
Décider et agir
87
signer des personnes et des groupes res-ponsables de la guerre, afin de protégerl’honneur de l’ex-armée impériale 1. Unparfait exemple se situe page 154 del’ouvrage de Hata. En effet, ce dernier faitde la 1ère division de l’état-major de l’arméeun foyer de « têtes brûlées » désirant oc-cuper l’Indochine afin de réaliser la pre-mière étape de l’expansion vers le Sud. Enoutre, il oppose un état-major belliqueux àun ministère modéré 2. Il va même, afind’innocenter le ministère, jusqu’à pré-tendre que celui-ci aurait refusé toute in-tervention armée, se contentant d’envoyerla mission Nishihara en Indochine pourfaire cesser le transit. Cette thèse repré-sente pourtant une contre-vérité, puisquecette mission fut constituée par l’état-major– état-major dont elle ne cessera de dé-pendre par la suite 3. Une excellente illustra-tion du topos de la conspiration visant àuser de la force se trouve dans la compila-tion de documents commentés par leBureau d’histoire militaire de l’Agence de ladéfense. Alors que l’armée et la marinen’auraient encore établi aucune ligne direc-trice de la politique à mener à l’encontre del’Indochine, le service de Tominaga et lesarmées locales auraient pris des mesuresvisant à utiliser la force contre la coloniefrançaise, ce qui constituerait une raisonessentielle du caractère troublé de l’occu-pation du Tonkin en septembre 1940.Ainsi, ceux-ci constituent de parfaits boucsémissaires 4.
Si l’opposition entre ceux que nouspourrions baptiser les « intrépides » et les« prudents », constitue l’une des causes ducaractère chaotique de l’intrusion du Japonen Indochine, celle-ci n’explique en rien la
manière dont le Japon a marché vers laguerre de juin 1940 à décembre 1941. Eneffet, se lançant toujours plus en avant,Tokyo occupe le Nord de la colonie fran-çaise, arbitre – en majesté – le conflitfranco-thaïlandais, s’empare progressive-ment du contrôle de l’économie indochi-noise, et s’engage finalement dans la luttecontre les puissances anglo-saxonnes.Pourtant, le caractère minoritaire de l’al-liance entre une seule section de l’état-major de l’armée de terre et deux arméeslocales n’aurait pas pu, semble-t-il, assurerun tel triomphe aux extrémistes face auclan des modérés constitué de la plusgrande partie du même état-major, du mi-nistère de l’Armée, de la marine au grandcomplet, de la diplomatie et de l’empereur.Comment expliquer alors cette course enavant de la politique étrangère japonaise ?Pour répondre à cette question, il nous fautà présent tenter de démonter les méca-nismes de la prise de décision chez les di-rigeants japonais.
La théorie des meneurs 5 tend à simpli-fier l’interprétation du conflit entre les avo-cats de la force et ceux des négociations enen faisant un affrontement entre deux poli-tiques déterminées : extension ou non ex-tension de la guerre. Or, cette oppositionn’est pas constante, et l’opposition à l’ex-tension de la guerre marque plutôt la re-cherche d’un autre type d’extension 6.Yoshizawa Minami attire pourtant l’atten-tion sur le principal défaut de cette thèse :elle omet de considérer les conflits déci-sionnels comme un processus dyna-mique 7. Il ne s’agit pas, en effet, de l’oppo-sition statique de deux positions bienétablies, mais d’un processus dynamiquemarqué par des relations de rivalité entreles différents groupes au cours duquelchacun essaie de prendre la tête du mou-
1. Yoshizawa Minami, « Sensô kadai… », op. cit., p. 6.2. En raison de l’existence, pour les deux armes, d’un état-
major – chargé des questions stratégiques et tactiques –, etd’un ministère – chargé de l’administration de l’armée –,subsiste encore aujourd’hui la vision d’une opposition entreun état-major belliciste et un ministère opposé aux solutionsde force. Toutefois, cette opposition nous semble artificielledu fait de l’existence de nombreuses passerelles entre lesdeux organismes.
3. Cf. supra, p. 79.4. Daihon.ei rikugunbu, op. cit., t. 2, p. 46.
5. Cf. supra, p. 86.6. Par exemple, les partisans d’une action contre l’URSS
s’opposent à une intervention contre les colonies occiden-tales, tandis que les tenants de l’expansion vers le Sud refu-sent toute nouvelle opération en Chine.
7. Yoshizawa Minami, « Sensô kadai… », op. cit., p. 6-8.
Franck Michelin
88
vement d’expansion. Les partisans de lathéorie des meneurs, à notre sens, ne pren-nent donc pas suffisamment en compte lesfacteurs structurels 1.
Rappelons en effet que la prise de déci-sion au Japon obéit à certaines modalités.Tout d’abord, l’imprécision de la définitiondes concepts qu’expriment mots et expres-sions-clés utilisés par les dirigeants pourénoncer leur politique constitue, d’unepart, une conséquence et une cause desoppositions entre décideurs. Elle joue,d’autre part, un rôle d’amortisseur permet-tant des changements de politique pro-gressifs, ainsi que l’établissement de com-promis selon des formes floues 2. Demême, les dirigeants japonais, malgré leursconflits, restent unis quant au principe fon-damental de la politique à mener : l’expan-sion. La cause de ces conflits est à chercherdans la contradiction qui existe entre lesdeux caractéristiques de l’impérialismejaponais : sa volonté de bâtir une puis-sance militaire autosuffisante, et sa dépen-dance économique vis-à-vis des États-Uniset du Royaume-Uni. Naissent de cettecontradiction deux politiques étrangèresantagonistes : l’une vise à établir une doc-trine Monroe asiatique tendant à exclureces deux puissances d’Asie ; l’autre oblige àcoopérer avec ces dernières dans le cadrecréé par la Conférence de Washington 3.
La façon dont les décisions sont prisesau sein du groupe qui décide de la guerreconstitue également un point extrêmementimportant. En effet, les diverses positionssont présentées parallèlement (ryôron hei-ritsu), et la politique adoptée accorde uneimportance égale aux différents points devue (ryôron heiki). Il n’y a pas de débat lo-gique permettant un échange d’arguments,
et ainsi la constitution d’un véritableconsensus. Aucune décision ferme n’estprise en faveur de l’une ou l’autre desidées avancées, ce qui permet de résoudreles conflits. Ce type de décision patchworkconstituée de positions contradictoiresrend les politiques adoptées particulière-ment imprécises. Une phrase d’IshiwaraKanji, prononcée après qu’il a quitté sa po-sition à l’état-major de l’armée, exprimebien cet état de fait : « Dans notre armée etnotre marine, nous avons des plans d’opé-ration, mais pas réellement de plan deguerre 4. » Conséquence fâcheuse de cetype de décision qui met en avant deuxpoints de vue en leur donnant une impor-tance égale, chacune d’entre elles peut gé-nérer au moins deux types d’action diffé-rents. En outre, les conflits qui déchirentles différentes sections au sein du groupequi prépare puis mène la guerre créent unmouvement d’oscillation en spirale de plusen plus violent allant de la confrontationau compromis, ce qui a pour résultatd’exacerber les frictions et de renforcer lemouvement vers la guerre 5. L’on assisteainsi à un processus de radicalisation per-manente, le seul moyen dont dispose ungroupe d’imposer ses vues consistant àlancer des propositions plus radicales quecelles de ses rivaux.
Dresser un aperçu du fonctionnementdu système impérial d’avant 1945 s’imposepour étudier le processus de décision chezles dirigeants japonais car l’empereur cons-titue alors la pierre d’achoppement del’édifice politique. Dans un monde si pro-fondément marqué par les luttes entrecliques et où ni le service de l’État, ni lasouveraineté populaire, ni la morale reli-gieuse ne tiennent une grande place, lerôle de l’empereur est central, comme lerappelle avec pertinence le politologue ja-ponais Maruyama Masao 6 : « Ce qui déter-minait la morale quotidienne de la classe
1. En cela, nous pouvons les rapprocher des « personna-listes » qui, parmi les spécialistes du régime nazi, mettent es-sentiellement l’accent sur la personnalité de Hitler. Or, dansle cas du Japon, cette thèse est d’autant plus insoutenableque personne n’a pu y tenir le rôle d’un Hitler.
2. Shiraishi Masaya et Furuta Motô, « Taiheiyô sensô ki noNihon to tai Indoshina seisaku », in Ajia Kenkyû, t. 23, n° 3,octobre 1976, p. 3.
3. Yoshizawa Minami, « Sensô kadai… », op. cit., p. 9.
4. Cité par Michael A. Barnhart, « Japan prepares… »,op. cit., p. 143.
5. Yoshizawa Minami, « Sensô kadai… », op. cit., p. 11.6. Gendai seiji no shisô to kôdô, Tokyo, Miraisha, 1964.
Décider et agir
89
dirigeante n’était, ni une conscience abs-traite de la légalité, ni un sens intime de cequ’était un crime, ni le concept de servicepublic : c’était le sentiment de proximitéentretenu vis-à-vis de l’entité concrète etsensible qu’était l’empereur. Il allait alorsde soi que ces personnes identifieraientleurs propres intérêts à ceux de l’empe-reur, et assimileraient automatiquementleurs adversaires à des usurpateurs desprérogatives impériales. »
Chaque groupe essaie d’établir un lienvertical direct avec l’empereur, ce qui luipermet alors d’agir de façon indépen-dante. Quant au souverain, il doit af-fronter une contradiction particulière ausystème impérial entre le caractère ultimede son pouvoir et la pluralité des forcespolitiques qui en sont issues. Deux mé-thodes sont employées pour la résoudre :la première consiste à insister sur ce ca-ractère ultime et unique du pouvoir impé-rial, tandis que la seconde vise à respecterle pluralisme 1. La seconde méthode né-cessite un processus de décision accor-dant un poids équivalent aux diverses po-sitions. La première est à chercher dans letexte et l’application de la constitution deMeiji. En effet, celle-ci accorde à l’empe-reur un pouvoir extrêmement étendu, quien fait, selon l’historien Ienaga Saburô, unmonarque autocratique et absolu n’ayantpas la possibilité d’agir en souverain cons-titutionnel 2.
Il existe toutefois une limite constitution-nelle à l’exercice, par l’empereur, de sesprérogatives : la nécessité de consulter lesministres d’État. Celle-ci est cependanttoute relative puisque ces derniers devantassumer la totalité des responsabilités dé-coulant de l’exécution des décisions impé-riales, l’empereur se trouve placé endehors des sphères de responsabilitéslégale et politique. Une prérogative de-meure pourtant inconditionnelle : celle ducommandement suprême des armées, car
elle ne nécessite pas l’avis des ministresd’État. Surtout, les chefs d’état-major desdeux armes ont le droit de s’adresser direc-tement à l’empereur concernant ces af-faires en vertu de ce que l’on appelle« l’indépendance du commandementsuprême » (tôsuiken no dokuritsu) 3. Cetteindépendance des militaires vis-à-vis dugouvernement, ainsi que l’extension deson domaine d’application à l’approche dela guerre créent une division nette entre legouvernement et l’armée 4.
Ainsi, trois pouvoirs à peu près indépen-dants rivalisent entre eux, sans qu’aucunne puisse tout à fait prendre un ascendantdécisif 5. Seul l’empereur peut résoudre cesconflits en se présentant en arbitre. Avec lamarche vers la guerre, ces conflits devien-nent chroniques, ce qui l’oblige à jouer deplus en plus le rôle du souverain absolu.Afin de déterminer les choix politiquesimportants, il réunit tout simplementmembres du gouvernement et de l’état-major impérial, car il s’agit de la façon laplus rapide de parvenir à un consensus.Néanmoins, afin de conserver son côtésacré et inviolable, il doit continuer d’êtreperçu comme une entité transcendantale,au-dessus des factions. Cette donnéesemble contredire l’extension de son pou-voir, mais il use de sa position transcen-dantale comme une forme de déguisementqui lui permet d’exercer, dans les faits, son
1. Yoshizawa Minami, « Sensô kadai… », op. cit., p. 13.2. Ienaga Saburô, Rekishi no naka no kenpô, t. 1, Tokyo,
Tokyo Daigaku Shuppankai, p. 70.
3. En vigueur en Allemagne, la notion juridique d’indé-pendance du commandement suprême est adoptée auJapon dans la seconde moitié du 19e siècle. En Allemagne,elle est notamment à l’origine de la soumission des autoritésciviles à l’armée durant la première guerre mondiale. AuJapon, elle a pour conséquence, à compter de la fin desannées 1920, d’empêcher tout contrôle du gouvernementsur l’armée, et finalement de rendre l’armée toute puissante,celle-ci dépendant directement de l’empereur.
4. Yoshizawa Minami, « Sensô kadai… », op. cit., p. 14.5. Il faut toutefois souligner qu’indépendance ne signifie
pas ici égalité. En effet, l’armée va à peu près continuelle-ment rester en position de force face à la marine. De plus,alors que le gouvernement ne peut exercer la moindre pres-sion directe sur les militaires, ces derniers sont en mesure debloquer le travail, voire de provoquer la chute de tout gou-vernement du fait que les deux armes disposent chacuned’un ministre au sein du gouvernement, qu’aucun cabinetne peut être constitué sans que ces ministres ne soientnommés et que ces ministres doivent obligatoirement êtredes officiers d’active.
Franck Michelin
90
rôle d’unificateur 1. Ce qui explique le ren-forcement de l’aspect cérémoniel du règnede Hirohito 2. Quant à la pression qui ré-sulte des conflits intenses qui déchirent lesfactions, deux valves semblent avoirpermis de la laisser s’échapper : la répres-sion au Japon des mouvements d’opposi-tion à la guerre et à la classe dirigeante, etla marche à la guerre 3.
Mettant en rapport la question de laprise de décision au Japon et le problèmede l’Indochine française, YoshizawaMinami écrit 4 : « Concrètement, si l’on con-sidère les différentes circonstances qui en-tourèrent l’occupation par l’armée japo-naise du Nord (1940) et du Sud del’Indochine française, il apparaît en défini-tive que l’opposition entre la faction prô-nant l’usage de la force, qui prit l’initiativede l’occupation, et celle favorable aux né-gociations, autrement dit à une occupationpacifique, ou encore le conflit opposant lafaction favorable à l’expansion vers le Sudà celle militant pour une entrée en guerrecontre l’Union Soviétique, c’est-à-dire lafaction soutenant l’idée d’une expansionvers le Nord, constituent une lutte, à la foissouterraine et déclarée, entre les “blaireauxd’un même terrier” ; ainsi, il nous estimpossible de considérer qu’elles aient puavoir une action permettant de juguler l’ex-tension ou la continuation de la guerre. »
La faction favorable à la tenue de négo-ciations avec le gouvernement générald’Indochine ne chercherait donc pas à en-rayer la marche à la guerre, mais constitue-rait au contraire un participant actif à ceprocessus.
Les divisions, ainsi que la façon dontelles se résolvent, sont clairement visiblesdès la formation de la mission Nishihara.Le fait que la marine obtienne l’autonomied’action vis-à-vis du chef de la mission –lui-même membre de l’armée – reflète cesectionnalisme. L’armée de terre se signalepar le jeu particulier qu’elle cherche àmener. Ayant obtenu une informationselon laquelle cette dernière prépareraitdes instructions secrètes pour son repré-sentant, le chef du haut commandementde la marine déclare au chef du « bureaudu Sud » de la 2e section de l’état-major del’armée de terre, le lieutenant-colonel Mu-rakami Kimisuke, venu afin d’établir unaccord sur la question des directives et desordres à envoyer en Indochine française 5 :« Il faut que nous donnions des instruc-tions claires concernant les questions quidevront servir de modèles à notre actionlorsqu’elle dépassera le cadre des activitésd’observation, par exemple à propos de ceque nous ferons de l’Indochine françaisedans l’avenir. »
Bien que chacun des deux commande-ments mène un jeu particulier, il existedonc bel et bien un désir d’aboutir à unecertaine synthèse – au vrai indispensable àtoute politique. Ainsi, le jour suivant, Mu-rakami apporte au haut commandementde la marine le projet d’instructions duvice-chef de l’état-major de l’armée deterre pour lequel il demande l’accord de lamarine. Il déclare alors 6 : « En fait, ce planest à la fois plus vaste et plus importantque les instructions du chef d’état-major del’armée. »
L’état-major de l’armée joue franc-jeu, etexpose à l’état-major de la marine son
1. La façon dont le souverain britannique, Georges V,influe sur la conduite de la politique de son pays, notam-ment pendant la guerre, de façon souterraine mais efficace,ainsi que sa manière d’utiliser les rites monarchiques pourrendre populaire la Couronne et renforcer le nationalismene sont pas sans rappeler ce que fait Hirohito. À cet égard,il est intéressant de se rappeler que ce dernier fut très favo-rablement impressionné par Georges V durant son voyageen Europe (1920-1921), et que son entourage prit bien notede ces pratiques. Cf. Herbert P. Bix, Hirohito and themaking of modern Japan, New York, Harper Collins, 2000,p. 115-118.
2. Le même phénomène se produit également en Grande-Bretagne dans la seconde moitié du 19e siècle (cf. DavidCannadine, « The Context, Performance and Meaning of Ri-tual. The British Monarchy and the Invention of Tradition »,in Eric Hobsbawn et Terence Ranger (dir.), The Invention ofTradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983,p. 101-164).
3. Yoshizawa Minami, « Sensô kadai… », op. cit., p. 15-16.4. Ibid., p. 5.
5. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,p. 65.
6. Ibid., p. 66.
Décider et agir
91
désir d’obtenir le passage des troupes japo-naises par le Tonkin, ainsi que l’usaged’aérodromes en territoire indochinois.Mais si le haut commandement de lamarine acquiesce, tel n’est pas le cas duministre, Yoshida Zengo, qui s’oppose à ceque cela figure dans les instructions à en-voyer au représentant de la marine au seinde la mission Nishihara, Yanagisawa, la dé-cision n’ayant pas été prise au niveau na-tional 1.
Les directives du vice-chef de l’état-major de l’armée à Nishihara et celles deson homologue du haut commandementde la marine à Yanagisawa restent tout àfait différentes. En effet, les premières met-tent l’accent sur des points stratégiques telsque le passage des troupes par l’Indochineou l’utilisation d’aérodromes 2, alors queles secondes mettent en avant un projetplus vaste qui n’est rien d’autre que l’ab-sorption de la colonie française 3 : « Colla-borant avec l’armée, et ayant pour objectifde contribuer à hâter la résolution de l’In-cident de Chine et à construire un nouvelordre en Asie orientale, vous devrez agirdans les domaines politique et écono-mique afin d’attirer totalement l’Indochinefrançaise dans le camp de l’Empire, ainsique faire le nécessaire dans le Guanxi et leYunnan. »
Soulignons toutefois que les directivesdes deux commandements, malgré leursdifférences, ne se contredisent en rien, lesdifférences caractérisant les perspectivesplus que les objectifs. Si les instructions dela marine, à la différence de celles del’armée de terre, restent prudentes, cher-chant à éviter toute solution de force dansl’immédiat, elles ne font pas mystère d’undésir profond de s’emparer de la coloniefrançaise. En fait, en s’additionnant, cesinstructions risquent de mettre de l’huilesur le feu, les dispositions belliqueuses de
l’armée de terre renforçant les ambitionsexpansionnistes de la marine et vice-versa.
La mission d’observation elle-mêmeconstitue, dès sa formation, une sorte demicrocosme des luttes de factions parmiles dirigeants japonais. Son caractère com-posite 4 – elle est composée de représentantsdes deux états-majors, de la diplomatie, etdes armées de Chine du Sud – marque lavolonté des autorités de synthétiser les dif-férents points de vue. Mais il ne va serviren fait qu’à exacerber la désunion. Les ins-tructions conjointes adressées par l’arméeet la marine à Nishihara constituent un par-fait exemple de ce problème : au lieu destipuler une action unique, elles énoncentles points de vue respectifs des deuxarmes 5. Étant donné que les représentantsdes Affaires étrangères sont placés sousl’autorité des militaires 6, le conflit mili-taires/diplomates ne va pas prendre l’am-pleur qu’il a à Tokyo. Par contre, celui quioppose l’armée à la marine va se repro-duire à peu près à l’identique. En outre,l’inclusion de représentants des armées deChine du Sud dans la mission accentue lesdivisions. Se joue alors un « jeu à trois »entre l’état-major de l’armée, les armées lo-cales et la marine 7.
Moment-clé donc, où l’histoire s’emballeet se resserre, l’intrusion du Japon en Indo-chine française permet de saisir, sur letemps court, la nature du processus de déci-sion au Japon en matière de politique étran-gère et de stratégie. Le Japon est, depuis lafin des années 1920, une sorte de bateauivre, presque ingouvernable, en proie auxassassinats, aux coups de force, et aux riva-lités des différentes autorités, un pays envoie de fascisation sous fond de crise socialeet politique. Il n’y a alors rien de plus diffi-cile pour les décideurs que d’adopter unepolitique claire et de l’appliquer avec effica-
1. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,p. 66.
2. Daihon.ei rikugunbu, op. cit., p. 76.3. Daihon.ei rikugunbu, Daitôa-sensô kaisen keii, op. cit.,
p. 66.
4. Cf. supra, p. 78-79.5. Yoshizawa Minami, « Sensô kadai… », op. cit., p. 10-11.6. Ceux-ci étant soumis aux militaires, et le consul gé-
néral, Suzuki Rokurô, étant placé à la tête de cette déléga-tion des Affaires étrangères, le consulat lui-même va donctomber sous la coupe de l’état-major impérial.
7. Yoshizawa Minami, « Sensô kadai… », op. cit., p. 20-22.
Franck Michelin
92
cité et constance. Se débattant dans un envi-ronnement international toujours plus dan-gereux et instable, le Japon ne sait quel partiprendre dans la crise qui annonce l’embra-sement de la seconde guerre mondiale. Maisl’effondrement de la France en Europe luifait entrevoir la possibilité de réaliser la pre-mière étape de l’expansion vers le Sud sansprendre de grand risque. Il doit toutefoisagir rapidement afin de profiter de la situa-tion d’isolement de l’Indochine et du troubledes Anglo-Saxons. Et ce Japon ingouver-nable y parvient en moins d’un mois. Cettepériode très courte, qui constitue alors uneexception, permet d’analyser clairement lesdifférentes composantes du processus déci-sionnel au Japon, un peu comme s’il s’agis-sait d’une expérience in vitro.
Ce processus de décision comportedeux caractéristiques fondamentales. Pre-mièrement, il n’y pas d’opposition entre uncamp belliciste et un autre pacifiste. Briserle statu quo né de la conférence deWashington au moyen d’une expansionterritoriale fait l’objet d’un quasi-consensusau sein des sphères dirigeantes à l’ap-proche du second conflit mondial. Seuls ladirection et les moyens font l’objet d’undébat. Tous les conflits, souvent aigus,chez les dirigeants se rapportent à cesdeux derniers points, et tout refus d’uneforme d’expansion signifie la recherched’une autre forme d’expansion. Mettre enéchec ses rivaux ne peut se faire qu’en dé-passant leur position, ce qui aboutit à unprocessus de radicalisation permanentequi va accélérer la marche à la guerre. Cescénario se vérifie dans sa varianteindochinoise : l’intrusion dans la coloniefixe un consensus mais la méthode – uti-liser la force ou non – fait l’objet d’undébat, débat qui débouche sur l’accéléra-tion de l’absorption de la colonie françaiseentre juin 1940 et décembre 1941.
Deuxièmement, le Japon ne possédantalors ni fonctionnement étatique bienancré, ni religion transcendante, ni tradi-tion fondée sur la souveraineté populaire,le seul principe légitimant chez les diri-
geants du Japon de cette période résidedans la personne de l’empereur. C’est laproximité vis-à-vis de sa personne quipermet de faire triompher ses vues surcelles de rivaux plus éloignés du souve-rain. Dans ce contexte, l’accès direct àl’empereur dont bénéficient les dirigeantsmilitaires leur offre un ascendant sur leurscompétiteurs civils. De nombreux cher-cheurs pensent aujourd’hui que Hirohitoest alors un souverain actif, animé par l’am-bition de redonner à sa famille l’ascendantqu’elle avait perdu sous le règne de sonpère 1. L’accès direct des militaires à sa per-sonne, le côté inconditionnel de son pou-voir de commandement (le tôsuiken), et lanécessité qu’ont les dirigeants des forcesarmées de s’appuyer sur lui pour fairetriompher leurs vues lui permettent de ren-forcer son ascendant sur le pays par l’inter-médiaire de ces derniers. Mais comme,selon la tradition, il ne peut faire valoir sonpoint de vue de façon trop ouverte, il doitexercer son influence de façon souterraine.Il réussit toutefois à renforcer son pouvoiren tant qu’arbitre du jeu politique et réussitainsi, au prix de l’accélération de la courseà la guerre, à stabiliser le fonctionnementétatique de son pays. À cette fin, il utilisedeux moyens : le renforcement de sonprestige par le biais de l’appareil cérémo-nial, et la réunion d’instances gouverne-mentales officieuses, regroupant un petitnombre de décideurs militaires et civils 2.
1. Le pouvoir de l’empereur est très peu fixé par la cons-titution promulguée en 1889. Il s’agit d’un pouvoir flou, maisillimité. Son étendue dépend en bonne partie de la person-nalité du souverain régnant, ainsi que des conditions socio-politiques de l’époque. Le père de Hirohito, Yoshihito, étantatteint de graves troubles mentaux, le pouvoir impérials’était effrité sous son règne, et ce d’autant plus que le pro-cessus démocratique – connu au Japon sous le nom deTaishô demokurashii (démocratie de l’ère Taishô) – étaitbien entamé.
2. À cet égard, l’arrivée au poste de ministre de l’Arméede terre, puis de Premier ministre, de Tôjô Hideki, person-nage tout dévoué à l’empereur, peut être considéré commeune victoire politique de Hirohito, bien que celui-ci ait gardéjusqu’à ce jour l’image d’un dictateur auquel l’empereurn’aurait pu résister. Ce rôle a d’ailleurs été parfaitementassumé par Tôjô lors du procès de Tokyo dans le but deprotéger son souverain (cf. Franck Michelin, « Le procès descriminels de guerre japonais », op. cit., p. 60).
Décider et agir
93
Comme on peut le voir dans le cas del’Indochine en juin 1940, les rivalitésentre les différentes instances de décisionmènent à édifier des compromis bancalsoù chacun fait valoir ses vues. Au lieu decalmer la situation, ces compromis nesont adoptés qu’au prix de la reconnais-sance des visées agressives des différentsprotagonistes, ce qui constitue, à chaquefois, le point de départ d’un nouvel élanvers l’expansionnisme. Dans le cas del’Indochine, les revendications qui exi-gent, entre autres, la fermeture de la fron-tière sino-indochinoise, le stationnementde troupes au Tonkin, l’utilisation d’aéro-dromes, le ravitaillement et le passage parl’Indochine de troupes japonaises quiévoluent en Chine du Sud…seront toutesadoptées par le Japon et la France devra yconsentir. L’on peut ainsi dire que la poli-
tique étrangère du Japon de la périodequi précède la guerre du Pacifique est unepolitique qui ne connaît pas de marchearrière. L’analyse du processus déci-sionnel dans l’affaire indochinoise permetainsi de comprendre pourquoi le Japonsera incapable, dans la seconde moitié del’année 1941, de freiner sa marche versune guerre perdue d’avance contre lesÉtats-Unis, ni de l’arrêter lorsque sonissue deviendra désespérée.
�
Franck Michelin enseigne l’histoire à l’universitéde Tsukuba au Japon. Spécialiste de l’histoire desrelations internationales, il travaille sur la poli-tique indochinoise du Japon de juin 1940 àdécembre 1941 ainsi que sur les procès des crimi-nels de guerre japonais de l’après-guerre.