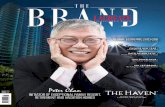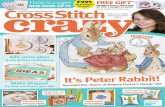DE L’EXTREME ET DE L’ETRANGE, CHEZ PETER VAN INWAGEN
-
Upload
univ-rennes1 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of DE L’EXTREME ET DE L’ETRANGE, CHEZ PETER VAN INWAGEN
DE L’EXTRÊME ET DE L’ÉTRANGE, CHEZ PETER VAN INWAGEN, AU CHIMÉRIQUEPHYSICALISME NON RÉDUCTIONNISTE
RÉSUMÉ
Le problème de la causalité mentale apparaît comme un ensemble de propositionsformant une mécanique dont les rouages se seraient grippés. Alors que nombre dephilosophes cherchent encore une solution intelligible à ce puzzle, Peter Van Inwagen, dansun article récent publié dans la revue soutient certaines idées « extrêmes » et « étranges » àpropos de l’ontologie et de la causalité, étouffant ainsi dans l’œuf le problème lui-même. Dece fait, il écarte la conclusion dirimante de l’argument de l’exclusion causale de Jaegwon Kim,et établit l’existence d’un lien entre le mental et le physique, qu’il qualifie lui-mêmed’« étrange ». Dans cet article, je compare les idées « extrêmes » au sujet de l’ontologie del’un (Van Inwagen) aux idées « standard » de l’autre (Kim). Bien que P. Van Inwagen,s’opposant à Kim, entend ne pas permettre à son argument de démarrer, on découvrecependant, au travers de deux voies métaphysiques qui n’ont rien ou si peu de balises encommun, une proximité dans leurs conclusions qui mettent à mal les fondements mêmes dela thèse courante au sujet du mental : le physicalisme non réductionniste.
ABSTRACT
The problem of mental causation appears as a set of proposals forming a mechanicalworkings which would have seized up. While many philosophers are still seeking anintelligible solution to this puzzle, Peter Van Inwagen, in a recent article published in thejournal supports certain ideas "extreme" and "strange" about ontology and causality, thusstifling in the egg the problem itself. Thus, he rejects the diriment conclusion of the argumentof causal exclusion of Jaegwon Kim, and establishes a link between the mind and body, hecalls himself "strange". In this article, I compare "extreme" ideas about the ontology of one(Van Inwagen) to "standard" ideas of the other (Kim). Although P. Van Inwagen, opposingKim, intends not to allow his argument to start, we discover, however, through two channelsmetaphysical have little or nothing in common, a close in their conclusions that underminethe very foundations of the current thesis about the mind: the non-reductionist physicalism.
MOTS-CLEFS
Causalité mentale, David Chalmers, Dualisme, Evénement, Jaegwon Kim,Peter Van Inwagen, Physicalisme non réductionniste, Propriété,
*
LE PHYSICALISME NON RÉDUCTIONNISTE ET LE PROBLÈME DE LA CAUSALITÉMENTALE
Le physicalisme non réductionniste (PNR) au sujet du mentalest une thèse que l’on peut qualifier de standard tant sacompatibilité est grande avec le domaine physique et la fameuseintuition d’Hilary Putnam : la réalisation multiple du mental(Putnam, 1967). Cette thèse permet de donner un sens auxexplications impliquant des prédicats mentaux qui n’ont pas derésonnance dans le domaine physique, comme par exemple macroyance que Paris est située au nord de Lyon, et qu’il seraitbien curieux de chercher à réduire à un état de mon cerveau.Cependant, le PNR est dit « physicaliste » en raison de sonengagement en faveur de l’identité des occurrences d’événementsmentaux et physiques. En effet, la théorie acquiesce à l’idéeque les événements mentaux sont des événements physiques(neuraux), mais soutient, néanmoins, que les instances depropriétés engagées dans ces événements sont mentales. Cedernier point est la face « non réductionniste » de la théorie.Elle souligne le fait que les caractéristiques mentales, bienque réalisées ou fondées dans la constitution matérielle desagents, ne sont pas réductibles à leurs caractéristiquesmatérielles. Ce que je pense ou ressens sont des propriétés mentalesqui surviennent sur des propriétés physiques (neurales) mais neleur sont pas identiques. Il n’est donc pas surprenant que lePNR apparaisse comme un point de vue philosophique standardsoutenant les théories naturalistes au sujet de l’esprit, enparticulier les théories qui font, peu ou prou, appel aufonctionnalisme.
Toutefois, lorsque l’on considère un ensemble depropositions qui se trouvent être au fondement même de lathéorie du PNR, c’est le problème de la causalité mentale quisurgit. Voici les propositions :
1) Il peut se produire que des causes mentalesaient des effets physiques. 2) Les propriétés mentales ne sont pas des
propriétés physiques. 3) Chaque événement physique possède une cause
physique suffisante. Prises séparément – et à première vue – nous pouvons
produire de bonnes raisons d’adhérer à chacune de cespropositions, mais lorsque, conjointement, nous les examinons,elles forment un ensemble qui n’est pas consistant. Un problème
philosophique est comme un nœud dans notre esprit à proposd’une question fondamentale que nous ne parvenons pas àdéfaire. La façon dont nous cherchons à le résoudre peut alorsavoir des implications au-delà de l’espace logique de sessolutions. Le problème de la causalité mentale, parce qu’ilquestionne l’ontologie, est de cette nature. Peter Van Inwagen(2011), dans son article, questionne justement l’ontologiesous-jacente qui est à l’œuvre dans ce problème. Les troispropositions parlent de causalité mentale, de propriété et d’événementet pour chacun de ces items, le métaphysicien a des idées.
Un autre philosophe, Jaegwon Kim, a quant à lui, au regardde ces trois propositions produit un argument qui aboutit à laréduction des états mentaux aux états physiques. Cet argument,dit de l’« exclusion du mental » ou plus récemment de la« survenance » (Kim, 1989, 2005), a suscité un grand nombre deréticences, d’objections, voire de rejets. Dans son articlePeter Van Inwagen, au moyen d’une méthode de rapprochementd’idées qu’il qualifie d’« étranges » et d’« extrêmes », ancrela question de la relation entre le mental et le physiquerésolument dans l’espace métaphysique. C’est ainsi, qu’en vertude certaines conceptions des propriétés, des événements et dela causalité, Van Inwagen prétend empêcher le problème de lacausalité mentale de démarrer et barrer ainsi la route à laconclusion de l’argument ravageur de Kim. Dans cet article,nous suivrons la méthode de rapprochement des idées de VanInwagen et resterons sur le terrain de la métaphysique.Auparavant, avant d’examiner les cadres ontologiques respectifsde Van Inwagen et de Kim, faisons le point sur ce à quoi faitappel, d’un point de vue que l’on peut lui aussi qualifier de« standard », les trois propositions constituant le problème, àsavoir, la causalité, les propriétés, les événements.
La causalité. La première proposition soutient que des étatsmentaux peuvent être la cause de certains effets physiques ou,pour le dire autrement, que parfois des états mentaux possèdentun pouvoir causal. Ma croyance qu’il pleut, par exemple, peutêtre mentionnée comme la cause de mon comportement lorsque jeprends un parapluie ou encore cette douleur soudaine au piedcomme la cause de ma grimace, contraction musculaire de monvisage. Ces deux exemples, le premier comme causeintentionnelle et le second comme cause non intentionnelle,
sont des cas « ordinaires » qui montrent un lien causal entrele mental et le physique.
L’intuition préliminaire qui préside à notre conceptd’agent nous donne des raisons de penser que ce sont despropriétés mentales qui sont pertinentes dans une relationcausale du mental au physique. C’est ce que je pense qui produitune différence dans ce que je fais (j’actionne mon corps, je saisisun objet). Cette pertinence causale de la propriété mentalesouligne alors un second aspect de ces propriétés : la distinctionavec les propriétés de type physique. En effet, la premièreproposition sous-entend que les effets physiques peuvent avoirdes causes mentales et que celles-ci sont distinctes des causesphysiques.
Les propriétés (physiques et mentales). Selon les termes du débatphilosophique, certaines choses ont des propriétés mais ne sontpas des propriétés. Lorsque l’on dit d’une chose qu’elle atelle propriété, on dit quelque chose à son sujet ou encore quecette chose est d’une certaine manière. La sphéricité de cette boulede billard, sa masse, sa rougeur, sont ce que l’on peut dire decet objet, ou encore que ce sont des manières dont est cetteboule (Seargent, 1985).
Parfois pour dire quelque chose de certaines choses, parexemple de certains êtres vivants, on peut user de prédicatsmentaux, comme « éprouver une douleur » ou « croire que Parisest située au Nord de Lyon ». Lorsque l’on considère que cesprédicats désignent de véritables propriétés comme être unedouleur ou la croyance que p, nous soutenons alors qu’il existedeux instances différentes d’authentiques propriétés distinctesayant leur propre nature, c'est-à-dire leurs propres pouvoirscausaux. C’est ainsi, que de la deuxième proposition émerge undualisme des propriétés. Ce dualisme est un monisme de la substance,c'est-à-dire qu’il soutient que les entités physiques et lasomme méréologique de leurs agrégats forment tout ce quiexiste ; toutefois, il assure que les propriétés psychologiquessont irréductibles et distinctes des propriétés physiques deces mêmes entités.
Les événements (physiques et mentaux). Affirmer la pertinence d’unepropriété mentale signifie que la possession de cette propriétémentale par un individu, à un moment donné, participe de la
cause, ici en l’occurrence, d’un certain effet physique. Parexemple, lorsque je forme l’intention de me diriger versl’endroit où est rangée l’aspirine, c’est une certaine douleur,un certain événement mental, qui est la cause de cetteintention que je nourris d’apaiser cette douleur, cause elle-même de mon déplacement.
On définit habituellement la manifestation de cette douleurcomme un événement, c'est-à-dire comme quelque chose qui arriveou se produit, ici dans un être vivant, à un certain moment. Etparce que ce changement dans cet être vivant est reconnu commela cause d’un certain effet, cet événement est dit « causal ».Il apparaît donc que la responsabilité causale d’un événement,soutenue dans ces trois propositions, est la manifestationd’une propriété qui peut-être mentale. Dans ce cas, l’événementcausal est dit « mental ».
Néanmoins, et c’est un principe méthodologique préliminaireà toute science physique, un événement ou un état physiquequelconque, dans la mesure où il est causé, a toujours unecause physique suffisante. C’est ce qui permet de conclure quelorsque des phénomènes mentaux sont la cause de phénomènesphysiques, il y a aussi une cause physique suffisante quiexplique ces mêmes phénomènes physiques. Pour qualifier cettedétermination des effets physiques par des causes physiques, onutilise le terme de complétude (Papineau, 1993, p.16) ou de clôturecausale du domaine physique. C’est le sens qu’il faut donner à latroisième proposition.
Voyons maintenant, après ce parcours lapidaire dansl’ontologie courante sous-jacente au problème de la causalitémentale ce que sont les idées « extrêmes » et « étranges » queVan Inwagen défend et rapproche.
LES IDÉES « EXTRÊMES » ET « ÉTRANGES » DE PETER VAN INWAGEN.1) LES IDÉES EXTRÊMES
Selon Van Inwagen, les choses sont soient abstraites soientconcrètes et ces catégories sont exclusives : « Il n’y a aucunechose qui est ni abstraite ni concrète, et aucune chose qui estles deux à la fois » (Van Inwagen, 2011, p.2). Une
caractéristique manifeste des choses concrètes, les substances,est qu’elles peuvent entrer en relations causales, c'est-à-direqu’elles sont capables de changer et de produire du changement.L’extrémité d’un tisonnier peut chauffer, rougir et mettre lefeu à une bûche de bois : le tisonnier est un objet concret.Une chose abstraite, comme le nombre 600 sur l’échelle desdegrés Celcius, qui est un objet abstrait, ne met pas le feu àla bûche.
Selon les termes du débat philosophique, que reprend VanInwagen, certaines entités sont concrètes, c'est-à-dire que cesont des entités spatiotemporelles ou substances. Les seulesentités abstraites, toujours selon Van Inwagen, sont lesrelations et parmi les relations il y en a qui sont desrelations à une place et ce sont les propriétés ou attributs ouqualités. Le bleu d’une écharpe par exemple est l’attribut d’unobjet, plus précisément d’une substance et cet attribut est ununiversel (le bleu de l’écharpe de Julia peut être identique aubleu de l’écharpe de Jill). Ces universaux, entités abstraites,peuvent simultanément être exemplifiés, instanciés, possédéspar différents particuliers (Nef, 2006, 220-223). Ce qui reliealors l’attribut, la propriété d’être bleu, à la substance(exemplification, instanciation, possession) est une relationqui, elle aussi, demeure abstraite. En conséquence, lespropriétés, puisque « voir » est causal, ne peuvent pas êtrevues (Van Inwagen, 2006, p. 30). Ce que l’on voit lorsque l’ondit de l’écharpe de Julia qu’elle est bleue, c’est l’écharpe.En somme, lorsque nous disons que x et y sont z, où x estdifférent de y, nous disons que z existe, qu’il est abstrait etuniversel et que c’est une propriété. Ainsi, une propriété estce que l’on dit vraiment d’une chose ; elle est ce que l’onasserte à son sujet (Van Inwagen, 2006, p.27). Cependant, parcequ’elle est abstraite, elle ne peut être l’objet de nossensations. On ne peut donc pas percevoir les propriétés.Ultime précision, mais déterminante : le genre d’universelauquel les idées « extrêmes » de Van Inwagen se rallie estplatonicien, c'est-à-dire que les propriétés sont éternelles etqu’elles existent nécessairement. En effet, non localisées àl’endroit où se trouvent leurs instances, elles séjournent endehors de l’espace et du temps (Van Inwagen, 2011, p.4). Enconséquence, parce qu’elles ne sont pas « inhérentes » auxchoses (ante res), elles existent indépendamment de leurs
instances. De plus, elles n’ont pas besoin, pour exister,d’être exemplifiées. C’est pourquoi, dans un monde où rien, pasmême une écharpe ne serait bleue, la couleur bleue pourraitexister ou dans un autre monde, où il n’existait aucunorganisme conscient, la pensée que Paris est située au Nord de Lyonpourrait également exister.
Le découpage qu’opère Van Inwagen entre les deux sortes dechoses qui existent, à savoir les substances concrètes et lesrelations abstraites, ne laisse alors aucune place pour lesévénements. Bien qu’il reconnaisse qu’une substance puisseperdre ou acquérir une propriété ou que l’on puisse dire d’unechose comme d’un tisonnier qu’il était froid à un certainmoment puis qu’il est devenu chaud à un autre, il se refuse àquantifier sur les changements (Van Inwagen, 2011, p.8). Il nedit pas que les changements ne sont pas réels, ou que quelquechose ne se produit pas, que le tisonnier ne devient pasincandescent mais, strictement parlant, le changement commesynonyme d’« événement » n’existe pas. Par conséquent, il estnul besoin d’étendre l’ontologie des objets concrets et celledes objets abstraits, en plus des substances et des propriétés,aux événements. Les énoncés qui impliquent l’existenced’événements peuvent être paraphrasés comme des énoncés ausujet des changements de propriétés et de relations parmi lessubstances (Van Inwagen, 2007, p. 203). Passons maintenant auxidées « étranges ».
2) LES IDÉES ÉTRANGES
a. La causalité
Les discours causaux se comprennent en termesd’explications causales et rendent comptent de relations quis’établissent entre les seuls concreta : les substances. Quant auphénomène de la causalité, puisqu’il n’y a pas d’événements, iln’existe pas (Van Inwagen, 2011, p. 12). Certes le tisonnierincandescent possède le pouvoir causal de chauffer et de brûlermais ce n’est ni l’état du tisonnier, ni l’événementd’exemplifier une propriété d’atteindre le nombre 600 surl’échelle des degrés Celcius qui possède ce pouvoir. Il n’y adonc pas de relation de causalité entre deux états, pas plusqu’il y en a entre deux événements.
b. La relation entre le mental et le physique
Ce que l’on nomme un « état mental » n’est pas unesubstance mais une propriété ou une conjonction de propriétés.De sorte que ce sont les substances comme les personnes qui ontdes états mentaux donc des propriétés mentales. Mais pour VanInwagen, les propriétés mentales ne sont pas véritablementdifférentes des propriétés physiques : les deux sontabstraites, éternelles et existent nécessairement. Certainespropriétés sont dites « mentales » parce qu’une chose qui lespossèdent a des pensées et des sensations, mais ellesexisteraient même si rien ne pensait ou avait des sensations(Van Inwagen 2007, p. 210). Votre douleur soudaine dans une molaireet votre croyance qu’il pleut, existent nécessairement etéternellement (Van Inwagen, 2011, p. 6-7). Cette douleur etcette croyance existeraient dans des mondes dans lesquels lapensée et la conscience seraient totalement absentes. Ainsi,bien qu’ils les nomment « mentales », elles ne sont pas plusdes choses mentales que les propriétés physiques sont deschoses physiques.
Cependant, alors que les propriétés mentales, selon lepoint de vue standard, sont considérées comme des propriétésnon-physiques, comment comprendre la relation entre le physiqueet le non-physique ? La troisième proposition du problème de lacausalité mentale soutient un dualisme des propriétés. Maisquel sens donner à un engagement ontologique en faveur d’unepropriété qui est dite « non-physique » ? Pour le direcouramment, les propriétés mentales ne sont pas des propriétésphysiques. Toutefois les propriétés mentales sont despropriétés portées par des êtres qui sont eux-mêmes dessubstances entièrement physiques. Une propriété de type non-P(non-physique), comme une sensation ou une croyance, peut doncêtre la propriété d’une chose de type P (physique). Ainsi,lorsque l’on se demande pourquoi votre douleur soudaine à lamolaire et votre croyance qu’il pleut sont des propriétésmentales, on répond que c’est parce que ce que l’on ditvraiment de vous implique une sensation et une pensée. Ainsiconçues, les propriétés mentales sont des propriétés qui nesont pas différentes des propriétés physiques puisqu’elles sontassertées au sujet d’une chose physique - vous - et que lespropriétés sont des choses abstraites. En somme, selon VanInwagen, le classement de propriétés comme « mentales » n’est
pas l’expression de leur nature mais seulement de leur contenu(Van Inwagen, 2007, p. 214). Son ontologie, nous l’avons vu, sedivise clairement en objets concrets, les substances et enobjets abstraits, les relations. Lorsque ces relations sont àune place, elles sont des propriétés et qu’elles soientphysiques ou mentales, cela ne correspond pas à une divisionontologique significative. La seule division ontologiquesignificative est, selon Van Inwagen, si l’on est moniste,entre les substances concrètes et les propriétés ; et si l’onest dualiste, entre les substances physiques et les substancesnon physiques et les propriétés. Ce n’est que dans ce seuldernier cas, de substances non physiques qu’il seraitsignificatif de donner un sens à des propriétés qui seraientnon physiques. De sorte que soutenir qu’une propriété mentaleest une propriété non-P reviendrait à dire qu’elle ne peut êtreattribuée qu’à une chose non-P. Mais ce n’est pas là une idéeque peut défendre le dualiste contemporain qui est, rappelons-le, un moniste de la substance. Affirmer que ce sont lesesprits immatériels ou les âmes situés en dehors de l’espace etdu temps qui sont les seuls porteurs des propriétés non-P,n’est, en effet, pas vraiment la thèse que soutient le PNR.Comme on le voit, pour notre auteur, la notion de propriéténon-P demeure difficilement intelligible lorsqu’elle estrapportée à des substances, qui plus est si, comme le soutientle point de vue standard, les propriétés mentales surviennentsur les propriétés physiques.
Pour résumer le point de vue ontologique que soutient VanInwagen, une propriété est l’attribut d’une substance ;substance qui elle, et seulement elle, est susceptible d’entreren relation causale avec une autre substance. Pour rendrecompte de cette relation nous pouvons faire des « narrations »dont « les personnages sont des substances qui acquièrent ouperdent certains attributs ou viennent à se trouver danscertaines relations et cessent de se trouver dans certainesautres » (Van Inwagen, 2011, p. 18). Ces narrationsexplicatives peuvent êtres diverses et impliquer le vocabulairedes sciences physiques ou le vocabulaire mental. Toutefois,cette différence dans les explications qui contiennent dulangage mental ou du langage physique ne les rendent pas pluscorrectes l’une que l’autre. En effet, la vérité des énoncésqui contiennent du langage mental ou physique n’est qu’une
« conséquence métaphysiquement nécessaire de la distribution dematière et de rayonnement dans l’espace-temps » (Ibid., p. 11).
Après ce bref résumé des idées métaphysiques de VanInwagen, il est temps maintenant de regarder de plus près unautre engagement qui prend lui aussi l’ontologie au sérieux,celui que sous-tend l’argument de la survenance de Kim.
LES IDÉES « MODÉRÉES » ET « ORDINAIRES » DE JAEGWON KIM
La qualification de « modérée » à propos de l’ontologie deKim fait ici écho à la métaphore qu’utilise David Armstrong ausujet des universaux en disant qu’il les a ramenés « sur laTerre » (Armstrong, 2010, p. 97). Quant au vocable d’« ordinaire » il spécifie un point de vue standard concernantla causalité et la relation entre le mental et le physique quise trouvent être au cœur du problème de la causalité mentale,point de vue que Kim adopte dans son argument.
1) LES IDÉES MODÉRÉES
Dans son argument, Kim ne plaide pas spécialement en faveurd’une ontologie plutôt qu’une autre au sujet des objets et despropriétés, mais soutient explicitement un principed’individuation des événements comme exemplification d’unepropriété par un objet à un moment donné (Kim, 1976).Toutefois, il adopte au sujet des propriétés nombre de traitsqui en font, comme pour Van Inwagen des universaux1 (Ehring,1997, p. 84-87, Whittle, 2007, p. 64). Mais là s’arrête leterritoire ontologique commun entre les deux auteurs. En effet,lorsque Kim parle d’exemplification d’une propriété, il seréfère à des universaux qui se trouvent là où se trouvent leursinstances, c’est-à-dire à la David Armstrong, dans les choses(in rebus). Ainsi, tournant le dos à ce que lui-aussi qualifie depoint de vue « extrême », Armstrong considère que toutuniversel doit être instancié (Armstrong, 1989, trad., p. 96-102) et comme étant une exigence métaphysique minimale.
1 Bien que J. Kim n’aborde pas directement la question de son choix enfaveur des universaux, un auteur comme D. Erhing définit les relata kimiensde la causalité comme exemplifications de propriétés universelles ; quant àA. Whittle, elle affirme que pour Kim les instances de propriétés sont desinstanciations d’universaux.
Entièrement présent dans chacune de leurs instancesnumériquement distinctes, c'est-à-dire habitants le mondespatiotemporel, Armstrong ramène effectivement et littéralementles universaux « sur Terre ». Ainsi dans un monde où rien neserait bleu, pas même une écharpe, la couleur bleuen’existerait pas ; ou dans un autre monde où n’existerait aucunorganisme conscient, la pensée que Paris est située au Nord de Lyon nepourrait également pas exister.
La distinction entre les catégories d’universaux in rebus etante res est ici cruciale ; elle est le point de divergence quidétermine et enracine chacune des deux ontologies. Pour VanInwagen, dire que les propriétés sont des constituants deschoses, tel le bleu de l’écharpe de Julia, est une idéeobscure. En revanche, pour Armstrong, les propriétés sont à lafois des constituants des choses2 et des universaux (Ibid., p. 97).Autrement dit, les propriétés font partie de la structure deschoses ; elles sont localisées à l’endroit où se trouvent leursinstances et y sont entièrement présentes. L’universel bleu estexemplifié dans l’écharpe de Julia ; son instance est perçue.Ainsi, alors que selon Van Inwagen, la relation entre lapropriété et la chose est une abstraction, pour le tenant despropriétés comme universaux dans les choses, l’instanciationest le « nexus fondamental » qui relie le particulier àl’universel.
Comme on le voit, en ramenant sur Terre les propriétésuniverselles, lorsqu’un changement se produit dans une chose,ou pour le dire comme Van Inwagen lorsque qu’une substance perdou acquiert une propriété, c’est la propriété inhérente à lachose qui se manifeste. Au moment où la chose exemplifie lapropriété, c’est un événement qui se produit. On peut alorsparler de l’événement comme d’un particulier temporel : quelquechose de non répétable qui se produit à un instant t. C’estainsi que Kim représente l’événement, comme l’exemplificationpar un objet d’un attribut (relation ou propriété) à un momentou sur une période donnée (Kim, 1973, 1976)3. Schématiquement,si on considère P comme étant l’attribut, o l’objet et t letemps, on spécifie l’événement d’avoir P pour o à t [o, P, t].2 Pour D. Armstrong, les choses en question sont des états de choses, c'est-à-dire, un composé de particuliers et de propriétés (Cf. Arsmtrong, A World ofState of Affairs, 1997).3 J. Bennett (1988) défend également cette individuation des événements.
Ainsi, selon ce mode d’individuation, ce qui constituel’événement est un attribut unique. De sorte que la propriétéP, constitutive de l’événement à t, est exemplifiée par l’objeto. Ce qui rend vrai l’énoncé « le tisonnier est devenuincandescent » est l’exemplification d’une propriété P à t parl’objet o (le tisonnier) constitutive de l’événement. Cetévénement peut alors être un événement causal car au moment t,le tisonnier acquiert le pouvoir causal de chauffer ou debrûler les choses. Précisons que c’est l’objet et nonl’événement qui exemplifie la propriété4. Qu’en est-ilmaintenant des idées « ordinaires » ?
2) LES IDÉES ORDINAIRES
a. La causalité
Alors que pour Van Inwagen le phénomène de la causalitén’existe pas et que la seule façon de rendre compte desrelations qui s’établissent entre les substances ne se faitqu’en termes d’explications causales, pour Kim, la causalitéexiste et elle est l’exercice des pouvoirs causaux. Cetteconception de la causalité est rendue possible par l’ontologiedes propriétés dans les choses qui, ne séparant pas l’instancede la propriété, confère un pouvoir à une substance. Ce pouvoircausal dans la chose à un instant t est l’événement, ceparticulier temporel qui explique que le phénomène de lacausalité existe et qu’il est une relation entre deuxévénements
b. La relation entre le physique et le mental
Les idées de Kim concernant la relation entre le mental etle physique se déploient à l’intérieur de la conceptionfonctionnaliste de l’esprit5 (Block, 1980). Une propriété
4 Seules les substances, c'est-à-dire les objets concrets possèdent lespouvoirs causaux. Van Inwagen le reprécise dans son article, (2011, p. 20)En effet, strictement parlant un événement ne peut pas faire quelque choseet ne peut pas causer quelque chose. Causer est proche de faire. Dire queles événements font quelque chose serait une erreur de catégorie. Cetteerreur, Kim ne la commet pas. Selon lui, la propriété constitutive del’événement est la propriété d’un objet et non de l’événement.5 Le fonctionnalisme dit que les états mentaux sont constitués par lesrelations causales qu’ils entretiennent les uns avec les autres et les
mentale fonctionnelle est une propriété pour laquelle un rôlecausal est spécifié. Une douleur causée par des lésionstissulaires, par exemple, provoque des grimaces. Ainsi, lapropriété, pour un être humain, d’éprouver une douleur revientà être dans un état qui associe causalement certaines entrées,comme des lésions tissulaires, à certaines sortiescomportementales comme des grimaces. Un état mental est donc unrôle causal ou une spécification fonctionnelle.
Le lien métaphysique, quant à lui, entre le mental et lephysique est celui de la survenance. Habituellement comprisecomme une relation entre deux classes de propriétés (Kim, 1982,p. 57-58, Horgan, 1993, p. 566), la survenance exprime ladépendance d’une classe par rapport à l’autre. L’idée basiquede dépendance s’exprime ainsi : si les propriétés B dépendentdes propriétés A alors les propriétés A déterminent lespropriétés B. Si les propriétés A déterminent les propriétés Balors il n’est pas possible que les propriétés A soient fixeset que les propriétés B puissent encore varier. Appliquée aumental, la survenance soutient qu’il n’y a pas de mondepossible qui puisse être identique au monde actuel dans chacunde ses aspects physiques et qui puisse être différent dans sesaspects biologiques ou psychologiques. Autrement dit, ces deuxtypes de propriétés co-varient. Et selon le fonctionnalisme, cequi explique cette co-variation de ces deux classes depropriétés est une relation de réalisation. On dit alors queles propriétés mentales sont réalisées par les propriétésphysiques mais ne leur sont pas identiques. Etre une douleurpeut, en effet, être réalisée par une diversité de propriétésneurales dans différentes espèces. La question que soulève Kimest alors celle de la pertinence causale de la propriétémentale réalisée, propriété de second-ordre, par la propriétéphysique.
Pour un objet, posséder une propriété de premier ou desecond ordre, c’est donc être doté de certains pouvoirscausaux. Mais les propriétés réalisées par des propriétésphysiques (neurales, dans le cas des propriétés mentales)peuvent-elles être individuées sur la base de leurs proprespouvoirs causaux ? Kim, dans son maître argument met enévidence le caractère instable de la relation de survenance et
entrées sensibles et sorties comportementales.
démontre l’impuissance causale que cache involontairement lathèse du PNR. Cet argument peut se résumer ainsi : lespropriétés mentales et les propriétés physiques entrent parfoisen concurrence pour causer un événement physique, mais comme ilexiste toujours une histoire causale physique complète àl’intérieur du domaine physique, et que la surdéterminationcausale ne peut être systématique, les propriétés mentales sontpréemptées au profit des propriétés physiques. En somme commeles propriétés mentales sont des propriétés de second ordresituées au niveau psychologique, les pouvoirs causaux qu’ellesconfèrent à leurs porteurs sont les pouvoirs causaux despropriétés de premier ordre sur lesquelles elles surviennent.Si donc l’on soutient que le niveau psychologique est constituépar des propriétés de second ordre, il est causalementimpuissant. Par exemple, lorsque je veux voter « oui » enlevant le bras dans une assemblée (instance de propriétémentale), mon désir d’adhérer à une idée ou une proposition etma croyance que mon bras levé comptera pour « oui » constituentla cause de mon geste. Cependant, il existe aussi uneexplication complète neurophysiologique (instance de propriétéphysique) qui contient également la cause de ce mouvement et,dans ce cas, suivant l’argument de la survenance de Kim,préempte l’instance de la propriété mentale considérée. C’estcette conclusion que Van Inwagen stipule comme étant« épiphénoméniste » (Van Inwagen, 2011, p. 21) et contrelaquelle la somme de ces idées ambitionne de lutter. Mais pourKim, bien au contraire, l’argument de la survenance, enconduisant au réductionnisme, échappe à la l’épiphénoménisme etsauve la causalité mentale (Kim, 2005, p. 159). Selon lui,c’est dans le domaine physique que le mental trouve sa place.Ainsi, la réduction du mental au physique n’est pas, aux yeuxde Kim, une contradiction verbale : elle est la solution auproblème de la causalité mentale. C’est la réduction dite« conservative6 » (Kim, 2006, trad. p. 310).
Récapitulons.
Van Inwagen KimLes propriétés sont desuniversaux qui séjournent hors
Les propriétés sont desuniversaux qui sont dans les
6 Selon Kim, la réduction « préserve » le mental en le « conservant » commeune partie du monde physique – comme la chaleur par exemple est« conservée » comme énergie cinétique moléculaire.
de l’espace et du temps (anteres).
choses (in rebus).
Les objets sont des blobs7 (VanInwagen, 2011, p.6).
Les objets sont desparticuliers porteurs despropriétés.
Les événements n’existent pas. Les événements sont desexemplifications de propriétésuniverselles dans les choses àun moment donné.
Le phénomène de la causalitén’existe pas.
Le phénomène de la causalitéexiste comme relation entreles événements.
Le dualisme des propriétés estinintelligible.
Le dualisme des propriétés estinopérant.
Comme on le voit, les ontologies de Kim et de Van Inwagense font face et n’offre que peu d’espace en commun. Toutefois,on se souvient de la difficulté qu’a Van Inwagen à comprendrequ’une propriété non-physique puisse se rapporter à une chosephysique… et bien Kim, dans une veine similaire, mais cettefois via la réduction conservative, nous propose de quitter noshabitudes qui nous font considérer que le terme « mental »serait synonyme de « non-physique » ou que « non mental » leserait de « physique » (Kim, 2005, p. 160). Et c’est là lepremier indice de cette convergence entre les deux auteurs quedésormais, nous abordons.
RAPPROCHER LES IDÉES DE KIM ET DE VAN INWAGEN
Bien que Van Inwagen, dans son article, use d’une ontologie« étrange » et « extrême » contre la thèse réductionniste, iln’en demeure pas moins qu’en se focalisant sur l’ontologie etbien que les engagements diffèrent, l’ontologie de chacun desdeux philosophes contribue au discrédit du PNR.
Le PNR se construit sur les principes de pertinence causaledes propriétés mentales (proposition 1) et de distinction enversles propriétés physiques (proposition 2) ainsi que d’uneacceptation de la clôture causale du domaine physique (proposition 3)
7 Les blobs (blob theory) sont des particuliers amorphes. Des objetsindividuels dénués de structure – sans propriétés ni relations (Armstrong,1989, trad. p.53)
à laquelle s’ajoute la relation de survenance. La cohabitationde ces principes noue alors non seulement, comme nous l’avonsvu, le problème de la causalité mentale mais constituent lesocle métaphysique qui précise la relation que le mental et lephysique entretient. C’est ainsi que le PNR soutient que lesévénements physiques sont identiques aux événements mentauxmais que les propriétés mentales sont différentes despropriétés physiques. En rapprochant les idées de Kim et de VanInwagen dont nous avons montré qu’elles faisaient écho à deuxstructures ontologiques discordantes, nous ne pouvons queconstater qu’elles mettent à mal, l’une et l’autre et chacune àleur manière, le socle métaphysique du PNR.
1) L’IDENTITÉ DES ÉVÈNEMENTS OCCURRENTS
La théorie de l’identité du cerveau et de l’esprit règle defaçon radicale le problème de l’interaction entre le mental etle physique : les événements mentaux et les propriétés mentalessont identiques aux événements et aux propriétés physiques.Cependant, si le PNR admet une identité, c’est celle entre lesévénements physiques et mentaux. Concernant cette identité VanInwagen nous dit, puisque l’événement n’est pas une pièce deson ontologie que la messe est dite ! (« Ite missa est ! »). Selonle métaphysicien, la thèse de l’identité des événements estsoit « fausse » soit « creuse » (Van Inwagen, 2011, p. 8). Enrevanche, selon Kim, les événements existent et leur moded’individuation qu’il formalise implique l’identité despropriétés mentales et physiques. Pour le PNR, ce sont là deuxmauvaises nouvelles qui montrent une singulière convergenceentre les deux auteurs. Mais comment Kim convertit-il cetteidentité des occurrences d’événements en identité des types depropriétés ?
Suivant le point de vue standard, une douleur ou unecroyance sont des événements mentaux tandis que l’excitation defibres neurales est un événement physique. Ainsi, selon le PNR,lorsqu’une personne éprouve une douleur à un moment donné cettepersonne est aussi l’objet, à ce même moment, d’un événementphysique qui lui est identique. Cette identité des occurrencesd’événements revient à affirmer que chaque personne quiinstancie une propriété mentale d’éprouver une douleur,instancie également, au cours de ce même événement, une
propriété physique (neurale). Toutefois, cette thèse nie quel’instanciation de la propriété d’être une douleur soitidentique à l’instanciation de la propriété neurale (lastimulation de la fibre C). Or, si les événements sont définiscomme l’exemplification d’une propriété à un instant donné,alors l’identité des occurrences implique l’identité despropriétés. En effet, si x exemplifie une propriété mentale M àt et qu’un même événement exemplifiant une propriété physique P,à ce même moment t, se produit, alors les propriétés M et Psont identiques. Plus formellement nous pouvons écrire :
Identité des événements = identité des propriétés : Si [x, M, t] = [x, P,t], alors M = P.
C’est ainsi qu’une ontologie délestée des événements (VanInwagen) ou les intégrant (Kim) conduit à l’inanité du supportcrucial de la théorie standard au sujet du mental qu’estl’identité des événements occurrents (Van Inwagen) ou la remiseen cause du dualisme des propriétés (Kim). C’est justementdirectement au dualisme des propriétés qu’est donnée la secondeestocade, par les deux philosophes, au PNR.
2) LE DUALISME DES PROPRIÉTÉS
Alors que selon les idées ontologiques de Van Inwagenl’argument de la survenance de Kim est barré, il n’en reste pasmoins qu’au-delà de leurs divergences les deux auteursaboutissent à des conclusions très gênantes au sujet dudualisme des propriétés : inintelligible, à moins que l’onsouscrive également au dualisme des substances, selon VanInwagen et inopérant pour Kim.
Le dualisme des propriétés est sanctionné par l’argument deKim non seulement parce qu’il entretient le problème de lacausalité mentale mais parce qu’il n’offre aucune solutionontologiquement stable. Van Inwagen, quant à lui, insiste surla notion de propriété non-P et se désespère de ne jamais lacomprendre. Questionnant alors David Chalmers, grand défenseurdu dualisme naturaliste des propriétés, il bât en brèche unecertaine idée de la survenance que développe le philosophedualiste. Mais qu’est-ce donc vraiment, pour le dualiste
contemporain, qui est un moniste des substances, une propriéténon-P ?
Pour tenter de comprendre pourquoi les phénomènes de laconscience échappent à l’explication physique, Chalmerssubdivise le concept de survenance en deux catégories : lasurvenance logique et la survenance naturelle. Le premier type desurvenance explique que si les propriétés B surviennent sur lespropriétés A, alors il ne peut pas exister une situation danslaquelle on aurait deux objets x et y qui auraient A alorsque x aurait seulement B (Chalmers, 1996, trad. p. 63).Autrement dit, il est logiquement impossible que A existe sansB. Selon Chalmers, chaque fait de notre monde survientlogiquement sur des faits physiques fondamentaux, à uneexception près : les faits de la conscience. Ces faits de laconscience surviennent « naturellement » sur les faitsphysiques. C’est-à-dire qu’un être conscient requiert nonseulement un certain agencement de particules mais aussi deslois de nature spécifiques à ces agencements. Pour le dire entermes de mondes possibles, il existe un monde dans lequel vousavez des propriétés mentales, c’est le monde actuel, mais il ya des mondes où votre contrepartie, identique à vous, à laparticule près, est un zombie, c'est-à-dire, un être dépourvuede certaines propriétés de la conscience.
Ainsi, les propriétés de la conscience ne surviennent pas« logiquement », mais naturellement sur les propriétés de typephysique (Ibid., p. 67). Alors que presque tout survientlogiquement sur le physique, la relation que la conscienceentretient avec le physique n’apparait pas comme étant du mêmetype que celle que les faits physiques ordinaires entretiennentavec le physique. Chalmers pose ainsi la conscience à part detous les faits physiques et développe un argument contre lematérialisme : les propriétés des phénomènes de consciences nesont pas des propriétés physiques8.
Si, en revanche, selon Van Inwagen, la création divine estentièrement physique, un être humain, en tant qu’entitébiologique, n’est rien de plus qu’un certain arrangement de
8 Kim reconnait lui aussi que les qualia, dans la mesure où ils résistent àla réduction fonctionnelle, ne trouvent pas leur place dans la structurecausale du monde (Kim, 2005, p. 171). En cela, il rejoint la position deChalmers.
particules. Pour reprendre la phraséologie de Chalmers, celaimplique que toutes les propriétés intrinsèques de l’êtrehumain surviennent logiquement sur cette distribution dematière et parmi ces propriétés intrinsèques on trouve lespropriétés mentales. Mais pour sa part, Chalmers écrit qu’« une fois que Dieu a (hypothétiquement) créé un mondecontenant certains faits de type A, les faits de type B lesaccompagnent pour rien, comme une conséquence automatique »(Ibid., p. 68). Or, il n’est pas du tout évident que Dieu aitterminé son travail ! Dieu pourrait, selon Chalmers, créer unmonde identique physiquement au nôtre, mais l’ajout de laconscience exigerait plus. Dieu aurait besoin d’ajouter denouvelles lois fondamentales de la nature. Ces lois de lanature fonderaient l’émergence de la conscience. Aux yeux deVan Inwagen, c’est tout simplement « faux » (Van Inwagen, 2011,p. 11). Le dualiste exprime ici une confusion métaphysique (VanInwagen, 2007, p. 215).
En effet, le dualisme des propriétés rejette la survenancede certaines propriétés dans des mondes qui sont de parfaitesrépliques physiques du nôtre. Pour que dans ces mondes lesêtres humains aient un esprit, Dieu a alors besoin d’ajouterdes propriétés non-P. Peut-on dire dans ce cas-là que cespropriétés, en plus, des propriétés qui surviennent surl’arrangement de particules qu’est l’entité biologique quiconstitue l’être humain, sont encore des propriétés de lasubstance physique ? Alors que pour un dualiste comme Chalmersles qualia caractérisent des structures irréductibles dans lemonde, on ne voit pas bien comment ces propriétés non-Ppourraient être des propriétés de la substance physique. C’estpourquoi Van Inwagen rappelle que les seuls dualistes quipeuvent revendiquer les termes sont Platon et Descartes car ilsconsidèrent que le physique et le non-physique est unedistinction de la substance.
Pour conclure partiellement, nous pouvons donc dire que siles propriétés sont les abstracta comme le défend Van Inwagen,alors les propriétés sont toutes des propriétés non-P, dans lesens où elles ne sont pas des entités spatio-temporelles ; etsi nous interprétons ces propriétés comme se distinguant despropriétés physiques alors elles sont des propriétés desubstances non physiques.
Mais qu’en est-il pour l’ontologie de Kim d’universaux dansles choses ? Comme nous l’avons vu, Kim met en difficulté ledualisme des propriétés au moyen de l’argument de lasurvenance, mais l’on pourrait aussi s’interroger, d’un pointde vue ontologique kimien, sur la cohérence du PNR lorsqu’ilsoutient à la fois le monisme des substances et le dualisme despropriétés. En effet, pour l’universaliste à la Armstrong, letype de propriété est un composant du pouvoir causal que celle-ci confère à son porteur. De plus, une propriété mentale entant qu’entité répétable entretient aussi un certain lien avecla propriété de l’événement physique sur laquelle ellesurvient. Cependant, parce qu’elle est constituée de son type,elle n’est pas réductible à la propriété physique sur laquelleelle survient - le caractère irréductible de la propriétémentale étant ici soutenu par la célèbre intuition de laréalisation multiple9. Mais que signifie précisément ce traitd’irréductibilité sinon à affirmer qu’il existe une différenceontologique de substance dans le monde ! En effet, si lespropriétés mentales sont constituées par les types d’universauxalors les prédicats mentaux et physiques ont des genres devérifacteurs différents. C’est pourquoi, affirmer que les typesmentaux et physiques sont différents quand on est universalisten’introduit pas seulement une façon différente de découper lemême patchwork de matière mais réfère à des propriétés qui nesurviennent pas sur la totalité de la distribution de lamatière. C’est pourquoi, s’engager en faveur del’irréductibilité de certaines propriétés, c'est-à-dires’engager en faveur de propriétés non-P, que celles-ci soit despropriétés ante res ou in rebus, conduit le défenseur du PNR dansle giron du dualisme de la substance - chose qu’il ne voulaitpas.
Conclusion
Alors que Peter Van Inwagen dans son article s’efforce àchasser l’émergence du problème de la causalité mentale et parlà-même, prétend étrangler l’argument de la survenance deJaegwon Kim, nous avons mis entre parenthèses cette lutte desarguments au profit d’une comparaison et d’un rapprochementd’idées ontologiques que tout oppose. Si Kim et Van Inwagen9 L’intuition de la réalisation veut qu’un même état mental soit réalisédifféremment dans une grande variété d’individus, voire différemmentréalisé à l’intérieur d’une même espèce ou d’un même individu.
prennent l’ontologie au sérieux, ils fondent, néanmoins, celledes entités sous-jacentes en jeu dans le problème de lacausalité mentale sur deux socles différents empruntant ainsideux chemins d’analyse qui n’ont rien en commun. Toutefois,alors que leurs ontologies diffèrent, l’un et l’autreaboutissent à des conclusions désastreuses pour la thèse du PNRqui est un standard en philosophie de l’esprit. Van Inwagen, enniant l’existence des événements, montre l’incohérence de cetteposition métaphysique et démontre que le dualisme despropriétés cache un dualisme de la substance. Quant à Kim, enacceptant l’identité des événements, fait fonctionner sonargument réductionniste et démontre que le dualisme despropriétés est totalement instable. Enfin, nous montrons quel’ontologie des propriétés adoptée par Kim et les tenants duPNR, ne peuvent résister au réductionnisme sans retomber dansle giron du dualisme de la substance. Ainsi, la théorie du PNR,ne pouvant plus faire appel à ses deux piliers métaphysiquesque sont l’identité des événements et l’irréductubilité despropriétés mentales, n’apparaît plus comme une thèsephysicaliste et perd ainsi de son crédit en voulant rendrecompte de la relation psychophysique.
BIBLIOGRAPHIE
Armstrong, D.M. (1989) Universals: An Opinionated Introduction,Boulder, Colo.: Westview Press, trad. française S. Dunand, B.Langlet, J. M. Monnoyer, Les universaux : une introduction partisane,Ithaque, 2010.Armstrong, D.M. (1997) A World of States of Affairs. Cambridge:
Cambridge University Press.Bennett, J. (1988) Events and Their Names, Hackett,
Indianapolis/Cambridge.Block, N. (1980) « What is Functionalism? », Reading in
Philosophy of Psychology, vol 1, Cambridge Harvard U.P.Chalmers, D., The Conscious Mind, Oxford and New-York: Oxford
University Press, 1996, trad. française S. Dunand, Ithaque,2010.Ehring, D. (1997) Causation and Persistence: A Theory of Causation, New
York: Oxford University Press.Horgan, T. (1993) « From Supervenience to Superdupervenience:
Meeting the Demands of a Material World », Mind 102, p. 555-586.
Kim, J. (1973) « Causation, Nomic Subsumption, and theConcept of Event », The Journal of Philosophy 70, p. 217-236.Kim, J. (1976) « Events as Property Exemplifications », dans
Supervenience and Mind: Selected Philosophical Essays Cambridge: CambridgeUniversity Press , 1993, trad. française S. Dunand et M.Mulcey, « Les événements comme exemplifications de propriétés», dans La survenance et l’esprit, Volume 2, Ithaque, 2012.Kim, J. (1989) « Mechanism, Purpose and Explanatory Exclusion
», Philosophical perspectives 3, p. 77-108, trad. française S. Dunandet M. Mulcey, « Mécanisme, finalité et exclusion explicative »,dans La survenance et l’esprit, Volume 1, Ithaque, 2008.Kim, J., « Psychophysical Supervenience », Philosophical Studies
41, p. 51-70, 1982.Kim, J. (2005) Physicalism or Something near enough, Princeton,
Princeton University Press, 2005.Kim, J. (2006) Philosophy of Mind, Westview Press, trad.
française, Philosophie de l’esprit, D. M. Pajus, M. Mulcey et C.Théret, sous la direction de M. Mulcey Ithaque, 2008. Nef, F. (2006) Les propriétés des choses : expérience et logique, Paris,
Vrin.Papineau, D. (1993) Philosophical Naturalism, Oxford : Oxford
Blackwell.Putnam, H. (1967) « The Nature of Mental States », Art, Mind
and Religion, University of Pittsburgh Press, trad. Française, J.M. Roy, dans Philosophie de l’esprit, psychologie du sens commun et sciences del’esprit, textes réunis pas D. Fisette et P. Poirier, Vrin, Paris,2002.Seargent, D. A. J. (1985) Plurality and Continuity. An Essay in G.F. Stout’s
Theory of Universals, La hague, Nijhoff.Van Inwagen, P. (2006), « Properties », Knowledge and Reality,
T.M. Crisp, M. Davidson et D. Vander, (eds.), Springer, p. 15-34. Van Inwagen, P. (2007), « A materialist Ontology of the Human
Person », Persons, Human and Divine, P. Van Inwagen, et D. Zimmerman(eds.), Clarendon Press, Oxford, p. 199-215.Van Inwagen, P. (2011), « L’esprit et la causalité », Igitur,
vol. 3, n° 4, p. 1-22.Whittle, A. (2007) « The Co-Instanciation Thesis »,
Australasian Journal of Philosophy 85, p. 61-79..