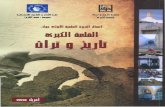De l'autopsie du site éponyme de Groh-Collé (Saint-Pierre-Quiberon) à l'élaboration du cadre...
-
Upload
archeodunum -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of De l'autopsie du site éponyme de Groh-Collé (Saint-Pierre-Quiberon) à l'élaboration du cadre...
De l’autopsie du site éponyme de Groh-Collé (Saint-Pierre-Quiberon) à l’élaboration du cadre chrono-culturelde l’Ouest de la France (IVe-IIIe millénaires avant J.-C.)
Présentation du site et historique des recherches
L’habitat ceinturé néolithique de Groh-Collé est établie sur la côteoccidentale, dite « sauvage », de la presqu’île quiberonnaise, près du villagede Kervihan (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan ; fig. 1). Cet éperon barréculminant à 19 mètres NGF surplombe actuellement l’Océan d’une quinzainede mètres. Orientée est-ouest, cette pointe offre un sommet relativement plat.Le substrat, leucogranitique à faciès fin à muscovite dominante, est ponctuéde nombreux filons de micaschiste, de schiste et de quartz.
Mentionné dans la littérature dès 1868, les premières descriptions sontà créditer au compte de l’abbé Collet qui repère sur cette pointe un talusmarqué par « une légère saillie sur le sol [...] ayant la forme courbe d’un ferà cheval, de 25 mètres de long ». Il engage alors des fouilles « dans l’épais -seur et aux deux extrémités du talus », mettant au jour des pierres verticalesqu’il interprète comme les vestiges d’une allée couverte ou d’un cromlech.Le mobilier issu de cette première campagne réunit « une dizaine de vasesen terre cuite dont un orné de dessins pointillés […] trois pointes de flècheen silex et un très grand nombre d’esquilles et de nucléi [ainsi que de]celtae » (Collet, 1868).
Z. Le Rouzic semble avoir réalisé, de 1911 à 1913, la fouille la plusexhaustive, si l’on s’en réfère aux deux plans de terrain et quelques pagesrédigées en 1932 et adressées au Ministère des Beaux-Arts, au moment dela restauration du site (Le Rouzic, 1932). Il s’intéressa au talus de « 37 mètresde longueur, 9 mètres de largeur » décrit comme une « grossière muraille
11
intérieure composée de blocs plats placés debout sur une à trois assises degros galets de granits [et] d’une muraille de blocs également debout, penchéset couchés » pour la partie extérieure. Entre les deux, il signale 3 à 5 mètresd’un blocage de terre glaise et de pierres. Côté sud-ouest, une interruption de2,10 mètres suggère une entrée. A proximité directe de cette muraille, un « fond de cabane, sorte de cuvette oblongue [de] 2 mètres 80 cent. delongueur et 1 mètre 80 cent. de largeur au centre » est mis au jour, compre -nant en son centre « trois pierres placées sur champ fortement rougies par lefeu » avec graines carbonisées, charbons, pièces lithiques et céramiques. Aproximité de cette structure, une deuxième du même type est identifiée,mesurant « 1 mètre 80 cent. de longueur, 1 mètre 60 cent. de largeur et 0,25 cent. de profondeur […] limité[e] par de gros galets et recouvert[e] depierres plates », accompagnée du même aména gement de type « foyer ». Uncoffre de pierre surmontant une masse d’argile accolée à la muraille estinterprété par l’auteur comme le « calage d’un menhir, qui […] surmontaitcette partie de l’enceinte ». Cette couche argi leuse était tapissée d’un« parquet de galets » surmonté d’une couche d’ossements mêlés à du mobi -lier lithique et céramique. Cette couche est enfin recouverte de pierres plates.Au centre du talus, « une chambre dolménique […] formée par 4 blocs »,contenant du mobilier osseux, céramique et lithique, surmontées d’une pierreplate, est qualifiée de bouleversée. L’intervention à proximité du talus a
AUDREY BLANCHARD ET JEAN-NOËL GUYODO
12
Figure 1 - Localisation du site et principaux sites mentionnés
permis à Z. Le Rouzic de mettre au jour de nombreuses structures àl’intérieur de l’enceinte, notamment des « fonds de cabanes » et des « foyers ».Hors structure et près du talus, ce sont « 60 kilogrammes » de céramiques et« 35 kilogrammes d’éclats de silex percutés » qui ont été récoltés, sans plusde précision (ibid.). Suite au classement Monument Historique, Z. Le Rouzicexplique y avoir « redressé les blocs tombés des deux murailles » et« recouvert en partie la muraille nord » lors de sa restauration.
Le matériel ainsi récolté a fait l’objet de multiples études au cours duXXe siècle. C’est finalement G. Bailloud qui donne naissance, en 1975, austyle Groh-Collé, après avoir étudié un nombre important de lots céramiquesdes fouilles menées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle sur le littoralmorbihannais. Il avance alors une périodisation des ensembles, du Néo -lithique moyen au Néolithique final (Bailloud, 1975). La définition qu’ilpropose pour le style de Groh-Collé s’appuie sur les éléments céramiquesrecueillis sur le site éponyme (fouilles de l’abbé Collet et de Z. Le Rouzic)ainsi que ceux des habitats du Lizo (Carnac), de Pen-Men (Groix), d’Er Yoh(Houat) et de certaines tombes à couloir comme Mané Grageux (Carnac) etMané Roullarde (La Trinité-sur-Mer).
Ce style connaît une extension littorale, « du golfe du Morbihan à laBaie d’Audierne » (ibid., p. 364). Parmi ses caractéristiques, on admet desformes basses (bols, écuelles à ruptures de pente, douce dans la plupart descas), des céramiques à fond plat voire aplati, des bords à lèvre épaissie àaplatie et des éléments de préhension et/ou de suspension qui se limitent à degros boutons. Les récipients ont des surfaces lissées, moins souvent lustrées,et des teintes variant du noir au beige. Les décors, essentiellement en creux(cannelures ou incisions), prennent place en partie haute des vases, entrebord et carène. Les affinités décoratives avec le précédent style Castellic sontévidentes et plaident pour une origine locale. Les motifs s’organisentdésormais en panneaux de lignes parallèles horizontales, verticales, obliques,alternées à entremêlées. Des tracés plutôt circulaires sont à mentionner demême que de très rares boutons réalisés par la technique dite au repoussé,notamment sur certaines pièces du site éponyme. En marge de ce répertoire,une production de grands vases à ligne de perforations sous le bord apparaitcommune au Groh-Collé et au Kerugou. Une contemporanéité, mêmepartielle, de ces derniers ensembles est supposée puisque l’influence duKerugou transparait dans « l’évolution des formes et en partie celle desdécors » du Groh-Collé (ibid., p. 364). Les récipients Kerugou sontrégulièrement associés à des céramiques type Groh-Collé. Par la suite, lestyle ainsi défini sera érigé au rang de véritable groupe culturel(L’Helgouac’h, 1976).
AUTOPSIE DU SITE ÉPONYME DE GROH-COLLÉ (ST-PIERRE-QUIBERON)
13
2006-2008 : reprise des fouilles
Les sondages réalisés dès 2006 dans la partie centrale du talus ainsiqu’au niveau de son extrémité septentrionale ont permis la mise en évidence- pressentie par la culture matérielle (Guyodo, 2001) - d’un double phasagede l’occupation du site et d’une perturbation minime lors des interventionsprécé dentes (Le Rouzic 1911 / 1913). En 2007, deux secteurs supplémen -taires ont été ouverts, l’un côté ouest, l’autre en avant du talus côté est. En2008, un sondage a été réalisé au contact de la ceinture intérieure de dallesdressées du talus, au niveau de la zone sondée en 1911 / 1913 par Z. Le Rouzic.Ce sont ainsi 140 m2 qui ont été abordés en trois campagnes, permettant deréunir 7304 pièces lithiques et 1260 éléments céramiques (fig. 2). La surfacetotale ouverte peut paraître dérisoire, mais elle était conditionnée aux normesenvironnementales en vigueur, dans ce secteur protégé appartenant auConservatoire du littoral qui a gentiment autorisé cette fouille pluriannuelle.
Quatre horizons stratigraphiques ont été reconnus (fig. 3 et 4). Sous uncouvert pédologique récent assez anecdotique se distingue une première unitéstratigraphique qui livre un lot lithique et céramique abondant. Elle regroupedeux niveaux sablo-limoneux : le premier (US1a) composé de sable grossiercorrespond à un sol piétiné par l’afflux touristique appréhendé au décapagetandis que le second (US1b), plus fin et charbonneux, n’a pas subi les mêmesdégradations. L’unité stratigraphique 2 est un niveau sablo-limoneux fin brunfoncé à noir, organique, qui offre un ensemble mobilier important maislégèrement moins conséquent. Cet horizon stratigraphique comprend quel -ques structures notamment des calages de poteaux et un calage de monolitheavec son bloc d’environ 0,80 mètre de hauteur effondré à proximité. L’hori -zon stratigraphique 3, sablo-limoneux fin, gris foncé à noir cendreux, n’a étédiscerné que sur quelques mètres carrés. Enfin, le dernier niveau correspondà l’arène granitique, sans mobilier, reposant sur la roche en place.
Au terme de ces fouilles, un scénario a été proposé (fig. 5). Un premiertalus de 5 mètres de largeur barre la pointe de Groh-Collé au niveau de sapartie la plus étroite. Il est installé sur le substrat rocheux préalablementaffouillé, mis à nu et écrêté, facilitant la récupération de matériaux, notam -ment le granite très micacé à gros grains en place sous le tracé du talus et quel’on retrouvera dans son comblement. Cet aménagement du sol après mise ànu préalable est également attesté une dizaine de mètres en arrière du talus(côté intérieur) en lien avec l’exploitation d’une carrière horizontale où ontété extraits les blocs nécessaires à la construction et à l’édification du talusprimaire (Guyodo, Mens, 2013). L’installation d’une semelle souple (niveaucendreux, limon hydromorphe, etc.) et drainante est signifiée par l’apport de
AUDREY BLANCHARD ET JEAN-NOËL GUYODO
14
ces matériaux sur l’emprise restreinte du talus. Ce dernier est architecturé pardes murets de pierres sèches conservés sur 5 à 7 assises, avec blocage internede plaquettes et surtout de blocs massifs de roches locales et de galets marins.Un renfort de poteaux de bois, côté extérieur, est attesté. Des murets trans -versaux internes, perpendiculaires, semblent se dessiner. Ils sont placés àdistances irrégulières ou plutôt installés au niveau de rupture de pente natu -relle pour compenser les forces de poussées latérales. Ces éléments ne sontpas sans rappeler l’architecture contemporaine fouillée en 2001 sur la pointe
AUTOPSIE DU SITE ÉPONYME DE GROH-COLLÉ (ST-PIERRE-QUIBERON)
15
Figure 2 - Plan topographique du site
de Pen Men à Groix (Morbihan ; Molines et al., 2004) ou plus récemment(2010-2013) à la Pointe de la Tranche à l’Ile d’Yeu (Vendée ; Blanchard,2013a), dont les structures sont similaires. Côté extérieur, une tranchée defaible largeur, parallèle au talus et située à une dizaine de mètres de distance,
AUDREY BLANCHARD ET JEAN-NOËL GUYODO
16
Figure 3 - Plan de la zone 1 (d’après Guyodo, 2008)
est utilisée pour l’édification d’une palissade en bois. Côté interne del’enceinte, un niveau de sol associé est encore présent sur près de 0,20 m depuissance, avec mobilier et structures associées (calages de poteaux, calagede monolithe avec son bloc de 0,80 m effondré).
AUTOPSIE DU SITE ÉPONYME DE GROH-COLLÉ (ST-PIERRE-QUIBERON)
17
Figure 4 - Plan de la zone 2 (d’après Guyodo, 2008)
L’étape architecturale récente correspond à l’implantation d’un talusmassif de près de 7 mètres de largeur enserrant le précédent de part et d’autre.Ce dernier talus est formé de dalles extraites, de 0,50 mètre de hauteur côtéouest et de près de 1 mètre de hauteur côté est, disposées de chant et caléesplus fortement côté intérieur ; architecture déjà évoquée sur certains gisementscontemporains tels que Beaumont (Saint-Laurent-sur-Oust, Morbihan ;Tinevez, 1988) ou le Lizo (Carnac, Morbihan ; Lecerf, 1986). Côté internede l’enceinte, ces dalles sont par endroits simplement appuyées contre leparement de l’architecture antérieure, qui devait encore être partiellementvisible lors de cette phase, pour profiter ainsi d’un appui stable. Un niveaud’occupation (US1), surmontant le précédent, est aisément identifiable, sur0,20 à 0,30 m de puissance, avec calages de poteaux à proximité immédiatedu talus (côté interne) et mobilier céramique (décors associés) et lithique.Les perturbations liées aux « multiples » sondages de Z. Le Rouzic en 1911/1913 sont dans ce secteur minimes et aisément repérables (sol meuble,remplissage de blocs disposés en vrac avec vides interstitiels), sur dessurfaces très faibles (3 m2).
Trois datations par le radiocarbone sont disponibles, une par horizonstratigraphique reconnu (tab. 1). Les trois dates obtenues sur charbons debois en 2011 prennent place dans un même intervalle chronologique comprisentre 3000 et 2700 Cal BC, supposant une succession directe de ces archi -tectures et implantations dans un laps de temps relativement court, ce quiavait déjà été évalué au terme de la fouille.
Numéro d’échantillon Zone US Passe Date BP Cal BC
Lyon-8381 (GrA) 2 1 3 4230 +/- 35 2911-2681
Lyon-8380 (GrA) 2 2 7 4325 +/- 35 3023-2889
Lyon-8379 (GrA) 2 3 9 4160 +/- 35 2880-2627
Le caractère domestique de cette implantation est indéniable (niveauxde sols, architectures en pierres, productions matérielles, etc.). Ce gisementconnait toutefois une localisation particulière qui l’astreint à de fortescontraintes climatiques et qui engage peu à une occupation pérenne. Sa posi -tion, à l’ouest de la presqu’île quiberonnaise, sur la côte traditionnellementdite « sauvage », en fait un site particulièrement exposé et sensible, soumisà différentes périodes de l’année à des vents parfois violents. Il correspondplus vraisemblablement à un site occupé de façon temporaire et/ou saison -nière (Blanchard, 2013b).
AUTOPSIE DU SITE ÉPONYME DE GROH-COLLÉ (ST-PIERRE-QUIBERON)
19
Tableau 1 - Groh-Collé, Saint-Pierre-Quiberon, datations par le radiocarbonedisponibles pour le site
L’assemblage lithique
Les différences, tant sur le plan technologique que typologique, deslots récoltés au sein des deux principaux niveaux archéologiques sont peuimportantes. Ainsi, l’approvisionnement en matière première diffère peu :les matériaux exogènes, exceptionnels dans le niveau inférieur (US3 : aucun ;US2 : 0,1 %), sont plus fréquents dans le niveau supérieur (US1b : 0,2 % ;US1a : 0,5 %). Leur provenance est le plus souvent incertaine, à l’exception despièces en silex turonien de la région du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire) ;déjà identifié dans la collection Z. Le Rouzic (Guyodo, 2001). Les matièrespremières locales (galets côtiers, quartz, leucogranite, grès, quartzite, etc.)sont majoritaires.
Des galets bruts, impropres à la taille (difformes, modules réduits ouirréguliers) de même que des galets testés, au débitage interrompu, suggèrentpeut-être une segmentation des intervenants (ramasseurs / tailleurs). De lamême façon, des demi-galets, exploitables, supposent si ce n’est un stockageavant transformation en outil, du moins un produit abandonné sans soucid’économie.
A l’exception de pièces importées comme les lames, fragmentées, depoignards en silex turonien de la région du Grand-Pressigny qui relèventd’une production technique complexe exogène, la chaîne opératoire dévelop -pée sur le gisement est simple et relativement courte. Elle est tournée vers laproduction rapide d’éclats et de façon plus opportuniste de supports lami -naires. Hormis un nucléus débité par pression (Guyodo, 2012), les techniquesengagées sont peu variées : percussion posée sur enclume ou dans unemoindre mesure percussion directe dure. Cette première technique permetd’ouvrir aisément le galet en deux moitiés, qui sont par la suite débitées oufaçonnées. La faible préparation des surfaces frappées, la morphologie desnucléus tout comme la présence de demi-galets suggèrent un débitage rapide,répondant vraisemblablement à des besoins immédiats.
Les supports utilisés bruts sont fréquents (11 à 12,7 % selon lesniveaux), à l’inverse des supports retouchés : le taux d’outillage et le taux de retouches sont en effet faibles (5,6 à 8 %). Les classes d’outils sont peuvariées, dominées par celle des pièces esquillées (50 %), le plus souventconfectionnées sur des nucléus quadrangulaires (fig. 6, n° 1 à 10). Ces piècesont fréquemment de larges plages corticales latérales, qui peuvent faciliter la prise à pleine main. Elles sont cependant absentes dans le lot du plusancien niveau d’occupation (US3). Grattoirs, perçoirs, coches retouchées etdenticulés sont des classes d’outils bien représentées tandis que les racloirset burins sont exceptionnels. Les supports de début de débitage sont privi -
AUDREY BLANCHARD ET JEAN-NOËL GUYODO
20
légiés pour la réalisation des grattoirs et des perçoirs tandis que tous les typesde supports sont utilisés, indifféremment, pour le reste de l’outillage (fig. 6,n° 11 à 20). Les armatures de flèches perçantes sont fréquentes (10). La
AUTOPSIE DU SITE ÉPONYME DE GROH-COLLÉ (ST-PIERRE-QUIBERON)
21
Figure 6 - Productions lithiques, 1-10 : pièces esquillées sur nucléus, 11-15 : grattoirs, 16-19 : perçoirs, 20 : coche retouchée
majeure partie d’entre elles, à pédoncule et ailerons, provient de l’horizonrécent (US1) tandis qu’une seule pièce à pédoncule provient de l’horizonancien (US2, fig. 7, n° 3 à 9). Si l’une d’elle (US1) est façonnée sur silexturonien de la région du Grand-Pressigny, les autres sont confectionnées surmatière première locale. Elles ont la particularité d’avoir un méplat centralnon envahi par les retouches rasantes sur une voire leurs deux faces. Deuxfragments mésiaux de lames de poignards à dos poli, en silex turonien de larégion du Grand-Pressigny, ont été retrouvés dans le niveau supérieur del’horizon ancien (US2) ainsi que dans le niveau le plus récent (US1, fig. 7,n° 1 et 2).
Le macro-outillage, essentiellement sur roches locales, évoque diversesactivités : taille (percuteurs, enclumes), extraction de matière minérale (pics,coins, percuteurs), mouture (meules, molettes) et pêche (poids). Des outilscomposites ont été identifiés dans les séries des différents niveaux. Quelquesgalets à zones polies pourraient avoir servi pour le traitement des surfaces(lissage) des céramiques. Aucune lame de hache polie n’a été découverte encontexte, alors qu’il y en a dans la collection ancienne. Enfin, les prismes dequartz hyalin sont fréquents, dont deux qui se distinguent par des arêtestotalement écrasées par percussion pour le premier et par un polissageintégral pour le second.
AUDREY BLANCHARD ET JEAN-NOËL GUYODO
22
Figure 7 - Productions lithiques, 1-2 : fragments de poignards à dos polis, 3-9 : armatures perçantes (1, 4-9 : us 1 ; 2-3 : us 2)
La production céramique
Sur le plan technologique, les productions des différents lots 2006-2008 et collections anciennes sont similaires. Seul le lot de l’unitéstrati graphique 3 dénote quelque peu (notamment avec un tesson à pâtesableuse) et suggère une occupation bien plus ancienne du site.
Un seul type de pâte céramique a été identifié. Le cortège minéra -logique (quartz, feldspath, muscovite) renvoie à une argile d’altération d’unsocle cristallin. Quelques minéraux, identifiés grâce à des analyses archéo -métriques (pétrographie et spectrométrie RAMAN), supposent néanmoinsdes approvisionnements complémentaires plus lointains : c’est le cas pour leglaucophane (île de Groix) et le disthène (embouchure de la Vilaine et/ousud de l’estuaire de la Loire). Des fragments de roches granitoïdes, desvégétaux ou encore des graines (de céréales pour la plupart) ont égalementété observés. Il reste toutefois difficile d’affirmer qu’il s’agit systématique -ment d’ajouts anthropiques ; à l’inverse de la chamotte, rare volontairementadditionnée. Les inclusions ont des dimensions variées qui ne dépassent querarement 3 millimètres. Aucun tri préalable n’est perceptible à l’œil nu.Néanmoins, les lames minces réalisées sur certains récipients ont permisd’établir que la pâte était préparée et déchargée de ses éléments les plusvolumineux.
Les céramiques sont relativement fines. La grande fragmentation destessons du corpus ne permet pas de distinguer avec certitude toutes les tech -niques exprimées lors du montage des récipients. Le montage au colombinsemble avéré, de même que le modelage ou le montage de plaques. Si lestraitements de surface sont particulièrement poussés dans la collectionancienne (fort taux de pièces lustrées), le corpus récent s’en distingue asseznettement. Il est dès lors évident que les manipulations prodiguées sur lestessons de la collection Z. Le Rouzic (lavage, brossage, conditionnement,multiples études) ont sensiblement généré une modification de l’état de leurssurfaces. Dans le corpus 2006-2008, le lissage, notamment soigné, est plusfréquent dans l’horizon récent. Le polissage et le lustrage des surfaces descéramiques des différentes unités stratigraphiques ont des proportions simi -laires. Les teintes des récipients sont sombres à cœur et en surface ; maissouvent plus claires pour ceux des collections anciennes.
Le lot issu de la fouille 2006-2008 ne compte qu’une forme complète :une coupelle au bord largement débordant vers l’intérieur et l’extérieurprovenant de l’horizon ancien. Quelques éléments morphologiques et/oudécoratifs ont pu être isolés et permettent de mieux cerner la production
AUTOPSIE DU SITE ÉPONYME DE GROH-COLLÉ (ST-PIERRE-QUIBERON)
23
(fig. 8). Les récipients à fonds plats sont plus nombreux que ceux à fondsronds. Les bords ont des formes variées. Ils sont le plus souvent droits àéversés aux lèvres débordantes, amincies, arrondies ou encore aplanies. Lesrécipients carénés sont peu nombreux et même rares dans l’horizon ancien.Il n’y a pas ici de dissemblance avec le lot recueilli par Z. Le Rouzic,réunissant de nombreuses formes basses (bols, écuelles parfois carénés) etdes récipients épais à fond plat, parfois segmentés.
Les éléments de préhension et/ou de suspension sont exceptionnelspuisqu’on ne compte qu’un fragment d’anse, issu de l’horizon ancien. Lesbords à perforations, réalisées avant cuisson, proviennent des différentshorizons stratigraphiques et appartiennent visiblement aussi bien à desformes basses que hautes.
Les décors en creux (cannelures et incisions) sont plus nombreux queceux réalisés en reliefs. Ces derniers sont d’ailleurs plus fréquents dansl’horizon supérieur (US1), avec quatre tessons à nervure, que dans l’horizonsous-jacent (un fin cordon et des boutons). Dans les collections anciennes,ces motifs en relief sont plus variés, avec des cordons qui courent du bord àla carène à la verticale mais également à l’horizontale. Des pastilles, desboutons au repoussé et des boutons à enfoncement sommital existentégalement. Les décors d’incisions et/ou de cannelures prennent place sur lesparties hautes des récipients, entre bord et carène ou entre bord et diamètremaximum. Des lignes parallèles peuvent ainsi courir sur le pourtour desrécipients. Toutefois, les motifs de panneaux de lignes horizontales, verti -cales, voire les deux, sont plus fréquents. Certaines d’entre elles, rectilignesou curvilignes, sont parfois espacées. Le décor en dents de loup concernedes tessons du niveau basal (US3) jusqu’au sommet du remplissage (US1).Les collections anciennes offrent un corpus de motifs décoratifs beaucoupplus foisonnant avec des tracés courbes, des chevrons, des lignes ondées, deszigzags ainsi qu’un décor de cupule.
Les productions, lithique et céramique, recueillies au sein des deuxniveaux archéologiques témoignent d’une grande proximité tant techno -logique que typologique et/ou stylistique. Les deux principales phasesd’occupations se sont donc très vraisemblablement succédées sur un laps de temps assez court.
AUDREY BLANCHARD ET JEAN-NOËL GUYODO
24
AUTOPSIE DU SITE ÉPONYME DE GROH-COLLÉ (ST-PIERRE-QUIBERON)
25
Figure 8 - Productions céramiques du Néolithique récent
Un contexte chrono-culturel précisé
Le groupe culturel Groh-Collé avait donc été défini sur la base de lotsmélangés issus de fouilles anciennes. Le matériel du site éponyme résulteen réalité de deux occupations successives, de surcroit relatives à la fin duNéolithique récent. Le type même du gisement, à savoir un habitat tempo -raire/saisonnier, est également un facteur à prendre en considération ; lesbesoins fonctionnels conditionnant en partie les productions. Dès lors, ilapparaissait nécessaire de reconsidérer cet ensemble et de le replacer dans leNéolithique récent régional (Blanchard, 2012a).
Les sites fouillés et datés du début du Néolithique récent (3800/3700-3400/3300 Cal BC) sont peu nombreux sur le littoral sud-armoricain.Plusieurs enceintes fossoyées du sud de l’estuaire de la Loire livrent descorpus Groh-Collé (Gâtineaux à Saint-Michel-Chef-Chef, Loire-Atlantique ;Guyodo, 2003 ; Le Priaureau à Saint-Gervais, Vendée ; Poisblaud, 2011 ;fig. 9). Les productions céramiques sont alors peu ornées et l’assemblagelithique se caractérise par l’emploi de matières premières principalementlocales, un investissement technique « modeste » et une production domesti -que dominée par les grattoirs, perçoirs et pièces esquillées (fig. 8).
Au même moment, sur le littoral morbihannais, des sites-ateliers,déconnectés de l’habitat, dévolus à la production d’outils lithiques font leur apparition (Guernic à Saint-Pierre-Quiberon ; Guyodo, 2000 ; Groah Denn 1 à Hoëdic ; Blanchard, 2012b). La production lithique est alorstournée vers l’obtention rapide d’outils sur galets côtiers de silex débités parpercussion posée sur enclume. Concernant la production céramique, lesdonnées disponibles dans ce secteur sont rares. La datation obtenue dans latombe à couloir de Port-Blanc (Saint-Pierre-Quiberon ; Schulting, 2005 ;Guyodo et Blanchard, 2014) tend à positionner le style Conguel au début duNéolithique récent. Il coexiste alors avec le Groh-Collé dont il pourrait n’êtrequ’une variante locale (fig. 9). En effet, seuls des motifs tels que les triangleshachurés imbriqués et la forme biconique à ovée le distinguent du Groh-Collé.
La période 3400/3300 à 3100/3000 Cal BC est peu documentée (fig.10). Le Groh-Collé perdure mais les récipients sont désormais plus ornésque lors de la phase précédente. Les éperons barrés par des talus font leurapparition sur la côte atlantique, du Morbihan à la Vendée, à côté des tradi -tionnelles enceintes fossoyées. Ces habitats temporaires et/ou saisonniersont une fonction particulière sans doute en lien avec une spécialisation desactivités de production et l’émergence d’un trafic important de biens, d’idéesou de personnes, suivant les axes fluviomaritimes. Si les populations Groh-
AUDREY BLANCHARD ET JEAN-NOËL GUYODO
26
Collé réutilisent les tombes à couloirs, l’arrivée des Kerugou, autour de 3300Cal BC, va occasionner le développement de monuments funéraires ditsévolués aux formes variées (sépulture à entrée latérale, sépulture en V, en T,etc.). La production lithique est en tout point identique à celle du Groh-Collé.En revanche, la production céramique se distingue par des récipients à fondsplats, carénés et des décors en relief (nervures verticales, boutons, fig. 8).
Le site éponyme correspond donc à l’ultime phase du Néolithiquerécent, à la charnière entre les IVe et IIIe millénaires avant J.-C. (fig. 10). LeGroh-Collé se caractérise par des récipients bas, plus fréquemment ornésque lors des phases précédentes (fig. 8). La production lithique témoigne enrevanche de changements socio-économiques majeurs. Les armatures deflèches se diversifient avec les premières productions sur matières premièreslocales d’armatures perçantes à ailerons naissants et à pédoncule et ailerons.L’importation des premières lames de poignards en silex turonien de larégion du Grand-Pressigny (31e siècle avant J.-C.) suggère des contacts avecles groupes orientaux.
AUTOPSIE DU SITE ÉPONYME DE GROH-COLLÉ (ST-PIERRE-QUIBERON)
27
Figure 9 - Synthèse des groupes observés, sur la base de l’assemblage lithique (à gauche) et des productions céramiques (à droite)
AUDREY BLANCHARD ET JEAN-NOËL GUYODO
28
Figure 10 - Caractéristiques du Néolithique récent de l’Ouest de la France
Conclusion
La reprise des fouilles en 2006-2008 sur le site d’habitat de Groh-Colléa révélé deux architectures, inédites, associées à deux principaux niveauxd’occupation datés de la seule fin du Néolithique récent. Corrélées à un statutparticulier du gisement, sans doute temporaire et/ou saisonnier, ces donnéesont rapidement conduit à s’interroger sur le devenir de ce groupe culturel de la fin du Néolithique. La production céramique, l’assemblage lithiqueainsi que les données stratigraphiques assurent désormais deux tempsd’occupations, pour lesquels les modifications sont certes sensibles maislégères. Sachant que la culture matérielle, jusque là considérée commecontemporaine, servait de référent régional pour le groupe de Groh-Collé,dont ce gisement est éponyme, une poursuite des investigations s’imposaitafin de recréer des référentiels fiables.
Une reprise des collections datées de 3800/3700 à 2900/2800 avant J.-C. sur l’ensemble du nord-ouest de la France permet désormais deproposer de nouveaux ensembles et un phasage en trois temps du Néolithiquerécent, prenant en compte tant les modifications de la culture matérielle(assemblage lithique et production céramique) que la multiplicité descontextes, statuts et fonctions des gisements. Le Groh-Collé peut certes resterun groupe culturel du Néolithique récent mais doit désormais être entenducomme un ensemble à différents faciès.
Les sites d’habitat néolithiques encore conservés en élévation au XXIe
siècle sont très rares, d’où l’urgence de traiter ce genre d’information au plus tôt, notamment sur ce type de site mis en péril par l’afflux touristiqueet la forte érosion littorale et marine, qui s’accélère d’année en année. Néan -moins, la recherche ne peut se concentrer uniquement sur la zone nucléairemorbihannaise, et essentiellement littorale, mais impose aussi de porter uneattention particulière dans les secteurs les plus éloignées de son aire d’exten -sion, comme le Centre et le Nord de la Bretagne, où les données pour cettephase chronologique sont lacunaires voire inexistantes.
Audrey Blanchard Membre associée UMR 6566 CReAAH
Laboratoire de recherche Archéologie et Architectures, [email protected]
et Jean-Noël GuyodoMaître de conférences en Archéologie - Préhistoire
Université de Nantes, LARA-Nantes, UMR 6566 CReAAHLaboratoire de recherche Archéologie et Architectures
UFR d’Histoire, Histoire de l’Art et Arché[email protected]
AUTOPSIE DU SITE ÉPONYME DE GROH-COLLÉ (ST-PIERRE-QUIBERON)
29
Bibliographie
BAILLOUD, Gérard, « Les céramiques « cannelées » du Néolithique morbihannais »,bulletin de la Société préhistorique française, 1975, t. 72, n° 1, p. 343-367.
BLANCHARD, Audrey, « Occupations insulaires au Néolithique récent : Groah Denn1 à Hoedic (Morbihan) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 2012, t. 119,n° 1, p. 7-30.
BLANCHARD, Audrey, Le Néolithique récent de l’Ouest de la France (IVe-IIIe
millénaires avant J.-C.) : productions et dynamiques culturelles, thèse de doctorat,Université de Rennes 1, 2012, 2 vol., 643 p.
BLANCHARD, Audrey, « Organisation et gestion de l’espace littoral du sud du Massifarmoricain au Néolithique récent », in : M.-Y Daire., C. Dupont, A. Baudry, C.Billard, J.-M. Large, L. Lespez, E. Normand, C. Scarre (dir.), Anciens peuplementslittoraux et relations homme/milieu sur les côtes de l’Europe Atlantique / Ancientmaritime communities and the relationship between people and environment alongthe european Atlantic coasts, actes du colloque international HOMER, Vannes, 28 sept. / 1er oct. 2011. Oxford, British Archaeological Reports, S2570, 2013, p. 295-306.
BLANCHARD, Audrey, L’éperon barré néolithique de la Pointe de la Tranche, l’Îled’Yeu, rapport final d’opération, Service régional de l’Archéologie des Pays de laLoire, Nantes, 2013, 182 p.
COLLET, Abbé, « Monument de Kervihan », bulletin de la Société polymathique duMorbihan, Vannes, 1868.
GUYODO, Jean-Noël, « L’atelier de débitage de Guernic (Saint-Pierre-Quiberon,Morbihan) : résultats des campagnes 1998-1999 », bulletin de l’AMARAI, 2000, n° 13, p. 43-64.
GUYODO, Jean-Noël, Les assemblages lithiques des groupes néolithiques sur le Massifarmoricain et ses marges, thèse de doctorat, Université de Rennes 1, 2001, 465 p.
GUYODO, Jean-Noël, Le site d’habitat néolithique des Gâtineaux à Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique), rapport final d’opération, Service régional del’Archéologie des Pays de la Loire, Nantes, 2003, 28 p.
GUYODO, Jean-Noël, « L’Ouest sous pression : premiers indices de productionscomplexes (Ve - IVe millénaires avant J.-C.) », in G. Marchand, G. Querré (dir.),Roches et Sociétés de la Préhistoire, entre Massifs cristallins et Bassins sédimentaires,actes du colloque international de Rennes, 28-30 avril 2010. Presses Universitairesde Rennes, 2012, p. 317-324.
GUYODO, Jean-Noël et Blanchard, Audrey, « Histoires de mégalithes : enquête à Port-Blanc (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan) », Annales de Bretagne et des Paysde l’Ouest, t. 121-2, 2014, p. 7-30.
GUYODO J.-N., MENS E. (dir.), Les Premières architectures en pierre en Europeoccidentale du Ve au IIe millénaire avant J.-C., actes du colloque international deNantes, Musée Thomas Dobrée, 2 - 4 octobre 2008, Rennes, 2013, Presses Univer -sitaires de Rennes, collection « Archéologie et culture », 307 p.
AUDREY BLANCHARD ET JEAN-NOËL GUYODO
30
LECERF, Yannick, « Une nouvelle intervention au camp du Lizo en Carnac(Morbihan) », Revue Archéologique de l’Ouest, n° 6, 1986, p. 47-58.
L’HELGOUAC’H, Jean, 1976, « Les civilisations néolithiques en Armorique », in LaPréhistoire Française, Les civilisations néolithiques et protohistoriques de la France,t. 3, p. 365-374.
LE ROUZIC, Zacharie, Carnac, restaurations faites dans la région. Talus de défenseavec dolmen et fonds de cabanes de Croh-Collé (Commune de Saint-Pierre-Quiberon), rapport aux Beaux-Arts manuscrit, Carnac, 1932, 9 p., 2 plans, inédit.
MOLINES, Nathalie, DAIRE, Marie-Yvane et GUYODO, Jean-Noël, Les occupationspréhis toriques et protohistoriques de l’île de Groix (Morbihan), fascicule de la Journée« Civilisations Atlantiques et Archéosciences », Rennes 27 mars 2004, p. 29-31.
POISBLAUD, Benoît, Saint-Gervais (85) Le Priaureau, rapport final d’opération, INRAPGO, Service régional de l’Archéologie des Pays de la Loire, Nantes, 2011, 128 p.
SCHULTING, Rick, « Comme la mer qui se retire : les changements dans l’exploitationdes ressources marines du Mésolithique au Néolithique en Bretagne », in G.Marchand, A. Tresset, Unité et diversité des processus de néolithisation sur la façadeatlantique de l’Europe (6e-4e millénaire avant J.-C.), actes de la table ronde (Nantes,2002), Société préhistorique française (mémoire XXXVI), 2005, p. 163-171.
TINEVEZ, Jean-Yves, « La sépulture à entrée latérale de Beaumont à Saint-Laurent-sur-Oust », Revue Archéologique de l’Ouest, n° 5, 1988, p. 55-78.
Résumé :Mentionné dans la littérature dès 1868 par l’Abbé Collet, l’habitat
néolithique de Groh-Collé (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan) a fait l’objetde plusieurs explorations à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. La plusexhaustive revient à Z. Le Rouzic qui, en 1911-1913, met au jour un talus,une « chambre dolménique » ainsi que plusieurs « fonds de cabanes ». Lemobilier récolté a fait l’objet de nombreuses études. Les productionscéramiques sont rapidement dites caractéristiques d’un groupe culturel. Lesite devient éponyme et une référence pour le Néolithique récent de l’Ouestde la France.
La reprise des fouilles sur le gisement en 2006-2008 (dir. J.-N. Guyodo)va quelque peu modifier la donne. Des niveaux d’occupation distincts,associés à deux architectures bâties (des talus) au cours du seul Néolithiquerécent, sont mis en évidence et datés de 3000-2700 avant J.-C. Le mobiliercéramique des fouilles de Z. Le Rouzic, à l’origine de la définition du styleGroh-Collé, et jusqu’alors étudié comme un lot unique et homogène, serapporte en réalité à deux occupations successives réunies en un seulensemble. Il ne peut plus servir raisonnablement de base pour définir lesproductions domestiques de la fin du Néolithique récent.
AUTOPSIE DU SITE ÉPONYME DE GROH-COLLÉ (ST-PIERRE-QUIBERON)
31
En conséquence, il est apparu nécessaire de reconsidérer le Groh-Colléet de le replacer dans le Néolithique récent régional. Pour cela des rappro -chements et des comparaisons ont été réalisés avec d’autres gisements,notamment ceux du sud du Massif armoricain. Trois phases chronologiquesont dès lors été distinguées ; le site éponyme de Groh-Collé ne correspondantqu’à l’ultime phase du Néolithique récent. De la même façon, troisensembles géographiques ont été mis en évidence, du Finistère au sud del’estuaire de la Loire. Enfin, le type de gisements (habitats, funéraires, sitesateliers) et leur statut ont été pris en compte pour distinguer les choixenvironnementaux et fonctionnels des traits culturels du Groh-Collé.
Abstract :
Mentioned since 1868 by Abbé Collet, the neolithic settlement ofGroh-Collé (Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan) was the object of severalexplorations and digs from the end of the XIXth to the beginning of the XXth
century. The most exhaustive digs were realized by Z. Le Rouzic, in 1911-1913, which brings to light a bank, a ‘dolmen’ and several ‘huts’. The rawmaterial collected was the object of several studies. Ceramic productions arequickly said characteristics of a cultural group. The site becomes eponymand then a reference for Late Neolithic in the West of France.
New excavations in 2006-2008 (dir. J.-N. Guyodo) going to modifythis fact. Differents stratigraphic levels, associated to two built architectures(banks) during the only Late Neolithic, are dated 3000-2700 BC. Theceramic sets of the Z. Le Rouzic digs, at the origin of the definition of Groh-Collé style, and studied as a unique and homogeneous package, relates inreality to two successive occupations gathered in a single group. He cannotserve any more reasonably as basis to define the domestic productions of theend of Late Neolithic.
Accordingly, it seemed necessary to reconsider Groh-Collé and replaceit in the regional Late Neolithic. Links and comparisons were realized withother sites, in particular those of the south of the armorican Massif. Threechonological phases were distinguished; the eponym site of Groh-Collécorresponding in fact to the ultimate one. In the same way, three geographicalgroups were distinguished, from Finistère to the South of the Loire estuary.At last, the type of sites (settlements, funerals, workshops) and their statuswere taken into account to separate the environmental and functional choicesof the cultural features of Groh-Collé.
AUDREY BLANCHARD ET JEAN-NOËL GUYODO
32