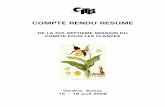Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Performance et gouvernance de l'entreprise
Compte-rendu de J. Bottéro, La plus vieille cuisine du monde, Paris, Éditions Louis Audibert,...
-
Upload
college-de-france -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Compte-rendu de J. Bottéro, La plus vieille cuisine du monde, Paris, Éditions Louis Audibert,...
Food & HistoryInstitut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation
European Institute for the History and Culture of Food
Volume 5 – n° 2 2007
HF
FOOD & HISTORYRevue semestrielle publiée par l’Institut Européen
d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation
16 rue BriçonnetBP.31437
37014 Tours cedex 1
Directeur de PublicationFrancis CHEVRIER
Directeur de l’IEHCATél. 02 47 05 90 30 – Fax. 02 47 60 90 75
e-mail : [email protected]
Rédacteur en chefMassimo MONTANARI
Università degli Studi di Bologna
Secrétariat de rédactionRengenier RITTERSMA
e-mail : [email protected]
Comité de rédactionKarin Becker Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Allen J. Grieco The Harvard University Center for Italian Renaissances Studies, Florence Florent Quellier Université Rennes 2, Haute Bretagne
Manuela Marin Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid Stephen Mennell University College Dublin Henry Notaker (Chercheur indépendant) Antoni Riera Melis Universitat de Barcelona
Marie-Pierre Ruas Centre de bio-archéologie et écologie de l’université de Montpellier Françoise Sabban Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, Paris Peter Scholliers Vrije Universiteit Brussel John Wilkins University of Exeter
Avec le concours du Ministère de l’Education nationale,
de l’Université François-Rabelais de Tours, du Conseil Régional du Centre
FOOD & HISTORYBiannual journal published by the European Institute
for the History and Culture of Food
16 rue BriçonnetBP.31437
37014 Tours cedex 1
Series Editor Francis CHEVRIERDirector of IEHCA
Tel. +33 ( 0 ) 2 47 05 90 30 – Fax. +33 ( 0 ) 2 47 60 90 75e-mail : [email protected]
Editor Massimo MONTANARI
Università degli Studi di Bologna
Secretary Rengenier RITTERSMA
e-mail : [email protected]
Editorial Board Karin Becker Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Allen J. Grieco The Harvard University Center for Italian Renaissances Studies, Florence Florent Quellier Université Rennes 2, Haute Bretagne
Manuela Marin Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid Stephen Mennell University College Dublin Henry Notaker (Chercheur indépendant) Antoni Riera Melis Universitat de Barcelona
Marie-Pierre Ruas Centre de bio-archéologie et écologie de l’université de Montpellier Françoise Sabban Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, Paris Peter Scholliers Vrije Universiteit Brussel John Wilkins University of Exeter
With the support of Ministère de l’Education nationale,
Université François-Rabelais de Tours, Conseil Régional du Centre
© 2008, Brepols Publishers n.v., Turnhout, Belgium
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior permission of the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages in a review.
D / 2008 / 0095 / 137
ISSN 1780-3187ISBN 978-2-503-52321-7
Printed in the E.U. on acid-free paper
Revue bénéficiant de la reconnaissance scientifique du CNRS
Journal with CNRS scientific recognition
TABLE OF CONTENTS / SOMMAIRE
HEBREW FOOD STuDIES / ETuDES SuR L’ALIMENTATION JuIvE
“A covenant of salt” : Salt as a major food preservative in the historical Land of IsraelEfraim Lev / Uri Mayer-Chissick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Food in Roman Palestine : ancient sources and modern researchSusan Weingarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
FRENCH FOOD STuDIES / ETuDES SuR L’ALIMENTATION EN FRANCE
Le repas de funérailles de Bonhomme Jacques. Faut-il reconsidérer le dossier de l’alimentation paysanne des Temps modernes ?Florent Quellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
“Un doux repas”. Politique de l’alimentation chez FénelonOlivier Leplatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Alimentation populaire et secours charitables. L’exemple parisien (1840-1870)Matthieu Brejon de Lavergnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
GERMAN & SCANDINAvIAN FOOD STuDIES / ETuDES SuR L’ALIMENTATION EN ALLEMAGNE ET DANS LES PAYS SCANDINAvES
Food as Social Markers : A Copenhagen Hospital 1800Ole Hyldtoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Bad Habits and Liquid Pleasures. Milk and the Alcohol Abstinence Movement in late 19th Century GermanyBarbara Orland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Cookery and ideology in The Third ReichHenry Notaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
To Do Business, to Practise Ethics, and to Produce Knowledge : The Construction of ‘Organic Milk’ in Sweden in the late 20th CenturyOskar Broberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
AMERICAN FOOD STuDIES / ETuDES SuR L’ALIMENTATION Aux ETATS-uNIS
Worthy of Respect : Black Waiters in Boston before the Civil WarKelly Erby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Indian Restaurants in San Francisco and America : A Case Study in Translating Diversity, 1965-2005Laresh Jayasanker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
DOSSIER : FOOD QuALITY / LA QuALITé ALIMENTAIREEdited by Jérôme Bourdieu, Martin Bruegel, Peter Atkins
“That elusive feature of food consumption ”: Historical perspectives on food quality, a review and some proposalsJérôme Bourdieu, Martin Bruegel, Peter Atkins . . . . . . . . . . . . . . . 283
Managing a natural ressource : the Mantova fish market in modern timesAlberto Grandi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Searching for the Best Standard : Different Strategies of Food Regulation during German IndustrializationVera Hierholzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Review articles / Comptes rendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Submission of articles / Envois d’articles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Jean Bottéro, La plus vieille cuisine du monde Paris, Éditions Points, Coll. Histoire, 2006. 208 pages. ISBN 2-02-086052-X, 7 €
La plus vieille cuisine du monde
La sortie en livre de poche de l’ouvrage de Jean Bottéro, La plus vieille cuisine du monde, paru initialement en 2002, aux éditions Louis Audi-bert (Paris)1, est l’occasion de rendre hommage à ce grand chercheur, récemment décédé, le 15 décembre 2007. L’auteur a conçu ce livre comme une version grand public tirée d’un travail précédent réalisé sur les trois fameuses “tablettes de Yale”, datées de 1700-1600 av. J.-C. env., nous livrant 35 recettes culinaires2. Il n’en reste pas moins un ouvrage d’érudition qui, sous des apparences de vulgarisation, peut parfois rester difficile d’accès pour le non-spécialiste. Après avoir posé les bases de la culture mésopotamienne (le pays et les gens, en donnant une carte et une chronologie) et présenté les sources épigraphiques (directes et indirectes) dont il fait son point de départ (une cinquantaine de recettes en tout)3, Jean Bottéro nous entraîne dans un voyage gustatif au travers d’une approche qui se veut principalement anthropologique. Son but est d’élargir son propos afin d’adopter une vision d’ensemble de l’alimenta-tion des anciens Mésopotamiens. Pour ce faire, l’auteur a donc étudié, dans un premier temps, tout ce qui touche de près ou de loin à la cuisine : partant du feu et des modes de cuisson, qu’il faut comprendre avant de
1 Cet ouvrage a récemment été traduit en anglais : The Oldest Cuisine in the World : Cooking in Mesopotamia (Chicago, 2004).
2 Jean BOTTERO, Textes culinaires mésopotamiens (Winona Lake [Indiana], 1995). On y trouve les copies des textes, ainsi que les transcriptions, traductions et commentaires linguisti-ques. Voir aussi son article préliminaire : “The Culinary Tablets at Yale”, Journal of the American Oriental Society, vol. 107 (1987), pp. 11-19.
3 Ce silence des sources sur les recettes est tout à fait étonnant pour une civilisation qui écrivait somme toute beaucoup, d’autant plus qu’il en va de même pour les populations contemporaines voisines de la Mésopotamie (Hittites, Egyptiens…). On peut tout de même signaler l’ouvrage de Madeleine PETERS-DESTERACT, intitulé Pain, bière et toutes bonnes choses… L’alimentation dans l’Egypte ancienne (Monaco, 2005), qui fait le pendant à celui de J. Bottéro pour le domaine égyptien. Pour l’alimentation chez les Hittites, voir par exemple Harry A. HOFFNER Jr., Alimenta Hethaeorum. Food Production in Hittite Asia Minor (New Haven, 1974).
Food & History, vol. 5, n° 2 (2007), pp. 357-360
358 Review articles / Comptes rendus
pouvoir appréhender le contenu des recettes, J. Bottéro évoque également les modes de conservation des aliments pour expliquer certains usages culinaires comme la grande proportion des fruits secs par exemple ou encore les différents types de boissons, alcoolisées ou non.4 Les ustensiles de cuisine ne sont quant à eux que très rapidement évoqués.5
Il tente également de familiariser le lecteur avec les mœurs des anciens Mésopotamiens à travers l’étude de ce qui constitue selon lui les trois stades de la cuisine : la préparation, la cuisson et la présentation.
Puis, afin d’être complet, J. Bottéro présente les différents acteurs de cette cuisine, acteurs à différents niveaux : d’abord au niveau de la confection, il s’agit alors des “chefs cuisiniers” (nuðatimmu) mais égale-ment de la maîtresse de maison, qu’on ne saurait oublier. A ce propos, il évoque un proverbe sumérien tout à fait actuel (“Quant la maîtresse de maison court les rues / En son absence la servante fait la fête”) qui pourrait être assimilé à notre “Quand le chat n’est pas là, les souris dansent”. Il oppose ainsi une cuisine domestique, au sujet de laquelle on ne sait que très peu de choses, à une cuisine officielle des grands cuisiniers, monde majoritairement masculin, et destinée à des personnages aisés6. Il envisage enfin le niveau des consommateurs, qu’il considère comme de fins gastronomes (pp. 108-109).
En dernier lieu, la symbolique de l’alimentation est abordée, J. Bottéro ne cessant de nous rappeler l’importance de celle-ci, régissant la vie de la naissance à la mort voire au-delà. Ainsi, non seulement la table des dieux est le reflet, en plus grandiose, de celle des hommes, mais les morts doivent aussi se sustenter et ce, par exemple par le biais de rituels funéraires tel que le kispum, bien connu par les tablettes de Mari entre autres.
Au-delà de cela, il existe donc une dimension bien plus grande qui se cache derrière la simple nécessité vitale de s’alimenter, d’où l’insistance de l’auteur, tout au long de l’ouvrage, sur la différence entre se nourrir,
4 Le chapitre intitulé “la cuisine à froid” est en fait dévolu aux techniques de conservation sur lesquelles nous reviendrons ci-dessous.
5 En effet, il se contente (p. 84) de citer et identifier les deux seules formes céramiques trouvées dans ses textes en les considérant comme réservées à cette fonction de cuisson, alors qu’il insiste ailleurs sur la diversité des batteries de cuisine retrouvées (voir Jean BOTTERO, “La plus vieille cuisine…” [1992], p. 85).
6 Si J. Bottéro insiste sur la “dignité du métier” de cuisinier, on peut aussi ajouter que ceux-ci étaient des personnages très recherchés comme l’ont démontré Jack SASSON (“Instances of Mobility among Mari Artisans”, Bulletin of the American School of Oriental Research, vol. 190 [1968], pp. 46-54) ou Denis LACAMBRE, Adelina MILLET ALBA (voir le chapitre “12. L’en-tretien de Sîn-iqı̄šam : pain et bière pour un haut fonctionnaire de Samsı̄-Addu”, in Ö. TUNCA, A. BAGHDO [eds.], Chagar Bazar (Syrie) III. Les trouvailles épigraphiques et sigillographiques du chantier I (2000-2002) [Louvain/Paris/Dudley, 2008], pp. 225-226).
Review articles / Comptes rendus 359
pour survivre, et manger, qui sous-entend des repas pris en société permettant des prises de décisions, des alliances politiques, etc. Dans la perspective pédagogique que propose l’auteur, ce dernier parsème son ouvrage de notes d’humour7 ou de rappels des principaux traits de la culture mésopotamienne, comme la présentation de grands mythes tels que celui de Gilgamesh et de textes religieux dont l’auteur était également l’un des spécialistes. La version de 2002 est également agrémentée de quelques photos bien que, de façon tout à fait étonnante, celui-ci ne présente aucune reproduction de tablette. Il est dommage que la version de poche ne propose qu’une carte de la Mésopotamie.
Ainsi, quelques aspects problématiques de l’ouvrage sont à relever. On déplorera le fait que l’auteur, épigraphiste sans conteste possible,
n’envisage, à aucun moment, l’archéobotanique comme une méthode pouvant venir en aide à quiconque étudie la cuisine ancienne. Il affirme même que l’ethnographie ne peut être d’un quelconque secours (p. 109). Plus surprenant encore, J. Bottéro va jusqu’à affirmer (p. 78) que “bâti plus volontiers d’argile”, la fragilité du tannoûr (four à pains) “ne nous a point encore offert à ce jour (si je n’oublie rien !), la chance d’en récu-pérer, même en morceaux, quelque spécimen vénérable”, ce qui est tout à fait étonnant vu que l’on en retrouve un peu partout.
Il ne fait également qu’effleurer la question des tabous alimentaires (p. 61), notion malheureusement assez difficile à appréhender. Pour la question particulière du porc, nous renvoyons à l’ouvrage suivant : Brigitte LION, Cécile MICHEL (eds.), De la domestication au tabou. Le cas des suidés au Proche-Orient ancien (Paris, 2006).
Il en va d’ailleurs de même pour la question, encore quelque peu problématique faute d’indices suffisants, de la conservation par le “sucre”. En effet, bien documenté et ayant par ailleurs travaillé sur le sujet,8 J. Bottéro ne fait que mentionner très rapidement cet aspect de la conservation. Il ne mentionne pas non plus la possibilité de sortes de conserves d’aliments déjà cuisinés, pratique courante au début du IIe millénaire av. J.-C. notamment.9
7 Notes d’humour mésopotamien puisqu’il évoque l’une ou l’autre farces où les plats prévus se composent de “crottin de mulet, à l’ail, et de la paille hachée, au lait tourné ! (p. 41)” ou personnelles se plaisant à qualifier de “thé” quelques boissons aromatisées (p. 138).
8 Voir Jean BOTTERO, “La plus vieille cuisine du monde”, in J. BOTTERO (ed.), Initiation à l’Orient ancien de Sumer à la Bible (Paris, 1992), p. 83 ; J. BOTTERO, “Konzervierung”, dans Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie, vol. VI (Berlin/New York, 1980-1983), p. 196.
9 Voir Cécile MICHEL, “A table avec les marchands paléo-assyriens”, in H. WAETZOLDT, H. HAUPTMANN (eds), Assyrien im Wandel der Zeiten, XXXIXe Rencontre Assyriologique Inter-nationale Heidelberg 6.-10. Juli 1992 (Heidelberg, 1997), pp. 99, 110-111.
360 Review articles / Comptes rendus
En dernier lieu, il serait nécessaire de nuancer les propos de J. Bottéro lorsque celui-ci affirme qu’en dehors des professionnels (donc des scribes) nul ne savait lire et écrire. En effet, Dominique Charpin nous dépeint une situation bien différente dans son dernier ouvrage Lire et écrire à Babylone (Paris, 2008).
L’ouvrage de Jean Bottéro n’en demeure pas moins des plus instructifs et incontournable pour qui veut étudier cet aspect de la civilisation mésopotamienne.
Rappelons que beaucoup de tablettes encore inédites, dormant dans différents musées du monde, ainsi que les futures découvertes archéo-logiques nous réserveront peut-être de bonnes surprises dans l’avenir. En revanche, il est tout à fait déconseillé de se nourrir en suivant ces recettes, on serait certainement déçu celles-ci n’indiquant aucun temps de préparation, rarement les quantités et posant, souvent, des problèmes d’identification des ingrédients…10
Julie Patrier, Université Marc Bloch-Strasbourg II, France
10 Jean BOTTERO, La plus vieille cuisine… (2006), pp. 193-194. L’auteur est d’ailleurs farouchement opposé à toute tentative de recréer les mets des anciens Mésopotamiens. Voir, par exemple, J. BOTTERO, “The Culinary Tablets…”, pp. 18-19 ou J. BOTTERO, “La plus vieille cuisine…” (1992), pp. 100-101.




















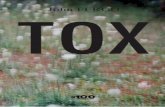
![[Compte-rendu] Sally Price: au musée des Illusions. Le rendez-vous manqué du Quai Branly](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6313f5353ed465f0570aea38/compte-rendu-sally-price-au-musee-des-illusions-le-rendez-vous-manque-du-quai.jpg)