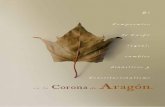CHOIX des PAGES MODIFIER Liste des ^«yes & nodifier . ftc ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of CHOIX des PAGES MODIFIER Liste des ^«yes & nodifier . ftc ...
CHOIX des PAGES MODIFIER
Liste des «yes & nodifier . ftc
identificationlocalisationdescription du trou nutubagesannulairescontexte liydrogéo log iquevenues d'eaucoupe géologiquedéveloppementponpages d'essaiparamètres physico-chinique«géophysiquc'd iagraphiesobservations conplénentaires
* : Pages dont les donnéesont été saisies .
C ox : AIICFDH^«ccRSsir Her. r- (\,?..C..
Saisie des Informations de (orages et valorisation immédiate sous forme de coin pie-rendud'ex¿r.uti(m Ri dû cdupes technique Ü\ Üthotagiquc. Transfert possible en bsss dt donnéespour ¡nlenonaiions, tris, traitements statistiques et cartographiques.
BRGM
Logiciel ACTIF
Acquisition et Traitement
des Informations de Forages
Prise en main et applications
VERSION 3.4
Septembre 1989
Claude ARMAND, Jean-Marie BARRAT
Yves BARTHELEMY et Philippe CROCHET
R 30194
EÀU 4S 89
PR 93 048 00052
BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERESSERVICE DU SOL ET DU SCUS-SOL - Départeoent EAU
Boîte Postale n" 6009 - 45060 ORLEANS CEDEX
Tél. 38.64.34.34 - Télex BRGM 780 258 F
ACTIF est un logiciel spécialisé dans l'élabo¬ration des comptes rendus de forage d'eau. Il estdestiné aux sociétés de forage, bureaux d'étude etorganismes chargés de la gestion des données hydro -géologiques .
Très "convivial", ce logiciel est utilisable partout scientifique après quelques heures de familiari¬sation. Ce manuel d'utilisation est un répertoirecomplet de toutes les fonctions et possibilités offer¬
tes par ACTIF.
Ce produit ACTIF est constitué d'un volume dedocxomentation (celui-ci) , de deux disquettes 2S/HD ou 4disquettes 2S/2D et d'une clé d'accès (boîtier élec¬
tronique de protection) . Tous les programmes et fi¬chiers nécessaires se trouvent sur les disquettes .
Ce logiciel bénéficie de la protection légaleaccordée aux logiciels. Les disquettes peuvent êtredupliquées sans restriction par l'utilisateur, mais
l'usage d' ACTIF nécessite la présence de la clef deprotection sur le port parallèle du micro -ordinateur.
En l'absence de la clef de protection, ACTIF peutêtre utilisé comme une version de démonstration,
permettant de tester et de s'initier au logiciel, sans
assurer la sauvegarde des données.
Si après avoir lu ce manuel et utilisé ACTIF,
vous souhaitez contacter le BRGM pour des remarques ,
des questions ou des suggestions, n'hésitez pas àenvoyer une lettre détaillée à l'adresse suivante :
BRGM - Département EAUBP 6009 - 45060 ORLEANS CEDEX 2 FRANCE
Si vous êtes de ceux qui ne lisent pas lesnotices et documentations, ne refermez pas ce volumesans avoir survolé les chapitres III "Configuration dulogiciel" et IV "Répertoire de travail".
SOMMAIRE
I - DESCRIPTION GENERALE I. 1
II - INSTALLATION OU MISE A JOUR DU II. 1
LOGICIEL "ACTIF" SUR LE DISQUE DUR
III - LANCEMENT ET CONFIGURATION DU LOGICIEL III. 1
"ACTIF"
1. LANCEMENT DU PROGRAMME III. 3
2. CONFIGURATION DU LOGICIEL "ACTIF" III. 5
2.1. Libellé de l'utilisateur III. 5
2.2. Pays ou organisme utilisateur III. 62.3. Divisions administratives III. 6
n* 1, 2, 3. 4. 5. 6
2.4. Unité (s) utilisée (s) pour les III. 6
coordonnées géographiques2.5. Option retenue pour les III . 7
sorties sur table traçante
2.6. Edition de la coupe III. 9
lithologique2.7. Nombre de lignes par page III. 10
imprimante
2.8. Présentation du compte-rendu III. 10
sur imprimante2.9. Format du numéro de classe- III. 10
ment national
2 . 10 . Carte graphique utilisée III . 122.11. Type d'écran utilisé III. 122.12. Format utilisé pour les dates III. 122.13. Unité utilisée pour les III. 13
diamètres
2.14. Unité utilisée pour les débitsIII.13
3. CONNEXION DES PERIPHERIQUES III . 14
3.1. Connexion de 1 ' imprimante III . 143.2. Connexion de la table tra- III. 14
çante
V. 3
V. 3
V. 4
V. 6
V. 7
V. 7
IV - REPERTOIRE DE TRAVAIL ET LISTE IV. 1
DES FICHIERS MEMORISES
V - SAISIE. MODIFICATION. MEMORISATION V. 1
DES DONNEES
1. PRINCIPES GENERAUX
1.1. Pages de saisie1.2. Déplacement du curseur
1.3. Codage des réponses etlexiques correspondants
1.4. Messages d'erreur1.5. Tableaux des pages de saisie
C, D, E, G, et H
2. OPTION "SAISIE DES DONNEES RELATIVES V. 11
A UN NOUVEL OUVRAGE"
3. OPTION "CORRECTION OU AJOUT DE DONNEES V.17
POUR UN OUVRAGE DEJA MEMORISE"
4. OPTION "EDITION D'UNE FICHE OUVRAGE" V.19
4.1. Page de saisie A - Identifi- V.21cation de l'ouvrage
4.2. Page de saisie B - Localisation V.23de l'ouvrage
4.3. Page de saisie C - Description V.27du trou nu
4.4. Page de saisie D - Description V.29des tubages
4.5. Page de saisie E - Description V.33des annulaires
4.6. Page de saisie F - Contexte V.35hydrogéologique
4.7. Page de saisie G - Description V.39des venues d'eau
4.8. Page de saisie H - Coupe litho- V.41logique
4.9. Page de saisie I - Développe- V.47ment de l'ouvrage
4.10. Page de saisie J - Pompage V.49d'essai
VI
4.11. Page de saisie K - Paramètres V.53phys ico - chimiques
4.12. Page de saisie L - Géophysique V.55
Diagraphies4.13. Page de saisie M - Observations V.59
complémentaires
EDITION D'UNE FICHE OUVRAGE VI. 1
VII - TRACE DES COUPES LITHOLOGIQUE ET
TECHNIQUE
1. MODE OPERATOIRE
1.1. Echelle du tracé
1.2. Option de tracé1.3. Exécution du tracé
2 . REMARQUES
2.1. Coupe lithologique2.2. Coupe technique
VII. 1
VII. 3
VII. 3
VII. 5
VII. 13
VII . 16
VII. 16
VII . 17
VIII- TRACE DE LA COURBE CARACTERISTIQUE
1. MODE OPERATOIRE
2. EXECUTION DU TRACE
VIII. 1
VIII. 3
VIII. 9
IX - TRACE DE DIAGRAMME SCHOELLER- BERKALOFF IX. 1
1. MODE OPERATOIRE IX. 5
2. EXECUTION DU TRACE IX. 7
X TRACE DES DIAGRAPHIES X. 1
SAISIE, MODIFICATIONS, DESTRUCTION,
IMPORTATION DE DIAGRAPHIES
1.1. Saisie d'une nouvelle
diagraphie
1.2. Modification d'une diagraphie1.3. Descruction d'une diagraphie1.4. Importation d'un fichier ASCII1.5. Fin
X. 5
X. 7
X.ll
X.12
X.15
X.16
EXECUTION DU TRACE X.19
XI - EXPORTATION DE DONNEES "ACTIF" SOUS
FORME DE FICHIER "ASCII"
XI. 1
XII - FONCTIONS UTILITAIRES DIVERSES XII. 1
1. CONSULTATION D'UN LEXIQUE
2. EDITION DE LEXIQUES GENERAUX ET
GEOLOGIQUES3. EDITION DE LA CONFIGURATION
4. TRACE DES FIGURES LITHOLOGIQUES5. EDITION DU BORDEREAU DE SAISIE
6. CREATION / MODIFICATION DE LEXIQUE7. LISTE DES OUVRAGES + DESIGNATION
XII. 5
XII. 7
XII. 7
XII. 9
XII. 10
XII.,11
XII. 13
ANNEXE 1 Anomalies de fonctionnement du
logiciel ACTIF
ANWF.yR 2 Charte des figurés lithologiquesmis en oeuvre dans le tracé de
la coupe géologique. Godes à afficheren 3ème colonne de la page de saisieH du module de saisie.
Al.l
A2.1
FIGURES
111.1 Menu principal déroulant
111. 2 Grille de saisie des options deconfiguration
111.3 Position des switchs pour tabletraçante HP 7475
V.,1 Menu affiché pour l'option "saisie"V.,2 Sélection des pages de saisie
V.,3 Sélection des pages à modifier
V.,4 Page de saisie1 ' ouvrage
A - Identification de
V..5 Page de saisie1 ' ouvrage
B - Localisation de
V,.6 Page de saisienu
Page de saisie
C - Description du trou
V,,7 D - Description des
tubagesV..8 Page de saisie
annulaires
E - Description des
V.,9 Page de saisielogique
F - Contexte hydrogéo-
V.,10 Page de saisievenues d'eau
G - Description des
V,,11 Page de saisie H - Coupe lithologique,12 Page de saisie
1 ' ouvrage
I - Développement de
V.,13 Page de saisie J - Pompage d'essaiV,,14 Page de saisie K - Paramètres
physico - chimiquesV,,15 Page de saisie
Diagraphies
L - Géophysique /
V.,16 Page de saisie M - Observations
complémentaires
10
VI. 1 Compte -rendu édité sur imprimante(page 1/6)
VI. 2 Compte-rendu édité sur imprimante(page 2/6)
VI. 3 Compte -rendu édité sur imprimante(page 3/6)
VI. 4 Compte -rendu édité sur Imprimante
(page 4/6)VI. 5 Compte-rendu édité sur imprimante
(page 5/6)VI. 6 Compte -rendu édité sur imprimante
(page 6/6)
VII. 1 Tracé des coupes. Choix de l'échelleet de l'option de tracé pour le panneaude droite
VII. 2 Tracé des coupes. Option de tracé n* 1.Sortie sur table traçante
VII. 3 Tracé des coupes. Option de tracé n* 2.Sortie sur table traçante
VII . 4 Tracé des coupes . Option de tracé n" 3 .Sortie sur table traçante
VII. 5 Tracé des coupes. Option de tracé n" 4.Sortie sur table traçante
VII. 6 Tracé des coupes. Informations affichéesavant l'exécution du tracé
VIII. 1 Page de saisie pour l'interprétationdes pompages par paliers
VIII. 2 Ajustement de la courbe caractéristiqueà l'écran
VIII. 3 Tracé de courbe caractéristique.Informations affichées avant l'exécution
du tracé
VIII. 4 Tracé de courbe caractéristique. Sortiesur table traçante
11
IX, 1 Sélection des ouvrages pour le tracéd'un diagramme de Schoëller-Berkaloff
IX. 2 Tracé de diagramme de Schoëller-Berkaloff.Informations affichées avant l'exécution
du tracé.
IX. 3 Tracé de diagramme de Schoëller-Berkaloff.Sortie sur table traçante
X.l Menu déroulant spécifique pour la gestiondes fichiers Diagraphie
X.2. Page de saisie relative aux diagraphiesX.3. Affichage écran des noms de diagraphies
mémorisées
X.4. Structure d'un fichier ASCII importable
sous ACTIF pour constituer xon fichier
diagraphiesX.5. Sélection des diagraphies et des options
de tracé désirées
X,6. Tracé des diagraphies. Informationsaffichées avant exécution du tracé
X.7. Tracé des diagraphies. Sortie surtable traçante
XI. 1 Sélection des fichiers ouvrage àexporter sous forme de fichier ASCII
XI. 2 Contenu du fichier ASCII. LST
XI. 3 Contenu du fichier ASCII. LST (suite)
XI. 4 Contenu du fichier ASCII. LST (suite)
XI. 5 Descriptif détaillé de la structuredu fichier ASCII. LST
XI. 6 Descriptif détaillé de la structuredu fichier ASCII. LST (suite)
XI . 7 Descriptif détaillé de la structuredu fichier ASCII. LST (suite)
XI. 8 Descriptif détaillé de la structuredu fichier ASCII. LST (suite)
XI. 9 Descriptif détaillé de la structuredu fichier ASCII, LST (suite)
XI . 10 Descriptif détaillé de la structuredu fichier ASCII. LST (suite)
12
XII . 1 Menu des fonctions utilitaires
XII. 2 Consultation d'un lexiqueXII . 3 Edition des lexiques
XII. 4 Tracé des figurés géologiques : écrande sélection, puis informations affichéesavant l'exécution du tracé
XII. 5 Exemple de liste d'ouvrages mémorisésdans les répertoires des fichiers ACTIF
1.3
L'accélération des vitesses de foration, notam¬
ment en forage au marteau fond de trou où les foreuses
réalisent couramment plus d'un forage par jour, se
traduit de plus en plus souvent par des retards ,
parfois très importants , dans la rédaction des comptes
rendus de forage . Du fait de ces difficultés , on
observe une tendance générale à la réduction de ces
comptes rendus , voire , dans les cas extrêmes , à leur
disparition pure et simple.
Ces pratiques bien compréhensibles au regard de
la charge de travail des surveillants de forage, n'en
sont pas moins très préjudiciables aux sociétés de
forage, bureaux d'étude et organismes publics chargés
de la gestion des données géologiques, tant il est vrai
que les archives de forage constituent une des princi¬
pales sources de leur savoir.
En termes économiques , ce sont des sommes très
importantes qui sont gaspillées, du simple fait que des
rapports de forage manquants ou incomplets peuvent
amener à refaire une campagne de forage quelques années
plus tard.
Confronté à ces problèmes dès la fin des années
1970, le BRGM a développé dès cette époque une chaîne
de logiciels fonctionnant sur micro -ordinateurs HP-75.
Cette chaîne de logiciels, baptisée "Chaîne HIVI", a
1.4
permis, et permet encore, de réaliser des milliers de
comptes -rendus de forages dans plus d'une dizaine de
pays .
Le logiciel ACTIF, développé depuis 1986, en est
la transcription sur micro -ordinateur compatible PC. Il
offre six fonctions principales :
- saisie et mémorisation des données de forage,- édition d'un compte-rendu de forage sur impri¬mante ,
- tracé de coupes lithologique et technique,- tracé de courbes caractéristiques ,
- tracé de diagrammes de Schoëller-Berkaloff,- tracé de diagraphies .
Développé en langage BASIC compilé, ce logiciel
est extrêmement convivial et son utilisation ne re¬
quiert aucune compétence en informatique. Un appren¬
tissage de quelques heures suffit à en assurer la
maîtrise complète.
Le module de saisie est très complet. Il permet à
l'utilisateur de ne négliger aucune donnée importante,
tout en s 'adaptant très facilement à ses besoins et
contraintes .
1.5
En moyenne, les temps requis pour l'élaboration
d'un compte -rendu de forage avec le logiciel ACTIF sont
les suivants :
- saisie des données : de 5 à 10 minutes,
- édition sur imprimante : de 2 à 10 minutessuivant l'imprimante utilisée,
- dessins sur table traçante : de 15 à 45 minutes
au total pour les 4 types de graphiques .
Pour réaliser des comptes rendus extrêmement complets ,
il suffit donc de 20 à 65 minutes par forage, dont
seules les 5 à 10 minutes correspondant à la phase de
saisie des données nécessitent la pleine participation
de 1 ' opérateur .
Le matériel nécessaire est le suivant :
- micro-ordinateur compatible IBM/XT ou IBM/AT avec320 Ko de mémoire centrale, équipé d'un disquedur, d'un écran couleur ou monochrome et d'une
carte graphique (EGA, CGA, Hercules) ;
- imprimantes 80 colonnes ;
- table traçante de format A4 ou A3 , compatibleHP-GL.
1.6
Le logiciel ACTIF est l'un des maillons de la
chaîne modulaire de gestion Informatisée Des Eaux
(GIDE) développée par le BRGM sur micro -ordinateur
compatible PC. Celle-ci comporte, en amont, des modules
d'acquisition automatique de données in-situ (MADO) et
d'interprétation semi -automatique des pompages d'essai
(ISAFE ) , et en aval un module de base de données pour
la gestion des eaux (BADGE) débouchant sur le traite¬
ment et l'interprétation des données : tri, édition de
tableaux, analyse statistique, reports graphiques et
cartographiques, modélisation.
II. 3
ACTIF est foumi avec l'un des quatre jeux de
disquettes suivants :
- deux disquettes 5"l/4 de t3T)e 2S/HD (1,2 Mo),- six disquettes 5"l/4 de type 2S/2D (360 Ko),- trois disquettes 3"l/2 de type 2S/4D (720 Ko),- detox disquettes 3"l/2 de tj^je 2S/HD (1,4 Mo).
Chacune de ces disquettes est identifiée par un numéro .
Compte -tenu de la place mémoire requise par ses diffé¬
rents fichiers (environ 1,5 Mo au total), ACTIF doit
être installé sur disque dur.
Pour une première installation d' ACTIF sur disque
dur , ou une mise à j our ultérieure , placer la disquette
n° 1 dans le lecteur de disquette A: , puis frapper la
commande A: INSTALL, suivie d'vme pression sur la touche
^ (RETURN, ou ENTER ou ENTREE).
Indiquer alors le nom du répertoire dans lequel
installer le logiciel (C:\ACTIF en principe), puis
appuyer sur la touche 4J . S'il n'existe pas, ce réper¬
toire est créé et la copie du logiciel ACTIF s'effectue
dans ce répertoire. Au cours de la procédure d'instal¬
lation, des informations sont affichées à l'écran pour
demander à l'utilisateur de placer successivement les
différentes disquettes dans le lecteur A: .
II. 4
Protection du logiciel
ACTIF est un logiciel protégé. Son utilisation
nécessite la présence d'une clé d'accès, matérialisée
par un boîtier électronique livré avec le logiciel,
qu'il faut enficher sur le port parallèle n° 1 du
micro -ordinateur. Si l'imprimante est connectée sur ce
port, il faut intercaler le boîtier entre le micro¬
ordinateur et celle-ci ; dans ce cas, il faut impéra¬
tivement que l'imprimante soit sous tension.
III. 2
Version 3.ii
BRGM
09/
SAISIE des données relatives S un nouvel ouvrageCORRECTION ou AJOUT de données pour un ouvrage dëjâ mémoriséEDITION d'une fiche ouvrageTRACE de - coupe géologique et technique
- courbe caractéristique- dlagranme SCHOËLLER-BERKALOFF- de diagraphies
EXPORTATION de données d'ouvrages sous forme de fichier ASCIICONFIGURATION du logiciel ACTIFREPERTOIRE de travail et LISTE des ouvrages memorisesFonctions UTILITAIRES diverses
FIN des traitements
FIGURE III. 1
Menu principal déroulant
III. 3
1 - LANCEMENT DU PROGRAMME
Pour lancer ACTIF, l'utilisateur doit se placer
dans le répertoire où a été installé le logiciel
(C:\ACTIF en principe, sauf choix d'un autre répertoire
lors de la procédure d'installation).
La commande ACTIF (ou AC) permet de lancer
l'exécution du logiciel en provoquant l'affichage d'un
menu principal déroulant (fig. III 1) dont on sélec¬
tionne les options à l'aide des touches et t . L'op¬
tion choisie est exécutée en appuyant sur la touche «J
(RETURN, ou ENTER ou ENTREE).
Si la clef de protection est absente du port
parallèle n" 1, qu'elle est défectueuse ou qu'une
imprimante y est connectée sans être sous tension, un
message le signale en bas d'écran. Sortir d' ACTIF
(option "Fin des traitements"), remédier à l'anomalie
et relancer ACTIF, sinon aucune des données saisies par
le logiciel ne sera sauvegardée .
III. 4
CONFIGURATION DU LOGICIEL ACTIF
Libellé de l'utilisateur â faire figurer sur les sortiesBureau de Recherches Géologiques et Minières
Pays ou organisme utilisateur : FRANCEDivision administrative n"! : Département
n'a : Lieu-ditn'B
Unité(s) utilisèe(s) pour lescoordonnées géographiques
( 1 : kilomètres )1 ( 2 : de
Conmine
degrës.minutes, secondes )
Option retenue pour les sortiessur table traçante (type HP)
Edition de la coupelithologique sur Imprimante : 1 ( 1 : nonEdition imprimante ->11gnes/page: 66 Présent.:Format du numéro de classement
( indice BSS : CCCC-CL-CCCC ) : CCCC-CL-CCCC
1 : connexion RS 232 | 2: HP-IL )3 : fichier dessin temporaire )4 : fichier dessin multi-ouvrages )
2 : oui )1: normal, 2: condenseC : chiffre. L: lettre/-: séparateurs )
Carte graphique utilisée : 1Type d'écran utilisé : 2Format utilise pour les dates : 1Unité utilisée pour les diamètres:lUnité utilisée pour les débits : 1
1 : EGA-VGA | 2 : CGA | 3 : HERCULES )1 : monochrome I 2 : couleur )
il:JJ/nin/aa I 2:nm/jj/aa | 3:aa/inn/Jj)1 : mn 12: pouces )1 : mS/h I 2 1/s ) [ESC] abandon
FIGURE III .2
Grille de saisie des options de configuration
III. 5
2 - CONFIGURATION DU LOGICIEL ACTIF"
Après installation ou mise à jour d'une nouvelle
version d'ACTIF, l'utilisateur doit configurer le
logiciel en fonction des conditions d'exploitation qui
lui sont propres .
L'exécution de cette option du menu principal
permet d'adapter le logiciel ACTIF à certaines des
conditions d'utilisation spécifiques d'un pays (déno¬
mination des divisions administratives, coordonnées
géographiques...), ou d'un site informatique (type de
table traçante utilisée...). Par défaut, la configura¬
tion adoptée est celle qui est valable pour la France
métropolitaine (fig. III. 2).
En se déplaçant de champ à champ à l'aide des
touches 4- , t et ^ , puis de la touche PgDn pour revenir
au menu principal, l'utilisateur peut modifier les
différents paramètres de configuration.
2,1. Libellé de l'utilisateur
Ce libellé sert à personnaliser les documents
élaborés par le logiciel ACTIF. Il est reproduit sur la
"fiche ouvrage" éditée à l'imprimante, et sur les
sorties graphiques sur table traçante.
III. 6
2.2. Fays ou organisme utilisateur
Ce paramètre de configuration est utilisé en
cours d'exécution du logiciel pour remplacer éventuel¬
lement certaines procédures standards par des applica¬
tions spécifiques aux utilisateurs concemés. En France
métropolitaine, frapper "FRANCE".
2.3. Divisions administratives n' 1, 2. 3, 4, 5,
et 6
Ces 6 rubriques permettent de définir les noms
des divisions administratives en usage dans le pays
concerné . La convention hiérarchique suivante doit être
respectée : chaque division administrative de rang i
contient une ou plusieurs divisions administratives de
rang i + 1.
2.4. Unité (s) utilisée (s) pour les coordonnées
géographiques
Les coordonnées géographiques peuvent être
définies en kilomètres (option 1) ou en degrés -minutes -
secondes (option 2).
III. 7
2.5. Option retenue potir les sorties sur table
traçante
Le traceur utilisé doit être de type compatible
HP, c'est-à-dire qu'il doit reconnaître le langage
HP-GL (Hewlett Packard Graphics Language) .
Pour les sorties de tracés, quatre options sont
proposées à l'utilisateur :
a) option 1 - connexion RS 232 : le traceur est
connecté au port de communication série n° 1
(COMÍ) du micro -ordinateur par un câble de
connexion à la norme RS 232 .
b) option 2 - connexion HP-IL : le protocole de
communication entre le traceur et le micro -ordi¬
nateur est de type HP-IL (HP Interface Loop) .
Dans ce cas , le traceur ne comporte pas de
switchs de configuration et le micro -ordinateur
doit être muni de la carte d'interface spécifique
HP (HP 82973 A) à laquelle le traceur est con¬
necté par deux câbles bi- conducteurs sur xm port
spécial HP-IL.
III. 8
c) option 3 - fichier dessin temporaire : avec les
options 1 et 2, le traceur est "en ligne" et les
tracés sont réalisés en "temps réel", sous la
conduite du logiciel ACTIF. Avec l'option 3, le
logiciel ACTIF crée des fichiers dessins qui
contiennent toutes les instructions HP-GL rela¬
tives à ces dessins. Ceux-ci peuvent ensuite être
exécutés en différé en frappant les commandes
DOS :
. TYPE nom fichier dessin > COMÍ, pour la con¬
nexion RS 232
. TYPE nom fichier dessin > HPILPLT, pour la
connexion HP-IL
Les noms des fichiers dessins générés par ACTIF
sont les suivants :
- tracé de coupes technique et
lithologique : COUPES. PLT- tracé de courbes caractéristiques : CARÁCTER. PLT
- tracé de diagrammes SCHOËLLER-BERKALOFF : SCHOEL.PLT
- tracé de diagraphies : DIAGRA.PLT
Ces fichiers dessins sont des fichiers ASCII ;
ils peuvent donc être donc visualisés et modifiés (en
respectant la syntaxe HP-GL) sous éditeur de texte.
III. 9
d) option 4 - fichier dessin multi -ouvrases : cette
option est une variante de l'option 3 pour les
traceurs équipés d'une alimentation feuille à
feuille automatique . Dans ce cas , le fichier
temporaire stocke les instructions de tracé
relatives à plusieurs ouvrages, ce qui permet à
l'utilisateur de lancer une série de tracés en
différé sans que sa présence soit requise pour
changer les feuilles sur le traceur. Cette option
n'est valable qur pour le tracé des coupes
lithologique et technique (fichier COUPES. PLT).
2.6. Edition de la coupe lithologique sur impri¬
mante
Si l'on sélectionne l'option 1, la coupe litho¬
logique n'est reproduite que sur le tracé des coupes
lithologique et technique, alors qu'avec l'option 2,
son descriptif est imprimé en outre sur le compte -rendu
de forage édité à l'imprimante.
III. 10
2.7. Nombre de lignes / page imprimante
Cette valeur correspond au nombre de lignes que
1 ' imprimante édite sur chaque page . Par défaut , elle
est de 65, valeur la plus courante. En cas de mauvaise
pagination, l'utilisateur doit ajuster ce nombre en
conséquence .
2.8. Présentation du compte-rendu sur imprimante
Selon la valeur attribuée à ce code, la pré¬
sentation du compte -rendu édité sur imprimante est
soignée (code - 1 : cadre externe et rubriques bien
individualisées) ou condensée (code - 2 : pas de cadre
externe, mise en page plus dense permettant une écono¬
mie de papier de l'ordre de 30 %) . Ces mêmes valeurs
précédées du signe - permettent d'obtenir une édition
en 78 colonnes au lieu de 79, ce qui peut être rendu
nécessaire par les caractéristiques techniques de
l'imprimante utilisée.
2.9. Format du ntiméro de classement national
Un des principes du logiciel ACTIF est d'at¬
tribuer à chaque ouvrage un numéro de classement
national qui lui soit propre et qui permette de l'iden¬
tifier sans ambiguïté. La composition de ce numéro est
déterminée selon des règles spécifiques à chaque pays .
III. 11
D'une façon générale, ce nvunéro est constitué d'une
série de chiffres, lettres et séparateurs (/ ou -)...
L'utilisateur définit la structure (format) du
numéro de classement, caractère par caractère, en
indiquant la correspondance de chaque position avec une
lettre (L) , vin chiffre (C) ou un séparateur (-ou /) .
La longueur totale du nvunéro de classement ne peut
dépasser 15 caractères, et le nombre total de (lettres
+ chiffres) doit être inférieur ou égal à 10.
exemple
CC-LL-CCC/LL format valide (4 lettres + 5 chiffres < 10)
CCCLLLCCCLLL format invalide (6 lettres + 6 chiffres > 10)
En France métropolitaine , le format du numéro de
classement est celui de la Banque des données du
sous-sol : CCCC-CL-CCCC.
Four mémoriser les données relatives à un
ouvrage, le logiciel ACTIF crée un fichier dont le nom
est constitué par le numéro de classement de cet
ouvrage , sans séparateurs , prolongé de caractères (§
jusqu'à former un nom de 11 caractères. Les 8 premiers
caractères forment la partie gauche du nom de fichier.
III. 12
Les 3 autres caractères constituent l'extension du nom
de fichier.
Exemple Les données de l'ouvrage 12-AB-456/CD sont
mémorisées dans le fichier 12AB456C.D@(3
2 . 10. Carte graphique utilisée
Les cartes graphiques suivantes sont reconnues
par le logiciel ACTIF :
1. EGA ou VGA
2. CGA
3 . Hercules
2.11. Type d'écran utilisé
1. Ecran couleur
2 . Ecran monochrome
2.12. Format utilisé pour les dates
1. jj/mm/aa
2. mm/jj/aa
3. aa/mm/jj
III. 13
2.13. Unité utilisée pour les diamètres
1. mm
2 . pouces
En règle générale, il est recoimnandé
d'exprimer les diamètres en millimètres
pour se conformer aux unités du Système
Intemational .
2.14. Unité utilisée pour les débits
1. m3/h
2. 1/s
III. 14
3 - CONNEXION DES PERIPHERIQUES
3.1. Connexion de 1 ' imprimante
Connecter 1 ' imprimante sur la clef de protection
enfichée dans le port parallèle n* 1 et mettre 1 ' im¬
primante sous tension pour que le micro -ordinateur
puisse reconnaître cette clef.
3.2. Connexion de la table traçante
Pour simplifier au maximum la gestion des
communication entre micro -ordinateur et table tra¬
çante , les différents modules de tracé du logiciel
sont programmés de la façon suivante :
- dans un premier temps , toutes les instructionsde tracé sont stockés dans un fichier tampond'extension .PLT,
- dans un deuxième temps, si l'option "type deconnexion de la table traçante" déclarée lors de
la configuration du logiciel est inférieure à 3 ,ce fichier *.PLT est automatiquement envoyé surla table traçante, ce qui provoque l'exécutionimmédiate du tracé.
Deux cas sont alors à considérer suivant que le
protocole de communication de la table traçante est à
la norme RS-232 ou à la norme HP-IL.
III. 15
3.2.1. Connexion de type RS-232
Dans ce cas , la table traçante comporte un
certain nombre de "switchs" de configuration qui
permettent de modifier les paramètres de communication
avec le micro -ordinateur.
Pour que les tracés se déroulent normalement, il
importe que les configurations de communication de la
table traçante et du micro -ordinateur soient identi¬
ques. Cela signifie que les positions des différents
"switchs" de la table traçante doivent être en con¬
formité avec la commande d'ouverture du port de
communication sur le micro -ordinateur.
En principe, les commandes d'ouverture des ports
de communication du micro -ordinateur sont regroupées
dans le fichier AUTOEXEC.BAT, et la table traçante est
configurée en conséquence (s'en assurer...).
Si c'est le cas, supprimer la commande "OPEN
COMÍ : 9600..." qui se trouve dans les fichiers AC. BAT
et ACTIF.BAT implantée dans les répertoires C:\ et
C:\ACTIF. Le logiciel est alors prêt pour exécuter les
différents modules de tracé.
III. 16
Avant de lancer l'exécution du tracé :
Vérifier la position des switchs de configuration de la table traçante
S2 SI Y US A3 84 B3 B2 81
1
0
parité D MET A4 bauds( 9600 )
Vérifier que la table traçante est bien connectée sur le port ¿êrie XOMl
Mettre en place une feuille de papier A4, rabattre le levier,puis appuyer sur une touche quelconque exécuter le tracé ...
Plumes utilisées : n'I - Tout le tracé , sauf le cartouche
n''2 - Cartouche
[ ESC ] : abandon Tracé : autre touche ...
FIGURE III. 3
Position des switchs de la table traçante HP 7475
III. 17
Si aucune commande "OPEN COMÍ : ..." ne se
trouve dans le fichier AUTOEXEC.BAT, deux solutions
s'offrent à l'utilisateur :
ou bien conserver tels quels les différentsfichiers AC. BAT et ACTIF. BAT. Ceux-ci con¬
tiennent la commande
OPEN COMÍ : 9600, E, 8, 1, P.
En conséquence, la table traçante doit être
connectée sur le port série n" 1 et les "
switchs" de configuration doivent être posi¬tionnés de façon à ce que les paramètres decommunication soient les suivants :
vitesse de transmission : 9600 bauds,
parité paire,
8 bits de données ,1 bit d'arrêt
carte de transmission asynchrone utiliséecomme interface d'imprimante série.
Consulter la notice -constructeur de la table
traçante pour connaître la position à attribuerà chacun des "switchs".
A titre indicatif, les positions des "switchs"requises pour la table traçante HP 7475 A sontdécrites en figure III. 3.
ou bien modifier la commande OPEN COMÍ : 9600,
E, 8, 1, P des différents fichiers AC. BAT et
ACTIF. BAT pour la mettre en conformité avec la
configuration de la table traçante.Consulter la notice -constructeur de la table
traçante et la commande "MODE COM" du DOS.
III. 18
3.2.2. Connexion de type HP-IL
Dans ce cas, la table traçante n'est pas con¬
figurable, et le port de communication HPIL.PLT doit
être ouvert par une procédure particulière à la carte
d'interface HP 82973 A.
Si cette carte est correctement installée dans
le micro -ordinateur, celui-ci affiche, à sa mise sous
tension, le message suivant :
HP-IL Rev, 6.4 85/11/04 (c)COPYRIGHT Hewlett-Packard Co,
1985 Adress 1700
où 1700 est l'adresse hexadécimale de la carte d'in¬
terface .
Pour permettre au micro -ordinateur de "piloter"
la table traçante, il faut que les deux conditions
suivantes soient réalisées :
- le fichier CONFIG.SYS doit contenir les com¬
mandes :
DEVICE - ANSI.SYS
DEVICE + HPIL PRN.SYS
III. 19
- le fichier HPIL_PRN.SYS joint sur la disquetteaccompagnant la carte d'interface HP 82973 Adoit être copié dans le répertoire C:\.
Le port de communication HP-IL est considéré par
le micro -ordinateur comme étant le port série COM2 :
toute instruction DOS d'ouverture de ce port (OPEN
COM2...) doit donc être enlevée du fichier AUTOEXEC.
BAT.
Lorsque toutes ces conditions sont réunies , les
fichiers de tracé *.PLT constitués par le logiciel
sont transmis normalement à la table traçante et les
tracés s'exécutent immédiatement.
IV. 3
En exécutant cette option du menu principal ,
l'utilisateur définit le répertoire dans lequel il
souhaite stocker les fichiers ouvrages générés par
ACTIF. Par défaut, ce répertoire est C:\ACTIF, mais
plusieurs possibilités sont offertes :
- sous -répertoire d'ACTIF, du typeC:\ACTIF\PROJET,
- répertoire ou sous -répertoire quelconque dudisque C: : C:\REPERT ou C:\REPERT1\REPERT2
- stockage sur disquette : dans la racine A:\,dans un répertoire A:\REPERT, dans un sous -ré¬pertoireA:\I
Avant de retourner au menu principal, le logi¬
ciel affiche la liste des fichiers ACTIF mémorisés
dans le répertoire choisi par l'utilisateur. Ces
fichiers sont classés en colonnes , par numéros de
classement national croissants , éventuellement sur
plusieurs pages que l'on peut visualiser successive¬
ment grâce avix touches PgDn et PgUp.
IV. 4
jRemaroues
a) ATTENTION ! ACTIF ne crée pas de répertoire. Le
répertoire proposé doit auparavant avoir été
créé par l'utilisateur en utilisant la commande
DOS : MD nom répertoire.
Exemple : pour créer un sous -répertoire d'ACTIF
nommé REPERT, se placer dans le répertoire ACTIF
et frapper MD REPERT.
b) Pour faciliter la gestion des fichiers, il est
conseillé de stocker les fichiers ouvrages
générés par ACTIF (reconnaissables à leur nom se
terminant par le caractère @) , dans des sous-
répertoires du type "Unité disque: \ACTIF\
REPERT", l'unité disque pouvant être un disque
dur (C ou D) ou un lecteur de disquette (A ou
B) . En règle générale, on stockera dans des
répertoires différents des fichiers ouvrages
ayant trait à des lievix ou marchés différents .
v.3
1 - PRINCIPES GENERAUX
L'utilisation du logiciel ACTIF pour traiter les
données d'un ouvrage, comporte devtx étapes :
- La première étape a pour objet la saisie desdonnées de forage, leur modification si besoinest, puis leur stockage en mémoire informati¬que ; cette phase demande la pleine partici¬pation de l'opérateur pour entrer les dizaines,voire les centaines de données permettant de
rendre totalement compte de la réalisation d'un
ouvrage .
- La deuxième étape correspond à l'exploitationdes données par le logiciel pour l'élaborationdes comptes rendus de forages ; ici, l'utilisa¬teur n'intervient que pour indiquer le numéro declassement du forage à traiter, sélectionner lessorties désirées, préciser les échelles desgraphiques à produire , et alimenter le traceuren feuilles vierges de format A4 (21 x 29,7).
Chaque ouvrage est identifié par son classement
national (§ 2.7, chapitre III).
1.1. Pages de saisie
Le logiciel ACTIF comporte treize pages de
saisie, identifiées par les lettres A à M :
A identification de l'ouvrageB localisation de l'ouvrageC description du trou nu
D description des tubages
V.4
E description des annulaires
F contexte hydrogéologiqueG description des venues d'eau
H coupe lithologiqueI développement de l'ouvrageJ pompages d'essai
K paramètres physico-chimiquesL paramètres géophysiques et/ou diagraphiesM observations complémentaires
Dans chacune de ces pages, les données à saisir
sont regroupées, par tableavix ou par cadres corres¬
pondant à des données de même nature. Chaque donnée à
saisir est associée à un "champ" . zone de l'écran
destinée à visualiser les caractères frappés au cla¬
vier. Au fur et à mesure de la saisie, le curseur se
déplace d'un champ à l'autre, en suivant généralement
un sens balayage gauche -droite et haut -bas.
Le passage d'une page à l'autre est automatique
après la saisie du demier champ de la page affichée à
1' écran.
1.2. Déplacement du curseur
Dans chaque page , les déplacements du curseur
sont régis par les touches suivantes :
V.5
ANNUL,DEL
ou SUPPR
INS
4, OU J
END, FINOU /"
HOME OU \
PgDn OU f
PgUp OU t
ESC
OU ECHAP
1 ' intérieur
d'un champ
déplacement vers la droite
déplacement vers la gauche
effacement du caractère
situé à l'emplacementdu curseur
Insertion d'un blanc à
l'emplacement du curseur
et décalage des caractèressitués à droite de celui-ci.
passage au champ suivantretour au champ précédent
saut au groupe de champs suivant (généra¬lement matérialisé par un cadre) ou"descente" d'une ligne à l'intérieur d'untableau (en restant dans la même colonne)
retour au groupe de champs précédent, ou"remontée" d'une ligne à l'intérieur d'untableau
Passage à la page suivante
Retour à la page précédente
Retour au menu principal
Les touches HOME et END sont particulièrement
utiles pour se déplacer rapidement dans les tableaux
lors des modifications de données .
A tout moment, il est possible de positionner le
curseur sur n'importe lequel des champs d'une page de
saisie, et ce dans n'importe laquelle des pages.
V.6
1.3, Codage des réponses et lexiques corres¬
pondants
Pour accélérer la saisie des données, limiter
les fautes de frappe, et faciliter les traitements
statistiques ultérieurs , un certain nombre de réponses
sont codées . Les lexiques correspondants sont affichés
au fur et à mesure dans un cadre réservé à cet effet,
en partie droite des pages de saisie. Chaque lexique
contient les réponses les plus fréquentes avix ques¬
tions posées .
Toutefois, si la réponse à fournir ne figure pas
dans le lexique proposé, le fait de frapper 99, si la
réponse attendue est à 2 chiffres, ou 9 si elle n'est
qu'à 1 chiffre, transfère le curseur au bas du lexi¬
que : il ne reste alors plus qu'à indiquer en toutes
lettres la réponse souhaitée.
Il faut cependant souligner que cette procédure
n'est qu'une procédure de dépannage utilisée pour
résoudre le problème posé par un ouvrage particulier :
elle ne met pas à jour les lexiques, tâche réservée au
responsable de la maintenance du logiciel. Du reste,
cette procédure présente des limites, à savoir qu'une
seule définition du code 99 est acceptée pour chaque
lexique, et que les réponses correspondantes ne
peuvent donner lieu ultérieurement à des traitements
V.7
statistiques, le code 99 attribué à un lexique pouvant
différer d'un ouvrage à l'autre.
1.4. Messages d'erreur
En cours de saisie ou de modification des
données , ACTIF effectue de nombreux contrôles pour
s'assurer de la cohérence des données. Lorsqu' vme
erreur est détectée, un message le signale en bas de
l'écran, selon l'une des devix procédures suivantes :
en noir sur fond rouge lorsque l'erreur détectéeest Inacceptable (exemple : date de fin deforation antérieure à la date de début de
foration) ; dans ce cas, l'utilisateur ne peutquitter la page de saisie affichée à l'écranqu'après correction de l'erreur signalée ;
en noir sva fond bleu clair lorsque l'anomalie
détectée est jugée acceptable ou lorsque les
données mises en jeu concernent plusieurs pagesde saisie (exemple : profondeur de tube supé¬rieure à la profondeur du trou nu) . Dans ce cas ,l'utilisateur peut quitter la page affichée àl'écran pour aller modifier les données mises en
cause dans une autre page.
1.5. Tableaux des pages de saisie C, D, £. G,
et H
Dans les tableavix, les données doivent, en
principe, être entrées par profondeurs croissantes, du
haut vers le bas de l'ouvrage. Si ce n'est pas le cas.
V.8
un message d'erreur signale l'incohérence détectée. Au
moment de quitter la page, un reclassement est auto¬
matiquement effectué si nécessaire, et les données
reclassées restent à l'affichage pour vérification,
jusqu'à ce que le changement de page soit à nouveau
notifié (touche PgDn ou PgUp).
Pour supprimer une ligne , il suffit de mettre un
0 (zéro) à la profondeur correspondante (profondeur
inférieure pour les tubages).
L'insertion d'vme nouvelle ligne ne peut se
faire , du fait du contrôle effectué entre deux lignes
consécutives, qu'après une ligne vierge (ou une ligne
où la profondeur vaut 0) . Pour insérer une ligne dans
un tableau, il faut donc placer le curseur deux lignes
vierges au-dessous de la dernière ligne saisie, puis
entrer la ligne souhaitée. Au moment de quitter la
page , il y a alors reclassement des données et réaf¬
fichage des données reclassées : la nouvelle ligne s'y
trouve insérée .
V.IO
Version 3.4
BRGM
09/1989
SAISIE des données relatives à un nouvel ouvrageCORRECTION ou AJOUT de données pour un ouvrage dëjâ mémoriséEDITION d'une fiche ouvrageTRACE de - coupe géologique et technique
- courbe caractéristique- diagramne SCHOËLLER-BERKALOFF- de diagraphies
EXPORTATION de données d'ouvrages sous forme de fichier ASCIICONFIGURATION du logiciel ACTIFREPERTOIRE de travail et LISTE des ouvrages mémorisésFonctions UTILITAIRES diverses
FIN des traitenents
Numéro de classement national d'un ouvrage dont lescaractéristiques générales sont voisines : 1099-9X-0099
(Abandon)( ESC )
Fl Sélection des pages de saisie F2 Sélection d'un ouvrage mémorise
FIGURE V.l
Menu affiché pour l'option "SAISIE"
V.ll
2 - OPTION "SAISIE DES DONNEES RELATIVE A UN NOUVEL
OUVRAGE"
Lorsque cette option du menu principal est
sélectionnée, le message suivant s'affiche au bas de
l'écran : "Numéro de classement d'vm ouvrage dont les
caractéristiques générales sont voisines" (fig. V.l).
Deux cas peuvent alors se présenter :
* 1er cas : l'ouvrage à saisir est similaire à unouvrage type dont les données ont déjà étéentrées dans ACTIF.
Dans ce cas, il est possible d'accélérer la
saisie de ce nouvel ouvrage en bénéficiant des données
déjà saisies pour 1 ' ouvrage - type . Il suffit pour cela
d'indiquer le numéro de classement national de l'ou¬
vrage-type, soit directement, soit par l'intermédiaire
de la touche F2 .
En appuyant sur la touche F2, l'utilisateur a la
possibilité d'afficher la liste des fichiers ouvrages
mémorisés dans le répertoire de travail, puis de
sélectionner le fichier désiré à l'aide des touches de
déplacement : i , t , -*, et de la touche ^J .
V.12
SELECTION des PAGES de SAISIE
Liste des pages â saisir : ABCDEFGHIJKLM
A - identification
B - localisation
C - description du trou nuD - tubagesE - annulaires
F - contexte hydrogéologiqueG - venues d'eau
H - coupe géologiqueI - développementJ - pompages d'essaiK - paramètres physico-chimiquesL - gëophysique/diagraphiesM - observations conplëmentaires
[ESC] retour au menu général
Par défaut , les 13 pages de saisie défi¬lent successivement , de A â M .
Cependant . il est possible de supprimerune ou plusieurs pages de saisie , et/oude modifier l'ordre de défilement (seulesles pages A , B et C sont imposées) .
Il faut pour cela préciser ci -dessus laliste des pages â saisir , dans l'ordreoù l'on souhaite les voir défiler .
( ex : ABCFDH provoque l'affichagesuccessif des pages A,B,C.F,D,H ) .
FIGURE V.2
Sélection des pages de saisie
V.13
A partir du numéro de classement fourni , le
logiciel recherche le fichier de données de l'ouvrage-
type, le lit et pré -affiche sur les différentes pages
de saisie du nouvel ouvrage les données qui sont
susceptibles d'être communes. Il ne reste plus alors à
l'utilisateur qu'à compléter ou modifier les données
affichées .
* 2ème cas : L'ouvrage à saisir ne ressemble àaucun des ouvrages déjà saisis avec ACTIF.
Effacer alors le numéro de classement national
pré -affiché à l'aide de la touche ANNUL (ou DEL ou
SUPPR) : la première page de saisie s'affiche alors
automatiquement à l'écran, avec des champs vides.
Par défaut, les 13 pages de saisie sont appelées
successivement par ordre alphabétique ; mais l'utili¬
sateur peut changer l'ordre de défilement et sauter
certaines pages grâce à la procédure accessible en
appuyant sur la touche Fl. Dans ce cas, le logiciel
affiche la liste des pages de saisie identifiées par
les lettres A à M (fig. V2) , et préaffiche la chaîne
de caractères ABCDEFGHIJKLM, qui signifie que, sauf
indication contraire de l'utilisateur, toutes ces
pages seront affichées successivement dans cet ordre.
V.14
Seules les trois premières pages (identifica¬
tion, localisation, description du trou nu) sont
imposées, dans cet ordre. Toutes les autres pages
peuvent être supprimées , décalées , interverties ou
répétées. Pour ce faire, utiliser les touches ANNUL
(DEL ou SUPPR) et INS pour effacer ou ajouter des
pages de saisie.
Dans le cas de la référence à un ouvrage - type ,
l'ordre et la liste des pages de saisie sont ceux qui
ont été choisis pour cet ouvrage.
V.16
CHOIX des PAGES â MODIFIER
Liste des pages â modifier :
V A - Identification
V B - localisation
V C - description du trou nuD - tubagesE - annulaires
F - contexte hydrogéoiogiqueG - venues d'eau
V H - coupe géologiqueI - développementJ - pompages d'essaiK - paramètres physico-chimiquesL - géophysique/dlagraphiesM - observations complémentaires
[ESC] retour au menu général
V : Pages dont les donnéesont été saisies .
( ex : ABCFDH provoque l'affichagesuccessif des pages A,B,C,F,D,H )
F3 : toutes pages (ABCDEFGHIJKLM)
FIGURE V.3
Sélection des pages à modifier
v.17
3 - OPTION "CORRECTION OU AJOUT DE DONNEES POUR UN
OUVRAGE DEJA MEMORISE"
Indiquer le numéro de classement national
de l'ouvrage concerné, soit directement, soit par
1 ' intermédiaire de la touche F2 . A partir du numéro de
classement foumi, le logiciel recherche le fichier de
données correspondant, le lit et affiche la liste des
pages de saisie. Le symbole ^ précède chacune des
pages dans lesquelles des données ont effectivement
été enregistrées (fig. V.3). Indépendamment de cette
information, les 13 pages de saisie peuvent être
complétées ou modifiées : indiquer la liste des pages
à traiter, dans l'ordre désiré, en constituant une
chaîne alphabétique avec leurs lettres d'identifica¬
tion, puis appuyer sur la touche^ . Si l'on souhaite
contrôler ou modifier toutes les pages , il est plus
rapide d'appuyer sur la touche F3, ce qui équivaut à
frapper la séquence ABCDEFGHIJKLM
v.19
4 - REMARQUES SUR LES PAGES -ECRAN DE SAISIE
Le logiciel ACTIF a été conçu pour offrir vm
maximum de convivialité et les pages -écran ne néces¬
sitent que peu de commentaires spécifiques.
Chacvme des 13 pages de saisie est néanmoins
présentée ci-après, accompagnée des précisions néces¬
saires sur le contenu des champs qui peuvent poser
problème.
Pour chaque page -écran, sont présentées deux
illustrations :
- l'une montre la grille de saisie correspondante,avec le dimensionnement des différents champs,
- l'autre présente un exemple de saisie de don¬nées .
PAGE A
V.20
IDENTIFICATION
I ProjetMarché
Financement
Maître d'ouvrageMaître d'oeuvre
Ingénieur conseilEntrepreneur
PAGE A IDENTIFICATION
Numéro B.S.S.
Désignation0099-9X-0099
PZ IBTypeObjetUsageEtat
Date réalisation : du 20/02/87 au 18/03/87Date de réception: 23/03/87Numéro du P.V. :
ProjetMarché
Financement
Maître d'ouvrage ;Maître d'oeuvre :
Ingénieur conseil:Entrepreneur :
CONTROLE DEPOT AZF
CDF-AZF
CDF-A2FB.R.G.M.
B.R.G.H.SOFREH
Numéro B.S.S. :
Désignation :Type :Objet :Usage :Etat :
Date réalisation : duDate de réception:
au
LEXIQUE
LEXIQUE
USAGE de 1 'OUVRAGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A.E.P.
Piézométrie
IrrigationIndustrie
Qualité eauxDêpol lutionGéotechnîquePétrolier
Minier
Recharge art.P.A.C.
99
[ESC]-retour au MENU [PgUp]-page précédente [PgDn]-page suivante
FIGURE V,4
Page de saisie A - Identification de l'ouvrage
v.21
4.1. Pages de saisie A - Identification de
l'ouvrage (fig. V.4)
Désignation : cette information correspond à
l'indicatif le plus utilisé pour désigner l'ou¬
vrage concerné : par exemple : F12 , PZ15 .
Nvunéro du P.V. : numéro du procès -verbal de
réception.
V.22
PAGE B ] C LOCALISATION
Département
Conmune
Lieu-dit
N" dept :
N" cne :
Code aquif.:Code B.V. :
Coordonnées Zone Lambert-aLambert X - km Y -
Z m *!km
m
Carte topographique : nomnuméro
échelle l/i
L
Mission photo :
Mission satellite:
numero:
numéro:
numéro:
t P^g^ B 1 [ LOCALISATION
Département SEINE-MARITIME
Conmune ST-FRANCOIS DU ROUVRAY
Lieu-dit Fontaine aux Ducs
N" Dept : 98
N' Cne : 765
Code aquif.:Code B.V. :
Coordonnées Zone Lambert-1Lambert X - 508.370 km
Z - 50.00 mY - 1187.270 km
+/- 2.50 m
Carte topographique : nom : ROUENnuméro : 99
échelle : 1/ 25000
Mission photo : 127-5X-045
Mission satellite:
numéro: 1287A
numéro: 1287B
numéro:
[ESC]-retour au MENU [PgUp]-page précédente [PgDn]-page suivante
FIGURE V.5
Page de saisie B - Localisation de l'ouvrage
v.23
4.2. Page de saisie B - localisation de l'ou¬
vrage (fig. V.5)
Les intitulés des décisions administratives
affichées sur cette page -écran sont ceux qui ont été
saisis lors de la configuration du logiciel. Leur
nombre peut varier de 1 à 4.
- N° dept : code administratif du département,
- N" Cne : code administratif de la commvme.
ACTIF ne dispose pas de lexique administratif
des numéros de département, ni de commune.
" Xi Xi suivant le système d'unités retenu lorsde la configuration du logiciel, les coordonnéesgéographiques de l'ouvrage sont exprimées enkilomètres ou en degrés , minutes , secondes .
- Code Aouif. : code d'identification du systèmeaquifère où est implanté l'ouvrage. En France,il est recoEomandé d'adopter la classification
proposée par J. MARGAT (1)
[1) M.J. LIENHARDT et J. MARGAT .- Domaines hydrogéologiques de
référence du Territoire Français. Carte et catalogue, 1979,
37 p., 1 carte .- Rapport BRGM n* 79 SGN 342 HYD (document
pub1 ic)
V.24
Code B.V. code d'identification du bassin
versant où est implanté l'ouvrage. En France, ilest recommandé d'adopter la classificationutilisée par les Agences Financières de Bassin.
Z : l'altitude correspond à l'altitude du sol,rapportée au système de nivellement en vigueur .Elle est accompagnée d'une estimation de laprécision de cette valeur. Cette demière peut
varier grandement suivant que l'altitude du sola été nivelée à l'emplacement de l'ouvrage ouqu'elle est déduite d'une lecture de carte à1/250 000, 1/100 000, 1/50 000, 1/25 000, ...
V.26
PAGE C DESCRIPTION DU TROU NU LEXIQUE
:::!::::::»:::::t::::
!:::!:::::::::::
liiiimilSi::!
Indiquer en partant du haut du forage lesparamètres suivants pour chaque diamètre:- profondeur inférieure- mode principal de foration- fluide utilisé lors de la foration
::::::;!
;::::::l
r DIAM PROF. MODE FLUIDE
(code)(m) (code)
1 aa aa
nn.n
3
4
5
6
PAGE C ][ DESCRIPTION DU TROU NU
Indiquer en partant du haut du forage lesparamètres suivants pour chaque diamètre:- profondeur inférieure- mode principal de foration- fluide utilisé lors de la foration
N" DIAM PROF,
(im) (m)MODE
(code)FLUIDE
(code)
i5
6
600 4.00
400 12.00
252 73.00
4
2
1
6
4
LEXIQUE
MODE de FORATION
1 I M.F.T.
2 I Rotary3 I Rotary inverse4 I Battage5 I Fonçage6 I Havage7 I Tarière8 I Roto-percussion9 I Manuelle
10 I Turbo-forage11 I Carottage
99
[ESC]-retour au MENU [PgUp]-page précédente [PgDnJ'page suivante
FIGURE V.6
Page de saisie C - Description du trou nu
v.27
4.3. Page de saisie C - Description du trou nu
(fig. V.6)
Les diamètres de foration sont à saisir en
millimètres ou en pouces suivant l'unité choisie lors
de la configuration du logiciel.
La description du trou nu s'effectue en principe
par profondeurs croissantes. Si ce n'est pas le cas,
le logiciel effectue un reclassement des données au
moment de quitter la page et réaffiche le tableau de
données reclassé. Frapper à nouveau l'une des touches
PgDn ou PgUp pour quitter la page.
ACTIF accepte des phases de foration ayant le
même diamètre de foration et des modes ou fluides de
forage différents .
La description du trou ne concerne que l'état
final de l'ouvrage, une fois toutes les opérations de
foration terminées. Les phases de foration intermé¬
diaires (avant réalésage par exemple) ne sont donc pas
à prendre en compte.
PAGE D
V.28
TUBAGES
TYPE
codeDIAM
int.PROFONDEURS (m)sup. 1 inf.
NAT.
code
EPAIS,
(irni)
1 1^
3
4
5
6
7
8 mmmm.mm
9 nn.M
10
TYPE (code)SLOT (mn)OUVERTURE (%)CENTREURS
TUBAGES
N" TYPE DIAM PROFONDEURS (m) NAT. EPAIS.code int. sup. inf. code (nm)
1 1 500 4.00 3 4
2 1 350,
11.00 3 3
3 3 180 11.00 12.00 3 3
4 1 180 12.00 50.00 3 35 2 180 50.00 63.00 3 36 1 180 63.00 71.00 3 37 4 180 71.00 73.00 38 8 180 73.00 73.10 3 3
Définition des
tubages en 15rubriques au maximum
TYPE (code)SLOT (nm)OUVERTURE (%)CENTREURS
LEXIQUE
LEXIQUE
TYPE de TUBE
1 I Tube plein2 I Crépine3 I COne réducteur4 I Tube décanteur
5 I Sabot laveur6 I Bouchon de pied7 I Fond conique8 D Fond plat9 I Pointes filtr.
10 I Buses11 n Cuvelage12 I Trousse coup.13 I Raccord diëlec
99
[ESC]-retour au MENU [PgUp]-page précédente [PgDn]-page suivante
FIGURE V.7
Page de saisie D - Description des tubages
v.29
4.4. Page de saisie D - Description des tubages
(fig. V.7)
Comme pour la page de saisie C, les diamètres de
tubages sont à entrer en millimètres ou en pouces ,
suivant l'unité choisie lors de la configuration du
logiciel.
Bien que seuls dix tubages puissent être pré¬
sents simultanément à l'écran, le tableau de saisie
est dimensionné pour 15 tubages, le défilement des
lignes vers le haut ou vers le bas étant assuré par le
logiciel.
Lors de la saisie, le logiciel propose comme
diamètre le diamètre du tubage précédent, et comme
profondeur supérieure la base du tubage précédent ;
ces valeurs peuvent bien sûr être modifiées, si besoin
est.
Chaque tubage est décrit par l'intermédiaire de
6 variables. Quatre variables supplémentaires per¬
mettent en outre de préciser les caractéristiques des
crépines. Les champs correspondants, situés dans un
cadre particulier au bas et au milieu de l'écran, ne
sont balayés que lorsque le tubage en cours de saisie
est vme crépine (type de tube = 2) .
V.30
Les profondeurs de tube sont exprimées en mètres
par rapport au sol. Lorsque la tête d'un tube dépasse
au-dessus du sol, la profondeur correspondante doit
être affectée du signe - .
exemple : Si la tête dépasse de 35 cm au dessus du
sol, la profondeur correspondante sera entrée
avec une valeur égale à -0.35.
Dans le cas d'un réducteur, entrer pour diamètre
le diamètre du tube situé immédiatement au-dessus (sa
valeur est pré-affichée par le logiciel).
Tous les tubages doivent avoir une hauteur, quel
que soit leur type (profondeur inférieur > profondeur
supérieure), y compris les "fonds coniques", "trousses
coupantes" , . . .
Au moment de quitter la page, le logiciel classe
les tubages par diamètres décroissants , et pour chaque
diamètre par profondeurs croissantes. Si l'ordre des
tubages entrés par l'utilisateur a été modifié, le
nouveau classement reste affiché jusqu'à ce que
l'utilisateur frappe l'une des touche PgDn ou PgUp.
En cours de saisie, une aide à l'utilisateur est
assurée par l'intermédiaire des messages qui s'affiche
dans le petit cadre situé en bas et gauche de l'écran.
PAGE E
V.32
ANNULAIRES
ESPACE ANNULAIRE EXTERNE (entre trou nu et tubage ext.)
r PROFONDEUR j TYPE et GRANULOMETRIEsonnet base NATURE (millimètres)
1 0.00 BBBB.BI BB.B - BB.B
2 BBBB BB.B - BB
i BBBB BB.B - BB
4 BBBB BB.B - BB
b BBBB BB.B - BB
b BBBB BB.B - BB
/ BBBB BB.B - BB
8 BB.B - BB
9 BBBB BB.B - BB
10 BBBB BB BB.B - BB
ESPACE ANNULAIRE INTERNE (intrados du tubage externe)
1 1 BHB.n BB.B - BB.B
2 1 BBBB.Ba B B B BB.B - BB.B
PAGE E ANNULAIRES
ESPACE ANNULAIRE EXTERNE (entre trou nu et tubage ext.)
N" PROFONDEUR TYPE etNATURE
GRANULOMETRIE
sonnet base (millimètres)
1 0.00 4.00 3 . - . 12 4.00 20.00 1 -
3 20.00 22.00 4 .
4 22.00 71.00 2 1 1 2 0 - 5 0
5 71.00 73.00 3 -
6 73.00 -
7,
-
8,
-
9
10
LEXIQUE
NATURE de REMBLAI
1 I Tout-venantGravier
ESPACE ANNULAIRE INTERNE (intrados du tubage externe)
\ 1 1.00 4.00 1 1 ^
! ^ . -
Sable
ArgileEboulement
Décantation
[ESC]-retour au HENU [PgUp]-page précédente [PgDn]-page suivante
FIGURE V.8
Page de saisie E - Description des annulaires
V.33
4.5. Page de saisie E - Description des annu¬
laires (fig. V.8)
ACTIF ne reconnaît que deux formes d'annu¬
laires :
- les annulaires dits "externes" qui corres¬pondent, pour une profondeur donnée, au volumecompris entre la paroi du trou nu et le premiertube rencontré ;
- les annulaires dits "intemes", qui corres¬pondent, pour une profondeur donnée, au volumecompris entre les deux tubes les plus externes .
Pour chaque ouvrage, il est possible de décrire
10 annulaires "extemes" et 2 annulaires "internes".
Les annulaires "extemes" sont décrits successivement
du haut en bas de l'ouvrage, la base de l'annulaire n
correspondant au sommet de l'annulaire n + 1. Pour les
annulaires "internes", il faut donner la profondeur
supérieure et la profondeur inférieure de l'annulaire.
Les champs relatifs à la granulométrie ne sont
balayés que lorsque l'annulaire en cours de saisie est
un massif filtrant (type d'annulaire -= 2).
Un annulaire, de quelque forme. ou type qu'il
soit, peut comporter plusieurs changements de diamè¬
tres.
V.34
PAGE F CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
CLASSER les AQUIFERES CAPTES par ORDRE d' IMPORTANCE
N* NOM AQUIFERE [ FACIES | PROFONDEUR(ou nappe) et TYPE | toit 1 mur
B B
B
B
BBBB.BB g BBBB.BBBBBB.BB I BBBB.BBBBBB.BB I BBBB.BB
Base recouvrement: bbbb.bb m
Base altération : bbbb.bb mGéomorphologie: bb |
LINEAMENTS Direction Longueur Dist. /ouvrage
1
2
3
N BBB ° BBBBBB m
N BBB " BBBBBB m
N BBB ' BBBBBB m
BBBB.B m
BBBB.B m
BBBB.B m
N» NOM AQUIFERE(ou nappe)
FACIES
et TYPE
PROFONDEUR
toit mur
1
2
3
SENONIEN 3 5 7 1 23.50 67.60
LEXIQUE 1
<
I PAGE F I I CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE |
CLASSER les AQUIFERES CAPTES par ORDRE d' IMPORTANCE
Base recouvrement:
Base altération :Géomorphologie: 7
LINEAMENTS Direction Longueur Dist. /ouvrage
1
2
3
N 30N
N
m
m
m
. m
. m
. m
LEXIQUE
CONTEXTE GEOMORPHO
1 Plaine2 Plaine alluv.3 Vallée alluv.4 Vallée glac.5 Thalweg6 Dépression7 Plateau8 Zone tabulaire
9 Colline
10 Interfluve
11 Versant
12 Oued
13
99
Marigot
[ESC]-retour au MENU [PgUp]-page précédente [PgDn]-page suivante
FIGURE V.9
Page de saisie F - Contexte hydrogéologique
v.35
4.6. Page de saisie F - Contexte hydrogéolo¬
gique (fig. V.9)
Décrire les différents aquifères captés en les
classant par productivités décroissantes pour l'ou¬
vrage concerné . Chaque aquifère est identifié par son
nom ou par le nom de la nappe qui y siège. Son faciès
lithologique dominant est décrit par un code à deux
chiffres : le premier caractérise la famille litholo¬
gique, le second précise le faciès. Deux codes sup¬
plémentaires permettent de caractériser la nature de
la perméabilité de l'aquifère et le contexte hydro-
d3mamique de la nappe.
Recouvrement et altération : ces rubriques sont
à employer essentiellement en zone de socle . Le
recouvrement représente les terrains "allochtones" :
remblai, sable dunaire, éboulis, alluvions. L'altéra¬
tion concerne les formations "autochtones" : arène,
cuirasse latéritique , etc . . Les données à fournir
correspondent à la profondeur / sol de la base du
recouvrement, et la profondeur /sol de la base de
l'altération (- profondeur / sol du socle sain).
V.36
Critère important pour les venues d'eau, notam¬
ment en zone de socle , la fracturation est prise en
compte par l'intermédiaire de 3 paramètres carac¬
térisant les 3 plus importants linéaments situés à
proximité de l'ouvrage : direction, longueur et dis¬
tance à l'ouvrage.
Orientation de linéaments : pour la direction
Nord- Sud, entrer la valeur 180° ; la valeur 0* est
prise pour une absence de donnée et n'apparaît pas à
l'édition.
La plupart des variables entrées dans cette page
de saisie sont destinées à des traitements statisti¬
ques ultérieurs , une fois constituée une base de
données "points d'eau" à l'aval d'ACTIF.
V.38
PAGE G DESCRIPTION DES VENUES D'EAU
PAGE G
Ces données ne concernent que les ouvragesexécutés dans des milieux où les venuesd'eau sont nettement individualisées .
PROFONDEUR PAR DEBITSN" RAPPORT AU SOL CUMULES
(mètres)
1 BBB.BB BBB.B
2 BBB.BB BBB
3 BBB.BB BBB
4 BBB.BB BBB
5 BBB.BB BBB
6 BBB.BB BBB
7 BBB.BB BBB
8 BBB.BB BBB
9 BBB.BB BBB
10 BBB.BB BBB
DESCRIPTION DES VENUES D'EAU
Ces données ne concernent que les ouvragesexécutés dans des milieux où les venuesd'eau sont nettement individualisées .
PROFONDEUR PAR
RAPPORT AU SOL
(mètres)
1
23
4
5
67
8g
10
52.0058.0065.00
DEBITS
CUMULES
(m3/h)
.3
.91.3
[ESC]-retour au MENU [PgUp]-page précédente [PgDnj-page suivante
FIGURE V.IO
Page de saisie G - Description des venues d'eau
v.39
4.7. Page de saisie G - Description des venues
d'eau (fig. V.IO)
Ces données ne concernent que les ouvrages
exécutés dans les milieux où les venues d'eau sont
nettement individualisées. Pour chaque venue d'eau
importante, entrer la profondeur par rapport au sol et
le débit d'exhaure mesuré. Ce débit correspond en
principe au cumul de toutes les venues d'eau rencon¬
trées jusqu'à cette profondeur.
Exprimer les débits dans l'vmité choisie lors de
la configuration du logiciel .
Pour les traces d'humidité ou les suintements à
débit non mesurable, entrer une valeur fictive de
débit égale à -0.1. Cette valeur sera remplacée par la
mention "humidité" sur le compte -rendu de forage édité
sur imprimante .
Les données sont reclassées par profondeurs
croissantes au moment de quitter la page. Si leur
ordre a été modifié, elles restent à l'affichage
jusqu'à ce que l'utilisateur presse sur l'une des
touches PgDn ou PgUp.
V.40
PAGE H ][
PAGE H
1 r
No
COUPE GEOLOGIQUE DETAILLEE
BASE
2.00
4.00
63.00
73.00
DESCRIPTION
LIMONS
BANCS DE SILEX
CRAIE A SILEXTRES FISSUREE
CRAIE MARNEUSE
r COUPE GEOLOGIQUE DETAILLEE {
No BASE DESCRIPTION FIG.
1
2
BBB.BB
BBB.BB
BB
BB
3
4
BBB.BB
BBB.BB
BB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5 BBB.BB BB
6 BB
30
AU
NIVEAUX
MAXIMUM
BASE:niveau inférieur
de l'horizon parrapport au sol(en mètres)
DESCRIPTION:
lithologie etstratigraphiesur 2 lignesde texte libre
FIG.: code du
figuré pour larestitution
graphique dela coupe géo¬logique
FIG,
17
27
40
43
30
AU
NIVEAUX
MAXIMUM
BASE:
niveau Inférieur
de l'horizon parrapport au sol(en mètres)
DESCRIPTION:
lithologie etstratigraphiesur 2 lignesde texte libre
FIG.: code du
figuré pour larestitution
graphique dela coupe géo¬logique
[ESC]-retour au MENU [PgUp]-page précédente [PgDn]-page suivante
FIGURE V.ll
Page de saisie H - Coupe lithologique
v.41
4.8. Page de saisie H - coupe lithologique
(fig. V.ll)
La coupe lithologique peut comporter jusqu'à 30
niveaux différents, dont seulement 6 sont simulta¬
nément affichés. Le logiciel gère le défilement à
1 ' écran de 1 ' ensemble des 30 niveaux .
Chacun des niveaux est défini par 3 paramètres :
- la profondeur de sa base par rapport au sol,
exprimée en mètres ,
- deux lignes de 25 caractères chacune, destinéesà décrire dans le détail la lithologie de laformation concernée ,
- un code de figuré lithologique, choisi parmil'un des 96 codes de la charte reconnue par le
logiciel (décrit en annexe 2) .
La coupe lithologique est, en principe, décrite
par profondeurs croissantes . Toutefois , les données
sont reclassées au moment de quitter la page. Si leur
ordre a été modifié, elles restent à l'affichage
jusqu'à ce que l'utilisateur presse sur l'une des
touche PgDn ou PgUp.
Rappelons que ce reclassement permet notamment :
- de supprimer un niveau en se contentant d'affi¬cher 0 pour la profondeur de la base correspon¬dante.
V.42
- d'insérer vm niveau en l'ajoutant après ledemier niveau descriptif de la coupe litholo¬
gique .
Remarque
Il est possible de décrire un niveau litholo¬
gique avec un nombre de lignes de texte dépassant les
devix lignes normalement prévues à cet effet.
Pour ce faire, entrer la même profondeur povir
plusieurs bases successives de niveaux lithologiques.
Tous les niveaux ayant la même base sont considérés
comme décrivant une seule et même formation. Ils sont
regroupés en conséquence sur le tracé de la coupe
lithologique, dans la mesure où l'une des trois
conditions suivantes est vérifiée :
- le même code de figuré lithologique est répétépour chacvm de ces niveaux : par exemple :
Base Description lithologique Figuré
12.75 Description n' la 14Description n" Ib
12.75 Description n" le 14Description n° Id
12.75 Description n° le 14Description n° lf
V.43
le code de figuré n'est donné que pour lepremier niveau : il n'est pas rempli pour lesniveaux suivants : par exemple :
Base Description lithologique Figuré
12.75 Description n' la 14
Description n" Ib
12.75 Description n* le
Description n" Id
12.75 Description n" le
Description n" lf
- le code de figuré est donné pour le premierniveau : pour les niveaux suivants, l'utilisa¬teur peut afficher des codes fictifs négatifsdécroissants par exemple :
Base Description lithologique Figuré
12.75 Description n" la 14Description n° Ib
12.75 Description n" le - 1Description n* Id
12.75 Description n" le - 2Description n° lf
V.44
L'avantage de cette troisième solution, malgré
sa lourdeur relative, vient de ce qu'elle permet
d'insérer des lignes descriptives complémentaires dans
un fichier existant. Dans ce cas, en effet, le reclas¬
sement par profondeurs croissantes effectué au moment
de quitter la page réinsère ces lignes complémentaires
à la place qui leur convient.
Au total, 60 lignes descriptives par fichier
sont réservées pour la description lithologique com¬
plète d'une coupe d'ouvrage. Ces 60 lignes peuvent
être, au gré de l'utilisateur, consacrées à la des¬
cription d'un seul niveau, ou bien découpées en 30
modules de 2 lignes affectés chacun à vm niveau
différent. Entre ces deux extrêmes toutes les solu¬
tions intermédiaires sont possibles.
V.46
DEVELOPPEMENT DE L 'OUVRAGE
PAGE I
Date du développement: bb/bb/i
LEXIQUE
DUREE (h) I DEBITou i MOYEN
QUANTITE
Suivant le type de développement.Indiquer la durée du pompage oula quantité de produit utilisée .
DEVELOPPEMENT DE L 'OUVRAGEZ] LEXIQUE I
Date du développement: 25/05/87
DUREE (h)ou
QUANTITE
8.00
1.00
16.008.00
DEBIT
MOYEN
(m3/h)
2.0
TYPE de DEVELOP.
1 Pompage continu2 Pompage alterné3 Surponpage4 Air-lift
5 Pistonnage6 HCL (en tonnes)7 H2S04 (tonnes)8 Polyphos. (kg;
g 9 Jet sous press.I 10 Fractur. hydr.
Suivant le type de développement,indiquer la durée du pompage oula quantité de produit utilisée . ET
FIGURE V.12
Page de saisie I - Développement de l'ouvrage
v.47
4.9. Pages de saisie I - développement de
l'ouvrage (fig. V.12)
Les différentes étapes du développement de
l'ouvrage peuvent être résumées au moyen de 8 lignes
descriptives contenant chacune 3 paramètres :
- type de développement, sous forme d'un code à 2chiffres ,
- durée ou quantité correspondante : préciser ladurée (en heures décimales) des différentes
phases de développement mécanique (pompage,pistonnage...) ou les quantités mises en jeudans les traitements chimiques (acidifications,traitements par polyphosphates) . Attention auximités relatives avix quantités : le lexique
affiché à droite rappelle que les quantitésd'acide doivent être exprimées en tonnes, alors
que les doses de polyphosphates sont à entrer enkg-
- pour les phases de pompage et d'air lift, indi¬quer en outre le débit moyen extrait de l'ou¬
vrage. Ce paramètre est à exprimer dans l'unitéchoisie pour les débits lors de la configurationdu logiciel.
V.48
{ PAGE J I I POMPAGES D ' ESSAI
Hauteur repèreNiveau d'eau
BB.BB m par rapport au solbbbb.bb m mesuré le bb/bb/bb
Début des pompages le bb/bb/bb â bb h bb mnNiveau d'eau avant les ponpages: bbbb.bb mChambre pompage de bbbb.bb â BBBB.aam ^:bbbb
DESCENTE REMONTEE]N» Durée
(h)Débit Niveau
(ID)Durée
(h)Niveau
(m)
1 BBBB.BB BBB.BB BBB.BB BBBB.BB BBB.BB
2 BBBB.BB BBB.BB BBB.BB BBBB.BB BBB.BB
3 BBBB.BB BBB.BB BBB.BB BBBB.BB BBB.BB
4 BBBB.BB BBB.BB BBB.BB BBBB.BB BBB.BB
5 BBBB.BB BBB.BB BBB.BB BBBB.BB BBB.BB
6 BBBB.BB BBB.BB BBB.BB BBBB.BB BBB.BB
PAGE J POMPAGES ESSAI
Hauteur repèreNiveau d'eau
.30 m par rapport au sol48.00 m mesuré le 28/05/87
Début des pompages le 28/05/87 â 7 h mnNiveau d'eau avant les ponpages: 48.00 mChambre pompage de -3.36 â . m (^: nm
D E S C E N T E remontee|N" Durée
(h)Débit Niveau
(m3/h) (m)Durée
(h)Niveau 1(m)
l3
4
5
6
1.00
1.00
1.00
8.00
1.00
1.50
2.00
1.30
52.0055.0059.30
56.70
1.00
1.00
1.00
16.00
48.5049.00
49.70
49.20
INTERPRETATION
Débit spécifique:B.B 10- a m3/s/m
Transm.: b.b 10- a m2/sCoef. S: B.B 10- aMéthode: BaBaaBaaBaaBaai
P.d.C. BBBBBBBB m2/s5Limite(s) alimentation: aLimite(s) ëtanche(s) : a
Si le repère est sous lesol, le 'niveau repère'doit être précédé dusigne - .
INTERPRETATION
Débit spécifique:4.0 10- 5 m3/s/m
Transm.: 7.0 10- 5 ni2/sCoef. S: . 10-Mêthode: GRINGARTEN
P.d.C. : ni2/s5Limite(s) alimentation:Limite(s) êtanche(s) :
[ESC]-retour au MENU [PgUp]-page précédente [PgDn]-page suivante
FTGDRE V.13
Page de saisie J - Pompage d'essai
v.49
4.10. Page de saisie J - pompage d'essai (fig.
V.13)
* Hauteur repère : hauteur par rapport au sol du
repère utilisé lors des mesures piézométriques.
Cette hauteur est comptée positivement si le
repère dépasse au-dessus du sol. Elle est
comptée négativement (signe -) si le repère est
sous le sol .
* Hauteur d'eau : position du niveau d'eau au
repos par rapport au repère, et date de la
mesure (niveau compté positivement s'il est
situé sous le repère ; niveau compté négative¬
ment, (signe -), s'il est situé au-dessus du
repère .
* Niveau d'eau avant les pompages : position du
niveau d'eau par rapport au repère, au moment de
commencer les pompages par paliers . Ce niveau
peut être différent du niveau d'eau au repos,
notamment si les pompages par paliers commencent
avant que la nappe ait totalement récupérée son
équilibre après la phase de développement.
V.50
* Chambre de pompage de . . . à ... m p : Indiquer
les profondeurs supérieure et inférieure de la
chambre de pompage, ainsi que son diamètre.
Celui-ci est à exprimer dans l'vmité choisie
pour les diamètres lors de la configuration du
logiciel.
* Cadre descente -remontée : Il est destiné à
décrire les différents paliers de pompage
éventuellement effectués , et non à rassembler
les mesures temps -niveau relevées en cours
d'essai. Ces dernières sont à traiter avec un
logiciel d'interprétation des pompages d'essai,
de type ISAPE.
Pour chaque palier de pompage, indiquer :
- la durée de pompage en heures décimales ,
- le débit, exprimé dans l'unité choisie pour lesdébits lors de la configuration du logiciel,
- le niveau mesuré dans l'ouvrage en fin de
pompage . Tous les niveaux sont à exprimer enmètres par rapport au repère. Les niveaux situéssous le repère sont comptés positivement, tandisque les niveaux situés au-dessus du repère sontcomptés négativement (précédés du signe - ) .
- la durée de remontée, en heures décimales,
- le niveau mesuré par rapport au repère en fin deremontée .
V.51
Les données utilisées pour le tracé de la courbe
caractéristique proviennent du tableau des pompages
par paliers ; les rabattements sont calculés par
rapport au "niveau d'eau avant les pompages".
Il est d'usage que les différents paliers de
pompage aient la même durée et que le temps de re¬
montée soit au moins égal à celui de la descente .
* Cadre Interprétation. Ce cadre est à compléter
en fonction des résultats d'interprétation d'un
pompage d'essai de longue durée.
- TRANSM Transmissivité
- COEF. S Coefficient d'emmagasinement
- METHODE Méthode utilisée pour interpréterles données d'essai (Theis, Grin-
garten, etc..)
- P.d.C. Pertes de charge quadratiquesobservées en cours d'essai. La
valeur correspondante est fournielors du tracé de la courbe carac¬
téristique ou lors d'vme interpré¬tation avec le logiciel ISAPE.
* Liffllte(s) alimentation - limlte(s) étanche(s)
Indiquer par les lettres 0 (oui) ou N (non)
l'existence éventuelle de limite (s) étanche(s)
et/ou de limite(s) d'alimentation.
V.52
PAGE K
TempératurepH In situConductivité
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
BB.B "C
BB.B
IBBBB |iS/cm
Résidu sec
pH labo.Dureté (TH)
BBBB.BB mg/lBB.B
BBaaaBBB <> F
Type des analyses chimiques: b
CATIONS (mg/l) ANIONS (mg/l)
Ca++ BBBBB.BB HC03- BBBBB.BB
Mg++ BBBBB.BB C03" BBBBB.BB
Na+ BBBBB.BB Cl- BBBBB.BB
K+ BBBBB.BB S04" BBBBB.BB
Fe++ BBBBB.BB N03- BBBBB.BB
Mn++ BBBBB.BB N02- BBBBB.BB
NH4+ BBBBB.BB F- BBBBB.BB
02 dissousC02 dissousSilice
BBBBB.BB Rig/lBBBBB.BB JCQ/]
mg/l
Conditions d' échantillonnage
Date de prélèvement :bbbbbbbbOuvrage en
exploitation (O/N) ? : b
PAGE K PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Température :pH in situ :Conductivité:
10.3 "C
7.0
1230 nS/cm
Résidu sec
pH labo.Dureté (TH)
. mg/l
35 F
I Type des analyses chimiques: 1 I
CATIONÎ; (mg/l) ANIONS (mg/1)
Ca++ 4.80 HC03- 380.00
Mg++ 2.40 C03- ,
Na-' 160.00 Cl- 34.00
K+ , S04~ 18.00
Fe++ N03- 8.00
Mn++,
N02- ,
NH4+ F-
02 dissousC02 dissousSilice
ng/lmg/lmg/l
Conditions d' échantillonnage
Date de prélèvement : 12/09/86Ouvrage en
exploitation (0/N) ? :
[ESC]-retour au MENU [PgUp]-page précédente [PgDn]-page suivante
FIGURE V.14
Page de saisie K - Paramètres phys ico-chimiques
v.53
4.11. Page de saisie K - Paramètres physico-
chimiques (fig. V.14)
* Type des analyses chimiques. Ce paramètre
correspond à la configuration standard utilisée
en France :
tjrpe 1 - analyses des ions majeurs (Ca, Mg,
Na, HCO3, CO3, Cl, SO4, NO3)type 2 - analyse comprenant en outre des
éléments additionnels : Fe, Mg,F. . .
type 3 - analyse complète avec des élémentsen traces et bactériologie.
Indiquer les concentrations (mg/l) des ions
majeurs et des principaux éléments traces. Il est
possible de saisir des concentrations négatives pour
indiquer qu'elles sont inférieures aux seuils de
détection des appareils. Par exemple, si le seuil de
détection d'un élément est de 0.05 mg/l, on peut entre
une teneur fictive de -0.05 mg/l qui se traduira par
la mention <0.05 mg/l sur le compte -rendu édité sur
imprimante .
Lors de l'édition de la fiche de compte rendu
d'ouvrage, ainsi que lors du tracé des diagrammes de
"Schoëller-Berkaloff", le logiciel calcule les concen¬
trations en meq/1, les bilans et la balance ionique.
V.54
PAGE L GEOPHYSIQUE / DIAGRAPHIES
Définir la nature et l'unité des paramètres retenus
I")PHYSIQlMETH PARAMETRE UNITE VALEUR DATE 1
1 BB BBBBBB BBBBB.BB bb/bb/bb^ BB BBBBBB BBBBB.BB bb/bb/bb3 BB BBBBBB BBBBB.BB bb/bb/bb
4 1 BB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBB.BB bb/bb/bb
5 1 BB 1 BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBB.BB bb/bb/bb
DIAGRAPHIES ^
N II METH I PARAMETRE UNITE
BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB
VALEUR DATE
bb/bb/bbbb/bb/bbbb/bb/bbbb/bb/bbbb/bb/bb
PAGE L [ GEOPHYSIQUE / DIAGRAPHIES
Définir la nature et l'unité des paramètres retenus
GEOPHYSIQUEN METH PARAMETRE UNITE
RESIS.TRANRESIS.APPA
0HM.M2
OHM.M
VALEUR DATE
3800.00230.00
12/01/8713/01/87
/ // // /
r uit
N
UlKMfnit
METH PARAMETRE UNITE 1 VALEUR DATE 1
1 5
3 IMPULSION CPS 30.00 23/05/87 1
MM/ / 1
LEXIQUE
LEXIQUE
METHODE GEOPHY.
Sondage électr.Trainé électr.
Electro-magnët.Magnéto-tel lur.Gravimétrie
SismiquePolar, spont.
99
[ESC]-retour au MENU [PgUp]-page précédente [PgDn]-page suivante
FIGURE V.15
Page de saisie L - Géophysique / Diagraphies
v.55
4.12. Page de saisie L - Paramètres géophysiques
et/ou diagraphies (fig. V.15)
Ces tableaux ne sont destinés à recevoir que des
données ponctuelles jugées caractéristiques, pour
1 ' ouvrage concerné , des mesures effectuées . Pour
traiter les séries de mesures profondeur -valeur,
utiliser l'option "tracé de diagraphies" du menu
général .
L'utilisateur peut mémoriser 5 valeurs géophy¬
siques ponctuelles, ainsi que 5 valeurs de diagraphie.
Chaque donnée est caractérisée par 5 paramè
tres
- code lexique de la méthode employée,- paramètre mesuré,- unité,
- valeur ,- date de la mesure .
Exemple Pour une prospection géothermique dans le
réservoir du Dogger, saisir les données sui¬
vantes, dans le tableau "Diagraphies" :
- méthode utilisée : thermométrie ,
- paramètres : température au toit du Dogger,
température au mur du Dogger.
V.56
Ces données, outre qu'elles sont éditée sur la
fiche de compte-rendu d'ouvrage, peuvent ultérieu¬
rement être transférées en base de données pour
traitements cartographiques ou statistiques.
V.58
\ PAGE H I r OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES
Observations
N.B.: Les 12 lignes de comnentalre libre proposées ci-dessus sont éditéestelles quelles en fin de la fiche de compte-rendu d'ouvrage .
PAGE M OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES
Observations : OUVRAGE DE CONTROLE DE LA QUALITE CHIMIQUEDES EAUX SOUS LE DEPOT DE PHOSPHOGYPSE AST-ETIENNE DU R. - FORAGE BIDON
N.B.: Les 12 lignes de comnentalre libre proposées ci-dessus sont éditéestelles quelles en fin de la fiche de compte-rendu d'ouvrage .
[ESC]-retour au MENU [PgUp]-page précédente [PgDn]-page suivante
FIGURE V.16
Page de saisie M - Observations complémentaires
v.59
4.13. Page de saisie M - Observations complé¬
mentaires (fig. V.16)
Cette rubrique permet à l'utilisateur de noter
toutes les informations qui n'ont pu être saisies dans
les pages précédentes , faute de champs prévus à cet
effet.
12 lignes de 45 caractères, chacune pouvant
ainsi recevoir les données relatives aux équipements
de pompage, débits obtenus au soufflage, analyse
bactériologique, venues de sable en cours de dévelop¬
pement, etc. .
VI. 3
Connecter une imprimante (si possible avec un
bac d'alimentation feuille à feuille) sur le port
parallèle n' 1. Indiquer le nvunéro de classement
national de l'ouvrage concerné, soit directement, soit
par 1 ' intermédiaire de la touche F2 .
A partir du numéro de classement foumi , le
logiciel recherche le fichier de données corres¬
pondant, le lit, en traduit les réponses codées, et
génère dans le répertoire C:\ACTIF, un fichier de
comptes rendus nommé EDIFICHE.LST. Ce fichier est
fichier texte , consultable et modifiable sous éditeur
de texte, ce qui offre à l'utilisateur la possibilité
de le contrôler, le compléter, l'annoter, ou même de
le reprendre sous traitement de texte .
EDIFICHE.LST n'est envoyé sur imprimante que si
l'utilisateur confirme sa demande d'édition. Dans la
négative, le menu général est réaffiché et l'utilisa¬
teur peut éventuellement sortir d'ACTIF pour consulter
le fichier EDIFICHE.LST. Ce fichier est écrasé à
chaque nouvelle procédure d'édition ; se placer sous
système et le renommer si l'on souhaite le conserver.
Au cours de la procédure d'édition, aucun ordre
de saut de page n'est envoyé à l'imprimante. Celle-ci
enchaîne elle-même ses pages en fonction de ses
propres paramètres de configuration. Si l'on constate
VI. 4
un décalage dans la mise en page du compte rendu édité
par ACTIF, on peut y remédier en modifiant le paramè¬
tre "nombre de lignes / page imprimante" dans l'option
"Configuration du logiciel ACTIF" :
- si la première page du compte rendu édité parACTIF se termine sur la seconde feuille émise
par l'imprimante, c'est que le nombre de lignespar page imprimante est inférieur à celui qui aété déclaré lors de la configuration d'ACTIF (65par défaut) . Il faut donc diminuer ce nombre
d'une valeur égale au nombre de lignes impriméessur la seconde feuille .
- si, au contraire, la seconde page du compte-rendu d'ACTIF commence au bas de la premièrefeuille émise par l'imprimante, il faut aug¬
menter la valeur du paramètre "nombre de lignes/ page imprimante" .
Le docvunent édité ne comporte que les rubriques
renseignées au cours de la phase de saisie. Sa lon¬
gueur varie de 1 à 7 pages selon le nombre de données
saisies. Toutes les données .codées sont traduites pour
être "éditées" en clair. La mise en page est to¬
talement prise en charge par le logiciel (fig. VI. 1,
VI. 2, VI. 3, VI. 4, VI. 5, VI. 6)
Si le type de présentation choisi lors de la
configuration du logiciel est "normal" , un cadre
entoure chaque page éditée, et les différentes rubri¬
ques sont précédées de titres encadrés.
VI. 5
Avec le tjrpe de présentation "condensé", le
cadre externe est supprimé et la présentation est plus
dense. Le gain de place est de l'ordre de 30 %.
VI. 6
Création dossier: FICHE OUVRAGE
H' classt : 0099-9X-0099
Désignation : PZ IB
Page 1/6
LOCALISATION ET IDENTIFICATION
ProjetMarché
Financement
CONTROLE DEPOT AZF
CDF-AZF
DépartementConmune
Lieu-ditN" conmune
SEINE-MARITIMEST-ETIENNE DU ROUVRAYFontaine aux Ducs765
MAITRE D'OUVRAGE : CDF-AZFMAITRE D'OEUVRE : B.R.G.M.INGENIEUR CONSEIL : B.R.G.M.ENTREPRENEUR : SOFREM
Objet : contrôlePiézomètre
Usage : qualité eauxRéalisé du 20/02/87 au 18/03/87Réception le 23/03/87Carte topographique: ROUEN (99)
Zone Lambert : 1
X - 508.370 kmY - 1187.270 kmZ - 50.000 ro +/- 2,
Etat : exploité
5m
Echelle : 1/25000
DESCRIPTION DU TROU NU
Diamètre
(nm)Profondeur/sol
(m)
600
400
252
0.00
4.00
12.00
4.00
12.00
73.00
Mode de
foration
BattageRotaryM.F.T.
Fluideutilisé
Boue polymèreMousse
.
Bureau de Recherches Géologiques et Minières Logiciel BRGM
FIGURE VI. 1
Compte rendu édité sur imprimante (page 1/6)
VI. 7
Création dossier: FICHE OUVRAGEN" classt : 0099-9X-0099
Désignation : PZ IB
Page 2/6
TUBAGES
Type de ^int. Profondeur (m) Nature du Epaisseurtube sup. - Inf. tube tube (nm)
Tube plein 500 0.00 - 4.00 ACIER ordinaire
Tube plein 350 0.00 - 11.00 ACIER ordinaireCOne réducteur 180 11.00 - 12.00 ACIER ordinaire
Tube plein 180 12.00 - 50.00 ACIER ordinaire
Crépine n*l 180 50.00 - 63.00 ACIER ordinaire
Tube plein 180 63.00 - 71.00 ACIER ordinaire
Tube décanteur 180 71.00 - 73.00 ACIER ordinaire
Fond plat 180 73.00 - 73.10 ACIER ordinaire 3
CARACTERISTIQUES OES CREPINESN'I Type de crépine j Slot (nm) I Vide (%) I Centreurs
1 I Fentes oblongues 2.0 12.0
ANNULAIRES
ESPACE ANNULAIRE EXTERNE (entre trou nu et tubage externe)
Profondeur/solsonnet base
Typed'annulaire
Nature
(et texture)Granulométrie
( nm - nn }
0.00
4.00
20.00
22.00
71.00
4.0020.00
22.00
71.00
73,00
RenblaiCimentation
Packer
Massif filtrantRenblai
Tout-venant
Ciment
Siliceux (Roulé)Tout-venant
2.0 5.0
ESPACE ANNUUIRE INTERNE (intrados du tubage externe)
0.00 4.00 I Ciaentation Clnent
Bureau de Recherches Géologiques et Minières Logiciel BRGM
FIGURE VI. 2
Compte rendu édité sur Imprimante (page 2/6)
VI, 8
Création dossier: FICHE OUVRAGEN* classt : 0099-9X-0099
Désignation : PZ IB
Page 3/6
DESCRIPTION DES VENUES D'EAU
Profondeur/sol(m)
Débit cimiilé
(m3/h)
52.00
58.00
65.00
0.30.9
1.3
DEVELOPPEMENT DE L'OUVRAGE
Dtibut du développement : 25/05j'87
Type dedéveloppement
Durée (h)ou quantité
Débit moyen(n3/h)
Air-lift
HCL (en tonnes)Air-lift
Poopage alterné
8.00
1.00
16.00
8.00
2.0
3.02.5
Bureau de Recherches Géologiques et Minières Logiciel BRGM
FIGURE VI, 3
Compte rendu édité sur Imprimante (page 3/6)
VI. 9
N' classt : 0099-9X-0099
Création dossier: FICHE OUVRAGE
Désignation : PZ 18
Page 4/5
POMPAGES D'ESSAI
Niveau au repos : 48.00 m/repère (28/05/87) Repère / sol : 0,30 mDébut des ponpages le 28/05/87 i 7 h 0 mn N.P. Initial : 48.00 m
DESCENTE REMONTEE
Durée (h) Débit (m3/h) N.P. final Durée (h) N.P. final
1.00 1.00 52.00 1.00 48.501.00 1.50 55.00 1.00 49.00
1.00 2.00 59.30 1.00 49.70
8.00 1.30 56.70 16.00 49.20
Déb t spécifique : 4.0 10-5 m3/s/m Transmissivité : 7.0 10-5 m2/s( Ponpage d'essai interprété par la méthode de GRINGARTEN )
Bureau de Recherches Géologiques et Minières Logiciel BRGM
FIGURE VI. 4
Compte rendu édité sur imprimante (page 4/6)
VI. 10
Création dossier: FICHE OUVRAGEN° classt : 0099-9X-0099
Désignation : PZ IB
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Température de l'eaupH In situDureté (TH)
10.3 'C
7.035 «F
Conductivité
Page 5/6
1230 |iS/CD
Cations mg/l neq/1 Anions ng/l neq/1
Ca++
Mg++Na+
4.80
2.40160.00
0.240.206.96
HC03-Cl-
S04-N03-
380.0034.00
18.008.00
6.230.960.37
0.13
Sonne des cations 7.39 Sonme des anions 7.69
Balance ionique : 0.30 meq/1 Erreur : 2 % (déficit cationique)
Ca / Na Na / Hg Ca/Mg S04 / Cl Cl-(Na+K) / Cl
0.03 35.25 1.21 0.39 -6.26
GEOPHYSIQUE / DIAGRAPHIES
GEOPHYSIQUE
Méthode Paramètre Unité Valeur Date
Sondage électr.Traîné électr.
RESIS.TRANRESIS.APPA
0m.H2OHM.M
3800.00
230.0012/01/8713/01/87
DIAGRAPHIES
Méthode Paramétre Unité Valeur Date
Ganma-ray IMPULSION CPS 30.00 23/05/87
Bureau de Recherches Géologiques et Minières Logiciel BRGM
FIGURE VI. 5
Compte rendu édité stir imprimante (page 5/6)
VI. 11
Création dossier: FICHE OUVRAGEN* classt : 0099-9X-0099
Désignation : PZ IB
Page 6/6
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES
OUVRAGE DE CONTROLE DE LA QUALITE CHIMIQUEDES EAUX SOUS LE DEPOT DE PHOSPHOGYPSE AST-FRANCOIS DU ROUVRAY
Bureau de Recherches Géologiques et Minières Logiciel BRGM
FIGURE VI. 6
Compte rendu édité stir imprimante (page 6/6)
2
ACTIF
TRACE de COUPE GEOLOGIQUE et TECHNIQUE
N° classement
Profondeur (m)0099-9X-0099
73
Echelle choisie pour le trace 7 : 80(Valeurs reconmandëes: 20,50,100)
Option graphique demandée 7 :(Réponses autorisées: 1 â 4)
Fl [4J ] Retour au menu général
Le facteur d'échelle demande
m/page correspond â la profondeur deterrain â représenter surchaque feuille de format A4 .
Options proposées pour lepanneau de droite:1 - panneau vierge2 - édition de données
caractéristiques3 - profil des venues d'eau4 - diagraphie optionnelle
FIGURE VII. 1
Tracé des coupes. Choix de l'échelle et
de l'option de tracé pour le panneau de droite.
VII. 3
1 - MODE OPERATOIRE
Indiquer le nvunéro de classement national de
l'ouvrage concerné (soit directement, soit par l'in¬
termédiaire de la touche F2) , puis "l'échelle" du
tracé et l'option graphique désirée (fig. VII. 1)
Tous les tracés sont exécutés au format A4, même
avec des tables traçantes de format A3 .
1.1. Echelle de tracé
"L'échelle" de tracé correspond à la longueur de
forage que l'utilisateur sotihaite voir dessiner siir
chaque page de format A4. Par exemple, une échelle de
50 m correspond à une longueur de forage de 50 m par
page . Les valeurs recommandées sont de 20 , 50 ou 100
m, de façon à faciliter la comparaison des coupes de
différents ouvrages .
Si l'échelle choisie est inférieure à la pro¬
fondeur du forage , le tracé des coupes s ' enchaîne sur
plusieurs pages. Entre deux pages consécutives, un
message s'affiche à l'écran pour demander à l'utili¬
sateur de changer la feuille de tracé.
VII, 4
Dépar-tewnt : INDRE-ET-LOIRE
Coanjnc : LAN6UILLE
N claaseaent
Désignation
04B5-BX-0071
5 2
COUPE LITHOLOGiaUE COUPE TECHNiaUE
n
lau «uLBKaiii
&i±mm
îmmimzs:m
EErcMl! I ! i
mmî?
i*ii
i^
mame ma i«B
lumuiLnc aaajn
i^^M «P wnr
MUTT 131 nn
- DM HCa)
FIGURE Vil . 2
Tracé des coupes. Option de tracé n" 1.
Sortie sur table traçante.
vil. 5
1.2. Options de tracé
Pour le panneau de droite , quatre options sont
proposées :
1) panneau vierge (fig. VII. 2),
VII. 6
OépartaMnt : SEINE-MARITIME
COMuna : ST-ETIENNE OU ROUVRAY
N classaient
Déalgnatlon
0099-9X-0099
PZ IB
COUPE LITHCLOBIQUE COUPE TECHNIOUE
1Lsoa
miMOB aux
1 ' r ' 1
'l'I'1 ' 1 ' 1
iiiii
=Stras
! I
DM «ur tat
:«>iU.
atTEBI D'EXECUTION
Début : 20/02/17
Fin is/oa/a?
LOCALUtTION
X
Y
Z aal
aet.m «
1117. 270 aa
90.00 B
IB/*sl <7.70 a
«as/sa 1 O.SO a
Z ra«. so.se a
Cet!
«Mio
2.ao a
NMPASC D'ESSAI
Data 2S/09/Í7
Ourta 1.0 h
Dtait 2.0 O/fl
llaMt. 11.30
PAMMCnCISI
HYWODYNANIBUEIS)
7.0 10- 9 12/8
PARANmCS
mYSICO-CHMISUCS
Taaa.
Cara. :
Omté:
10.1 C
7.0
1210 pS/ca
S9 "F
FIGURE VII. 3
Tracé des coupes. Option de tracé n' 2.
Sortie sur table traçante
VII. 7
2) panneau présentant sous forme de texte un
certain nombre de données caractéristiques de
l'ouvrage (fig. VII. 3),
VII. 8
Oéparteunt : ARDECHE
Coaaune : SRAvIERES
N dassaoïent : 007S-6X-0139
Désignation F3
COUPE LIIflOLOGIQUE
i
i.l
COUPE TECHNIQUE
raaikTm 1 ai10 TUK t Ol
S"
TTrTW^I^pCîImxi$iSi
m
at aacnioaet otuii
J
DEBIT INSTAKTANE OA0 9 1* U a
"l""l""l""l
liai KUr uoo aa
ÜTP'lrtPa
'?va,''ff'1 ^¡7T3S.-ff'I r=ÎSJi1î,ra.-
fiM-*
a-kM mt aa
M.lt
9a.lt
FIGURE VII, 4
Tracé de coupes. Option de tracé n' 3.
Sortie sur table traçante
VII. 9
3) profil des venues d'eau (fig. VII. 4)
Les mesures représentées correspondent aux
mesures entrées dans le tableau de la page de
saisie G ("Venues d'eau").
VII. 10
Oépsrteaant : LOIRET
CoMune : LA SOURCE
N dasseaent
Déalgnatlon
0SB5-5X-O023
P 321
COUPE LITHOLOSIOUE COUPE TECHNIOUE
i
S
iii
il
iiii
iii'
ii;
|iill'
tr*:
^
iHm* pwulaai.
a liaiii M airiu.
ataativw.»ailu «IMrt rlmiitlauuu.
iivMnu ti rwsta tiranaïai i ru
awiu raa mai.
îrrjrt!".cipnutiai atale r a,tt mautaai sH
l
-Maiu
SE AVANCEM. m/m19 m m m
't""l""i""l
liiiitiiiip.r'.n
FIGURE VII. 5
Tracé de coupes. Option de tracé n° 4.
Sortie sur table traçante.
VII. 11
4) Diagraphie optionnelle (fig. VII. 5) : représen¬
tation d'une diagraphie quelconque dont les
données peuvent être saisies au clavier (moins
de 300 couples profondeur / valeur) ou importées
à partir d'un fichier ASCII. Pour plus de
précisions, consulter le chapitre X - "Tracé des
diagraphies" .
Quatre modes de représentation graphique sont
proposées à l'utilisateur pour le tracé de la diagra¬
phie :
- ligne brisée,- ligne brisée avec report des valeurs le long dela ligne,
- histogramme en escalier,- histogramme en escalier avec report des valeurs.
VII. 12
Avant de lancer l'exécution du tracé :
Vérifier la position des switchs de configuration de la table traçante
S2 SI Y US A3 B4 B3 B2 El
Iil 1
B 0|_I II B II II
parité D MET A4 bauds( 9600 )
- Vérifier que la table traçante est bien connectée sur le port série COMÍ
- Mettre en place une feuille de papier A4, rabattre le levier,puis appuyer sur une touche quelconque exécuter le tracé ...
- Plumes utilisées : n'I » Tout le tracé , sauf le cartouche
n''2 - Cartouche
[ ESC ] : abandon Tracé : autre touche
FIGURE VII. 6
Tracé des coupes. Informations affichées
avant l'exécution du tracé.
VII. 13
1 . 3 Exécution du tracé
Suivant l'option retenue pour la rubrique "type
de connexion du traceur" lors de la "Configuration du
logiciel ACTIF" (§ 2.4, chapitre III), deux cas
peuvent se présenter :
* 1er cas : exécution immédiate du tracé (option
"connexion RS232" ou "connexion HP-IL"). Dans ce
cas, apparait à l'écran une série d'informations
(fig. VII. 6) précisant :
. les positions que doivent occuper les différents
"switchs" de configuration du traceur. Pardéfaut , le schéma présenté correspond au traceurHP 7475A pour un protocole de communication
compatible avec la commande DOS d'assignation duport 1 : OPEN COMÍ : 9600, 8, N, 1, P.
. les nviméros des plvunes qui correspondent auxdifférentes parties du tracé, ce qui permet àl'utilisateur de choisir en conséquence diamè¬tres et couleurs de ces plumes .
A ce stade , la procédure de tracé peut être
interrompue (touche ESC ou ECHAP) ou poursuivie
(toute autre touche) : dans ce cas, deux phases
se succèdent sans que 1 ' opérateur puisse les
interrompre :
VII. 14
constitution d'un fichier de tracé, nommé
COUPES. PLT, dans le répertoire C:\ACTIF. Cefichier contient toutes les instructions HP-GL
nécessaires à l'exécution du tracé ;
envoi de ce fichier sur le traceur, ce qui apour effet d'exécuter aussitôt le tracé.
* 2ème cas : si l'option "fichier de dessin
temporaire" a été sélectionnée, le tracé est
mémorisé dans le fichier C:\ACTIF\COUPES.LST,
puis le menu principal d'ACTIF est réaffiché à
l'écran sans que le tracé ne soit effectué.
L'utilisateur a la possibilité de consulter et
modifier ce fichier de tracé sous éditeur de
texte , puis de 1 ' exécuter en différé en frappant
la commande DOS :
. TYPE COUPES. PLT > COMÍ (connexion RS 232)
. TYPE COUPES. PLT > HPILPLT (connexion HP-IL)
Le fichier COUPES. PLT est écrasé à chaque nou¬
velle procédure de tracé de coupes ; se placer
sous système et le renommer si l'on souhaite le
conserver .
Avec l'option de tracé n° 4 ("fichier dessin
multi-ouvrages"), le fichier COUPES. PLT peut être
écrasé ou être conservé selon le choix de l'utilisa¬
teur. S'il est conservé, les instructions de tracé
VII. 15
correspondant à de nouveavix ouvrages viennent s'y
ajouter les unes à la suite des autres.
Cette option est intéressante avec un traceur de
type HP7550 muni d'un bac d'alimentation feuille à
feuille automatique, puisque la commande :
TYPE COUPES. PLT > COMÍ
permet alors d'enchaîner plusieurs tracés sans inter¬
vention de 1 ' opérateur .
VII. 16
2 - REMARQUES
2.1. Coupe lithologique
Les figurés lithologiques correspondent aux
graphismes présentés à l'annexe 2. Chaque niveau est
sjnnbolisé par le figuré représentatif du code qui lui
a été attribué lors de la saisie de la coupe litholo¬
gique (page de saisie H). Si aucun code n'est attribué
à un niveau donné, la représentation graphique corres¬
pondante reste vide. Cette propriété permet de pallier
les lacunes de la charte des figurés d'ACTIF en
complétant la coupe "à la main" .
Les descriptions lithologiques littérales ne
sont transcrites le long de la coupe que pour autant
qu'il y ait suffisamment de place entre le sommet et
la base du niveau. Si ce n'est pas le cas, seule la ou
les premières lignes de texte sont reproduites. Si le
niveau représenté est peu épais au regard de "l'échel¬
le" adoptée, il peut même arriver que la première
ligne ne soit pas reproduite elle non plus.
VII. 17
2.2. Coupe technique
Les différents diamètres de foration et de
tubages sont représentés à la même échelle , ce qui
peut amener quelques difficultés de lecture en cas de
diamètres très contrastés comme on peut en rencontrer
avec des ouvrages de tjrpe forages -puits.
Tous les codes correspondant aux types de
foration, tubages ou annulaires sont traduits en
clair.
VIH , 2
NUMERO de CLASSEMENT
DATE DU POMPAGE
Département :Coimune :
NIVEAU INITIAL : m/sol
Palier Durée Débit Rabattement Q/ s s /q(m/m3/h)N" (h) (m3/h) (m) (m3/h/m)
123 HH.n
4
5
6
Borne inférieure
Borne supérieureNbre graduations
Débit Rabattement
0.00 0.00
s / Q
NUMERO de CLASSEMENT : 0099-9X-0099
DATE DU POMPAGE : 28/05/87
ESC : Retour au menu général
Département : SEINE-MARITIMECoimune : ST-ETIENNE DU ROUVRAY
NIVEAU INITIAL : 47.70 m/sol
Palier Durée Débit Rabattement Q / s s / QH' (h) (m3/h) (m) (m3/h/m) (m/m3/h)
1 1.00 1.00 4.00 0.25 4.0002 1.00 1.50 7.00 0.21 4.667
3 1.00 2.00 11.30 0.18 5.6504 8.00 1.30 8.70 0.15 6.6925
^
6
GRAPHIQUES
Borne inférieure
Borne supérieureNbre graduations
Débit Rabattement
0.00
3.00
3
0.0020.00
2
s /Q
0.0007.000
7
ESC : Retour au menu général
FIGURE VIII. 1
Page de saisie potir l'interprétation
des pompages par paliers
VIH. 3
Cette option du menu général permet d'interpré¬
ter les pompages d'essai par paliers de débit. Elle
consiste à reporter graphiquement les points repré¬
sentatifs des mesures de débit et rabattement entrées
à la page de saisie relative aux pompages d'essai
(page J).
1 - MODE OPERATOIRE
Indiquer le numéro de classement national de
l'ouvrage concerné (soit directement, soit par l'in¬
termédiaire de la touche F2) , Les durées, débits et
rabattements des différents paliers de pompage effec¬
tués sur cet ouvrage sont alors affichés à l'écran,
accompagnés des débits et rabattements spécifiques
correspondants (fig. VIII. I).
En bas de page, un petit tableau présente les
bornes et nombres de graduations proposés par le
logiciel pour l'illustration graphique des schémas
rabattement / débit et rabattement spécifique / débit.
Toutes ces valeurs peuvent être modifiées par l'uti¬
lisateur.
VIH. 4
Les déplacements de champ à champ se font selon
les conventions habituelles . Les touches PgDn et PgUp
permettent en plus de ce déplacer d'un tableau à
l'autre, puis de faire apparaître deux graphiques où
sont reportées les mesures de terrain.
En règle générale, les pertes de charge ob¬
servées dans un forage sont de la forme :
s - bQ + cQ^
où s est le rabattement mesuré dans l'ouvrage au débit
Q. Les pertes de charge linéaire (b Q) sont générées
par l'écoulement laminaire dans l'aquifère et l'ou¬
vrage, tandis que les pertes de charge quadratiques2
(cQ ) sont engendrées par les turbulences qui prennent
naissance dans l'ouvrage lorsque le débit de pompage
excède un débit seuil, dit "débit critique".
On peut individualiser les pertes de charge
quadratiques par l'artifice suivant :
s - bQ + cQ^ --> s/Q - b + cQ
Autrement dit, le rabattement spécifique s/Q est une
fonction linéaire du débit Q, dont la pente c et
l'ordonnée à l'origine b sont les coefficients des
pertes de charge quadratiques et linéaires de la2
courbe caractéristique s - bQ + cQ .
VIH. 6
DEBIT (aS/h) DEBIT (ai3>0i)
0.00 '
4.00
LOO
«.00 '\
4.00 '
LOO -
\^
eoo
\
Rabaitattent (ti)
»= 2.1fl-lB°»Q* 1.73-ia°«q;m = 7.S7-1B Q 2.25-lB » Q
Rabat. si>é.()i/ti2) AJUSTEHINTti*'»
[ unitós : s(ii) , Q(ti3/0i) ][ unitós : s(ii) . q(ii3/s) 1
UOUUZ-UOUS UNE SORTIE SUR TABLE TRAÇANTE (O/W) ?CESO]
0
-> ABANDON
FIGURE VIII. 2
Ajustement de la courbe caractéristique à l'écran
VIH. 7
Le logiciel affiche à l'écran (fig. VIII. 2), en
partie gauche, le grapique s = f(Q) et en partie
droite le graphique s/Q - f (Q) . Dans chacun de ces
graphiques, les points représentatifs des mesures de
terrain sont figurés par le symbole *. Dans le gra¬
phique s/Q - f (Q) , est représenté en outre un segment
de droite ajusté par la méthode des moindres carrés.
Son ordonnée à l'origine b et sa pente c permettent
d'afficher au bas de l'écran l'équation de la courbe
caractéristique, et de reporter sur le graphique s -
f (Q) le segment de droite représentatif des pertes de
charges linéaires. Sur celui-ci les points représen¬
tatifs des couples pertes de charge linéaire -débit
sont figurés par le symbole +.
A l'aide des flèches t, 4-, - on peut dépla¬
cer et faire pivoter le segment de droite traduisant
la relation rabattement spécifique - débit pour tenir
compte des réalités de terrain (présence d'une mesure
aberrante par exemple) . Le segment de droite repré¬
sentatif des pertes de charge linéaires s'ajuste en
conséquence sur le graphique s -= f (Q) , ainsi que les
coefficients de l'équation de la courbe caractéristi¬
ques . Un coefficient négatif de pertes de charge
quadratiques fait apparaître la mention "développement
probable en cours de pompage".
VIH, 8
Avant de lancer l'exécution du tracé :
Vérifier la position des switchs de configuration de la table traçante
S2 SI Y US A3 B4 B3 B2 BI
i__ii " «
parité D MET A4 bauds( 9600 )
Vérifier que la table traçante est bien connectée sur le port série COMÍ
Mettre en place une feuille de papier A4, rabattre le levier,puis appuyer sur une touche quelconque exécuter le tracé ...
Plumes utilisées n'I - Tout le tracé , sauf le cartouchen''2 " Cartouche
[ ESC ] : abandon Tracé : autre touche
FIGURE VIII. 3
Tracé de courbe caractéristique. Informations
affichées avant l'exécution du tracé.
VIH. 9
2 - EXECUTION DU TRACE
Une fois les différents ajustements achevés et
contrôlés à l'écran, l'utilisateur peut obtenir sur la
table traçante une copie des graphiques obtenus à
l'écran.
Suivant l'option retenue pour la rubrique "type
de connexion du traceur" lors de la configuration du
logiciel ACTIF" (§ 2.4, chapître III), deux cas
peuvent se présenter :
* 1er cas : exécution immédiate du tracé (option
"connexion RS232" ou "connextion HP-IL") . Dans
ce cas, apparaît à l'écran une série d'informa¬
tions (fig. VIII. 3) précisant :
. les positions que doivent occuper les différents
"switchs" de configuration du traceur. Pardéfaut, le schéma présenté correspond au traceurHP 7475A pour un protocole de communication
compatible avec OPEN COMÍ : 9600, E, 8, 1, P
. les numéros de plumes qui corespondent auxdifférentes parties du tracé, ce qui permet àl'utilisateur de choisir en conséquence diamè¬
tres et couleurs de ces plumes .
A ce stade , la procédure de tracé peut être
interrompue (touche ESC ou ECHAP) ou poursuivie (toute
autre touche) : dans ce cas, deux phases se succèdent
sans que l'opérateur puisse les interrompre :
VIH. 10
. constitution d'un fichier de tracé, nommé
CARÁCTER. PLT, dans le répertoire C:\ACTIF. Cefichier contient toutes les instruction HP-GL
nécessaires à 1 ' exécution du tracé ;
. envoi de ce fichier sur le traceur, ce qui apour effet d'exécuter aussitôt le tracé.
* 2ème cas si l'option "fichier de dessin
temporaire" a été sélectionnée, le tracé est
mémorisé dans le fichier C:\ACTIF\CARACTER.PLT,
puis le menu principal d'ACTIF est réaffiché à
l'écran sans que le tracé ne soit effectué.
L'utilisateur a la possibilité de consulter et
modifier ce fichier de tracé sous éditeur de
texte, puis de l'exécuter en différé en frappant
la commande DOS :
TYPE CARÁCTER. PLT > COMÍ
(connexion RS232)
ou TYPE CARÁCTER. PLT < HPILPLT
(connexion HP-IL).
Le fichier .PLT est écrasé à chaque nouvelle
procédure de tracé de coupes ; se placer sous
système et le renommer si l'on sovihaite le
conserver .
VIH, 12
POMPAGE PAR PALIERS
IDENTIFICATION DU POMPAGE
Dtpartaaant : SEINE-MMITIME n' elaasaaant : 0099-9X-0099
Caaauni : ST-ETIEM4E DU ROUVIur Déalgnatlon n le
Oau au paapaga : 26/0S/B7 Nlvaau initial: 47.70 a/aol
DESCRIPTION DU POMPAGE
PALIER
DUREE DU
Pa<>ME
lainutaa)
DEBIT
MOYEN
(a3A)
RABATTEMENT
FINAL
la)
RABATTEMENT
SPECIFIQUE
n" 1 M 1.0 4.00 4.000
n* i 60 1.9 7.00 4.667
n' 3 60 2.0 11.30 9.690
n" 4 460 1.3 6.70 6.662
n' 9
n" 6
CALCUL DES PERTES DE CHARGE
Caurba earaetéPlatlqua a - bO « cO
' oarta aa cnarga llnéalpaa : a 2.22 h /a* e.OO 10 ' a /a*
' partaa da changa quadratlquaa : c nVa* - 2.14 10 a Va'
SRAPHiaUE a-f toi 6RAPHIBUE a/Q - f (Q)OCBIT |B3/I<) KBIT Ia3/hl
r
«
-^
U.M.
m
-
a.M.
PERTES DE CHARGE TOTALES la)
LINEAIRES le)
Bunaau da Racnarchaa Séeloglguaa at Mlnléraa Legicial
FIGURE VIII. 4
Tracé de courbe caractéristique,
Sortie sur table traçante.
IX. 3
Cette option du menu général permet de sélec¬
tionner jusqu'à 4 analyses différentes dans le réper¬
toire des fichiers d'ouvrages, et de reporter leurs
concentrations chimiques en éléments majeurs sur un
même digramme gradué en échelle logarithmique .
Ce type de diagramme mis au point par Messieurs
SCHOELLER et BERKALOFF facilite la comparaison d'ana¬
lyses d'eaux entre elles (faciès, concentrations...).
Les données prises en compte sont celles qui
sont entrées à la page de saisie relative aux paramè¬
tres phys ico -chimiques (page K) .
IX. 4
I Fichiers ouvrages mênorisés dans le répertoire C:\ACTIF\ IPage 1/ 1
0057-5A-0180 0178-2X-0068
0057-5X-0180 0485-8X-00680075-6X-0139 0485-8X-0071
0098-6X-0100 0585-5X-0023
0099-8A-0500 0585-5X-0024
0099-8A-0501 1003-4X-0053
0099-8A-0502 1111-lA-llll
0099-8A-0503 1111-lW-llll0099-88-05040099-9X-0098
0099-9X-0099
0123-4X-0297
0149-8X-0055
0150-3X-0183
0150-3X-01840150-3X-0185
0150-5X-0095
0151-1X-0190
[Fl] : Exécution du tracé [ESC]: retour au menu généralI ^ puis^I : sélection de 1 â 4 ouvrages â traiter
FIGURE IX .1
Sélection des ouvrages pour le tracé d'un
diagramme "Schoëller-Berkaloff"
IX. 5
1 - MODE OPERATOIRE
Le logiciel affiche la liste des fichiers -
ouvrages présents dans le répertoire de travail
classés par numéros croissants (fig. IX. 1). Cette
liste peut éventuellement se poursuivre sur plusieurs
pages auxquelles l'utilisateur peut accéder à l'aide
des touches PgDn et PgUp.
L'utilisateur peut sélectionner de 1 à 4 fichiers-
ouvrages dont les analyses seront reportées sur le
même diagramme de Schoëller-Berkaloff. La procédure à
employer est la suivante :
- utiliser les touches de déplacement t, 4-, -», *-,
PgDn et PgUp pour positionner le curseur surl'un des ouvrages choisis ; frapper ensuite latouche .«J (RETURN, ENTER ou ENTREE) pour sélec¬
tionner cet ouvrage, "Marquer" de la même façontous les ouvrages à représenter (jusqu'à 4 pardiagramme). En cas d'erreur, on peut annuler lasélection d'un ouvrage déjà "marqué" en ypositionnant le curseur et en frappant à nouveaula touche <J ,
- un fois "marqués" les différents ouvrages choi¬sis, frapper la touche de fonction Fl pourlancer le tracé.
IX. 6
Avant de lancer l'exécution du tracé :
Vérifier la position des switchs de configuration de la table traçante
S2 SI Y US A3 B4 83 82 811
0" " '
parité D HET A4 bauds( 9600 )
Vérifier que la table traçante est bien connectée sur le port série COMÍ
Mettre en place une feuille de papier A4, rabattre le levier.
Plumes utilisées : n'I - Tout le tracé , sauf le cartouche
n°2 - Cartouche
[ ESC ] : abandon Tracé : autre touche ...
FIGURE IX. 2
Tracé de diagramme "Schoëller-Berkaloff
Informations affichées avant l'exécution du tracé
IX. 7
2 - EXECUTION DU TRACE
Suivant l'option retenue pour la rubrique "type
de connexion du traceur" lors de la "Configuration du
logiciel ACTIF" (§ 2.4, chapître III), deux cas
peuvent se présenter :
* 1er cas : exécution immédiate du tracé (option
"connexion RS232" ou "connexion HP-IL"). Dans ce
cas, apparaît à l'écran une série d'informations
(fig. IX. 2) précisant :
. les positions que doivent occuper les différents"switchs" de configuration du traceur. Pardéfaut, le schéma présenté correspond au traceurHP 7475A pour un protocole de communication
compatible avec la commande DOS d'assignation duport 1 :
OPEN COMÍ : 9600, E, S, 1, P
. les numéros de plumes qui correspondent auxdifférentes parties du tracé, ce qui permet àl'utilisateur de choisir en conséquence diamè¬
tres et couleurs de ces plumes .
A ce stade, la procédure de tracé peut être
interrompue (touche ESC ou ECHAP) ou poursuivie (toute
autre touche) : dans ce cas, deux phases se succèdent
sans que l'opérateur puisse les interrompre :
. constitution d'un fichier de tracé, nommé
SCHOEL. PLT, dans le répertoir C:\ACTIF. Cefichier contient toutes les instructions HP-GL
nécessaires à l'exécution du tracé ;
IX. 8
Errairbalança
S.Dialifiattan F1(UP*
Cand
lH»l/ca)
OIAtauWE
D'ANALYSES D'EAU
'SCHOELLER BEWALOFF'
Ca** Mg* Ht'*K' Cl" sor HCO;«Or NOimm mm mm mm mm mm mm
FIGURE IX. 3
Tracé de diagramme "Schoëller-Berkaloff"
Sortie sur table traçante
IX. 9
. envoi de ce fichier sur le traceur, ce qui apour effet d'exécuter aussitôt le tracé.
* 2ème cas si l'option "fichier de dessin
temporaire" a été sélectionnée, le tracé est
mémorisé dans le fichier C:\ACTIF\SCHOEL.PLT,
puis le menu principal d'ACTIF est réaffiché à
l'écran sans que le tracé ne soit effectué.
L'utilisateur a la possibiité de consulter et
modifier ce fichier de tracé sous éditeur de
texte , puis de 1 ' exécuter en différé en frappant
la commande DOS :
TYPE SCHOEL.PLT > COMÍ
(connexion RS 232)
ou TYPE SCHOEL.PLT > HPILPLT
(connexion HP-IL)
le fichier SCHOEL.PLT est écrasé à chaque nou¬
velle procédure de tracé de coupes ; se placer
sous le système et le renommer si l'on souhaite
le conserver.
La figure IX. 3 reproduit un diagramme de
Schoëller-Berkaloff obtenu sur table traçante.
X.3
Cette option du menu général général permet de
représenter jusqu'à 5 diagraphies en parallèle sur une
feuille de format A4, selon différents modes de
représentation graphique . Les séries de données
correspondantes peuvent être saisies au clavier ou
importées à partir de fichiers ASCII. Dans les deux
cas, elles sont mémorisées en fichiers dans le réper¬
toire de travail (les noms des fichiers -diagraphies
sont élaborés par le logiciel : ils sont identiques au
nom du fichier -ouvrage, à ceci près que la dernière
lettre est l'vme des lettres de l'alphabet latin, au
lieu du caractère @) . Pour chaque ouvrage, il est
ainsi possible de traiter jusqu'à 26 diagraphies
différentes . Indiquer le numéro de classement national
de l'ouvrage concerné (soit directement, soit par
l'intermédiaire de la touche F2) , puis "l'échelle" du
tracé .
X.4
Acquisition ou modification des
données d'une diagraphie quelconque
Saisie d'une nouvelle diagraphieModification d'une diagraphie mémoriséeDestruction d'une diagraphie mëmorisëeInnportation d'un fichier ASCIIFin
[ESC]: abandon
FIGURE X.l
Henu déroulant spécifique pour la
gestion des fichiers - diagraphie
X.5
1 - SAISIE. MODIFICATION. DESTRUCTION. IMPORTATION
DE DIAGRAPHIES
Si aucun fichier -diagraphie relatif à l'ouvrage
traité n'a été préalablement constitué par ACTIF, un
message le signale en bas de l'écran, puis le logiciel
affiche un nouveau menu propre au traitement des
diagraphies (fig. X.l).
Ce menu propose 5 options , dont les fonctions
sont décrites ci-après.
X.6
Numéro de classement national: Paramètre:
Unité :
Prof. Valeur
(m)Prof. Valeur Prof,
(m) (m)Valeur Prof,
(m)Valeur
H
BBBaB.aal
BBBB
BBBB
BBBB
BB
BB
BB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BBBBB.BB BBBB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BBBB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
Numéro de classement national:
0099-9X-0099Paramètre: VITESSE AVANCEM.
Unité : mn/5m
Page1/5
Prof. Valeur Prof. Valeur Pro F. Valeur Prof. 1 Valeur 1(m) (m) (m ) (m )
0.00 85.00 75.00 67.005.00 67.00 80.00 58.00
10.00 52.00 85.00 54.00
15.00 55.00 90.00 59.0020.00 76.00 95.00 64.0025.00 87.00 100.00 47.00
30.00 64.00 105.00 57.0035.00 54.00 110.00 39.0040.00 48.00 115.00 42.0045.00 45.00
,
50.00 53.00, ^
55.00 41.00.
60.00 37.00, ,
65.00 42.00, ,
70.00 47.00
[ESC]-retour au MENU [PgUp]-page précédente [PgDn]-page suivante
FIGURE X.2
Page de saisie relative aux diagraphies
X.7
1.1. Saisie d'une nouvelle diagraphie
Cette option permet de saisir au clavier jusqu'à
300 couples profondeur-valeur par l'intermédiaire de
5 pages de saisie similaires, comportant chacune
60 couples de données (fig. X.2).
Identifier en premier lieu la diagraphie con¬
cernée par son nom et l'unité de mesure utilisée.
Saisir ensuite les couples profondeur -valeur en
remplissant les tableaux prévus à cet effet. Si
nécessaire, les 5 pages de saisie se succèdent à
l'affichage. Les règles de saisie sont les règles
générales déjà décrites pour les tableaux (§ 1,
chap . V) .
Devix nouvelles fonctions de déplacement sont
offertes à l'utilisateur :
CTRL + - déplacement "horizontal" d'un tableau à
l'autre, de gauche à droite
CTRL + +- déplacement "horizontal" d'un tableau à
l'autre, de droite à gauche
Un reclassement par profondeurs croissantes est
effectué à chaque changement de page , ce qui permet
d'effectuer des insertions ou des suppressions. Un
message d'erreur signale deux profondeurs égales.
X.8
En fin de saisie, taper ESC ou ECHAP ; une
sauvegarde est proposée permettant de stocker les
données dans vin fichier de diagraphie dont le nom est
attribué par le logiciel.
X.IO
Acquisition ou modification des
données d'une diagraphie quelconque
Saisie d'une nouvelle diagraphieModification d'une diagraphie mémoriséeDestruction d'une diagraphie mémoriséeImportation d'un fichier ASCIIFin
[ESC]: abandon
Diagraphies mémorisées
* GAMMA RAY
THERMOMETRIEMICRO-MOULINET
VITESSE AVANCEM.
[ESC]: abandon* : plus de 300 nesures
FIGURE X.3
Affichage écran des noms des diagraphies mémorisées
x.ll
1.2. Modification d'une diagraphie
Le choix de cette option provoque l'affichage à
l'écran (fig. X.3) des noms des diagraphies relatives
à l'ouvrage concerné et dont les fichiers de données
constitués préalablement par ACTIF sont stockés dans
le répertoire de travail .
Les noms précédés du symbole * correspondent à
des fichiers de plus 300 couples profondeur -valeur ,
dont les données ne peuvent être modifiées à partir
d'ACTIF. Ces fichiers -diagraphies ont été constitués
par importation de fichiers ASCII. Pour les modifier,
il faut procéder de la façon suivante :
- détruire le fichier-diagraphie (§ 1.3.),- modifier le fichier ASCII sous éditeur de texte,
- réimporter le fichier ASCII (§ 1.4).
La sélection de la diagraphie à modifier (tou¬
ches t , 4 , puis ^ ) amène la lecture du fichier-
diagraphie correspondant, puis l'affichage de la
première page de données.
x.12
1.3. Destruction d'une diagraphie
Sélectionner la diagraphie à supprimer dans la
liste des diagraphies de l'ouvrage concerné. La
destruction du fichier-diagraphie ne se fait qu'après
une double confirmation de la part de l'utilisateur.
X.14
GAMMA RAY
(API)0.108426 36.4322000.605056 33.5869100.843915 26.3891501.148480 21.8032901.876241 21.5543202.043255 22.3451602.334685 21.4819002.495572 20.8731802.628753 20.4291802.804576 20.5800503.108773 17.8676904.324936 17.2157304.978295 21.4453704.990679 21.4697206.058028 21.4745506.406071 22.9619407.203805 23.1670507.892642 28.5130408.097431 29.3293708.485887 28.8029108.955113 28.8733309.254441 24.6666909.497656 24.5363009.828506 23.580160
10.219530 25.63882010.624090 31.32662010.800630 29.58031011.180690 25.97050011.480890 27.24211011.667770 27.51213012.017080 30.75454012.279500 31.07569012.671800 33.03960012.791310 32.66597013.192550 41.36547013.446190 41.40159014.094840 28.43730014.397990 28.57071014.801830 25.080620
FIGURE X.4
Structtire d'tin fichier ASCII Importable sous ACTIF
pour constituer un fichier diagraphie
x.15
1.4, Importation d'un fichier ASCII
Cette option permet d'importer des fichiers
ASCII comprenant un très grand nombre (< 30 000) de
couples profondeur -valeur. Ces fichiers peuvent avoir
été générés par digitalisation d'enregistrements sur
papier ou par mémorisation directe de couples profon¬
deur-valeur à partir d'appareils de mesure numériques
(du type d'appareil à "diagraphie instantanée").
Les fichiers de données correspondants doivent
avoir la structure suivante (fig. X.4)
- Ire ligne : nom de la diagraphie sur 15 carac¬tères ,
- 2ème ligne : unité de mesure sur 5 caractères ,
- lignes suivantes : profondeur (m), valeur...
Les mesures se suivent à raison d'un couple
profondeur -valeur par ligne, où profondeur et valeur
sont séparées par une virgule et/ou un (des)
"blanc(s)". Les profondeurs sont exprimées en mètres
par rapport au sol. Les virgules décimales sont à
exclure : les remplacer par des points décimaux.
x.16
Le choix de l'option "Importation d'un fichier
ASCII" provoque l'écriture du message suivant au bas
de 1 ' écran :
Indiquer le nom du fichier ASCII à importer
Lorsque le nom est foumi, le logiciel lit le
fichier correspondant en affichant à 1 ' écran le nombre
de couples profondeur-valeur lus. Une fois toutes les
données lues, celles-ci sont recopiées dans un fichier-
diagraphie propre à ACTIF, comportant en tête le
nombre de données, ainsi que la valeur minimale et
maximale du paramètre mesuré. Le nom donné à la
première ligne du fichier ASCII permet ensuite d' iden¬
tifier la diagraphie. Si celui-ci n'est pas foumi, le
logiciel intitule la diagraphie "Fichier ASCII impor¬
té" et elle apparaît sous cette dénomination dans la
liste des diagraphies relatives à l'ouvrage concerné.
1.5. Fin
Cette option permet de revenir au programme de
tracé initialement choisi, à savoir "tracé de coupes
géologiques et techniques" ou "tracé de diagraphies".
X.18
Diagraphies
THERHOnETRIE
niCRO-flOULINET
UIIESSE ftUftNCEn.
Création /nodif ication
Position de la diagraphie i Hode desur la feuille M Ipeprésentat ion
( de gauche à droite ) J sélectionné
thehhohetkie
HICRO-mULIHET
UITESSE MMCEH.
^ -^
[ESC]: ABMIDOM
[Fl] : TRMX
t t t 1 SéloctiomiBz une diagraphie , puis (
FIGURE X.5
Sélection des diagraphies et des options
de tracé désirées
x.19
2 - EXECUTION DU TRACE
Si au moins un fichier diagraphie relatif à
l'ouvrage concerné est identifié dans le répertoire de
travail, le logiciel affiche à l'écran une série
d'informations peirmettant à l'utilisateur de choisir
les options de représentation graphique qu'il désire
(fig. X.5).
Cinq diagraphies pouvant être représentées en
parallèle sur une même feuille A4, l'utilisateur doit
sélectionner successivement les diagraphies qu' il
souhaite voir reportées, de gauche à droite, et
indiquer le mode de présentation graphique à affecter
à chacune d'elles.
Quatre figurés graphiques sont proposés, numé¬
rotés de 1 à 4 :
1. ligne brisée,
2 . ligne brisée , avec report des valeurs lelong de la ligne,
3. histogramme en escalier,4. histogramme en escalier, avec report des
valeurs .
X.20
Avant de lancer l'exécution du tracé :
Vérifier la position des switchs de configuration de la table traçante
S2 SI Y US A3 84 83 82 81
parité D MET A4 bauds( 9600 )
Vérifier que la table traçante est bien connectée sur le port série CONl
Mettre en place une feuille de papier A4, rabattre le levier,puis appuyer sur une touche quelconque exécuter le tracé ...
Plumes utilisées : n'I - Tout le tracé . sauf le cartouchen'2 " Cartouche
[ ESC ] : abandon Tracé : autre touche ...
FIGURE X.6
Tracé de diagraphies. Informations affichées
avant l'exécution du tracé.
X.21
A tout moment, l'utilisateur peut interrompre la
procédure en frappant la touche ESC (ou ECHAP) , ou
lancer le tracé en frappant sur la touche Fl.
Suivant l'option retenue pour la rubrique "type
de connexion du traceur" lors de la "Configuration du
logiciel ACTIF" (§ 2.4., chap. Ill), deux cas peuvent
se présenter :
* 1er cas : exécution immédiate du tracé (option
"connexion RS232" ou "connexion HP-IL"). Dans ce
cas apparaît à l'écran vme série d'informations
(fig. X.6) précisant :
- les positions que doivent occuper les différents"switchs" de configuration du traceur. Pardéfaut, le schéma présenté correspond au traceurHP 7475A pour vm protocole de communication
compatible avec la commande DOS d'assignation duport 1 :
OPEN COMÍ : 9600, E, 8, 1, P
- les numéros des plumes qui correspondent auxdifférentes parties du tracé, ce qui permet àl'utilisateur de choisir en conséquence diamè¬tres et couleurs de ces plumes .
A ce stade, la procédure de tracé peut être
interrompue (touche ESC, ou ECHAP), ou poursui¬
vie (toute autre touche) ; dans ce cas, devix
phases se succèdent sans que l'opérateur puisse
les interrompre :
X.22
Coaauna : ST-ETIENNE OU ROUVRAY
Z 901 : 50 a
N cl assènent : 0099-9X-0099
Déalgnatlon PZ IB
FIGURE X,7
Tracé de diagraphies . Sortie sur table traçante
X.23
constitution d'un fichier de tracé, nommé
DIAGRA.PLT, dans le répertoire C:\ACTIF. Cefichier contient toutes les instructions HP-GL
nécessaires à l'exécution du tracé ;
envoi de ce fichier sur le traceur, ce qui a
pour effet d'exécuter aussitôt le tracé.
* 2ème cas : si l'option "fichier de dessin
temporaire" a été sélectionnée, le tracé est
mémorisé dans le fichier C:\ACTIF\DIAGRA.PLT,
puis le menu principal d'ACTIF est réaffiché à
l'écran sans que le tracé ne soit effectué.
L'utilisateur a la possibilité de consulter et
modifier ce fichier de tracé sous éditeur de
texte, puis de l'exécuter en différé en frappant
la commande DOS :
TYPE DIAGRA.PLT > COMÍ
(connexion RS232)
ou TYPE DIAGRA.PLT > HPILPLT
(connexion HP-IL)
Le fichier DIAGRA.PLT est écrasé à chaque
nouvelle procédure de tracé de coupes ; se
placer sous système et le renommer si l'on
souhaite le conserver.
XI. 2
I Fichiers ouvrages mémorisés dans le répertoire C:\ACTIF\ IPage 1/ 1
0057-5A-0180 0178-2X-00680057-5X-0180 0485-8X-00680075-6X-0139 0485-8X-00710098-6X-0100 0585-5X-00230099-8A-0500 0585-5X-00240099-8A-0501 1003-4X-0053
0099-8A-0502 1111-lA-llll0099-8A-0503 1111-lH-llll0099-88-0504
0099-9X-0098
0099-9X-0099
0123-4X-0297
0149-8X-0055
0150-3X-0183
0150-3X-0184
0150-3X-0185
0150-5X-00950151-1X-0190
[Fl] : constitution du fichier ASCII I [F3] : annulation de toute sélection[F2 : sélection de tous les ouvrages | [ESC]: retour au menu général
4 > puis ^I sélection des ouvrages â traiter
FIGURE XI. 1
Sélection des fichiers ouvrages à exporter
sous forme de fichier ASCII
XI. 3
Pour accélérer les opérations d'entrées-sorties
sur les fichiers -ouvrages gérés par ACTIF, ceux-ci ont
une structure de fichiers formatés à accès direct. En
tant que tels , ils ne peuvent être consultés sous
éditeur de texte, et leurs données ne peuvent être
utilisées telles quelles par d'autres logiciels.
L'option "Exportation..." permet de s'affranchir
de cette contrainte en générant vm fichier ASCII
séquentiel à partir d'un (ou d'vme série de) fichier (
s) -ouvrages de trype ACTIF.
Ce fichier séquentiel regroupe toutes les
données relatives aux différents ouvrages sélection¬
nés : il peut être consulté sous éditeur de texte et
lu par tout logiciel.
Lorsque cette option est sélectioiuiée , le
logiciel affiche la liste des fichiers -ouvrages
présents dans le répertoire de travail. Cette liste
peut éventuellement se poursuivre sur pl<as leurs pages
auxquelles l'utilisateur peut accéder à l'aide dpc
touches PgDn et PgUp (fig. X.l).
L'utilisateur peut sélectionner autant d'ouvra¬
ges qu'il le désire, dont les données se succéderont
dans le fichier ASCII résultant. La procédure à
employer est la suivante :
XI. 4
Utiliser les touches de déplacement t, 4, - +-,PgDn et PgUp, pour positionner le curseur surl'un des ouvrages choisis. Frapper ensuite latouche <J (RETURN, ENTREE ou ENTER) pour sélec¬tionner cet ouvrage . "Marquer" de la même façontous les ouvrages à traiter. En cas d'erreur, onpeut annuler la sélection d'un ouvrage déjà
"marqué" en y positionnant le curseur et enfrappant à nouveau la touche «J .
Si l'on souhaite traiter tous les ouvrages, onpeut les "marquer" tous en appuyant sur latouche F2.
En cas de fausse manoeuvre, on peut annuler tous
les "marquages" effectués grâce à la touche F3.
Une fois "marqués" tous les ouvrages désirés,lancer le traitement avec la touche Fl.
Le logiciel lit alors successivement tous les
fichiers concernés et en recopie les données dans un
fichier nommé ASCII. LST. Dans ce fichier (fig. XI. 2,
XI. 3 et XI. 4), les données relatives aux différents
ouvrages sont séparées par un trait continu. Pour
chaque ouvrage , les données sont regroupées par lots
correspondant au découpage des 13 pages de saisies.
Chaque lot est identifié par le titre récapitulatif de
son contenu.
XI. 5
- IDENTIFICATION -
IB"," ','11','2, 3. 5,1, "20/02/87", "18/03/87", '23/03/87". "CONTROLE DEPOT A2F".""CDF -AZF', "CDF-AZF". "B.R. G.M. ", "B.R.G.H. "."SOFREH"
* MM
"' LOCALISATION -"SEIHE-KARITIHE". 'ST-ETIENNE DU ROUVRAY". "Fontal ne aux Ducs",""98". "765"."",'"1,508.37,1187.27,50.2.50,0.0.0,0.0"ROUEN". "99". 25000
' TROU NU ~600.4,4,0400.12,2,6252.73.1.40.0.0,00,0.0,00,0,0,0
-' TUBAGES -1,500,0,4,3.4,0.0.0,01.350,0,11,3.3,0,0,0,03.180,11,12,3,3,0.0.0.01.180.12.50,3.3.0.0.0,02.180.50.63,3.3,2,2,12.51.180,63.71,3,3,0.0,0.04,180.71.73.3,0.0.0.0.08.180.73.73.1,3,3,0.0,0.00.0.0.0.0.0,0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0,00.0,0,0,0.0.0,0,0,00,0.0.0,0.0.0.0,0.00,0,0.0,0,0,0,0,0,00,0,0,0.0.0.0.0.0,00,0.0,0,0,0,0,0,0,0
-' ANNULAIRES ~4,3.1.0.0.020.1.1.0,0.022.4.1.0.0.071.2.1,1,2.573,3,1.0,0,00.0.0,0,0,00,0,0,0,0.00.0.0,0.0.00.0.0.0,0.00,0,0,0,0,00,4,1,1.0.0,00,0.0,0.0,0.0
FIGURE XI. 2
Contenu du fichier ASCII. LST
XI. 6
- HYDROGEOLOGIE -
3, 5, 7, 1,0, O
".0.0.0.0.0.00,0,00,0,0,0,0,0.0,0.0
-' VENUES D'EAU -52..3.58..9.65.1.3.0,0,0,00,0,0,0.0.0.0.0.0.0- LITHOLOGIE -
2."LIH0HS"."".174. "BANCS DE SILEX^.'^,2763, A SILEX', 'TRES FISSUR£E*.4073, 'CRAIE HARNEUSE'."^.430.".".00.",",0O.".",00."."".00.".".00.",".00,".",00, 00,"',",00,",",00,",",00,".".00."^,^",00,".".0O.".",00,",",00, 00 " 0
0.".".00.".".00.".".00,",",00 " 0
0.".".00.".".00.".".0- DEVELOPPEMENT -
4.8.2.6.1.0.4.16.3.2.8.2.50.0.0.0.0.0.0.0,0,0.0,0
- POHPAGE D'ESSAI -
.3,48, *28/05/87^ , .7 ,0.483.36.0,01.1,52,1,48.5.1.1.5.55,1,49.1,2,59.3.1.49.78,1.3.56.7,16,49.2.0.0,0,0.0,0,0.0.0.0
FIGURE XI, 3
Contenu du fichier ASCII. LST (suite)
XI. 7
4,5,7,5,0,0'GRINGARTEN',O,'","'- PHYSICO-CHIMIE -
10.3,7,1230.0,0.35.04.8,2.4,160,0,0.0.0380,0.34.18.8.0.0O.O.O.' / / '."- GEOPHYSIQUE - DIAGRAPHIES -1. 'RESIS.TRAN'. 'Om.H2". 3800. '12/01/87'2, 'RESIS.APPA', 'OIW.M'. 230. '13/01/87'0.".".0.' / / '0.".".0.^ / /0.".".0.' / / '3. IMPULSION" . "CPS" ,30,0,^","',0,^ / /0."^,"".0,^ II'Q,".".<i,' I I '0,"",",0,' / / '
-' OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES -'OUVRAGE DE CONTROLE DE U QUALITE CHIMIQUE*'DES EAUX SOUS LE DEPOT DE PHOSPHOGYPSE A'
'ST-ETIENNE DU R. -' FORAGE BIDON
~ IDENTIFICATION
2','12/02/88^,^12/05/88^,^3,1,99,9, '25/01/88". '01/02/88',' / / ','", SAUHUR 88",
URBAIN DE SAUMURA. URB. SAUHUR*. 'BRGH^.^BRGH^."Controle'
- LOCALISATION -
. . 'LES FONTENELLES' . '"13" "S7Q** ** *"
2. 422. 09. 2247167.61.5.. 50.0.0.0,0.0
25000
~ TROU NU ~
131,4.7.2.2116,28.5,2,20,0,0,00,0,0,00.0,0.0
FIGURE XI. 4
Contenu du fichier ASCII. LST (suite)
XI. 8
Les figures XI . 5 à XI . 10 décrivent de façon
détaillée le contenu du fichier ASCII. LST. Celui-ci
peut être édité par ACTIF en répondant 0 ou .^J , à la
question : "Désirez-vous éditer le contenu du fichier
ASCII. LST ?".
XI. 9
CONTENU DU FICHIER ACTIF AS.CII
Ce fichier ASCII stquentlel contient les donnies relatives aux n fichiers-ouvrages select ionnës .
Chaque fichier-ouvrage correspond I 136 lignes de données regroupées en 13rubriques correspondant aux 13 grilles-écran de saisie . Chacune de ces rubri¬ques porte un titre descriptif de son contenu .
Un trait continu sépare 2 fichiers-ouvrages successifsLes données contenues dans ce fichier sont de type nuDérique (N) ou alpha-
nuMérique (A) . Pour les diaaAtres , elles sont de type variable (V) :- si les dianétres sont expriaés en nilllRiëtres , elles sont de type
nunérique- si les dianétres sont exprinès en pouces , elles sont de type alphanumé¬
rique
I IDENTIFICATION | ( 5 lignes . dont 4 lignes de données )ligne 1 : n* de dasseaent (A), désignation (A), date saisie dossier (A),date Dise i Jour (A) . version du logiciel ACTIF utilisée (A).unité utilisée pour les dianétres (A), unité utilisée pour lesdébits (A), forwt utilisé pour les dates
liane 2 : code type ouvrage (N). code objet ouvrage (N). code usage del'eau (N). code état ouvrage (N). date début de travaux (A), datefin de travaux (A), darte réception (A), procés-verbal (A),projet (A), Marché (A)
ligne 3 : financenent (A), aattre d'ouvrage (A), naître d'oeuvre (A),ingénieur-conseil (A), entrepreneur (A)
ligne 4 : type d'ouvrage optionnel (A), objet ouvraoe optionnel (A), usage del'eau optionnel (A), état de l'ouvrage optionnel (A)
LOCALISATION I ( 9 lignes . dont 8 lignes de données )
ligne 1 : division a(tiiinistrative n* 1 (A), division adninistrative n° 2 (A)division administrative n° 3 (A)
ligne 2 : division adninistrative n* 4 (A), division adnlnistratlve n° 5 (A)division adninistrative n* 6 (A)
ligne 3 : code départenent (A), code corniune (A), code aquifère (A), codebassin versant (A)
ligne 4 : zone Lambert (N), X (N), Y (N), altitude (N), précision surl'altitude (N)
ligne 5 : longitude-degrës (N), longitude-minutes (N}, longitude-secondes (N),latitude-degrés (N), latitude-minutes (N), latitude-secondes (N)
ligne 6 : carte topographique (A), n* carte (A), échelle (N)ligne 7 : mission photo aérienne (A), n* photo 1 (A), n° photo 2 (A)ligne 8 : mission satellite (A), n* photo (A)
FIGURE XI. 5
Descriptif détaillé de la structure
du fichier ASCII. LST
XI. 10
TROU NU
ligne 1
ligneligneligneligneligneligne 7
( 8 lignes , dont 7 lignes de données )
pour foration n* 1 : diamètre (V). profondeur (N). code modeforation (N). code fluide foration (N)Idem pour foration n* 2idem pour foration n* 3idem pour foration n' 4Idem pour foration n* 5idem pour foration n* 6
foration optionnel (A), fluide foration optionnel (A)
I TUBAGES I ( 17 lignes . dont 16 lignes de données )ligne 1 : pour tubage n* 1 : code type tube (N), diamètre
ligne 2 :ligne 3 :ligne 4 :ligne 5 :ligne 6 :ligne 7 :ligne 8 :ligne 9 :ligne 10:ligne 11:ligne 12:ligne 13:ligne 14;ligne 15:ligne 16:
tete (N). profondeur base (N). code nature tube (N). épaisseur(H).
(V). profondeur(H), -
tube (N). code type crépine (N). slot (H), ouverture (N), nombrede centreurs (N)
234
S
67
89
10
11
12
1314
15
(A), nature tube optionnelle (A), type crépine
idem pour tube n*Idem pour tube n*Idem pour tube n*Idem pour tube n*Idem pour tube n*idem pour tube n*idem pour tube n*Idem pour tube n'Idem pour tube n*idem pour tube n*Idem pour tube n*Idem pour tube n*Idem pour tube n*Idem pour tube n*type tube optionneloptionnel (A)
FIGURE XI. 6
Descriptif détaillé de la structure
du fichier ASCII. LST (suite)
ANNUUIRES
XI. 11
( 14 lignes . dont 13 lignes de données )
ligne 1 : pour annulaire externe n* 1 : profondeur base (N), code typereii()lis$age (N). code nature remplissage (N), code textureremplissage (N). granulométrie inférieure (N). granulométriesupérieure (N)
ligne 2 : idem pour annulaire externe n* 2ligne 3 : idem pour annulaire externe n* 3ligne 4 : idem pour annulaire externe n* 4ligne 5 : idem pour annulaire externe n* Sligne 6 : idem pour annulaire externe n* 6ligne 7 : Idem pour annulaire externe n* 7ligne 8 : Idem pour annulaire externe n* 8ligne 9 : idem pour annulaire externe n* 9ligne 10: Idem pour annulaire externe n* 10ligne U: pour annulaire Interne n* 1 ; profondeur tete (N), profondeur
base (N). code type reif)!Usage (N), code nature renplissage (N),code texture rea^tllssage (N). granulométrie inférieure (N).granulométrie supérieure (N)
ligne 12: Idem pour annulaire externe n* 2ligne 13: type annulaire optionnel (A), nature ciment optionnelle (A),
nature massif filtrant optionnelle (A), texture massif filtrantoptionnelle (A), nature renblai optionnelle (A)
HYDROGEOLOGIE I ( 7 lignes . dont 6 lignes de données )
ligne 1 : pour aquifère n* 1 : nom de l'aquifère (A), code famille faciès (N),code faciès (N), code type porosité (N), code type hydrodynamique(N), profondeur toit aquifère (N), profondeur mur aquifère (N)
ligne 2 : idem pour aquifère n* 2ligne 3 : Idem pour aquifère n* 3ligne 4 : profondeur base recouvrement (N), profondeur base altération (N).
code géomorphologie (N)ligne 5 : direction fracture n* 1 (N). longueur fracture n* 1 (N). distance
S la fracture n* 1 (H), direction fracture n* 2 (N). longueurfracture n* 2 (N). distance a la fracture n* 2 (tt). directionfracture n* 3 (H), longueur fracture n* 3 (H), distance è lafracture n* 3 (H)
ligne 6 : type porosité optionnel (A), géomorphologie optionnelle (A), facièsoptionnel (A)
VENUES D'EAU [ ( 3 lignes , dont 2 lignes de données )ligne 1 : profondeur venue n* 1 (N), débit venue n* 1 (N), profondeur venue
n' 2 (N). débit venue n* 2 (N). profondeur venue n* 3 (N), débitvenue n* 3 (N). profondeur venue n* 4 (N). débit venue n° 4 (N).profondeur venue n* 5 (N). débit venue n* 5 (NI
ligne 2 : profondeur venue n* 6 (N). débit venue n* 6 (N). profondeur venuen* 7 (N). debit venue n* 7 (N), profondeur venue n* 8 (N), débitvenue n* 8 (N), profondeur venue n* 9 (N), débit venue n* 9 (N),profondeur venue n* 10 (N), débit venue n* 10 (N)
FIGURE XI, 7
Descriptif détaillé de la structure
du fichier ASCII. LST (suite)
XI. 12
LITHOLOGIE ( 31 lignes , dont 30 lignes de données )
ligne 1 : profondeur base niveau n* 1 (N), première ligne description litholo¬gique (A), deuxième ligne description lithologique (A), code figurélithologique (N)
1 igné 2 : idem pour niveau n* 2ligne 3 : idem pour niveau n* 3ligne 4 : idem pour niveau n° 4I igné 5 : idem pour niveau n* 5ligne 6 : Idem pour niveau n* 61 igné 7 : idem pour niveau n* 7ligne 8 : idem pour niveau n* 8ligne 9 : Idem pour niveau n* 9ligne 10: idem pour niveau n* 10ligne 11: Idem pour niveau n* 11ligne 12: Idem pour niveau n* 12ligne 13: Idem pour niveau n* 13ligne 14: Idem pour niveau n* 14ligne 15: idem pour niveau n* 10ligne 16: Idem pour niveau n* 16ligne 17: idem pour niveau n* 17ligne 18: idem pour niveau n* 18ligne 19: Idem pour niveau n* 19ligne 20: idem pour niveau n* 20ligne 21: idem pour niveau n* 21ligne 22: idem pour niveau n* 22ligne 23: idem pour niveau n* 23ligne 24: Idem pour niveau n* 241 igné 25: idem pour niveau n* 251 igné 26: Idem pour niveau n* 26ligne 27: idem pour niveau n* 27ligne 28: Idem pour niveau n* 28ligne 29: idem pour niveau n* 29ligne 30; idem pour niveau n* 30
[ DEVELOPPEMENT ( 5 lignes , dont 4 lignes de données )
ligne 1 ; date de développement (A)ligne 2 : code type dvpt n* 1 (N),
code type dvpt n' 2 (N)code type dvpt n* 3 l N)code type dvpt n* 4 (N)
ligne 2 : code type dvpt n* 5 i N)code type dvpt n* 6 i N>code type dvpt n* 7 (Nicode type dvpt n* 8 (N)
durée dvpt n*durée dvpt n*durée dvpt n*durée dvpt n*durCe dvpt n*durée dvpt n*durée dvpt n*
-,,r- - »"#. durée dvpt n*ligne 4 ; type de développement optionnel (A)
débit dvpt n*débit dvpt n'débit dvpt n*débit dvpt n*débit dvpt n*débit dvpt n*débit dvpt n*débit dvpt n* 8
FIGURE XT ft
Descriptif détaillé de la structure
du fichier ASCII, LST (suite)
XI. 13
{ POMPAGE D' ESSAI | ( 7 lignes , dont 6 lignes de donnée» )ligne 1 : dépassement repère/sol (N), niveau statique (N), date niveau
statique (A), date début pompage d'essai (A), heure début ponpaged'essai (N), minute début pcnpage d'essai (N). niveau d'eau débutpcnfwge (N)
ligne 2 : profondeur tête chambre pcafiage (N). profondeur base chambrepcnpage (N). diamètre chaiÉ>re ponpage (V)
ligne 3 : durée ponpage n* 1 (N). débit pcnpage n* 1 (N). nlvaau fin ponpagen* 1 (N). durée ramwtée n* 1 (N). niveau fin remontée n* 1 (N),durée pompage n* 2 (H), débit poo^ge n* 2 (N), nlvaau fin pooon* 2 (N), durée remontée n* 2 (N), niveau fin renantée n* 2 (N)durée ponpage n* 3 (N), débit poopage n* 3 (H), niveau fin pcbdn^ 3 (N), durée remontée n* 3 (H), niveau fin remontée n* 3 (N)
ligne 4 : durée ponpage n* 4 (N), débit ponpage n* 4 (N). niveau fin pogsagen* 4 (N). durée remontée n* 4 (H), niveau fin remontée n* 4 (N),durée poipage n* S (N). débit ponpage n* S (N), niveau fin ponôagen* S (H), durée remontée n* 5 (N). niveau fin remontée n* 5 (N).durée ponpage n* 6 (N), débit pao^Mge n* 6 (N). niveau fin poañagen* 6 (N). durée remontée n* 6 (N). niveau fin remontée n* 6 (N)
ligne 5 : mantisse débit spécifique (N). exposant débit spécifique (R), mantissetransmissivité (H), exposant transmissivité (N), mantisse onagasl-nement (N). exposant engages Inement (N)
ligne 6 : méthode Interprétation ponpage (A), perte de charge forage (N).existence limite alimentation (A), existence limite étanche (A)
PHYSICO - CHIMIE | ( 5 lignes . dont 4 lignes de données }ligne 1 : teapérature (N). pH In situ (N), conductiviu (M), résidu sec (N).
pH labo (N). dureté (H), type d'analyse (R)ligne 2 : Ca (N), Hg (N), Na (N), K (N), Fe (R), Kl (N), RH4 (R)ligne 3 : HC03 (N). C03 (N), CI (N). S04 (N), N03 (N). N02 (R). F (R)ligne 4 : 02 (N). C02 (H). SI (N). date échantillonnage (A), conditions
d'échantillonnage (A)
GEOPHYSIQUE - DIAGRAPHIE I ( 12 lignes . dont 11 lignes de données )
ligne 1 : pour mesure géophysique n* 1 : code méthode géoptiysique (N).paramètre mesuré (A), unité de mesure (A), valeur mesurée (M).date mesure (A)
ligne 2 : idem pour mesure géophysique n* 2ligne 3 : idem pour mesure géophysique n* 3ligne 4 : idem pour mesure géophysique n* 4ligne 5 : idem pour mesure géophysique n* 5ligne 6 ; pour mesure diagraphie n* 1 : code méthode diagraphie (R).
paramètre mesuré (A), unité de mesure (A), valeur mesurée (R),date mesure (A)
ligne 7 : idem pour mesure diagraphie n* 2ligne 8 : idem pour mesure diagraphie n* 3ligne 9 : Idem pour mesure diagraphie n* 4ligne 10: idem pour mesure diagraphie j)' 5ligne 11: méthode géophysique optionnelle . méthode diagraphie optionnelle
FIGURE XI, 9
Descriptif détaillé de la structure
du fichier ASCII, LST (suite)
XI. 14
1 OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES | ( 13 lignes
ligne 1 ligne d'observation n* 1 A
ligne 2 ligne d'observation n* 2 A
ligne 3 ligne d'observation n* 3 A
ligne 4 ligne d'observation n° 1 A
ligne 5 ligne d'observation n" 5 A
ligne 6 ligne d'observation n^ 6 A
ligne 7 ligne d'observation n* 7 A
ligne 6 ligne d'observation n* 8 A
ligne 9 ligne d'observation n* 9 A
ligne 10 ligne d'observation n* 10 i*îligne 11 ligne d'observation n* 11 A
ligne 12 ligne d'observation n* 12 iA/
dont 12 lignes de données )
FIGURE XI. 10
Descriptif détaillé de la structtire
du fichier ASCII. LST (suite et fin)
XII. 2
ACTIFFonct 1ons ut i 1 1 taires diverses
TRAITEMENT A EFFECTUER
Consultation d'un lexiqueEdition lexiques générauxEdition lexiques géologiquesEdition de la configurationTracé des figurés litholog.Edition bordereau de saisie
Créât ionXmodif icat. lexiqueListe ouvrages + désignationFin des traitements
FIGURE XII. 1
Menu des fonctions utilitaires
XII. 3
Cette option permet de disposer, à partir du
menu général, d'utilitaires dont la liste est donnée
dans la figure XII. 1.
XII. 4
ACTIF
Fonctions utilitaires diverses
TRAITEMENT A EFFECTUER
Consultation d'un lexiqueEdition lexiques générauxEdition lexiques géologiquesEdition de la configurationTracé des figurés litholog.Edition bordereau de saisie
CrêationNmodificat. lexiqueListe ouvrages + désignationFin des traitements
CHOIX DU LEXIQUE MODE de FORATION
[ESC]: Retour menu principal
TYPE d' OUVRAGE
OBJET de 1 'OUVRAGEUSAGE de T OUVRAGEETAT de 1' OUVRAGE
MODE de FORATION
FLUIDE de FORATION
TYPE de TUBE
NATURE de TUBETYPE de LUMIERES
TYPE d' ANNULAIRENATURE de CIMENT
NATURE de FILTRE
TEXTURE du FILTRE
NATURE de REMBLAITYPE de POROSITE
TYPE de NAPPE
I
1 M.F.T.
2 Rotary3 Rotary inverse4 Battage5 Fonçage6 Havage7 Tarière
8 Roto-percussion9 Manuelle
10 Turbo-forage11 Carottage
Appuyer sur la touche RETURN pour revenir au menu principal
FIGURE XII. 2
Consultation d'un lexique (ici. Type d'Ouvrage)
XII. 5
1 - CONSULTATION D'UN T.F.yxf^nF.
Après avoir choisi cette option, une fenêtre
s'ouvre, dans laquelle il est possible de choisir le
nom du lexique à consulter.
Utiliser les touches de déplacement vertical
(flèches, PgDn, PgUp, Home et Fin) pour pointer sur un
lexique, puis [ENTER] pour valider le choix.
Les termes du lexique sélectionné apparaissent
alors dans une fenêtre à droite de l'écran (fig.
XII. 2). Appuyer sur n'importe quelle touche pour
revenir au menu des utilitaires .
XII. 6
ACTIF
Fonctions utilitaires diverses
TRAITEMENT A EFFECTUER
Consultation d'un lexiqueEdition lexiques générauxEdition lexiques géologiquesEdition de la configurationTracé des figurés litholog.Edition bordereau de saisie
Création\modif1cat. lexiqueListe ouvrages + désignationFin des traitements
PRESENTATION
(DispositionIVerticale iHorizontale I
Ecriture des 1ex1<^es demandés dans le fichierLEXIK.LST modifiable sous éditeur de texte.
1 TYPE d'OUVRAGE |1 Forage2 Piézomètre3 Sondage4 Puits
5 Pults-foré6 Puits tradit.7 Contre-puits
ETAT de rOUVRAGE
2
"etc
1 I Exploité2 I Sec
OBJET de 1'OUVRAGE
Reconnaissance
ExploitationControle
InjectionInfiltrationRabattement
WOE de FORATION
1 j H.F.T.2 I Rotary
1 USAGE de l'OUVRAGE |1 1 A.E.P.
2 Plézooètrle3 Irrigation4 Industrie5 Qualité eaux6 Dëpol lution7 Géotechnîque8 Pétrolier
9 Minier
10 Recharge art.11 P.A.C.
12 Thermalisme
FLUIDE de FORATION
Air
Eau claire
FIGURE XII. 3
Edition des lexiques
XII. 7
2 - EDITION LEXIQUES GENERAUX OU GEOLOGIQUES
Ces deux options permettent d'imprimer le
contenu des lexiques généraux ou géologiques. L'im¬
pression se fera sur des feuilles 21 x 29,7 en dispo¬
sition portrait (verticale) ou paysage (horizontale) .
Une fois la disposition choisie, les lexiques
sont d'abord imprimés sur le fichier LEXIK.LST,
éventuellement modifiable sous éditeur de texte , puis
envoyés sur imprimante, après confirmation (fig.
XII. 3).
3 - EDITION DE LA CONFIGURATION
Lorsque cette option est validée, la configura¬
tion du logiciel ACTIF (telle qu'elle est présentée à
la figure III. 2) est d'abord envoyée dans le fichier
texte CONFIG. LST, puis imprimée après confirmation.
XII. 8
ACTIFFonctions utilitaires diverses
TRAITEMENT A EFFECTUER
Consultation d'un lexiqueEdition lexiques générauxEdition lexiques géologiquesEdition de la configurationTracé des figurés litholog.Edition bordereau de saisie
Créât 1on\inodif icat. lexiqueListe ouvrages + désignationFin des traitements
CODES A DESSINER
Ensemble des codes sans légendeCodes 1 ê 32 avec légendeCodes 33 Í 64 avec légendeCodes 65 i 96 avec légende
[ESC]: Retour menu principal J
Avant de lancer l'exécution (bi tracé :
Vérifier la position des switchs de configuration de la table traçante
S2 SI Y US A3 B4 83 B2 BI
Umâ I I I I
parité D NET A4 bauds( 9600 )
- Vérifier que la table traçante est bien connectée sur le port série COMÍ
- Mettre en place une feuille de papier A4, rabattre le levier,puis appuyer sur une touche quelconque pour exécuter le tracé ...
- Pliaes utilisées : n*l > Tout le tracé . sauf le cartouche
n*2 Cartouche
TTTfiTTRE XII. 4
Tracé des figurés géologiques : écran de sélection,puis informations affichées avant l'exécution du trace
XII. 9
4 - TRACE DES FIGURES LITHOLOGIOUES
Lors de la saisie de la coupe lithologique dans
la page-écran H, l'utilisateur peut choisir jusqu'à 96
figurés lithologiques , dans la charte décrite en
annexe 2 .
L'option des utilitaires permet de redessiner
cette charte sur un traceur, en choisissant l'une des
options suivantes (fig. XII. 4)
- ensemble des codes sans légende (la chartetiendra alors sur une seule page) ,
- codes avec légende , auquel cas 3 pages serontnécessaires pour l'imprimer.
Avant de lancer 1 ' exécution du tracé , il faudra
prendre soin de vérifier les indications qui appa¬
raissent sur l'écran, et d'effectuer les opérations
nécessaires :
- positionner correctement les "switchs" du
traceur type HP 7475A, compatibles avec lacommande DOS d'assignation du port 1 :
OPEN COM 1, 9600, E, 8, 1, 9.
- placer dans le barillet du traceur les plumes dela couleur désirée.
XII. 10
A ce stage , la procédure de tracé peut être
interrompue (touche ESC) ou poursuivie (toute autre
touche) : dans ce cas, deux phases se succèdent, qui
ne peuvent plus être interrompues :
- constitution d'un fichier texte de tracé, nommé
FIGUR.PLT, qui contient toutes les instructionsnécessaires à l'exécution du tracé ;
- envoi de ce fichier sur le traceur.
5 - EDITION DU BORDEREAU DE SAISIE
Cette option permet d'imprimer un bordereau de
saisie vierge, destiné à être rempli sur le terrain
avant de faire la saisie des données sous ACTIF.
Comme toute édition, un fichier texte est
d'abord créé (nommé BORDACT.LST) avant d'être envoyé
sur 1 ' imprimante . Le bordereau comprend 5 pages , qui
peuvent éventuellement être modifiées sous éditeur de
texte .
XII . 11
6 - CREATION / MODIFICATION DE LEXIQUE
Il s'agit d'une option réservée à la mainte¬
nance. Elle permet de changer le titre d'un lexique et
d'en modifier le contenu. Cette opération n'est pas
sans danger pour l'intégrité des données ; il donc
fortement déconseillé de l'utiliser sans précautions.
XII. 12
Fichiers mémorisés dans le répertoire C:\ACTIF\FICHIERS\
00190019
0019
0019
0019
0019
00190019
0019
0020
0020
0020
0020
0020
0020
0020
0021
0021
-4D-0015
-4D-0266
-4D-0206
-5X-0003
-5X-0044
F4prjtFl
F2
F3
F4
FIBIS
F2BÍS
Fl
Fl
Fl
Fl
F2
F2
F3
F3
Fl
F2
0021-6X-
0021-6X-
0021-8X-
0026-2X-
0027-4X-
0027-6X-
0027-8X-
0027-8X-0028- IX-
0028- IX-
0028-2X-
0028-2X-
0028-4X-0028-4X-
0028-4X-0028-7X-0028-7X-
0029-7X-
0021 Fl
0118 F2
0371 Fl
0057 Fl
9999 F2N
0031
0004 F2
0099 Fl
0007 Fl0167 F2
0227 F3
0257 F3BIS
0428 PZ20429 PZ2
0430 PZlOUI
0112
9998 S2
0029-7X-9999
0035-8X-9999
0036-6X-0017
0037-8X-0149
0038-1X-0031
0038-1X-00880075-6X-0139
0121-4X-0568
0235-3X-04528888-8X-88889999-9X-9999
PageSI
Fl
Fl
Fl
F2
& IXX
F3
23
1/ 1
[ESC]: Retour menu principal
FIGURE XII. 5
Exemple de liste d'ouvrages mémorisés
dans le répertoire des fichiers ACTIF
XII. 13
7 - LISTE DES OUVRAGES -l- DESIGNATION
Cette option permet d'obtenir sur écran ou sur
imprimante , la liste des ouvrages mémorisés dans le
répertoire des fichiers ACTIF, comprenant leur numéro
de classement et leur désignation (fig. XII. 5). Cette
dernière correspond à un code, il est donc possible de
savoir rapidement à quel type d'ouvrage correspond un
numéro BSS donné.
Lors de l'affichage à l'écran, les touches PgDn
et PgUp permettent de faire défiler les pages .
Al. 2
De nombreux messages d'assistance à l'uti¬
lisateur et une série de tests de contrôle sont en
place dans le code du logiciel ACTIF pour en assurer
un fonctionnement aussi fiabe que possible. Il peut
malgré tout arriver que l'utilisateur se voit con¬
fronté à des difficultés de fonctionnement. Celles-ci
sont décrites ci-après, accompagnées des procédures
permettant d'y remédier.
1 - FICHIER MANQUANT
En cours de fonctionnement, le logiciel affiche
le message "fichier non trouvé" et renvoie au système
d'exploitation. Contrôler que les 47 fichiers suivants
se trouvent bien dans le répertoire C :\ACTIF (ou le
répertoire dans lequel a été installé ACTIF) :
- fichier progrnmmes : 13 modules exécutables
ACTIF7.EXE constituent le programme lui-même :
ACTIF0.EXE menu et gestion des différentes options
ACTIF1.EXE saisie des pages A, B, C, 0, E,
ACTIF2.EXE saisie des pages F, G. H, I, J, K, L, M,
tracé des coupes lithologique et techniqueACTIF3A.EXE
ACTIF3B.EXE
ACTIF4.EXE édition du compte rendu sur Imprimante
ACTIF5.EXE tracé de courbe caractéristique
ACTIF6.EXE tracé de diagramme Schoeller Berkaloff
ACTIF7.EXE gestion des f ichlers-diagraphies {saisie,
modifications, suppression, importation de
fichiers ASCII)
Al, 3
ACTIF8.EXE tracé de diagraphies
ACTIF9.EXE exportation de données ACTIF sous forme defichier ASCII
ACTIF10.EXE fonctions utilitaires diverses
fichiers "messages" : chacun des 13 modules -
programmes ACTIFn.EXE est accompagné d'un
fichier ACTIFn.MSF contenant tous les messages
affichés à l'écran, ou édités sur imprimante/
table traçante en cours de fonctionnement (les
fichiers ASCTIF3A.MSF et ACTIF3B.MSF sont
regroupés en xm seul fichier ACTIF3.MSF). Les 12
fichiers -messages suivants doivent donc se
trouver dans le répertoire C:\ACTIF (ou le
répertoire dans lequel a été installé ACTIF) :
ACTIFO.MSF
ACTIFl.MSF
ACTIF2.MSF
ACTIF3.MSF
ACTIF4A.MSF
ACTIF4B.MSF
ACTIFS. MSF
ACTIF6.MSF
ACTIF7.MSF
ACTIF8.MSF
ACTIF9.MSF
ACTIFIO.MSF
fichier pape -écran en outre , 17 fichiers
ACTIF?. GEF correspondent aux. grilles de saisie
utilisées par ACTIF :
Al. 4
ACT I FA GEF page écran A
ACTIFS GEF page écran B
ACTIFC 6EF page écran C
ACTIFD GEF page écran D
ACTIFE GEF page écran E
ACTIFF GEF page écran F
ACTIFG GEF page écran G
ACTIFH GEF page écran H
ACTIF] GEF page écran I
ACTIFJ GEF page écran J
ACTIFK GEF page écran K
ACTIFL GEF page écran L
ACTIFM GEF page écran M
ACTIFN GEF page écran N
ACTIFO GEF page écran 0
ACTIFQ GEF page écran Q
ACTIFR GEF page écran R
identification de l'ouvrage
localisation de l'ouvrage
description du trou nu
description des tubages
description des annulaires
contexte hydrogéologique
description des venues d'eau
coupe lithologique
développement de 1 'ouvrage
pompages d'essai
paramètres physico-chimiques
paramètres géophysiques et/ou diagrapi^sobservations complémentaires
sélection des pages de saisie
choix des pages à modifier
tracé des courbes caractéristiques
couples profondeur-valeur d'une diagraphie
fichiers annexes : 5 fichiers annexes complètent
la série des fichiers constituant le logiciel
ACTIF :
CONFIG. ACT paramètres de configuration du logiciel ACTIF
ACTIF. LEX fichier contenant les différents lexiques appelés en
cours de fonctionnement
AC. BAT fichiers "batch" utilisés pour lancer l'exécution
ACTIF.BAT d'ACTIF
Si certains de ces fichiers sont absents, les
recopier à partir des disqettes originales .
Al. 5
2 - LOGICIEL PROTEGE
A la mise en route, le logiciel affiche le
message "Vérifier que la clef de protection est ...".
S'assurer que la clef de protection est bien enfichée
sur le port parallèle n" 1. Si c'est le cas, s'assurer
que l'imprimante qui y est éventuellement connectée,
est sous tension.
Sortir du logiciel ACTIF, puis relancer son
exécution.
Si le même message s'affiche à nouveau, contac¬
ter le BRGM pour un échange standard de la clef de
protection.
3 - PAS D'EDITION SUR IMPRIMANTE
En option "Edition d'une fiche ouvrage", l'im¬
primante n'édite rien. S'assurer que l'imprimante :
- est sous tension,
- est connectée au port parallèle n* 1 du micro -
ordinateur ,
- est "on line"
Al. 6
Une fois ces trois conditions remplies, mettre
l'imprimante et le micro -ordinateur hors tension.
Remettre sous tension l'imprimante, puis le micro-or¬
dinateur. Relancer la procédure d'édition.
4 - EDITION DEFECTUEUSE
Les caractères semi -graphiques (cadres, symboles
mathématiques) édités sur l'imprimante sont incor¬
rects. Mettre hors tension l'imprimante et le micro¬
ordinateur. Remettre sous tension l'imprimante, puis
le micro -ordinateur. Lancer le logiciel permettant à
l'imprimante d'interpréter correctement les caractères
semi -graphiques (codes ASCII > 127) qui lui sont
envoyés par le micro -ordinateur (ce logiciel peut être
GRAFTABL ou un logiciel spécifique à l'imprimante
utilisée). Relancer ACTIF et la procédure d'édition.
Al. 7
PAS DE TRACE SUR TABLE TRAÇANTE
En option "tracé", la table traçante ne dessine
rien. S'assurer que :
- la table traçante est sous tension et connectée
au port de communication déclaré lors de laconfiguration du logiciel (chapitre III) ;
- la table traçante est en ordre de marche :
. levier d'entraînement du papier abaissé,
. logements n° 1 et 2 du barillet des plumeschargés ;
- le câble de connexion reliant la table traçanteau micro -ordinateur est confomne et en bon
état ;
- l'option de connexion de la table traçante
sélectionnée lors de la configuration du logi¬ciel est l'option 1 (connexion RS-232) oul'option 2 (connexion HP-IL).
- pour une liaison de type RS-232, la configura¬tion de la table traçante (position des switchs)est en conformité avec la commande DOS d'ouver¬
ture du port de communication ; sauf modifica¬tion de l'utilisateur, cette commande se trouve
dans les fichiers AC. BAT et ACTIF. BAT quipermettent de lancer l'exécution du logiciel(chapitre III) .
Si besoin est, remédier au défaut observé.
Mettre la table traçante et le micro -ordinateur hors
tension. Remettre sous tension la table traçante, puis
le micro -ordinateur. Relancer la procédure de tracé.
Al. 8
6 - TRACES DE MAUVAISE QUALITE
Les tracés sont de mauvaise qualité (pâles ,
empâtés , . . . ) , contrôler :
- l'état des plumes n' 1 (diamètre recommandé 0,3mm) et n° 2 (diamètre recommandé 0,7 mm) ;
- la qualité du support utilisé pour les tracés .Le papier glacé recommandé par le fabricant estle meilleur ; à défaut, on peut y substituer dupapier bristol. Par contre, l'usge du "papiermachine" ordinaire est déconseillé, car ce
papier très abrasif provoque une usure rapide
des plumes qui se traduit par une dégradationtrès sensible de la qualité des tracés.
7 - DONNEES SAISIES NON SAUVEGARDEES
Cette "perte de mémoire" a pour cause une
anomalie sur la clef de protection. Se reporter à la
rubrique 2 ci-avant "Logiciel protégé".
A2.1
ANNEXE 2
CHARTE DES FIGURES 6E0L0GI0UES MISE EN OEUVRE
DANS LE TRACE DE LA COUPE 6E0L0GI0UE
Codes à afficher en 3ème colonne
de la page de saisie H
A2.3
B.R.G.M. ACTIF : code des figurés géologiques
1
:ûû*Z'rI:2
3
MTiT-
iiiizTÎTÎ-
4
il S
6
A
teB
g
.10
I»-»-»
I»-»-»tl
* * *
* * *
12
0 0 0
ro°o°13
14
11111 llllll 11111 llllll 11111 18
IIIIIIIIIII IIIIIIIIIII iiiiiiinii IIIIIIIIIII IIIIIIIIIII 18
t - "3 17t'» ^ 1k*~~ ^ 1
|« _' 18
1
19
<i 1 eo
r
ï ' * J 21
1 w w 1 1
"^"^ 22im m" 11 m 1 11* ^Il 1 J 23t.fc1 d ^ 1 1
::: : ^*
^
(
::::[ae
\\\ : ^^
'vHfîK 28
l.>.
i.:>.
k!»; ao
n M n fl^ "L ttj aiB iT i»!* 1
1 A
h*'vl 82
T
1 »
1 1
'H ^ 1
Rî
m
**l 1
n m]1
1"
k<il
1 *» %
V
V 1
l*vhvhV %V %
V 1 1
V 89vl
* I
V
1 v| 1n
T 1 41ri j
-i. JDiJ
1 ij 423îj **
] ^Jl
^ i i 431 ' J
] J .] ] J
j 441 1
,41
1 ] J ] J1 ] 48
1
J 4Br /
\ Í '^^1
[ f / 1
^ 1 471 /
1 / #1
1 i* !£ J 48\m 1 t
! ïTsl
i
lu
ïî:;!
83
84
88
se
87
sa
88
80
81
82
83
«
88«
J&A«MJ 1
N »
%v 88 1N « li
A AAAAA A 87 1A A iA A
::::::::: 88
1 88
70
...'... ...71
t-:-"U .;. ..
72k. .; .;
«ÍM J. ^'
1 *
* * 734
r
{*!1 .. 74!
Uî:*:i
* * 78\* * *l*.*'
+ +
i\V 78u +1 + +
'iîîî*îî*î*î 77
!\*****
78\*****
} !
|l;| j1 79
ivQu<>\*^ 80
l\*\*\
X XXXX
X X
X XX X
um <Ê w
IxSxSxIxSxSx
I* 4- 4.
L.\. \.!
I*
u:
81
82
83
84
88
88
87
\t.\t.
i.\/.
81
82
84