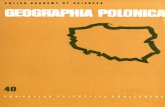Byrsa 1 1979
Transcript of Byrsa 1 1979
Serge LancelJean-Michel CarriéMonsieur Jean DeneauvePierre GrosNicole SanvitiMonsieur Jean-Paul ThuillierFrançoise VilledieuMonsieur Charles SaumagneGérard RobinePhilippe de Carbonnières
Mission archéologique française à Carthage. Byrsa I. Rapportspréliminaires des fouilles (1974-1976)Rome : École Française de Rome, 1979, 372 p. (Publications de l'École française de Rome, 41)
Citer ce document / Cite this document :
Carrié Jean-Michel, Deneauve Jean, Gros Pierre et al. Mission archéologique française à Carthage. Byrsa I. Rapportspréliminaires des fouilles (1974-1976). Sous la direction de Serge Lancel, Avant-propos de A. Beschaouch et G. Vallet. Rome :École Française de Rome, 1979, 372 p. (Publications de l'École française de Rome, 41)
http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/monographie/efr_0000-0000_1979_arc_41_1
COLLECTION DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME 41
RECHERCHES D'ARCHÉOLOGIE AFRICAINE PUBLIÉES PAR L'INSTITUT NATIONAL D'ARCHÉOLOGIE ET D'ART DE TUNIS
MISSION ARCHÉOLOGIQUE FRANÇAISE
À CARTHAGE
BYRSA I
Rapports préliminaires des fouilles (1974-1976)
SOUS LA DIRECTION DE
SERGE LANCEL
PUBLIÉS PAR
JEAN-MICHEL CARRIÉ, JEAN DENEAUVE, PIERRE GROS, SERGE LANCEL, NICOLE SANVITI, JEAN-PAUL THUILLIER et FRANÇOISE VILLEDIEU
avec un texte inédit de CHARLES SAUMAGNE, et la collaboration de GÉRARD ROBINE (relevés d'architecture) et PHILIPPE DE CARBONNIERES (relevés de détails et dessins)
ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME PALAIS FARNESE
1979
Diffusion en France: DIFFUSION DE BOCCARD
1 1 RUE DE MÉDICIS 75006 PARIS
Diffusion en Italie: «L'ERMA» DI BRETSCHNEIDER
VIA CASSIODORO, 19 00193 ROMA
TIPOGRAFIA S PIO X - VIA ETRUSCHI, 7-9 - ROMA
AVANT-PROPOS
En ces lieux que l'histoire dispute à la légende, voilà plus d'un siècle que la pioche remue le sol ... Et pourtant notre incertitude demeure : depuis les temps héroïques de Beulé jusqu'aux grandes découvertes de Charles Saumagne, aucune des belles théories sur la topographie de Carthage n'est parvenue à emporter tout à fait l'adhésion. Mais ces lieux, tout le monde persiste à les nommer Byrsa, puisqu'il est malaisé de trouver une meilleure situation pour l'acropole carthaginoise et, sans doute aussi, parce que les fondateurs du « ribat », dans le Moyen Age musulman, et les bâtisseurs de la cathédrale, à la fin du siècle dernier, ont choisi cette haute colline qui domine le site, face à la mer.
On comprendra, dès lors, que, dans la «Campagne internationale de sauvegarde» organisée par l'Institut national d'archéologie et d'art de Tunis, sous l'égide de l'UNESCO, les archéologues français se soient tout naturellement trouvés en parfait accord avec leurs collègues tunisiens pour soumettre à un nouvel examen la question de Byrsa et tenter, en particulier, d'obtenir des progrès réels dans la connaissance archéologique de Carthage punique. C'était également pour eux l'occasion de remettre en ordre les vestiges d'une zone bouleversée, peu stable et qui serait menacée, à nouveau, si l'effort de présentation était interrompu . . .
Voici donc un premier bilan des travaux de fouille et d'investigation! L'activité si louable de notre ami Serge Lancel nous vaut le grand plaisir de le présenter dans des délais raisonnables. Au delà des résultats scientifiques, importants malgré leur caractère provisoire, on voudra bien voir ici l'heureux effet d'une coopération qualifiée, à juste titre, d'exemplaire. L'on nous permettra surtout d'exprimer notre commune reconnaissance à tous ceux qui ont rendu possible le succès de nos travaux : le maire de Carthage, qui lui devra, à jamais, la résurrection de son passé, S. E. M. Chedly Klibi; les Ambassadeurs de France en Tunisie, M. Georges Gaucher, puis M. Philippe Rebeyrol; les Ministres des Affaires culturelles de Tunisie et, en particulier, S. E. M. Mahmoud Messadi.
Puisse ce premier volume être suivi d'une longue série et contribuer, à sa manière, à illustrer l'amitié franco-tunisienne!
A. BESCHAOUCH - G. VALLET
INTRODUCTION
par SERGE LANCEL
Les travaux de la mission archéologique française à Carthage se situent dans le cadre d'une action internationale de sauvegarde et de mise en valeur du site de Carthage, lancée par l'UNESCO après publication d'une étude réalisée par cet organisme à la demande du gouvernement tunisien (Projet Tunis-Carthage, 1971).
Le 8 juin 1973, le gouvernement français répondait à cet appel et décidait de participer à l'entreprise par la signature d'une entente préalable, complétée en décembre 1974 par l'établissement d'une convention qui liait, sur le plan scientifique, MM. Azedine Beschaouch, directeur général de l'Institut National d'Archéologie et d'Art de Tunis, et André Dupont-Sommer, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, sponsor de la mission française; la ratification de cette convention était elle- même suivie d'un échange de lettres entre MM. Mahmoud Messadi, ministre tunisien des Affaires Culturelles, et Georges Gaucher, ambassadeur de France à Tunis.
Aux termes de l'accord régissant les modalités de la participation française à l'action internationale, valable pour une période de cinq ans venant à expiration le 31 décembre 1978, et éventuellement renouvelable, la mission française a vocation à effectuer des fouilles archéologiques d'une part sur le sommet et les pentes sud et sud-ouest de la colline dite' de Byrsa (titres cadastraux 8104, 21543, 34401, 47872, 34400, 87280, 89411), d'autre part sur une parcelle de terrain appartenant à la commune de Carthage et comprise entre l'avenue Didon et la montée de l'Odèon (titre cadastral 89379) (fig. 1). Cette dernière parcelle occupe, en termes de topographie antique, un peu plus de l'espace
d'une centurie de la Carthage romaine, entre les decumani III et IV nord et les kardines IX et X est; c'est peut-être là qu'il faudrait rechercher les vestiges du Serapeum, et c'est dans ces parages que le P. Delattre, entre 1892 et 1896, a mis au jour et fouillé près d'un millier de tombeaux puniques de la nécropole dite de Douimès. Quant à la colline de Byrsa, autrefois dite de Saint-Louis, elle domine comme on sait de plus de 50 mètres la petite plaine littorale qui s'étend à ses pieds, fermée à l'est par les hauteurs de Bordj Djedid, prolongée au sud par les lagunes du quartier des ports, avant la baie du Kram. Si aucune découverte archéologique décisive n'est encore venue confirmer la thèse généralement admise selon laquelle cette colline était bien le site de l'acropole et du dernier bastion de résistance de la ville assiégée en 146 par les soldats de Scipion, on connaît l'importance - rappelée plus loin, p. 13-39 - des résultats acquis par les fouilles faites sur les pentes est, sud et sud-ouest, pour ce qui est des vestiges puniques. Et il est d'autre part bien établi - cf. infra, p. 41-55 -, notamment à la suite des travaux de Ch. Sauma- gne, que l'axe de la cadastration julienne de Carthage, sa groma, avait été fixé à l'aplomb de l'actuel emplacement du chevet de la basilique moderne, au sommet de cette colline transformée en un vaste plateau et devenue le centre monumental de la cité dès le début de l'époque impériale romaine. C'est assez dire l'importance historique du site, qui justifie qu'on lui ait consacré, après beaucoup d'autres, les premiers travaux des nouvelles fouilles (fig. 2).
Ces travaux sont subventionnés par la Direction Générale des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques du Ministère des Affaires
INTRODUCTION
400 m
Fig. 1 - Plan de situation des fouilles françaises à Carthage (mise au net I.A.M., M. Borély).
fc_
1
/
i / \ i
s
0 20m
1 1
1 1
tJB mlieaunal
\c V
s 4 / A
/
/
A
§1 s
A A
Κ Λ
/
♦'
>
/ / f\ù i y
l
/
*
/ / f
0
^d /
f < f —
:IV9
^E.V EHI 13 Π
EHI 14
S - — k
j
EHI 19 EHI 11 s /
EHI 12 EHI 8 /
/ 5 F.Î* 13
A
' 1 / s r
/
c 3 IV
m
ili ! W
-
î
Fil Fil ^ ̂
19
10 . Fil 11 \
GII 9 GII 2 GII 19 M
Ä^
ι ι
m
ET
Ι ΙΜβ"
GII 10
Gì 10
Hill HH 13 HI
^lll / L 9
ff
! » «III
Hill
/ Hill 10,
/
/
13 θ 5 1 ϊβ
/
14 10 β 2
HS m
/ /
/' 1
15 11 7 3 Ä
IIV7
/
16 12 8 4 Αι
Ä /
/ / / L VI IV
III
Fig. 2 - Mise en place du carroyage sur la pente sud et sud-ouest de la colline de Byrsa avant la reprise des fouilles en 1974 (assem
blage et mise au net I.A.M., M. Borély).
INTRODUCTION
Étrangères, sur l'avis de la commission consultative des recherches archéologiques à l'étranger, et ce nous est un agréable devoir de remercier de leur appui le secrétaire général de cette commission, M. Jean Leclant, membre de l'Institut, le directeur général des Relations Culturelles, successivement MM. Pierre Laurent, Jean Laloy et Roger Vaurs, ainsi que M. Philippe Guillemin, chargé de mission à cette direction. Les travaux de la mission archéologique française à Carthage bénéficient en outre du patronage de M. Georges Vallet, directeur de l'École française de Rome, qui lui apporte sa caution au sein de la commission mixte franco-tunisienne de coopération archéologique et historique, et de M. Roland Martin, membre de l'Institut, sur le rapport duquel le Ministère des Affaires Étrangères a bien voulu créer un poste d'architecte et un poste de dessinateur dont la première affectation à Carthage a considérablement renforcé le potentiel de notre mission. Qu'ils en soient l'un et l'autre très vivement remerciés.
Sur place, nous avons toujours trouvé la plus grande compréhension, ainsi qu'une aide précieuse, auprès des autorités diplomatiques et des responsables de la mission de coopération culturelle, et technique, et d'abord en la personne de l'ambassadeur de France, M. Georges Gaucher, puis M. Philippe Rebeyrol, du conseiller culturel, M. Alain Bry, puis M. Michel
Leveque, de l'attaché culturel, successivement MM. René Gachet, Claude Schopp et Paul Béda- rida : qu'ils veuillent bien trouver ici l'expression de notre gratitude.
Enfin, qu'il nous soit permis de saisir cette occasion de remercier de leur amical concours et de leur bienveillante attention à nos travaux ceux sans inlassable action desquels cette campagne internationale de sauvegarde et de mise en valeur du site de Carthage n'aurait pu se développer, M. Azedine Beschaouch, directeur général de l'Institut d'Archéologie et d'Art de Tunis, M. Abdelmajid Ennabli, conservateur en chef du musée et du site de Carthage, Mme Mou- nira Harbi-Riahi, secrétaire général du Centre de la Recherche Archéologique et Historique, puis directrice adjointe de ΓΙ.Ν.Α.Α. et leurs collaborateurs, notamment Mmes Liliane Ennabli, chargée du Centre de documentation archéologique de Carthage, et Chedlia Annabi, son adjointe. Et qu'ils nous permettent d'ajouter que la qualité des rapports très confiants que nous avons avec eux est un gage de succès pour nos entreprises, tout comme la gentillesse et le dévouement de ceux, ouvriers et gardiens, permanents ou saisonniers, qui sont quotidiennement mis avec nous sur le terrain à l'épreuve des faits et des choses.
Serge LANCEL
AVERTISSEMENT
Le parti, pris au printemps de cette année 1977, de publier les résultats des nouvelles fouilles françaises à Carthage dans une série de volumes qui paraîtront sous le double patronage de l'Institut National d'Archéologie et d'Art de Tunis et de l'École française de Rome répond notamment au vœu conjointement formulé par ΙΊΝΑΑ et l'UNESCO que les publications des travaux réalisés dans le cadre de la campagne internationale de sauvegarde et de mise en valeur du site de Carthage ne soient pas dispersées, mais rassemblées dans des volumes de même format, sous une jaquette uniforme, qui traduiront concrètement la volonté commune qui a présidé à l'entreprise. On ne saurait trop remercier ici l'équipe scientifique de l'École française de Rome et son directeur d'avoir accepté volontiers ce surcroît de tâche et cette charge supplémentaire : que M. Georges Val- let veuille bien trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance, ainsi que M. Michel Gras, directeur des études pour l'Antiquité, et Mlle Marianne Guadagnino, secrétaire de rédaction : le présent ouvrage leur doit beaucoup.
On y retrouvera, mais dans son complet développement, le rapport préliminaire sur les campagnes de 1974 et 1975, publié en une première version abrégée dans Antiquités Africaines, t. 11, 1977. Que ce rappel nous soit une occasion de remercier ici la direction et le comité de rédaction de cette revue de nous avoir alors fait place si libéralement. Si généreux qu'ait été cet accueil improvisé, il imposait cependant des limites aux différents rédacteurs, qui font ici paraître leurs textes in extenso. Cette seconde publication des rapports de 1974 et 1975 n'est donc pas un simple doublet. On y retrouvera naturellement une présentation
en trois parties sous la responsabilité de rédacteurs distincts, ce qui correspond à l'articulation réelle de la fouille en cette première phase de nos travaux. Rappelons que la fouille dans le secteur A a été menée par Serge Lancel avec le concours en 1974 de Mlles Roseline Bret, Anne-Marie Bumbalo et Elisabeth Lafaye, en 1975 avec le concours de Mlles Joëlle Bara et Elisabeth Lafaye, et de M. Jean-Louis Tilhard; dans le secteur B, les travaux ont été dirigés par Jean-Michel Carrié, avec le concours en 1974 de Mlles Roseline Bret et Elisabeth Lafaye, et en 1975 conjointement avec Mlle Nicole Sanviti; dans le secteur C, enfin, la fouille a été menée par Jean Deneauve, avec le concours en 1975 de Mlle Françoise Villedieu.
Ce découpage par secteurs, A, Β et C, initialement réalisé par commodité afin de délimiter les tâches sur le terrain, n'excluait pas la poursuite d'objectifs méthodiques, en fonction d'une problématique ou de centres d'intérêts appelés à se substituer au découpage strictement spatial. En 1976, avec une équipe restructurée et renforcée par de nouvelles participations - celle de Pierre Gros, codirecteur responsable de la recherche sur les niveaux et vestiges d'époque romaine, celle de Jean-Paul Thuillier, qui assiste le chef de mission responsable de la fouille sur les niveaux et vestiges puniques -, on a fait coexister le découpage «vertical» par secteurs avec une organisation plus souple, qui a donné par exemple à P. Gros la possibilité d'intervenir sur telle structure d'époque romaine du «secteur A» (cf. infra, p. 277-280). A l'avenir, on généralisera cette répartition des tâches et cette division du travail, en fonction des deux séries de niveaux essentiellement représentées sur la colline, les niveaux puniques et les
10 AVERTISSEMENT
niveaux d'époque romaine, haute et tardive^. Et l'on sait que la radicale solution de continuité entre les deux séries de niveaux créée par l'interposition d'un épais remblai rapporté à l'époque augustéenne rend plus facile à Byrsa que partout ailleurs à Carthage de traiter séparément les deux séries de niveaux.
En 1974 et 1975, le chantier de Byrsa a reçu de l'Institut d'Archéologie Méditerranéenne d'Aix-en- Provence un concours limité qui a cependant permis son démarrage. Nous en remercions ici le directeur de ce laboratoire associé du C.N.R.S., M. Euzennat, et les techniciens qui sont venus sur le terrain : en 1974, M. Jean-Marie Gassend; en 1975, M. Gilbert Rallier, M. André Carrier-Guillo- met, M. Maurice Borély, M. Antoine Chéné. Depuis le mois de juillet 1976, grâce à deux postes créés par la Direction Générale des Relations Culturel-
' On ne peut citer le niveau médiéval musulman que pour mémoire, car il n'en subsiste plus que quelques éléments en sous-sol, inclus dans le remblai rapporté d'époque romaine, fonds de citernes et de silos (cf. infra, p. 74-75). Le matériel céramique qu'on y recueille est parfois abondant, mais le contexte stratigraphique en est perdu.
les du Ministère des Affaires Étrangères sur rapport de M. Roland Martin, la mission bénéficie du concours à temps plein d'un architecte, Gérard Robine, et d'un dessinateur-archéologue, Philippe de Carbonnières. Ce renfort a considérablement accru l'efficacité de notre mission.
Un mot encore sur l'avenir envisageable de cette série de publications. H est prévu qu'un second volume, Byrsa II, rendra compte de façon préliminaire des campagnes de 1977 et 1978. Après devront venir, pour continuer la série, les études de fond sur ce dont les rapports préliminaires n'auront pas épuisé la matière : les structures et niveaux puniques et romains, envisagés dans leur cohérence organique et chronologique, les architectures, et le matériel, regroupé par séries homogènes. Souhaitons donc de nombreux volumes à cette série que nous appelons Byrsa, avec - sans en faire un pari - le secret espoir que ce titre soit pleinement justifié, et qu'ainsi cette colline si souvent déjà scrutée soit enfin assurée par la grâce des certitudes archéologiques de la prestigieuse identité que suggèrent si fortement la tradition et l'histoire.
S. L.
LES NIVEAUX ET VESTIGES PUNIQUES DE LA COLLINE DE BYRSA
HISTORIQUE DES RECHERCHES
par SERGE LANCEL
II est peu de sites de la Méditerranée occidentale qui aient été depuis si longtemps scrutés que cette colline qui s'appelait autrefois colline de Saint-Louis, et qu'il est convenu maintenant de désigner sous le nom de colline de Byrsa. A l'époque où N. Davis explorait la petite plaine littorale encore déserte pour le compte du gouvernement britannique, c'est Beulé, plus connu comme découvreur des Propylées de l'acropole d'Athènes, qui avait, en 1859 et pour son propre compte, entrepris les premières fouilles sur la colline. Plus tard, en 1880, c'est là que le P. Delat- tre devait faire ses premières armes et, par la suite, les Pères Blancs, installés sur place, s'y trouvèrent à pied d'œuvre pour des recherches poursuivies durant de longues années, depuis le P. Lapeyre, dans les années 30, jusqu'au dernier fouilleur en date, le P. Ferron, avec la collaboration de M. Pinard, de 1952 à 1959. Entretemps, cependant, d'autres que les Pères Blancs avaient aussi apporté leur contribution à notre connaissance du site : ainsi Ch. Saumagne, qui travailla en différents points de 1924 à 1933, et Mme C. Picard, qui fit une campagne de fouilles en 1947. En dressant le bilan de cet héritage, on se limitera ici à l'exposé des résultats obtenus sur les niveaux et les vestiges puniques1.
Il faut le dire tout de suite : à Byrsa comme ailleurs à Carthage, le premier objectif des explorateurs des ruines de la cité antique fut d'abord, sinon exclusivement, la découverte des
restes de l'époque punique. Sur ce qui était alors la colline de Saint-Louis, immédiatement identifiée comme le site de l'acropole en fonction des données de la topographie et des descriptions des auteurs anciens2, ce fut tout naturellement la citadelle et les monuments publics de la ville haute, ainsi que son enceinte, que l'on ambitionna de mettre au jour. On verra plus loin comment Beulé manqua son but en croyant l'atteindre, à une époque où le terrain était largement disponible, mais la connaissance du site très insuffisante, et les méthodes de travail inadéquates.
A la fin du XIXe siècle, ajoutant ses effets à la confiscation qui s'était déjà produite lors de l'édification de la chapelle de Saint-Louis et de son enclos octogonal, la construction de la basilique, du grand séminaire et de ses vastes annexes, ainsi que l'aménagement des voies de desserte, interdisait pratiquement toute recherche sur les trois-quarts du plateau supérieur de Byrsa. Sur les pentes, notamment sur la pente sud-est, si bien exposée, les premières maisons n'allaient pas tarder à s'élever. Dès lors, si l'on
1 On trouvera ci-dessous, p. 41-55, l'historique des recherches concernant les structures romaines de la colline de Bvrsa.
2 Nous n'exposerons pas ici en détail les raisons qui militent en faveur d'une identification de l'ex-colline de Saint- Louis avec le site antique de Byrsa. Pour Beulé (Fouilles à Carthage, Paris, Impr. Imp., 1861, p. 28-31), cette identification n'était pas plus douteuse qu'elle ne l'était pour Chateaubriand, Humbert, Falbe et Barth, avant lui. Le dossier, fondé essentiellement sur les considérations topographiques et les témoignages des auteurs anciens, ne s'est enrichi d'aucun indice archéologique décisif depuis l'exposé très complet qu'en a fait A. Audollent, Carthage romaine, Paris, 1901, p. 267-273 (recueil de textes antiques relatifs à la topographie de Carthage, p. 775-792).
14 BYRSA I
excepte les travaux si ingénieusement menés, et de façon si fructueuse, entre 1924 et 1931, par Ch. Saumagne dans son propre terrain et dans la zone avoisinante, la recherche fut confinée de fait sur les pentes sud et sud-ouest, et n'eut jamais le caractère d'une exploration systématique. De sorte que, si, à l'heure du bilan, nous pouvons plus loin faire apparaître que ces travaux menés en ordre dispersé ont eu pour effet de faire connaître, pour les époques puniques, d'une part des niveaux et des vestiges funéraires - avec une dispersion chronologique assez sensible -, d'autre part des niveaux et des structures d'habitat tardif, il paraît plus expédient, avant d'en faire la synthèse, de présenter les résultats obtenus par les fouilleurs successifs en fonction de la topographie du site, et dans l'ordre chronologique.
I - Le plateau et les pentes sud et sud-ouest
1) Les fouilles de Β e ul é .
A l'époque où Beulé vint fouiller à Carthage, en 1859, le sommet de la colline présentait un plateau uni, moins désert et moins nu que ne l'avait vu Chateaubriand au début du siècle3, mais disponible encore pour la recherche archéologique, si l'on excepte la chapelle gothique dédiée au souvenir du roi croisé et l'enclos qui l'entourait, dont le jardin de l'actuel Musée National de Carthage conserve, avec la même superficie, la forme octogonale. Sur ce plateau alors encore à peu près rectangulaire, comme à la fin de l'Antiquité4, Beulé pratiqua d'abord
quelques sondages, guidé pour le choix de leur emplacement par la préoccupation de retrouver l'enceinte de la Byrsa punique. Les sondages qu'il fit au centre du plateau, en arrière des dépendances de la chapelle, eurent au moins le mérite de faire reconnaître dès cette époque le niveau du sol naturel sous le sol de l'esplanade, lequel devait alors se situer sensiblement à la même cote qu'aujourd'hui, soit à 56 m. Il trouva la «roche», ce noyau de grès tendre, d'argile et de marne blanche qu'il décrivit fort bien, à des profondeurs variant entre 1 m, 50 («fouille J», vers la pente sud-ouest), 2 m, 36 («excavation B»), 3 m, 20 («excavation C») (fig. 1)\ Le plus profond de ces sondages, à l'angle sud-est du plateau («sondage F»), fut lancé à travers des terres rapportées jusqu'à une profondeur de 19 m avant de rencontrer le sol vierge6.
C'est cette dernière excavation qui lui suggéra d'aller chercher sur la pente méridionale de la colline les fortifications puniques qu'il désirait retrouver : ce fut la « fouille G », faite en gradins descendant vers la plaine, sur un front d'une quarantaine de mètres de largeur7. Arrivé au terme de sa fouille, Beulé trouva bien un mur, qu'il prit pour l'enceinte qu'il cherchait : il s'agissait en réalité d'une série d'absides - dont une à parement en opus reticulatiim - dont l'extrados contenait la poussée des terres rapportées lors des vastes terrassements entrepris à l'époque augustéenne8. Et cet alignement de soutènements d'époque romaine a de fait disparu, débité par les chercheurs de pierres, à l'endroit où ce négatif permet de situer précisément la «fouille G» de 18599. Beulé avait cependant, dans les derniers mètres de sa fouille, un peu en
' Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem, VIIe partie, éd. de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1969, p. 1202 : «Pour aller des citernes publiques à la colline de Byrsa, on traverse un chemin raboteux. . . Le sommet de l'Acropole offre un terrain uni, semé de petits morceaux de marbres, et qui est visiblement l'aire d'un palais ou d'un temple. Si l'on tient pour le palais, ce sera le palais de Didon; si l'on préfère le temple, il faudra reconnaître celui d'Esculape». On notera en passant que l'autorité du grand écrivain a influencé la recherche archéologique durant tout le XIXe siècle.
4 Beule, Fouilles à Carthage, Paris, 1861, p. 5 : «La forme de Byrsa est à peu près rectangulaire». Beulé réfute ici l'opinion soutenue par Barth (Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeers in 1845-1847, Berlin, 1849, p. 93)
selon qui cette forme ne pouvait qu'être due à des terrassements artificiels; il constate pourtant lui-même (p. 42) avoir traversé, lors de son «sondage F», 19 mètres de terres rapportées qui avaient peu de chances d'être toutes des couches de décombres en place.
' Beulé, Fouilles à Carthage, p. 41-42. On verra (infra, p. 23) que ces niveaux ont été contestés par le P. Delattre.
6 Ibid., p. 42. 7 Ibid., p. 45-66 et p. 79. s Ibid., p. 56-61, pi. 1 (reproduite ici fig. 1), et pi. II, fig. 1.
Sur la signification et le contexte de ces structures d'époque romaine, cf. infra, p. 48-49.
y Le long du petit côté sud-ouest du rectangle formé par le deciunanus I sud et les katdines II et III est, ou encore dans les carrés F II, G II et H I de notre carroyage.
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 15
e. . Cnambresr* Π
Crosmur dont les llocs ont été enlevés·
> ^ Ruines, »vcûtes écroulées
fyOros délris de ilocage Massif considerarle
avec de grosses pierres Orifice de citerne Ο
Grandes aternes effondrées
Endroit » . o couvert de ruines! I "" Rujne3 supposées
dPis dej)iion Ruine* et blocage
Mur détruit Β par les Arabes g ,
Orifice Ode citerne Fouilles G·. les foTtifi citions de Byrea M r J Massit carre Emplacement supposé [ 1
β de Jupiter i ι Fouilles J
b — Isr PLAN DE BYRSA.
Fig. 1 - Les fouilles de Beulé à Byrsa (Fouilles à Carthage, pi. I).
16 BYRSA I
Î-LL...D π ω α
'23 24 25
9,',28i π 27 _πππ
4
10 20m
Fig. 2 - La nécropole de la pente sud-ouest de la colline de Byrsa : fouillei> Delattre (D), Lapeyre (L), Ferron-Pinard (F-P); en poché noir, vestiges puniques (assemblage S. Lancel).
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 17
arrière de l'extrados des absides, rencontré de bien réels vestiges puniques : non point ceux de Γ «intérieur des murs de Byrsa»10, comme il le croyait, mais ceux des maisons établies sur la pente de la colline, et dont le P. Ferron et M. Pinard devaient, près d'un siècle plus tard, retrouver tout un quartier, sur la même pente, mais un peu plus en amont".
2) Les fouilles du Ρ . Del altre.
En 1893, le P. Delattre reprit la fouille dans le secteur qui vient d'être évoqué, à proximité du terrain fouillé par Beulé, en direction de l'angle sud-est de la colline, zone depuis soustraite à la recherche par la construction de la villa Salammbô : c'est là qu'il devait découvrir un énorme dépôt d'amphores formant drain et soutènement supplémentaire en arrière des extrados des absides déjà décrites par Beulé12. Mais, à la différence de ce dernier, il ne rencontra pas là de vestiges d'habitat domestique d'époque punique et son nom, on le sait, était déjà attaché à la découverte des habitations des morts, sur cette même pente sud de Byrsa, mais du côté occidental.
2.1.) La nécropole du flanc sud-ouest.
La découverte de la nécropole punique du flanc sud-ouest de la colline est une histoire longue de près de vingt années, riche de détours et de retours, qui justifie un mot malicieux mais prophétique du regretté G. Ville11. Les tombes
111 Beulé, Fouilles à Catthage, p. 54. 11 Beulé, Fouilles à Carthage, p. 55-59. La description de la
couche d'incendie, des débris de sols, des fragments de stucs architecturaux et du matériel céramique trouvé dans la fouille (céramique punique tardive, céramique hellénistique à vernis noir) ne laisse aucun doute sur la nature des vestiges rencontrés là par le fouilleur.
12 A.L. Delattre, Un mur à amphores romain découve it à l'angle sud de la colline de Byrsa, dans CRAI, 1893, p. 152; Le mur à aniphotes de la colline Saint-Louis de Caithage, dans BCTH, 1894, p.89-119. Sur ces structures, cf. infra, p. 48-49.
n G. Ville, Dictionnaire de l'Archéologie, Paris, Larousse, 1968, p. 6 : «Déjà ceux qui vont travailler sur Carthage savent qu'il leur faudra parfois, pour situer telle inscription, telle pierre, refaire la biographie du R. P. Delattre, qui fut le plus célèbre fouilleur et massacreur de la ville antique». On manquerait cependant à l'équité en n'ajoutant pas que les méthodes du P. Delattre étaient celles de son temps (qui ne connaît à Carthage la fameuse et dévastatrice «tranchée»
fouillées dans ce secteur par le P. Delattre de 1880 à 1897 ont été publiées - et plus souvent simplement signalées - dans diverses publications qui, le plus souvent, se répètent les unes les autres. Un seul plan de l'ensemble du secteur : celui de Bonnet-Labranche, publié dans le Bulletin Archéologique du Comité de 1893, repris dans Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896. S'y ajoutent, outre quelques clichés photographiques, un plan de détail pour les tombeaux 1, 5, 6, 9, 12 u, ainsi que quelques schémas de situation et relevés de plusieurs sépultures dus à l'officier de marine Aude- mardls. Ce cheminement compliqué à travers les publications multiples et peu précises du P. Delattre a été refait très récemment avec la plus grande exactitude possible par Mme H. Benichou-Safar16. Dans le plan que nous donnons ici (fig. 2), nous avons suivi la numération qu'elle a affectée aux tombes de ce secteur (fig. 3), avec quelques différences dont nous nous expliquons dans l'inventaire ci-dessous. Dans la mesure du possible, la brève notice consacrée à chaque tombe fait mention de la datation approximative qu'on peut lui attribuer, la plupart du temps avec la plus grande prudence, car on ne peut trop se fier aux descriptions vagues du fouilleur, et, par ailleurs, dans les clichés et dessins qui illustrent assez sommairement ces publications, les mobiliers des différentes sépultures ne sont presque jamais individualisés17.
de S. Reinach et E. Babelon : BCTH, 1886, p. 4-40?), et que c'est à son action que l'on doit d'avoir été maintenus dans le domaine public de larges secteurs de la zone archéologique de Carthage, où de ce fait la recherche est encore possible aujourd'hui.
14 Dans Les tombeaux puniques de Carthage, Lyon, 1890, p. 69, reproduisant Rev. Arch., XV, 1890, p. 9.
15 Cf. Les tombeaux puniques de Carthage, Lyon, 1890, p. 54, 55, 57, 61, 72, 73; BCTH, 1893, p. 108, 109; Rev. Arch., XV, 1890, p. 9 (tombe 12); XVII, 1891, p. 55. On se reportera aux références indiquées ci-dessous dans la courte notice de chaque tombe.
1(1 H. Benichou-Safar, Carte des néciopoles puniques de Carthage, dans Karthago, XVII, 1976, p. 12-14, 24-25 et 30-31.
17 Un seul exemple, celui de la planche photographique publiée dans Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 25 : sur cette planche intitulée «poteries diverses trouvées dans les tombes», on voit figurer côte à côte de la céramique protocorinthienne et de la céramique hellénistique; le n° 1 1 de la planche, un arvballe corinthien, provient en fait de la colline de Junon (cf.
18 BYRSA I
Tombes Ferrea- PLmri-
(/955 -s*)
mur punirvi At/on
mmmmm^
1930-1935 /e cerc/e )
Fouilles
Fouilles DelattrE 1880-1895 Les ni'Ji 6ori/f-fc rt tivoient <>v supplément ί
ί J
Dec. r. Sud.
foist commune 25
Fig. 3 - La nécropole de la pente sud-ouest de la colline de Byrsa : fouilles Delattre, Lapeyre et Ferron-Pinard (assemblage H. Benichou-Safar, dans Karthago, XVII, 1976, fig. IV, p. 15).
1) Tombeau construit (dim. int. : 2 m χ 0 m, 68 de larg. et 1 m de haut.) fouillé le 1er août 1889 au nord de la fondation en opus caementicium. Réf.: Rev. Arch., XV, 1890, p. 9 (plan de situation) et 12-13 (texte). Deux inhumations superposées; datation approximative du matériel : fin VIIe, début VIe. Autres réf. : CRAI, 1889, p. 15-16; Les tombeaux puniques de Carthage, Lyon, 1890, p. 64-66; Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 91.
S. Boucher, Céramique archaïque d'importation au musée Lavigerie de Carthage, dans Cahiers de Byrsa, III, 1953, p. 16).
2) Tombeau construit (dim. int. : 2 m, 04 χ 1 m, 54 de larg. et 1 m, 73 de haut), découvert violé. Réf. : Les tombeaux puniques de Carthage, Lyon, 1890, p. 68; BCTH, 1893, p. 110. Datation probable (un fragment de lampe à deux becs) : fin VIIe-début VIe.
3) Tombe à fosse creusée dans le sol à la dimension d'un adulte, et recouverte de dalles. Réf. : Les tombeaux puniques de Carthage, Lyon, 1890, p. 67. Datation approximative : fin VIIe- début VIe.
4) Inhumation d'enfant dans une amphore placée au-dessus de 3 (même réf.). Datation probable : IVe-IIIe (guttus ou «vase-biberon»).
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 19
5) Sarcophage en calcaire coquillier (dim. ext. : 2 m, 20 χ 0 m, 78 de larg. χ 0 m, 57 de haut.; dim. int. : 1 m, 83 χ 0 m, 42 de larg. χ 0 m, 37 de haut.) fouillé le 7 juin 1889. Réf. : Rev. Arch., XV, 1890, p. 8, 9 et 11; Les tombeaux puniques de Carthage, Lyon, 1890, p. 59-63. Datation approximative : VIIe-VIe siècle.
6) Le «tombeau punique de Byrsa», tombeau construit fouillé en 1880 (dim. int. : 2 m, 68 χ 1 m, 58 de larg. χ 1 m, 80 de haut.). Réf. : Bull. trim, des Ant. Afric, III, 1885, p. 241-246 et pi. XXIV-XXV; Rev. Arch., XV, 1890, p. 9 et 11 et fig. 1; Les tombeaux puniques de Carthage, Lyon, 1890, p. 22-31. Datation approximative: fin VIIe- début VIe siècle18.
7) Tombeau construit (dim. int. : 2 m, 29 χ 1 m, 75 de larg. χ 1, m, 63 de haut.) fouillé en 1890, contenant deux sarcophages. Réf.: BCTH, 1893, p. 107-109 («tombe S»), Tombe ouverte dans l'Antiquité, non datable.
8) Amphore de forme cylindrique à base conique et sans col, contenant les «ossements d'un adulte et d'un enfant ne portant aucune trace de crémation, puis, au fond, des ossements calcinés d'un autre enfant accompagnés d'une petite bague en argent, d'un biberon et d'un vase noirci par l'action du feu» : A. L. Delattre, BCTH, 1893, p. 107; cf. également Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 64-65. Datation probable: IVe-IIIe siècles19.
9) Tombeau construit (dim. int. : 2 m, 40 χ 1 m, 60 de larg. χ 1 m, 60 de haut.) fouillé le 19 octobre 1888. Réf.: Les tombeaux puniques de Carthage, Lyon, 1890, p. 48-59; cf. aussi BCTH, 1893, tombe X sur le plan Bonnet- Lab ranche, et M. de Vogue, Rev. Arch., XIII, 1889, p. 169-173 (plan). Datation approximative: VIIe- VIe siècles. Cf. infra, fig. 4, p. 50.
10) Groupe d'amphores utilisées comme sépultures à inhumation pour des enfants. Réf. :
18 Aussi bien le P. Delattre (cf. Bull. trim, des Ant. Afric, 1885, p. 241) que M. de Vogue (Rev. Arch., XIII, 1889, p. 164) affirment que ce tombeau a été découvert lors de la construction de la cathédrale, alors qu'il en est en fait très éloigné. Il semble bien en réalité que la recherche de matériaux pour la construction de la cathédrale ait été à l'origine de la découverte de ce tombeau.
ll) C'est à tort, nous semble-t-il, que Madame H. Bénichou- Safar, interprétant la description au demeurant peu claire du P. Delattre, a vu là deux amphores distinctes, ses numéros 8 et 9 dans Karthago, XVII, 1976, p. 31.
BCTH, 1893, p. 111 et plan (lettre d); cf. aussi Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 70-71 (cliché p. 71); Bull, de la Soc. de Géogr. et d'Arch . . . d'Oran, 1898, p. 1 et pi. IV, n° 9. Datation probable : IVe- IIIe siècles.
11) Tombeau construit. Réf.: BCTH, 1893, p. 110 et plan (lettre Y). Aucune autre précision sur cette tombe aujourd'hui remblayée ne figure dans les diverses publications du P. Delattre20.
12) Tombeau construit (dim. int. du compartiment supérieur au-dessus des sarcophages : 2 m, 35 χ 1 m, 95 de larg. χ 1 m, 1 1 de haut.) fouillé le 19 août 1889. Réf. : Les tombeaux puniques de Carthage, Lyon, 1890, p. 69-79; cf. aussi Rev. Arch., XV, 1890, p. 13-15; Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 84-87 (avec clichés d'une œnochoé de bronze doré, élément le plus saillant d'un mobilier datable des VIIe-VIe siècles; sur cette œnochoé, cf. aussi M. de Vogue, Rev. Arch., XXII, 1893, p. 136-137); en dernier lieu, cf. C.Picard, dans Rev. Arch, 1959, p. 29-32, qui la date du Ve siècle (fig. 4).
13) Tombeau construit (dim. int. du compartiment supérieur : 2 m, 30 χ 1 m, 75 de larg. x 1 m, 35 de haut.) fouillé le 4 juillet 1890. Réf. : Rev. Arch., XVII, 1891, p. 52-59; cf. aussi BCTH, 1893, p. 110 et plan (lettre Y); Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 16-28. Datation approximative : fin VIIe- début VIe siècle.
14) Fosse à inhumation. Réf.: Rev. Arch., XVII, 1891, p. 53; Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 21. Mobilier indatable.
15) Fosse à inhumation fouillée le 16 novembre 1890. Réf.: Rev. Arch., XVII, 1891, p. 69; Carthage. Nécropole punique de la colline
20 Mention est cependant faite de ce tombeau dans un ancien guide de Carthage : Carthage autrefois, Carthage aujourd'hui, description et guide, par deux Pères Blancs, 4e édit., Tunis, 1921, p. 85 : «La chambre funéraire est de facile accès, car toute la façade a été détruite, sans doute par les Romains. Lors de la découverte, ce tombeau était rempli de terre; aujourd'hui, il est complètement vide. Au fond, deux niches carrées étaient destinées à contenir des vases funéraires». La violation ancienne de cette tombe explique que la découverte n'en ait pas été autrement mentionnée dans les publications du P. Delattre.
20 BYRSA I
Fig. 4 - Vue partielle, à la fin du XIXe siècle, des tombes des fouilles Delattre (les numéros portés sur le cliché sont ceux du présent catalogue).
de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 42. Datation : VIIe siècle.
16) Fosse à inhumation fouillée le 14 novembre 1890. Réf.: Rev. Arch., XVII, 1891, p. 67-69; Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 40-42. Datation approximative : VIIe- VIe siècles.
17) Fosse à inhumation recouverte de dalles, fouillée le 4 octobre 1890. Réf.: Rev. Arch., XVII, 1891, p. 61-67; Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 31-40. Mobilier daté du VIe siècle par une œnochoé du Corinthien moyen (cf. S. Boucher, dans Cahiers de Byrsa, III, 1953, p. 28, n° 112)21.
21 Grâce à l'obligeance de M. F. Chalbi, attaché de recherche à Π.Ν.Α.Α., et à celle de M. A. Ennabli, conservateur en chef du Musée de Carthage, nous avons pu revoir une partie du matériel de cette tombe, un des rares qui soient reconsti- tuables (cf. Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, planche reproduite p. 33) : il comporte notamment une coupe ionienne qui confirme sa datation au VIe siècle.
18) Tombe à auge, encore visible aujourd'hui, qui figure sur le plan Bonnet- Labranche publié dans BCTH, 1893, et sur différents clichés. Mais la fouille de cette tombe n'est relatée dans aucune des publications du P. Delattre. On remarquera qu'elle se trouve en limite du front de fouille indiqué sur le plan publié en 1893 (fig. 2 et 5).
19) Tombe à auge (mêmes dim. que 20, ci- dessous), fouillée le 30 septembre 1890. Réf.: Rev. Arch., XVII, 1891, p. 61-62; Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 30-31. Il s'agit d'une tombe remployée: l'inhumation primitive est datable des VIIe-VIe siècles, les remplois (plusieurs squelettes) sont datables des IVc-IIIe siècles (une monnaie, des balsamaires tardifs).
20) Tombe à auge (dim. int. : 2 m, 20 χ 1 m, 23 de haut, χ 0 m, 63 de larg.) fouillée le 28 août 1890. Réf.: Rev. Arch., XVII, 1891, p. 58-61; Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 28-30. Tombe remployée, inhumation primitive datable des VIIe- VIe siècles.
U\ SIECLE DE TOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 21
21) Fosse à inhumation (larg. : 0 m, 35) recouverte de dalles (fouilles de 1889-1890). Réf.: BCTH, 1893, p. Ill; Carthage. Nécropole piinicjite de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 70. Matériel datable approximativement des VIP-VI^ siècles.
22) «Fosse commune» s'étendant sur une assez vaste superficie (non précisée) dans les niveaux supérieurs à ceux des tombes suivantes. Réf. : BCTH, 1893, p. 1 14-1 18; Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 77-80. «Plusieurs centaines de squelettes», disposés sur plusieurs strates; plus de 200 monnaies mises au jour, datables jusqu'au début du IIe siècle.
23) Tombe à auge (dim. int. : 2 m, 20 χ Im, 25 de haut. xOm, 70 de larg.); fouilles antérieures à 1891. Réf.: BCTH, 1893, p. 1 13-1 14; Cartilage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 74; Bull, de la Soc. de Géogr. et d'Arch . . . d'Oran, 1898, pi. II. Tombe remployée contenant plusieurs squelettes; inhumation primitive datable fin VIIe-début VIe; remplois datables IVC-IIIC siècles.
24) Tombe à auge (dim. int. : 2 m χ 1 m de haut, χ 0 m, 65 de larg.). Réf. : BCTH, 1893, p. 1 14; Cartilage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 74-77; Bull, de la Soc. de Géogr. et d'Arch... d'Oran, 1898, pi. III. Tombe remployée; inhumation primitive datable des VIIe-VIc siècles, remplois des IVC-III° siècles.
25) Tombeau construit, «incomplètement exploré»: BCTH, 1893, p. 113 (lettre C" sur le plan); Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 74. Non datable.
26) Fosse à inhumation couverte de dalles, «incomplètement explorée» : BCTH, 1893, p. 113 (lettre b" sur le plan); Cartilage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 74. Non datable.
27) Tombeau construit (dim. non indiquées). Réf.: BCTH, 1893, p. 112-113; Carthage. Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, Lyon, 1896, p. 70-75; Bull, de la Soc. de Géogr. et d'Arch... d'Oran, 1898, plan et reproduction d'un partie du matériel en place, pi. I. Tombe remployée à de nombreuses reprises; le fouil-
Fig. 5 - Vue partielle, en 1935, des tombes des fouilles Delattre (l'axe du cliché est dirigé \ers le nord).
22 BYRSA I
i t -r â m* · Jf
•""Λ γΤΛ" * »* *_ "
wSÈÊÊÊm^
Fig. 5 bis - Vue partielle, en 1975, des tombes des fouilles Delattre (cliché I.A.M., Chéné).
leur signale une quarantaine de squelettes; le matériel s'échelonne d'une part entre le VIIe et le VIe siècles, d'autre part entre le IVe et le IIIe; rien n'est datable entre la fin du VIe et le Ve siècle.
28) Tombeau construit fouillé le 28 janvier 1897. Réf. : Bull, de la Soc. de Géogr. et d'Arch . . . cl'Oran, 1898, p. 142-144 et pi. IX, X, XI, XII. Tombe remployée, inhumation primitive datable des VIIe-VIe siècles, puis réinhumations nombreuses (30 à 40 squelettes) accompagnées de matériel des IVe et IIIe siècles (balsamaires, askoi, monnaies).
29) Fosse à inhumation, fouillée à la môme époque que la précédente, recouverte de quatre grosses dalles : Réf. : Bull, de la Soc. de Géogr. et d'Arch.. . d'Orati, 1898, p. 144-145, pi. XVI-XVII. Tombe remployée; inhumation primitive datable des VIIe- VIe siècles, remplois des IVC-IIIC.
Deux remarques, à titre de conclusion provisoire, sur ces niveaux puniques fouillés par le P. Delattre dans ce secteur du versant sud-ouest de la colline : 1) les descriptions du fouilleur ne font jamais état de vestiges qui pourraient être ceux d'un habitat ou de monuments publics
d'une époque punique postérieure au-dessus des niveaux funéraires22; 2) une deuxième remarque, complémentaire de la précédente, pour souligner - avec la prudence nécessitée par l'imprécision de ces publications - que ces niveaux funéraires les plus anciens, ou encore leur premier état, sont datés ou datables du VIIe au VIe siècle, avec de nombreux remplois ou superpositions datables de la fin du IVe au IIe siècle (ainsi les tombes ou groupes de tombes 4, 8, 10, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29). De ce facies exclusivement funéraire de ce secteur semblent exclus le Ve siècle et vraisemblablement une partie du IVe.
2.2.) Fouilles et sondages sur le plateau.
On regrettera toujours qu'à partir de 1888 la quête jugée par lui prioritaire de sépultures
:: A la différence de la situation observée par le P. Lapevrc dans ses fouilles des années 1930-1933 (cf. infra, p. 25) a quelques dizaines de mètres vers l'est. Nous ne savons à quoi ce dernier faisait allusion lorsqu'il écrivait: «Le Père Delattre a\ait déjà signalé dans les environs une citerne, qu'il disait punique, au-dessus d'un caveau bâti» (Rev. Afric, 1934, p. 349; DCTH, 1932-33, p. 416).
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 23
puniques à Byrsa et ailleurs à Carthage ait détourné le P. Delattre de publier avec quelque détail - et surtout avec un plan - les résultats des différents sondages de circonstance entrepris sur le sommet de la colline entre 1880 et 1885. Il semble pourtant qu'en certains points des niveaux puniques aient été atteints, même si l'attribution de tels ou tels vestiges à l'époque punique peut parfois paraître douteuse, et en tout cas invérifiable en l'absence de toute illustration.
Il s'agit tout d'abord des puits creusés jusqu'au sol vierge pour asseoir les fondations de la cathédrale. Ces 89 sondages de grande ampleur2"* sont donc situés dans le périmètre actuellement couvert par la basilique, mais les enseignements qui en ont été tirés sont loin d'être à la mesure de l'importance matérielle des terrassements entrepris. Les constats très sommairement faits par le P. Delattre sont d'une part d'ordre si l'on peut dire stratigraphique et portent sur le niveau du sol vierge, qui se situerait selon lui, à la différence de ce qu'affirmait Beulé, à une profondeur variant entre 4 mètres et 7 mètres au-dessous du niveau moderne du plateau24. Mais ce constat d'une si grande épaisseur de la couche archéologique au sommet de la colline est contredit par le constat fait simultanément de la disparition des niveaux de sols romains au niveau même du sol moderne2\
2' Cf. Bulletin épigraphique, t. V, 1885, p. 302 : «Sur une superficie de 2084 mètres carrés, 89 puits dont 32 de 2 m, 70 de diamètre ont été creusés jusqu'en plein sol primitif. La profondeur moyenne de ces puits a été de 4 mètres, mais dans plusieurs d'entre eux on a dû descendre jusqu'à 7 mètres pour atteindre la terre vierge. On aura une idée exacte de l'importance de ces travaux en apprenant que 3600 mètres cubes de terre ont été remués et enlevés».
24 Cf. Bulletin épigraphique, t. V, 1885, p. 302 (cité dans la note précédente) et ibid., p. 303 : « Les puits de fouille n'ont point rencontré le grès argileux qui, d'après Beulé, existerait presque à Heur de terre et formerait le noyau de Byrsa. «Si l'on opère des sondages, dit-il, on trouve partout le rocher à une faible profondeur qui varie de 2 m, 35 à 3 m, 40». Les 89 puits dont la profondeur moyenne de 4 mètres dépasse de beaucoup les fouilles de Beulé ont permis de constater que le sol primitif de Carthage est formé non pas d'un grès argileux, mais d'une argile très compacte, de couleur rougeâtre».
2=; Ibid., p. 303 : «Avant que le premier coup de pioche fût donné, des vestiges de constructions antiques apparaissaient à la surface du plateau. Mais les travaux de déblaie-
D'autre part le P. Delattre fait état de la découverte dans ce secteur de différents types de vestiges qu'il attribue à l'époque punique : six grands silos - qui doivent plus vraisemblablement être d'époque médiévale musulmane -, ainsi que «les assises inférieures de murs construits en grand appareil et appartenant à la citadelle»26. A l'emplacement du chevet de la cathédrale, il a noté la présence d'une «construction en pierres de taille, contre laquelle était un long bassin, large seulement de 0 m, 94, mais long de 14 m, 50 et profond de 7 m, 10»; il y a reconnu une citerne punique et vu dans une abside voisine, qui s'ouvrait vers la cour du grand séminaire, un vestige de la cella du temple d'Escu- lape27.
Par ailleurs, quelques autres sondages au voisinage de la cathédrale, qu'on ne peut situer précisément, ont mis au jour quelques témoins d'époque punique (stèles, monnaies) dont rien n'assure qu'ils se trouvaient in situ au moment de leur découverte28. Enfin, publiant des fragments d'inscriptions latines provenant du secteur des ruines du « Palais de Didon », le long du grand côté sud-ouest de la cathédrale, le P. Delattre remarquait que le monument d'époque romaine construit à cet endroit était lui- même bâti sur les restes d'un grand monument
ment ne firent constater que des murs droits de citernes romaines dont la voûte avait disparu. On se trouvait donc au-dessous du sol des constructions antiques, et ce fait constaté fournissait une preuve évidente que le sommet de Byrsa a été nivelé depuis l'époque romaine, puisque le plateau actuel est inférieur au sol des édifices de cette époque ». Mais alors il y a peu de chances que la couche archéologique réduite aux seuls niveaux puniques atteigne et même dépasse 4 m d'épaisseur.
2(1 Ibid., p. 303 : « Le plan en a été soigneusement levé sous la direction de l'architecte. Je le publierai plus tard avec quelques notes sur les fortifications de Byrsa». Ce plan n'a pas été publié, et, en dépit des recherches faites par J. Deneauve et par sous-même il est demeuré introuvable.
27 Ibid., p. 304: « La forme de ce bassin, le mode de sa construction et surtout la nature de l'enduit, tout indique qu'il appartient à l'époque punique. Il était divisé en quatre compartiments communiquant entre eux dans la partie inférieure. Ce sont des citernes. On en conçoit la nécessité dans une citadelle. Le massif de pierres de taille présentait à l'opposé de cet étroit et long bassin, c'est-à-dire vers la cour du grand séminaire, la base d'une abside de lm,67 de rayon». Sur la situation de ces vestiges, cf. D 12 sur la figure 1, infra, p. 43.
211 Ibid., p. 91-92, «fouilles A et C».
=^f
lw^A
tdji!
Fig. 6 - Plan, dû à A. Thouverey, des fouilles du P. Lapeyre (Revue Africaine, 1934, pi. 2, entre p. 345 et p. 346); la zone hachurée 12 est celle des tombes mises au jour en 1937-1938; la zone 13 est celle des deux tombes Ferron-Pinard (Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 52-54). Nous a\ons donné des
numéros (de 1 à 11) aux tombes figurant sur ce plan, qui ne sont pas autrement désignées sur l'original.
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 25
d'époque punique29. Mais cette information, comme les précédentes, n'est étayée sur aucun relevé qui la rende utilisable, non plus que les brèves allusions faites au tracé de Γ « enceinte punique» de Byrsa30.
3) Les fouilles du Ρ . L a ρ e y r e.
Entre 1930 et 1938, le P. Lapeyre a exploré à diverses reprises le rebord sud-ouest du plateau de Byrsa. Les publications sommaires qui témoignent de cette activité en fournissent malheureusement des comptes rendus très incomplets et imprécis.
Entre 1930 et 1933, des dégagements de grande ampleur aboutirent à la mise au jour d'importantes substructions d'époque impériale romaine, et reconnues comme telles par le fouil- leur31 ; dans l'une des structures dégagées (fig. 6), le P. Lapeyre crut cependant pouvoir identifier plusieurs tronçons de Γ «enceinte punique de Byrsa»: il donna de ce mur un relevé - au demeurant inexact - ainsi qu'une description, sans y omettre la mention de remplois dont le constat aurait dû l'avertir qu'il y avait toute chance que la ruine appartînt, comme les autres structures voisines de même orientation, au système de l'organisation romaine de la colline32. A cette même époque fut procédé à une exploration complète, sur une vingtaine de mètres, des niveaux profonds le long de la façade extérieure de cette «enceinte punique». C'est ainsi que
2g MEFR, XII, 1892, p. 238-240 et note 1, p. 240. Emplacement D 7 sur fig. I infra, p. 43.
V) Bulletin épigraphique, t. V, 1885, p. 84 : «Je possède moi- même bon nombre de points de repère qui me permettent d'en suivre la direction générale et les principales lignes. L'enceinte murée du plateau supérieur de Byrsa n'avait pas plus de 300 mètres de profondeur, mais en contre-bas existaient d'autres lignes fortifiées».
" Cf. G. G. Lapeyre, L'enceinte punique de Byrsa d'après les dernières fouilles de la colline Saint-Louis de Carthage, dans Revue Africaine, 1934, p. 336-339; cf. aussi BCTH, 1932-33, p. 408-410; cf. infra, p. 53-54, sur ces substructions, et notamment sur le pseudo-palais des proconsuls.
« Cf. Rev. Afric, 1934, p. 341 et BCTH, 1932-33, p. 411: «On n'y rencontre guère de matériaux remployés, jamais de marbre, seulement un fragment de colonne stuquée et une console de pierre». Soulignant ces remplois ainsi que l'orientation du mur, Madame C. Picard avait dès 1951 suggéré d'y voir un soutènement d'époque romaine : Karthago, III, 1951, p. 125 et note 7.
furent dégagées et fouillées quelque onze tombes33, qui sont pour partie des caveaux bâtis, pour partie des fosses recouvertes ou non de dalles. Le mobilier, sommairement décrit de façon collective, et non reproduit, semble bien pouvoir être daté des VIIe et VIe siècles. Superposée à l'un des caveaux bâtis - la tombe 2, sem- ble-t-il, pour autant qu'on puisse préciser cette localisation, qui n'est pas sans importance -, a été recueillie une inhumation d'enfant sous jarre qui pourrait être beaucoup plus tardive34. Quant au matériel recueilli dans les couches supérieures au-dessus des sépultures, il comporte en abondance du matériel hellénistique — céramique attique tardive, estampilles d'amphores rho- diennes, monnaies puniques3S - dont faute de toute précision stratigraphique on ne peut savoir s'il se trouvait dans un remblai rapporté ou dans des niveaux d'habitat en place, postérieurs aux sépultures. Ce qui est du moins certain, c'est qu'ici à la différence du secteur des fouilles Delattre à quelque 20 ou 30 mètres vers l'ouest le fouilleur avait dégagé - et clairement reconnu pour tels - des vestiges d'un habitat punique tardif: une citerne - superposée à la tombe 11, cf. fig. 2 et 6 - et un tronçon de mur en grand appareil, l'une et l'autre apparemment dans la même orientation36. A ces vestiges on doit ajouter, bien visibles à peu de distance vers le nord, et dans des orientations légèrement différentes, des structures de citernes et de murs
" Cf. Rev. Afric. , 1934, p. 344-349 et pi. 2 et 5 (= BCTH, 1932-33, p. 412-416). «Une dizaine environ», dit le P. Lapeyre (op. cit., p. 345). Madame H. Benichou-Safar (dans Karthago, XVII, 1976, fig. IV et p. 25) compte 12 tombes, mais son n° 12 est en fait une citerne punique superposée à une sépulture antérieure; comme Mme Benichou-Safar, nous admettons avec le P. Lapeyre que les deux sépultures à fosse trouvées en amont du mur, sans « presque aucune trace de mobilier funéraire » (ibid., p. 350), ne sont pas puniques.
u Cf. Rev. Afric, 1934, p. 348 (BCTH, 1932-33, p. 415-416) : « Une jarre qui contenait les restes d'un petit enfant, un vase biberon, un petit vase à parfum en verre et les fragments d'un collier». Le petit vase en verre et le vase biberon attesteraient une date tardive (fin IVe-début IIe), encore que P. Cintas date exceptionnellement du VIe siècle un vase biberon trouvé dans le tophet de Salammbô (Céramique punique, n° 380).
" Cf. Rev. Afric, 1934, p. 345-346 (BCTH, 1932-33, p. 413). '6 Ibid., p. 350 (BCTH, p. 417). Le tronçon de mur en grand
appareil est orienté presque exactement nord-sud.
26 BYRSA I
Fig. 7 - Le secteur des fouilles Delattre (C) et celui des fouilles Lapeyre (B) au début des années 50 (cliché Combier, Mâcon).
dont le dégagement n'a fait l'objet d'aucun compte rendu publié (cf. fig. 2). Ces dégagements non signalés ont pu avoir eu lieu dans les années 1934 et suivantes, où nous savons par une brève allusion du P. Lapeyre que la fouille fut aussi reprise à l'ouest des grands tombeaux fouillés entre 1880 et 1890 par le P. Delattre: cette fouille mit au jour, entre autres, des sépultures puniques tardives37.
"Cf. Rev. Afric, 1934, p. 350-351, en particulier p. 350 : «Depuis le printemps de 1934, quelques élèves du scolasti- cat des Pères Blancs, reprenant une ancienne tradition, consacrent une partie de leurs récréations à faire des fouilles dans le terrain non encore exploré qui longe la façade sud-ouest du rempart punique. . . A trois mètres cinquante en\iron de profondeur, à une dizaine de mètres du rempart punique, ils ont découvert des sépultures carthaginoises qui paraissent postérieures aux grands tombeaux dont nous a\ons parlé».
D'une dernière campagne de fouilles du P. Lapeyre dans ce secteur, il ne reste qu'une relation très sommaire, qui interdit tout report précis sur un plan : il s'agit de la fouille faite en 1937-1938 vers le nord et le nord-est du secteur précédemment décrit, sous les substructions de l'édifice à plan basilical (le «palais des proconsuls»). Là, dans un périmètre malheureusement non précisé, (cf. la fouille 12 sur la fig. 6), le P. Lapeyre mit au jour 16 tombeaux puniques dont le matériel semble pouvoir être daté des VIIe et VIe siècles18. Ajoutons que chemin faisant
" Cf. CRAI, 1939, p. 301 : «Sous le mur du grand monument (le palais du proconsul romain?) nous avons découvert à plus de 8 mètres de profondeur, au fond d'un puits très large pratiqué dans le tuf, un tombeau taillé lui aussi dans le tuf. Le mobilier était celui que l'on trouve habituellement dans les tombes des VIIe et VIe siècles : aiguière à bec tréflé, aiguière à forme de bobèche, «urnes» pansues et
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 27
Fig. 8 - Les fouilles Delattre (C), les fouilles Lapeyre (B) et les fouilles Ferron-Pinard (A), en 1960 (cliché G. van Raepenbusch).
il avait au même endroit découvert, mais sans les reconnaître, des fragments architecturaux appartenant à des constructions puniques postérieures à ces tombes archaïques, qu'il avait prises pour un «mausolée»3y. On verra plus loin que la nature de ces découvertes n'avait pas échappé à Mme C. Picard, qui en reprit l'étude,
lampe bilobée posée dans le creu\ d'une patere. . . De nouveaux sondages dans les environs nous firent découvrir quinze autres tombeaux plus ou moins intacts, plus ou moins riches». Des allusions à cette fouille également dans G. G. Lapejre et A. Pellegrin, Cailhage punique, Paris, Pavot, 1942, p. 42.
19 Cf. G. G. Lapeyre et A. Pellegrin, Canhage punique, Paris, 1942, p. 154 : « Le Père Lapeyre d'ailleurs a découvert en janvier 1937 les restes probables d'un mausolée sur la colline de Byrsa. Ce sont deux petites colonnes stuquées, un chapiteau ionique stuqué, une gorge égyptienne et quelques autres pierres taillées recouvertes de stuc. Elles gisaient à quelques mètres au-dessus des tombeaux très anciens vraisemblablement du VIIe-VI siècle, et à une profondeur de un métré environ sous les soubassements du grand monument (le palais du proconsul romain?) dont il a déjà été parlé».
et qui eut le mérite, dès 1947, de reconnaître dans toutes ces structures sous-jacentes aux fondations d'époque romaine de ce secteur les vestiges de constructions puniques d'époque hellénistique40.
A titre provisoire, soulignons, d'un mot, l'originalité, pour les niveaux puniques, du facies du terrain fouillé par le P. Lapeyre à l'est et au nord-est des anciennes fouilles Delattre : ici comme là, on trouve au niveau profond des sépultures d'époque archaïque, avec une densité d'occupation qui n'apparaît pas moindre dans le secteur fouillé par le P. Lapeyre; mais les sépultures tardives ne sont plus ici attestées - si ce n'est dans un cas, et de façon douteuse -, et d'autre part on voit apparaître au niveau punique supérieur des structures non cohérentes, mais qui semblent bien être celles d'un habitat
411 C. Picard, Vestiges» d'un édifice punique à Carthage, dans Kaithago. III, 1951, p. 119-126.
28 BYRSA I
Fig. 9 - Coupe stratigraphique faite par Ch. Saumagne au point CXXIII-158 de la carte Bordy (£C77/, 1925, p. CLI).
ou de monuments publics d'époque hellénistique. A cet égard, dans l'ensemble du rebord et du versant sud-ouest du plateau de Byrsa, la zone des fouilles Lapeyre - et tout particulièrement la zone fouillée entre 1930 et 1933 immédiatement à l'est des fouilles Delattre - apparaît comme une zone charnière.
4) Les fouilles de Ch. Saumagne.
Si l'apport le plus important de Ch. Saumagne à la connaissance des vestiges antiques de Byrsa concerne, nous le verrons, le versant est et sud-
est de la colline, à deux reprises ses fouilles ou sondages ont intéressé les parties basses du versant sud et sud-ouest du site, et les constats stra- tigraphiques qu'il a faits là à cette occasion ont été longtemps les seules analyses de référence41.
41 Pour respecter l'ordre chronologique dans ce rappel des fouilles anciennes, on n'omettra pas ici la mention, faite par L. Poinssot et R. Lantier dans BCTH, 1923, p. XXIV, de la découverte «sur le flanc sud de la colline de Byrsa, au voisinage de la fontaine décorée de mosaïques et de peintures (2). . . d'un petit groupe de tombes en rapport avec cel-
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 29
Τ 11
ο Ci
k vn uj
J)ecun7anus JL Sud 9
Echelle
S to ι5 i© 2Γιη Fouilles 19.32
Fig. 10 - Tombes explorées par Ch. Saumagne au bas de la pente sud de Byrsa (assemblage H. Benichou-Safar, dans Karthago, XVII, 1976, fig. V, p. 16).
En 1925 tout d'abord, Ch. Saumagne publiait une note très suggestive sur un sondage profond, spécialement effectué à des fins de recherche stratigraphique, en bas de la pente sud de la colline de Byrsa, en aval de l'actuelle avenue
les fouillées par le R. P. Delattre au nord de ce point ». La note (2) de ce texte renvoie pour la fontaine à A. Merlin, dans BCTH, 1920, p. CHI, qui n'en précise pas autrement la situation qu'à «l'angle sud de la colline de Saint Louis». Il n'est donc pas possible de localiser précisément cette trouvaille de tombes puniques - dont on ignore la date -, faite probablement dans une zone occupée maintenant par les propriétés privées.
Tite-Live42. Juste au-dessus du sol vierge, le
fouilleur signalait - couche m - la présence d' «un lit de 0 m, 25 de cendres, de charbons et scories vitrifiées mêlés à des débris de cérami-
42 BCTH, 1925, p. CL-CLIII. Cote de départ du sondage : 15 m, 60, «dans le terrain Khmis-en-Najar, au point déterminé par la jonction des perpendiculaires issues des nombres CXXIII et 158, indiqués sur les bords de la Carte archéologique de Carthage dressée par Bordy». Il s'agit donc des premières pentes de la colline en venant de Douar- Chott. En termes de topographie antique, la zone sondée se situe légèrement au sud du decwnaniis II sud, entre les car- dines III et IV est.
30 BYRSA I
ques grossières. Parmi ceux-ci dominent des cylindres percés de deux trous et des fragments de fours d'argile, en forme de hutte, semblables à ceux dont les fellahs tunisiens font encore usage, et qu'ils appellent taboima»43 (fig. 9). L'examen stratigraphique des couches superposées au-dessus de ces vestiges de type industriel lui permettait de conclure avec beaucoup de vraisemblance - dans les limites matérielles d'un sondage de 4 m x 4 m - qu' « à l'époque punique n'existait à cet endroit aucun édifice; lors de la prise de Carthage par les Romains, ce furent seulement des cabanes abritant des fours d'argile qui furent détruites par l'incendie»44.
Quelques années plus tard, des sondages préliminaires à la construction d'une maison en bas de l'actuelle impasse Tacfarinas, sur le terrain Ploix, fournissaient à Ch. Saumagne l'occasion d'une fouille limitée mais également exemplaire, un peu plus haut sur la même pente méridionale de la colline, entre la cote 22 et la cote 3045. Là, il explorait en un premier temps cinq tombes46, puis trois autres dans le même secteur, auxquelles s'ajoutait une dernière tombe découverte vide, sur un autre terrain situé à 75 m à l'est47 (fig. 10). Des huit tombes fouillées dans le terrain Ploix, deux étaient des caveaux, dont l'un - tombeau Τ 5 - entièrement bâti à l'image des grands tombeaux à toit déjà mis au jour à Byrsa et sur la colline de Junon; les autres tombes étaient des fosses recouvertes de dalles (fig. 11). Le mobilier, pour la première fois dans l'histoire des fouilles de Byrsa présenté de façon utilisable, avec des indications précises sur les groupements, la répartition des objets et une classifica-
·" Ibid., p. CL. C'est la couche tu de la figure de la page CLI, reproduite ici fig, 9, η étant le sable constituant le sol vierge.
44 Ibid., p. CUII. 45 BCTH, 1932-33, p. 67 : «Dans l'angle septentrional des
quatre angles formés par l'intersection du decumaniis II sud et du kardo II est». Soit dans le carré de 20m Β XXIII de notre carroyage. Cf. infra, fig. 18.
4* BCTH, 1932-33, p. 83-90 : tombes 1 à 5. 47 BCTH, 1932-33, p. 324-327 : tombes 6 à 10; mais la tombe
9 avait été pillée, semble-t-il, dès l'Antiquité, et la tombe 10 ne put être fouillée, faute de movens; ibid., p. 327-330 : terrain situé à 75 m à l'est, avec une tombe à sarcophage trouvée vide et des superpositions (dépôts d'incinérations) datées postérieurement à 146.
tion de la céramique, était là encore celui des tombes des VIIe et VIe siècles, sans remploi ni superposition de tombes postérieures48. Cependant, au-dessus du sarcophage découvert vide à 75 m à l'est du terrain Ploix, sensiblement aux mêmes cotes, Ch. Saumagne faisait état de sépultures à incinération aux ossements brûlés des-
Fig. 1 1 - Plan des tombes du terrain Ploix, par Ch. Saumagne {BCTH, 1932-1933 p. 68).
Cf. BCTH, 1932-33, p. 88-90 et 325-327.
UX SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 31
quelles «étaient mêlées des coupes d'argile à vernis noir». A défaut d'une étude céramologi- que et d'une datation de ces coupes à vernis noir, des considérations purement stratigraphi- ques lui faisaient avancer que ces derniers dépôts funéraires étaient postérieurs à la destruction de la ville punique, et naturellement antérieurs à la reconstruction augustéenne49.
En outre, avec l'acribie déjà manifestée en 1925, il livrait une étude détaillée et précise des couches archéologiques observables au-dessus des tombes du terrain Ploix (fig. 12 et 13). Dans une stratification qui comportait exclusivement du matériel punique d'époque tardive et du matériel d'importation hellénistique, il retrouvait ces fossiles de type industriel - scories de fer et de cuivre, tabouna, «briques à trous» vitrifiées, corail - déjà relevés en 1925 quelques dizaines de mètres plus au sud, mais alors en place, tandis qu'ici son analyse lui faisait conclure que, sur cet éperon entre les cotes 22 et 30, le terrain était resté sans emploi après son utilisation funéraire à l'époque archaïque, et que la stratification postérieure qu'il décrivait, déposée par nappes, était due à des apports de terres venues de l'amont, et sans doute de main d'homme, après la destruction de Carthage50.
' »tipi liu Ml mu m \ .
A. Ì. Nappe« régulières d·· chain ι·1 d·· rendre« gris.·«, sans te*Oii«. an con Uri du sol >ierj;e; a. (i'-ndn·* lecere* et Ιι·«»οιι«. X tiros tossons, sain rendre; S. Humus, «able et cli.iui ; ■*■. Seuil dense do cendre« ol de charbon«
Κ. ι. Combe Ιιοηΐι·|;Λιιο d humus, tessons Ijrossier«. rares débris à vernis nc:r, fragments d'urnes et de lampes ^unique* ; •j. Seuil de ceudres et de charbons.
C. ι. Cendres de bois: cuivre; tessons a ternis noir; poterie fine; tabovna, branches deforail; a. Poche homogène de coquillages »pi ri formes; 3. Sable cendré et briques a trous; i. Sable cendré et briques à trous; 5. Trace· d'incendie uolent, scories de fer et de cuivre, tabouna, briques à trous, vitrification; 6. Sable légèrement cendré; 7. Banc de briques crues, delite»·*; H. Conclu* dense de cendres durcie« et de testons blutés.
l). Humus meuble, ossements d'aniinaui, il hommes (î), mâchoires d'équides, palourde« et huîtres, le»«ons de grande* amphore».
K. Huinu» arable moderne.
Fig. 13 - Stratigraphie relevée par Ch. Saumagne sur le terrain Ploix (BCTH, 1932-1933, p. 70).
5) L e s fouilles de Mme C . Picard, et les travaux du Ρ . J . F e r r ο η et de M . Pinard.
H
\Ti \ ti
A B
Fig. 12 - Coupe sur les tombes du terrain Ploix, par Ch. Saumagne {BCTH, 1932-1933, p. 69).
Remontons la pente sud du plateau pour en retrouver le rebord sud-ouest, où se situent les derniers en date de la longue série de travaux entrepris sur ce versant. Les résultats des dernières recherches du P. Lapeyre sous les substructions du grand édifice d'époque impériale romaine à plan basilical attirèrent une dizaine d'années plus tard l'attention de Mme C. Picard, alors conservatrice du site de Carthage. Elle entreprit en 1947 des fouilles limitées en contrebas de cet édifice sous les fondations duquel apparaissaient des pans de murs d'une orienta-
44 Ibid., p. 329-330. Les céramiques à vernis noir accompagnant ces tombes à crémation n'ont pas, à notre connaissance, été conservées.
so Ibid., p. 69-73 et fig. 2 et 3, reproduites ici fig. 12 et 13. Deux remarques pour appuyer ces conclusions, qui paraissent vraisemblables. La stratigraphie reproduite fig. 3, p. 70 (notre fig. 13) fait état pour les couches relevées immédiatement au-dessus du sol vierge (couches A 1 à 5) de nappes de cendres et de chaux, qui pourraient être comme le dit
Ch. Saumagne un apport de déblais formé par les eaux de ruissellement. Les couches B, comportant de la céramique à vernis noir, et C, comportant les fossiles de facies industriel déjà décrits, ne seraient pas, dans ces conditions, en place, et pourraient provenir de la coupe faite dans les niveaux puniques de la colline en aval des absides de soutènement du flanc sud, lors du tracé du decumanus I sud situé une centaine de mètres en amont du terrain Ploix fouillé par Ch. Saumagne.
32 BYRSA I
20m
Fig. 14 - Les fouilles du P. Ferron et de M. Pinard de 1952 à 1959; en noir, les structures préromaines; la zone hachurée est la zone explorée par Mme C. Picard en 1947 (compléments graphiques de S. Lancel sur fond de plan M. Pinard).
tion différente51. Les remarques qu'elle fit sur ces structures en place, jointes à un réexamen des ' fragments architecturaux stuqués mis au
Sl En G IV 10, 11, 13, 14, 15, de notre carroyage : cf. Karthago, III, 1951, p. 119-126.
jour jadis à cet endroit par le P. Lapeyre, redonnèrent leur vraie signification à cet ensemble de vestiges dans lesquels on pouvait désormais reconnaître des constructions non funéraires de la Carthage punique, que Mme Picard proposait de dater de la fin du IIIe siècle ou des débuts du
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 33
IIe en vertu d'indices stratigraphiques suffisamment solidesS2 (fig. 14).
A la suite de cette brève intervention, un dégagement systématique du terrain, dont les objectifs visaient essentiellement les niveaux bas, sous le remblai rapporté, fut conduit pendant plusieurs années, à partir de 1952, sous la direction du Père J. Ferron et de l'architecte M. Pinard. En un premier temps - de 1952 à 1954 -, ces fouilles concernèrent les niveaux et structures situés sous les fondations de l'édifice à plan basilical, ainsi qu'un sud de celui-ciS3; puis elles furent étendues à une large zone à l'est154 (fig. 15).
Deux tombes apparemment superposées furent fouillées dans les niveaux profonds à l'ouest de l'édifice à plan basilical, livrant un matériel datable de la fin du VIIe siècle ou du début du VIe 5\ A cette exception près, les fouilles n'ont mis là au jour dans les niveaux sous- jacents au remblai rapporté que des vestiges et structures non funéraires, dont les alignements manifestent sensiblement une même orientation, soit 65/66° N.E. (par rapport au Nord Lambert). Les auteurs du travail, constatant que cette orientation était presque superposable à celle de la cadastration rurale de Carthage, retrouvée sur le terrain grâce à des travaux récents de Ch. Saumagne^6, entirèrent immédiatement argument pour proposer de dater ces constructions de l'époque des GracquesS7. Pourtant, comme le faisait remarquer G. Picard sans attendre le deuxième rapport des fouilleurs38, le
"2 Ibid., p. 124; l'égout signalé et figuré fig. 6, p. 125 est en realité une citerne, et il n'y a donc pas de rue passant là; ajoutons que J. Ferron et M. Pinard parlaient encore en 1955 de canalisation souterraine à cet endroit : Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 52.
f' Cf. Les fouilles de Byrsa : 1953-1954, dans Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 31-81 et pi. I-XCI, non paginées (p. 83-263).
S4 Cf. Les fouilles de Byrsa (suite), dans Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, p. 77-168 et pi; I-XCV, non paginées.
« Cf. Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 52-54 et pi. XLVIII-XLIX; ni la forme ni le type de ces tombes - des inhumations, apparemment - ne sont précisés. La céramique punique de l'une d'elles (œnochoé à bobèche, œnoché à embouchure trilobée) est datée par la coupe en bucchero sottile qui lui est associée.
S6 Cf. Ch. Saumagne, Colonia lidia Karthago, dans BCTH, 1924, p. 131-140; Vestiges de la colonie de C. Gracchus à Cai- thage, dans BCTH, 1928-1929, p. 648-664.
" Cf. Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 80-81. S8 G. Picard, Un quartier de maisons puniques à Catthage,
matériel recueilli - et soigneusement publié - au cours de la fouille, notamment dans les couches de destruction proches des niveaux en place, et en particulier au contact des sols, était en sa presque totalité du matériel hellénistique datable entre la fin du IIIe siècle et le milieu du IIe siècle". On ajoutera que le gros œuvre des murs, de type divers, mais présentant souvent un opus mixt um ou africanum qui fait un large emploi de la brique crue60, que les sols en opus signinum, que le type des citernes étroites et profondes, à double abside, ainsi que leur mode de construction et leur revêtement61 rapprochaient assez clairement ces édifices de quelques homologues datés à Carthage même des derniers temps puniques62. Au total, les fouilleurs avaient en quelques années mis au jour, outre un instrumentum domesticum cohérent et suggestif, quelques éléments d'un quartier conçu suivant un plan orthogonal apparemment concerté, avec une rue en terre battue63 bordée de maisons reconnues
dans Revue Archéologique, 1958, 1, p. 21-32, notamment p. 24-27.
S9 A propos des monnaies de fouille, on citera les auteurs du rapport, dans Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, p. 120-121 : « Si les débris d'anses d'amphores ont été surtout ramassés parmi les déblais correspondant à une hauteur de deux mètres environ mesurée à partir du sol des habitations, les monnaies appartenant à cette couche stratigraphique étaient mêlées à la terre qui recouvrait les pavements et dans laquelle les traces d'occupation deviennent beaucoup plus sensibles. Sur les vingt-neuf pièces qui ont ou être recueillies, vingt-cinq sont des bronzes puniques de Carthage, frappés entre 241 et 146; trois autres, une de Masae- sylie et deux de Cyrénaïque, sont de la même époque ou peut-être mêmes plus anciennes; une, plus récente, est une monnaie romaine; il s'agit d'un moyen bronze, bien conservé, de Carthage ou de Carales (Cagliari), trouvé en E 2 du plan sur le sol d'une maison». Quant aux estampilles d'anses rhodiennes datables ibid., n° 226 à 280, p. 99-114 et V, 1955, n° 99-120, p. 61-68 -, elles appartiennent aux groupes datés entre 220 et 180 ou entre 180 et 150 av. J.-C.
"° Sur les matériaux et les modes de construction, cf. Cahiers de Byrsa, V, p. 51-52, 54, 80; IX, p. 97.
M Sur les sols, cf. Cahiers de Byrsa, V, p. 80; IX, p. 97-98; sur les citernes et les canalisations : ibid., V, p. 80; IX, p. 98.
62 Cf. les remarques de G. Picard, dans Rev. Arch., 1958, 1, p. 24 et 29-31.
*' Cf. Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, p. 95-96 et p. 77-78, où les auteurs parlent d'un « habitat disposé en ordre continu, aligné au cordeau et se raccordant avec la maison mise au jour lors de notre sondage antérieur», cette dernière notation renvoyeant à Cahiers de Byrsa, V, p. 60 et
34 BYRSA I
Fig. 15 - Le secteur des fouilles du P. Ferron et de M. Pinard en 1960; au second plan, en B, le secteur des fouilles du P. Lapeyre (cliché G. van Raepenbusch).
surtout de façon significative en aval de la chaussée, là où la moindre densité des fondations romaines superposées avait laissé plus de chance de les retrouver avec moins de dommages en plan et en élévation. Pourtant, si la datation à l'époque gracchienne par le seul constat d'une similitude d'orientation pouvait sembler fragile, subsistait encore sur l'appartenance de ces vestiges à l'époque punique finale un doute que pouvait entretenir telle trouvaille troublante64, et que l'absence de sondages sous les
sols et niveaux scellés n'avait pas permis de lever.
suiv. : ils ne reconnaissaient donc pas de rue entre les deux groupes distincts de vestiges dont il est question.
64 On n'omettra pas ici un élément non négligeable du dossier, publié dans Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, p. 142 et
pi. LXVI et LXVII : il s'agit d'une coupe (profil Lamboglia 5) et d'un bol (profil 27) en céramique à vernis noir, marqués l'un et l'autre du même graffitto tracé à la pointe sèche : SPASIMI (à lire peut-être Sp[urii] Asinii). Selon les auteurs, ces deux vases ont été retrouvés posés l'un sur l'autre (et donc semblant faire «service») sur le sol d'une de ces maisons. En dépit de l'obligeance de M. Ennabli, conservateur en chef du musée de Carthage, nous n'avons pu retrouver ces deux objets, vraisemblablement en campanienne A, d'une série peut-être tardive.
Dans d'autres cas, la nomenclature trahit le parti pris et tire le lecteur dans un sens prédéterminé; ainsi dans Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 78 et pi. LXXXVI montre-t-on un «moulin romain», avec catillus et meta : c'est décider d'avance que ce type de moulin ne pouvait avoir cours à Carthage avant la seconde moitié du IIe siècle.
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 35
II - Le versant est ET LES FOUILLES DE CH. SAUMAGNE
La seule exploration méthodique du versant est de la colline de Byrsa a été entreprise en 1923 par la Direction des Antiquités et Arts de Tunisie, sous la direction personnelle de Ch. Saumagne, puis poursuivie et développée en 1925 et 1926 par le même chercheur65.
Les fouilles faites dans ce secteur avec beaucoup d'ingéniosité, et non sans péril, la plupart du temps en sape et en galerie, ont surtout permis la restitution graphique partielle de la situation du terrain à l'époque impériale romaine, avec le report des constructions qui s'étageaient sur les différents paliers reconnus par Ch. Saumagne66 (cf. infra, fig. I, p. 306). Mais des vestiges préromains ont aussi été relevés, et tout d'abord - mais il faut employer là le terme avec quelque précaution - des tombes (fig. 2, p. 307). La première de ces tombes - Τ 1 - peut paraître en effet suspecte en raison des dimensions extraordinaires enregistrées par le fouilleur67. Des deux autres tombes explorées, l'une (T3)68 est du type des tombes à fosses non construites dont il est de nombreux exemples à l'époque archaïque; mais cette tombe a été trouvée vide et bouleversée, et ce n'est que par hypothèse qu'on peut la faire remonter à l'époque archaï-
^ Les résultats des travaux de 1923 ont été publiés par Ch. Saumagne, Notes de topographie carthaginoise; la colline de Saint-Louis, dans BCTH, 1924, p. 177-193. Le rapport sur les travaux de 1925-1926 était resté inédit : il est publié dans le présent volume, avec des relevés également inédits, par les soins de J. Deneauve : cf. infra, p. 283-310.
66 Sur ces résultats concernant les niveaux et structures d'époque romaine, cf. infra, p. 42-46.
67 Cf. BCTH, 1924, p. 186-. «... l'exploration nous conduisit méthodiquement au dégagement du couloir d'accès, dirigé vers l'Ouest-Nord-Ouest, coupé de gradins dans le sol de grès et de glaise, long de 8 mètres et descendant à 7 mètres au-dessous du sol d'accès (sol vierge). Ce couloir débouchait à l'angle sud-est d'une salle rectangulaire. . . La salle, profonde de 8 mètres, large de 7 mètres, était creusée dans sa partie septentrionale non plus dans la glaise, mais dans le grès blanc et jaune. Au fond de cette salle, un puits carré profond de 13 mètres parut nous réserver quelque grande découverte. Il s'achevait malheureusement en cul- de-sac, rempli de grosses pierres plates (pierres dites de l'Aouina) ». De telles dimensions pour une tombe à fosse non construite sont sans exemple ailleurs à Carthage, et la répétition des chiffres (8 mètres, 7 mètres) paraît suspecte.
M BCTH, 1924, p. 187.
que. Quant à l'autre (T2), il s'est avéré par la suite que ce que Ch. Saumagne avait d'abord pris pour une chambre funéraire69 était en fait le départ d'un puits dont la fouille, poursuivie jusqu'à 18 mètres de profondeur, n'a pu être achevée, et dont la destination demeure donc douteuse70.
Sous les terres de comblement de la tombe Τ 1, du matériel était, semble-t-il, en place, mais sa description n'autorise aucune datation71. Dans ces terres de comblement elles-mêmes, on note la présence massive de fragments de grosses poteries dont la face externe présente des encoches faites au pouce, et qui sont des débris de fours, ou tabounas12 . Le contexte de la tombe Τ 1 ainsi que son comblement étaient scellés par un niveau en place, constitué par un dallage fait de losanges en terre cuite imbriqués les uns dans les autres, matériau et technique qui caractérisent les sols puniques un peu antérieurs, semble-t-il, à la toute dernière époque de Carthage73.
M Ibid. 711 Cf. infra, p. 303, note 89. 71 Cf. BCTH, 1924, p. 186 : «A l'angle Est, posées à leur
place originelle, semble-t-il, gisaient deux œnochoés en terre, au bec brisé, à une anse (0m, 18 de hauteur)».
72 Cf. BCTH, 1924, p. 186; ces fragments de tabounas sont plus précisément décrits dans le rapport inédit (infra, p. 303-304), où il est aussi fait état dans le même contexte de fragments de braseros («kanouns»); une datation tardive - fin IIIe - début IIe siècle - est avancée pour ces tessons.
73 Cf. BCTH, 1924, p. 185 : «Les éléments de ce pavement sont des losanges de terre cuite (0m, 195 χ Ora, 090) noire, jaune ou rouge, s'imbriquant avec exactitude au moyen de gorges et de nervures alternées. Deux briques du même système, mais hexagonales, avaient déjà été trouvées près du canal punique ». Depuis, des pavements de ce type ont été mis au jour ailleurs à Carthage, et tout d'abord par Ch. Saumagne lui-même à Dermech, dans la fouille de la «maison du Paon» : «Le pavement a été refait, de briques juxtaposées d'abord, puis, à quelques centimètres au-dessus, de tui- leaux noyés dans le ciment. «(BCTH, 1934-1935, p. 55; c'est par inadvertance, comme l'a bien vu M. G. Picard - BCTH, 1946-1949, p. 677 -, que Ch. Saumagne a attribué ces pavements à une «installation romaine»). Egalement à Dermech, dans sa fouille du terrain Clariond, M. Vézat a reconnu un dallage de briques en losanges surmonté par un sol en ciment uni, puis par un sol en opus figlinum juxtaposé lui- même à un sol en opus signinum (BCTH, 1946-1949, p. 676- 677). Ces mêmes carreaux losanges ou hexagonaux ont enfin été retrouvés à Kerkouane, où ils ne peuvent être datés plus bas que le milieu du IIIe siècle : cf. P. Cintas, Manuel d'Archéologie punique, t. II, 1976, p. 94 et pi. LVI.
36 BYRSA I
Κ. 'V. E
Ο 5m
Fig. 16 - Plan partiel inédit des fouilles de Ch. Saumagne sur le versant est de la colline de Byrsa.
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 37
A — .
5m
Fig. 17 - Fouilles de Ch. Saumagne sur le versant est de la colline de Byrsa; document inédit (détail de la figure précédente).
38 BYRSA I
Venant s'ajouter à ce pavement, diverses autres structures appartenant clairement à un habitat punique d'époque tardive ont été reconnues par Ch. Saumagne dans ce secteur : deux puits, dont la localisation demeure, au moins pour l'un d'eux, imprécise74, et surtout plusieurs citernes en forme de baignoire à double abside qui paraissent pour l'essentiel appartenir à deux systèmes d'orientation différents75. « Le premier de ces deux systèmes semble dépendre d'un ensemble qui s'étendait entre le decumanus maximus au Sud et la maison d'Attis au Nord»76. Ces citernes disposées suivant des axes perpendiculaires manifestent une orientation assez proche de celle de la cadastration julienne, et qu'on peut fixer à 23/24° N.E. (cf. fig. 18). Un second système d'orientation sensiblement différente - 7/8° N.N.E. - a été reconnu à quelques dizaines de mètres vers le nord, « sous l'extrémité N.O. de la maison d'Attis, le mur d'amphores et la maison d'Ariadne»77. L'une de ces citernes, qui présente un plan en équerre, a dû à son remploi à l'époque impériale romaine d'avoir été parfaitement conservée (fig. 16 et 17). Ont en outre été relevées dans ce secteur des structures appartenant à un «édicule punique», ainsi que deux chapiteaux doriques en grès stuqué qui, joints à un fragment de tarif des sacrifices, ont pu donner à penser au fouilleur qu'il se trouvait peut- être en face des vestiges de quelque monument religieux. Quant au matériel recueilli dans ces contextes, il comportait notamment des estampilles d'amphores rhodiennes qui indiquaient des dates comprises entre la fin du IIIe siècle et le milieu du IIe78.
Conclusions et bilan
Au terme de cette analyse, le bilan qu'on peut dresser des résultats acquis concernant les vestiges et niveaux puniques de Byrsa fera tout d'abord apparaître la grande incertitude qui subsiste pour le sommet de la colline : très vite soustraite à la recherche par les diverses constructions des Pères Blancs et des voies les desservant, insuffisamment interrogée alors qu'elle était encore disponible, cette zone demeure largement, du point de vue qui est le nôtre ici, une terra incognita.
En revanche, sur les deux versants qui ont fait l'objet de fouilles suivies et publiées, les pentes sud et sud-ouest, et le versant est, la situation archéologique connue met en évidence, de façon discontinue, mais assez clairement, deux facies ou niveaux distincts (fig. 18).
Le premier est un niveau funéraire, attesté, semble-t-il, sur l'un comme sur l'autre versant pour ce qui est de l'époque archaïque; ce n'est du moins pas douteux pour la pente sud-ouest, où les tombes datées du VIIe siècle et du début du VIe ont été explorées en grand nombre79. Nous avons vu que, parmi ces sépultures, rien n'est attesté entre la fin du VIe siècle et le IVe siècle80. En revanche, les sépultures tardives - IIIe, début IIe siècle - et les remplois tardifs de tombes archaïques sont assez bien documentés, notamment dans le secteur des fouilles du P. Delattre, et peut-être encore, de façon plus douteuse, au-dessus d'une des tombes Lapeyre limitrophes des fouilles Delattre. Mais il n'est
74 Cf. le rapport publié infra, p. 300. " Dans son rapport inédit, Ch. Saumagne signale d'abord
une citerne «isolée, oritentée N.E-S. O. (51° N.E.), longue de 3 m, 58, large de lm,02, profonde de 3 m, 45» (rapport inédit, p. 36). Cette citerne était située «dans le terrain du Dr. Legrand», entre le kardo VI est et le kardo VII est (ibid., p. 300).
76 Cf. rapport inédit, p. 301; les largeurs varient de 0m,87 à 0m,87 à 0m,90; les autres dimensions ne sont pas connues. Il s'ensuit nécessairement que le relevé proposé par Ch. Saumagne est approximatif, tant en ce qui concerne l'orientation de ces citernes que leur emprise au sol.
77 Ibid., p. 301. 7H Ibid., p. 303. Ces indications, demeurées inédites, seront
reprises ailleurs.
74 On peut hésiter, comme on vient de le voir, en ce qui concerne les tombes Saumagne du versant est (cf. supra, p. 35).
80 St. Gsell le notait déjà en 1921 (Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord, t. II, p. 91) et rien, depuis, à notre connaissance, n'est venu combler ce vide chronologique, à l'encon- tre de ce qu'écrivait J. Vercoutter en 1945 (Les objets égyptiens et égyptisants du mobilier funéraire carthaginois, p. 20) : « Autant qu'on peut en juger dans l'absence de fouilles plus étendues, elle a été utilisée à toutes les époques»; l'auteur se réfère en note à « un vase grec et une inscription punique [qui] semblent remonter au Ve siècle» et renvoie à Delattre, CRAI, 1889, p. 15-16 et M. De Vogue, Rev. Arch, XIII, 1889, p. 169, qui signalent simplement des tessons de céramique grecque du Ve et plutôt du IVe, trouvés dans les terres au- dessus des tombeaux.
υ \
\ ToiuIh\s »Γ«'·|μμ|ιμ» »ιπίκιϊφίο <·! hunt«: (VIT* -VI*)-
tardivo ol r<Mii|iloÌN lurdif.s
ί DiffórmitOM oriontatìoiiM Aus
Fig. 18 - Les vestiges puniques de la colline de Byrsa, pentes est, sud et sud-ouest : état des découvertes avant la reprise des fouilles en 1974 (assemblage G. Robine, sur fond de plan au l/500c).
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 39
pas surprenant de ne plus rencontrer ces tombes tardives en allant vers l'est, dans une zone où - constat positif complémentaire de ce constat négatif - les vestiges d'un habitat punique tardif ont été mis au jour de façon dense. De ces structures de maisons en place, on notera (fig. 18) les orientations différentes d'un secteur à l'autre - mais aussi la cohérence dans les axes du petit «quartier» dégagé par J. Ferron et M. Pinard -, et cette remarque détournera de privilégier telle orientation en particulier : en fait, il semble bien que ces orientations diverses, du flanc sud-ouest au flanc est, sont à peu près
perpendiculaires aux lignes de pente, et qu'ainsi les maisons installées à flanc de colline à l'époque hellénistique en ont assez souplement épousé les versants, ce qui n'empêchait pas dans chaque quartier le développement d'un plan orthogonal concerté, avec, de l'un à l'autre, des articulations qui sont encore à découvrir. Ainsi, pour ne rien dire ici de quelques traces d'un facies industriel, trop ténues et trop sporadiques pour être prises stratigraphiquement en compte, les résultats des fouilles anciennes suggèrent au mieux une stratigraphie à deux niveaux, séparés par un hiatus de près de trois siècles.
LES STRUCTURES ROMAINES DE BYRSA
HISTORIQUE DES RECHERCHES
par JEAN DENEAUVE
Depuis 1859, époque des fouilles de Beulé, la colline de Byrsa a été livrée, à plusieurs reprises, à des travaux d'investigations. Beulé avait espéré retrouver des vestiges de la Carthage punique, il crut y être parvenu alors que ses fouilles n'en avaient rien livré. Il eut du moins le mérite de reconnaître l'intérêt exceptionnel de Byrsa et d'y ouvrir la voie aux recherches archéologiques.
L'ensemble de ces travaux et les observations qui en ont été tirées par Ch. Saumagne ont démontré que la colline de Byrsa était, à l'époque romaine, une vaste place entourée de plates- formes s'étageant sur les pentes. Cet aménagement n'a pu être obtenu que par une profonde transformation du relief primitif de la colline. D'importants travaux de terrassement, qu'il s'agisse d'arasements ou de remblaiements, ont concouru à lui donner un aspect nouveau, l'intégrant dans le tracé de la Colonia Julia dont Byrsa devenait le centre.
La stabilité de ces remblais, dont la hauteur atteint parfois plus de huit mètres, nécessita la construction de murs de soutènement. L'édification de monuments sur les plates-formes ainsi constituées imposa le creusement de tranchées ou de puits de fondation atteignant le sol primitif de la colline. Structures de soutènement et de fondation ont en partie survécu à l'arasement total des monuments qu'elles supportaient.
Bien des éléments livrés par les fouilles anciennes sont éclairés d'un jour nouveau par des travaux plus récents. C'est en particulier le
cas des découvertes1 qui ont précédé les études topographiques de Ch. Saumagne et de P. Davin.
La division adoptée pour présenter une synthèse de ces travaux est dictée par le relief actuel du site plutôt que par sa configuration antique. Depuis 1880, les recherches de tombes et de vestiges puniques ont, en effet, profondément modifié la vaste plate-forme créée à l'époque romaine par des accumulations de remblais en faisant réapparaître une partie des pentes primitives.
La Byrsa romaine apparaissait comme une vaste place s'élevant au centre d'un tracé urbain dont elle interrompait la répartition en insulae. Les ressauts successifs s'étageant sur les pentes dont parle A. Lézine2 existaient sur le versant est, mais ils étaient inclus dans le tracé urbain et les monuments publics, qui y étaient édifiés, occupaient une partie des insulae. Ils existaient probablement aussi sur le versant nord qui n'a pas encore été suffisament exploré pour les définir. Le «versant» sud correspond sans doute au relief primitif de la colline, et la destruction d'une grande partie des structures romaines lui a partiellement rendu cet aspect, mais il a été la zone méridionale de la vaste plate-forme qui dominait Carthage.
1 Les fouilles ont été poursuivies de manière assez discontinue par différents fouilleurs : en 1859, Beulé; de 1880 à 1895, A. L. Delattre; 1924-1926, Ch. Saumagne; 1930-1939, G. G. Lapeyre; 1950-1960, J. Ferron et M. Pinard.
2 A. Lézine, Architecture romaine d'Afrique, Tunis, 1964, p. 41.
42 BYRSA I
Le versant est.
La topographie de ce versant a été, en grande partie, reconstituée par Ch. Saumagne3. Nous y considérerons deux zones situées de part et d'autre du cardo IV.
A sa rencontre avec le decumanus maximus, le cardo IV était dominé, à l'ouest, par d'importantes structures de soutènement (fig. 1, D 10 et Le Métroôn de Carthage et ses abords, fig. 1). Treize absides4, de proportions monumentales, longeaient le cardo. L'axe de leur alignement coïncidait avec celui du decumanus maximus. Il s'agit très probabablement du soubassement d'un monument incorporé dans les structures du soutènement de la plate-forme supérieure; l'interruption du decumanus était peut-être compensée par des escaliers ménagés de part et d'autre de cette série d'absides5.
Les fouilles ont été menées successivement par Beulé6, par Delattre7 et, semble-t-il, par Lapeyre8. Ce dernier a aussi exploré la plateforme supérieure où il a reconnu les vestiges de deux alignements parallèles de colonnes (Le Métroôn . . . fig. 1).
La zone située à l'est du cardo IV, et qui a été l'objet des recherches de Ch. Saumagne, correspond aux insulae réparties de part et d'autre du decumanus maximus et comprises entre les car- dines IV, V et VI. Plusieurs paliers correspondant à ces insulae s'étageaient sur ce versant. Le
3 Ch. Saumagne, Notes de topographie carthaginoise, dans BCTH, 1924, p. 177 à 193. Dans cette publication Ch. S. ne tient pas compte du tracé urbain de la Colonia Julia que des recherches ultérieures publiées à la même période (BCTH, 1924, p. 131 et suiv.) devaient lui permettre de préciser. La poursuite des recherches dans cette zone a donné lieu à un compte-rendu resté inédit jusqu'à ce jour : Le Métroôn de Carthage et ses abords.
4 Le nombre des absides est indiqué d'après le relevé exécuté lors des fouilles de G. G. Lapeyre, en 1939; certaines, en particulier les deux dernières, au nord et au sud, semblent avoir été supposées.
s Les deux extrémités de ce soubassement sont formées d'absides perpendiculaires aux premières.
6 Beulé, Fouilles à Carthage, Paris, 1861, p. 67 à 76. 7 A. L. Delattre, La colline de Saint-Louis, à Carthage, dans
Revue Tunisienne, 1901, p. 279 et suiv. 8 G. G. Lapeyre, Les fouilles du Musée Lavigerie à Carthage,
dans CRAI, 1939, p. 302-303. Une restitution très influencée par le monument de Bordeaux dit «Piliers de la Tutelle» a été proposée par G. G. Lapeyre et A. Pellegrin, Carthage latine et chrétienne, Paris, 1950, p. 31-32 et pi. IV.
plus élevé semble se trouver au même niveau que les absides découvertes par Beulé; le second est établi à un niveau inférieur de plusieurs mètres auquel correspond le cardo V. La dénivellation était compensée par des degrés sur le decumanus maximus9 .
Le premier de ces paliers affecte donc une partie de l'insula délimitée, au sud, par le decumanus maximus, à l'ouest, par le cardo IV et, à l'est, par le cardo V. Des structures de soutènement et de fondations ont été suivies, sur sa limite est, jusqu'à leur extrémité sud (fig. 2). Le mur de soutènement 2 s'élève en bordure du cardo V, un mur de fondation 1, distant d'environ 4 m lui est parallèle10. Le soutènement nord interrompt le cardo V par une brusque dénivellation et rejoint le cardo IV en formant un redent qui laisse davantage d'extension à ce palier dans sa partie ouest (fig. 2). Vers le centre de cette plate-forme, un ensemble de huit citernes mesurant environ 15 m. E-0 et llm. N-S était probablement intégré dans l'infrastructure d'un édifice.
Ch. Saumagne a pensé que cette zone était répartie en deux niveaux : le premier, dans la partie proche du decumanus serait à 46 m, le
9 Ch. Saumagne, Le Métroôn de Carthage et ses abords, p. 292.
10 Ch. Saumagne {op. cit., BCTH, 1924) semble avoir interprété le tracé de ces fondations comme celui d'un sous-sol, en particulier en ce qui concerne l'intervalle séparant les murs M 1 et M 2. Nous pensons que ces structures n'appartiennent pas à la première phase de construction romaine qui semble attestée par le mur réticulé M 8. Celui-ci aurait été enfoui dans le remblai maintenu par le soutènement M 2. Ce remblai était aussi traversé par une conduite d'évacuation qui reliait très probablement les citernes établies au centre du palier à l'égout du cardo V. Croyant se trouver dans une sorte de couloir qui aurait été coupé par cette canalisation Ch. Saumagne a pensé pouvoir l'attribuer à un remaniement très tardif. Un de ses arguments est la constitution du remblai contenu entre les murs dans les espaces qu'il désigne comme les salles S 1, S 2, S 4 qui a livré en grand nombre «des fragments de marbre, des chapiteaux concassés et noircis par le feu» et même, l'exploration étant menée par galeries: «un sondage dans le toit de la galerie nous a fait reconnaître, à 3 m au dessous du niveau de l'occupation romaine, un sol de basse époque, pavé d'inscriptions monumentales retaillées en forme de dalles, le texte en dessous». Ces trouvailles semblent ne concerner qu'une zone située dans l'angle S-E et en particulier la «salle» S 1 qui ne figure plus sur les relevés postérieurs à 1924, probablement à partir des travaux que Ch. S. poursuivit sur le tracé du decumanus maximus.
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA
I
43
, II J Ι decornano s I Uud~l "
1 1 L IL 1 L II n ι ι m -j ι 1 1
Fig. 1 - Situation des structures romaines sur la colline de Byrsa, d'après Ch. Saumagne, Notes de topographie carthaginoise, dans BCTH, 1924, p. 181, plan II. Le plan de Ch. Saumagne a été complété par le report du tracé des insulae.
44 BYRSA I
second, attesté par l'extrados des citernes, à 50 m. Le seul témoignage de l'existence d'un niveau à 46 m est « un mur de bel appareil revêtu de stuc»" perpendiculaire à M 3. Cet indice parait assez mince car il existe dans cette zone des structures antérieures à l'implantation des murs 1, 2 et 3. En effet, trois citernes puniques et un pavement ont été reconnus sensiblement dans la même orientation12, d'autre part, entre Ml et M 2, perpendiculairement à eux, Ch. Saumagne a relevé la présence d'un mur à parement d'opus reticulatum sur ses deux faces.
Le «templum Gentis Augustae».
L'existence de ce temple est attestée par les découvertes d'une inscription de dédicace" et de l'autel de Rome et d'Auguste14. L'inscription était rejetée entre des murs de basse époque superposés aux vestiges d'une maison romaine (fig. 2, Β), l'autel semblait avoir été basculé d'un palier supérieur sur le cardo V à proximité de sa jonction avec le decumanus maximus (fig. 2, A). De l'emplacement de ces deux découvertes on déduisit que le temple devait être situé sur la plate-forme délimitée par les cardines IV et V bien que son exploration n'ait livré aucun vestige qui atteste avec certitude de la présence de cet édifice. Les découvertes de Ch. Saumagne semblent mettre en évidence deux périodes de construction à partir de la fondation de la Colonia Julia. A la première appartient le mur en opus reticulatum (fig. 2, 8) enfoui, au cours de la seconde, dans le remblai contenu entre les murs 1 et 2. On pourrait considérer cette première
11 Ch. Saumagne, BCTH, 1924, p. 183. 12 Ch. Saumagne signale le pavement formé de losanges
de terre cuite dans BCTH, 1924, p. 185; des éléments similaires ont été découverts à Sousse et à Kerkouane, cf. L. Fou- cher, Hadrumetum, p. 62 et note 146, fig. a, pi. V.
n Cagnat (M.), Un temple de la Gens Augusta à Carthage, dans CRAI 1913, p. 680 et suiv. Notons que l'existence d'un templum divi Augusti à Carthage est attestée au cours du IIe siècle par deux inscriptions de Dougga {CIL VIII, 1494 et 26606, 26607, 26608) cf. Bassignano, // Fiammato nelle Province Romane dell'Africa, Roma, 1974, p. 109 et suiv.
14 A. Merlin, BCTH, 1919, p. CLXXXVI et suiv. - L. Poins- sot, L'autel de la Gens Augusta, à Carthage, Notes et Documents publiés par la Direction des Antiquités et Arts, Tunis, 1929.
phase comme contemporaine de l'autel de Rome et d'Auguste IS.
Si l'édifice construit solo privato par P. Pere- lius Hedulus, ainsi que l'atteste l'inscription, a bien occupé cet emplacement, la seconde phase de construction dont témoignent les découvertes pourrait correspondre à un agrandissement ou à une reconstruction l6. Les murs 1 et 2 qui ont été suivis à l'est et au sud de l'insula peuvent apparaître comme les fondations d'un portique entourant une petite area au centre de laquelle un édifice se serait élevé au dessus des citernes. La divinisation d'Auguste, les débuts du développement du culte impérial et sans doute aussi l'achèvement des grands travaux qui devaient donner à la plate-forme supérieure de Byrsa son relief définitif17 auraient pu favoriser sinon imposer cette reconstruction. En partant de cette hypothèse on peut se demander si la dédicace de P. Perelius Hedulus ne serait pas contemporaine du second édifice. Elle conserverait alors l'expression Genti Augustae et commémorerait la générosité de celui qui le premier solo privato primus pecunia sua fecit. Il faudrait alors supposer qu'une seconde inscription mentionnait la reconstruction l8.
Le «Métroôn».
Entre les cardines V et VI, Ch. Saumagne a découvert les vestiges d'un temple dont le fond
" L. Poinssot (op. cit.) pense celui-ci un peu antérieur à 14 après J.-C.
16 A. Lézine se basant sur le nombre de 3000 colons et la superficie urbaine livrée à l'habitat estime qu'à l'origine de la colonie les lots devaient correspondre au l/8e d'une insula. La plate-forme dont les limites viennent d'être définies occupe près du double. Cf. Sur la population des villes africaines, dans Antiquités Africaines, 3, 1969, p. 69 et suiv.
17 L'autel de Rome et d'Auguste apparaît comme contemporain des premiers travaux d'urbanisme effectués sur la plate-forme supérieure de Byrsa. Un mur d'amphores découvert dans l'angle S-E est postérieur à 15 avant J.-C. (cf. p. 48). L'achèvement des puissants contreforts et des structures limitant le plateau supérieur à l'est (absides de Beulé) a pu entraîner de profondes modifications des édifices établis en contrebas, en bordure du decumanus maximus.
'■* L'inscription de P. Perelius Hedulus est répartie en quatre lignes sur une plaque de marbre rectangulaire. Il semble improbable qu'elle ait pu être destinée à une façade de temple et ses proportions concorderaient mieux avec celles d'une entrée secondaire de cour ou de portique.
11
ü
12
citemes 8
Γ
+b
Ο 25 m
Fig. 2 - Emplacement présumé du temple à la Gens Augusta et situation des découvertes : a, autel; b, inscription.
46 BYRSA I
de la cella est formé d'une abside19 (Le Métroôn . . . fig. 1). Quelques fragments d'inscriptions votives conservés dans les remplois de l'édifice l'ont incité à considérer ces restes comme ceux du Métroôn de Carthage.
Au sud du decumanus maximus, un puissant mur de soutènement maintenait une partie de l'insula comprise entre les cardines IV et V. Quelques vestiges, aujourd'hui disparus semblent indiquer la présence de thermes, il s'agit d'hypo- caustes découverts par A. L. Delattre dans la partie nord de l'insula20.
Entre les cardines V et VI, une crypte et des citernes formaient probablement une partie du soubassements d'un édifice. Des graffiti et une fresque attestent que cette crypte fut transformée en oratoire chrétien21.
Le decumanus maximus gravit la pente en suivant une croupe de terrain de chaque côté de laquelle, au nord et au sud, le relief s'abaisse progressivement. Les constructions comprises dans une même insula ont donc été étagées sur plusieurs niveaux. Tandis que des édifices publics paraissent avoir occupé, dans la partie haute, les abords immédiats du decumanus maximus, des vestiges d'installations privatives ont été découverts dans les parties basses22. Les maisons dites d'Attis et d'Ariadne occupent le nord de l'insula comprise entre les cardines IV et V2\ Au sud du decumanus, entre les mêmes cardines, d'importants vestiges ont peut-être fait partie d'une somptueuse demeure24.
Le versant nord.
La forte déclivité du versant nord, des bâtiments proches du bord supérieur de la colline et le passage de plusieurs chemins communaux ont peu favorisé les recherches dans cette zone.
Nous ignorons si des traces des cardines I, II et III ont été relevées entre le tracé théorique du decumanus maximus et le decumanus I nord23. Le relief, tel qu'il apparaît actuellement, incite à penser que le plateau supérieur de Byrsa englobait approximativement la moitié sud des insu- lae comprises entre ces deux decumani.
Quelques vestiges qui pourraient appartenir à des soutènements apparaissent dans un secteur proche du tracé théorique du cardo maximus. La distance qui les sépare de la groma est d'environ 72 m. Il s'agit probablement des constructions indiquées sur le plan de Beulé qu'Audollent pense être des citernes26 (fig. 1, Β 3). Delattre a découvert un mur qui se trouvait peut-être dans leur prolongement (fig. 1, D 9) et dont Lapeyre a poursuivi le dégagement vers l'est27 (fig. 1, L 4). Un reste de mur aurait aussi été retrouvé vers le nord-ouest28 (fig. 1, L 5).
Les vestiges découverts par Delattre et Lapeyre sont aujourd'hui recouverts, leur situation et leur structure n'ont pas été suffisament précisées pour en tirer des informations utiles. La situation29 de ceux qui sont encore visibles fournit un élément important mais il serait indispensable que des recherches permettent de l'exploiter.
|l) Le Métroôn de Carthage et ses abords, cf. p. 283-287. 20 A. L. Delattre, op. cit. {Revue Tunisienne, 1901), p. 288. Un
fragment d'inscription découvert par Ch. Saumagne dans une zone voisine mentionne peut-être des thermes proconsulaires : op. cit., p. 192. Cette inscription, daRDANIVS THERMIS PROCON, peut se rapporter à Fl. Dardanius, proconsul vers 340-350 : A. Merlin et L. Poinssot, Le proconsul d'Afrique Dardanius, dans MSAF, LXXVIII, 1932.
21 A. L. Delattre, L'antique chapelle souterraine de la colline de Saint-Louis, dans Cosmos, Paris, 1896.
22 Ces installations privatives ont peut-être, à l'origine, concerné la totalité de la surface des insulae. Le templum Gentis Augustae a, d'après la dédicace, été construit par P. Perelius Hedulus «solo privato».
21 Ch. Saumagne, Le Métroôn de Carthage et ifi abords, p. 25 à 32. L. Poinssot et R. Lantier, Les mosaïques de la «Maison d'Ariadne», dans MMAI, XXVII, 1924, p. 69 à 86.
24 Ch. Saumagne, Le Métroôn .... p. 33 à 35. L'auteur pense qu'il pourrait s'agir d'un sanctuaire.
25 Ch. Saumagne a reconnu le tracé du cardo III est entre les decumani I et II nord. L'indication donnée dans son compte-rendu « entre le decumanus maximus et le decumanus I nord» est inexacte : Notes de topographie carthaginoise, dans BCTH, 1930-1931, p. 641.
26 A. Audollent, Carthage romaine, Paris, 1901, p. 293. Beulé, (op. cit., p. 37-38) dit avoir découvert, dans cette zone, des vestiges de tours circulaires et un égout.
27 G. G. Lapeyre, L'enceinte punique de Byrsa, dans Revue Africaine, n° 360, 1935, p. 5 (de l'extrait) «Enfin sur le versant nord-est de la colline, en faisant des sondages près d'une portion de mur découvert autrefois par le Père Delattre, nous avons mis à jour les restes importants et les fondations d'un mur ... ».
2S G. G. Lapeyre, op. cit., p. 16 (de l'extrait). 24 D'après le plan photogrammétrique (A. Carrier, C.N.R.S.,
1975) ils peuvent être situés à proximité du cardo maximus, à environ 75 m au nord de la groma.
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 47
Le versant ouest.
Nous ne possédons que très peu de renseignements au sujet du versant ouest. Deux grandes citernes, encore visibles aujourd'hui, sont indiquées dans les plans de Falbe et de Beulé30 (fig. 1, Β 4). Delattre a exhumé des vestiges qui pourraient appartenir à un édifice important dans la zone sud-ouest (fig. 1, D 8)31. Lapeyre signale, un peu plus au sud, la découverte d'un angle de mur32 (fig. 1, L 6).
Le relief actuel, en pente plus douce que sur les autres versants, permet de supposer que deux plates-formes s'étageaient sur ce flanc de la colline.
Le plateau supérieur de Byrsa.
Le portique dont les vestiges ont été successivement découverts par Delattre et Lapeyre33, au sommet du versant est, composait certainement la limite du plateau supérieur dans cette direction. Les structures couvrant et délimitant ce plateau, au sud, seront mentionnées dans les notes concernant ce versant. Tout le reste de la surface de cette vaste plate-forme est actuellement couvert par l'ex-cathédrale de Carthage, les bâtiments du Musée National et leurs jardins.
Dans toute la partie de cette zone comprise entre les restes de portiques, à l'est et le tracé théorique du cardo maximus, aucun vestige important n'a été signalé. Delattre mentionne
"'Beulé, op. cit., p. 36 «Je commence par le côté de l'ouest. C'est là que mon attention s'est portée tout d'abord, parceque Falbe y signale, aux lettres a, a, a, des voûtes et des débris . . . Ces voûtes sont tout simplement des citernes romaines, larges de 4 m, longues de 27; mais comme leur partie antérieure a été rasée au niveau du sol, il faut ajouter sept mètre et demi à ce chiffre. Les deux citernes sont juxtaposées et parallèles . . . Vers l'angle sud-ouest on voit sortir de terre une mosaïque, pavement d'un édifice disparu . . . qui représentait les douze mois de l'année, en costume byzantin, avec leur nom en lettres latines; les personnages sont un peu plus petit que nature».
11 A. L. Delattre, MEFR, 1892, p. 251-252 «Au milieu de terrasses renversées des restes d'architecture monumentale. Il convient de signaler un morceau de grande frise et celui d'un chapiteau de pilastre à feuilles d'acanthe de dimension considérable. A côté de ces vestiges d'un édifice considérable, on a recueilli plusieurs lampes chrétiennes et quelques inscriptions ... ».
u G. G. Lapeyre, op. cit., p. 5 (de l'extrait). " Cf. p. 42.
l'existence « d'une terrasse établie sur une épaisse maçonnerie en blocage» et des débris de grandes dalles retrouvées en divers points (fig. 1, D 11); il signale aussi de nombreux fragments de colonnes34.
Il n'est pas toujours possible de situer avec précision les découvertes effectuées dans le secteur ouest du plateau. En 1884, un certain nombre de puits furent creusés afin d'établir les fondations de la cathédrale de Carthage35. Delattre mentionne, parmi les découvertes provoquées par ces excavations, les assises inférieures de murs construits en grand appareil, des silos et des citernes dont les voûtes étaient arasées. A un emplacement qui semble proche de la groma, « à l'endroit correspondant sur le plan à l'abside du fond de la cathédrale»36, une construction en grand appareil comportant une abside, située à côté d'un long bassin, fut mise au jour (fig. 1, D 12). Delattre a observé que cette construction délimitait, à l'ouest, la zone dans laquelle il a retrouvé de nombreux vestiges de dallage et des colonnes et où il voit, peut-être avec raison, une vaste area précédant un sanctuaire.
Un peu à l'ouest de la groma, sous la cathédrale, fut découvert un fragment important de la dédicace d'un aedes Concordiae11 (fig. 1, D 13).
Il semble bien que l'on puisse situer sur le tracé du cardo maximus, à quelques dizaines de mètres au sud de la groma, la découverte de grands reliefs de marbres représentant des Victoires, les unes avec un trophée, les autres avec une corne d'abondance (fig. 1, D 6)38.
Dans la même zone, au sud-ouest de la groma, subsiste un massif de maçonnerie en opus cae- menticium avec des restes de revêtement en grand appareil. Les fondations, d'après Delattre, se prolongent vers le nord et traversent une citerne. Ces vestiges ont donné lieu, depuis les
'4 A. L. Delattre, Les grandes statues du Musée de Saint- Louis, dans Cosmos, 1898, p. 7 (de l'extrait). Inscriptions latines de Carthage, 1884-1886, dans Bulletin Épigraphique, 1887.
" A. L. Delattre, op. cit. {.Inscriptions latines), p. 2 (de l'extrait). Un plan, qui semble malheureusement avoir disparu, aurait été levé par l'architecte de la cathédrale.
16 A. L. Delattre, op. cit., p. 3-4 (de l'extrait). " CIL, VIII, 12569. is CRAI, 1894, p. 176 et 195 à 201. G. Ch. Picard, Le monu
ment aux Victoires de Carthage, dans Karthago, I, 1950, p. 65 à 94.
48 BYRSA I
fouilles de Beulé39, à diverses interprétations; Cagnat et Gauckler y voient les premières assises du stylobate d'un temple40, tandis que Delat- tre41 et G. Picard42 les attribuent à l'époque byzantine (fig. 1, D 7).
Le versant sud.
En 1859, Beulé avait entrepris des sondages dans la zone sud-est du plateau supérieur de Byrsa. Delattre41, attiré par la découverte fortuite d'une tombe punique, en 1880, consacra la plus grande partie de ses travaux, sur le versant sud, à la recherche de la nécropole. Les efforts successifs des deux fouilleurs mirent au jour, entre autres découvertes, une partie des substructions d'une plate-forme. Il s'agit de vestiges de constructions, dont une série d'absides, qui formaient un soutènement longeant et dominant une partie du decumanus I sud, délimités, à l'ouest, par le cardo maximus, à l'est, par le cardo IV.
Les vestiges découverts en 1859 semblent avoir complètement disparu depuis. Beulé décrit une série de six absides, proche de l'angle sud-est de la colline, l'une à parement d'opus reticulatum44, les cinq autres en grand appareil4S (fig. 1, Β 2). Delattre découvrit le prolongement de cet alignement d'absides en direction de
'4 Beulé, op. cit., p. 7-8 «ruines supposées du palais de Didon».
40 R. Cagnat et P. Gauckler, Les monuments historiques de Tunisie, Paris, 1898, p. 109.
41 A. L. Delattre, MEFR, 1892, p. 239-240. 42 G. Ch. Picard, op. cit., p. 89. 41 A. L. Delattre, Les tombeaux puniques de Carthage, Lyon,
1890, p. 22 à 30. 44 Beulé, op. cit., p. 63 «J'en ai déblayé un qui a encore
huit mètres de hauteur, et qui porte avec lui sa date, puisqu'il est construit tout entier en opus reticulatum». (Notons que Beulé, croyant avoir découvert les fortifications puniques de Carthage considérait comme des réfections tardives les éléments caractéristiques de l'époque romaine).
45 Beulé, op. cit., p. 60 «L'appareil des murs est colossal, c'est à dire que les blocs qui les composent sont d'une grande dimension : il en est qui mesurent 1 mètre 50 centimètres de large, 1 mètre 25 centimètres de hauteur, 1 mètre de profondeur... Les murs transversaux qui séparent les salles demi-circulaires les unes des autres sont les mieux conservés : ils ont encore 4 mètres, jusqu'à 5 mètres de hauteur ... ».
l'ouest. Le plan relevé en 189246 indique onze absides dont quatre sont supposées dans une zone non fouillée. La dernière, à l'ouest, est à parement d'opus reticulatum (fig. 1, D 2 et fig. 5). Elle se présente isolément, la rupture de l'alignement étant due, très probablement, à une destruction47. Quelques vestiges des autres absides subsistent encore (fig. 3), ils présentent un appareil de petits moellons dans lequel étaient intercalées des jambes de pierre de grand appareil. Les blocs ont été arrachés mais leur empreinte reste bien visible.
En 1892, ce mur de soutènement avait été dégagé, ou du moins repéré, sur une longueur d'environ 90 m48. La section comprise entre les absides découvertes par Beulé et l'angle S-E de la colline fut perçue en 1893 par Delattre (fig. 1, D 3). Dans l'intention d'explorer une zone particulièrement riche en timbres amphoriques, il dégagea un amoncellement d'amphores emplies de terre et entassées par rangées successives. Ce « mur d'amphores » était disposé contre les extrados d'absides à parement intérieur en opus reticulatum49. Ce remploi des amphores semble destiné à réduire la poussée qui se serait exercée contre le soutènement en maçonnerie dans une
46 Plan relevé après les fouilles Delattre par l'architecte Bonnet-Labranche. L'original au 1/200 ne semble pas avoir été conservé, une réduction au 1/500 dans BCTH, 1893.
47 A. L. Delattre, Les tombeaux puniques de Carthage, la nécropole de Saint-Louis, dans RA, XVII, 1891, p. 52 «on se heurta à un second mur, épais de 1 m, 75, construit en pierres de taille et moellons passant par dessus une double abside romaine bâtie en très bel opus reticulatum». En 1892, Delattre ne parle plus que d'une seule abside : Fouilles archéologiques dans le flanc sud-ouest de la colline de Saint- Louis, dans BCTH, 1893, p. 102.
48 Nous ignorons si les absides découvertes par Beulé faisaient immédiatement suite à celles de Delattre. Il faut aussi noter des différences dans les dimensions données par les deux fouilleurs. Delattre indique que quinze absides occupent une longueur de 48 m, ce qui donnerait une largeur moyenne de 3,20 m par abside (murs latéraux compris). Beulé est apparemment plus précis : « leur largeur était de 3,30 m, séparées les unes des autres par des murs transversaux de 1,10 m».
44 A. L. Delattre, Un mur à amphores romaines découvert à l'angle sud de la colline de Byrsa, dans CRAI, 1893, p. 152 et suiv. Une seconde publication donne plus de détails au sujet des marques d'amphores : Le mur à amphores de la colline Saint-Louis, dans BCTH, 1894, p. 89 et suiv. La marque amphorique la plus récente serait de 15 avant notre ère.
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 49
Fig. 3 - Vestiges des absides du soutènement sud (photo A. Chéné, C.N.R.S., 1975).
zone où le remblai atteint sa plus grande hauteur50.
En 1859, Beulé avait déjà découvert quelques vestiges du soutènement est. Un de ses sondages atteignit un mur en opus reticulatum dont les fondations étaient formées d'assises de grande appareil51 (fig. 1, Β 1). Ayant traversé ce mur il se trouva dans l'amoncellement d'amphores et crut avoir pénétré dans une cave ou dans un magasin. Cette découverte ne devait être éclair- cie que par celle faite par Delattre, trente quatre ans plus tard.
L'extrémité ouest du soutènement sud a été partiellement explorée par Delattre. Un massif de maçonnerie (fig. 1, D 4) forme l'angle déterminé par l'intersection du decumamis I avec le cardo maximus. Le mur ouest, parallèle au cardo, était, d'après Delattre, construit en opus reticula-
so Un sondage pratiqué par Beulé (op. cit.. p. 42, fouilles F), dans l'angle S- E de B\rsa, aurait atteint le sol naturel à 19 m. Les piles de fondation rencontrées par Lapevre, dans la même zone, mais plus à l'ouest, mesurent 8 m (op. cit., p. 8, de l'extrait).
M Beulé, op. cit., p. 39.
mm52. A quelques mètres de ce mur fut rencontré un égout que Ch. Saumagne devait plus tard identifier comme appartenant au cardo™.
Le soutènement ouest a été atteint par les fouilles de Delattre. Le plan de 1892 indique les extrados de deux absides54 situées à une quinzaine de mètres, au nord, du massif de maçonnerie de l'angle S-O. Elles ont été dégagées à l'occasion de travaux plus récents qui ont provoqué l'effondrement presque total de l'une55. Elles sont construites en moellons avec un parement interne d'opus reticulatum (fig. 1, D 5). L'abside encore en place apparaît actuellement comme l'élément le mieux conservé de cet ensemble de structures de soutènement. Son arasement au N.G. de 53,12 m. et sa largeur probable permet-
s: A. L. Delattre, op. cit. {BCTH, 1893), p. 101. " Ch. Saumagne, Colonia lidia Karthago, dans BCTH, 1924,
p. 134. S4 Delattre n'en fait aucune mention mais les deux extra
dos sont indiqués sur le plan de 1892 avec la mention «citernes romaines».
" Fouilles Lapevre, en 1934, voir plus loin le rapport de fouilles.
50 BYRSA I
t . ι. - " I- - •fr
*.t *r.
-Λ'αη».
*, \ v.*--!
Fig. 4 - L'intérieur «quadrilatère» après les fouilles Delattre. Les murs est, sud et la tombe punique (photo prise vers 1892).
tent de restituer son extrados au N.G. minimum de 55,60 m.S6.
La restitution du plan de la Colonia Julia, telle qu'elle ressort des travaux de Ch. Saumagne", permet de mesurer l'importance de ces structures dans le tracé urbain de Carthage (fig. 1 et fig. 7). Comprise entre le cardo maximus et le cardo IV, formant une longue façade parallèle au decumamis I, la longueur de la plate-forme maintenue par ces soutènements était donc égale à la largeur de quatre insulae à laquelle il faut ajouter celle des cardines qui les séparaient, soit
if> Largeur de l'abside : 3,75 m; rajon de la voûte et du cul de four: 1,87; épaisseur possible au-dessus de l'intrados : 0,60 m.
" Ch. Saumagne, op. cil. (BCTH, 1924).
environ 160 m. Il est fort probable qu'elle appartient, par ses structures les plus anciennes, à la première phase de travaux d'urbanisme entrepris après la fondation de la Colonia Julia. Cette ancienneté est attestée par la datation des amphores utilisées dans une partie des soutènements; et ce remploi apparaît comme contemporain des constructions en maçonnerie qu'il complète.
Les éléments mis au jour au cours des fouilles antérieures nous permettent donc de délimiter une partie de la plate-forme supérieure de Byrsa au sud et à l'est. Les travaux qui ont été poursuivis dans cette zone, à la surface même du plateau, nous livrent aussi des éléments importants quant à l'implantation des constructions romaines qui y ont été édifiées.
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA 51
II, ρ*. . . . __,·, — : ίι it m n · "·\
Fig. 5 - Le mur sud et les tombes puniques, l'abside en opus reticiilatum du soutènement sud et une tombe punique (photo prise vers 1892).
Dans la partie sud-ouest de cette plate-forme, la recherche de tombes puniques a provoqué le dégagement de structures de fondation en opus cacììicìiticiiuìì'^. Deux murs parallèles E-0 sont reliés par un troisième et présentent un tracé en forme de H. Ils ont été coffrés dans des tranchées traversant un remblai ancien qui recouvrait des tombes puniques du VIIe- VIe siècle et
Λ' En 1880, Delattre fouilla une tombe punique décomerte fortuitement, probablement à l'occasion d'extraction de pierres : «en 1880, à l'occasion de la construction des nou- \eaux bâtiments de Saint-Louis, des fouilles firent découvrir un tombeau punique... » (Delattre, Le tombeau punique de Bmsü, dans Bulletin des antiquités africaines, III, 1885). Ce tombeau était situé dans l'angle N-E du quadrilatère qui fut, par la suite, progressivement dégagé selon les hasards de la recherche des tombes puniques {Les tombeaux puniques de Catthage, L\on, 1890, p. 34-35, 63, 68). Le procédé de fouilles qui consistait, à tout prix, à arriver de plein pied à ces tombes a provoqué un déchaussement complet des murs et finalement l'effondrement d'une partie du mur sud. Quand à l'interprétation de ces vestiges, elle resta des plus \ agues; Delattre et ses successeurs les considéraient comme un bastion (Lape\re, op. cit., p. 9 de l'extrait).
contenait des tombes en amphores59 (fig. 4 et fig. 6, coupe E-O). La pente naturelle de la colline étant assez forte, le mur nord prend appui à un niveau plus élevé que le mur sud (fig. 6). L'extrémité ouest de la tranchée nord a cependant été creusée aussi profondément que celle du mur sud; une rangée de blocs de grand appareil relie la base de ces deux murs (fig. 4), d'où l'appellation de «quadrilatère» souvent utilisée pour désigner ces fondations. Les murs nord et sud se prolongent d'environ 4 m au delà du mur est (= barre du H).
Une pile de fondation, accolée à l'extrémité est du mur nord, est le début d'un alignement E- O dont une partie a été découverte par G. G. Lapeyre60. Au cours des fouilles qu'ils poursuivit de 1931 à 1933, les seize piles suivantes furent reconnues. Il s'agit de fondations en opus cae- wenticium coffrées dans des puits traversant le
i4 A. L. Delattre, op. cit., p. 35 et suiv. Ml G. G. Lape\ re, op. cit., p. 8-9 (de l'extrait).
52 BYRSA I
remblai afin de prendre appui sur le tuf de la colline. Distantes de 4,60 m de centre à centre, ces piles étaient reliées, à leur sommet, par des arcs à voussoirs en pierres plates. Des cintres en petits mœllons les obturaient sous l'intrados. Elles supportaient, de part et d'autre des arcs, de petits piliers en grand appareil (fig. 1, L 1 et fig. 7).
A cinq mètres, au nord de ces fondations, Lapeyre découvrit un mur qui leur est parallèle. Il prend aussi appui sur le tuf de la colline et sa construction mêle des blocs de grand appareil à des éléments puniques utilisés en remploi et à des mœllons. Son inventeur, croyant avoir retrouvé l'enceinte punique de Byrsa, lui attribue un prolongement vers l'ouest qui semble dû à une confusion avec d'autres structures situées
à peu près dans le même alignement. Dans l'état actuel de notre connaissance de cette zone de Byrsa, le tracé de ce mur ne semble pas s'étendre, dans cette direction, au delà de celui des piles de fondation (fig. 7). L'extrémité est de ces deux alignements est encore inconnue; d'après le plan de G. G. Lapeyre, ils auraient été suivis sur plus de quatre-vingt mètres.
Au nord du quadrilatère, les recherches de tombes puniques ont provoqué le dégagement de quelques structures en opus caementicium. Un mur de fondation, établi à un niveau plus élevé, est parallèle au côté nord du quadrilatère (fig. 7, Κ). Il forme un angle droit avec un mur (L) qui est interrompu sur une partie de son parcours. Parallèlement à ces deux murs subsistent des vestiges de canalisations établies au même
COUPE PARTIELLE EST-OUEST DANS LE QUADRILATERE
C. TOMBES PUNIQUES A AMPHORES
MUR DE MASSIF DE SOUTE- MACONNERIE NEMENT
TOMBES PUNIQUES
10m
COUPE NORD-S'JD A L'EXTREMITE EST DU QUADRILATERE
Fig. 6 - Coupe N-S, d'après le plan Bonnet-Labranche (BCTH, 1893). Coupe E-O, d'après Delattre (Les tombeaux puniques de Carthage, Lyon, 1890, p. 60).
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA
1 tJUI
53
L_J DDG Cm
¦ ??» ¦ ¦ mïà m J' ¦ ¦ . .T^i ¦? .
«apa?apap??pa
? ! I
? ?
OECVMANVS I
^ A.
Fig. 7 - Structures romaines de la zone sud de la plate-forme, d'après les plans de M. Pinard (1960) et de M. Borely (1975).
niveau. A la partie nord du mur L est contigue, vers l'ouest, une épaisse semelle de béton dont la surface a conservé l'empreinte de grandes dalles (fig. 8). Du mur même, il ne subsiste que la fondation en opus caementicium, large de 2,40 m, dont le niveau, à l'arase, est plus bas que le support du dallage. A l'est, ce mur est doublé d'une semelle de fondation dont la surface, établie à un niveau plus bas, conserve les traces de blocs de grand appareil6'. Il paraît important de souligner que ce soubassement de dallage et d'autres vestiges du même type situés au-dessus des absides dites «de Beulé», entre les vestiges de portiques (cf. p. 42), sont à des niveaux à peu près identiques qui correspondent à la cote 56. Nous avons aussi constaté que le niveau minimal du soutènement ouest est à 55,60 m. Il paraît donc
61 Un nouvel examen de ces vestiges nous a convaincu qu'il s'agit bien de traces de blocs de grand appareil et non d'un dallage, c'est donc probablement à tort que nous avons émis l'hypothèse d'un portique (cf. Antiquités africaine!,, 11, p. 62 et 64).
très probable que la plate-forme supérieure de la colline s'étendait à ce niveau de 56 m.
Les fouilles entreprises de 1950 à 1960 par J. Ferron et M. Pinard62 ont poursuivi le dégage-
Fig. 8 -Le soubassement du dallage (Photo J. Deneauve).
62 J. Ferron et M. Pinard, Les fouilles de Byrsa, dans Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 31 et suiv. et Cahiers de Byrsa, IX, 1960- 1961, p. 77 et suiv.
54 BYRSA I
Ν. G. 54,50
Ν. G. 50,00
DECVMANVS I
20m 1 I I A' Dépotoir paléochrétien
Fig. 9 - Vestiges situés à l'ouest, d'après le plan photogrammétrique de A. Carrier, C.N.R.S.
ment des structures romaines découvertes par G. G. Lapeyre au centre et à l'est de la zone sud de la plate-forme. Il s'agit des fondations d'un ensemble monumental implanté dans une orientation légèrement différente de celle des structures dont il vient d'être question. Ces importants fondements prennent appui, au sud, sur le mur considéré par Lapeyre comme une enceinte punique (fig. 7, D) et ils enjambent les murs F, G et H, parallèles à cette pseudo-enceinte. Le plan qu'ils nous livrent est celui d'un édifice axé sur une abside en avant de laquelle deux rectangles inscrits dans le tracé de fondation suggèrent une partie centrale et une partie en façade plus élevées. Au nord, le même édifice comportait une seconde petite salle à abside et une salle trifoliée63. Une date relativement tardive a été
buée à cet ensemble à la suite de la découverte d'une monnaie de Constant Ier prise dans le mortier d'une pile de fondation proche du monument64.
63 Lapeyre (op. cit.) avait reconnu le plan de la salle trifoliée; à ce sujet : A. Lézine, Le palais de Byrsa, Cai thage-U tique, Paris, 19, p. 178. L'abside de la salle basilicale a été
nue par M. Pinard (Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 50). A. Lézine (op. cit.) a proposé, à partir su relevé de M. Pinard, une restitution de cette salle dont toute la longueur serait divisée en trois nefs. Cette restitution obligerait à considérer que le tracé des fondations, tel qu'il apparaît actuellement, résulte d'une modification de ce premier état. Or l'appareil d'opus caementicium est parfaitement homogène. L'interruption des deux murs parallèles n'est pas due à l'aménagement tardif d'une citerne mais elle appartient à ce tracé de fondations qui formait deux rectangles. La citerne a été logée, dans sa longueur, entre les petits côtés de ces rectangles qui ont alors été reliés l'un à l'autre par les murs formant ses extrémités. Ceux-ci ont disparu, mais on remarque des traces d'arrachement. Le plan de fondations qui a subsiste parait donc bien être le tracé primitif et tout essai de compréhension des structures en élévation doit en tenir compte.
64 J. Ferron et M. Pinard, op. cit. (1955), p. 50.
UN SIECLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA
Si l'on considère l'ensemble des vestiges dont le tracé a été reconnu dans la zone délimitée, à l'est, par le cardo IV, à l'ouest, par le cardo maximus, au sud, par le decumamts I et, au nord, par l'alignement du mur (H) découvert sous l'édifice à absides, il se dégage donc deux implantations distinctes. Cet édifice à absides est actuellement le seul témoin de la seconde. Sa déviation par rapport au tracé augustéen peut être due à la destruction des structures au centre desquelles il a été construit.
Les traces d'édifices établis dans le tracé précis de la Colonia Julia ont été relevés à l'extrémité ouest de la plate-forme et dans les alignements de murs et de piles de fondation qui la parcourent d'est en ouest. Cette implantation suggère une vaste area entourée de monuments et de portiques dont les colonnades reposaient sur les piles de fondation. Une partie de cette area, dont les portiques étaient peut-être déjà détruits, aurait tardivement été occupée par le monument à absides.
La zone située à l'ouest du cardo maximus et au nord du decumamis I ne semble pas avoir subi d'investigations archéologiques mais elle a été, par contre, gravement atteinte par les prélèvements de terre effectués vers 1950. Sur une surface d'environ 40 m de côté, l'arasement ainsi réalisé a atteint le N.G. de 50 m sans, sem- ble-t-il, rencontrer de structures de maçonnerie.
A l'ouest de cette zone, et du tracé théorique du cardo I ouest (fig. 9), des constructions émergent partiellement de terre à un niveau plus élevé. Elles forment un massif contre lequel une découverte fortuite a livré un petit dépotoir paléochrétien65.
Au nord, entre le tracé du cardo maximus et celui, encore théorique, du cardo I, le niveau s'élève brusquement à 54,50 m, quelques vestiges de constructions apparaissent dans le talus.
Il paraît donc probable que la largeur N-S de la plate forme supérieure était réduite, à l'ouest du cardo maximus, par des paliers intermédiaires s'étageant dans la pente.
Ce rapide bilan des recherches menées pendant un siècle laisse apparaître que nous connaissons encore bien incomplètement la topographie romaine de Byrsa. Il montre aussi, nous l'espérons, que, malgré l'état d'extrême délabrement des vestiges, des recherches systématiques peuvent encore permettre de déterminer les structures essentielles de l'implantation romaine à travers sept siècles de l'histoire de Carthage.
ftS J. Deneauve, Un dépotoir paléochrétien sur la colline de Bvrsa, dans Antiquités Africaines, 8, 1974, p. 133-156.
DEUXIÈME PARTIE
LE SECTEUR A 1974-1975
LE SECTEUR Β 1974-1975
LE CARDO MAXIMUS ET LES ÉDIFICES
À LEST DE LA VOIE 1974-1976
LE SECTEUR A (1974-1975)
par SERGE LANCEL
Compte tenu des résultats acquis mais aussi des problèmes laissés pendants par les fouilles anciennes sur la pente sud et sud-ouest de la colline de Byrsa1, seule partie du site qui fût immédiatement accessible, à la reprise des fouilles en 1974, il a été décidé de faire porter l'effort en premier lieu sur une bande de terrain orientée nord-ouest/sud-est et située approximativement entre la cote 50 et la cote 55. Cette zone a été par convention divisée en trois secteurs, A, Β et C, qui correspondent sensiblement, d'est en ouest, aux secteurs explorés par le P. Ferron et M. Pinard (A), et précédemment par le P. Lapeyre (B), ainsi que par le P. Delattre (C) (cf. fig. 1).
Plus précisément, le secteur A est topographi- quement défini par les carrés suivants, de 20 m de côté, du quadrillage de chantier mis en place en 19742 : G II, G III, G IV, H II, H III, H IV, I III, I IV; on y ajoutera partie de F II, F III, F IV. Cet espace est délimité au nord-est par la rue Pierre- Viénot, incluse dans le périmètre concédé pour les nouvelles fouilles, et en cours de déclassement, à l'est et au sud-est par les villas Marie- Thérèse et Salammbô, au sud-ouest par le palier constitué en contrebas par le decwnanus I sud de la Carthage romaine, enfin à l'ouest et au
1 Cf. supra, p. 13, l'historique des recherches antérieures sur niveaux et vestiges puniques, et, p. 41, sur les niveaux et vestiges d'époque romaine.
2 Ce quadrillage implanté suivant les axes du carroyage Lambert Nord-Tunisie a été mis en place par une officine topographique tunisienne en mai et juin 1974; cette implantation a été vérifiée et complétée en juin 1975 par A. Car- rier-Guillomet, ingénieur topographe à l'Institut d'Archéologie Méditerranéenne d'Aix-en-Provence.
nord-ouest par la limite occidentale de l'édifice à plan basilical mis au jour par le P. Lapeyre (cf. fig. 2). Sur la partie de remblai antique seulement écrétée par les fouilles précédentes, les cotes atteignent respectivement 51,92 m (plot 39), 52,59 m (plot 33), inférieures donc d'environ 1 m, 50 à 2 m au niveau de la rue Pierre-Viénot (53,96 m, plot 23) ou au niveau d'implantation de la villa Salammbô (54,06 m, plot 40), qui représentent à peu de choses près le niveau de cette partie de l'esplanade à la fin de l'Antiquité. Dans les parties basses déjà fouillées, les cotes descendent à 48,94 m (plot 32), 48,34 m (plot 31), manifestant donc une dénivelée de 3 à 4 m par rapport au niveau du remblai laissé en place.
\) Ê t a t et problématique du secteur à la reprise des travaux en 1974.
Concrètement, la partie haute du secteur retenu pour une nouvelle exploration présentait, au-delà d'un front de limite de fouille irrégulier et raviné (fig. 3), l'aspect d'un petit plateau à la surface duquel n'apparaissait plus rien des vestiges de construction d'époque musulmane reconnus là jadis par J. Ferron et M. Pinard \ Aucune
' Cf. Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, p. 77 et plan, pi. I, contrôlé par les photographies aériennes obliques des pi. II et III; sur ce dernier cliché, dans l'angle en bas à gauche - cf. aussi supra, fig. 15, p. 34 - on peut voir également les arcs reliant les têtes des piles de fondations d'époque romaine, à l'image de ce qui est encore visible dans le secteur B, dans le secteur des anciennes fouilles Lapeyre; mais ici ces structures ont maintenant disparu.
Ili
y?X f
/
1
6 τ
Δ
Ì
Ο
Β
05
15m ι
ι I^OBELY G HALLIER
IAM.CNRS
Fig. 1 - Les trois secteurs de fouille sur la pente sud et sud-ouest de la colline (état des lieux après la campagne de l'été 1975) (Relevé I.A.M., G. Hallier, M. Borély).
LE SECTEUR A (1974-1975) 61
Fig. 2 - Le secteur A après la campagne de l'été 1975.
trace non plus n'était immédiatement perceptible des sondages autrefois pratiqués dans ce secteur par le P. Lapeyre pour reconnaître l'épaisseur du remblai et signalés par le fouilleur sans report sur un plan4. A plus forte raison n'y avait-
4 Cf. Revue Africaine, 1934, p. 343: «Ces fondations sont des fondations sur puits. Les puits ont une profondeur variable, de 1 m à 8m près de la \illa Salammbô ... ». Cette remarque suppose des sondages profonds - depuis remblayés - qui sont peut-être ceux qui figurent sur la 3e plan-
il aucune chance de situer les fouilles et sondages, notamment sous forme de puits circulaires, faits par Beulé en 1859 approximativement dans cette partie du plateau\ En revanche, la trace négative de la grande fouille pratiquée par le même chercheur à la limite sud-ouest de l'espla-
che photographique non paginée après la page 339 de la publication ci-dessus mentionnée.
s Cf. Fouilles à Carthage, Paris, 1861, p. 42 et pi. I, puits J. et D.
62 BYRSA I
Ι .λ·*-**"* c™*"·*""""* ä , λ _^"\7*~* * * *** * C "
■ £., "^ ;^w^ ^Cii
Fig. 3 - Vue du secteur A depuis la rue Pierre-Viénot (axe du cliché : sud-sud-ouest) après un premier nettoyage du terrain à l'automne 1973 (Cliché S. L).
nade6 était nettement visible en limite du secteur A : là, ce qui pouvait demeurer encore du grand mur de soutènement à absides d'époque romaine qu'il avait mis au jour a disparu, laissant ce qui reste encore du terre-plein supérieur sans protection contre les ravinements (fig. 4).
Dans les parties basses du secteur, les dégradations et déprédations n'avaient pas épargné les vestiges mis au jour jusqu'au niveau des sols d'habitat préromain par J. Ferron et M. Pinard. Certaines structures de fondation ou de soutènement d'époque impériale romaine n'ont pas survécu à la fouille7 et, au demeurant, les modalités
h Ibid., p. 46-66 et particulièrement p. 60 et 63, et pi. I, fouille G; cf. aussi supra, p. 14.
7 Ces disparitions, dues parfois à l'impossibilité de conserver des structures très fragiles dès lors qu'elles
Fig. 4 - Vue du secteur A depuis le palier du decwnaniis I sud : au premier plan à droite, le soutènement du remblai a disparu, trace négathe de la fouille de Beulé (cliché S. L).
JKT
J'.xiïi? ^— -" ... ■ , j .y-, M
1 Γ^~η-: · V /
ijfoi if
ν \-r.
. ...»
.;-■» ··-,
Fig. 5 - Etat des structures dégagées par J. Ferro η et M. Pinard au nheau bas du secteur A avant la reprise de la fouille (comparer avec Cahier* de Byisa, IX, 1960-1961, pi. XLI et XLVI) (Cliché S. L.).
d'implantation, la datation et le rôle respectif de ces divers éléments n'ont pas suffisamment retenu l'attention des fouilleurs8. De leur côté,
n'étaient plus enserrées par le remblai (c'est notamment le cas du gros soutènement figuré en pointillé dans les carrés G IV, H IV et H III), dues aussi au\ déprédations consécutives à l'abandon du chantier après 1959, expliquent les différences perceptibles entre notre plan de situation du secteur (fig. 2) et le plan publié par M. Pinard {Cahiers de Byna, IX, 1960-1961, pi. I); on notera en particulier la totale disparition d'une pile de fondation romaine, figurée en H 1 sur le plan de M. Pinard.
s Des indications cependant dans Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, p. 88-90. Mais aucune hypothèse n'est faite pour l'énigmatique massif de fondations en grand appareil assemblées par des tenons : ibid., p. 96, et pi. XL-XLII (en H, I, 9, 10 du plan pi. I: ici en HIV 10-11 du plan). Quant à l'édifice à plan basilical (le «palais des proconsuls» du P. Lapeyre), on a proposé {Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 50) de le dater en fonction d'une monnaie de l'empereur Constant retrouvée dans le mortier d'une pile considérée comme partie intégrante de l'édifice (la pile a été détruite lors de la fouille et figure en pointillé dans le plan M. Pinard : Cahiers de Byrsa, IX, pi. I, en F 5); en réalité, comme l'a bien vu
les niveaux et vestiges préromains sous-jacents à ces structures d'époque romaine - ou d'époque médiévale - ont beaucoup souffert de l'état d'abandon où est demeuré le site après l'arrêt de la fouille en 1959: cette situation de carence a facilité les déprédations des chercheurs de pierre et les entreprises destructrices des fouilleurs clandestins. En outre, faute de protection, les élévations de murs, la plupart du temps très fragiles, en brique crue et en pisé, ont souvent partiellement fondu sous la double action du ruissellement et des pluies fouettantes. Il s'en faut de beaucoup que les structures actuellement subsistantes se présentent encore avec la richesse de détail qui les caractérisait lorsqu'elles furent mises au jour (fig. 5).
A. Lézine {Catlhage, Ulique, éludes d'architectuie et d'urbanisme, Paris, 1968, p. 177-180), la pile est apparemment indépendante de l'édifice, auquel elle n'est en tout cas pas join- tive.
64 BYRSA I
D'autre part, dans cette partie du site depuis longtemps scrutée et en dernier lieu de façon suivie et méthodique par J. Ferron et M. Pinard, subsistaient encore bien des inconnues et des incertitudes. Tout d'abord, en dépit de quelques remarques publiées dans les Cahiers de Byrsa sur la consistance et la nature des terres traversées au cours de la fouille9, il manquait encore une étude stratigraphique de ce remblai qui va s'épaississant à mesure qu'on se rapproche des angles du plateau. Outre les informations qu'elle pouvait apporter sur les modalités concrètes de la mise en œuvre de cette gigantesque cultellatio, cette étude avait chance d'en confirmer la datation, déjà indiquée par les dates consulaires - entre 43 et 15 av. J.-C. - portées par les amphores du « mur d'amphores » en soutènement fouillé autrefois sous l'actuelle villa Salammbô par le P. Delattre10. Par ailleurs, comme on l'a déjà dit, bien des incertitudes subsistaient dans l'identification et la datation des divers vestiges mis au jour. L' « enceinte punique » du P. Lapeyre n'est pas une enceinte, et les remplois visibles dans ce mur excluent qu'il soit d'époque punique, comme cela a été vu par Mme C. Picard11, mais sa fonction et sa chronologie restent à préciser, comme d'ailleurs celle de la plupart des fondations ou soutènements d'époque romaine - et parfois médiévale - qui jalonnent le secteur, et le site dans son ensemble12. L'étude du «palais des proconsuls» exploré par le P. Lapeyre a été brièvement reprise par A. Lézine : c'est un édifice à plan basilical prolongé par un triconque lui-même flanqué d'une chapelle à abside simple; mais sa date, tardive, est encore incertaine, ainsi que sa destination. Il fallait aussi trancher le débat resté ouvert sur la datation des maisons dégagées par J. Ferron et M. Pinard, et au demeurant très insuffisamment publiées : d'époque grac- chienne, comme le voulaient les fouilleurs, ou bien plutôt puniques d'époque hellénistique, comme le suggéraient G. et C. Picard13? Des son-
* Cf. Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, p. 88 et 90. 10 Cf. A. L. Delattre, Le mur à amphores de la colline Saint-
Louis de Carthage, dans BCTH, 1894, p. 89-119. 11 Cf. Karthago, t. 3, 1951, p. 125, note 7. 12 En effet, bien des problèmes évoqués ici ne sont pas
spécifiques du secteur A. Cf. supra, p. 51-53. 11 Cf. C. Picard, Vestiges d'un édifice punique à Carthage,
dans Karthago, t. 3, 1951, p. 119-126; G. Picard, Un quartier de
dages sous les niveaux scellées de ces maisons, outre qu'ils pouvaient en assurer la datation, avaient enfin chance de faire connaître la nature des niveaux puniques plus anciens.
Tels sont les constats qui ont déterminé l'orientation des travaux sur le terrain dans le secteur A, au cours des campagnes de 1974, 1975 et 1976.
2) L e s travaux des campagnes de 1974 et 197 514 .
Un double objectif a été poursuivi au cours des campagnes de 1974 et 1975 : d'une part la reconnaissance, au moyen de sondages stratigra- phiques, de la composition du remblai, et, si l'épaisseur de ce remblai le permettait, la poursuite du dégagement des maisons sous-jacentes jadis mises partiellement au jour par J. Ferron et M. Pinard; d'autre part, une série de travaux dans les parties basses déjà dégagées, pour amorcer l'étude de ces maisons, seulement rapidement signalées par les fouilleurs, et tout d'abord pour assurer leur datation.
2.1.) Les sondages stratigraphiques dans les parties hautes du secteur.
Plusieurs sondages de 4 m χ 4 m (une berme d'lm étant réservée entre chaque sondage) ont été entrepris (fig. 6). Du sud au nord : en G II 15, G II 16, H II 13 (ces trois sondages constituant une tranchée de 4 m de largeur après suppression des bermes) (fig. 7); en H III 2, H III 5, H III 6, H III 7 (les trois derniers également en ligne); en H III 15 et 16, et en I IV 7. Le remblai a été également examiné en G III 4 et G III 7, où
maisons puniques à Carthage, dans Revue Archéologique, 1958, 1, p. 21-32.
14 Ces travaux ont été menés en 1974 avec la collaboration de Mlles Anne-Marie Bumbalo et Elisabeth Lafaye pour la surveillance de la fouille; quelques relevés ont été faits par M. Jean-Marie Gassend, architecte-adjoint du bureau d'architecture de l'Institut d'Archéologie méditerranéenne (L. A. du CNRS). En 1975, le chantier a bénéficié de la collaboration de Mlles Joëlle Bara et Elisabeth Lafaye, et de M. et Mme Jean-Louis Tilhard, pour la surveillance de la fouille; des vérifications et des compléments topographiques ont été effectués par M. André Carrier-Guillomet, ingénieur topographe à ΓΙΑΜ; relevés partiels de M. Maurice Borély, du bureau d'architecture de ΠΑΜ, et de M. Gilbert Hallier, chef du bureau d'architecture de ΓΙΑΜ.
Fig. 6 - Vue du secteur A depuis la rue Pierre-Viénot en juillet 1974 : au second plan, les sondages de la partie haute (Cliché G. van Raepenbusch).
* '^^*1-Γ^^^ΛΓ2^1^^ ^
Fig. 7 - Les sondages H II 13 (au premier plan) et G II 16 (Cliché G. van Raepenbusch).
66 BYRSA I
-IOO
_ 2OO.
-3OO
too
IOO 2OO 3OO too
Fig. 8 - Sondage H II 13, coupe sur talus ouest (Relevé E. Lafaye, S. Lancel).
des rectifications de coupe ont été faites sur le talus des fouilles anciennes, très raviné par les intempéries après quinze ans d'interruption de chantier. Rappelons aussi (cf. supra, p. 59) que le remblai a disparu dans sa partie supérieure sur une hauteur d'environ 2 m : les stratigraphies relevées sont donc nécessairement incomplètes vers le haut, et cette situation explique aussi que sur les coupes faites approximativement dans le sens de la ligne de pente (coupes nord-sud, donc
sur des talus est ou ouest) les strates apparaissent coupées en haut par la ligne sensiblement horizontale du sol actuel.
Seuls les sondages en G II 16 et H II 13 sont apparus exempts de tout remaniement et présentent donc une image sincère de la constitution du remblai rapporté. On ajoutera cependant que, compte tenu du pendage assez accentué des couches et de leur disparition partielle, ces stratifications ne sont représentatives que de cette
LE SECTEUR A (1974-1975) 67
_ IOO
_ 2OO.
_3OO
ite jL·
Ί
IOO 2OO 3OO Fig. 9 - Sondage H II 13, coupe sur talus sud (Relevé R. Bret, S. Lancel).
partie du remblai et non du terre-plein dans son ensemble15. En voici la stratigraphie16 :
15 La stratigraphie apparaît plus complète sur la «butte Lapeyre », située dans le secteur B, où toute l'épaisseur du remblai a été conservée (cf. infra, p. 101-104).
16 II s'agit ici d'une caractérisation qualitative des couches et du matériel qu'elles contiennent. Le matériel recueilli, souvent très abondant (notamment dans les couches 3, 5 et 7), mais coupé de tout contexte in situ par rapport à sa datation, sera publié par la suite par séries homogènes (céramique punique, céramiques grecques et hellénistiques importées, amphores, etc.).
a) Sondage en H II 13 (4mx4m; profondeur atteinte : 3,90 m; fig. 8, coupe sur talus ouest, fig. 9 et 10, coupe sur talus sud)
1 - Épaisseur de la couche : 0,80 m sur le talus sud, mais le pendage est très accentué et la couche est très peu représentée sur la superficie totale du sondage (cf. coupe sur talus ouest). Humus en surface, puis terre sablonneuse mêlée de cailloutis par bandes d'épandage. Matériel : céramique attique : un fragment de fond de plat; céramique précampanienne : un fond de plat
68 BYRSA 1
.... . ,-^tfi
Fig. 10 - Sondage H II 13, vue du talus sud (Cliché G. \an Raepenbusch).
estampillé à palmettes. Campanienne A : plusieurs tessons dont un bord de forme 23. Imitations de céramiques à vernis noir : un fond de plat à pâte et engobe gris; un bec de lampe tournée. Plusieurs tessons de céramique de tradition punique, dont un fragment de col d'amphore de forme Cintas 312, et un fragment de plat à repeints de filets rouges.
2 - Épaisseur moyenne de la couche : 0,10 m à 0,20 m sur le talus sud, disparaissant en sifflet vers l'est. Chape d'argile mêlée de cailloux, stérile.
3 - Couche mince, d'environ 0,10 m d'épaisseur sur le talus sud, disparaissant à l'est. C'est une couche détritique riche en tessons et en ossements. Sa faible importance, notamment en
surface du sondage, a rendu difficile la distinction de son matériel avec celui de la couche 1, cité plus haut.
4 - Couche de sable et de gravillons, mêlés de débris de stucs de revêtement mural, de peu d'épaisseur sur la coupe du talus sud (0,05 m à 0,10 m), mais s'élargissant sensiblement vers l'amont (cf. coupe sur talus ouest). Un bronze de 9,8 mm de diamètre, du monnayage de Carthage, datable de la fin du IVe ou début du IIIe siècle (cf. Jenkins, S. N. G., type 120-123), recueilli en surface, peut appartenir à cette couche 4 comme à la couche 3. Céramique attique à venus noir satis décor: deux tessons de fond de kylix; pré- campaniejine : une forme 22 (A. 240. 2); plusieurs tessons de campanienne A et d'imitations à pâte
LE SECTEUR A (1974-1975) 69
et engobe gris; plusieurs fragments de lampes tournées et divers tessons amorphes de céramique de tradition punique.
5 - Cette couche d'environ 0 m, 20 d'épaisseur sur la coupe du talus sud, s'élargissant vers l'est, d'épaisseur relativement constante vers l'amont, est une strate très riche en cendres et en charbons, et d'une grande densité en matériel archéologique. Céramique attique tardive à vernis noir : plusieurs fragments de fonds de kylix (cf. J. et L. Jehasse, Nécropole préromaine d'Aléna, pi. 112, 127, 1038, 1533); céramique précampa- nienne : fonds de coupes et patères à décor de palmettes; campanienne A : nombreux tessons, dont un fragment de cratère cannelé, une forme 21/25, un rebord de forme 36, un bord de forme 31, un fragment de guttus à versoir zoomorphe; imitations de campanienne à pâte grise : nombreux tessons, dont deux bords de forme 23 et plusieurs bord de forme 36. Nombreux fragment de lampes tournées; un bord de sombrero de copa. Céramique de tradition punique : nombreux tessons de bords de jattes et de plats, en particulier à large marli plat (cf. déjà Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, n°435 et pi. LXXV); plusieurs fragments d'embouchures d'amphores de forme Cintas 312-313; nombreux fragments de balsa- maires; céramique domestique d'époque hellénistique : plusieurs fragments de bords d'instruments à feu (casseroles, marmites) à parois minces et plan de pose pour couvercle (cf. déjà Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, n« 405 à 409, pi. LXX et LXXI; matériel de comparaison de l'agora d'Athènes: H. Thompson, dans Hesperia, 1934, p. 466-468). Une anse d'amphore rhodienne estampillée, cartouche rectangulaire de 38 sur 12 mm (fig. 11): ΜΑΡΣΥΑ ΠΑΝΑΜΟΥ17. Une monnaie de bronze du monnayage carthaginois de la fin du IVe siècle ou du début du IIIe (diam. : 8 mm, 4; cf. Jenkins, S. N. G., type 94-98).
6 - Couche de sable jaune d'une épaisseur moyenne d'environ 1 m, 50 à 2 m, homogène, marquée à sa base par un lit de cailloux. Présence sporadique de débris de stucs de revêtement mural, d'opus sigmmtm et d'opus tessella-
Fig. 11 - Estampille sur anse d'amphore rhodienne (Cliché IAM, A. Chéné).
,M ■ :·:·:.'■'...·..;. i>.· -i
à ^ M
17 Même éponyme, mais avec un nom de mois différent, sur une estampille communiquée par le P. Delattre : BCTH., 1915, p. CCIII; cf. aussi P. Gauckler, Nécropoles puniques de Carthage, t. 2, p. 592.
Fig. 12 - Estampille sur bord externe d'amphore punique (Cliché IAM, A. Chéné).
turn, plus abondants vers le bas de la couche. Faible densité en matériel céramique : céramique attique tardive : trois fragments de fonds de kylix, un fond de lampe tournée; céramique précampa- nienne : un bord de forme 21/25, deux fragments de fonds de patères; campanienne A : nombreux tessons de fonds de coupelles et de patères; trois bords de forme 21/25; un bord de forme 36 à vernis rougeâtre intérieurement, sans vernis
70 BYRSA I
sur la face externe; nombreux tessons d'imitations à pâte et engobe gris. Plats à feu : plusieurs tessons de bords de marmites à parois minces et· plans de pose pour couvercle (matériel de comparaison déjà cité, dans Hesperia, 1934, p. 466- 468). Céramique de tradition punique : plusieurs fragments d'embouchures d'amphores de forme Cintas 312/313, dont un portant une estampille sur le bourrelet externe (fig. 12), deux tessons de bords de patères à large marli plat, parmi lesquels un bord engobé de red slip, plus ancien que le contexte d'ensemble, fait figure de fossile aberrant. Signalons aussi, au bas de la couche, quelques patelles, objets ambigus - coquillages, ou matériel archéologique (godets à fard, fréquents dans les tombes puniques)? -, mais aussi deux escargots fossilisés et plusieurs balles de fronde en terre cuite de forme ovoïde (long. : 0,046 à 0,049, larg. : 0,036 à 0,039). Monnaies de cette couche : trois bronzes non identifiés, un grand bronze de 35,5 mm dont l'appartenance au monnayage carthaginois n'est pas sûre, un bronze de 15,5 mm de diam, du monnayage carthaginois, datable entre 241 et 221 (S. N. G., 273- 275); enfin, à une profondeur de 2,50 m, le long du talus sud, un petit bronze de 9,6 mm de diam., difficilement lisible, mais qui pourrait être attribué au monnayage de Basiliscus (cf. Late Roman Bronze Coinage, II, p. 110) : si l'identification est confirmée, cette monnaie de la fin du Ve siècle de notre ère, retrouvée là bors de toute proximité d'une pile de fondation romaine, ne pourrait être qu'une inclusion aberrante.
7 - Couche de couleur ocre à marron- rouge, contenant en abondance des décombres et débris divers; petits moellons de grès, briques de terre crue, fragments de stucs de revêtements muraux, nombreux débris de sols en opus signi- num et en opus tessellatum. La couche 8 est une petite loupe de terre cendreuse incluse dans la couche 7. Matériel céramique relativement peu abondant : céramique attique et précampanienne : quatre tessons de fonds de coupes et patères; campanienne A : trois bords de forme 31, un bord de forme 28; plats à feu : plusieurs tessons de bords; céramique de tradition punique : un fond de plat décoré de deux filets concentriques marrons; un fragment de panse et d'embouchure de vase de type lagynos, à décor de feuilles stylisées; plusieurs bords de soucoupes ou
d'assiettes, dont deux à engobe rouge, lesquels, joints à un fragment de panse d'aryballe corinthien, indiquent une date plus haute au milieu d'un matériel d'époque hellénistique dans son ensemble. b) Sondage en G II 16 (4mx4m; profondeur
atteinte: 3,95m; fig. 13, coupe sur talus ouest)
Même type de stratigraphie, représentée par les mêmes couches, mais avec un pendage beaucoup moins accentué. On notera l'importance de la couche 2, qui comportait un matériel d'époque hellénistique non attesté dans le sondage précédent; de cette couche provient entre autres un fragment de lampe figurine à tête de Silène, ainsi qu'un tesson de panse de bol mégarien. La couche 3 est aussi sensiblement plus épaisse et très riche en matériel, parmi lequel on notera en particulier une tête de figurine féminine en terre cuite bien représentative d'une production des coroplastes d'époque hellénistique répandue dans tout le bassin de la Méditerranée aux IIIe et IIe siècles (fig. 14) IS. On notera aussi l'importance de la couche 6, qui dépasse sensiblement les 2 m d'épaisseur vers l'aval, et la constance de la couche 7, qui présente ici comme en H II 13 une surface fortement damée. Monnaies recueillies dans ce sondage : couche 3 : deux bronzes non identifiés, trois bronzes du monnayage de Carthage de la fin du IVe ou du début du IIIe siècle (cf. Jenkins, S. N. G, 120-123); couche 6 : deux bronzes non identifiés, un bronze de diam. 15,5 mm datable de la fin du IVe ou du début IIIe (S. N. G., 109-119), un bronze datable entre 300 et 264 av. J.-C. (S. N. G, 144-178); couche 7 : un petit bronze (diam. : 8,3 mm) datable fin IVe-début IIIe (S. N. G, 120-123).
Ces stratigraphies sont confirmées par les coupes faites en rectification de talus à la limite des anciennes fouilles Ferron-Pinard, en G III 4 et G III 8, avec un profil différent des strates et des différences qui tiennent à la différence de situa-
IS Un exemplaire assez proche dans les fouilles du P. Fer- ron et de M. Pinard : Cahier b de Byrsa, IX, 1960-1961, n" 501, pi. LXXXVII. Mais l'exemplaire de comparaison le plus proche, même face ronde et un peu empâtée, même disposition de la coiffure, provient des fouilles de l'Agora d'Athènes, et serait une production attique du second siècle avant notre ère: D. Burr, dans Hesperia, II, 2, 1933, p. 187 et fig. 4, 1, p. 188.
LE SECTEUR A (1974-1975) 71
NG - 51.83
_IOO,
_2OO.
_3OO.
4OO
Ο IOO 2OO 3OO 4OO
Fig. 13 - Sondage G II 16, coupe sur talus ouest (Relevé R. Bret, E. Lafaye, S. Lancel).
tion d'une zone située légèrement en amont (fig. 15) : mais on retrouve, avec son épaisseur et son homogénéité, la couche 6, devenue ici 3, juste au-dessus de la couche ici 4 (plus haut 7), couche riche en décombres et en débris dont le sommet semble marquer la limite entre le remblai en place après la destruction de 146 (et l'effondrement de ce qui demeurait encore des superstructures puniques) et le remblai rapporté à l'époque augustéenne; soulignons que nos sondages, lors de ces deux premières
pagnes, n'ont fait qu'atteindre le haut de cette couche, qui promet d'être très importante sur ce flanc de colline où nous travaillons. On verra plus loin (infra, p. 226) qu'on la retrouve, mais naturellement beaucoup moins épaisse, vers l'amont, c'est-à-dire vers le nord-ouest.
Par son épaisseur - dépassant par endroits 2 m -, par son homogénéité, par sa faible densité en vestiges archéologiques, la couche de remblai immédiatement supérieure à la couche de destruction en place (couche 6 en H II 13 et G II 16)
72 BYRSA I
fait problème : la quasi-absence de matériel inclinerait d'abord à y voir une strate alluviale accumulée par le ruissellement, mais l'épaisseur de la couche contredit à cette hypothèse, et il convient plutôt d'y reconnaître un apport massif, homogène, de terres rapportées artificiellement lors de la constitution du remblai augus- téen. De quel endroit du site de Carthage? D'une même zone, à en juger par la cohérence de la strate; peut-être d'une zone littorale, compte tenu de l'importance du sable dans la strate. Les couches supérieures, en revanche, sont de lecture assez claire : il s'agit de couches de déversement faites de terres rapportées, plus ou moins détritiques, plus ou moins riches en matériel archéologique selon leur origine; la couche 3 des sondages H II 13 et G II 16, où les ossements humains sont relativement abondants, pourrait parvenir, au moins partiellement, du raclage d'une zone funéraire (cette indication peut être
donnée plus nettement pour une couche de la stratigraphie observable dans le secteur Β : cf. infra, p. 104). Ajoutons cependant que, si ces strates sont individualisables, le matériel qu'on y recueille ne varie guère de l'une à l'autre : céramique attique finale et précampanienne, campa- nienne, surtout de la série A (et imitations diverses), céramique de tradition punique de la phase finale. Il s'agit donc d'un matériel d'époque hellénistique, entre la fin du IVe siècle et le IIe siècle avant notre ère, comportant de rares inclusions de matériel plus ancien; et les monnaies trouvées dans ces couches confirment ces datations. On soulignera dans ce bilan la totale absence de matériel datable du premier siècle avant notre ère (absence de sigillée aretine, notamment) : ainsi sont confirmées les indications déjà données par les inscriptions du «mur d'amphores»: le remodelage des pentes, et notamment leur remblaiement, a bien eu lieu à l'époque augustéenne, avec des terres prélevées à divers endroits du site détruit en 146 - et tout d'abord bien sûr des parties hautes de la colline elle-même -, où l'on retrouve surtout, de façon bien explicable, le facies archéologique des deux derniers siècles de la Carthage punique.
L'épaisseur du remblai et le volume des terres à analyser n'avaient pas encore permis, à l'issue de la campagne de 1975, de parvenir à partir du niveau haut au sol des maisons puniques qui doivent faire suite, vers le sud-est, à celles dégagées jadis par J. Ferron et M. Pinard : ces niveaux de sols se situent certainement assez profondément sous les accumulations de décombres de la couche 719.
Fig. 14 - Tête de figurine féminine en terre cuite (Cliché G. van Raepenbusch).
14 Le niveau de ces maisons est à 48, 94 au point 32; notre sondage au droit du point 39, situé à 51, 92, a été approfondi à 3,90 m sans cependant parvenir au sol de la basse époque punique, ce qui indique clairement que ce sol se situe ici à un palier inférieur, rachetant la pente de la colline, assez forte vers le sud-est. La coupe d'un sondage pratiqué vers 1930 par le P. Lapeyre dans ce secteur, et qui se situerait entre Γ «enceinte punique» et la première rangée de piles de fondations qui lui est parallèle vers l'aval (approximativement en G III 8 et 12 de notre plan de situation, pour autant que l'imprécision du plan Thouverey permette ce report), indique à cet endroit le «sol vierge» à la cote 43, 50, ce qui semble tout de même très bas. Le relevé n'indique au demeurant aucun vestige entre le mur et les piles, ce qui paraît suspect (cf. Revue Africaine, 1934, p. 336-352, pi. 2 et 3).
LE SECTEUR Λ (1974-1975) 73
7 '' '
"V Λ^-"·--" r-i^*..
Fig. 15 - Vue des» talus est en G III 4 et G III 7; la couche 3 correspond à la couche 6 des stratigraphies relevées en H II 13 et G II 16; au centre du cliché, pile de fondation romaine (Cliché S. L.).
Par ailleurs, ces sondages ont permis de compléter le relevé des différents murs et piles de fondation d'époque impériale romaine et de faire des observations sur leur tracé et leur mode de construction (cf. aussi itifra, p. 132-135).
Ainsi la pseudo-enceinte punique du P. Lapeyre reparaît dans les sondages H III 2 (fig. 16) et H III 5-6; mais toute cette zone est affectée par les sondages anciens non reportées sur les plans dressée par A. Thouverey, sondages non consolidés ni entretenus, et devenus des dépotoirs peu à peu comblés par des détritus et rebuts divers (fig. 17); le mur fait de remplois (notamment des moellons de grès stuqué qui proviennent de la démolition des édifices puniques tardifs), déjà très fragile, a beaucoup souffert de cette situation (déjà sans doute aussi des sondages du P. Lapeyre) et ne peut plus être conservé que par tronçons; les contreforts qui figurent avec une équidistance régulière de 5,90 m sur le plan Thouverey n'ont pas été constatés20. Ajoutons que le bouleversement des lieux à ces niveaux (entre cote 52 et 49) n'autorise à cet endroit aucune recherche stratigraphi-
que tendant à préciser la datation du mur; au demeurant, si comme il est probable le «mur Lapeyre» a été élevé dans ce secteur comme dans le secteur Β au contact immédiat des vestiges in situ des édifices puniques tardifs, son implantation ne pourra pas être étudiée au-dessus de la cote 45/46 au plus haut, pour les raisons qui viennent d'être dites (cf. note 19).
20 Cf. Revue Africaine, 1934, p. 336-352, pi. 2. Fig. 16 - Un tronçon de la pseudo-enceinte punique
dans le sondage H III 2 (Cliché S. L.).
74 Β Y RSA I
Fig. 17 - Sondage H III 5, talus sud : ancien sondage Lapeyre comblé en partie avec des rebuts modernes; au tiers inférieur du cliché, la couche sablonneuse presque stérile est la couche 6 des stratigraphies établies en H II 13 et
G II 16 (Cliché S. L).
Dans la zone des carrés G II 1 1, 12, 14, 15, 16 et G III 4, ainsi qu'en H II 13, 14 et H III 1, la situation en surface du remblai est maintenant très différente de celle relevée par M. Pinard dans son plan publié en 1961 21. Les vestiges de constructions musulmanes d'époque médiévale sommairement signalées alors22 avaient totalement disparu en 1974 : il n'en reste plus que le fond du puisard d'une citerne qu'un décapage de surface a fait réapparaître, son radier en partie implanté sur une pile de fondation romaine (en G III 4, H III 1); faute d'un relevé en coupe et en élévation dans la publication de la fouille précédente, la relation de cet élément avec les vestiges aujourd'hui disparus est perdue. Par ailleurs, de nouvelles piles de fondation ont été partiellement dégagées dans ce secteur, en G II 14-15, G II 1 1, G II 12, H III 7 et H III 10. La coupe dans le remblai au contact de l'une de ces piles (en G III 4 : cf. fig. 15) ne fait apparaître aucune fosse de fondation coupant les strates, lesquelles viennent buter contre la pile : le puits a donc été
soigneusement creusé aux dimensions de la pile à élever, dont les parois apparaissent bien dressées, avec un profil de pyramidion renversé, la section du sommet étant légèrement plus grande que la section de la base. Les piles de l'alignement médian (en F III 15 et 16, G III 6 et 7) comportent dans leur maçonnerie des éléments de remploi, notamment des petits mœllons de parement d'opus reticulation, ce qui les dénonce clairement comme postérieures à la première organisation de l'esplanade, caractérisée et datée par l'emploi de cet appareil dans des structures de soutènement, comme il a été vu. Les piles de l'alignement méridional, moins bien dressées, employant un mortier différent, et moins profondément jetées dans le remblai, paraissent plus tardives que les précédentes. Quant aux piles de l'alignement septentrional (en G III 16, H III 13, H III 10 et H III 7), elles sont constituées encore différemment, de gros blocs de lias ayant été jetés dans un puits, seule la partie supérieure de la pile étant approximativement dressée (cf. fig. 20).
En H IV 3, le plan dressé par M. Pinard faisait apparaître, en surface de la partie résiduelle du remblai, un bassin (ou fond de citerne?) maintenant disparu. Les sondages entrepris là ont mis au jour, en Hill 16, des structures implantées sensiblement selon l'axe de la cadastration julienne, mais qui sont des fondations de constructions d'époque musulmane. En H III 15, la fouille a mis au jour un silo également d'époque médiévale musulmane, en forme de goutte (fig. 18), creusé en partie au détriment d'un grand mur de soutènement d'époque impériale romaine, qu'il entame; il s'agit peut-être là du silo comblé que Beulé découvrit en 1859 lors d'un de ses sondages23. La fouille de ce silo a fourni en abondance de la céramique musulmane en majorité d'époque fatimide, mais aussi du matériel dont nous avons vu qu'il était caractéristique de la composition du remblai : céramique attique finale et précampanienne, campa- nienne A, imitations de céramiques à vernis noir, céramique de tradition punique tardive; signalons aussi un fragment épigraphique provenant
21 Cf. Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, pi. I; cf. aussi cliché aérien oblique, pi. II).
22 Ibid., p. 77.
23 Cf. Beulé, Fouilles à Carthage, p. 42 et pi. I : « fouilles D», qui semblent toutefois, sur ce relevé très imprécis, sises plus vers le sud-est.
LU SIX I HL R Λ (1974-1975) 75
Λ
Fig. 18 - Vue du talus nord du sondage H III 15 : silo d'époque musulmane, comblé (cliché S. L.).
de ce silo : plaque de marbre blanc brisée de tous côtés, ép. 12-14 mm, h. 1. 70 mm :
.... I V I Ç (c ou ο ?) (fig. 19).
Un dernier sondage a enfin été entrepris en I IV 7. Il a fait apparaître, dans un secteur très bouleversé par des fouilles anciennes (peut-être des sondages de Beulé) des structures, inclinées à 10° vers l'est par rapport à la cadastration julienne, dans lesquelles abondent les éléments de remploi d'époque impériale romaine. Une récolte très importante de céramique vernissée musulmane a été faite dans ce sondage; dans les couches profondes (mais le sondage n'a pas été poursuivi au-delà de 2,70 m au-dessous de la surface du sol actuel, c'est-à-dire au-dessous de la cote 49,84), le matériel céramique d'époque hellénistique, comparable à celui des sondages précédemment décrits, redevient abondant.
lV»-'V',
Fig. 19 - Fragment de dédicace pro\enant du silo comblé, en H III 15 (Cliché IAM, A. Chéné).
76 BYRSA I
Fig. 20 - L'îlot où ont été pratiqués les sondages a, b, c et cl sous les sols; axe du cliché : sud-est; à l'arrière-plan, trois
piles de fondation romaines (Cliché S. L.).
époque punique, en forme de vaisseau allongé à double abside, aux parois intérieurement revêtues d'un ciment hydraulique très résistant fait de cendres et de chaux (dimensions : long. : 4,45 m; larg. : 0,93 m; prof. : 3,40 m). Compte non tenu de quelques débris modernes infiltrés ou jetés par l'orifice de puisage, et recueillis dans un petit cône d'effondrement situé entre 0,60 m et 1 m, la citerne contenait un abondant matériel céramique27 : céramique attique tardive et précampanienne, campanienne A (notamment des tessons des formes 23, 27, 31, 34, 36, 42, 55), imitations diverses - notamment à pâte grise - de céramique à vernis noir, céramique de tradition punique; les fragments de vases récipients sont naturellement spécialement fréquents : tessons de bords d'amphores puniques de profil Cintas 312-313, 314 et 315, la partie supérieure complète d'une amphore de type gréco-italique (fig. 21). Plusieurs monnaies ont été retirées de
2.2.) Relevés et soudages clans le quartier de maisons dégagé par les fouilles de J. Ferro η el M. Pinard.
Seule une description rapide des édifices dégagés entre 1952 et 1959 par J. Ferron et M. Pinard a été faite par les fouilleurs dans leur publication24. L'étude architecturale de ces vestiges seulement signalés et simplement relevés en plan au 1/1 00e est d'autant plus urgente que depuis bientôt vingt ans qu'ils ont été mis au jour, sans avoir été consolidés ni protégés, les murs et les sols ont déjà beaucoup souffert des intempéries (fig. 5 et 20) 2\
Un relevé de détail au l/50e et au 1/20° a été entrepris en 197526. Deux citernes ont été vidées à l'occasion de cette campagne de relevés, en Hill 13 et en G IV 3.
En H III 13, la citerne est du type fréquemment attesté dans les constructions de basse
24 Cf. supra, p. 33. 2ί Des mesures de consolidation ont déjà été prises,
notamment en F III 7 (reprise du petit appareil des parois d'une citerne, consolidation des dalles de couverture), en G III 14 et 15, en H IV 5 (reprise et consolidation de murs et de sols, protection d'enduits).
2(1 Amorcés en 1975 par G. Hallier, chef du bureau d'architecture de ΓΙ. A. M., ces relevés ont été par la suite poursuivis par G. Robine, architecte affecté à la mission de Carthage par le Ministère des Affaires Etrangères.
Fig. 21 - Citerne en H III 13 : partie supérieure d'une amphore gréco-italique (Cliché IAM, A. Chéné).
27 Ce matériel sera publié par la suite de façon exhaustive en même temps que l'unité d'habitation à laquelle appartient la citerne : on ne mentionne ici que les quelques éléments dateurs de ce matériel.
LE SECTEUR A (1974-1975) 77
0 1m GH.SL
Fig. 22 - Citerne en G IV 3 (minute de G. Hallier, cotes relevées par S. Lancel).
cette citerne; entre 1,20 m et 1,80 m de profondeur, cinq bronzes du monnayage carthaginois datables entre la fin du IVe siècle et le début du IIIe (respectivement types 94-98, 109-119, 102- 105, 120-123 de la Sylloge Nummo rum Graeconim de G. K. Jenkins, vol. 42, North Africa, Copenhague, 1969); à 1,50 m de profondeur, un bronze du monnayage carthaginois datable entre 241 et 238 (S. N. G., type 251-252); à 2 m, un bronze datable entre 241 et 221. Sans leur accorder une valeur
absolument déterminante, une citerne n'étant pas un milieu réellement scellé, on retiendra ces indications chronologiques, qui fournissent des dates entre le début du IIIe siècle et le milieu du second siècle (céramique campanienne A).
La citerne sise en G IV 3 est une citerne profonde (6,10 m) en forme de bouteille, de plan elliptique (2,50 sur 2 m), comportant un parement intérieur de gros blocs alternant en lits irréguliers avec de petits moellons; ce parement n'est pas revêtu d'un enduit ou d'un ciment (fig. 22) 28. Le matériel recueilli dans la fouille de cette citerne est pour l'essentiel celui qui vient d'être décrit. Une seule monnaie : un as républicain daté entre 187 et 155 (datation de Syden- ham, The Coinage of the Roman Republic, p. 28, n° 264; daté entre 169 et 158 par Crawford, Roman Republican Coinage, t. 1, 1974, p. 243, n° 196,1).
D'autre part, quatre sondages ont été effectués sous des niveaux scellés dans la zone comprise dans les carrés G III 15 et 16, G IV 3 et 4 (fig. 20 et 23).
a) En G III 15, un sondage de 1 m de largeur sur 2,20m de longueur a été pratiqué sous le béton de pose d'une mosaïque en opus tessella- tum monochrome fait de tesselles de marbre blanc (fig. 24 et 25; coupe, fig. 26). Sous le nidus, dont la faible épaisseur (2 à 3 cm) peut s'expliquer par la compacité du terrain sous-jacent, une première couche, 1, est faite d'un cailloutis très tassé, stérile; la couche 2 est également une couche ou plutôt une poche de petits mœllons constituée pour rattraper le niveau, la déclivité naturelle étant ici assez marquée. La couche 3, qui s'épaissit vers l'amont, est une strate noire, riche en cendres et en charbons, comportant de grosses masses de scories métalliques; une petite enclume cubique en calcaire dur à grain fin (fig. 27), relevée dans la couche confirme qu'il s'agit bien là de débris de forge, de traces d'une petite installation industrielle dont on ne peut toutefois préciser davantage la nature. La
:s II s'agit donc là d'un type de citerne inédit par rapport à ceux qui ont été relevés par J. Ferron et M. Pinard dans leurs fouilles sur la colline (cf. Cahiers de Byisa, IX, 1960- 1961, p. 98); différent aussi des variantes énumérées par Ch. Saumagne dans son rapport jusqu'ici inédit des fouilles du versant est : infra, p. 301, note 84.
78 BYRSA I
Fig. 23 - Plan de l'îlot situe en G III 15 et 16, G IV 3 et 4 (sondages a, h, c et d) (Relevé I.A.M., M. Borély).
couche 4 est une loupe d'argile presque pure, au contact du sol vierge 5, tuf argileux comportant des poches de sable jaune et des noyaux de grès tendre.
Le matériel ci-dessous enregistré (fig. 28 à 30) a été recueilli dans les couches 2 et 3 :
Céramique attique et précampanienne : A.101. 4 : fond de patere de forme 21/25; A.101. 5 : tesson de bord, avec départ d'anse, de
kylix de forme 42; A.101. 6 : fragment de lampe tournée à vernis
noir, probablement type Howland 23 c;
A.101. 7 : bord de forme 23, un simple épaissis- sement du bord remplaçant le rebord plongeant; sillon double près du bord;
Céramique campanienne A : A.101. 8 A.101. 9 A.101. 10 A.101. 11 A.101. 12 A.101. 13
tesson de bord de forme 55; tesson de bord de forme 55; tesson de bord de forme 5? tesson de bord de forme 28; tesson de bord de forme 25; tesson de bord de forme 27;
Imitations diverses de céramiques à vernis noir : A. 101. 14 : bord de forme 21/25 à vernis grisâtre
écaillé;
LE SECTEUR A (1974-1975) 79
Fig. 24 - Mosaïque en opus tessellatiim de marbre blanc (G III 16); on distingue à gauche sur le cliché la base d'une pile de fondation romaine reposant sur le pavement
(Cliché S. L).
Fig. 25 - Sondage α sous le béton de pose de la mosaïque (en G III 15) (Cliché S. L.).
49,13 NG mosaïque
_50
_100
·λ·λ Noyaux de grès 1 Cailloutis 2 Petits moellons
COUPE*AA-_GIII 15
tir* Scories métalliques 3 Cendres. charbons 4 Argile
5 Tuf argileux
50cm
Fig. 26 - Sondage a en G III 15; coupe sur talus est (Relevé S.L., mise au net I.A.M., M. Borélv).
80 BYRSA I
A 101.3 bcm
Fig. 27 - Matériel du sondage a (A. 101) : enclume en pierre {del. Ph. de Carbonnières).
A. 10 1.1 5 : bord de forme 28 à pâte grise et couverte gris foncé;
A. 10 1.1 6 : bord de forme 22; pâte beige rosé, vernis rouge orangé écaillé sur la face externe;
Céramique de tradition punique : A. 10 1.1 8 : bord de jatte; pâte feuilletée, dure,
très cuite, ocre rose; surface lissée blanchâtre; décor de feuilles d'eau brunâtres peintes sur la face externe du marli;
A.101.19 : tesson de fond de plat; pâte ocre brune; deux filets noirs peints sur la face interne;
A. 10 1.20 : fragment de fond de plat; pâte ocre; deux filets brun-rouge sur la face interne;
A. 10 1.21 : fragment d'embouchure de forme fermée; pâte ocre au cœur, blanchâtre en surface;
A. 10 1.22 : fragment de bord de grande jatte; mêmes caractéristiques que le précédent;
A. 10 1.23 : fragment de fond de plat; filets lie de vin sur la face interne;
A.101.24, 25 et 26 : trois tessons de bords de bols, à décor de bandes et filets rouge et brun rouge sur le bord externe;
A.101. 1 : fragment de bord de grand plat, à marli plat puis plongeant; pâte verdâtre au cœur, blanchâtre en surface;
A.101. 2 : fragment d'embouchure d'amphore de profil Cintas 312/313;
Céramiques diverses : A. 10 1.1 7 : petit tesson amorphe; pâte et surface
beige; repeints noirs; A. 10 1.27 et 28 : deux fragments de bords de réci
pients allant au feu; pâte couleur brique, feuilletée, dure, très cuite; surface gris foncé;
A. 10 1.29 : fragment de gros vaisseau portant des encoches profondes faites avant cuisson; fragment de tabouna?
A. 10 1.30 : fragment de terre cuite en forme de tronc de pyramide à section rectangulaire;
A. 10 1.3 1,32,33 et 34 : quatre fragments de grosses terres cuites à parois externes arrondies; pâte brique au cœur, brun-noir en surface, souvent vitrifiée;
νττ
AKT
16 ï
0 5cm
Fig. 28 - Matériel du sondage a (A. 101) : (del Ph. de Carbonnières).
LE SECTEUR A (1974-1975) 81
Monnaies : deux bronzes du monnayage carthaginois, l'un de 10mm de diam., type 94-98 de la S.N.G. de Jenkins, datable entre la fin du IVe siècle et le début du IIIe, l'autre de 18mm de diam., type 144-178, datable de la première moitié du IIIe siècle.
On retiendra de ce sondage la présence, sous l'unique niveau de sol d'habitat, représenté au demeurant par un pavement de type très évolué (opus tessellatiun régulier), de données suggérant une activité industrielle sans doute métallurgique (aux indications fournies par les scories et l'enclume A.101.3, ajouter les fragments A.101.29 à 34). Ces données sont datées tardivement, jusqu'au début du IIe siècle, par les trouvailles de campanienne A.
b) En G IV 4, un sondage pratiqué sous un sol en opus signinwn, dernier sol en place d'une pièce où les traces d'incendie sont très visibles
4101
_d
28
Fig. 29 - Matériel du sondage a (A. 101) : (del. Ph. de Carbonnières).
Fig. 30 - Matériel du sondage a (A. 101) : (del. Ph. de Carbonnières).
(fig. 31; plan, fig. 23; coupe, fig. 32) a fait apparaître, à 0,46 m sous le niveau du sol, une large structure a, qui semble bien être une structure de fondation se développant parallèlement au mur a de cet îlot; contre cette structure a vient buter une couche d'incendie qui passe sous la fondation du mur b, lequel appartient au même état du bâtiment que le mur a; des fragments d'opus signinwn (fig. 33), débris d'un sol qui n'est plus en place, ont été recueillis à ce niveau.
Un matériel abondant (A. 106) a été collecté dans cette couche. Une analyse quantitative par pesées fait apparaître, sur un poids total de 10,280 kg de céramiques recueillis, le décompte suivant : grosse céramique punique (fragments d'amphores, tessons d'une épaisseur supérieure à 6mm) : 7,750kg; céramique punique fine, y compris les fragments de balsamaires : 1,650kg; récipients allant au feu (marmites, casseroles); 0,510kg; céramiques à vernis noir (surtout cam-
82 BYRSA I
Fig. 31 - Sondage Ζ? en G IV 4; à droite du cliché, la fondation a' est parallèle au mur α (Cliché S. L.).
panienne A) : 0,160kg; imitations diverses (en général à pâte grise) de céramiques à vernis noir : 0,150kg; tessons roulés (galets) : 0,210kg.
Ce décompte fait apparaître une très faible proportion (0,160 kg sur 10,280 kg) de céramiques sûrement importées par rapport aux céramiques locales. Céramique précampanienne (fig. 34) : A.106.6 : fragment de fond de plat ou de coupe
(forme 21?); face interne : palmette dans un large cercle de guillochures; graffito incisé sur la face externe; pâte beige rosé finement grenue; vernis noir luisant;
Céramique campanienne A : A. 106. 7 : fragment de fond de petite patere
(forme 25?); A. 106. 8 et 9: deux bords de forme 34; A.106.10 : tesson de bord de forme 36; A. 106. 11 : tesson de bord de forme 55; A.106.12 : tesson de bord de forme 28; A.106.13 : tesson de bord de forme 31; A. 106. 14 : tesson de bord de forme 23; Imitations diverses de céramiques à vernis noir
(A.106.15 à 25 sont des céramiques à pâte grise
cendres _ charbons
tuf argileux
Fig. 32 - Coupe est-ouest du sondage b (Relevé I.A.M., M. Borély).
LE SECTEUR A (1974-1975) 83
Fig. 33 - Débris d'opus iigiiiiium au niveau de la couche d'incendie séparant les couches A. 106 et A. 107 (sondage b)
(Cliché S. L).
en général un peu feuilletées, plus ou moins foncées, à engobe gris à gris noir) :
A.106.15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 : tessons de bords apparentés à la forme 28, à ourlet extérieur plus ou moins marqué;
κ
25 3cm
A.106.20 : tesson de forme 31 à paroi mince; A.106.23 : tesson de bord de forme 36; A. 106.24 et 25 : deux fragments de paroi à
pseudo-godrons; A.106.26 à 28 sont des céramiques à pâte beige
rosé ou saumon, finement grenue, à vernis rouge ou rouge rosé (fig. 35) :
A.106.26 : deux tessons reconstituant une forme de bol apode (cf. forme 33?);
A.106.27 : tesson de bord de forme 21/25; A. 106.28 : tesson de bord ourlé extérieurement
(forme 22?); A.106. 4 : une forme 23 complète, miniaturisée;
pâte ocre jaune, traces de vernis orangé (fig. 35);
Récipients allant au jeu (fig. 36) : A.106.30 : fragment de bord de casserole; pâte
brique, surface gris foncé; A.106.29 : fragment de grande marmite; mêmes
caractéristiques que le précédent; Céramique de tradition punique (fig. 36 et 37) : A.106. 32 : tesson de bord ourlé extérieurement;
repeint rouge sur le bord externe;
A 106
26 28
A 106. A
A 106.5
Fig. 34 - Matériel du sondage b; couche A. 106 {del. Ph. de Carbonnieres).
Fig. 35 - Matériel du sondage b; couche A. 106 (del. Ph. de Carbonnieres).
84 BYRSA I
37
33
0 5cm
Fig. 36 - Matériel du sondage b; couche A. 106 (del. Ph. de Carbonnières).
A.106. 5 : forme incomplète, peut-être d'un couvercle (retourner l'image, fig. 35); pâte beige, sans engobe;
A. 106.38 : fragment de terre-cuite en forme de tronc de pyramide à section rectangulaire (fig. 37); cf. déjà A.101.30;
A. 106.44 : fragment de terre cuite vitrifiée à face externe arrondie (cf. déjà A.101.31 à 34).
Monnaies : un bronze du monnayage carthaginois (diam. : 20 mm; cf. type 307-323 de la S.N.G. de Jenkins), datable circa 221-210 av. J.-C.
L'indication fournie par la monnaie n'est pas négligeable; ce sont cependant les tessons de campanienne A qui donnent le terminus post quern : le dernier sol de la maison ne peut pas être beaucoup antérieur au milieu du second siècle.
Au-dessous de la couche d'incendie, c'est-à- dire au-dessous de la cote 48,96, le matériel recueilli le long de la structure à, beaucoup
A 106 to
Y7
A. 106.33 : fragment de marli de patere; engobe rouge sur la face supérieure; A. 106.34 : fragment de marli de patere; repeint rouge sur le bord; A. 106.35 et 36 : fragments de fonds de forme fe
rmées; A. 106.37 : fragment d'embouchure de gros vais
seau, à large ourlet extérieur; A. 106.39 : fond de forme fermée; A. 106.40 : forme complète de balsamaire; A. 106.41 à 43 : tessons de balsamaires; A.106. 1 : fond et panse de forme fermée
(fig. 38). Divers : A.106. 2 : carreau de terre cuite en forme de
losange (fig. 39); ép.: 27/31 mm; long, dans le grand axe : 205 mm; pâte verdâtre;
A.106. 3 : carreau en schiste bleu, en forme de losange irrégulier (fig. 40), à pans obliques; ép. : 49/50 mm; long, dans le grand axe : 203 mm.
39
0 5 cm
Fig. 37 - Matériel du sondage b; couche A. 106 (del. Ph. de Carbonnières).
LE SECTEUR A (1974-1975) 85
A 106 1
0 Fig. 38 - Matériel du sondage b; couche A. 106
(del Ph. de Carbonnières).
A 106 3
A 106 2
5cm
Fig. 39 - Matériel du sondage b; couche A. 106 (del. Ph. de Carbonnières).
5cm
Fig. 40 - Matériel du sondage b; couche Α.. 106 (del. Ph. de Carbonnières).
86 BYRSA I
A 107
Fig. 41 - Matériel du sondage b; couche A. 107 (del. Ph. de Carbonnières).
moins abondant, n'est pas très sensiblement différent (lot A. 107). Mais en bas du sondage on note, au contact d'une loupe d'argile qui est elle- même immédiatement superposée au tuf natif, parfois incluse dans ce sol naturel dont elle est une des composantes, d'importantes poches de cendres et de charbons, dans lesquelles on recueille des fragments de terres cuites épaisses, parfois marquées d'encoches, souvent presque vitrifiées (fig. 41)29.
L'analyse quantitative par pesées du lot A. 107 fait apparaître, sur un total de 3,920 kg de céramiques recueillies, le décompte suivant : grosse céramique punique : 3,100kg; céramique punique fine, y compris les fragments de balsamai- res : 0,650kg; récipients allant au feu (marmites,
29 On se reportera à des trouvailles d'un matériel apparemment très semblable faites par P. Gauckler dans sa fouille du «Céramique» de Dermech : Nécropoles puniques de Carthage, t. I, Paris, 1915, pi. CCXXIV; cf. aussi, supra, p. 29-31, les résultats de sondages stratigraphiques réalisés par Ch. Saumagne en 1925 et 1931 dans les parties basses de la pente sud de notre colline.
etc.) : 0,080 kg; céramique à vernis noir : 0,090 kg. La proportion de ces dernières apparaît donc très faible; on ajoutera qu'elles étaient réduites à des fragments non dessinables, parmi lesquelles on doit signaler deux tessons amorphes de campanienne A, et un fragment de lampe (A.107.11) (fig. 42). Imitations de formes de céramiques à vernis noir : A. 107. 1 : fragment de bord de forme 36; pâte
grise, vernis brun-noir très écaillé; A. 107. 2 : fond de forme 28; pâte grise, vernis
gris foncé; A. 107. 4 : fragment de bord de forme 21/25;
pâte brique; vernis brunâtre; Récipients allant au feu : A. 107. 3 : fragment de bord de plat à cuire; pâte
brique, surface gris foncé; Céramique de tradition punique : A. 107. 5 : fragment de large marli de patere;
engobe rouge-orangé sur la face supérieure;
A 107
Fig. 42 - Matériel du sondage b; couche A. 107 [del. Ph. de Carbonnières).
LE SECTEUR A (1974-1975) 87
A. 107. 6 : fragment de bord évasé de jatte ou de mortier; pâte ocre au cœur, surface beige; repeints de bandes et de filets brun rouge sous le rebord;
A.107. 7 : tesson de bord d'un grand mortier; pâte verdâtre au cœur, surface blanchâtre;
A.107. 8 : fragment de marli plongeant d'un grande jatte; mêmes caractéristiques que le précédent;
c) A cheval entre G IV 4 et G III 16, un troisième sondage a été fait dans une petite pièce délimitée par les murs c, e, f et g (fig. 23 : plan; fig. 42bis et 43 : coupe). Les niveaux de sols avaient disparu dans l'angle nord-ouest de cette petite pièce, mais, le long de la cloison f, trois sols successifs en opus signinum ont été relevés (fig. 44). Les sols a et b sont rigoureusement superposés et manifestent un même plan; le sol
COUPE "SN"_ Im
I I I
Fig. 42 bis - Coupe sud-nord des sondages d et c (G III 16 - G IV 4) (Relevé I.A.M., M. Borély).
A.107. 9 : fragment de col de forme fermée (amphore); pâte chamois à dégraissant siliceux, surface beige pâle, repeint brun clair;
A.107. 10 : fragment d'embouchure de forme fermée, ourlée extérieurement; pâte ocre, surface beige clair.
On retiendra donc de ce sondage pratiqué en G IV 4 deux indications : d'une part la présence au niveau profond, comme à quelques mètres plus au sud en G III 15, de poches de cendres et de charbons, de scories et de terres cuites vitrifiées, qui suggèrent une installation industrielle; d'autre part l'indication chronologique concernant Y opus signinum du dernier niveau, peu avant le milieu du second siècle. Quant au niveau de sol antérieur, mal assuré, qui pourrait être en liaison avec la structure a , il ne saurait être beaucoup plus ancien.
le plus ancien, c, est lié à un plan différent de la pièce ou de l'îlot, et passe sous la cloison g, qui s'appuie sur le mur e sans être liaisonnée avec lui.
Le sol supérieur, a, est un terrazzo de facture médiocre qui n'est séparé du sol précédent que par un faible intervalle de 8 à 10cm, dans lequel on observe une sorte d'assise de réglage faite de petites pierres plates, de fragments de signinum et des morceaux d'un petit autel brûle-parfums en terre cuite (A. 108.1 fig. 45) 30. En dehors de cet objet, le matériel recueilli dans cette souche 1 de faible épaisseur est le suivant (fig. 46) :
"' Dimensions : 0,190 χ 0,140 χ 0,120; même type d'objet, de dimensions très proches, trouvé sur un sol dans la fouille de J. Ferron et M. Pinard: Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, p. 132, n°339, et pi. LVI.
BYRSA I
PhdeC
Fig. 43 - Sondage c, coupe nord-ouest-sud-est (Relevé Ph. de Carbonnières).
1m
A. 108. 2 : petit fragment de fond, avec pied, d'une coupe ou patere; pâte beige rosé finement épurée; vernis noir luisant (céramique attique ou précampanienne);
A. 108.3 : petit tesson taillé en forme de jeton arrondi; pâte ocre, grenue, vernis noir bleuté à reflets métalliques : campanienne A, comme deux autres tessons amorphes relevés dans cette couche;
A. 108.4 : fragment de bord; pâte gris beige, vernis brun noir (imitation d'une forme à vernis noir, peut-être f. 27);
A. 108.5 : petit fragment de panse de forme ouverte; pâte rouge orangé, vernis rougeâtre (imitation d'une forme à vernis noir);
A. 108.6 : fragment de bord de forme fermée (cf. Cintas 241); pâte verdâtre, surface lissée
châtre (céramique de tradition punique; à ce tesson s'ajoutent dans cette couche plusieurs autres tessons amorphes de cette catégorie).
Le matériel dateur de cette couche, et donc du sol a, est constitué par la céramique campanienne A, qui n'autorise pas une datation beaucoup antérieure au milieu du second siècle.
Le sol médian, b, est un opus signinum de belle facture, parsemé d'éclats de marbre blanc; il est lié à un enduit mural qui remonte le long des murs c et e. Le matériel recueilli dans la couche 2, de faible épaisseur (9 à 10cm) qui sépare ce sol du sol inférieur est le suivant (fig. 46) : A. 109.1 : fragment de fond de patere; pâte beige
rosé finement épurée; vernis noir luisant; pal- mettes imprimées reliées par des guirlandes (céramique attique tardive);
LE SECTEUR A (1974-1975) 89
A.109.2 : petit fragment de fond de coupe; pâte ocre rose; vernis noir luisant; trois cercles de guillochures (précampanienne ou camp. A précoce?);
A.109.3 : tesson de bord de forme 21/25; mêmes caractéristiques que le précédent;
A 108
Fig. 44 - Sondage e; sur le sol Z?, fragments d'un petit autel brûle-parfums en terre cuite (Cliché S. L.).
A 109
Fig. 45 - Autel brûle-parfums en terre cuite retrouvé en fragments sur le sol b (Cliché I.A. M., A. Chéné).
0 5cm
Fig. 46 - Sondage c; matériel de la couche 1 (A. 108) et 2 (A. 109) (ciel. Ph. de Carbonnières).
A. 109.4 : fragment de bord de forme 25, pâte ocre rouge foncé, vernis noir peu luisant (céramique campanienne A);
A.109.5 : trois tessons reconstituant partiellement une forme de bol (forme 30/31); pâte et vernis rouge orangé (imitation de céramique à vernis noir);
A. 109.6 : deux fragments d'un vase brûle-parfums; pâte gris-verdâtre, décor fait d'incisions et de perforations (cf. Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, p. IX, n° 442). On y ajoutera quelques tessons amorphes de céramique punique à repeints et achrome.
Pour cette couche 2 également, et donc pour le sol /;, c'est la campanienne A (A.109.4) qui fournit l'indication chronologique, sensiblement la même que pour la couche précédente.
Enfin le sol inférieur, e, est un terrazzo assez fragile sans liaison vers le nord avec le mur de la pièce. On peut distinguer sous son niveau deux
90 BYRSA I
couches, 3a et 3b, séparées par un sol damé cl. On a recueilli dans la couche 3a (fig. 47): A.I 10.1 : fragment de fond de vase; pâte beige
rosé, fine, bien épurée, vernis noir brillant; filets et cercles concentriques sur le fond externe;
A.110.2 : fragment de marli de patere de tradition punique; pâte ocre grenue, engobe rouge sur le bord supérieur;
A.110.3 : fragment d'un gros vaisseau (ép. 23 à 26 mm); pâte brunâtre à gros grains de dégraissant siliceux; nombreux tessons amorphes de panses de vases, dont :
A.110.4 : fragment de panse avec attache d'anse; pâte ocre; surface beige non engobée;
A.110bis : grand fragment de fond et de panse de kylix (forme 42 B) pâte beige rosé clair, finement épurée, vernis noir très lisse, luisant; double cercle de palmettes se chevauchant sur le fond interne; bandes et filets concentriques sur le fond externe (fig. 48). Datation 2e quart du IVe siècle (cf. J. et L. Jehasse, Nécropole préromaine d'Alena, n° 2142).
On notera encore dans cette couche 3a plusieurs fragments de grosses terres cuites à face externe arrondie, souvent vitrifiées en surface. Au-dessous du sol rudimentaire d, la couche 3b ne comporte que de rares tessons amorphes de céramique punique achrome; e est une loupe de cendres et de charbons, à peu de distance du sol vierge, 4.
Les éléments dateurs dont nous disposons pour ce sondage n'autorisent pas de conclusions chronologiques trop précises. On a vu déjà que les deux sols supérieurs a et b (ce dernier en liaison avec le mur c qui enfonce profondément ses fondations dans un terrain remanié) se succèdent sans doute assez rapidement dans la première moitié du second siècle. Le terminus post quem du sol c est la kylix A.110bis du deuxième quart du IVe siècle; mais cet objet recueilli à hauteur du sol d date moins le niveau d'habitat c qu'il ne date la couche 3a, caractérisée par les terres cuites vitrifiées, qui manifestent là aussi une activité industrielle antérieure aux habitats.
d) En G III 16, un simple nettoyage a fait réapparaître, dans une petite pièce étroite qui pourrait être l'extrémité d'un couloir d'accès, une mosaïque en opus figlinum (fig. 49) signalée
A110
0 5cm
Fig. 47 - Sondage c; matériel de la couche 3 (A. 110) {del. Ph. de Carbonnières).
A 110 bis
5cm Fig. 48 - Sondage c; matériel de la couche 3 (A. 110 bis)
{del. Ph. de Carbonnières).
LE SECTEUR A (1974-1975) 91
Fig. 49 - Mosaïque en opus figlimmi (opus segmentatimi en terre cuite), en G III 16-H III 9 (Cliché S. L.).
Fig. 50 - Sondage a, en G III 16, vue du talus nord-ouest (Cliché S. L.).
jadis par J. Ferro η et M. Pinard Ή. Le niveau de ce pavement (cote 48,90) correspond à celui du sol supérieur (sol a) de la petite pièce voisine du sondage précédent. Les tesselles sont de petits parallélépipèdes obtenus en fractionnant des morceaux de panse de gros vaisseaux de terre cuite, notamment des amphores; leur épaisseur varie entre 8 et 15 mm, la largeur des côtés (approximativement carrés) entre 18 et 30mm; ces tesselles sont posées à plat, la face convexe vers le haut, sur un béton à gros cailloutis, d'environ 45 à 50mm d'épaisseur. De la terre s'est infiltrée entre les tesselles et ce rudus, formant une pellicule pulvérulente de plusieurs millimètres d'épaisseur, qui rend la mosaïque très fragile. Le sondage a été entrepris là où cet opus figliiiuiii était plus particulièrement désagrégé.
Il a fait apparaître, sur 65cm d'épaisseur, plusieurs couches et trois sols distincts au-dessous du dernier niveau en date, a, c'est-à-dire Vopus liglimuu que nous venons de décrire (fig. 50 et 51).
Sous l'épais béton de pose des tesselles de terre cuite du sol a, la couche 1 est une strate
1m
Cahîets de Byisa, IX, 1960-1961, p. 97, en bas. Fig. 51 - Sondage cl, en G III 16; coupe du talus nord-ouest
(Relevé Ph. de Carbonnières).
92 BYRSA I
intersticielle assez mince; à 80cm du mur li, cette couche s'épaissit en une poche de décombres mêlés de cendres et de charbons qui a aussi affecté le sol b, mortier de tuileau rouge - opus signimtm - avec inclusions de fragment de terre cuite verdâtre (fig. 52), ainsi que le sol c, simple jetée de chaux mêlée de fragments de terre cuite rouge: ces deux sols ont donc été endommagés l'un et l'autre par une destruction à la suite de laquelle a été posé Yopus jiglinum du sol a. Outre des fragments de récipients allant au feu et des tessons amorphes de céramique punique achrome, on a recueilli dans la couche 1 : A. 1 11.1 : plusieurs fragments reconstituant en
grande partie une forme 49 (fig. 53) de campa- nienne A qui date la strate du début ou de la première moitié du second siècle.
La couche 2 sous le sol b en opus signinum est très mince et ne contenait aucun matériel significatif dans la portion assez restreinte que nous avons pu fouiller. En revanche la couche 3a présente une vingtaine de centimètres sous la mince jetée de chaux du sol c; on y rencontre en abondance des scories de fer et des fragments de terres cuites vitrifiées. Un très petit fragment de céramique attique à figures rouges a été recueilli dans cette couche, ainsi que plusieurs tessons amorphes de céramique attique tardive ou précampanienne; un autre élément dateur est A.122.7 (fig. 54), lampe tournée à corne latérale (type Howland 46 A, cf. Deneauve, Lampes de
A 123
5cm
Fig. 53 - Matériel du sondage cl: couche 1 (A. 111); couche 3a (A. 122); couche 3b (A. 123) (del. Ph. de Carbonnières).
Fig. 52 - Fragment du sol b (opus signinum), deuxième niveau du sondage d (Cliché S. L.).
Carthage, n° 200), datable du milieu ou de la seconde moitié du IIIe siècle; autre matériel : A. 122.1 : fragment de bord de forme 22; pâte
grise; vernis grisâtre avec bande d'empilement sous le rebord externe : imitation locale d'une forme de céramique à vernis noir;
A.122.2 : tesson de bord de récipient à feu; A. 122.3 : bord d'une forme fermée, ourlée exté
rieurement; pâte verdâtre, surface blanchâtre (céramique de tradition punique);
A.122.4 : tesson de panse de vase; pâte ocre sans engobe, décoration en pastilles imprimées;
A.122.5 : bord de forme fermée; pâte brunâtre au cœur; beige en surface, repeints de filets brun rouge sur le bord externe;
A. 122.6 : fragment de bord de gros mortier; pâte verdâtre, surface blanchâtre.
LE SECTEUR A (1974-1975) 93
-*,'*
Fig. 54 - Sondage d, couche 3a, lampe à corne latérale (Cliché S. L.).
La couche 3b, d'épaisseur un peu moindre, est séparée de la précédente par un lit de cendres et de charbons; on y retrouve deux fragments de grosses terres cuites à encoches, ainsi que des scories de métal, mais aussi une petite enclume en forme de parallélépipède de calcaire dur dont les faces (dimensions des plans de travail : 12 χ 14cm) présentent nettement des concavités résultant du martèlement et de l'usure (fig. 55). Matériel associé :
A. 123.3 : fragment de bord de kylix, forme 42 A; pâte gris beige, vernis noir tirant sur le brun; datation : milieu IVe siècle;
A. 123.4 : fragment de marli de patere de tradition punique; pâte ocre, engobe rouge sur le bord supérieur;
A. 123.5 : petit tesson de fond d'une kylix de forme 42 (même datation que A.123.3);
A.123.6 : fragment de fond de lampe tournée à vernis noir, type Howland 43; datation : deuxième moitié du IIIe siècle;
A.123.7; fragment de paroi de céramique attique (IVe siècle).
Comme dans le cas de la couche 3a, le terminus posi qiiem de cette couche 3b semble bien être le milieu ou la fin du IIIe siècle, l'imprécision des éléments dateurs (lampes A.127.7 et A.123.6) n'autorisant pas une plus grande précision. Vraisemblablement un peu plus ancienne est une patere à godet central et à large marli, en terre cuite ocre, portant encore des traces nettes de repeints rouges dans le godet et sur le marli (fig. 56); mais on sait que la dispersion chronologique de ces objets est large'2. Cette patere reposait à plat dans la couche, au niveau
A 123.2
Fig. 56 - Sondage d, couche 3b, patere punique (del. Ph. de Carbonnières).
5 cm
Fig. 55 - Sondage d, couche 3b, petite enclume en pierre dure (Cliché I.A.M., A. Chéné).
12 Cf. D. B. Harden, The Pottery from the Precinct of Tatiit at Salammbô, dans Iraq, IV, 1937, p. 83-85 : forme M 5-M 6, datables entre le VIe et le IVe siècle; cf. aussi S. Lancel, Tipa- sitami 111, dans Bull. d'Ardi. Alg., Ili, 1968, p. 135-136: forme lb (fig. 112), exemplaire datable du début du IVe siècle.
94 BYRSA I
du sol d. Ce sol d lui-même est une jetée de chaux grisâtre au-dessus d'un niveau damé, coupé par la fosse de fondation du mur h, alors que les trois niveaux supérieurs lui sont jointifs; on constate la profondeur (près d'un mètre) de la fondation de ce mur, nécessaire dans un terrain remanié. Au-dessous de ce sol d qui semble un sol d'atelier, la couche 4 est soit une couche de nivellement, soit encore la terre sablonneuse mêlée d'argile du puits de comblement d'une tombe sous-jacente : l'étroitesse du sondage et la présence des structures puniques tardives au niveau supérieur ne permettait pas de vérifier ce point. Dans la partie sondée de cette couche 4, le matériel est rare et malaisément datable : on notera un tesson de céramique punique à repeints.
La stratification révélée par ce sondage et son étude stratigraphique suggèrent donc une histoire sensiblement analogue à celle dont témoigne le sondage précédent; l'échelonnement chronologique est sensiblement aussi le même : le terminus post quern pour le niveau d'habitat le plus ancien au-dessus des couches d'atelier n'est pas antérieur au milieu du IIIe siècle, sinon même à la fin du IIIe siècle.
On observera enfin que les trois sondages pratiqués en ligne à l'est de l'alignement des murs a, d, e, h (fig. 23), c'est-à-dire les sondages b, c, et d, font apparaître deux niveaux (sondage b en G IV 4) et même trois niveaux d'habitation (sondages c et d) au-dessus des couches caractérisées par un matériel qui suggère une installation industrielle; en revanche, ces mêmes couches d'atelier sont immédiatement découvertes sous le pavement en opus tessellatum de marbre blanc de notre sondage a, en G III 15, de l'autre côté de cet alignement. Il se pourrait donc bien, en dépit du dernier état qui montre un passage entre les murs a et d, que l'alignement de ces murs ait été, à l'origine du développement de ce quartier de maisons (milieu et même plutôt seconde moitié du IIIe siècle), le mur délimitant vers l'ouest un îlot où la dévolution du terrain à l'usage d'habitat domestique aurait été un peu plus rapide, une activité de type artisanal ou industriel subsistant encore au-delà, vers l'aval, peut-être jusqu'à la fin du IIIe siècle. Des sondages en G IV 2 et 3, et dans l'angle sud-ouest de G III 16 devraient permettre de vérifier cette hypothèse.
3) Conclusions : bilan et perspectives.
On tiendra tout d'abord pour désormais bien établi que les structures d'habitat domestique d'abord reconnues par Mme C. Picard, puis dégagées par le P. Ferron et M. Pinard dans les années 1952-1959 sont bien d'époque punique, et d'époque punique finale. On sait que les fouil- leurs, pour proposer de dater de l'époque des Gracques des maisons dont ils constataient la sensible différence d'orientation avec l'axe de la cadastration urbaine (julienne) de Carthage, avaient argué qu'elles se trouvaient en revanche dans la même orientation que la cadastration rurale ordonnée par Ti. et C. Gracchus en 123 av. J.-C, et dont Ch. Saumagne a montré qu'elle était encore matérialisée, à la lisière nord-ouest de la colonie julienne, par un groupe de vestiges, et notamment par les grandes citernes de La Malga33.
Comme l'avait déjà soupçonné M. G. Picard, cette concordance approximative est illusoire^4. Nous pouvons maintenant l'affirmer avec des arguments nouveaux. En premier lieu, nous avons vu (cf. supra, p. 38) que la publication de documents inédits relatifs aux fouilles faites par Ch. Saumagne sur le versant est de la colline de Byrsa permettait de reporter en plan des vestiges significatifs d'un habitat punique datable entre le milieu du IIIe siècle et le début du IIe, manifestant diverses orientations - différentes de celles de notre quartier - qui paraissent commandées par les lignes de pente de la colline (fig. 18 et p. 39). En outre, la nouvelle citerne indiscutablement punique mise au jour en 1974- 75 dans le secteur B (citerne J, cf. fig. 6 et 22 et infra, p. 122), et dont l'axe est au demeurant à quelques degrés près le même que celui des vestiges - citernes et pans de murs - dégagés anciennement lors des fouilles du P. Lapeyre (cf. supra, p. 25 et fig. 2 et 18), matérialise encore une autre orientation : visiblement, les axes tournent avec la colline et les maisons qui en ont envahi sans doute progressivement les pen-
" Cf. J. Ferron et M. Pinard, dans Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 80-81; Ch. Saumagne, Colonia lidia Karthago, dans BCTH, 1924, p. 131-140; Vestiges de la colonie de C. Gracchus à Carthage, dans BCTH, 1928-1929, p. 648-664.
" G. Picard, Un quartier de maisons puniques à Carthage, dans Revue Archéologique, 1958, 1, p. 28-31.
LE SECTEUR A (1974-1975) 95
tes est et sud à l'époque des guerres puniques semblent avoir assez souplement épousé un relief dont les contraintes demeuraient, malgré quelques nivellements". Toutefois, la cohérence dans les axes dont témoigne le quartier de maisons dégagé par J. Ferron et M. Pinard suggère déjà qu'un plan concerté avait dû présider à ces aménagements, et que les orientations, de secteur en secteur, se modifiaient en fonction de paliers ou de surfaces prismatiques dont la détermination n'avait pas dû être laissée au hasard. C'est à la limite du secteur A et du sec-
" Ajoutons qu'en l'absence, regrettable, de la publication intégrale du rapport de Ch. Saumagne sur ses fouilles du versant est de la colline de Byrsa, on pouvait se reporter déjà aux constats faits par le même savant, et publiés ceux- là (dans BCTH, 1930-1931, p. 641-659) sur la colline voisine, dite de Junon, où le fouilleur a pris soin de relever le gisement de trois citernes puniques tardives construites aux dépens de tombeaux puniques des VIIe- VIe siècles et orientées dans un axe à peu près superposable à celui de la cadastration julienne de Carthage, ce qui manifeste bien l'absence de tout parti d'orientation systématique dans les implantation des habitats puniques relevés, qui sont tous d'époque basse (entre le IVe siècle et le IIe siècle). Certes, on a pu dire (Mme C. Picard, dans Karthago, III, 1951, p. 126) en se fondant sur des sondages faits à Dermech (fouille Vézat dans le terrain Clariond : BCTH, 1946-1949, p. 676-678; fouille Saumagne de la «maison du Paon»: BCTH, 1934- 1935, p. 51-58) qu'il «semblait bien qu'à l'époque des guerres puniques plusieurs quartiers de Carthage, si ce n'est la ville entière aient été bâtis suivant un plan orienté sud-ouest- nord-est». Mais, pour les parties hautes et moyennes de la ville, cette orientation générale, réelle avec de nombreuses variantes, est tout simplement celle de la ligne de hauteurs qui commence à Byrsa pour se terminer vers la mer avec le promontoire de Bordj-Djedid. On trouvera les mêmes observations (qu'il faut lire avec la même prudence) sur une orientation générale S.-O./N.-E. dans le livre posthume de P. Cintas, Manuel d'Archéologie punique, t. 2, Paris, 1976, p. 124-125, avec l'indication de légères variantes dans le détail, reportées fig. 9. Pour les parties basses de la ville, plus précisément en bordure du rivage, nous disposons maintenant des relevés faits par la mission allemande dans un terrain situé en face de l'ex-Palais Beylical, occupant environ la superficie de deux centuries de la cadastration romaine, à l'intersection du kardo XVIII est et du decuma- nus I nord : en ce qui concerne les niveaux préromains, la fouille révèle un habitat punique à partir du IVe siècle, avec des remaniements importants au IIIe; les axes sont rigoureusement parallèles à ceux de la cadastration romaine (renseignements communiqués par M. Fr. Rakob, chef de la mission archéologique de la République fédérale allemande, lors de la première session du Comité consultatif de l'UNESCO pour la campagne internationale de Carthage, en septembre 1975).
teur Β qu'une des articulations entre deux faisceaux d'orientations différentes devra être recherchée, si toutefois l'état du terrain après les fouilles du P. Lapeyre, et un long abandon, permet encore cette recherche.
Au demeurant, comme nous le disions plus haut (cf. supra, p. 27-28), cette même zone des anciennes fouilles Lapeyre est doublement une zone charnière, puisque c'est là, à la limite des anciennes fouilles du P. Delattre, que l'on cesse de relever des vestiges d'habitat et que commencent d'être attestées des sépultures tardives - IIIe siècle, peut-être début IIe : cf. supra, p. 22. On sait que Strabon, sur la base d'informations indirectes, dont on ignore la source, et qui ont trait à la basse époque carthaginoise, semble dire que tout le pourtour de Byrsa était habité %à. A quoi s'opposaient apparemment, avant même la reprise des fouilles en 1974, les constats de l'archéologie. Mais sommes-nous vraiment à Byrsa? La question se pose encore, en effet.
Ce qui est sûr du moins, pour en revenir aux structures préaugustéennes du niveau bas du secteur A, et limiter à cela ces conclusions provisoires, c'est qu'il s'agit bien là de maisons puniques, et puniques de date basse : les indications chronologiques fournies par nos sondages sous les sols concordent avec les dates suggérées déjà par le matériel recueilli par J. Ferron et M. Pinard dans les couches au contact de ces sols (cf. supra, p. 33). Les données nouvelles ne permettent pas de remonter plus haut que la seconde moitié, sinon même la fin du IIIe siècle pour le mise en place des structures, murs et sols, qui ont fait l'objet de ces sondages, et c'est dans les limites de la première moitié du IIe siècle que se situent les remaniements et recharges de sols que l'on peut constater. Sous les niveaux d'habitat, le trait commun de tous nos sondages est la mise en évidence d'une strate dont le facies, plus ou moins caractérisé ici ou là, incite à reconnaître, sinon toujours des niveaux d'atelier en place, du moins les traces laissées par une activité de type artisanal ou industriel utilisant les techniques du feu : forges sans doute, plutôt qu'ateliers de potiers? Scories exceptées,
'6 Strabon, XVII, 3, 14 : «Κατά μέσην 5έ την ζόλι,ν ή άκρο- ~ολις, ην έκάλουν βύρσαν, . . . κύκλω -εριοικουμένη ... ».
96 BYRSA I
aucun fossile vraiment déterminant, nul vestige d'installation en place ne permet une identification précise. Mais on se souviendra que Ch. Sau- magne avait déjà eu l'occasion de relever les traces apparemment sporadiques d'une activité de ce type sur le versant est et dans la partie basse de la pente sud de la colline (cf. supra, p. 31), et, par ailleurs, la proximité de telles installations industrielles avec la nécropole de haute époque attestée plus à l'ouest sur la colline ne serait pas pour surprendre : c'est bien à proximité d'un tel contexte funéraire que P. Gaukler, en 1901 a fouillé et fait connaître le «Céramique» de Der- mech".
Si le terminus ante quem de ces couches n'est autre que la fourchette chronologique assignable à la mise en place des structures d'habitat qui leur ont succédé - seconde moitié ou fin IIIe siècle -, et qui ont pu partiellement coexister avec elles, nous ne sommes pas encore en mesure d'en préciser le terminus post quem. C'est en fait le problème de la nature du niveau profond de ce secteur et de l'utilisation de cette partie de la colline à l'époque archaïque, qui est posé. Si dans l'état actuel des recherches aucun niveau funéraire n'a été reconnu sous les
sons dégagées par J. Ferron et M. Pinard, il n'en va pas de même dans le secteur des fouilles du P. Lapeyre, vers l'ouest, où les vestiges d'habitat domestique coexistent avec des tombes archaïques sous-jacentes™. Une situation identique a été observée par Ch. Saumagne sur la pente sud- est de la colline voisine, la colline dite de Junon, où des citernes de basse époque punique ont été construites aux dépens de tombeaux d'époque haute ™; et des indications analogues ont été données par le même chercheur - mais de façon douteuse, on l'a vu (cf. supra, p. 35), pour la nature et la datation du niveau funéraire - en ce qui concerne le versant est de notre colline. La caractérisation des niveaux profonds de notre secteur est donc un objectif prioritaire, dont la poursuite a chance de nous faire progresser sensiblement dans la connaissance de cette partie haute du site de Carthage aux époques archaïque et classique.
37 P. Gauckler, Nécropoles puniques de Carthage, t. I, Paris, 1915, pi. CCXXIV.
"Tombes Lapeyre: Revue Africaine, 1934, n° 360, p. 344- 351; tombes Ferron- Pinard : Cahiers de Byrsa, t. V, 1955, p. 53. Il convient certes d'y ajouter les tombes d'époque archaïque (VII-VIe siècles) fouillées par le P. Lapeyre en 1937-1938, reportées en F-G IV sur notre fig. 18 (cf. aussi fig. 6, p. 24); mais, faute de plan dans la publication au demeurant très sommaire des résultats de ces fouilles (cf. supra, p. 26), le report en plan de ces tombes aujourd'hui remblayée est nécessairement très imprécis.
*» Cf. BCTH, 1930-1931, p. 641-659.
LE SECTEUR Β (1974-1975)*
par JEAN-MICHEL CARRIÉ ET NICOLE SANVITI
i - presentation topographique. Les fouilles antérieures et la reprise
de l'exploration archeologique
Le deuxième secteur de fouille (convention- nellement baptisé «secteur B») occupe la partie centrale du périmètre exploité par les deux premières campagnes1. Sa délimitation est purement arbitraire, et ne répond à aucune spécificité autre que topographique (fig. 3). Fermé à l'est par la fondation occidentale du monument à plan basilical, largement ouvert à l'ouest vers le temple nouvellement découvert et les structures qui lui sont associées, ce secteur s'est établi à la limite des fouilles anciennes, dont c'est le point de rencontre. Au sud,. Delattre avait partiellement dégagé le mur à absides qui soutenait les terrasses supérieures de la colline. A l'est, MM. Ferron et Pinard ont mis à jour un quartier d'habitations prétendument gracchiennes, puniques en fait2: ils se sont arrêtés dans le prolongement du mur occidental du bâtiment basilical. C'est Lapeyre, surtout, qui avait imprimé à cette partie du site la configuration que nous avons trouvée au moment de reprendre l'exploration
* Le rapport présenté ici reprend le texte original du rapport préliminaire du secteur B, dont une version abrégée a entre temps paru dans Ant. Afr. 11, 1977. On y trouvera donc les compléments annoncés p. 69, n. 2 de l'article publié dans cette revue.
1 II couvre une partie des carrés F III et F IV du car- royage.
- Cah. Byrsa 5, 1955, p. 31-81 ; 9, 1960-1961, p. 77-170.
du terrain3 (fig. 1). Lapeyre avait centré sa recherche sur le mur qui constituait, selon lui, «l'enceinte punique de Byrsa» (mur D sur notre plan). Il avait également mis au jour, sur tout le flanc sud-ouest de la colline, un mur à ossature d'arcs en maçonnerie reposant sur des piles de fondation (c'est notre mur C), qu'il reconnaissait être de facture romaine. Entre ces deux murs, Lapeyre avait dégagé diverses structures puniques : des tombes (9), une citerne (3), complétées au nord du mur D par les murs 4 et 5. Nous verrons que cette fameuse «enceinte punique» n'était ni une enceinte, ni même une construction punique; pourtant, Lapeyre avait reconnu dans cette zone des vestiges puniques autres que des sépultures. L'idée ne fut pas reprise ensuite; elle aurait cependant pu éclairer les dégagements effectués plus tard, au nord des fouilles Delattre, dans le même secteur du site. Côté sud, enfin, une autre rangée de piles de fondation (notre rangée B), fut partiellement dégagée par les fouilles Ferron-Pinard4.
Au total, le niveau de dégagement précédent descendait en pente régulière du nord vers le sud, tendant à rejoindre la pente native du sol de la colline, avec lequel il se confondait en plusieurs endroits. C'est seulement au sud des piles C que nous avons retrouvé quelque épaisseur de terrain archéologique. Cependant, de part et d'autre du mur C, subsistait partiellement une
' G.G. Lapeyre, L'enceinte punique de Byrsa d'après les dernières fouilles de la Colline Saint-Louis de Carthage, dans Rev. Afr., 1934, p. 336-353.
4 Description sommaire dans Cah. Byrsa 9, p. 89.
oo
ik ml e k^f
à plan
'Ά \
râ^iwfc^u^cj
Fig. 1 - Les fouilles Lapeyre (d'après le relevé de A. Thouvcrcy, Revue Africaine 1934, pi. 2).
LE SECTEUR B (1974-1975) 99
^ ..—- fj
L·.
Fig. 2 - La partie sud du secteur B, vue du secteur A (cliché J.-M. Carrié).
eminence non encore entamée, que nous avons baptisée «butte Lapeyre»: c'était, dans cette partie du site, le dernier témoin des niveaux supérieurs détruits par nos prédécesseurs.
Poursuivant en 1974 des sondages partiellement amorcés, dont la localisation ne nous est pas imputable, notre fouille s'est orientée dès que possible vers une enquête stratigraphique (fig. 4). Le but recherché était moins d'étudier pour elles-mêmes des couches le plus souvent rapportées que de préciser les niveaux d'aménagement et de situer par rapport à eux les structures, qu'elles fussent anciennement dégagées, ou que la nouvelle fouille les ait révélées. Cet effort s'est systématisé en 1975 s.
s La fouille a été menée en 1974 par Jean-Michel Carrié avec la participation de Roselyne Bret et Elisabeth Lafaye; en 1975, par Jean-Michel Carrié et Nicole Sanviti.
C'est donc en fonction des niveaux successivement rencontrés que nous décrirons les structures. A défaut de donner un catalogue même sélectif du matériel extrêmement abondant que nous avons retrouvé, nous présenterons un aperçu rapide de quelques catégories d'objets parmi les plus représentatives6.
p Dans la description sommaire du matériel par couches, nous emploierons les symboles et références suivants :
- Attique tardif : Corbett = P. E. Corbett, Attic pottery of the Later Vth. Century from the Athenian Agora dans Hespaia 18, 1949, p. 298-351 ; Thompson = H.A. Thompson, Two centuries o/ hellenistic pottery dans Hesperia 3, 1934, p. 31 1-480.
- Camp.: campanienne; les formes indiquées par un simple chiffre sont celles de la classification de N. Lambo- glia.
- Imitation de campanienne : cf. G. Vuillemot, Recon- iiaissances aux éclielles puniques d'Orante, Autun, 1965.
- Céramique punique : les formes indiquées sont celles de P. Cintas, Céramique punique, Paris, 1950.
- Amphores puniques: la classification par t\pes A, B,
100 BYRSA I
II - Les niveaux tardifs
Quelques restes de murs tardifs, déjà déchaussés par les fouilles précédentes, subsistaient encore au sommet de la «butte Lapeyre». Le danger qu'ils présentaient pour toute poursuite de la fouille en contre-bas nous a contraints à procéder à leur destruction en octobre 1974, après les avoir étudiés et relevés (cf. fig. 6).
- S'appuyant sur la pile C 7 du mur à arches, et perpendiculaires à celui-ci, deux murs constituaient les parois latérales d'une canalisation (murs 2 et 3). Leur face interne, ainsi que le fond du chenal qu'ils délimitaient, étaient recouverts d'un enduit gris. Le sens de l'écoulement se faisait du sud vers le nord. A l'endroit où cette conduite recoupe le mur C, la canalisation a été créée par évidement du pilier armant le mur entre les deux arcs portés par la pile C 7. Plus au sud, la paroi ouest de cette canalisation (mur 3) obliquait vers l'est, suivant un angle de 50 degrés environ (mur 4). Ces trois éléments de mur sont construits d'une façon identique : de petits mœllons disparates liés par un mortier blanc, sans trace de lits de pose. Le mur 4 était encore conservé sur une élévation de 110 cm; à sa base, on pouvait déceler une trace de restauration moderne au ciment. Le mortier du mur 4 contenait un fragment de sigillée claire D.
- Le mur 4 n'a pu lui-même trouver place qu'en retaillant un élément de blocage (5). Ce dernier forme un quadrilatère dans lequel on pourrait reconnaître un massif ou une pile de fondation, moins profondément établi, cependant, que les piles B. C'est un blocage en mœllons, compact, mais assez peu résistant, composé de petits blocs de grès de formes irrégulières, liés à la chaux, et contenant également de nombreux fragments de revêtements de marbre. Ce blocage est venu à son tour incorporer l'extrémité du mur 6.
- Ce mur 6, parallèle au mur C, bordait la butte sur tout son côté Sud. Il était grossièrement dressé, et non paré. Il est fait d'un appareillage hâtif de mœllons de dimensions fort diverses, depuis de tout petits rognons de grès jusqu'à des blocs de 50 cm de longueur assemblés à la chaux; on y remarque aussi la présence en remploi d'un grand nombre de fragments de marbre, dont certains d'assez grandes dimensions : fragment de pilastre cannelé, bord
luré, fragment de drapé de statue, fragment d'inscription.
Partiellement recouvert à l'est par le blocage 5, ce mur a été également retaillé en sa partie médiane pour installer une citerne ronde (7), dont les mœllons sont venus se sceller dans l'échancrure du mur 6 ainsi créée.
- Le mur 7, circulaire, délimite une petite citerne, dont le fond s'amorce par un degré annulaire, de 38 cm de hauteur. La paroi interne est constituée d'un béton étanche, gris. Le fond repose sur un hérisson de petits mœllons irréguliers liés au mortier, identiques à ceux des parois, mais plus soigneusement disposés. L'intérieur de cette citerne avait été déjà fouillé, comme l'a montré le matériel moderne que nous y avons recueilli.
- Parallèle au mur C, le mur 8 est une fondation hétéroclite incorporant les éléments de remploi les plus divers (blocs taillés, parfois moulurés) et de petits mœllons (parmi lesquels des cubes de réticulé), liés par un mortier de chaux.
- Enfin, deux grands blocs parallélépipédi- ques plats (9 et 10) ont été déposés ici à la suite des fouilles antérieures. Leur lieu de provenance ne peut être établi. On peut penser à des dalles ayant recouvert une canalisation.
La chronologie relative de ces diverses structures peut être ainsi restituée :
6 antérieur à 5 antérieur à 2-3-4; 7 postérieur à 6.
La fondation du mur 6 n'atteint pas le niveau du sol de tuileau d'époque romaine7, ce qui impliquerait au moment de sa construction l'existence d'un nouveau niveau de sol, exhaussé par rapport au niveau romain. Par contre, les murs 2-3-4 ont percé le sol d'époque impériale8.
D'autre part, le plus ancien de ces murs (mur 6), de faible épaisseur, et de construction hétéroclite, évoque un état d'occupation du site par
C, D, E d'Ibiza renvoie à J. M. Mafia de Angulo, Sobre la tipologia de las anforas punicas dans Cronica del VI Congr. Arqiieol. del Sudeste Espanol, Alcoy, 1950 (1951).
- Lampes : cf. J. Deneauve, Lampes de Carthage, Paris, 1969.
7 Sur ce niveau de sol, cf. ci-contre. s Certains de ces remaniements du niveau romain sont
encore discernables dans la stratigraphie : cf. fig. 7, couches 4 et 8.
BYR5A secteur B
Ο 1 2 3 Λ 5m. releve et dessine par G.ROBINE. 1976
Fig. 3 - Relevé général des fouilles 1974-1975 dans le secteur (relevé G. Rubine).
BYRSA secteur B
releve et G.ROBfNE
Fig. 4 - Implantation des sondages 1974-1975 (relevé G. Rubine). N.B. : les numéros des coupes renvoient à la numérotation des figures du présent rapport.
LE SECTIIUR Β (1974-1975) 101
Fig. 5 - La «butte Lapeyre», vue d'ensemble (cliché J.-M. C).
des habitations sommairement construites : donc postérieurement à l'abandon de la plateforme supérieure de la colline comme centre politico-religieux de la cité, et à la désaffectation des édifices de type public. La citerne ronde 7, adjonction ultérieure au mur 6 et la fondation de mur 8 confirment cette impression. Une datation plus tardive encore doit donc être envisagée pour les murs 5 et 2-3-4, que l'on peut faire descendre jusqu'au Moyen-Age musulman. C'est d'ailleurs à la période musulmane qu'a été assignée par Lapeyre la citerne rectangulaire creusée au Nord des piles C 6 - C 7 (fig. 3, Ν)9. Par contre, aucune de ces structures ne nous paraît devoir être mise en relation avec la période tardo-romaine et byzantine.
III - Terrassement Augusteen ET REMBLAIEMENT PRE-AUGUSTÉEN Sondages 2-3-4-5 et sondage 14;
cf. fig. 7
La couche 1, sur laquelle repose, dans une situation stratigraphique malheureusement trop mal conservée, le mur tardif 6, recouvre elle- même un sol de tuileau épais de 3 cm qui, détruit ailleurs par les fouilles antérieures, a été préservé uniquement sous le mur 6. Entre ce sol 2 et une surface dure (β) qui, 3 m plus bas, aplanit le sommet des couches 25-26-27, nous rencontrons un épais remblai déposé en strates obliques, selon une disposition caractéristique qui se retrouve en d'autres point du site (secteur A : cf. supra, p. 64-72). Ce remblai n'a fourni aucun matériel d'époque romaine, mais uniquement celui que nous trouvons ailleurs, dans les niveaux de destruction de la ville punique. Il constitue le terrassement que le mur à absides (fig. 3, A) avait précisément pour fonction de contenir. La date augustéenne de ce mur a été autrefois établie à partir des timbres portés par les amphores qui avaient été empilées en arrière de la maçonnerie pour amortir la poussée des terres10.
Il nous a semblé intéressant d'étudier d'une façon quelque peu détaillée, dans un secteur préservé se prêtant bien à une telle enquête, la composition de ce remblai, afin de préciser comment avaient été effectués ces énormes travaux de terrassement. Il serait peu utile de retenir notre attention sur chaque strate de ce feuilleté, pris isolément. Par contre, nous chercherons à faire apparaître les principaux contrastes, ou les regroupements les plus signifiants pour notre propos, en commentant ici la fig. 7.
a) Couches étrangères au remblai augustéen :
Les poches 4 et 8, emboîtées l'une dans l'autre, sont des remaniements tardifs.
- 4 est le fond de la tranchée de fondation du muret 8 décrit au chapitre précédent.
" Localisation des plus approximatives sur le plan de Thouverey (fig. 1, n° 1), où elle est représentée à l'aplomb des piles C 5 - C 6. La paroi nord de cette citerne apparaît sur notre coupe 9.
10 A. L. Delattre, Le mur à amphoies de la colline Saint- Louis, CRAI, 1893, p. 152 sq.; BCTH, 1894, p. 89 sq. Cf. supta, Ie partie, II, p. 48.
102 BYRSA I
Coupe B.B.
Fig. 6 - « Butte Lapeyre » : les structures tardives (relevé J.-M. Gassend, I.A.M.).
300
250
200-
-200 -350
=50Ô
50 loO
150200
2503^0~
400450
500
Fig. 7 - Coupe sur le flanc est de la «butte Lapeyre» (relevé J.-M. Carrie, mise au net R. Guardi).
ο
104 BYRSA I
- 8 est une poche de terre grise friable, très pauvre en matériel (quelques tessons tardifs).
Recoupant la couche 7 du remblai augustéen (couche qui n'est représentée que dans la moitié sud-ouest de la butte, et n'apparaît donc pas sur la Coupe 7) :
7a est la tranchée de fondation de la citerne ronde tardive.
7b est l'argile liant la maçonnerie de la même citerne".
b) Le remblai augustéen :
La description des faciès rencontrés témoigne de la diversité d'origine des terres ainsi rapportées : 2 : Sol de tuileau rose, de 3 cm d'épaisseur -
NG au sommet du sol : 53, 67 m. 3 : Terre brune très tassée. 5 : Terre jaune, fine, tassée, avec horizon
dreux à la base. 6 : Terre ocre granuleuse. 9 : Terre ocre sableuse, contenant des traces
de bois brûlé. 10 : Cailloutis fin mélangé à des granules
d'argile, et contenant de petits fragments de stucs.
11 : Terre claire, à éléments assez fins, bant des intercalations de sable grossier, ou de cailloutis mêlé à de petits rognons de tuf.
12 : Couche sableuse plus ou moins fine et sée selon la situation dans le dépôt.
13 : Sable et cailloutis gris, contenant des coquillages marins.
14 : Sable de couleur jaune paille mêlé de nules d'argile blanche ou ocre.
15 : Sable gris très homogène. 16 : Concassage d'argile brune et verte, avec
horizon sablo-argileux et cailloutis fin à la base.
17 : Argile ocre, sable gris et cailloutis mêlés, contenant de nombreuses coquilles d'escargots et des brindilles brûlées.
18 : Terre argilo-sableuse gris-ocre, compacte et fine, contenant des cendres, des vertèbres de poisson et des ossements animaux.
Non visibles sur la Coupe 7.
19 : Terre grise cendreuse avec intercalations épaisses de cailloutis, de mottes d'argile; riche en céramiques; contient également galets, ossements, escargots, coquillages, pièces de bois carbonisé, et fragments de stucs en grand nombre.
20 : Cailloutis ocre et gris, contenant bois brûlé et escargots.
21 : Idem, mais constitué d'éléments plus gros. 22 : Argile ocre compacte incorporant des
rognons de tuf, de pierre, et contenant des ossements humains (crânes, etc.), des coquillages, ainsi que de très nombreux tessons de céramiques. La densité d'ossements est particulièrement forte au contact avec la couche 23.
23 : Couche grise cendreuse, contenant briques crues, pavements puniques et fragments de stucs; contient de très nombreux tessons, mais toujours de petite taille et souvent très érodés.
Un premier regroupement, en fonction du faciès et du matériel contenu, ferait apparaître les origines suivantes :
- Terres tirées de zones non habitées (strates 3; 6; 14? 16; 17; 207 21?)
- Terres provenant de zones d'habitations détruites (strates 5; 9; 10; 11; 18; 23).
- Remblais tirés de grèves marines (strates 12; 13; 15).
- Terres provenant de nécropoles arasées (strates 19 en partie?; 22).
La densité du matériel céramique est, quant à elle, très inégalement répartie. Elle est faible jusqu'à la couche 18 comprise; exceptionnellement riche dans les couches 22-23. Pour ces deux couches seulement nous donnerons le détail du matériel contenu. Un inventaire groupé du matériel retrouvé suffira pour les strates 3 à 18 : les indications de ce niveau pour la datation du matériel sont nécessairement grossières, puisque ces terres rapportées obéissent au seul critère chronologique du terminus ante quern 146 av. n.è.
Matériel.
Couches supérieures du remblai (3 à 18) : Attique rare; ampuritaine rare; Camp. A très
abondante (par ordre de fréquence décrois-
LE SECTEUR Β (1974-1975) 105
Fig. 8 - Flanc est de la «butte Lapeyre» : la stratigraphie (cliché J.-M. C).
sante : 28; 36; 55; 27; 23; 33; 34. Rares: 25; 26; 31; 32; 22; 6). Camp. Β assez rare (6; 31; 40; 42; 48?); Imitation de Camp, très abondante (surtout 28; 34; 27; en nombre encore: 36; 31; 23; rares : 5; 6; 10; 1 1 ; 22; 25; 29; 48; 55). Lampes : puniques; grecques (types Deneauve
grecques X-XI-XII). Marmites très abondantes; Céramique punique à vernis rouge assez fréquente; punique à surface blanche en grande quantité; à bandes peintes, assez fréquente.
Amphores : types C et D d'Ibiza. Divers : Figurines plastiques; stucs, enduits et
pavements, mosaïque à cubes blancs; fragments de tuiles plates à rebord (épaisseur : 2,5 cm).
Couche 22 : Camp. A très abondante (28; 34; 36; gobelet à pied). Camp. Β rare (29; 6; Plat à pieds en forme de têtes de Silène12. Imitation
12 Cf. Cali. Byna 5, n° 129; P. Wuilleumier, BCH 1932, pi. XXII; Rei Cietariae Romanae Faiitorum Acla VII, 1965, p. 84 n. 8 : daté des 2e et 3e quarts du IIIe siècle av. n.è.; Not. Scav. XXIV, 1970, 3e Suppl. p. 463 (n" 491) et 468 (n" 532).
Camp, très abondante (34; 28; 36; 21; 1). Punique à surface claire (pieds moulurés; cruche Ciiîîas 145; petites œnochoés; fonds à dépression et ombilic; balsamaires); punique peinte rare. Lampes puniques (à 2 becs); grecques (Deneauve X et XI). Amphores : punique (surtout C; D rare); rhodienne (marque ΔΑΜΟΚΡΑΤΗΣ); gréco-italique. Pavement punique; mosaïque blanche.
Couche 23: Ampuritaine (rare); Attique et ita- liote (figures rouges tardives; plats à palmet- tes; couvercle à décor blanc; pied de cratère Lamb. 40 D; coupe skyphoïde Corbet t 155; plat Corbett 153). Camp. A abondante (28; 31 à cercles blancs; 58 ou 60; fonds de patères à cercles blancs; coupe à anses 48; paroi striée 44 ou 61?). Imitations camp. (27; 28; rosettes Morel 215) Lampes grecques. Marmites très nombreuses. Punique claire abondante; peinte assez bien représentée. Amphores puniques (C et D) et gréco-italique. Stucs et enduits de mur. Pavements à tesselles de marbre blanc.
106 BYRSA I
c) Le remblaiement pré-augustéen. La couche 23 repose sur une surface d'aplani
ssement β qui façonne indifféremment le sommet des couches 25-26-27. Nous ne tiendrons pas compte de la couche 24 (terre sableuse sans matériel) qui est une formation récente consécutive aux fouilles de Lapeyre; et que nous rencontrons au pied de la butte (elle n'apparaît pas sur la coupe 7).
Cette surface dure β constitue le niveau de régularisation d'un premier remblaiement du quartier punique détruit. Elle est percée de trous de poteaux (26 a sur la coupe 7), et descend en pente régulière du nord vers le sud. Nous la retrouvons, plus bas, au nord de la citerne punique et dans le sondage 12 (cf. infra). C'est par dessus ce niveau d'aplanissement qu'a été déversée en oblique la masse du remblai augustéen.
Sous cette surface, nous rencontrons les couches suivantes : 25 : Terre ocre très tassée, assez fine, très
gée en éléments de destruction (stucs, enduits, pavements, bois brûlé) et en céramiques disposés en alignements partiels, irréguliers, se recoupant.
26 : Idem, mais terre plus grise. 27 : Terre rousse contenant les éléments de
truction les plus variés : rognons de grès et briques crues décomposés, planches brûlées, stucs et pavements (souvent calcinés).
Cet étage de remblai se différencie nettement de l'apport artificiel de terres auquel il a été procédé sous Auguste. Il consiste en deux couches (25 et 27 auxquelles s'ajoute 26 selon les endroits) qui recouvrent uniformément, et sur une forte épaisseur, les ruines de 146. Leur présence se vérifie tout aussi bien dans le secteur A. Séparées du remblai rapporté par la surface β, elles s'en distinguent nettement par leur composition, très chargée en éléments de destruction de maisons. Nous inclinerons donc à voir dans ces couches un remblai consécutif à la destruction, qui se serait épandu sur la ville ruinée, dans l'intervalle compris entre 146 et la nouvelle fondation de la ville sous Auguste, et qui se serait irrégulièrement accumulé selon les étage- ments de la pente. La couche 27 établit la transition avec la stratigraphie du sondage 11 (cf. infra) et le niveau d'écroulement des édifices puniques.
Matériel.
Couches 25-26 : (matériel récolté dans la zone comprise entre le sondage 5 et le sondage 10). Ces couches ont livré de nombreux objets provenant d'habitats détruits : fragment de baignoire en terre cuite (fig. 47), stucs blancs marbrés; enduits de mur roses; pavements puniques; réchaud en pierre volcanique (fig. 48; peut-être à usage métallurgique); pyxide en plomb; scories métalliques; petite enclume cubique en pierre; cols d'amphores : type C d'Ibiza (fig. 36) et gréco-italique (fig. 45); amphore punique (type Β d'Ibiza); balles de fronde; grands plats en pâte rose ou verte (Cah. Byrsa 9, n° 435 et pi. LXXV).
Couche 27 : Matériel récolté dans les sondages 11 à 14: cf. infra, p. 123.
IV - Le mur D
Ce mur a été étudié par Lapeyre, qui affirme l'avoir dégagé sur une centaine de mètres13, et qui en signale les prolongements à l'ouest, sous la villa Dakar, ainsi qu'à l'est, sous le jardin de la Villa Balande. Lapeyre en a également décrit le mode de construction14, mais il a relevé essentiellement les indices susceptibles d'accréditer son interprétation : il y voit en effet Γ« enceinte punique de Byrsa». L'assurance avec laquelle Lapeyre a avancé cette hypothèse ne doit pas masquer sa fragilité : le simple aspect de ce mur (fig. 13) interdit de penser sérieusement à un ouvrage de défense. Avec plus de raison, le P. Ferron a proposé depuis d'y reconnaître un mur de soutènement, mais il n'en parle qu'à propos des piles de notre rangée C, avec laquelle il le met en rapport 1S.
" Revue Africaine, 1934, p. 340, et pi. 2 (= fig. 1 du présent rapport).
14 Ibid., p. 342-343. La description de Lapeyre recourt aux artifices du style pour donner à ce mur une allure redoutable : « il est constitué essentiellement par de fortes chaînes composées de blocs de pierre de taille (p. 342). . . » Qu'on en juge par notre fig. 13!
15 Cah. Byrsa 5, p. 51 : «Une série de piles à plan carré s'alignent sur une assez grande longueur parallèlement à un gros mur». Dans la n. 1, même p., J. Ferron rejette à juste titre l'interprétation de Lapeyre : «En fait, il (= ce mur) est typiquement romain, et construit à la manière africaine ».
LE SECTEUR Β (1974-1975) 107
L'un des premiers objectifs que nous nous étions fixés était donc de reprendre l'étude de ce mur, non sans envier la chance, malheureusement si peu mise à profit, qu'avait eue Lapeyre de contempler cette structure dans sa continuité et son apparence originelles.
L'état actuel de conservation du mur D.
Comparé aux vestiges relevés sur le plan Thouverey (cf. fig. 1), l'état actuel du mur s'est considérablement détérioré depuis les fouilles de 1930-1932. L'élément le plus caractéristique se développe sous la fondation sud du monument à plan basilical (cf. fig. 12, éléments 5 à 9; et fig. 13) : on peut y voir encore les chaînes de grands blocs décrites par Lapeyre. Dans notre secteur, un tronçon démantelé dans sa partie supérieure (au nord de la «butte Lapeyre») offrait encore, cependant, la possibilité d'étudier la situation du mur par rapport à la stratigraphie. Plus à l'ouest (zone des tombes Lapeyre), la semelle de mœllons se devine de place en place; ailleurs, elle a été recouverte depuis les fouilles anciennes. Enfin, un élément présentant encore une élévation intéressante a été dégagé à l'est du chantier (Secteur A), dont le mode d'implantation demanderait encore à être étudié (cf. supra, IIe Partie, I, fig. 16).
L'implantation du mur (sondages 6, 8 et 9).
Une coupe perpendiculaire au mur D a été pratiquée sur le bord est du sondage 6 et le bord ouest du sondage 8 (cf. fig. 9 et 10) l6.
Stratigraphie (sondages 6 et 8).
2/25 : même couche que la couche 25 de la coupe 7 (cf. supra).
2 : Couche ocre rosé, cendreuse à la base, contenant de nombreux fragments d'enduit stuqué, ainsi que des dalles de grès. Matériel: Camp. A (23, 28, 33); Camp. Β (assiette apode); Imitations de Camp. (22, 36); Céramique punique à couverte blanche (pied de cratère); à surface brune (Cintas 98 ter); marmites; lampe
16 La coupe 9 est donc l'assemblage de deux relevés, la moitié sud ayant été dessinée côté est, et la moitié nord côté ouest, pour des raisons de configuration du terrain.
(Deneauve grecque VIII); amphores (punique C et gréco-italique de petites dimensions). Dans l'horizon cendreux à la base de la couche : amphore à panse godron- née (West Slope; cf. fig. 42); Camp. A (23; 28); imitations de Camp. (28; Morel 66); nombreux fragments de pavement punique.
2a : Terre brune très meuble, incorporant des noyaux d'argile; horizon cendreux à la base. Le matériel contenu dans cette tranchée n'a rien livré qui soit postérieur à l'époque hellénistique; il se compose uniquement de tessons en miettes, typiques d'un sol remodelé.
2b : Côté sud; même couche que 2, mais intercalée entre deux horizons cendreux.
3 : Terre sableuse avec cailloutis plus ou moins dense selon les endroits. La couche est feuilletée, avec intercalations de bancs détritiques. Elle contient de nombreux fragments de stucs. Le sommet constitue une surface damée (a) résistante, très nettement individualisée.
Matériel. Attique IVe siècle; Camp. A (28; 36); imitations de Camp.; marmites; céramique punique à surface blanche (Cintas 127); 2 fragments de statuettes plastiques (statue- trône?); Amphores (punique C et gréco- italique).
4 : Au nord seulement; couche ocre avec intercalation de cailloutis dense. Ne contient pratiquement pas de matériel.
5 : Au nord seulement; couche cendreuse de faible épaisseur.
6 : Au nord seulement; couche très tassée d'agglomérats d'argile remaniée; ne contient aucun matériel.
7 : Argile verte avec inclusion de gros les indurés (7a) de couleur blanche, ou de poches brunes (7b). Cette couche, stérile, apparaît comme la décomposition géologique superficielle du noyau argileux.
8 : argile ocre en place.
Interprétation. La surface damée (a) qui marque la limite
supérieure de la couche 3, et qui traverse toute cette zone, n'est séparée de l'argile de la colline (couches 7 et 8) que par une faible épaisseur de
108 BYRSA I
-sa
-10O
-150-
-200 -350 -300
300
Fig. 9 - Coupe perpendiculaire au mur D (relevé J.-M. Carrié et N. Sanviti, mise au net R. Guardi).
LE SECTEUR Β (1974-1975)
Υ" J· ·-
Fig. 10 - Coupe au Nord du mur D (cliché J.-M. C).
remblai (40 cm.) au nord du mur D. Le remblaiement a été plus important au sud, où l'argile plonge assez brusquement. Par la régularité de son profil, de sa pente et de son mode d'établissement, cette surface dure, très nettement discernable, paraît être la chaussée d'une rue ou d'une place, en terre battue, selon le même mode d'implantation que pour la rue fouillée plus à l'est par MM. Ferron et Pinard17. La comparaison des niveaux de cette aire et des blocs de fondation d'un mur de maison punique (sondages 6-7), dont il sera plus loin parlé, s'accorde avec cette hypothèse, de même que l'absence de structures architecturales à l'est de ce même mur punique. Cette chaussée, d'autre part, délimite deux niveaux différenciés. Le remblai (couche 3) sur lequel elle est établie contient déjà des éléments de démolition de maisons (stucs), mais le matériel le plus tardif ne dépasse pas le début du IIIe siècle. Dans la couche cendreuse qui recouvait la chaussée, beaucoup de poteries ont été brisées sur place : c'est en particulier le cas de l'amphore godron- née West Slope, mais cette pièce se trouve associée à un matériel sensiblement plus récent que celui de la couche 3 : Campanienne Β et formes
tardives de la Campanienne A (forme 33 à double ligne blanche surpeinte)18.
La tranchée de fondation du mur D (couches 1 et 2a) se lit aisément sur la coupe. Elle ne contient guère d'autre matériel que celui que nous trouvons dans les couches de destruction de la cité punique, dont la couche 2/25 est un exemple. Cette étude stratigraphique nous conduit donc à conclure que le mur D, recoupant au niveau de sa fondation les couches de destruction de la cité punique, à la recherche du sol natif de la colline, est antérieur cependant à l'occupation romaine, à laquelle il prélude. Il fait donc partie des premiers travaux de réaménagement du site, et serait contemporain du mur à absides.
Le sondage 9 (cf. fig. 11).
Nous avons suivi la semelle et la tranchée de fondation du mur D sur la face nord de celui-ci, en direction de l'est. Nous avons pu constater que sur cette portion du tracé, le mur recherchait toujours le sol naturel de la colline (argile ocre, couche 8 sur la Coupe 9). Vers le milieu du tronçon, ce niveau de l'argile plonge brutale-
17 Cah. Byrsa 9, p. 95. t* Forme datée par N. Lamboglia des IIIe-IIe siècles av.
110 BYRSA I
ment; situation à laquelle s'adapte la fondation, qui descend alors de - 2,10 m à - 2,70 m par rapport au niveau de la base des grands blocs de grès. Cette particularité locale s'explique, pensons-nous, par la présence de deux dalles dressées de champ (c et d sur le Plan 11), disposées à angle droit, vestiges d'une construction recoupée par notre mur D. Ces dalles, dont la mieux conservée (d) est un bloc parallélépipédique de 57 cm X 32 cm x 90 cm, ont été placées contre les parois d'une fosse creusée dans l'argile, remblayée à l'extérieur par du sable pur. Il semble difficile de ne pas reconnaître dans un tel dispositif celui d'une tombe punique comparable à celles qu'avait signalées Lapeyre, plus à l'ouest19. Celle-ci aura été mise au jour par la construction du mur D. Le matériel dut être alors dispersé, ce qui nous empêche de préciser la chronologie de cette sépulture20; seules furent laissées en place les dalles qui ne se trouvaient pas sur le tracé de ce mur. La largeur du mur D fait supposer que l'ensemble de la chambre sépulcrale a été détruite; cependant, une poursuite éventuelle de la fouille dans ce secteur pourrait faire apparaître quelque autre trace au sud du mur.
Plus à l'est (e), nous avons dégagé un squelette humain, à peu de profondeur sous la limite des fouilles anciennes mais déjà dans l'argile ocre. Le corps semble être encore dans sa position d'ensevelissement, les bras placés le long du corps, les jambes repliées vers la gauche. La partie conservée, depuis le crâne jusqu'au bassin, mesure une soixantaine de cm.; les jambes ont été tronquées par le creusement de la tranchée de fondation du mur D. Il s'agit d'une sépulture élémentaire, sans trace de tombe construite, sans dépôt de matériel. Le contexte stratigraphi- que est lui-même stérile. On pourrait penser à un ensevelissement sommaire effectué pendant le siège de la ville en 146.
Mode de construction du mur D.
Nous voudrions tout d'abord signaler un certain nombre d'erreurs, à vrai dire surprenantes,
|lJ Rev. Afr. 1934, pi. 2 (cf. fig. 1, η" 9). 20 Seuls ont été retrouvés au fond de la fosse un fragment
de pâte de verre bleue et un morceau de bronze pouvant provenir d'une poignée de sarcophage. Photographie du sondage 9 dans Am. Afr. 11, 1977, p. 78, fig. 8.
qui se sont introduites dans la description du mur D par Lapeyre et dans le plan de Thouverey qui l'accompagne (fig. 1).
Nous reprendrons l'examen du mur à partir de notre relevé schématique (fig. 12), qui ne prend en considération que le rythme d'espacement des chaînages de blocs. A partir de la séquence 5 à 9, qui représente l'élément le mieux conservé du mur, nous pouvons tout d'abord interpréter les trois blocs qui subsistent seuls, plus à l'ouest, surplombant notre sondage 9 : la chaîne double 4, figurée sur le plan Thouverey, a été détruite; 3 est la base d'un élément simple; 2 est la première assise, monolithique (1,80 m) d'un élément double légèrement plus étroit que 6 et 8. Il est cependant facile de lui restituer une largeur originelle plus comparable à celle des autres éléments doubles (6 : 2,21 m; 7 : 2,29 m) si l'on considère qu'un mur transversal tardif, visible en coupe sur la face nord du mur au-dessus de la pierre c du sondage 9, a tronqué l'extrémité est de cette assise. Enfin, 1 est le dernier témoin d'un élément simple, qu'il faut cependant supposer plus large que l'unique bloc subsistant, et tronqué à son extrémité ouest.
En appliquant ces restitutions à la description du mur par Lapeyre, nous ferons remarquer :
- que l'espacement d'axe à axe entre les éléments doubles est plus proche de 6 m que de 5, 90 m;
- surtout, que la présence de «contreforts de 0,70 m faisant saillie à l'extérieur de 0,50 m» est loin de se répéter aussi régulièrement que ne le dit Lapeyre : c'est aussi un des points les plus déconcertants du plan Thouverey. Nos propres vérifications nous ont en effet conduit aux constatations suivantes :
- Le seul contrefort encore visible actuellement (8) n'est pas représenté sur le plan Thouverey.
- Des deux contreforts indiqués par ce relevé pour notre zone, l'un concerne 4, qui a totalement disparu : nous ne pouvons donc rien en dire. Par contre, dans le cas de l'élément 2, il est absolument exclu que Lapeyre l'ait vu muni d'un contrefort, dont la destruction ultérieure aurait laissé quelque trace, et dont nous aurions pu vérifier la présence originelle en fouillant la semelle de fondation (sondage 10).
Argile aplanie
à 50,12 m
Argile aplanie
à 50,65 m
Couche de sable tranchée en oblique, sommet a 49,80 m
Niveau supérieur de l'argile à 49,60 m
SEMELLE
MUR
e
Fig. 1 1 - Plan du sondage 9 (relevé J.-M. Carrié et N. Sanviti, mise au net R. Guardi).
Ν G 52.3Q Et-
Mur transversal tardif
!nG 52,02m A
MG51,11m
I 7
.1.
Alignement théorique
Fig. 12 - La face sud du mur D, élévation (relevé schématique J.-M. Carrié, mise au net U. Colalelli).
Fig. 13 - Le mur D sous les fondations du monument basilical : état après les fouilles Ferron-Pinard (cliché J.-M. C).
Ces détails nous confirment non seulement l'inexactitude du relevé Thouverey, mais surtout le parti-pris de Lapeyre d'exagérer les caractères défensifs du mur et l'uniformité de sa construction : on a voulu réduire à une même appartenance divers éléments de murs périmétraux reconnus sur les différents versants de la colline.
De même, la description que Lapeyre a présentée du mode de construction du mur D demande à être précisée sur certains points, rectifiée sur d'autres21.
Il s'agit d'un mur à structure hétérogène. La partie inférieure - nous ne pouvons l'appeler fondation, puisque le mur tout entier est une fondation - se compose d'un blocage de mœl- lons liés par un simple mortier de terre, dont le parement offre l'aspect d'un appareil polygonal fruste. Les mœllons d'appareil sont grossièrement ajustés, et calés par de petits éclats de
21 Art. cité, p. 342-343.
pierre. La base extrême du mur prend des apparences fort diverses. Dans le sondage 7, les premières assises forment, sur la face nord, de véritables épis, donnant à la base du mur un tracé en dents de scie. Dans le sondage 9, les deux premières assises sont construites en gradins partant légèrement à l'oblique par rapport à l'alignement du mur (cf. fig. 1 1, a et b). Le plus souvent, ces particularités s'expliquent par l'adaptation des premières assises aux mouvements du terrain, qu'ils soient naturels (déclivité du sol) ou accidentels (fosse sépulcrale). Pourtant, à l'extrémité est du segment 3 (fig. 12), la base du mur, observée en coupe, descend plus profond (40 cm) sur le côté nord que sur le côté sud, suivant un pendage curieusement contraire à celui du terrain naturel.
La largeur du mur se rétrécit à la jonction entre la partie supérieure et la partie inférieure, cette dernière formant un léger ressaut. Au-dessus de cet épaulement, alternent des chaînages de blocs isodomes, disposés en parpaings (élé-
LE SECTEUR B (1974-1975) 113
ments simples) ou en parpaings et boutisses (éléments doubles, munis ou non de contrefort), et des panneaux intercalaires en appareil polygonal fruste. Les blocs de grès des chaînages, dont les dimensions font référence à la métrologie punique, proviennent des ruines du quartier hellénistique. De même, le blocage de mœllons est en grande partie constitué d'éléments de remploi, reconnaissables à leurs enduits stu- qués : ici encore, un examen même rapide du mur contredit les affirmations de Lapeyre22. Par contre, le marbre est totalement absent des remplois, ce qui confirme la datation haute - époque augustéenne - que nous proposons.
Notons encore une particularité du mode d'établissement de ce mur. Recherchant pour s'asseoir le niveau de l'argile en place, il a dû s'adapter au relief naturel de la colline, et présente donc une élévation variable selon les endroits. On remarquera cependant que la hauteur de la partie inférieure (blocage homogène) demeure plus ou moins constante : entre 1,50 m et 2 m en moyenne. La base des chaînages de blocs se situe donc à des hauteurs variables selon les sections du mur : 52,29 m sous l'élément 1, 51,11 m sous l'élément 5.
Datation du mur D.
Un faisceau convergent d'indices suggère donc une datation augustéenne : implantation strati- graphique, nature des éléments de remploi, mode de construction. Il est remarquable que la largeur de ce mur diminue à mesure qu'il s'élève : cette particularité exclut toute construction par moulage dans une tranchée, comme c'est le cas pour les piles Β et C. Construit sur les murs de la cité punique, le mur D est donc également antérieur au remblai augustéen qui l'a enseveli. Il se peut très bien que les deux phases - construction du mur et remblaiement - se soient immédiatement succédé. Nous verrons plus loin quel rôle architectural peut être assigné au mur D dans l'aménagement augustéen de la colline.
22 Ibidem, p. 342 : «On n'y rencontre guère de matériaux remployés,... seulement un fragment de colonne stuquée et une console de pierre».
Fig. 14 - Intersection du mur punique M et du mur D (cliché J.-M. C).
V - Les niveaux Puniques
A) Le mur punique M (soudages 6-7).
Cette structure de direction nord-sud, recoupée par le mur D (fig. 14), avait déjà été reconnue sur une certaine partie de sa hauteur (environ 1 m) par les fouilles Lapeyre. Seul le tronçon au nord du mur D figure sur le plan Thouve- rey (cf. fig. I, n° 4), où il donne l'illusion d'un contrefort en épi venant renforcer obliquement la face nord de «l'enceinte punique». Très inexact, comme il ressort d'une comparaison avec le nouveau relevé, ce plan est d'autre part incomplet, puisqu'il ne représente par le tronçon sud. Nous pouvons cependant reconnaître les déblais de teinte grise, remplis de matériel moderne, qui ont rebouché la tranchée de fouille ancienne : Lapeyre avait donc également dégagé la partie sud du mur, jusqu'au niveau de la deuxième assise, soit 1,60 m de profondeur par rapport au sol actuel.
Description (cf. fig. 14, 15 a et b, 16).
Ce mur, dont nous n'avons trouvé que les assises de fondation en gradins, et sans doute, à l'extrémité nord, la première assise apparente,
BYRSA I N.G. 51,94
^X^=^y :-:'■!.
150 -
100-
15 b 250 Fig. 15 - Elévation de la face est du mur punique M en E IV 16 et E IV 12 :
15a - au nord du mur D; 15b - au sud du mur D (relevé N. Sanviti, mise au net R. Guardi).
LE SECTEUR Β (1974-1975) 115
est construit en grand appareil. La fondation descend suivant la pente du terrain, du nord vers le sud. Les blocs de grès, isodomes, sont de longueurs variables; leur hauteur est de 48 cm, leur largeur, de 50 cm, à l'exception des blocs des assises supérieures.
- La partie sud comporte trois assises de blocs, sur une hauteur de 155 cm. La construction est régulière; les blocs, bien appareillés, ne sont pas liés au mortier. L'assise inférieure, sur la face est, déborde l'alignement de la deuxième assise, ménageant un empattement de 12 cm. L'unique bloc conservé de la troisième assise porte, à son extrémité nord, un ressaut de 16 cm de haut percé de deux encoches parallèles (sans doute des cavités pour gougeons d'assemblage) (fig. 16). Plus au sud, le dégagement a été arrêté par l'effondrement d'un des arcs du mur C.
- La partie nord présente encore deux assises de fondation; leur extrémité nord est constituée de blocs plus petits eux-mêmes calés par des éclats de pierre, l'ensemble étant jointoyé à l'argile. Sur la face ouest, accolé au grand appareil, un petit mur en moellons a été en partie dégagé. Il est encore difficile de préciser s'il s'agit d'une cloison parallèle, ou de l'arrachement d'un mur perpendiculaire. Une troisième assise, non fondée, est représentée à l'extrémité nord par un bloc de plus grandes dimensions (68 cm de haut χ 68 cm de large) : ce pourrait bien être la pierre d'angle de la première assise du mur apparent.
- Le plan d'attente de la dernière assise de fondation est légèrement plus bas sur le tronçon sud (51,03 m) que sur le tronçon nord (51,23 m)
Matériel.
Ce mur a été isolé de son contexte stratigra- phique par les fouilles antérieures. Le terrain non remanié par les travaux de Lapeyre n'est atteint qu'au niveau de la troisième assise de fondation. Il s'agit d'un remblai d'époque punique régularisant l'aire de construction du bâtiment :
Camp. A et Β (55 et 31 essentiellement); imitations de Camp, (surtout 28); Punique à décor peint; Balles de fronde et galets de pierre ovoïdes.
rï
Fig. 16 - Le mur punique, M, tronçon sud, face est (cliché J.-M. C).
Interprétation.
Bien que l'orientation en soit différente, ce mur s'apparente à ceux des maisons puniques fouillées par MM. Ferron et Pinard : mêmes blocs isodomes, mêmes modules, même appareillage, mêmes assises de fondation en gradins; ressaut de seuil d'environ 15 cm de haut; léger pendage du mur, à rapprocher de la pente des sols dans les maisons du secteur A.
La face externe du mur semble bien être la face est; nous pouvons noter une correspondance satisfaisante entre le niveau du sommet de fondation du mur M (51,03 m) et celui de la chaussée punique α individualisée dans le sondage 823. Nous tenterons plus loin (chap. VII) d'intégrer ce mur M aux autres vestiges puniques du secteur.
B) L'édifice effondré (sondages 10-11-12).
Les premiers sondages du secteur Β ont été ouverts, en 1974, à la limite occidentale des
21 Cf. supra, p. 109.
116 BYRSA I
Vv?
Fig. 17 - L'édifice effondré, vu du nord (cliché J.-M. C).
fouilles de MM. Ferron et Pinard. Ces derniers avaient reconnu dans cette zone des blocs effondrés n'appartenant pas à l'habitation mise à jour dans l'actuel carré F III24.
De nombreux membres d'architecture, blocs taillés dans le grès coquillier du Cap Bon, sont venus s'ajouter à ceux qu'avaient dégagés nos prédécesseurs. Ils font maintenant obstacle à la poursuite de la fouille, qui ne saurait s'élargir sans qu'on les déplace préalablement.
Les contours de cette aire d'écroulement se sont, à tout le moins, précisés (cf. fig. 4) : l'essentiel des blocs dégagés s'ordonne selon deux orientations : la première, continue depuis le mur D jusqu'à la pile Β 6 (sondages 10 et 11),
est grossièrement parallèle au mur punique des sondages 6-7, précédemment décrit; la deuxième (sondage 12), perpendiculaire à la première, s'inscrit dans le prolongement de la citerne punique décrite infra (sondage 13).
Éléments et modules architecturaux (cf. fig. 19).
Plusieurs blocs retrouvés en 1974 correspondent aux dimensions de ceux qui ont été décrits par MM. Ferron et Pinard. Nombreux sont ceux d'entre eux qui portent encore, totalement ou partiellement, leur revêtement stuqué.
- Corniche à bec de corbin. Nous reproduisons ici (fig. 19a) l'élément de
corniche publié par MM. Ferron et Pinard2S. Un autre élément, apparu en bordure du sondage 11, et ayant conservé intacte sa mouluration en stuc, permet de restituer le profil originel de cette corniche (fig. 19 b), dont le nouvel élément reproduit, semble-t-il, les dimensions du premier.
Fig. 18 - L'édifice effondré : colonne lisse et colonne cannelée stuquée (cliché J.-M. C).
24 Cf. Cah. Byn>a 5, p. 79. Certains de ces éléments d'architecture ont été empilés en bordure de fouilles anciennes.
2*· Call. By na 5, n° 166; cf. également l'élément de corniche décrit par Mme Picard, Karthago 3, 1951-1952, p. 119. On se reportera surtout à A. Lézine, Architecture punique, p. 103- 104, qui invite à distinguer ce type de corniche, importé de Sicile, de la corniche dite «à gorge égyptienne».
LE SECTEUR Β (1974-1975) 117
revêtement stuqué
Corniche à bec de corbin
( Cah. Byrsa V. η*165 ) b) Corniche partiellement
de'gagée pendant l'hiver 1975
C) Pilastre cannelé' d) Colonne Β 30
Fig. 19 - L'édifice effondré : éléments d'architecture (relevé J.-M. Carrié, mise au net U. Colalelli).
- Pilastres. Dans le sondage 11, un bloc de 50 cm X 50 cm
x 50 cm (fig. 19 c) présente une face stuquée creusée de six cannelures (distance moyenne d'arête à arête : 7,5 cm). On comparera avec un élément de pilastre trouvé dans les fouilles précédentes26.
26 Ibid, n" 165.
Un autre bloc de même type mesure 64 cm de long, pour une hauteur de 45 cm. (Inv. Β 29).
- Colonnes. Deux modules de colonnes ont été retrouvés :
- Colonne cannelée, de 0,45 m de diamètre moyen, à 20 cannelures (fig. 19 d). A ce module appartiennent un tambour stuqué (fig. 18) et deux fûts ayant perdu la plus grande partie de leur enduit stuqué : l'un conservé sur 1 m de longueur (Inv. Β 30), diamètre 45 cm (deux méplats
118 BYRSA I
Ν G 50,325
-100·
-150
-200
" "~°*° ""■"·· — ·.«_ Limite de fouille
250 200 150 100 50 Fig. 20 - L'édifice effondré : coupe sur le côté nord du sondage 1 1 (relevé J.-M. Carrié, mise au net R. Guardi).
de 22 cm de large, diamétralement opposés, interrompent le cannelage); l'autre, (dans le sondage 10) conservé sur une longueur de 1,17 m. Ces colonnes s'apparentent à celles qui ont été trouvées et publiées dans le même secteur par MM. Ferron et Pinard27;
- Colonne de 0,28/0,30 m de diamètre moyen, lisse, stuquée, trouvée en deux exemplaires (inv. Β 34 et Β 50) 28. Ce module avait été déjà rencontré dans le secteur29.
- Parpaings. Parmi les blocs parallélépipédiques, plusieurs
présentent des dimensions comparables : 50 χ 50 χ 41/42 51 χ 51 χ 75 56 χ 47 χ 73/75 75 χ 75 χ 75
120 χ 68 x 37/38
27 Ibid, n° 88; n° 89 et pl.'LIII. 28 Β 50 est visible sur notre 111. 17, dans la partie centrale
droite de la photographie. 29 Cah. Byrsa 5, n° 90, p. 55-57 et pi. LIV, mais à la diff
érence de nôtres, cannelés; Mme Picard, loc. cit.
Certains de ces blocs, engagés dans l'amoncellement, ne peuvent encore être mesurés, ni dessinés avec exactitude. Il apparaît cependant que les modules déjà repérables mettent en évidence une prédominance de la valeur 50/51 cm, sous la forme de l'unité, de multiples ou de sous-multiples30.
Les mêmes modules et les mêmes associations architecturales ont été trouvés en d'autres points du site : en particulier, sous les fondations du monument basilical, dans l'actuel carré G IV: Mme Picard y avait déjà reconnu nos deux modules de colonne, et la même corniche à bec de corbin. Faut-il supposer que les éléments d'architecture trouvés en ces divers secteurs du site proviennent d'un même monument? Mais alors, peut-on maintenir l'idée d'un effondrement sur place? doit-on, au contraire, penser
10 Nous n'avons pas retrouvé la trace des coudées de 0,46 m et 0,55 m qui caractériseraient l'architecture punique d'époque hellénistique dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, selon A. Jodin, Recherches sur la métrologie du Maroc punique et hellénistique, Tanger, 1975.
LE SECTEUR Β (1974-1975) 119
que ces blocs ont dévalé naturellement la pente, ou bien encore imaginer qu'ils ont été basculés et dirigés systématiquement vers une zone déprimée qu'on aurait voulu combler au début des grands travaux de terrassement de la colline? Un examen de la situation stratigraphique dans la zone d'amoncellement des blocs nous permet d'avancer une réponse.
Stratigraphie.
Le sol de la colline s'abaisse ici assez rapidement vers le sud. Au pied des piles C, nous le trouvons au niveau 49 m. Au sud du sondage 1 1, il n'a pas encore été atteint au niveau 47,35 m auquel nous nous sommes arrêtés.
Les coupes 20 et 21 nous permettent de distinguer successivement :
- les niveaux d'incendie (146 av. J.-C), puis de démantèlement et de comblement ultérieurs :
Couche 1 : Terre rousse chargée en éléments de destruction.
Couche 2 : Terre ocre chargée en éléments de destruction.
Couches 3-5-7 : Cendres et bois calciné. Couches 4 et 6 : Cailloutis argileux ocre,
compact. Sur ces coupes, nous retrouvons dans la cou
che 1 la couche 27, déjà individualisée et étudiée dans la stratigraphie de la butte Lapeyre. C'est cette couche 1/27, ainsi que la couche 2/28 qui lui est très semblable, qui ont noyé et enseveli les blocs de l'effondrement. Le dépôt de ces couches, postérieur à la chute des blocs, a d'ailleurs laissé entre eux de nombreux vides. La couche 1/27 se trouve, dans les sondages 11 et 12, nivelée à son sommet par la surface damée β.
Les couches 3 à 7 semblent avoir coulé (sans doute sous l'action de ruissellements violents) le long de la pente en se modelant aux flexures du terrain. Leur sommet est marqué par un écrasement caractéristique d'amphores, occasionné par la chute des blocs, et qui recouvre indifféremment les couches 3 et 7 sur la Coupe 21.
Sous ces couches, déposées dans un intervalle de temps sans doute réduit, après l'incendie de la ville, et avant la destruction systématique des ruines subsistantes, nous retrouvons la surface damée α déjà rencontrée dans le sondage 8, et partiellement reconnue dans le sondage 10. Cette surface, que nous avons identifiée à une
chaussée de rue ou de place, rattrape ici la dénivellation du terrain naturel, dont elle régularise la pente : tranchant le sommet de l'argile en place, sur la Coupe 20, elle surmonte, sur la Coupe 21, un remblai artificiel, antérieur à la destruction de la ville :
- Les niveaux de remblai de la chaussée (d'époque punique tardive) :
Ce sont les couches 8-9-10 de la Coupe 21. - couche 8 : gravier argileux - couches 9 et 10 : terre cendreuse
Ce remblai va en s'épaississant vers le sud pour rattraper une pente de plus en plus forte.
Interprétation du secteur.
Notre nouveau sondage a donc partiellement confirmé l'impression des fouilleurs précédents31, qui se représentaient les choses «comme si un pan de mur (d'un édifice situé plus à l'ouest) s'était écroulé sur la bâtisse (c.à.d. la maison comprise entre les piles C 10-C 12 et Β 7- B 9) et ses abords». Nous examinerons plus loin une restitution possible des vestiges architecturaux trouvés en place à l'ouest de l'effondrement : les blocs ainsi basculés pourraient effectivement provenir d'une façade de maison située plus à l'ouest, dans le prolongement du mur punique que nous avons précédemment décrit.
La présence de colonnes ne doit pas nécessairement orienter les hypothèses vers un édifice de type religieux (temple, chapelle) ou public (portique). Au contraire, le gabarit modeste de ces fûts s'accorderait mieux à une architecture civile à usage domestique : ils pourraient trouver place dans des péristyles de maisons, ou des portiques d'entrée comparables aux exemples que nous offre l'architecture délienne de même époque. La présence de tels éléments en des points variés du site conduirait alors à penser que de semblables types architecturaux étaient assez largement répandus dans le quartier d'habitations qui s'était construit à l'époque hellénistique sur le flanc sud de la colline.
Matériel.
Couches 1/27 et 2/28: Attique (figures rouges tardives; fragments de lécythe, d'aryballe;
Cali. Byrsa 5, p. 79.
Ni Ο
850900
Fig. 21a - L'édifice effondré : coupe sur les blocs (relevé J.-M. Carrié et E. Lafaye, mise au net R. Guardi).
LE SECTEUR Β (1974-1975) 121
fonds de coupes à cercles concentriques extérieurs et palmettes intérieures; tasse à pied mouluré); Apulien et Italiote (anses de coupes, de cratères); bol mégarien (un fragment à décor de palmettes en écailles et Amour
seur); Camp. A très abondante (1; 2; 3; 24; 34; 42; 55; fonds de plats à cercles peints; 21/25); Camp. Β : nombreux fragments (1; 16? 36; assiettes apodes, à bord de forme 36; 48?); Imitations de Camp. (5; 23; 27; 34; 36; askos);
293 Ο
E IH 16
302 G
F ΙΠ 14
306 ο
E m 12 FBI 9 F HU 10
308 Ο 309 Ο 310 Ο
Fig. 21b - Croquis de situation de la coupe sur les blocs (A-B-C).
1 angle N-E du sondage: à 7,76 du pt. 30; à 10,66 du pt. 304.
2 point Β : à 6,20 du pt. 30; à 7,16 du pt. 304. 3 angle S-E de la pile N-W : à 3,19 du pt. 301; à 5,39 du pt.
30. 4 départ de la coupe AB sur la pile S-E : à 3,13 du pt. 304; à
6,94 du pt. 30. 5 angle S-W du sondage: à 6,89 du pt. 301; à 1,22 du pt.
304.
6 angle E de la banquette S : à 5,03 du pt. 30; à 6,12 du pt. 301.
7 angle N-W du sondage : à 4,30 du pt. 301 ; à 4,77 du pt. 30. 8 à 6,05 du pt. 293; à 7,80 du pt. 301. 9 à 7,87 du pt. 293; à 7,10 du pt. 301.
10 à 9,85 du pt. 293; à 6,95 du pt. 301. 11 à 11,37 du pt. 293; à 8,10 du pt. 30.
122 BYRSA I
Lampes (Deneauve grecques VIII-IX-X); Marmites; Punique à surface blanche (lécythe Cin- tas 111; olpè Cintas 172; coupes; anses torsadées; balsamaires); Punique à décor estampé (cf. Cah. Byrsa 5, n» 130; 9, n° 439-441 ; 443; 449- 451); grand plat vert à marli; Amphores : puniques B, C, D; rhodienne (fig. 46a); gréco-italique; bouchons. Figurines de terre cuite et disques à décor en relief.
Couches 3-4-6-7 : Bol mégarien; Camp. A (23; 34); Imitations de Camp. (34; 36); Punique à surface blanche; à cercles peints; Amphores : punique C; quelques fragments de stucs. Brûle-parfums (cf. infra, p. 311-331). Statue en marbre d'Artémis (fig. 40).
C) La citerne punique (sondages 13 et 14).
Un sondage pratiqué en 1974 entre la rangée de piles de fondation Β et la butte Lapeyre (sondage 13) a fait apparaître une citerne comparable, par sa forme, à celles qu'avaient mises à jour MM. Ferron et Pinard. Les fouilles antérieures (en l'occurence, celles de Lapeyre) s'étaient arrêtées ici 50 cm au-dessus de l'arase de la cuve32.
Par sa forme allongée, ses deux extrémités en demi-cercles, son mode de construction, cette citerne paraissait bien punique. Pourtant deux particularités la signalèrent, dès les débuts du dégagement, à l'attention : son orientation, étrangère à celle du quartier punique précédemment fouillé comme à celle des constructions romaines; et la certitude acquise, dès le premier examen stratigraphique, que la citerne n'était pas totalement enterrée, comme les autres, mais partiellement construite au-dessus des niveaux possibles de sols. Le sondage 14, ouvert lui aussi en 1974, au sud de la citerne, confirmait bientôt la datation punique tardive de la citerne et les particularités de son implantation.
La campagne de 1975 nous a permis de dégager les murs externes nord et est, de préciser la stratigraphie au nord de la citerne, et de poursuivre partiellement le sondage à l'intérieur de la citerne jusqu'à atteindre son fond.
Description (fig. 22-23-24)
Dans l'état actuel du dégagement, la citerne apparaît comme un bassin étroit, allongé, à extrémités en demi-cercles, inscrit dans un massif de maçonnerie de forme extérieure rectangulaire : l'angle nord-est, tout au moins, a été retrouvé formant un angle droit. La maçonnerie est elle-même composée de deux épaisseurs liées l'une à l'autre, mais de textures différentes. Le « mur interne » trace l'ovale intérieur du bassin. Il est constitué d'un blocage de petits mœl- lons irréguliers coulés dans un ciment gris foncé très résistant, d'une épaisseur moyenne de 37 cm. Le rebord du bassin (NG 50,79 m) et la paroi interne sont recouverts d'un mortier hydraulique gris cendreux, épais de 0,5 cm environ33. Le rebord de la citerne, conservé sur la partie est du côté nord, est parfaitement lissé. Aucune dalle de couverture n'a été retrouvée, mais s'agissant d'une citerne non enterrée, on s'étonnerait de la voir dotée d'une couverture de ce type.
Le «mur externe», qui enveloppe le premier, est construit en petits mœllons de grès du Cap Bon rectangulaires, de 10 à 35 cm de dimension maxima moyenne, liés par un mortier moins résistant que celui du mur interne, disposés en lits horizontaux réguliers. La paroi extérieure, recouverte d'un enduit blanchâtre, à forte teneur en chaux (bien conservé sur le sommet des côtés est et nord-est), est un opus vittatum soigneusement assise. L'épaisseur de ce mur externe (30 cm en moyenne), s'élargit aux angles, dans l'espace compris entre le tracé en arc du bassin et le tracé rectangulaire extérieur. Le dégagement de l'angle sud-ouest, sans avoir encore atteint un sol ou du moins un niveau au sud de la citerne, permet déjà d'affirmer que de ce côté la citerne était libre sur une élévation d'au moins 1,70 m. X\c même, sur le côté nord, le parement externe du mur a pu être suivi jusqu'à une profondeur d' 1,50 m (cf. fig. 25). Le dégagement encore incomplet des parois extérieures de la citerne confirme déjà, cependant, l'hypothèse tirée des premières constatations stratigra- phiques (elles seront exposées plus loin), selon laquelle cette citerne n'avait pas été creusée et
32 Cf. Cah. Byrsa 9, pi. 26; l'emplacement de la citerne est à l'arrière-plan. 33 Une première couche de 40 mm, une seconde de 7 mm.
123
LA CITERNE PUNIQUE J (sondages 13 et
Ο 1 2 3 U GR 12- XI -77
Fig. 22 - La citerne punique J : plan (relevé G. Robine).
124 BYRSA I
Fig. 23 - La citerne punique J : extrémité ouest (cliché J.-M. C).
Fig. 24 - La citerne punique J : extrémité est (cliché S. Lancel).
maçonnée contre les parois d'une fosse : elle n'était que partiellement enterrée.
Par contre, ses dimensions l'apparentent aux citernes du quartier est : 5,10 m pour la longueur intérieure du bassin, 1,25 m pour sa largeur, 3,61 m de profondeur^4.
" On comparera avec les dimensions des citernes fouillées par MM. Ferron et Pinard : 5,20 m x 0,90 m; 3,20 m x 1,15 m; 4,30 m χ 1,10 m; 4,15 m x 1,05 m; 5,60 m x 1,15 m; 2,90 m x 1,15 m. Les profondeurs de ces citernes varient entre 2,70 m et 4,60 m : Cali. Byna 9, p. 98.
Son état de conservation est très inégal. Le sommet du mur a été détruit sur toute l'extrémité ouest. D'une façon générale, la ruine a été plus profonde sur le côté sud que sur le côté nord, et sur le mur externe que sur le mur interne, plus résistant. Sur le côté nord, le mur externe ne s'élève plus qu'à une cinquantaine de cm au-dessous du mur interne (fig. 25), et nous en avons trouvé des éléments de destruction (moellons et ciment) à l'extérieur nord de la citerne, en contrebas du mur actuellement conservé.
D'autre part, l'alignement des piles Β est venu recouper l'axe de la citerne, et l'une des piles (B 3) repose directement sur le mur sud, qu'elle a commencé à faire basculer sous son poids, l'arrachement occasionnant à son tour une crevasse dans l'extrémité sud-ouest du bassin. Ces conditions nous imposaient de procéder à un dégagement limité et prudent.
A l'intérieur du bassin, nous avons dû nous contenter de descendre dans un carré de 1,25 m de côté, qui nous a permis d'atteindre le fond cimenté au niveau 47,12 m.
Situation stratigraphiqiie (fig. 25).
L'examen de la coupe fait apparaître le même remblaiement, à quelques nuances près, à l'intérieur et à l'extérieur de la citerne. En remontant les couches à partir du niveau le plus profond, nous rencontrons successivement : Couche 27 (déjà décrite à propos de la Coupe
20) : C'est elle qui a rempli, pour l'essentiel, la cuve de la citerne, jusqu'à 120 cm au-dessous du rebord. Au sud de la citerne, elle plonge légèrement, en suivant la pente de la colline et, plus encore, l'étagement probable des niveaux d'occupation.
Couche 26 (déjà décrite à propos de la Coupe 7) : On ne la trouve qu'au nord de la citerne (dans laquelle elle a également pénétré). Elle y est aplanie par la surface dure β, déjà rencontrée sur la Coupe 5, et qui trace la limite entre les premiers comblements et le remblai augus- téen. Nous n'avons cependant pas retrouvé cette surface d'aplanissement au sud de la citerne.
Couche 22 (déjà décrite ibid.) : Elle surmonte la couche 26 au nord de la citerne, et directement la couche 27 au sud.
LE SECTEUR Β (1974-1975) 125
N.G. 50,70m 0 . ' · β - ." . · "ι
7//////////////.
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Fig. 25 - La citerne punique J : coupe (relevé J.-M. Carrié, J.-M. Gassend et N. Sanviti; mise au net U. Colalelli).
126 BYRSA I
Couche 19: couche argilo-sableuse à cailloutis. 19 bis : horizon cendreux. C'est la première couche du remblai augus-
téen à avoir recouvert sans discontinuité les deux parois de la citerne. Après dégagement de la pile de fondation Β 3, la couche 19 se lit encore sur la maçonnerie de celle-ci, en négatif inversé.
La solution de continuité stratigraphique entre la butte Lapeyre et le sondage 14 rendrait hasardeuse toute identification des couches supérieures dans la partie sud de la Coupe 25. Nous ne les intégrerons donc pas à la numérotation continue des couches. Ce sont, toujours en remontant la coupe :
couche d : constituée à peu près uniquement de céramiques et de matériel de destruction ou de rebut.
couche c : cailloutis mêlé de cendres et d'ossements.
couche b : poche détritique. couche a : cailloutis gris peu dense.
A titre indicatif, puisqu'il s'agit ici encore de niveaux de remblaiement, nous donnerons à la fin de ce chapitre un aperçu sommaire du matériel extrêmement riche retrouvé dans ces couches supérieures.
Pour conclure sur ce contexte stratigraphique, nous dirons que tout se passe comme si la présence de la citerne n'avait modifié en rien les processus de remblaiement naturel, puis de remblaiement artificiel, qui ont affecté l'ensemble de la zone. Une telle situation serait totalement incompréhensible, si nous ne prenions en considération deux faits particuliers : toute la partie supérieure de la cuve s'élevait au-dessus du niveau d'occupation punique; et le sommet du mur, exposé à la destruction pour cette raison même, a été partiellement démantelé, surtout dans la moitié ouest, ce qui a permis à la couche 27 de pénétrer à l'intérieur de la cuve, au-dessous du niveau initial de ses parois.
Intérieur de la citerne.
Le fond de la citerne était recouvert d'un dépôt cendreux d'environ 10 cm d'épaisseur, surmonté par la couche 27. Celle-ci contenait à sa base des briques crues (épaisseur : 10 cm;
gueur : 30 cm) et de nombreux débris de stucs et de pavements puniques.
Le matériel trouvé in situ sur le fond de la citerne peut être considéré comme contemporain de la dernière période d'utilisation de la citerne. Il se compose essentiellement de céramique punique commune : lagynos (Cintas 98 ter); cruches (fig. 32a et b); fragment de vase à décor incisé (fig. 33); récipients divers (Cintas 341-352 à cercles peints; 359 bis; 149 ter; 114); nombreux fonds à dépression et ombilic; un fragment à vernis rouge (sans forme); amphores C d'Ibiza.
Interprétation architecturale.
En attendant qu'une éventuelle poursuite du dégagement dans ce secteur fasse apparaître les niveaux d'occupation puniques en relation avec la citerne, nous pouvons au moins émettre une hypothèse sur le rôle que jouait cette structure dans l'organisation de l'habitat où elle prenait place, et auquel appartenait également le mur punique M précédemment décrit.
Notre citerne ne marquait pas la limite extérieure d'une maison; sans avoir encore trouvé plus au sud des murs puniques en place, nous avons déjà vu apparaître, au moment d'arrêter le sondage 14, des éléments de destruction (blocs de grès et briques crues) provenant de murs dont la base au moins aura pu être préservée.
Nous pensons donc que cette citerne assurait la transition entre deux niveaux d'une même habitation étages sur la pente de la colline.
Nous avons déjà, sur le site, l'exemple de maisons puniques se développant sur plusieurs niveaux : des cloisons mitoyennes assurant la continuité de la construction d'un étage à I'autre3\ Ici, le parti choisi est plus original encore, puisque c'est une citerne émergée qui délimite le passage entre deux paliers i6.
" Ainsi, dans la maison punique située sous l'angle nord- ouest du bâtiment basilical.
16 Un rapprochement partiel peut être fait avec une citerne, aménagée elle aussi en fonction d'une rupture de niveau, à Solunto, dans la Casa di Leda, d'époque hellénistique. En attendant la publication par V. Tusa, cf. M. De Vos, Pitture e mosaico a Solunto dans BABeih 50, 1975, p. 213, 111. 8 (plan et coupe B).
LE SECTEUR Β (1974-1975) 127
Matériel du remblai (sondage 14).
Couche 22 : outre le matériel déjà décrit supra (p. 105): Attique (rare); Camp. Β à décor peint (23); Imitations Camp. (8; 23; 26; 36; gut- tus.); Ampuritaine (rare); Punique à surface blanche (Cintas 111); à couverte blanche vernie (fig. 38); à décor peint (Cintas 170/171).
Couche 19 : Camp. A (9 = forme de la Β chez Lamboglia); Camp. Β (bases d'hydries, de pyxis, de lécythe; col d'olpé); Imitations de Camp. (1; 5; 24; 28); Ampuritaine (anses de coupes); Marmites.
Couche d: Attique (coupes Corbett 155); Camp. A (23; 25; 27; 28; 34; 36; 42 c; 55) Camp. Β (hydrie; coupe); Imitations Camp. (23; 28; 31; 36; 42 b; 55); Punique à surface blanche (cratère; oenochoés; Cintas 145; vases- biberons; balsamaires); Punique à bandes peintes; à vernis rouge (rare); Amphores : rho- dienne, timbre ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ (fig. 46 b); punique C d'Ibiza; Marmites (très nombreuses); Lampes grecques.
Couche c : Italiote à figures rouges; Attique IVe siècle et précampanienne (abondante); Camp. A (33; 34; 55); Camp. Β (assiette apode à rebord de 36); Imitation de Camp.; Punique à surface blanche; marmites.
Couche b : Camp. A en très grande abondance (28; 31; 32; 34; 36; 55); Camp. B rare (29); Imitations de Camp, très abondante (21/25; 23; 27; 28; 34; 55).
Couche a: Attique (1 frag. 23); Camp. A, B, et imitations; Punique à surface blanche vernie {Cintas 383/384, à décor de triangles rouges) et non vernie; Marmites; Lampes {Deneauve grecques XII et XV).
VI - Reconnaissance topographique DANS LA PARTIE NORD DU SECTEUR
Cette zone, artificiellement aplanie par les fouilles antérieures suivant une légère pente nord-ouest - sud-est, a été si profondément décapée que le niveau du tuf naturel s'est trouvé partout atteint, et même entamé en plusieurs endroits". C'est assez dire que, dans ce secteur,
" Au nord du mur D, en particulier : cf. la dépression indiquée sur la fig. 1, à l'est du mur 4.
la couche archéologique conservée est particulièrement mince. A notre connaissance, il n'existe aucun compte-rendu de ces explorations dévastatrices. Il est certain, du moins, qu'aucune des structures que nous allons décrire ne figure sur le plan de Thouverey. Dans ces conditions, notre objectif était ici de repérage plutôt que de fouille. Nous avons fait réapparaître les structures précédemment dégagées, pour les porter sur le relevé général du secteur, et tracé un front de taille prolongeant le côté ouest du sondage 7.
A) Eléments punique s : c i t e r n e s e t m u r s (cf. fig. 26).
Le résultat le plus important auquel ait conduit cette prospection réside dans la certitude que des habitations puniques occupaient cette zone à l'époque hellénistique. L'aire d'habitat précédemment reconnue par MM. Ferron et Pinard s'en trouve élargie d'autant et les vestiges puniques que nous avons nous-mêmes dégagés trouvent place dans ce nouvel ensemble.
La citerne compartimentée (K).
Elle reproduit la forme, les dimensions et le mode de construction des autres citernes du quartier d'habitations puniques précédemment fouillé: largeur, 1,30m à 1,40m; mur en petits mœllons liés par un ciment gris sombre; enduit gris cendreux sur les parois internes. Elle offre cependant la particularité d'être divisée en trois compartiments communiquant largement entre eux, mais marqués par des étranglements de la paroi des côtés longs. A une profondeur qu'on ne peut préciser - la citerne a été surfouillée, et les rebords de la vasque détruits - mais qu'on peut estimer de l'ordre de 1 m, ces étranglements formaient comme des consoles de 50 cm de long sur 12 cm de large, sur lesquelles reposaient des dalles transversales enjambant la cuve. Ce dispositif était originel, puisque l'enduit punique gris recouvre uniformément les ressauts de la paroi et les joints entre ces ressauts et les dalles transversales. On distingue par contre un remaniement ultérieur lié à une modification dans les conditions d'utilisation de la citerne : le compartiment central a été isolé des deux autres par deux murets de petits mœllons construits au-dessous et au-dessus des dalles transversales. Le nouveau bassin ainsi délimité a
128 BYRSA I
RECONNAISSANCE TOPOGRAPHIQUE DE_LA PARTIE NORD DU SECTEUR Β - ELEMENTS PUNIQUES -
Fig. 26 - Reconnaissance topographique dans la partie nord du secteur (relevé G. Robine).
Robine 11-XI-77
reçu un enduit de tuileau rose qui suggère, au même titre que les nombreux fragments de marbres architecturaux réemployés dans ces murets, une date tardive pour ce remaniement.
La cil crue L.
Plus au nord, il est possible encore de reconnaître dans une ruine résiduelle, résultat
lant des dégagements antérieurs, l'un des murs de pourtour d'une citerne punique, déchaussé par les prospecteurs de tombes. L'amorce de l'arrondi est encore marquée à chaque extrémité, et la face interne porte trace du ciment cendreux caractéristique. Les dimensions approximatives, obtenues après estimation du rayon de courbure des extrémités, seraient de l'ordre de 5,70 m pour la longueur, 1,40 m pour
LE SECTEUR Β (1974-1975) 129
Fig. 27 - La partie nord du secteur Β (cliché J.-M. C).
la largeur". L'orientation de cette citerne est grossièrement identique à celle de la citerne K, et l'on s'étonne que la répétition de cet alignement n'ait jamais été remarquée auparavant.
Lus murs voisins de la citerne K.
Parallèles ou perpendiculaires aux longs côtés de la citerne K, subsistent encore des fondations de murs en petits mœllons, d'une largeur pouvant atteindre 80 cm (murs F sur la fig. 26). Au sud-ouest de la citerne compartimentée subsiste encore, au niveau d'arrêt des fouilles anciennes, un alignement de blocs de grès taillés, de fortes dimensions. Ces blocs ont été reportés sur le plan Thouverey, sous la forme d'un mur (fig. 1, n° 5), représenté comme un contrefort oblique de la pseudo-enceinte punique. Il apparaît, à l'examen, qu'ils ont été basculés sur le côté pour faciliter le débitage qu'on projetait d'en faire et dont la pierre porte la trace. Leur largeur actuelle (1 m environ) correspond en fait à leur
hauteur, leur largeur originelle étant de 73 cm. Replacés dans leur position initiale (fig. 26, mur f 5), ils se trouvent alors alignés avec le mur f 4, dont ils constituaient sans doute une extrémité renforcée : disposition qui se rencontre dans de nombreux murs à structure hétérogène des maisons du quartier est.
Β ) É l a m e η î s cl' é ρ ο q u e r υ ni a i η e : ni n r s et pii e s de f ο η d a t i ο η .
Dans l'alignement des piles de fondation E, conservées à l'Est du chantier (secteur A; cf. IIe Partie, I, fig. 14), nous avons pu reconnaître, inégalement reconnaissables, les traces de deux autres piles, et peut-être même d'une troisième w.
Les piles de la rangée E sont aisément identifiables, par leur matériau et leur mode de construction : blocage grossier de mœllons irrégu- liers de calcaire de l'Ariana simplement liés à l'argile. C'est précisément cet appareil que nous avons retrouvé :
- Pile Eh : Elle subsiste à l'extrémité de notre sondage 8, sur une hauteur d'une cinquantaine de cm. Les fouilles antérieures l'ayant à moitié détruite, sa situation exacte et son contour originels ne peuvent être qu'approxima- tivement connus. Cette pile reposait directement sur l'argile de la colline.
- Pile El: »Mieux conservée que la précédente, elle repose en partie sur les fondations puniques en mœllons que nous avons signalées précédemment, à l'extrémité ouest de la citerne compartimentée (K). C'est ici que la similitude apparaît le mieux avec les piles El et E 3 (secteur A).
- Enfin, quelques mœllons de calcaire de l'Ariana subsistant en bordure d'une excavation moderne, à l'ouest des fondations du monument basilical, pourraient témoigner de l'emplace-
'*Ni\eau absolu du rebord actuellement conser\é: 52,63 m; nheau au sommet des dalles transversales de la citerne K: 51,59m (mais le rebord des parois était situé plus haut). Ces chiffres nous donnent au moins une indication appro\imati\e sur les ni\eau\ de sol des habitations puniques de cette /one.
™ La plupart des piles de cette rangée ont disparu; on peut cependant donner une restitution hypothétique de leur emplacement. De nom elles piles pomant être retrou- \ées, tant \ers l'est que vers l'ouest, nous n'a\ons pu suhre le même type de numérotation que pour les autres alignements. Une solution provisoire a été de numéroter les piles les mieux conser\ées (secteur A) d'ouest en est, et de donner une lettre aux piles détruites, d'est en ouest à partir de la pile El.
130 BYRSA I
ment de la pile Ee. Mais dans ce dernier cas, les indices sont plus ténus.
D'autre part, la coupe nord-sud tracée à l'est de la citerne compartimentée (fig. 4, talus 15) a fait apparaître deux murs de fondation en blocage de faible épaisseur orientés dans l'axe des constructions romaines.
D'autres murs de même orientation sont encore visibles en section sous les fondations ouest du monument à plan basilical, mais les destructions opérées par les fouilles anciennes ne nous permettent pas de dire si ces divers segments de murs étaient en relation les uns avec les autres. Nous pouvons cependant nous assurer que dans toute cette zone comprise entre l'alignement des piles E et le talus en contrebas du Circuit Saint-Louis, des fondations de murs romains parallèles aux axes de decumani avaient été coulées en tranchées dans le remblai augus- téen, moins épais ici qu'en contrebas, jusqu'à atteindre le sol natif de la colline.
VII - Hypothèses et perspectives
A) De nouvelles in s ul a e d u quartier pu η iq ue (cf. fig. 28).
Trois citernes (j, k, 1) et trois alignements de murs (m, f5, f4) nous permettent d'établir avec certitude que le quartier d'habitations hellénistiques fouillé par MM. Ferron et Pinard se poursuivait dans notre secteur, mais selon une orientation différente, formant avec l'autre alignement un angle de 20 à 22° environ40. Nous pouvons ajouter à ces vestiges la citerne h, dégagée par Lapeyre sous la pile C 5. Il n'en reste actuellement qu'une partie de l'extrémité nord, prise dans le béton de la pile. Mais l'orientation de cette citerne, relevée par Thouverey (fig. I, n° 3), et reportée sur notre schéma (fig. 28, h), est exactement parallèle à celle des murs m et f5 et perpendiculaire à celle des citernes j, k et 1. Il est donc assuré que les principes d'urbanisme orthogonal à l'œuvre dans les îlots du secteur A ont également présidé à l'aménagement de la zone que nous venons de reconnaître.
40 Cf. Ant. Afr. 11, 1977 (art. cité), p. 86, fig. 14.
La poursuite de la fouille permettra, nous l'espérons, de compléter ce premier relevé, dans la partie sud tout au moins. Au nord, les fouilles précédentes sont en effet descendues considérablement plus bas que les niveaux de sol des habitations puniques. En l'état actuel de la fouille et de la reconnaissance topographique, nous proposons provisoirement l'interprétation hypothétique de la fig. 28, que nous avons fondée sur les considérations suivantes :
- La distance maxima séparant ces vestiges (36 m entre les citernes j et 1) est nettement supérieure à la longueur des îlots du secteur A (30 m environ). Nous nous trouverions donc dès maintenant en présence de deux îlots distincts.
- La paroi est du mur m présente une fondation en gradins; il ne peut donc s'agir d'une cloison intérieure, mais d'un mur périmétral, qui nous donnerait l'alignement de l'îlot sur son côté est. De fait, aucun mur punique n'a été retrouvé plus à l'est, mais uniquement l'aire damée étudiée dans le sondage 8. Les blocs d'architecture du sondage 11 pourraient donc résulter de l'écroulement de la partie orientale de l'îlot; ils auraient partiellement dévalé la pente de la rue (ou de la place?), en direction du sud-est.
- L'extrémité nord de ce même mur C, constituée d'un bloc presque carré, d'une largeur plus forte que celle des autres parpaings, pourrait fort bien indiquer l'angle des murs est et nord de cet îlot.
- La même remarque pourrait être faite, encore qu'avec plus de prudence, tant la disposition originelle a été bouleversée, pour l'extrémité sud du mur f5. S'il en était ainsi, il subsisterait environ 4 m entre les deux îlots, largeur suffisante pour donner place à une ruelle.
Notre connaissance de ce nouveau secteur d'habitation punique ne pourra malheureusement se préciser que dans les parties non touchées par les fouilles de Lapeyre.
- La citerne j, si notre interprétation en est correcte, ne saurait se situer trop près de l'extrémité sud de l'îlot dont elle fait partie, puisqu'elle a pour fonction d'assurer la transition entre deux niveaux différents de construction. La plus grande dimension de l'îlot serait donc dans la direction nord-nord-ouest - sud-sud-est, c'est-à- dire dans le sens de la pente dominante dont le
LE SECTEUR Β (1974-1975) 131
IBIBIBIBIBIBIBIBIB
I AIRE \ : D'ECROULEMENT» t ACTUELLEMENT · ·. DEGAGEE. / Λ /
Fig. 28 - Restitution hypothétique de nouvelles insulae puniques (schéma J.-M. Carrié et G. Robine).
132 BYRSA I
problème aurait été résolu par une construction en terrasses étagées. Au contraire, dans les habitations dégagées par MM. Ferron et Pinard, l'implantation par rapport au pendage du terrain était oblique, ce qui accentuait l'inconvénient de ne pouvoir éliminer une certaine inclinaison des édifices, verifiable aujourd'hui encore sur les pavements de sol.
D'ores et déjà, cette nouvelle orientation de maisons puniques, dont il faudrait maintenant préciser la chronologie relative par rapport aux maisons déjà fouillées en 1953-1956, constitue une pièce importante à verser au dossier de la ville punique à l'époque hellénistique. A l'orientation perpendiculaire ou parallèle au rivage, que la Mission Allemande vient de dégager près du Palais Beylical, s'ajoutent et s'opposent déjà sur le seul flanc sud de Byrsa, deux orientations différenciées, quoique limitrophes. En même temps qu'à une adaptation très sectorielle aux conditions topographiques des divers quartiers, on pourrait penser encore à des opérations successives et ponctuelles de rénovation ou d'extension de la ville à partir du IVe siècle. Les quartiers nouveaux ou rénovés auraient surimposé des ensembles orthogonaux dans les mailles libres du vieux tissu urbain41. Seule, en effet, une ville à plan orthogonal originel peut maintenir intacte une telle disposition à travers les siècles.
Cette diversité devrait déjà nous inviter à aborder plus prudemment, désormais, le problème des permanences ou des continuités cadastrales entre la Carthage punique et la Carthage romaine. M. Ferron, après Charles Sauma- gne, voyait dans la centuriation rurale (ou grac- chienne) une généralisation de l'orientation qu'il avait dégagée à Byrsa. Nous savons maintenant qu'à Byrsa même, cette orientation n'était pas imperative ou exclusive. De même, il serait tentant d'extrapoler à partir de la superposition des orientations punique et augustéenne en bordure de mer. Ne faudra-t-il pas résister à cette idée séduisante à première vue? En effet, de ces diverses orientations des quartiers puniques, laquelle serions-nous justifiés de privilégier?
B) Chronologie r e l a t i ν e cl e s édifices cl' é ρ ο c/ ιι e r ο m a i η e (cf. fig. 29).
Les structures d'époque romaine ou postromaine constituent cinq alignements parallèles, inscrits dans l'axe des decumani de la Colonia lidia Angusta*2. Ce sont, successivement : le soutènement d'absides (A), les piles de fondation B, le mur à arcs sur piles de fondation (C), le mur D et la troisième rangée de piles de fondation (E). Légèrement différente est, par contre, l'orientation du monument à plan basilical, qui recoupe l'axe précédent par une déviation de 2° environ.
Les espacements compris entre ces divers alignements se présentent de la manière suivante (d'axe à axe) :
11,40 m entre le mur A et les piles B43; 1 1,40 m entre les piles B et le mur C; 6,60 m entre le mur C et le mur D; 5,50 m entre le mur D et les piles E.
Nous avons proposé de reconnaître dans le mur D une fondation contemporaine des travaux augustéens d'aménagement de la colline. En ce qui concerne le mur C, sa fonction et sa date ont été éclairées par le dégagement d'un temple (à l'ouest de notre secteur) dont l'alignement des piles C prolonge la fondation nord. Qu'il nous suffise de renvoyer le lecteur, sur ce point, au rapport de fouilles du secteur ouest44. Il reste donc à préciser la chronologie et l'interprétation des rangées de piles B et E.
Les piles de fondation E.
Ces piles, nous l'avons vu, sont antérieures au monument à plan basilical. D'autre part, certaines de leurs particularités ne se retrouvent guère ailleurs que dans le mur D. C'est, tout d'abord, l'emploi de mœllons de calcaire de l'Ariana mêlés à des éléments de destruction
41 La Rome tardo-républicaine et impériale illustre parfaitement ce type de développement urbanistique.
42 Nous ne voyons pas ce qui a autorisé Lapeyre à dire que le mur C n'est « pas tout à fait parallèle » au mur D (art. cité, p. 343).
4' Intervalle calculé à partir du fond des absides d'après le plan Bonnet - Labranche publié par A.L. Delattre dans BCTH 1893, pi. XL
44 Cf. infra, p. 168-171.
LE SECTEUR B (1974-1975) 133
puniques, parmi lesquels quelques blocs de fort calibre. C'est, ensuite, le parement que présente la partie supérieure de ces piles, parement polygonal sommaire, certes, mais suffisamment appareillé pour nous obliger à considérer que cette partie au moins a été construite à l'extérieur, cependant que la base des piles était moulée dans une tranchée de fondation : ce même parement apparaît sur le mur D (mais sur toute son élévation).
On remarquera d'autre part que sur les piles E1-E2-E3 la partie supérieure penche vers l'est, créant la distorsion singulière qui caractérise ces piles : autre indice d'une construction à l'air libre, par conséquent antérieure au dépôt du remblai augustéen venu ensuite les ensevelir. Le niveau auquel se fait le passage de la base coulée dans une fosse à la partie supérieure construite à l'air libre correspondait certainement à la surface β, c'est-à-dire au niveau supérieur des couches de destruction et de comblement naturel qui recouvrait les ruines puniques : ce que devrait vérifier la fouille de nouvelles piles à l'est du site4S.
Parmi les piles disparues dont nous pouvons restituer aisément l'emplacement, la pile Ea mérite une mention particulière. Nous retrouvons le tracé de son implantation au centre d'une mosaïque de sol qu'elle a percée. Or c'est à cet endroit même que MM. Ferron et Pinard ont dégagé et relevé un massif de blocage perpendiculaire au mur est du bâtiment basilical, avec lequel il était en relation architecturale directe46. On ne prit pas garde, en détruisant ce massif, qu'il avait incorporé la pile Ea. Cette fondation en blocage était moins profondément établie que la pile, puisqu'elle a laissé intacte au moins la première assise des murs puniques qui entouraient la mosaïque. Cette superposition constituerait, s'il en était besoin, un argument supplémentaire pour établir la date ancienne à laquelle remontent les piles E.
Ces piles sont donc liées au premier aménagement romain du site, et contemporaines du mur D. Le mode de construction de ces deux structu-
45 La partie inférieure du mur D, par contre, a été construite dans une tranchée plus large que la fondation, et a donc pu être elle aussi parée.
46 β sur le plan de M. Pinard, Cah. Byrsa 5, planche II.
res, par les similitudes qu'il offre entre elles ainsi qu'avec d'autres murs fouillés par la Mission Archéologique Anglaise, fait apparaître des caractères qu'il faudra donc considérer comme typiques de l'architecture augustéenne à Car- thaee.
La rangée de piles B.
Elles sont fondées beaucoup moins profondément que toutes les autres structures. Le type de blocage qui les constitue : petits mœllons noyés dans un ciment gris blanchâtre, est très différent de celui des fondations du monument basilical, et se rapproche davantage des murs tardifs décrits au sommet de la Butte Lapeyre. Certaines de ces piles (en particulier B 8 et B 9) ont incorporé, à leur base, des blocs puniques, à un niveau tel qu'ils ne peuvent avoir été rencontrés en cours de creusement des fosses. Ils ne peuvent donc provenir que de la destruction de murs romains antérieurs, où ces blocs puniques étaient eux-mêmes en réemploi : on peut penser au sommet du mur D. Les piles B pourraient donc avoir été installées après la désaffectation des constructions romaines. Nous ne pensons pas pouvoir préciser davantage leur date, dans l'état actuel de la fouille. On fera tout au plus remarquer que leur alignement, abstraction faite de son tracé hésitant, a été établi exactement à mi-distance entre le fond des absides A et les piles C; et que le rythme de ces piles (4,30 m à 4,50 m) s'adapte grossièrement à celui des piles C (4,50 m), non sans quelques décalages locaux. Vraisemblablement, le mur C était encore utilisable quand les piles B furent construites. Mais nous n'avons aucun indice que les deux structures aient pu fonctionner ensemble.
Interprétation des fondations romaines.
Le plus souvent, ces fondations ne nous ont pas été conservées dans leur élévation originelle. Le mur D est celui que les fouilles Lapeyre avaient déjà rencontré dans l'état de destruction le plus avancé, les blocs qui le constituaient l'exposaient naturellement à la récupération de pierre, qu'il a peut-être commencé à subir dès
134 BYRSA I
NG 55
50m.
Fig. 29 - Les terrassements romains sur le flanc sud de Byrsa (coupe J.-M. Carrié, mise au net U. Colalelli).
l'Antiquité47. Son élévation originelle ne peut être restituée.
La structure la mieux conservée est le mur C, pour lequel nous avons conservé les niveaux suivants :
Sommet des piles : 53,33 m (C 6) à 53,48 m (C 7)4î<.
Niveau de l'extrados des arcs: 55,12m. Nous tiendrons compte surtout de ce dernier niveau, qu'on peut supposer constant sur toute la lon- guer du mur49. Des niveaux très semblables se
47 Le seul niveau discernable sur le mur D est la limite entre les parties inférieure et supérieure de la fondation : 52,30 m dans notre secteur, 51,10/51,15 m sous le monument basilical (de même sur le plan Thouverey, art. cité, pi. 5). A l'est du monument, le mur D s'enfonçait sans doute encore, à la recherche du sol naturel : cependant, le niveau 45,70 m donné par Thouverey à la pi. 3 est manifestement faux, comme tous les autres niveaux indiqués par ce relevé.
4ii Thouverey indique pour cette même mesure un niveau de 51,65 m (art. cité, pi. 3 et 5). Cette erreur grossière s'explique sans doute par celles de la pi. 5, où le sommet du blocage des piles C (sous les blocs de couronnement) est aligné, on ne sait pourquoi, sur celui de la semelle du mur D.
49 Mesure prise sur le tronçon conservé entre les piles C 6 et C 7. Par contre, nous l'avons vu, la hauteur des piles variait légèrement : le rattrapage était effectué par le mur à arcs, dont la hauteur varie de 1,64 m à 1,79 m entre les piles C 6 et C 7. Thouverey aurait relevé une hauteur de 2,35 m pour un tronçon aujourd'hui disparu, qu'il n'a pas localisé en plan (art. cité, pi. 4). Il s'agit cependant d'une erreur manifeste, puisque le rayon indiqué pour le cintre est de 1,35 m.
retrouvent sur d'autres sommets de fondation arasés au nord de la zone des nouvelles fouilles; ils sont en relation avec le niveau de nucleus portant l'empreinte d'un dallage qui, retrouvé au nord du secteur C, situe à la cote NG 56 m la terrasse supérieure de la colline50.
Associé au mur C, nous possédons également le niveau du sol de tuileau (couche 2 de la Coupe 7) qui scelle le remblai augustéen : 53,67 m. Nous ne pouvons dire si ce sol, malheureusement trop peu conservé, est un sol augustéen originel, ou s'il a été remanié plus tard (il ne pourrait alors qu'être plus bas par rapport au niveau initial). Son épaisseur (4 cm) paraît faible, en comparaison de celle du nucleus mentionné précédemment. Il ne peut pourtant s'agir en aucune façon d'un fond de citerne comme il s'en trouve dans le secteur : ces fonds étant toujours de béton gris, et reposant uniformément sur une ruderatio de moellons.
La première interprétation qui se présente de ces fondations les mettrait en rapport avec des portiques de péribole entourant l'area centrale aménagée au sommet de la colline. Autant que les espaces entre alignements et les niveaux, importent les rythmes propres à chaque structure.
L'écart entre les piles E (5 m) est légèrement supérieur à celui des piles C (4,50 m); cette rela-
Cf. cuprei, p. 53.
LE SECTEUR B (1974-1975) 135
-■ - -' ' Ά "■"·>· -■^^"^"■■ώΧ,Γ- ^:'VrF".lI^, ^;*^' .ο«» "\- -Λ·^' '"^?c^^*!5\l'* >^
Fig. 30 - Un arc du mur C (cliché J.-M. C).
tion est inverse de l'espacement plus large entre les piles E et le mur D (5,50 m) qu'entre les piles C et le mur D (6,60 m). D'autre part, l'écart entre les piles E ne correspond pas à celui qui sépare les chaînages renforcés du mur D (6 m). Pourtant, nous pensons que le mur D et les piles E sont contemporains. Il ne peuvent donc avoir supporté qu'un portique ouvert par une colonnade sur Varca centrale, mais fermé vers l'extérieur par un mur plein rythmé de demi-colonnes engagées, selon un espacement différent de celui des colonnes.
Dans ce premier aménagement, le portique aurait été conçu en fonction des édifices construits au centre de la terrasse supérieure. Edifié très nettement en retrait par rapport au mur à absides qui délimitait le bord du plateau (29,40 m), ce premier portique, vu de la ville basse, ne pouvait guère offrir une perspective architecturale de grand relief Sl.
Dans une deuxième phase, le flanc sud-ouest de la colline, tourné vers les ports et les quartiers principaux de la ville, a été conçu comme une façade monumentale plaquée contre le péri- bole de Y area centrale. On pourrait expliquer ainsi le dédoublement du portique périphérique, qui aurait désormais offert vers l'extérieur une colonnade (C) associée à un temple, ou peut-être même encadrée par deux temples affrontés (cf. le Rapport du secteur ouest). Le mur C aurait eu la double fonction de constituer le stylobate du nouveau portiqueS2, et sur sa face sud, laissée visible, de marquer la limite entre la terrasse supérieure (dont le niveau se situait à 56 m) et la terrasse inférieure, allongée, comprise entre le portique C-D, le mur A et les escaliers des deux temples. On pourra cependant s'étonner de la faible dénivellation (2,30 m maximum) sur laquelle auraient été étagées les deux terrasses. On peut surtout se demander si la terrasse infé-
1 L'importance des entrecolonnements fait supposer une élévation asse/, considérable de ce portique; les proportions seraient du même ordre qu'au forum d'Augst.
;;i La hauteur de ce deuxième portique, à en juger par la largeur de la fondation du stilobate, devait êtie nettement inférieure a celle du premier.
136 BYRSA I
Heure était originelle; dans l'affirmative, sa limite nord aurait reculé du mur D au mur C lors de la deuxième phase d'aménagement. Une autre possibilité est que, lors de ce réaménagement, la terrasse inférieure ait été modelée en retaillant le sommet du remblai augustéen. Ainsi pourrait s'expliquer la différence marquée entre le sol de tuileau retrouvé sur la Butte Lapeyre et le béton supportant le dallage de la terrasse supérieure.
Seule une étude stratigraphique des niveaux 53/56 m, irrémédiablement détruits dans notre secteur par les fouilles Lapeyre, aurait pu nous permettre de préciser cette évolution.
VIII - LE matériel (Clichés 16 à 33)
L'extrême richesse du matériel retrouvé interdit de présenter ici autre chose qu'un aperçu des principales catégories représentées, illustré par quelques individus caractéristiques.
A) Le matériel punique. De nombreuses figurines de terre cuite (sta
tuettes de Bès, de Baal en trône, figurines animalières) ont été retrouvées, ainsi que divers fragments de reliefs céramiques. Fig. 31 - Disque à relief en terre cuite.
Inv. Β 30-1-Couche 27. Torsade entre deux câbles à fils peu serrés. Cf. M. Astruc, Empreintes et reliefs carthaginois de terre cuite, MEFR 1959, pi. I, n°4; cf. également Not. Scav. 1962, p. 405 (Gela) et 1966, p. 156-157 et pi. VI (Métaponte); Cah. Byrsa 9, nos 513 à 516.
La céramique se répartit entre la commune à surface blanche (formes Cintas 98 ter; 111; 114; 127; 145; 149 ter; 359 bis), la céramique à couverte blanche vernie {Cintas 147; 383/384), la céramique à décor peint {Cintas 341; 352; 170/171). Fig. 32 - Cruches puniques du fond de la citerne.
Inv. Β 136-4 et 136-5. Dans la couche cendreuse au fond de la citerne punique A. 17a: haut. 22,6 cm; diam. ext. de l'embouchure : 8,3 cm; diam. max. de la panse : 10,4 cm; diam. du pied : 5,5 cm. 17b : haut, conservée : 20,4 cm; diam. max. de la panse: 11,4cm; diam. du pied: 5,7 cm.
Pâte très légère, rendant un son métallique. Cette forme, qui n'a pas été répertoriée par P. Cintas, se rapproche de la forme AN 37 de G. Vuillemot, Reconnaissances p. 190.
Fig. 33 - Céramique punique à décor incisé. Inv. Β 135-4. Même lieu de découverte. Dim. max.: 15 cm; diam. reconstitué : 11,5 cm. Col d'un vase dérivé de la forme «chardon»? Sur ce type de décor, cf. Cah. Byrsa 9, nos 439-451. On comparera également avec Not. Scav. 1962, p. 186, fig. 167 (Apu- lie).
Fig. 34 - Céramique punique à décor peint. Inv. Β 49-3. Couche 6 de la Coupe 25. Embouchure d'un vase de forme Cintas 170/171.
Fig. 35 - Vase miniature. Inv. Β 34-1. Dans le remblai augustéen. Haut.: 7,2 cm; diam. de l'embouchure : 2,6 cm; diam. du pied : 3,2 cm. Forme Cintas 239/240, Bisi 14 (A.M. Bisi, Africa 1969-1970, p. 19, date cette forme des IVe-IIIe siècles av. n.è.).
Les amphores puniques, dont des fragments ont été retrouvés en abondance, se répartissent entre les types B, C et D d'Ibiza : Fig. 36 - Amphore punique.
Inv. Β 42-1. Couche 26 de la Coupe 7. Diam. max. ext. de la collerette : 40 cm. Type C d'Ibiza; «amphore à pied et à collerette» de F. Benoît, «amphore à pavillon» de M. Ponsich. Datation : IVe-IIe siècles av. n.è., selon P. Cintas, Céramique punique p. 149, et A.M. Bisi, Africa 1969-1970 p. 19.
Fig. 37 - Estampille de la même amphore
Dans ce matériel de fabrication punique, beaucoup d'objets portent la marque de fortes influences stylistiques grecques : c'est le cas, tout particulièrement, pour un brûle-parfums (Inv. Β 9-1; dans la couche 3 de la Coupe 20), composé d'éléments moulés séparément, dont deux fragments avaient été déjà trouvés lors des fouilles de MM. Ferron et Pinard. On trouvera une étude détaillée de cet objet infra, p. 311-331. De même : Fig. 38 - Médaillon d'applique.
Inv. Β 50-5. Couche 6 de la Coupe 25. Hauteur de la tête : 4,5 cm.
Fig. 31 - Disque à relief en terre cuite.
Fig. 32b - Cruche punique du fond de la citerne J.
Fig. 32a - Cruche punique du fond de la citerne J.
Fig. 33 - Céramique punique à décor incisé.
Fig. 34 - Céramique punique à décor peint. Fig. 35 - Vase miniature. (Clichés A. Chéné, IAM)
' * 'Γ^ "VK-fv.î^-'v" "· ^i^j.»
Fig. 36 - Amphore punique.
Fig. 40 - Statuette d'Artémis.
Fig. 37 - Estampille de la même amphore.
Fig. 39 - Guttus.
Fig. 38 - Médaillon d'applique.
\
Fig. 41 - Tête de statuette en terre cuite.
(Clichés A. Chéné, IAM)
LE SECTEUR B (1974-1975) 139
Terre blanche, vernis glacé. De semblables appliques, reproduisant les imitations grecques de vases métalliques, décorent en particulier les départs d'anses des vases de forme Cintas 147. Le visage est proprement hellénique : on le comparera à la tête de Zeus ornant un gut- tus du Musée de Naples, production dite «de Calés» : Corpus Vas. Ant., Italie Fase. 22, Mus. Naz. di Napoli, fase. II, IV, E, tav. 24 η« 15.
Fig. 39 - Guttus. Inv. Β 49-2. Couche 6 de la Coupe 25. Diam. max.: 5,4cm; haut, conservée: 3,7 cm; diam. du pied : 3,8 cm. Exemple d'imitation locale des productions campaniennes.
B) Le matériel d'importation grecque.
Les importations de matériel provenant de la Grèce propre ou de l'Italie hellénisée sont amplement attestées par les trouvailles faites dans le remblai ou dans les ruines des maisons. Fig. 40 - Statuette d'Artémis.
Inv. B 14-1. Dans la couche 6 des Coupes 20 et 21. Haut.: 46 cm; larg. du socle : 15 cm. De marbre blanc, elle portait encore des traces de peinture bleue sur le vêtement. Cette statue est un double absolument exact de celle qui a été trouvée à Erétrie et publiée par K. Kourouniotis dans Γ Αρχαιολογική Εφημερίς, 1900, p. 24-25 et fig. 4. Les deux exemplaires seraient des répliques, provenant sans doute d'un même atelier, d'un original grec du début du IVe siècle. Cependant l'identification de Kourouniotis avec l'Artémis Colonna est inacceptable.
Fig. 41 - Tête de statuette en terre cuite. Inv. B 74-1. Dans le remblai augustéen. Haut, de la tête : 4,5 cm. Tête de femme inclinée vers la droite; cheveux ramenés en chignon derrière la tête.
Fig. 42 - Céramique West Slope. Inv. B 137-1. Couche 2b de la Coupe 9. Haut.: 17,4cm; diam. de la collerette: 13 cm; diam. de l'embouchure : 9,5 cm; diam. du pied : 10,3 cm. Le décor de cette «amphore» : rinceau de lierre polychrome (blanc et rouge), rosaces de points blancs à centre rouge, peint et incisé à la fois, et à un moindre degré sa
forme, se retrouvent dans H. A. Thompson, Hespéria 3, 1934, p. 338 et fig. 18 (B 20 : West Slope krater). Notre exemplaire est intermédiaire entre les formes de kantha- ros (anse, profil de la lèvre, profil de la partie inférieure) et d'amphore (anses se rattachant à la panse, col moins ouvert). On comparera avec une petite amphore à vernis noir de Cozzo Piano Gennaro, conservée au Musée de Palerme : Sic. Archeol. 18- 19-20, 1972, p. 86, fig. 9. La forme ne semble pas avoir été reprise dans la céramique dite «de Gnathia» (cf. L. Forti, La Ceramica di Gnathia, Naples, 1965). Une autre amphore «West Slope», d'un type très différent, avait été trouvée à Byrsa par MM. Ferron et Pinard : Cah. Byrsa 9, n° 395.
Fig. 43 - Poignée de couvercle de lékané. Inv. B 53-1. Couche 27 de la Coupe 25. Cf. P. Orlandini dans Archeologia Classica 9, 1957, p. 60 et pi. XXII, 2; Idem dans Not. Scav. 1962, p. 366 et fig. 326; Mozia V, pi. XXXIV, 1 b.
Fig. 44 - Lampes grecques. 44a - Inv. B 49-1. Couche 6 de la Coupe 25. Diam. : 5,6 cm; haut. : 3,5 cm; long. : 8,2 cm. Type Deneauve grecque X (IIe siècle av. n.è.). 44 b - Inv. B 31-4. Couche 7 de la Coupe 25. Long. : 10,5 cm; haut. : 3,9 cm; diam. max. : 7,8 cm; diam. du médaillon : 4 cm; diam. du pied : 4,1 cm. Type Deneauve grecque XI, à corne latérale percée (IIIe-IIc siècles av. n.è.). 44 c - Inv. B 52-1. Couche 22bis de la Coupe 25. Type Deneauve grecque XII (IIIe-IIe siècles av. n.è.).
Fig. 45 - Amphore gréco-italique. Inv. B 41-1. Couche 26 de la Coupe 7. Haut, du col : 30 cm; diam. ext. de la lèvre : 18,2cm; diam. int. de l'embouchure: 13 cm. Cf. N. Lamboglia, RSL 3-4, 1955 (p. 241- 270), fig. 19, et M. Beltran Lloris, Las An foras romanas en Espana, p. 358-362.
Fig. 46 - Timbres d'amphores. 46a: Inv. B 6-1. Dans la couche 3 de la Coupe 20. Timbre rhodien rectangulaire : ΕΠΙ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΝΑΜΟΥ. Nom restitué par J. Ferron, cah. Byrsa 5, n" 118.
r
Fig. 42 - Céramique West Slope.
Fig. 43 - Poignée de comercle de lékané.
Fig. 44a - Lampe grecque.
Fig. 44b - Lampe grecque
Fig. 45 - Amphore gréco-italique.
ÄÄEÄ
Fig. 44c - Lampe grecque. (Clichés A. Chéné, IAM, à l'exception de la Fig. 44c, cliché J. Deneauve)
Fig. 46a - Timbre d'amphore.
Fig. 46c - Timbre d'amphore
Fig. 46b - Timbre d'amphore.
Fig. 47 - Fragment de baignoire.
Fig. 46d - Timbre d'amphore.
Fig. 48a - Réchaud en
Fig. 46e - Timbre d'amphore. Fig. 48b - Réchaud en pierre.
(Clichés A. Chéné, ΙΑΜ)
142 BYRSA I
46 b : Inv. Β 38-8. Couche 4 de la Coupe 25. Timbre rhodien rectangulaire : APIITARXOY; étoiles aux angles. Cf. Cali. Byrsa 5, n° 116. Déjà 12 attestations à Carthage. 46 c : Inv. Β 59-1. Couche 7 de la Coupe 25. Timbre rhodien circulaire : ΕΠΙ ΔΑΜΟΘΕΜΙΟΣ. Eponyme déjà attesté quatre fois à Carthage : Cah. Byrsa 5, n° 108. Daté soit entre 280 et 220, soit entre 220 et 180. 46 d : Inv. Β 80-2. Hors stratigraphie. Timbre rhodien circulaire : [ΕΠ]Ι Α[Ν]ΔΡ[Ο]ΜΑΧΟΥ [ΑΓ]ΡΙΑΝΙΟΥ 46 e : Inv. Β 125-1. Couche 22 de la Coupe 7. Timbre ovale : ΟΔΜ.
C) Le matériel domestique et artisanal.
111. 47 - Fragment de baignoire. Inv. Β 41-1. Couche 26 de la Coupe 7. Dim. max.: 45 cm; larg. int. du fond : 31 cm; épaisseur moy. du fond : 1 cm; des bords : 2 cm. Terre verdàtre. Cf. Cah. Byrsa 5, n° 145 et pi. LXXVI.
111. 48 a et b - Réchaud en pierre. Inv. Β 42-2. Couche 26 de la Coupe 7. Haut.: 17 cm; diam. moyen à l'embouchure : 28,5 cm; diam. du fond : 13 cm. Pierre volcanique poreuse. Le fond est percé de quatre trous d'évent, le sommet des parois porte trois supports. L'ensemble, calciné par l'usage, évoque une activité d'artisanat métallurgique, à laquelle se rapportent également de petites enclumes cubiques, en pierre dure creusée d'une cupule, trouvées dans le même contexte.
IX - Conclusion
Ces deux premières campagnes de fouilles dans le « secteur Β » permettent d'ores et déjà de préciser l'évolution historique du flanc sud de la colline de Byrsa, depuis la période punique
dive jusqu'aux derniers siècles de l'Empire romain.
Le quartier de maisons puniques précédemment dégagé plus à l'est se poursuit dans notre secteur, en s'étageant sur la pente, selon un alignement différent de celui qui ordonnait les insulae reconnues auparavant. La poursuite de la fouille permettra, espérons-le, d'établir la chronologie relative de ces diverses orientations, et de situer le moment où ce flanc de la colline, abandonnant son antique fonction de nécropole, a fait place aux habitations des vivants, pour se couvrir de demeures profondément hellénisées dans leur architecture, leur décor et leur mobilier. D'autre part, l'étude stra- tigraphique du secteur nous permet de nous représenter le processus de destruction du quartier punique : incendie des maisons en 146, première action de l'érosion climatique; puis démantèlement systématique des murs encore debout, sur l'essentiel de leur élévation. Ces ruines furent ensuite recouvertes pendant presque un siècle et demi par un épais dépôt de terres mêlées de briques crues, de rognons de grès, de divers matériaux de destruction, qui ont coulé des parties les plus hautes de la colline.
Sur ce comblement naturel (correspondant pour l'essentiel aux couches 27-28), systématiquement régularisé et tassé, ont été déposées par apports successifs les terres du remblai augustéen, lorsque les flancs de la colline ont été aménagés en terrasses étagées. La colline seule n'a pas suffi à fournir pour ces remblaiements toutes les terres nécessaires, dont une partie dut être importée d'autres zones par charrois multiples. Cette restructuration du site a laissé de puissants vestiges architecturaux : nous avons pu préciser la chronologie de certains d'entre eux (en particulier le mur D). Cependant, la nouvelle vocation de Byrsa comme centre monumental de la Carthage romaine, confère à ces structures une dimension grandiose qui ne peut plus être saisie à l'échelle d'un secteur limité de fouille, mais demande une prospection de plus grande envergure.
LE CARDO MAXIMUS ET LES ÉDIFICES SITUÉS À L'EST DE LA VOIE (Fouille de 1974, 1975 et 1976)
par JEAN DENEAUVE ET FRANÇOISE VILLEDIEU
Les travaux dont nous avons à rendre compte concernent une zone délimitée, à l'ouest, par le tracé du cardo maximus, au sud, par celui du decumamis I, à l'est, par les structures de fondation en opus caementicium du «quadrilatère Delattre», au nord, par la route moderne. Les recherches ont porté sur les secteurs suivants:
- le cardo maximus, - l'édifice situé à l'angle du cardo maximus
et du decumamis I, - le soutènement ouest de la plate-forme
supérieure, - le temple implanté sur ce soutènement,
(plan, fig. 1).
Situation de cette zone par rapport aux fouilles antérieures.
Fouilles Delattre. D'après le plan publié en 18921 (fig. 2), les dégagements se sont arrêtés à l'extrados des absides. Le prolongement du mur nord du quadrilatère a été suivi en tranchée sur quelques mètres. Le massif de construction situé à l'intersection du cardo maximus et du decumamis I a été contourné et les fouilles ont été poursuivies jusqu'à l'égout du cardo maximus. Le dégagement de cet égout a été poursuivi vers le nord à une époque ultérieure, probablement avant les travaux de Ch. Saumagne2.
Fouilles Lapeyre. A la suite des fouilles qu'il effectua dans les environs immédiats de cette
zone entre 1930 et 1933, Lapeyre y fit poursuivre des recherches en 1934. Il en précise la situation à partir des structures qu'il considérait comme une enceinte punique et du prolongement vers l'ouest qu'il lui attribuait3. L'extension donnée à ces recherches n'a pu être précisée qu'au cours des travaux, lorsque les éléments signalés par Lapeyre (citernes, silos) et des témoins modernes on été retrouvés. Ces excavations avaient probablement pour but la découverte de tombes puniques, les recherches menées au cours des années précédentes et celles de Delattre ayant livré une nécropole particulièrement dense aux abords immédiats de cette zone. Le très bref compte-rendu des fouilles de 1934 mentionne la découverte de quelques tombes4.
Ces fouilles semblent avoir été partiellement remblayées lors de l'avancement des travaux5. Elles ont donc provoqué un bouleversement de toute cette zone sans donner lieu à un relevé.
J. D.
1 BCTH, 1893, pi. XI. 2 Ch. Saumagne, Colonia lidia Karthago, dans BCTH, 1924.
1 G. G. Lapeyre, L'enceinte punique de Byrsa, dans Revue Africaine, n° 360, 3e trimestre 1935.
4 G. G. Lapeyre, op. cit., p. 15 (de l'extrait) «à trois mètres cinquante environ de profondeur (mais nous ignorons le niveau exact du remblai à l'époque), à une dizaine de mètres du rempart punique, ils (les fouilleurs) ont découvert des sépultures carthaginoises qui paraissent postérieures aux grands tombeaux. Chose nouvelle probablement . . . ils ont mis à jour, placés côte à côte, une dizaine de sépultures d'enfants, très simples, constituées par de petites dalles ou même seulement par des pierres».
** Ainsi que semble l'attester l'abondance de fragments de céramique retrouvés dans un remblai bouleversé au cours des fouilles de 1974-1975.
144 BYRSA I
Le Cardo maximiis.
Ainsi que nous l'avons déjà signalé (cf p. 49), l'égout du cardo maximiis a été perçu en 1890 par Delattre à un emplacement que le plan des fouilles permet de situer à proximité du decuma- nus I. L'identification de la voie en tant que cardo maximiis est due à Ch. Saumagne.
Le tracé du cardo s'est maintenu, jusqu'à une époque relativement récente, en un chemin de terre reliant la plateau supérieur de Byrsa au village de Douar Chott situé dans la plaine, au pied du versant sud de la colline.
Les travaux d'extraction de terre effectués vers 1950 ont gravement affecté, en même temps que la zone environnante, le tracé de ce chemin en rabaissant son niveau.
Lors du début des travaux, en 1974, plus rien n'apparaissait des structures dégagées par Delattre. Des sondages (correspondant aux carrés Β V 4, 12 et C V 6, 9, 10 - cf plan, fig. 1) ont été entrepris afin de vérifier l'emplacement de la voie et d'en reconnaître les vestiges. Leur implantation correspond à la zone située immédiatement au nord de celle signalée comme explorée par le plan de 1892 (fig. 2).
La chaussée centrale de la voie son égout, le trottoir est et la bordure de celui de l'ouest ont été reconnus sur une longueur d'environ 16 m à l'est, plus réduite à l'ouest du fait de l'implantation des sondages dans les divisions du car- royage N-S6. Un habitat tardif a utilisé le trottoir et une partie de la chaussée, ainsi qu'en témoignent des vestiges de murettes. Une canalisation bordant la façade d'un édifice7 a été ménagée sous les dalles du trottoir est. Elle est détruite au bas de sa pente, au sud, et sa jonction avec l'égout n'a pas été retrouvée. Deux canalisations secondaires venaient l'une de l'est, l'autre de l'ouest, et se déversaient dans l'égout. Celle de l'est appartenait probablement à l'habitat aménagé sur la voie; elle en longe le mur implanté sur la chaussée sans s'engager dans le trottoir. Elle aboutit à l'égout par une sorte de puisard vertical dans lequel ont été retrouvées deux lampes « paléochrétiennes ».
La céramique découverte au cours des fouilles de 1974 appartient, pour la majeure partie, à la production africaine à engobe rouge (sigillée claire) des Ve, VIe et VIIe siècles. Elle était mêlée à de nombreux fragments de lampes africaines «paléochrétiennes». '
Les vestiges de la voie n'étaient protégés que par un très faible remblai qui avait subi un bouleversement. D'autre part, des rejets modernes retrouvés dans l'égout témoignent que des fouilles ont été poursuivies au delà de la limite précisée par le plan de 1892.
J. D.
LE CARDO MAXIMUS
I - Les fouilles de 1975
Si la poursuite des fouilles en 1975 ne nous a pas permis de résoudre tous les problèmes, nous croyons cependant avoir déterminé plusieurs phases d'aménagement et d'utilisation de la voie. La chaussée serait la première; le portique qui la bordait, la seconde. L'escalier qui réalisait la transition avec un palier supérieur a dû favoriser le développement des habitations tardives qui correspondent à la dernière période d'utilisation du cardo.
I. A - La voie.
A.L. Delattre évaluait la largeur de la voie à 6 m 50 8. La réalité est tout autre puisque nous arrivons en moyenne à 11,40 m. Ce résultat diffère également des chiffres proposés par P. Davin9 et Ch. Saumagne10 qui, ayant attribué au pied employé à Carthage la valeur de 0 m 294, obtenaient pour un cardo maximus de 40 pieds la largeur de 11,76 m. L'écart paraît négligeable, mais nous avons noté aussi que la largeur du
6 Carrés de 20 m subdivisés en sondages de 5 m. 7 La description des vestiges découverts en 1974 est don»
née plus loin, avec le résultat des fouilles de 1975.
8 A. L. Delattre, Fouilles archéologiques dans le flanc sud- ouest de la colline de Saint-Louis en 1892, dans BCTH, 1893, p. 101.
9 P. Davin, Etude sur la cadastration de la Colonia Julia Carthago, dans Revue Tunisienne, 1930, 2, p. 79.
10 Ch. Saumagne, Les recherches récentes sur la topographie de Carthage, dans 75, 1931, 4, p. 152.
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 145
III Citernes Romaines
Vili Parties non fouillées
Ν Mur reticule
Ο Egout
d Tombeaux d'enfant à Amphore
LIMITE N-O DES FOUILLES EN ,1892 (d'après le B.C.T.H. 1893, pi. XI)
1935
mur Punique
I "Pilli I mur Romain
2 d'après le plan de 1892
LIMITE O.DES FOUILLES EN 1933
(d'après la Revue africaine, 1935, pi. 2)
Fig. 2 - Limite des fouilles antérieures d'après le relevé Bonnet-Labranehe (Delattre) et Thouverey (Lapeyre).
trottoir oriental est inférieure d'une trentaine de centimètres à celle de son vis à vis. Cela ne peut 'être attribué au hasard car l'égout est désaxé d'autant par rapport à l'ensemble de la voie,
dis qu'il occupe exactement le milieu de la chaussée centrale. D'autre part, des vestiges en grand appareil appartenant à la façade ouest d'un édifice établi à l'angle du cardo et du decu-
146 BYRSA I
mamis I sont alignés sur la limite théorique du cardo". Il semblerait donc que l'on ait légèrement empiété sur le trottoir lors de la construction du temple prostyle.
Un sondage, que nous avons pratiqué au-dessous du dallage (cf. p. 160), a permis de constater l'absence de la tripartition traditionnelle dans la construction de la chaussée12. L'assise de
"jr-',r
-— -
h -·- -? .~-™ì™*;
*.*ίϊ
Fig. 3 - Le trottoir est, les dalles E et la canalisation du temple. (Photo F.V.).
base manque et la noyau est constitué par un remblai identique à celui utilisé pour l'aménagement de toute la colline (voir les rapports des secteurs A et B).
Le revêtement, en calcaire du Djebel Djelloud, repose sur une couche plus compacte à laquelle se superpose une pellicule de mortier gris foncé, assez grossier. Les quelques dalles conservées sur la chaussée sont de forme rectangulaire et s'ordonnent en bandes parallèles. Le revêtement du trottoir s'en distingue, tant par l'irrégularité de la forme des dalles que par celle de leur disposition (fig. 3). On y note l'arrachement de la couverture de la canalisation qui longeait le temple, qui a sans doute été emportée lorsque le mur de façade de cet édifice fut démantelé.
11 Voir plus loin la description de ces \ estiges. 12 Nous a\ons adopté la terminologie proposée par
R. Che\ allier, Les voies loniaines, Paris, 1972, p. 94-95.
Le matériel trouvé dans ce sondage permet de rattacher la mise en place de la chaussée aux premiers travaux d'aménagement de la Colonia Julia. La forme de l'égout correspondrait selon Ch. Saumagne à une période haute11. Nous voyons (fig. 22) qu'il se compose de deux dalles horizontales accolées pour former le radier, et de deux autres verticales sur lesquelles reposent les dalles de la chaussée14. La section interne mesure, en moyenne, 0 m 35 de largeur pour 0 m 30 de hauteur; elle se réduit à l'approche des escaliers dont l'égout suivait la pente (fig. 23).
Ι. Β - Les canalisations secondaires (fig. 4).
Deux d'entre elles ont été dégagées en 1975 et une troisième cette année. Leur construction est médiocre; elles ont été réalisées dans des tranchées creusées dans les fondations du cardo, dont le fond et les parois ont été garnis de moellons et de dalles de remploi. Un enduit de mortier gris foncé recouvre le radier et parfois les côtés; il a été appliqué sur les dalles du collecteur principal à l'endroit où la canalisation nord y pénètre, découpant son passage dans un pied- droit (fig. 5). En plan, on observe qu'elles contournent les fondations des colonnes; elles sont donc postérieures à l'érection du portique
" Ch. Saumagne, op. cit. (1931), p. 153 «il sera aisé de restituer l'âge relatif de la rue et de l'égout dans la forme où on les retrouve. Il est, par exemple, permis d'avancer que le système des égouts, dont le développement total devait être de près de 60 km, est relativement récent et qu'il date du début du VIe siècle». Pour le type le plus ancien: L. Drap- pier, La nécropole punique d'Arci el Kheraib à Cartilage, dans Revue Tunisienne, 1911, p. 146; Ch. Saumagne, La maison du paon à Carthage, dans BCTH, 1934-1935, p. 55, note 1; du même, Sondage dans le flanc sud-ouest de Byrsa, dans BCTH, 1932-1933, p. 72. - Pour les égouts du IVe siècle : P. Gauckler, BCTH, 1902, p. CXLIX; Ch Saumagne, Notes de topographie carthaginoise, dans BCTH, 1930-1931, p. 643; du même, art. cité, BCTH, 1934-1935, p. 55. Un égout de ce type est visible actuellement dans les fouilles des \illas de l'Odèon et les fouilles italiennes en ont dégagé un autre sur le deciunanus V nord. Au IVe siècle auraient été construits des égouts hauts et larges réalisés en petits mœllons et couverts par une voûte sur laquelle prenait appui le revêtement de la voie. Ch. Saumagne est beaucoup moins précis au sujet des précédents et nous laisse hésiter entre deux grandes périodes de construction : l'époque d'Auguste et le IIe siècle. Les résultats du sondage permettent, dans notre cas de choisir la première.
14 Les dalles qui forment la canalisation sont en grès d'el Haouaria.
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 147
Fig. 4 - La canalisation secondaire ouest. (Photo J. D.).
(fig. 6 et 4). Deux de ces canalisations proviennent de l'extérieur du cardo mais nous n'avons pu établir de rapport avec aucun des édifices voisins.
I. C - Le portique.
Deux bases retrouvées en place, à la limite du trottoir oriental, nous révèlent la présence d'un portique ts. Les fondations de trois autres ont été reconnues dans la zone explorée en 1974, de part et d'autre de la voie. Ces fondations se composent de gros blocs juxtaposés alignés sur la limite du trottoir (fig. 8).
Les proportions des bases sont assez éloignées des règles que nous a transmis Vitruve16. Ainsi, à un diamètre au lit d'attente du fût de 0 m 47 correspond une hauteur de 0 m 26. L'aspect écrasé du tore résulte d'une même indifférence à l'égard de la modénature «canonique» (fig. 7). Le lit d'attente ne porte pas de mortaise; ce fait, joint à l'importance d'un entrecolonnement moyen de 3 m 66, conduit à imaginer un entablement réduit. Il est peu probable, tant d'un point de vue structural qu'esthétique, que l'on ait ici
15 Un auteur anonyme du IVe siècle (cf. C. Mueller, Geogra- phi gram tuiiioies, II, p. 526) décrit certaines rues de Carthage bordées d'arbres. Selon G. Ch. Picard, Civilisation de l'Ajiiqiie romaine, Paris, 1959, p. 198, cela n'aurait pu intéresser que le decumanus maximus et le cardo maximiis. Ce dernier, pour une partie au moins de son parcours, est donc à exclure.
16 Vitruve (111,5, 1-10).
un fût représentant 8,5 fois le module17, car on obtiendrait une colonne trop gracile pour une ordonnance aréostyle.
En ce qui concerne l'ordre adopté, on peut aisément proposer le corinthien auquel doivent être rattachés tous les fragments de décor d'architecture trouvés dans le secteur. Certains d'entre eux présentent des dimensions qui correspondent à celles des bases. Ainsi les fragments de chapiteaux inv. 75.36 et 75.57 pour lesquels il est possible de restituer une hauteur
t ->:^ few—
!Çr. Ä'·:'
^tt-r^ i-r^" Λ**.^ ' -'\"^r^- ^Àï-ÎJË
6- - ι- . -V
Fig. 5 - La canalisation nord à son arrivée dans l'égout. (Photo F.V.).
d'environ 0 m 45 pour le premier et 0 m 47 pour le second, à partir de l'épaisseur de l'abaque18. Il est difficile de proposer d'autres éléments car la plupart de ceux que nous avons retrouvés pro-
17 Vitruve (V, 9, 17 et 19) recommande que le fût des colonnes ioniques et corinthiennes employées dans l'architecture civile représente 8,5 fois le module.
18 Nos 3 et 6 de l'étude des éléments d'architecture (en annexe).
4λ
TROTTOIR OUEST C_\
'·<[""") IjE
CANALISATION1DU
TEMPLE
Fig. 6 - Le cardo maximus, relevé des vestiges découverts en 1974 et 1975. (J. M. Gassend et M. Borely, C.N.R.S., I.A.M.).
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 149
1
10 20 30 40 50 cm.
Fig. 7 - Profil d'une base du portique. (F.V.).
viennent d'entablements, et nous devons admettre avec. A. Choisy que celui d'un portique devait se réduire à l'architrave sur laquelle reposait directement la charpente19. Cette architrave elle- même ne pouvait être que de bois dans une ordonnance exagérément aréostyle20. Aucun des éléments de décor susceptibles de provenir du portique n'est antérieur au IIe siècle de notre ère. Ce fait, s'il ne constitue pas une raison suffisante pour lier la construction du portique aux grands travaux dont Carthage a été l'objet durant cette période, rejoint pourtant d'autres indices de remaniements que nous avons notés au niveau du trottoir. Ainsi, la dalle sur laquelle repose la base nord est de toute évidence un
19 A. Choisy, Vitruve, I, Analyse, Paris, 1949, p. 84 (d'après Vitruve IV, 4, 8).
20 Vitruve, 111,3,20-21.
remploi, car un de ses côtés est mouluré (fig. 8 et 23). Le revêtement du trottoir diffère de celui de la chaussée, et correspond probablement à un remaniement postérieur de la voie (cf. p. 146 et fig. 3). Par ailleurs, d'après les traces d'arrachement de la couverture de la canalisation longeant le temple, on peut avancer que celle-ci a été réalisée lors de la mise en place du trottoir; or cette canalisation semble directement liée au temple puisqu'elle s'achève avec sa façade (fig. 9). Tout ceci permet de penser que le trottoir, le temple et sa canalisation ont été construits contemporainement.
Un autre élément en faveur de la datation que nous proposons est fourni par l'histoire de ce type de portique21. C'est en effet au IIe siècle qu'appartiennent la plupart des exemples connus à Rome22, en Orient23 et en Afrique. Dans cette dernière, à l'exception des grandes colonnades monumentales de Leptis Magna et d'Utiques24, tous les portiques connus, à Tipasa, Djemila, Hippo Regius, Volubilis, se rattachent exactement au même type que le nôtre. Il s'agit, non plus de lieux de rencontre comme l'étaient les édifices orientaux, mais de simples abris couverts qui agrémentaient les rues les plus importantes. Ils sont directement liés aux insulae25, et l'on voit parfois, comme à Timgad26, leur style
21 R. Martin (J. Charbonneaux, R.. Martin, F. Villard), Grèce hellénistique, Paris, 1971, p. 92. R. Martin a identifié à Cos, dès le IIe siècle av. J.-C, les premiers indices d'une semblable organisation; selon lui ces portiques «résultent de l'association des agoras ou des gymnases aux rues avoisi- nantes, qui s'approprient le décor des édifices qui les bordent ». Toutefois, en Orient même, les rues bordées de portiques ne se multiplient qu'à partir du début de notre ère. Néron les introduit à Rome lors des reconstructions imposées par l'incendie de 64. Cf. A. Balland, Nova Urbs et «Nea- polis». Remarques sur les projets urbanistiques de Néron, dans MEFR, 1965, 2, p. 349-393.
22 G. Lugli, La tecnica edilizia romana, vol. I, p. 735. Plus spécialement G. Gatti, Caratteristiche edilizie di un quartiere di Roma nel II sec. D.C., dans Quaderni dell'Ist. di Storia dell'Archit, VI, VII, Vili, 1961, p. 49-66.
23 A Antioche, Apamée, Palmyre, Gerasa, Parge, Side, Ephèse, Alexandrie, etc . . . , cf. J. Charbonneaux, R. Martin, F. Villard, op. cit., p. 91-92.
24 A. Lézine, Carthage-U tique, Paris, 1968, p. 83-86; du même, U tique, notes de topographie, dans Mélanges Piganiol, Paris, 1966, p. 241.
25 Tacite, Ann., XV, XLIII, 1 : additisque porticibus quae frontem insularum protégèrent.
26 Ch. Courtois, Timgad, antique Thamugadi, Alger, 1951.
BYRSA I
-v -r *
r^^ ·. '... · \ - vît— „*^-^ ̂ ι^Α^
rii SH"
:λ
?}f:?^>:
Fig. 8 - Fondation d'une base du portique et degrés de l'escalier (F.V.).
changer avec chacune d'elles. A Carthage, le portique semble lié aux grands travaux dont la colline a été l'objet au IIe siècle. Nous espérons qu'un sondage sous le dallage du trottoir nous permettra de dépasser le stade des hypothèses.
I. D - Les escaliers. Nous avons retrouvé des fragments de trois
marches (fig. IO) pris dans le mur tardif, et les fondations des deux plus basses au niveau de la chaussée. Les blocs conservés sont en calcaire (Djebel Djelloud?), et présentent successivement une hauteur de 0 m 155, 0 m 18 et 0 m 20 pour une profondeur plus régulière d'environ 0 m 29 (soit un pied). Ils prennent appui sur une couche très compacte formée de terre mêlée d'éclats de pierre et de marbre, et de quelques tessons, qui repose elle-même sur une couche comportant moins de terre mais une plus grande quantité d'éclats de pierre et de marbre avec quelques
tessons (= couche 2 de l'aire B, cf. p. 156) (fig. 23). Dans le prolongement de la chaussée, la couche sur laquelle les marches prenaient appui s'apparente plutôt à la couche 1 du sondage dans la voie (cf. p. 161, fig. 23).
Les dalles «E» (cf. p. 161 et fig. 1 1 et 23) sur le trottoir, correspondent par leurs dimensions, à celles de l'escalier; elles reposent sur la même couche 2 et sont exactement au même niveau que la première marche (fig. 23 et 25), toutefois elles diffèrent de cette dernière par leur position plus méridionale. Nous pensons qu'il peut y avoir là l'indice d'une organisation particulière de l'escalier à hauteur du trottoir, en correspondance d'un espace situé au nord du temple, dont le niveau était plus élevé que celui de la voie. Si l'on suppose que cet espace débouchait sur le cardo, il faut donc imaginer un système destiné à rattraper la dénivellation, ce qui pourrait expliquer l'anomalie que nous avons notée.
LE CARDO MAXIML'S (1974-1976) 151
Fig. 9 - Extrémité nord de la canalisation du temple. (Photo F.V.).
Les vestiges du cardo découverts par A. L. Delattre semblent avoir complètement disparu27. Leur situation correspond à la zone comprise entre le decumamis I et la partie du cardo fouillée en 1974 et 1975. La différence de niveau existant entre le decumamis I et la première dalle de couverture de l'égout, au sud, permet de penser que la dénivellation était, là aussi, compensée par des degrés.
La découverte d'escaliers assurant la transition entre les paliers constitue un des éléments les plus intéressant apporté par cette campagne. Plusieurs découvertes similaires ont déjà été faites à Carthage28. Elles témoignent d'un programme d'une envergure exceptionnelle puisqu'il a touché toutes les hauteurs qu'englobait la ville29.
I. E - Les habitations tardives.
La prolifération des constructions privées sur le sol public à basse époque est un fait commun à tout l'empire romain M); il nous semble avoir été particulièrement favorisé ici par la présence des escaliers et du portique.
On peut distinguer deux temps dans cette occupation. On a d'abord fermé le portique au moyen d'un mur de moellons de grès; il semblerait que les colonnes aient été enlevées à cette occasion car on retrouve des traces de ce mur sur le lit d'attente des bases. Les seuls éléments nous permettant d'avancer une hypothèse concernant la datation de cette construction sont constitués par l'aspect du mortier, qui est gris et abondant, et un fragment de sigillée claire D d'assez belle facture qui y était incorporé. Aussi est-ce en nous fondant tout autant sur ce que nous savons de l'histoire de Carthage et de cette zone, que nous proposerons le IVe ou le Ve siècle. Par la suite, probablement dans le courant du VIe siècle, la chaussée est envahie, les dalles partiellement arrachées, et de nouveaux murs s'élèvent, perpendiculaires aux précédents. Un vestige de ces murs, dégagé en 1974 (fig. 12), relève d'une technique beaucoup plus négligée : des moellons informes et des blocs de remploi y sont unis par un mortier friable, marron. Cette dernière phase d'occupation peut être mise en rapport avec l'appauvrissement et le dépeuplement observés dans les quartiers situés entre la colline de Junon et la mer31.
27 A. L. Delattre, art. cité, dans BCTH, 1893, p. 100 et pi. XI. 28 En particulier sur la colline de Junon : J. Vernaz, Note
sur des fouilles à Carthage en 1884-1885, R.A., X, 1887, p. 19; Ch. Saumagne, art. cité, dans BCTH, 1930-1931, p. 643.
24 Nous avons relevé des allusions plus ou moins directes à des aménagements en terrasses, pour Byrsa : Ch. Sauma-
gne, dans BCTH, 1924, p. 177-193, du même, art. cité, dans BCTH, 1932-1933, p. 67-73; A. Lézine, op. cit., p. 41; pour la colline de Junon, Ch. Saumagne, art. cité, dans BCTH, 1930- 1931, p. 644; pour Bordj Djedid, A. Audollent, Carthage romaine, Paris, 1901, p. 246-249 (avec bibliographie antérieure); pour Dermèche, P. Gauckler, BCTH, 1927, p. XXVII, L. Poinssot et R. Lantier, Fouilles à Carthage, dans BCTH, 1927, p. 437 et suiv., pi. XVIII.
10 Code Théodosien, XV, 1, 39 et Code Justinien, VIII, 2, 20. " R. Lantier, Notes de topographie carthaginoise, dans
CRAI, 1922, p. 22; N. Duval et A. Lézine, Nécropole Chrétienne et baptistère souterrain à Carthage, dans Cahiers archéologiques, X, 1959, p. 147; Ch. Saumagne, art. cité, dans BCTH, 1934-1935, p. 57.
BYRSA I
Fig. 10 - Les degrés de l'escalier, une base du portique et le mur tardif. (Photo F.V.).
II - DÉROULEMENT DE LA FOUILLE
Après l'enlèvement d'une couche d'humus de faible épaisseur, diverses aires ont été définies (fig. 11) d'après leur aspect en surface et leur rapport avec la situation visible sur le parois dégagées antérieurement; sur celles-ci ont été établies les coupes stratigraphiques a-b et c-d (fig. 14 et 15).
L'aire A correspond au trottoir oriental sur lequel ne restait en place qu'un lambeau de terre de forme irrégulière et d'épaisseur limitée (en moyenne 0 m 40), qui a fait l'objet de la coupe a-b (fig. 13).
L'aire Β intéresse également le trottoir, mais dans un secteur dont l'aspect laissait suspecter des remaniements.
L'aire C, située sur la chaussée, se distinguait en surface par la présence de dalles et d'éléments d'architecture remployés comme revêtement du chemin de Douar Chott; lui succédait,
vers l'ouest, une zone de terre battue dont l'origine peut être attribuée aux travaux exécutés vers 1950. Il n'a pas été possible dans le cadre de la campagne 1975, de fouiller l'ensemble de cette aire dont l'extension correspond à la largeur de la chaussée.
Par ailleurs, certaines structures apparaissaient, un mur (D), longeant le trottoir, dont certains témoins subsistent en aval, et une série de trois dalles (E), alignées en travers du trottoir entre les aires A et B.
II. A - L'aire A (fig. 11 et 14).
La coupe a-b présente dans la partie sud, une succession de couches fines et compactes; lorsque nous les avons enlevées, leur extension s'est révélée parfois très limitée, tandis que d'autres apparaissaient, créant une situation assez complexe sur une espace pourtant réduit. Ces strates sont ensuite interrompues par une fosse résultant de l'exploitation des matériaux antiques.
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 153
3m
Fig. 1 1 - Emplacement des sondages.
1 - Description de la coupe :
1 - Blocs utilisés comme revêtement du chemin de Douar Chott;
2 - Mortier, chaux, pierres, peu de matériel; 3 - Terre grise mêlée de fragments de mort
ier, céramique;
3a - Poche de terre marron accolée au mur D;
4 - terre grise très compacte; 5 - Terre argileuse rouge, fragments de mort
ier; 6 - Terre marron, quelques débris de char
bons de bois;
154 BYRSAI
wpm^ "' V.MHMMHHMS. Ι Τ1* *
Fig. 12 - Mur tardif (G). (Photo F.V.).
9 - Poche d'argile de couleur claire; 10 - Terre jaune, fragments de mortier; 11 - Terre argileuse marron foncé; 12 - Poche de terre argileuse rouge-orangée;
charbons de bois, céramique; 12a - Poche de terre argileuse riche en céra
mique, sous la dalle déplacée; 13 - Fosse; tegulae, imbrices, mortier, pas de
terre.
2 - Le matériel :
Le matériel est abondant dans la zone stratifiée, mais il est constitué essentiellement de fragments de dimensions réduites.
La fosse 13 est plus riche, particulièrement dans le fond où la céramique tardive est mêlée au matériel des fondations.
Céramique provenant des fondations : campa- nienne et imitations locales, attique (1 fr.),
tine (4 fr.), lampes (1 fr. : fin Ier s., - 1 fr. : fin IIe s.)? Dans les couches tardives: lampes «paléochrétiennes» africaines (quelques fragments), sigillée claire (surtout la forme 99 de Hayes", commune, amphores byzantines (Forme M. 330 de Robinson", 186, 164, 181 de EglofP4 amphores africaines (formes non identifiées); divers: fragments de marbre, mosaïque, verre, nacre.
32 J. W. Hayes, Late Roman Pottery, London, 1972, p. 152- 155.
" H. S. Robinson, The Athenian Agora, vol. V, Pottery of the roman period, 1959, p. 115 et pi. 32.
14 M. Egloff, La poterie copte des Kellia, c/itatie siècles d'artisanat et d'échanges en Basse Egypte (Doctorat d'Etat, Université de Paris, I, 1975). Nous remercions vhement l'auteur qui a bien voulu nous communiquer la partie de sa thèse nous intéressant avant la parution de l'ouvrage.
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 155
|pr .''"^-^ü^ÄKJ. ...Y' - ".-a VIT-,
Fig. 13 - Base du portique et mur tardif. (Photo F.V.).
3 - Interprétation :
Les couches 2 à 1 1 représentent des moments successifs de l'occupation du trottoir. A son stade actuel, l'étude du matériel permet de les dater du VI-VIIe siècle de notre ère. Dans les couches 12 et 12a, le même matériel tardif était mêlé à de la céramique attique et à vernis noir; elles se sont en effet constituées à la suite de la tentative avortée d'arracher une dalle du revête-
La fosse 13 s'est constituée après récupération de la bordure du trottoir, car elle s'enfonce jusqu'au niveau de fondation et son remplissage est homogène. Le matériel qui en provient se compose presque exclusivement d'éléments de toiture (celle du portique?).
Π. Β - L'aire Β (fig. 11 et 23).
Nos craintes de trouver là une zone remaniée, suscitées par le niveau relativement bas de la surface, ont été justifiées par la couche 1 (fig. 23) dans laquelle des fragments modernes et musulmans côtoyaient de la céramique des VIe et VIIe siècles de notre ère. La couche 2, par contre, riche en éclats de pierres et de marbre, nous reporte à l'époque de la mise en place des structures de la voie. Le sol naturel lui succédait, aplani sur une certaine distance, puis laissé à l'état brut dans la partie nord où il indique un changement de niveau (fig. 8).
Le mur d'opus caementiciiim qui limite le trottoir à cet endroit, est bordé par une fosse alignée sur la canalisation du temple mais qui doit probablement être mise en rapport avec la construction de ce mur. Son remplissage faisant corps avec la couche 2, il semble que le mur ait été élevé à l'époque où l'on établissait, ou transformait, cette partie du trottoir (fig. 23).
chemin de Douar Chott mur tardif
0 5m
coupe a_b Fig. 14 - Aire A, coupe a-b. (Relevé F.V.).
ment, à une époque postérieure à la destruction du mur D, qui la recouvrait en partie à l'origine. En soulevant cette dalle, on a légèrement déplacé la terre qui s'y superposait, et le remblai sur lequel est établi le trottoir s'est mélangé à la strate inférieure.
- Matériel de la couche 1 : tessons de faïence moderne et fragments de céramique musulmane, quelques tessons de sigillée claire, lampes «paléochrétiennes» africaines, céramique commune, amphores orientales (forme M. 330 de Robinson), amphores africaines.
156 BYRSA I
- Matériel de la couche 2 : céramique peu abondante, vernis noir, aretine (1 fr.), céramique à parois fines (rare), 1 fr. de lampe hellénistique, commune (marmite hellénistique), amphore; divers: 1 balle de fronde punique, des éclats de marbre et de pierre.
IL C - L'aire C (fig. 11, 15 et 16).
Nous l'avons analysée à partir des coupes c-d- et e-f (fig. 6 et 7), et de l'aspect de la surface. La seconde coupe a été réalisée sur la paroi libérée après l'enlèvement de la fosse 13 (aire A). Nous avons pu distinguer une zone présentant une succession régulière de strates, d'une autre caractérisée par une série de fosses résultant de l'activité des voleurs de pierres.
Une autre fosse 9 est apparue postérieurement; perpendiculaire à l'axe du cardo, elle s'est formée lorsque l'on a récupéré les marches de l'escalier. Nous n'avons retrouvé que l'empreinte des degrés à cet endroit (fig. 8). Cette fosse 9 avait entamé superficiellement une autre zone stratifiée F située sur l'égout (fig. 18)35.
1 - Description des coupes c-d et e-f : 1 - Terre grise, pierre, marbre, quelques tes
sons; compacte. 2 - Terre grise, pierres, marbre, céramique. 3 - Terre marron, pierres, marbre, céramique
très abondante mêlée, près du mur D, à des vestiges d'un foyer (charbon de bois, os); texture plus aérée.
4 - Peu de terre, céramique et pierres abondantes.
6 - Fosse, terre grise, même matériel. 7 - Fosse, terre grise, même matériel. 8 - Fosse, terre grise, même matériel.
2 - Le matériel. La céramique découverte dans l'égout et dans
la petite canalisation nord est légèrement antérieure à celle qui a été trouvée sur la chaussée.
35 Cette zone était constituée ainsi : 1) Niveau supérieur composé de blocs remployés, parmi lesquels deux fragments de bases et un bloc quadrangulaire; 2) Couche de sable, pauvre en matériel, pénétrée par les blocs précédents; 3) Couche de terre, pierres, céramique abondante. Le matériel des couches 2 et 3, comme celui des diverses fosses, ne se différencie pas de celui des couches 1 à 4 des coupes c-d et e-f.
Le matériel correspondant à l'occupation tardive est plus abondant et mieux conservé que dans les aires A et Β : campanienne représentée par quelques fragments provenant du remblai; sigillée claire (formes plus fréquentes : 99, 91, 93B, 108, 184 de Hayes); lampes «paléochrétiennes» africaines, particulièrement abondantes dans l'égout; céramique commune (nous avons distingué deux types, l'un apparenté à la sigillée claire, l'autre à pâte d'une consistance légère, de couleur claire et à engobe variant du jaune pâle au blanc-verdâtre; au premier type appartiennent des formes de plats à paroi droite ou légèrement évasée, et une forme de mortier à lèvre courte; cette dernière se retrouve dans la seconde catégorie où les formes fermées prédominent. La seule forme de mortier identifiée s'apparente à la forme 197 de Hayes); amphores byzantines abondantes et variées, dans un état très fragmentaire : ont pu être identifiées les formes Robinson M. 330, Egloff 164, 186, 181 (Thomas B2, Bl, B4) et Almagro 5436; quelques fragments d'amphores africaines; nombreux fragments de marbre (moulures lisses ou décorées, plaques de revêtement, reliefs), pesons ( de céramique et de marbre), tessons roulés, verre (petites coupelles sur pied), nacre (un fragment porte des traces de travail), clous et tessons divers de fer et de bronze, fragments de mosaïques.
Nous avons noté déjà que la limite du sondage dans l'aire C est arbitraire. Les bermes sud (fig. 15) et est (fig. 19 et 20) révèlent une situation semblable à celle que nous avons déjà rencontré, et sans doute moins bouleversée. Nous pouvons donc espérer y retrouver en place les structures antiques, ou leur empreinte, puisque nous avons pu constater que leur répartition correspond exactement à celle des zones stratifiées.
3 - Interprétation :
Les couches 1 à 4, contemporaines de celles de l'aire A, correspondent à l'occupation de la chaussée au VIe et au début du VIIe siècle de notre ère.
La couche 4 n'apparaît pas sur la coupe c-d où la zone statifiée se limite à l'espace situé au-des-
36 M. Almagro, Las necropolis de Ampurias, II, Barcelona, 1953-1955, p. 320.
158 BYRSA I
SO ^NE
chemin de Douar Chott I
mortier'
1 2 m.
coupe e-f
Fig. 16 - Aire C, zone F, coupe e-f. (Relevé F.V.).
■■'··<■;
Fig. 17 - Fondations des degrés de l'escalier. (Photo F.V.). Fig. 18 - Zone F, pavement tardif du chemin de Douar Chott (?) (Photo F.V.).
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 159
Fig. 19 - Limite est des fouilles, au premier plan, dalles de couverture de l'égout. (Photo F.V.).
:-* Cas««. >^-<*? ' li^£-A''i 'i* -'ri '. -ζ-
ie nord de la zone fouillée. (Photo F.V.Ì
160 BYRSA I
sus d'une dalle conservée. En fait, partout ailleurs, elle se substituait au revêtement dont nous n'avons retrouvé que le mortier conservant encore l'empreinte des dalles. Elle s'est donc constituée immédiatement après l'enlèvement de ces dalles, réutilisées probablement pour élever les habitations tardives qui ont envahi la chaussée.
L'homogénéité du matériel recueilli dans les fosses, identique à celui des couches 1 à 4, paraît indiquer qu'aucune occupation n'a succédé à celle du VIe- VIIe siècle, ou (et?) que l'exploitation des matériaux antiques a commencé très tôt. Il est vrai que le caractère limité de notre sondage ne permet pas d'avancer de telles interprétations de manière trop affirmative. Ceci vaut aussi pour l'hypothèse que nous voudrions proposer au sujet de la zone F; les blocs qui en recouvraient le niveau supérieur rappelant le chemin de Douar Chott, nous avons supposé qu'il pourrait s'agir d'un mauvais passage remplaçant le cardo maximus à une époque où celui- ci était occupé par les habitations tardives.
Nous nous avançons sans doute beaucoup moins en voyant dans l'abondance des fragments de décor de marbre une preuve du délabrement des monuments élevés sur la colline de Byrsa durant la même période.
IL D - Sondage dans les fondations du cardo (fig. 21 et 6).
Ce sondage, d'une extension très limitée, a été exécuté dans l'espace correspondant à la coupe e-f, en pénétrant de 0 m 80 sur la chaussée. Il a été poursuivi, en profondeur, jusqu'au sol de la colline qui affleure à cet endroit sous les dalles du trottoir (fig. 24), mais s'enfonce sous la chaussée (jusqu'à 1 m 20).
1 - Description de la coupe g-h :
1 - Terre grise, céramique, éclats de pierres; très compacte.
2 - Terre marron, tessons rares, pierres; très aérée.
3 - Terre marron, céramique abondante, pierres; plus compacte.
4 - Terre marron, pierres, quelques tessons; texture légère.
5 - Terre marron foncé, pierres, tessons (surtout amphores), os; aérée.
_| myeau. dalles ! mortier
coupe g-h
Fig. 21 - Sondage dans les fondations du cardo g-h. {Relevé F.V.).
2 - Interprétation (fig. 22 et 23).
Ces cinq couches correspondent à des apports successifs de remblai qui ont comblé la dépression naturelle, et constitué l'assise sur laquelle a été établie la voie. Seule la première se distingue, tant par sa consistance que par le matériel contenu. (Matériel de la couche 1 : céramique aretine, céramique à paroi fine (gobelets). Matériel commun aux couches 1 à 5 : campanienne, attique (rare), lampes hellénistiques, commune (marmites hellénistiques), amphores puniques, une balle de fronde, un fragment d'enduit punique).
III - Conclusions à l'étude du materiel
Pour le moment, cette étude n'a pas dépassé le stade de l'analyse préliminaire; mais celle-ci apporte déjà un certain nombre d'informations intéressantes37.
" Nous regrettons de n'avoir pu utiliser l'étude des monnaies, entreprise par M. P. Gandolphe, qui ne nous a pas encore été communiquée.
canalisation TEMPLE
1.
niveau de la _£haussee
m.O Fig. 22 - Coupe transversale sur le cardo I-J. (Relevé F.V.).
MUR OPUS CAEMENTITIUM
SOL COLLINE fosse de fondation
I mur opus caement
34
5 Fig. 23 - Coupe transversale sur le cardo K-L. (Relevé F.V.).
162 BYRSA I
III. λ- La céramique.
Nous avons eu l'occasion, ici aussi, de retrouver le remblai qui a remodelé la colline à l'époque augustéenne™. La céramique campanienne qui en constitue un des éléments les plus importants, apparaît de manière sporadique dans les strates des VIe et VIIe siècle, trahissant sans doute les remaniements dont cette zone a été alors l'objet. Les couches superficielles de ce remblai contiennent quelques fragments de céramique aretine et de vases à parois fines. Dans les niveaux correspondant aux habitations tardives, la céramique sigillée claire présente parfois des éléments qui ne figurent pas dans la typologie de J. W. Hayes39, mais paraissent correspondre à l'évolution tardive de certaines formes qu'il n'a pu suivre que jusqu'au milieu du VIIe siècle, dans le meilleur des cas. La présence de fragments d'amphores orientales appuie notre hypothèse. Bien que nous n'en ayons aucune forme complète, nous avons pu identifier les types les plus fréquents :
- amphores rouges à panse striée et décor peint : Robinson M. 329 et 330 (Ve- VIe siècle) et Egloff 187 (650-730); cette dernière présente seulement un décor au peigne;
- amphores marron d'une exécution très grossière : Almagro 54 (IVe siècle, Egloff 182 (début Ve-fin VIIe siècle);
- amphores à pâte beige ou rosée, à dégraissant sableux, anses striées verticalement : Egloff 164 (début VIe-fin VIIe siècle), Robinson M. 33 (début VIe siècle);
- amphores jaune pâle, striées: Egloff 186 (milieu du VIIe siècle-début du VIIIe), Thomas Β I40. M. Egloff a identifié un four dans lequel était fabriqué ce type d'amphores à Abou Mina (Egypte), durant la seconde moitié du VIIe siècle41.
- amphores à pâte marron-rouge, fortement micacée et d'aspect savonneux: Egloff 181 (390- 500), Robinson M. 335 (début VIe) M. 373 (fin VIe), Thomas B4 (début du Ve siècle).
's Au sujet de ce remblai, voir les rapports de fouilles des secteurs A et B.
39 J. W. Hayes, op. cit. 40 C. Thomas, Imported Pottery in Dark Age Britain, dans
Medieval Archaeology, III, 1969, p. 89-111. 41 M. Egloff, op. cit., η" 186, p. 249.
Ces éléments permettent d'affirmer que l'occupation du cardo maximus s'est prolongée au-delà de 650, et très probablement jusqu'à la conquête arabe. La fouille elle-même suggère une conclusion semblable, puisque nous avons pu noter qu'aucune occupation ne paraît avoir succédé à celle que matérialisent les strates tardives (cf. p. 160). Par ailleurs, et bien que leur origine précise ne soit pas toujours connue, les amphores attestent, par leur abondance et leur variété, des rapports très développés avec la partie orientale du bassin méditerranéen.
III. Β - Marbre.
Nous avons déjà noté que ce matériau a été fréquemment rencontré dans les couches tardives. Il se présente sous forme de moulures simples ou décorées (marbre blanc), de plaques de revêtement simple (marbre blanc), ou d'opus secale (marbres colorés). La fouille a également livré un fragment très réduit d'inscription (inv. 75.31) et deux fragments de bas-reliefs représentant une pointe de lance (inv. 75.43) et un torse de personnage féminin drapé (inv. 75.59).
Les marbres blancs peuvent provenir de Luni, de Proconèse, des carrières de Filfila ou de Cap de Garde (Algérie). Les marbres colorés se répartissent, par ordre de fréquence, entre le marbre de Numidie qui est le plus commun, le cipolin, la serpentine, le pavonazzetto, le por- phire rouge, le vert antique42; on rencontre également quelques fragments de Djebel Oust et de Djebel Oudan. Seuls donc le marbre de Numidie et les deux derniers (qui ne sont pas exactement des marbres) proviennent des environs immédiats de Carthage.
Les éléments les plus intéressants apportés par cette étude préliminaire du matériel, concernent les habitations tardives. Celles-ci nous livrent un témoignage des profondes mutations sociales et économiques qu'a connues Carthage aux VIe et VIIe siècles de notre ère. Elles attestent aussi, indirectement, de l'état de délabrement de l'une des zones monumentales les plus prestigieuses de la ville.
42 R. Gnoli, Martnorata romana, Roma, 1971.
164 BYRSA I
Fig. 25 - L'édifice formant l'angle du cardo maximus et du decumanus I, vu de l'ouest; au premier plan, le mur effondré. (Photo J. D.).
ÉDIFICE SITUE À L'ANGLE DU CARDO MAXIMUS ET DU DECUMANUS I SUD
Des vestiges de murs en opus quadratimi marquent l'angle N-E du croisement du cardo maximus avec le decumanus I sud. Ils ont été contournés lors des fouilles effectuées par Delattre en 1890 mais, depuis cette époque, la terre les avait de nouveau recouvert. Les recherches entreprises dans cette zone à partir de 1975 ne sont pas encore achevées; elles ont livré des structures que leur état d'arasement rend particulièrement complexes et qui appartiennent très nettement à plusieurs phases d'utilisation.
Il semble que, dans un premier état, ces structures aient constitué le point de rencontre des soutènements qui étayaient la plate-forme supérieure de Byrsa en dominant le decumanus I, au nord et le cardo maximus, à l'est.
De ce état subsistent quelques blocs d'opus quadratimi appartenant aux angles S-0 et N-O. Ceux de l'angle S-0 s'étagent encore sur trois assises4' et, sur la face ouest de l'édifice, s'alignent sur une longueur de trois mètres. Dans leur prolongement, après une interruption de 2,60 m, deux blocs de la première assise de l'angle N-0 conservent, à leur surface, un trait de réglage des assises supérieures. Il y a donc là une interruption de la construction en opus quadratimi et l'intervalle ainsi ménagé était occupé par un mur en opus reticulatum. Celui-ci, encore en place lors des fouilles de 189244, a, depuis, basculé en avant où il repose horizontalement
4' Sont consenés : trois blocs de la première assise, deux de la deuxième et un de la troisième.
44 Plan des fouilles Delattre relevé par l'architecte Bonnet- Labranche, BCTH, 1893.
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 165
sur un lit de gros blocs bien appareillés4s (fig. 25).
Un fragment de mur en opus reticulatum appartenant à la face nord de cet édifice a été dégagé lors des travaux effectués en 1976
Fig. 26 - Vestiges de la face ouest, vus du N-O; au premier plan, à gauche, les blocs de l'angle Ν portant un trait de
réglage. (Photo J. D.).
(fig. 27). Son raccord avec les blocs d'opus quadratimi de l'angle N-0 a été détruit lors de la construction d'un mur tardif qui lui est perpendiculaire.
Les recherches ne nous ont encore livré aucun renseignement concernant la face sud, établie en bordure du decumanus I. Des blocs appartenant aux deux premières assises de l'angle S-0 sont encore en place mais plus rien ne subsiste dans leur prolongement46. La poursuite des travaux nous permettra probablement de préciser le tracé de la première abside du soutènement sud et, par conséquent, l'extension de cet édifice dans cette direction.
A l'origine, l'intérieur de la construction était vide et, comme les absides, il constituait proba-
45 Une partie de ces blocs disparait sous le mur effondré, le relevé en est donc encore incomplet. Il faut cependant noter qu'ils se trouvent à la limite de la zone dans laquelle Delattre a découvert une vaste fosse commune d'époque punique (cf. BCTH, 1893). Cette fouille a provoqué la destruction du cardo, y compris son égout. Il est donc possible qu'une partie de ces blocs ait été enlevée à cette occasion. La poursuite des travaux, après l'enlèvement du mur effondré, permettra de préciser ce point.
46 Nous nous trouvons, là aussi, à la limite de la fosse commune.
blement une salle dont le parement interne des murs était réticulé ainsi qu'il est possible de l'observer sur le fragment du mur nord et sur des éléments effondrés du mur ouest47.
Trois citernes ont par la suite été aménagées dans cet espace. Cette transformation a nécessité un renforcement intérieur des parois existantes par l'application d'une nouvelle maçonnerie contre les murs réticulés et l'établissement d'un compartimentage. Deux bassins E-0 com-
Fig. 27 - Vestiges du mur réticulé Ν. (Photo J. D.).
muniquent par leurs extrémités ouest avec un troisième, N-S, dont la longueur est à peu près égale à la largeur des deux premiers.
Il faut sans doute attribuer à des périodes beaucoup plus tardives la désaffectation de ces bassins, leur réduction, à l'est, à l'ouest et au sud par la construction de murettes prenant appui sur leur radier et le comblement de l'un au moyen d'éléments architectoniques liés par du mortier (fig. 28-29). Une partie du fond de la première abside du soutènement sud a été mise au jour au milieu de remaniements tardifs associant du blocage et des éléments de grand appareil. Un mur N-S a ainsi été établi à peu près dans son axe (fig. 30). Il appartient probablement au même stade de modifications qu'une assise de blocs reposant sur du remblai qui réduit le bassin ouest à son extrémité sud. En attendant que la poursuite des recherches per-
47 Plusieurs de ces éléments ont été décomerts dans le bassin ouest.
166 BYRSA I
Fig. 28 - Comblement du bassin N-E, vu de l'ouest. (Photo J. D.).
mette de mieux éclairer les dernières phases d'utilisation de ces structures, on peut penser que, dans leur dernier état, elles aient été liées au mur de fortification (?) découvert par Beulé et Delattre48 en avant des absides du soutènement sud.
Le dégagement du bassin N-E49 a livré un dispositif de renforcement des parois nord et sud
48 Beulé a découvert une partie de ce mur en avant des absides de soutènement: Fouilles à Carthage, Paris, 1861, p. 59. Delattre en a exploré le prolongement: BCTH, 1893, p. 100. Beulé y a vu une partie de l'enceinte punique tandis que Delattre l'a attribué aux fortifications de Théodose II. Le mode de construction et le remploi de nombreux fragments architectoniques incitent à le dater d'une époque tardive, peut-être du moyen-âge musulman.
44 Ce n'est qu'au cours des travaux que nous avons pu acquérir la certitude qu'il s'agit bien des citernes mention-
réalisé au moyen de blocs de grand appareil. Ils sont disposés en deux assises régulières contre la paroi nord mais présentent un aspect moins homogène contre la paroi sud où une base de colonne a même été incorporée à ces matériaux de remploi (fig. 28). Entre ces deux renforts des parois, le fond de la citerne a été comblé d'éléments architectoniques, dont plusieurs chapiteaux corinthiens, et de fragments de blocs noyés dans du mortier. Celui-ci a conservé l'empreinte d'éléments arrachés, en particulier contre la paroi sud et dans le fond de la citerne. Il semble aussi que des blocs disposés en assises contre la paroi nord aient été enlevés™. Ce comblement semble contemporain de la construe-
f fj "* ' ,« '·Λ l f »' '* ' î * * &:'te%'
"^''"X'-'l
i
Λ
Fig. 29 - Le bassin N-E, vu de l'est. (Photo J. D.).
nées par Lape) re dans son bref rapport sur les fouilles de 1934 (op. cit., p. 15 de l'extrait).
M) II est possible qu'une partie de ces extractions soit antérieure aux fouilles de 1934. Lapeyre mentionne parmi les découvertes: «des citernes, des silos, des restes de constructions romaines et arabes avec des fragments de colonnes en marbre, de chapiteaux en marbre, de statues, de poterie ».
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 167
ffîÛ-~
— i-ti> *'-*
j-— ..--^jy- -v,,%-, i^-j^ ··►*«-< ip"^»-'·!— t·— ; ;n
Fig. 30 - Le mur tardif construit dans l'abside du soutènement sud, vu de l'est. A droite, derrière les blocs de remploi, la maçonnerie de l'abside est visible en coupe. (Photo J. D.).
Le soutènement ouest
Nous avons déjà signalé deux absides à parement d'opus reticulatitm qui font partie de ce soutènement (cf. Historique ... p. 48). Les fouilles entreprises en 1934 par G. G. Lapeyre ont détruit les traces de niveaux de sol qui pouvaient subsister et se sont engagées profondément dans la couche d'argile assez friable sur laquelle elles sont établies. Ce déchaussement, atteignant un niveau inférieur à celui de leur fondation, a provoqué l'effondrement de l'abside située au nord. Les vestiges de celle qui subsiste (fig. 31) s'élèvent à environ 9 m de l'édifice aux citernes; son intrados fait face au cardo maximus dont il est distant de 11 m. La construction en petits mœllons liés à la chaux est intérieurement
tion des murettes qui ont réduit ces bassins à l'est, à l'ouest et au sud.
Contre la paroi est du bassin ouest sont plaquées deux «piles» en petits mœllons liés par un abondant mortier de chaux. Il s'agit probablement de fondations appartenant à la dernière phase d'utilisation qui ont été établies en puits ou en tranchée dans la citerne remblayée. Plusieurs fragments d'un mur à parement réticulé sur ses deux faces, épais de 0,60 m, ont été retrouvés dans ce bassin; deux chapiteaux corinthiens reposaient sur le fond51.
Les éléments de céramique recueillis dans ce milieu qui parait nettement avoir été bouleversé par des fouilles antérieures ne présentent aucune valeur stratigraphique. Des fragments attiques, sud-gaulois, africains (sigillée claire) et musulmans étaient mêlés à quelques tessons modernes". Le dégagement de l'abside située à l'est des citernes n'a pas livré de céramique moderne mais de nombreux fragments de céramique musulmane. Des blocs de pierre semblent avoir été extraits des remaniements tardifs liés au mur implanté dans cette abside.
M Ils ont peut-être été extraits du bassin \oisin lors des fouilles de 1934.
S2 L'étude de céramique, qui n'a pu tromer place dans ce rapport, sera publiée ultérieurement.
Γ~*7 ^i
ν*- -
Fig. 31 - Abside du soutènement ouest, vue de l'ouest. (Photo J. D.).
revêtue d'un parement d'opus reticulatum assez bien conservé. L'amorce de l'abside suivante, au nord, est encore bien visible et, au sud, des traces des deux absides précédentes ont été décelées à l'emplacement de leur jonction. Au cours des dernières recherches, un fragment du mur réticulé de la première abside sud a été découvert (fig. 32). Il correspond au début de la courbure de l'intrados immédiatement après sa jonction avec le mur latéral nord. A son extrémité,
168 BYRSA I
Fig. 32 - Fragment du mur de la première abside ouest. (Photo J. D.i.
un des éléments réticulés coupé verticalement semble indiquer qu'un jambage était intercalé entre l'abside et le mur. Celui-ci reposait sur une fondation formée de deux assises de blocs dont la première parait intégralement conservée jusqu'à son extrémité ouest, où un élargissement en Τ correspond à l'alignement de la façade (fig. 33). Les pierres sont disposées de manière à former un lit horizontal au dessus duquel ne subsiste qu'un seul élément de la deuxième assise qui est disposé verticalement. Il est assez curieux de noter que cette fondation ne se prolonge pas sous l'abside proprement dite dont le mur réticulé repose directement sur le tuf. Ces quelques éléments nous livrent donc les restes
d'un alignement de quatre absides dont la première, au sud, était mitoyenne de l'édifice aux citernes. Entre la quatrième, au nord, et un mur rectiligne en opus reticiilatum (fig. 34) établi sur le même alignement, mais à un niveau plus élevé, il est possible d'en restituer une cinquième.
Ces structures de soutènement, parallèles au cardo maximus, sont adaptées, comme le profil de la voie, à une pente ascendant du sud vers le nord. D'autre part, la première abside est déjà à un niveau beaucoup plus élevé que celui des voies à leur croisement". L'édifice aux citernes formant l'angle des soutènements sud et ouest compensait cette dénivellation à laquelle une série de degrés correspondait probablement sur le cardo. A partir de là, les absides de l'ouest suivaient une pente relativement faible (fig. 34).
Les recherches n'ont pas encore permis de déceler de traces de la jonction de la première abside ouest avec l'édifice aux citernes. L'aménagement tardif, probablement à l'époque musulmane médiévale54, d'une citerne occupant la largeur de cette abside a pu provoquer sa destruction partielle. La poursuite des travaux permettra peut-être de déceler des traces de son mur latéral sud et de préciser sa situation par rapport à l'édifice aux citernes. Les sondages n'ont pas encore été entrepris afin de ménager des vestiges d'un dallage tardif (N.G. 49,82 m) et un important fragment de voûte effondrée en opus caementicium.
Le temple prostyle
Les vestiges de l'édifice.
Le soutènement en absides a été profondément modifié et partiellement détruit lors de la construction d'un édifice implanté à l'extrémité ouest de la plate-forme. Son soubassement, qui se prolonge jusqu'au cardo maximus, a incorporé une partie de ce soutènement.
Fig. 33 - Blocs de fondation du mur N. de la première abside ouest, vue prise du N-E. (Photo J. D.).
53 N. G. : 47,50 m au croisement des voies, 49,15 m à la première abside.
54 Ce bassin N-S est perpendiculaire à l'édifice aux citernes. Il n'en subsiste que le fond (N. G. 48,09 m) comportant une sorte de cuvette qui semble caractéristique des citernes musulmanes rencontrées sur la colline de Byrsa.
2 3456789 10 m
Fig. 34 - Essai de restitution des absides de soutènement ouest et sud et situation par rapport aux édifices postérieurs. La restitution des absides sud est encore très hypothétique (dessin G. Robine).
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 169
La partie antérieure de cet édifice est établie sur la plate-forme; les murs en opus caeinenti- ciiun dont le tracé présente la forme d'un H en constituaient les fondations (cf. Historique . . . p. 51 et fig. 4, 5, 6). La partie postérieure, dont les fouilles de 1974-1975 ont permis de retrouver le tracé, prolongeait ces fondations jusqu'au cardo inaximus. Sa construction a provoqué la
Fig. 35 - Au premier plan, dalles du trottoir du cardo maxi- mus; à un niveau inférieur, semelle de fondation du mur N. sur laquelle subsistent quelques blocs; au-dessus, à gauche, le mur réticulé prolongeant le soutènement en absides. Vue
prise de l'ouest. (Photo J. D.).
destruction de l'abside 5 et d'une partie de l'abside 2, les absides 3 et 4 ont été enfermées dans le soubassement (fig. 35). Leur conservation semble due au fait qu'elles continuaient à maintenir le remblai auquel elles étaient adossées. Les murs latéraux et les voûtes qu'ils supportaient ont été détruits pour faire place à une division de ce soubassement en trois parties égales; les murs intérieurs Ν 1 et S 1 venaient buter contre les absides.
L'implantation de ces fondations a été creusée plus profondément dans le tuf que celle des absides de soutènement. Une épaisse semelle de béton, large de 2,40 m pour les murs Ν et S, de 2 m pour le mur 0 et de 1,20 m pour le mur Es supportait une construction en grand appareil (fig. 31 et 36). Les fondations des murs
rieurs N, S et 0 ont été établies à un niveau égal : 49 m (N.G.) à la surface de la semelle de fondation. Le niveau du lit de pose est à 49,50 m sur la fondation du mur S 1 et à 50,04 m sur celle du mur N 1. Cette différence correspond à la pente N-S de la colline. Quelques blocs des trois premières assises du mur N étaient encore en place, leur hauteur correspond à la profondeur de la tranchée de fondation dont la paroi sud a été reconnue (fig. 36). Il n'en subsiste aucun du mur Ο et seulement quatre de la première assise du mur S.
Les murs en grand appareil N et S prolongeaient, avec un léger décrochement, les murs en opus caemeiiticiimi mis au jour en 1890. Il parait évident que ces substructions appartiennent à un même édifice dont l'établissement sur deux niveaux a nécessité l'utilisation de procédés de construction différents^.
Fig. 36 - Mur à deux courbures établi sur les blocs de fondation de l'abside. (Photo J. D.).
Le plan que présente cet ensemble est celui d'un temple prostyle à cella et pronaos dont la façade était dirigée vers l'est. Le pronaos et l'avancée que formaient les murs d'échiffre étaient établis sur l'extrémité de la plate-forme. La plus grande partie de la cella s'élevait sur le
" Le dégagement et la conservation en élévation de murs de fondation ainsi que d'une abside de soutènement dont l'extrados ne retient plus aucun remblai, allié à la destruction des murs en grand appareil, donnent à ces \ estiges un aspect très confus qui n'en facilite pas l'interprétation sur le terrain.
170 BYRSA I
soubassement vide qui avait pris la place des anciennes structures de soutènement. Ce sous- sol ne s'étendait pas sous toute la longueur de la cella mais seulement du mur ouest (O) jusqu'aux absides (environ 9 m).
Les proportions de l'édifice correspondent à celles d'un grand temple prostyle et hexastyle (30 m χ 16, intérieur de la cella, 13 m χ 1 1 m). Ses dimensions sont très proches de celles du capitole de Thuburbo Maius. A Carthage, la situation du temple, offrant une vision de son profil à toute une partie de la ville, rend plausible l'hypothèse d'un pseudo-périptère56.
L'avancée des mur d'échiffre étant de 4 m, elle permet, d'après le nombre de degrés possible (13 marches de 0,33x0,18), de restituer le podium à environ 2,30 m au-dessus de la plateforme. Il a été possible d'établir que le N.G. de celle-ci est d'environ 56 m (cf. Historique . . . p. 53). La partie postérieure du podium, à laquelle était adossé le portique, aurait donc dominé le cardo maximus de près de 8 m (fig. 34).
Le sous-sol" était limité à l'espace compris entre le mur postérieur du podium et les absides de l'ancien soutènement. Le sol du pronaos et celui de la partie antérieure de la cella ne paraissent pas avoir été établis au-dessus d'un évide- ment de la construction. Il ne subsiste aucune trace de murs internes qui auraient supporté des voûtes et, d'ailleurs, deux tombes puniques, situées sous le pronaos, n'ont pas été atteintes lors de l'établissement des fondations (cf. Historique . . . , fig. 4).
L'arase de ces fondations en opus caementi- cium est à 52,50 m (N.G.) pour le mur de façade, elle est un peu plus élevée pour le mur d'échiffre nord et, au contraire, plus basse, de la valeur d'une assise de blocs, pour le mur sud. Il est pro-
Sfl L'épaisseur des fondations se prêterait à ce type d'édifice. A. Lézine pense qu'un temple périptère était établi, dans une situation un peu analogue, sur la colline de Bordj Djedid : Architecture romaine d'Afrique, Paris, 1964, p. 78.
" Nous retrouvons une disposition un peu analogue à Thuburbo Maius où la façade postérieure du podium a une élévation de 6 m. Mais, la pente dans laquelle est construit le capitole de Thuburbo est relativement faible et la différence de niveau entre les deux extrémités du podium ne dépasse guère 1 m. L'élévation de la partie antérieure a permis l'aménagement de sous-sol qui s'étendent sous toute la longueur du temple.
bable que plusieurs assises de grand appareil complétaient l'opus caementicium, jusqu'au niveau de la plate-forme. La partie de l'édifice s'élevant à partir du niveau du cardo maximus, et formant le soubassement de la cella, était, comme nous l'avons vu, entièrement construite en grand appareil. Son extrémité est, qui correspondait à l'entrée de la cella, se trouvait en arrière des absides de soutènement; les fondations en grand appareil ont donc été prolongées dans des tranchées traversant le remblai. La partie de l'édifice qui prenait la place des anciens soutènements a bénéficié du nivellement effectué lors de la construction des absides, le coffrage d'une semelle de fondation à un niveau égal n'a donc pas nécessité d'entailler très profondément le tuf. Les murs d'opus caementicium qui supportaient le pronaos sont établis dans la pente naturelle (cf. Historique . . . , fig. 6); l'utilisation de ce matériau a permis de limiter la profondeur des tranchées à la rencontre du tuf et de faire franchir au mur sud les dalles recouvrant des tombes puniques (cf. Historique . . . , fig. 5). Les différences de niveau du sol naturel ayant été ainsi rattrapées, la construction des fondations a pu être poursuivie en grand appareil.
Le soubassement de la cella est antérieur, du moins dans l'ordre de la construction, aux fondations en opus caementicium du pronaos, le blocage du mur nord a, en effet, gardé la trace de l'extrémité du mur en grand appareil contre laquelle il a été coffré. On ne peut cependant songer à une construction en deux phases distinctes; par sa faible épaisseur, le mur de façade de la cella ne peut être qu'une division interne de l'édifice.
L'élévation déjà considérable du podium au- dessus du cardo peut expliquer sa faible hauteur par rapport à la plate-forme (fig. 34).
L'extrémité du mur d'échiffre nord est accolée à la première pile de fondation du mur à arcs (fig. 1) (cf. Historique ... p. 51). Le tracé de ces fondations suggère une colonnade appartenant à un long portique dont le mur de fond aurait été formé par l'élévation du mur D (pseudo enceinte punique) S8. La disposition de cette colonnade,
s-< Au sujet de ce portique voir le rapport de fouilles du secteur B.
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 171
édifiée dans le prolongement exact d'un côté du temple, est inhabituelle. Elle incite à penser que le portique reliait deux monuments symétriques dont le second occupait l'angle sud-est de la plate-forme.
Cette disposition intégrant latéralement deux édifices symétriques aux extrémités d'une façade monumentale correspond mal aux lois de la frontalité. Elle les fait apparaître comme des éléments secondaires d'un vaste ensemble architectural. En partant de cette hypothèse, on serait tenté de rechercher un élément principal, établi dans l'axe nord-sud, qui ne pourrait être situé que très en retrait du portique et devant la façade duquel s'étendrait X'area.
Les soutènements ouest après la construction du temple
Comme nous venons de le voir, deux absides ont été incorporées dans le soubassement du temple tandis que deux autres étaient détruites pour faire place aux murs latéraux Ν et S de l'édifice. Seuls ont pu subsister la première abside, proche de l'édifice aux citernes et le mur réticulé situé au nord.
Il faut cependant observer que la dénivellation entre la plate-forme de la cote 56 et le cardo nécessitait des soutènements de part et d'autre (au nord et au sud) du temple. Dans l'état de destruction de ces structures et au stade actuel des recherches il est impossible de préciser les transformations qu'ont pu subir ces structures dans la nouvelle organisation de cette zone.
Un mur dont le tracé forme deux courbures a été établi sur l'assise de fondation du mur latéral nord de la première abside (fig. 36). Il semble s'agir d'un remaniement tardif destiné à contenir un remblai postérieur à la destruction de cette partie des soutènements.
Les fouilles
En 1974, lors du début des travaux, cette zone présentait un aspect très bouleversé. Plusieurs blocs informes d'opus caementicium gisaient, en avant de l'abside, où ils ne reposaient plus sur
leur site primitif d'effondrement^9. Des sondages implantés dans le carroyage N-S ont été ouverts dans les carrés C V 2, 8, 1 1, 12 et D V 5 (fig. 1). Ils ont été ensuite prolongés en fonction de la recherche des structures de l'édifice. Le sondage D V 5 correspond à l'emplacement de la tranchée de reconnaissance du mur Ν ouverte lors des fouilles Delattre et comblée depuis (fig. 2), nous y avons retrouvé les blocs de grand appareil qui sont indiqués sur le plan de 1890. Les sondages C V 8, 11, 12 permirent de retrouver le prolongement du mur Ν et son angle N-0 dont il ne subsiste, en C V 11, que la semelle de fondation.
Entre les murs Ν et Ν 1, une fosse profonde a été partiellement dégagée dans le sondage C V 8, elle se prolonge vers l'ouest en C V 7. Cette zone correspond au secteur dans lequel Lapeyre dit avoir découvert de petites sépultures puniques (cf. p. 143 et note 4).
La recherche de la semelle de fondation ouest a livré un des silos mentionnés par Lapeyre. Il était creusé contre la fondation, à proximité de l'angle qu'elle forme avec le mur interne S 1. Un deuxième silo a été découvert contre la semelle de fondation sud qui avait été légèrement entaillée par son aménagement. Dans l'angle interne S-O, cette semelle de fondation a aussi été entaillée par une excavation qui s'est poursuivie jusque sous le béton.
Les recherches effectuées devant l'abside (C V 3,15) ont permis de constater que nos prédécesseurs en avaient complètement déchaussé les fondations. Des fragments de céramique moderne ont été retrouvés au niveau le plus profond.
Là aussi, le matériel céramique découvert ne peut donc fournir aucun renseignement strati- graphique. On peut cependant considérer qu'il a peut-être été déplacé dans un périmètre relativement restreint. A l'emplacement des tombes puniques, entre les murs Ν et Ν 1, le remblai rejeté dans les anciennes fouilles contenait encore une bonne proportion de céramique atti- que du IVe siècle et de céramique à vernis noir. De nombreux fragments de céramique musul-
^' Ainsi que l'a montré la constitution récente du remblai sur lequel ils reposaient. Ils ont probablement été poussés en extrémité de chantier lors des prélèvements de terre de 1950.
172 BYRSA I
mane ont été retrouvés mêlés à de la céramique sud-gauloise et à de la céramique africaine rouge clair.
Vestiges situes au nord du temple prostyle
Les sondages C V 11 et 12 ont permis de reconnaître un mur d'opus caementicinm qui se poursuit sur une longueur de sept mètres, à partir du cardo maximus, contre la fondation nord du temple. Epais d'un mètre, ce mur, établi à partir du même niveau que la semelle de fondation N, a été coffré contre les assises qu'elle supportait. Sa hauteur de 1,50 m est un peu plus élevée à son extrémité ouest où il semble se retourner parallèlement au cardo. Dans cette partie, il a été entaillé pour livrer passage à une canalisation qui rejoint l'égout (cf. p. 144). Le coffrage contre les assises du mur Ν indique que la construction est postérieure à celle du temple. Il n'est pas encore possible de relier cet élément au tracé d'un ensemble auquel avait peut-être été incorporé le mur réticulé qui prolonge les soutènements en absides (fig. 1 et 35).
Le fond d'une chambre funéraire punique a été découvert à l'extrémité est de ce mur (fig. 37). La partie antérieure de la tombe, qui se trouvait à l'emplacement présumé du mur latéral nord de la cinquième abside de soutènement (fig. 35), a été détruite. La partie supérieure a été arasée au niveau des fondations du mur réticulé qui est distant de 2 m, à l'est.
La tombe était construite en blocs de grand appareil. Sa largeur interne, 1,40 m, est plus faible que celle des grandes chambres funéraires à auges60. Les blocs des parois sont dressés sur l'extrémité des dalles qui forment le sol. L'une de celles-ci s'est affaissée lors de la destruction de la partie antérieure sans entraîner les blocs de la paroi. Une œnochoé en terre cuite61 a glissé et s'est logée dans la cavité ainsi ménagée. La fosse contenant la tombe a été creusée dans le tuf de la colline que la destruction laisse apparaître en coupe. Un remblai a été tassé dans l'intervalle ménagé autour de la construction.
Ml La largeur des chambres funéraires voisines varie, d'après Delattre, de 1,95 m à 1,58 m.
61 P. Cintas, Céramique punique, p. 125 et pi. XV, forme 194, attribuée au VIIe siècle.
Au nord de ces vestiges, des nettoyages d'anciennes fouilles et le décapage de niveaux superficiels ont fait apparaître quelques éléments qui pourront servir de point de départ à la poursuite des recherches. A l'extrémité ouest du mur Κ (fig. 1), un important dépotoir d'ordu-
.'J Fig. 37 - Vestiges d'une chambre funéraire punique.
(Photo J. D.).
res modernes a été nettoyé. Une excavation profonde avait jadis atteint cette partie du mur jusqu'en sous-œuvre provoquant une rupture et un affaissement de la maçonnerie. Dans le prolongement ouest du mur, quelques blocs de grand appareil ont été remis au jour62. Au nord, se manifestent quelques alignements de structures parallèles comprises entre le mur L et le cardo.
J. D.
Cette première phase de recherches nous livre donc quelques renseignements intéressants quant aux différentes phases de l'implantation romaine sur Byrsa. Les profonds remaniements subis par le relief naturel de la colline se manifestent par l'arasement d'une tombe punique. La construction de la voie et des structures de sou-
"2 II s'agit très probablement de structures dégagées en 1934 et considérées alors comme la continuation \ers l'ouest de la pseudo-enceinte punique.
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 173
tenement concrétisent l'importance des travaux d'urbanisme qui ont suivi la création de la Colonia Julia. Le IIe siècle est, semble-t-il représenté par l'édification du temple et d'un portique sur le cardo. Les siècles troublés, marqués par de profondes mutations économiques et sociales, se traduisent par des aménagements divers qui aboutissent à la transformation du cardo en quartier d'habitations populaires. De nombreux problèmes, intéressant la chronologie et la topographie de cette zone, restent à éclaircir et, en particulier, ceux qui concernent les rapports de la voie avec les édifices voisins.
décoré de perles et pirouettes et un second kymation lesbique à rais de cœur semblables à ceux de l'architrave des Thermes. Ces motifs déterminent des fasces étroites.
L'évidante parenté liant ce fragment à la décoration des Thermes d'Antonin, apparaît avec la même netteté, tant sur le plan stylistique qu'au niveau de la syntaxe décorative, sur plusieurs éléments de décor architectural retrouvés sur Byrsa ou conservés dans le musée de Carthage. Tout semble indiquer que le même atelier, ou tout au moins des ateliers ayant eu la même formation et utilisant les mêmes modèles, ont travaillé contemporainement en divers points de la ville.
J. D. et F. V. 2 - Fragment de chapiteau corinthien
FRAGMENTS DE DÉCOR D'ARCHITECTURE TROUVÉS AU COURS DE LA CAMPAGNE 1975
DANS LA ZONE DU CARDO MAXIMUS
La présente étude intéresse seulement les quelques éléments portant une décoration suffisamment conservée pour permettre une analyse.
Le contexte archéologique ne fournissant aucune indication d'ordre chronologique, l'étude est basée sur des comparaisons établies, dans la mesure du possible, avec les monuments datés de Carthage et des environs6'. Nous avons toutefois évité de proposer des datations précises en raison du caractère fragmentaire de notre matériel, préférant nous limiter à le présenter dans un ordre qui nous semble correspondre à l'évolution de la décoration architecturale de la région.
Inv. : 75. 36 a et b; prov. : C. V. 14, cardo, remployé comme «revêtement» du chemin de Douar Chott.
Dim. : haut. max. : 0 m 25; haut, de l'abaque : 0 m 065; larg. max. : 0 m 19.
Marbre blanc à gros cristaux. Seule l'extrémité d'une corne de chanfrein est
conservée, ainsi qu'une partie des crosses et de la volute qui la soutenaient.
Le seul critère de datation nous est fourni par la feuille au limbe parcouru de nervires fines, qui égale les meilleurs exemples des Thermes d'Antonin. Tout aussi soignées sont les moulures ornant les crosses et l'abaque.
En se basant sur les proportions indiquées par Vitruve, (IV-I-38), on obtient, partant de l'épaisseur de l'abaque, une hauteur de 0 m 455 pour la hauteur du chapiteau, valeur qui est certainement approximative (rappelons que la coudée punique mesure 0 m 515).
1 - Fragment d'architrave. (Placage)
Inv. : 75. 7; prov. : C. V. 6, au fond de la fosse ouest du temple.
Dim. : larg. max. : 0 m 38; haut. max. : 0 m 35; épais, max. : 0 m 05.
Marbre blanc à grain fin.
Le décor de ce fragment reproduit très exactement celui de la frise architravée des Thermes d'Antonin à Carthage. S'y succèdent de haut en bas, un kymation lesbique orné d'un motif à anthemion, un astragale
61 II s'agit de la frise architravée portant l'inscription de 162; cf. A. Lézine, Carthage-U tique, fig. 19, p. 40 et p. 61.
3 - Fragment de corniche
Inv. : 75. 80; prov. : C. V. 14, cardo, fosse 7 (aire C). Dim. : larg. max. : 0 m 35; haut. max. : 0 m 14; épais,
max. :0m 11; glyphes haut. max. : 0 m 06; kymation haut. : 0 m 08.
Marbre blanc-grisàtre, cristaux moyens.
Il s'agit de la zone supérieure de la corniche, comprenant la cimaise et une partie du larmier.
Sur la cimaise, les fleurons du kymation lesbique à rais de cœur ont pris l'aspect de larges feuilles d'eau, divisées par une nervire médiane rigide, qui alternent avec de petite feuilles lancéolées. Au-dessous, apparaît la limite supérieure du larmier orné des gly-
174 BYRSA I
phes habituels à la région64. Le motif de rais de cœur qui apparait ici, semble avoir peu à peu supplanté celui à anthemion sur les cimaises postérieures à la réalisation des Thermes d'Antonin.
La sculpture est assurée et précise, mais dénuée de recherche et de nuances dans les détails.
4 - Fragment décore d'un KYMATION LESBIQUE. (Placage)
Inv. : 75. 24; prov. : C. V. 13/14, cardo, couche superficielle (aire C).
Dim. : haut. max. : 0 m 18; Larg. max. : 0 m 24; épais, max. : 0 m 05; bandeau haut : 0 m 04; kymation haut : 0 m 06.
Marbre de Cap de Garde. Les rebords supérieur et inférieur, ainsi que la face
postérieure, sont lisses. La plaque est bordée par un bandeau lisse, auquel
succède un kymation lesbique constitué de feuilles subdivisées en cinq petits lobes bien formés dont le limbe est animé de nervures harmonieusement modelées. Chaque demi-feuille s'unit à la feuille voisine pour former un calice enchâssant une feuille lancéolée. Un trou de trépan ponctue le point de contact des deux premiers lobes des feuilles principales.
5 - Fragment de chapiteau corinthien
Inv. : 75. 57; prov. : C. V. 13/14, cardo, couche superficielle (empierrement du chemin de Douar Chott).
Dim. : haut. max. : 0 m 20; larg. max. : 0 m 25; épais, max. : 0 m 19; haut, abaque : 0 m 07.
Marbre blanc, cristaux moyens. L'épaisseur de l'abaque correspond à celle d'un
chapiteau de 0 m 49 de hauteur, environ (Vitruve IV- I-38)-soit pratiquement une coudée punique (0 m 515).
Dans ce cas encore, seule une corne d'abaque et les volutes qui la soutenaient, ont été préservées. De ces dernières, l'une prend appui sous l'abaque tandis que l'autre déborde légèrement dessus. Les crosses ne sont plus libres comme sur l'exemplaire n° 3, mais le
calathos apparait et fait bloc avec elles dans la partie inférieure. On a négligé tous les détails naturalistes du limbe, et la feuille n'est plus animée que par plis profonds et rigides.
6 - Fragment de chapiteau corinthien (partiellement engagé)
Inv. : 75. 59; prov. : C. V. 14, cardo, couche superficielle (aire C).
Dim. : haut. max. : 0 m 22; épais, max. : 0 m 30. Marbre blanc, cristaux moyens. Les quelques détails conservés, l'acanthe, la pro
éminence du calathos entre les crosses, l'apparentent étroitement au précédent.
7 - Fragment de chapiteau corinthisant de placage (Figuré?)
Inv. : 75. 51; prov. : C. V. 14/15, cardo, couche superficielle (aire C).
Dim. : haut. max. : 0 m 125; larg. max. : 0 m 14; épais, max. : 0 m 04; abaque haute : 0 m 05.
Marbre blanc à grain fin.
Du décor de la corbeille on n'aperçoit plus que l'enroulement d'une crosse végétale et un motif médian qui paraît être le corps d'un dauphin. La première est constituée d'une feuille allongée dont le rebord est découpé en festons; ces incisions affectent toute la largeur de la feuille au niveau de l'enroulement65. Au centre de la corbeille, nous serions tentée de restituer deux dauphins affrontés de part et d'autre de la tige du fleuron ou d'un autre motif66). La hauteur de l'abaque nous permet d'évaluer celle du chapiteau à 0 m 35 environ (Vitruve IV-I-38).
8 - Chapiteau corinthien de colonne
Inv. : 75. 41; prov. : C. V. 9, citerne. Dim. : haut. : 0 m 49; diamètre au lit de pose : 0 m
38; haut, abaque : 0 m 07; lere couronne :0m 14; 2e couronne : 0 m 26.
Marbre blanc-grisâtre d'aspect granuleux, friable.
64 Ces glyphes sont présents sur la plupart des corniches conservées sur le site de Carthage; leur presence a ete notée également à Zaghouan, Sbeitla et Haidra : cf. F. Rakob, Das Quellenheiligtum in Zaghouan, M. DAI. (R), 81, 1974, I, p. 67, pi. 57, 3; 65, 2 et 66,1.
^ P. Pensabene, Scavi di Ostia, 7, I Capitelli, Roma, 1973, p. 137 sq.
6h Cf. E. von Merklin, Antike Figurai Kapitelle, Berlin, 1962, p. 207-221, fig. 967-1028. La queue des dauphins occupe généralement la place de la volute.
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 175
Le lit d'attente présente un scamillum en relief, carré, larg. : 0 m 38 χ 0 m 38, en ressaut de 0 m 025.
Il nous est parvenu en assez mauvais état, privé de trois cornes d'abaque et des volutes qui les soutenaient, de l'extrémité des feuilles et des folioles. Une face a été entaillée sur toute sa largeur et sur une hauteur correspondant aux deux couronnes d'acanthe; ce travail, qui a entamé des zones sculptées, a certainement été réalisé à l'occasion d'un remploi67. Sur l'unique corne de chanfrein conservée, et à l'extrémité d'une feuille, sont visibles des traces de goujons métalliques témoignant de réparations antiques68.
Au-dessus d'une zone réservée à la base sur 2 cm., s'élève une première couronne qui comptait à l'origine huit feuilles subdivisées en cinq lobes, et animées de lignes profondes tracées au trépan et par des oculi nés du contact des folioles entre lobes voisins. La nervure médiane est à peine incisée. Les feuilles de la seconde couronne naissent à un niveau bien distinct, et seule la fine nervure centrale pénètre un peu dans la zone inférieure; entre elles se glissent les caulicoles, légèrement obliques, décorés eux aussi de lignes profondes qui rappellent les cannelures des exemples plus antiques. Hélices et volutes présentent l'aspect d'un ruban légèrement concave, non mouluré, qui adhère au calathos dans le cas des premières. Un cavet et un filet divisent l'abaque, qu'orne, au centre de chaque face, un fleuron de taille importante probablement formé de pétales effilés encadrant un pistil très développé; la tige de ces fleurons nait d'une feuille ovale, inachevée sur l'une des faces.
La facture est négligée et l'emploi du trépan excessif.
Typologiquement, ce chapiteau appartient à une catégorie apparue à Rome à l'époque flavienne qui s'est perpétuée, en évoluant dans les détails, jusqu'au début du IIIe siècle69. A Carthage, ce type est représenté avant tout par les chapiteaux des Thermes d'Antonin qui, comme tous les autres éléments de décor architectural, font figure de chefs de file dans la région. Dans le cas présent, c'est au théâtre et au
"7 Les chapiteaux étant normalement achevés après leur mise en place on ne s'occupait alors que des parties visibles : W. D. Heilmeyer, Korinthische Normal Kapitelle, Heidelberg, 1970, p. 18 et P. Pensabene, op. cit., p. 194; on note par ailleurs que la zone en question est travaillée de manière différente et beaucoup plus sommaire que d'autres parties également cachées, tel le lit d'attente de l'abaque.
hS A. Lézine, Architecture romaine d'Afrique, Tunis, 1961, p. 116 et note 77.
M P. Pensabene, op. cit., n° 225 à 324, et plus particulièrement n° 247, p. 64.
musée de Carthage que se trouvent les exemples les plus proches (fig. 14 et 15); les chapiteaux du portique des Petronii à Thuburbo Majus (inscription de 225) se distinguent des nôtres par une facture plus soignée et plus délicate (fig. 13). G. Ch. Picard propose de dater de l'époque des Sévères une restauration du théâtre à laquelle pourraient être attribués les chapiteaux auxquels nous avons fait référence70. Sur la base de ces deux rapprochements, il semble possible de dater notre chapiteau de la fin de l'époque sévérienne.
9 - Fragment de corniche corinthienne
Inv. : 75. 53; prov. : C. V. 13/14, cardo, couche superficielle.
Dim. : larg. max. : 0 m 35; haut. max. : 0 m 195; épais, max. : 0 m 21; modillon large :0m 12; caisson : 0 m 10x0 m 10.
Marbre blanc à gros cristaux, aspect granuleux, friable.
Ce fragment comporte une partie de la cimaise, du soffite du larmier et du modillon. Le larmier a disparu71. Sur le talon d'une corniche du théâtre (fig. 16) on retrouve un décor de feuilles identique à celui de notre cimaise. Le trépan n'est intervenu dans sa réalisation, que pour découper, sur le pourtour, l'extrémité des folioles; le limbe est modelé superficiellement en plis parallèles. On y verra une forme végéta- lisée de kymation lesbique, qui accompagne un applatissement du profil. Nous retrouvons un kymation lesbique, décoré de rais de cœur, sur le soffite du larmier. Ce dernier s'orne également d'une grosse rosace dont le pistil disparaît sous la masse de la corolle (formée probablement de cinq pétales).
10 - Fragment de corniche corinthienne
Inv. : 75. 10; prov. : C. V. 10, au niveau des fondations ouest de l'édifice à abside. Dim. : haut. max. : 0 m 125; larg. max. : 0 m 215; épais, max. : 0 m 22; modillon large : 0 m 12.
Marbre blanc à gros cristaux, aspect granuleux, friable.
Il appartenait très probablement à la même corniche que l'exemplaire précédent.
70 G. Ch. Picard, Fouilles à Carthage, dans RA, 1969, 1, p. 182-193.
71 Tout comme sur les fragments n° 10 (inv. 74.137), sur la corniche du portique des Petronii et sur un fragment de corniche du théâtre de Carthage (fig. 17).
176 BYRSA I
1 1 - Fragment de corniche d'angle
Inv. : 75. 54; prov. : C. V. 13/14, cardo, couche superficielle (aire C).
Dim. : haut. max. : 0 m 13; larg. max. : 0 m 31; prof, max. : 0 m 26.
Marbre blanc-grisâtre, gros cristaux.
Ce fragment conserve partie des deux moulures et du lit de pose de la corniche. Sur le kymation lesbi- que les fleurons des rais de cœur sont soulignés par de profonds sillons réalisés au trépan; les feuilles d'eau, présentes sur les exemples plus antiques de ce motif, ont ici disparu. On retrouve une facture et un dessin semblable sur une corniche du théâtre de Carthage (fig. 16), où apparaît par ailleurs un type d'acanthe apparenté à celui de nos Nos 8,9 et 10. Les denticules sont larges et libres.
On distingue, au niveau supérieur, le départ d'un ovolo.
12 - Base attique de colonne
Inv. : 75. 30; prov. : C. V. 10, réutilisée, renversée, comme revêtement du chemin de Douar Chott.
Dim. : larg. plinthe : 0 m 405 x m 405; haut, plinthe : 0 m 07 : haut, totale : 0 m 27; haut, tore inférieur : 0 m 05, scotie : 0 m 06, tore supérieur : 0 m 05; diam. au lit d'attente : 0 m 36.
Marbre gris, cristaux moyens. Sur une face la scotie et le tore inférieur sont creu
sés d'une cavité aux contours irréguliers (large 0 m 07 χ 0 m 06), en partie encore remplie de mortier, dans laquelle devait être encastré quelque élément.
Le rapport du simple au double qui, selon Vitruve (III, 4, 2-10), doit lier la hauteur de la base et le diamètre au lit d'attente, ne se retrouve absolument pas
ici. La répartition des moulures ne respecte pas plus les proportions traditionnelles. La scotie, très peu fouillée, se développe en hauteur; les tores se sont aplatis, et l'ensemble compose un profil lourd que l'on ne peut confronter qu'à des œuvres bien postérieures au IIe siècle.
Il est difficile de formuler des conclusions à une étude aussi réduite. Pourtant, les observations que nous avons pu faire au sujet de ce matériel présentent l'intérêt de concorder avec celles qu'inspire l'ensemble des éléments de décor d'architecture conservés à Carthage. Ainsi, dans la mesure où il a été possible de determiner l'ordre auquel appartenaient nos fragments, on note une nette prédominance du corinthien qui, en général, semble avoir été employé quasi à l'exclusion de tout autre. En ce qui concerne l'histoire de la ville on constate ici encore l'absence de témoignages intéressant les premiers temps de la colonie (rares dans l'ensemble de Carthage). Par contre l'époque des Antonins semble avoir connu une activité particulièrement importante, qui a du modifier profondément l'aspect de la ville. Au IIIe siècle cette activité se poursuit, mais on a l'impression d'être en présence de réalisations secondaires qui n'ont du modifier que superficiellement les programmes de grande envergure du siècle précédent.
Les informations concernant les siècles suivants sont difficiles à déchiffrer, et, de toute manière, exceptionnelles dans ce secteur. Il est d'ailleurs aisé de supposer que le développement des habitations tardives que nous avons observé sur le cardo, accompagne une modification de la fonction et de l'aspect de ce quartier à l'origine monumental.
F. V.
LE CARDO MAXIMUS (1974-1976) 181
fr* f. ì · ·. · ;·*
13 Thuburbo Majus, portique des Petronii.
14 Carthage, Musée. ^Λ^^: .1 -'/^-·_ ^. ·.'·:, ;>..'. V^_ .- · ' '.r^* '' ^tjSj'l/ ' "":··'-^';·,'
15 Carthage, Théâtre.
AVERTISSEMENT
Les résultats des travaux de la campagne de 1976 ne sont pas présentés, comme précédemment, selon un ordre topographique, mais en fonction des deux grandes séries de niveaux attestés sur la colline de Byrsa, les niveaux puniques et les niveaux romains.
Pour des raisons pratiques, cependant, l'équipe chargée des travaux sur les niveaux et structures puniques a limité ses investigations, en 1976, au cadre topographique du «secteur A». Cette équipe dirigée par le chef de mission comprend deux responsables de fouille, Serge Lan- cel et Jean-Paul Thuillier, assistés pour une partie de la campagne par Elisabeth Sauser-Engel et Philippe Vieulès. L'enregistrement du matériel issu de la fouille a été coordonné par Jean-Louis Tilhard.
Les travaux de l'équipe chargée de la fouille sur les niveaux et vestiges d'époque romaine ont été menés par Pierre Gros, co-directeur adjoint au chef de mission, responsable de cette équipe, et Jean Deneauve, sur divers points du site. Le compte rendu de ces travaux constitue la deuxième partie de ce rapport".
A partir du mois de juillet 1976, la mission de Carthage-Byrsa a bénéficié du concours de deux collaborateurs techniques recrutés sur des postes créés par le Ministère des Affaires Étrangères, Gérard Robine, architecte, et Philippe de Carbonnières, dessinateur-archéologue. G. Robine s'est consacré d'abord, et en même temps qu'aux travaux de consolidation les plus urgents, au levé topographique d'un plan et de coupes d'ensemble de la colline; les plans et coupes partiels qui illustrent le rapport 1976 sont établis d'après l'état actuel de ces travaux. Les dessins et profils d'objets sont de Ph. de Carbonnières, à qui ce travail est aussi redevable de certains relevés de détail.
S.L.
"' Jean Deneauve a préféré intégrer à son rapport des deux campagnes précédentes le compte rendu de la brève campagne de 1976, dont les résultats complètent, précisent et parfois rectifient les apports des années 1974 et 1975. On ne trouvera donc ci-dessous sous la rubrique Niveaux et vestiges romains que le rapport préliminaire présenté par P. Gros à l'issue d'une première prise de contact avec le terrain en octobre 1976.
/F \ Complement -. la ^[e ig _ octobre 1976 - 1/50° -(G fi dtv Λ
Fig. I - Plan du secteur A après la campagne de 1976 (relevé au I/10CK).
RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LA CAMPAGNE DE 1976
(NIVEAUX PUNIQUES)
par SERGE LANCEL ET JEAN-PAUL THUILLIER
Compte tenu des résultats obtenus lors des deux campagnes précédentes, les travaux de fouille sur les niveaux et structures puniques du secteur A ont été menés en fonction d'un double objectif : d'une part étudier l'organisation du quartier de maisons puniques dont la datation - tardive - est maintenant assurée, et en poursuivre le dégagement; d'autre part reconnaître et dater les niveaux antérieurs aux sols d'habitat jusqu'ici mis au jour. Accessoirement et chemin faisant, ont pu aussi être précisées la nature ou la fonction de quelques éléments de substruction d'époque romaine, ainsi que leur relation avec les vestiges préromains1.
1) Recherches sur les niveaux d'habitat.
A titre d'hypothèse provisoire, sur la base des constats de nos prédécesseurs, J. Ferron et M. Pinard, et du plan dressé par ce dernier (Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, pi. I), et compte tenu des rectifications et compléments à ce plan que nos propres travaux nous autorisent dès maintenant à faire, nous considérerons que dans le quartier de maisons puniques en cours de dégagement (fig. 1) peuvent être délimités au moins trois îlots : îlot A ou îlot nord, îlot Β ou
1 Ces constats ont été faits au cours de la campagne de l'été 1976. Depuis l'automne de la même année, la responsabilité des travaux sur les structures d'époque romaine a été laissée à l'équipe dirigée par P. Gros : on trouvera ci-dessous, p. 278-280, ses remarques complémentaires sur certaines structures de fondations romaines du secteur A.
îlot ouest, îlot C ou îlot nord-est (fig. 2). On sait qu'a déjà été reconnue une rue, séparant les îlots A et C : nous l'appellerons «rue I»; nous verrons plus loin qu'il est maintenant licite de reporter au moins partiellement le tracé d'une « rue II » entre les îlots Β et C. Quant aux divers pans de murs et structures diverses mises au jour en 1976 vers le sud-est - en F II 16 et G II 9 et 13, en H III 5 et en H II 14-H III 2 -, ils ne peuvent encore être intégrés dans des ensembles cohérents.
Nous distinguerons donc dans le présent rapport d'une part la présentation de la fouille menée par Jean-Paul Thuillier en extension des travaux anciens au nord-est de l'îlot C - cf. infra, p. 225-240 -, d'autre part diverses fouilles et sondages de reconnaissance topographique exécutés en différents points par le chef de mission.
1.1) Recherches sur les niveaux d'habitat punique en G IV 1-2, F IV 7-8, G III 7-11, H II 14- H III 2, H III 5 et G II 9-10-13-14 (rapport présenté par S. Lancel).
1.1.1) Recherches sur les niveaux des rues I et II et sur l'angle ouest de l'îlot C.
En G IV 1 et 2, la fouille menée dans l'angle sud-est des lourdes fondations de l'édifice romain tardif à plan basilical a eu pour objet de reconnaître la situation punique tardive au niveau de la rue I et de préciser l'angle ouest de l'îlot C, qui n'avait pas été dégagé par les fouilles antérieures (fig. 3).
188 BYRSA I
Fig. 2 - Plan schématique du quartier de maisons puniques après la campagne de 1976 (compléments graphiques S. Lancel sur fond de plan G. Robine).
En G IV 1, un premier sondage a été effectué dans l'angle interne de l'édifice tardif à plan basilical, et en sous-œuvre de cette fondation, à partir du niveau de sol actuel, à la cote 50,82. Les couches superficielles sont apparues bouleversées par des fouilles anciennes, remontant probablement aux travaux du P. Lapeyre en 1937-1938 - cf. supra, p. 26. Le tuf argileux natif (fig. 4, couche 2), en assez forte pente vers le sud-est, est découvert entre les cotes 49,40 et 49. Implanté dans ce sol naturel, un alignement
d'amphores se développe en bordure de la rue et parallèlement à l'axe des fondations du mur périmétral nord-ouest de l'îlot C (fig. 5 et 6). On notera toutefois que cet alignement d'amphores dressées verticalement déborde dans la rue II de plus d'1,50 m au-delà de l'angle de l'îlot C. Ce dispositif à double fonction, semble-t-il, d'assèchement et de retenue des terres avait donc été mis en place beaucoup plus pour parer au dévers nord-ouest-sud-est, très accentué (fig. 4) que pour pallier la déclivité nord-est-sud-ouest,
190 BYRSA I
RUE I Coupe NW.SE
4 5m Ph de C
Fig. 4 - Coupe de la rue I (relevé et mise au net Ph. de Carbonnières). Au centre, le caniveau maçonné découvert par la fouille Ferron-Pinard.
^--j^^r;/ ""^
t υ-Ό'-ΊΓ- , 1
Fig. 5 - Alignement d'amphores dans la rue I en G IV 1 (cl. S.L.).
Fig. 6 - Alignement d'amphores dans la rue I en G IV 1 (cl. S.L.).
Vue prise dans l'axe de la fondation du mur de l'îlot C, à 90° de la précédente.
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 191
beaucoup moins importante. Dans le même axe, la fouille de 1952-1 953 : avait déjà mis au jour, dans la môme position, des amphores de même type, c'est-à-dire à embouchure à large pavillon, de profil Cintas 312/313, datées, imprécisément, entre le IVe et le IIe siècles. En fait cet aménagement a dû se situer au plus tôt au début du IIe siècle, le terminus post c/iieni étant fourni par la céramique campanienne A (un bord de forme 25, un bord de forme 23) recueillie dans la couche de nivellement 1 (cf. fig. 4) au-dessus du sol naturel. Il est également clair que le soi naturel a été entaillé pour la mise en place de la fondation C et du mur - aujourd'hui disparu - qui la surmontait, préalablement à l'implantation de ces amphores (cf. fig. 4, à droite).
A l'extérieur de la substruction romaine d'époque tardive, en G IV 1-2, la fouille a en effet permis de retrouver en fondation le plan de l'angle nord-ouest de l'îlot C (cf. fig. 3), ainsi que de préciser dans ce secteur le plan inexact donné pour le « mur Lapeyre » et l'édifice à plan basilical par le P. Ferron et M. Pinard, suivis par A. Lézine\ Elle a également permis de retrouver la base d'une pile de fondation romaine constituée de gros blocs de calcaire blanc, dans l'alignement déjà matérialisé par les piles relevées en H III 10, H III 9, G III 16.
En complément de la recherche entreprise en G IV 1-2, un sondage a été effectué en F IV 7-8, c'est-à-dire à l'intersection de l'axe du mur péri- métral (ou long côté) sud-est de l'îlot A et de celui du mur périmétral nord-est de l'îlot Β (fig. 7). Ce sondage avait chance soit de faire connaître l'amorce d'un nouvel îlot se développent vers l'ouest - vers le secteur B, ou, si l'on préfère, vers la zone des anciennes fouilles Lapeyre -, soit de faire apparaître des structures manifestant une différence d'orientation en ce point dont on sait qu'il peut révéler une articula-
: Cf. Cahiers de Byrsa, V, 1955, pi. LXXXIX (ces amphores ne sont pas signalées dans le texte du rapport); sur la même rue, un autre épi constitué par un double alignement d'amphores de type Cintas 316 a été signalé par J. Ferron et M. Pinard (Cahiers de By ι sa, IX, 1960-1961, p. 95-96 et pi. XXXIX, 2); l'orientation (cf. ibid., plan, pi. 1) en apparaît différente.
' Cf. Cahiets de Byisa, V, 1955, pi. II; IX, 1960-1961, pi. I; A. Lézine, Caithage, U tique. Eludes d'architecture et d'uiba- nisme, Paris, 1968, p. 178.
tion entre deux paliers ou deux surfaces prismatiques (cf. supra, p. 95). La fouille menée là dans l'angle sud-ouest des substructions de l'édifice romain tardif, et pour partie en sous-œuvre de ces substructions, a mis en évidence une fosse de violation ou de fouille ancienne remblayée de terre noire contenant un matériel hétéroclite où un fragment de céramique vernissée verte d'époque médiévale musulmane et un tesson de lampe tardo-africaine («chrétienne») voisinent avec des tessons de campanienne A (fonds de patères, un bord de forme 55, un bord de forme 28). Cette fosse menait, au niveau 48,75, à une tombe du type des coffres bâtis sans fond, le sol naturel formant le fond, les parois étant faites d'orthostates de grès bien dressées recouvertes de dalles (fig. 8). Le bris en deux fragments de la dalle du centre, dont l'un était encore levé verticalement, l'absence de tout ossement et de tout matériel dans la tombe, hormis un morceau de bougie, témoignaient clairement d'une fouille peut-être clandestine, mais peut-être aussi faite dans le cadre des travaux menés dans ce secteur par le P. Lapeyre en 1937-1938, et comme on sait (cf. supra, p. 26) très sommairement signalés. A une hauteur de 1 m 1,10 m au-dessus du niveau des dalles, soit approximativement à la cote 49,75, on a pu recueillir dans les terres de comblement de la fosse de la tombe les fragments reconstituant presque en totalité une amphore (fig. 9 : dim. : haut. : 0,290) de profil Cintas 284, forme figurant déjà avec de menues variantes dans le mobilier de tombes fouillées par le P. Delattre et par Ch. Saumagne sur cette pente sud-ouest de la colline de Byrsa et datables entre le milieu du VIIe siècle et le début du VIe4. Et on se rappelle que les tombes fouillées approximativement à cet endroit par le P. Lapeyre ont été datées par lui du VIIe siècle : cf. supra, p. 26. Le type de la tombe s ne contredit pas à une telle datation.
4 Cf. A. L. Delattre, Caithage. Neci opale punique de la colline de Saint-Louis, Lvon, 1896, p. 32, fig. 9; Ch. Saumagne, dans BCTH, 1932-1933, p. 88, fig. 2, objet 6.
' Cf. P. Cintas, Manuel d'aicheologie punique, t. II, p. 270, fig. 22 et 23; rappelons que des tombes archaïques à auges sans fond, du même t\pe, ont été mises au jour et fouillées par le P. Delattre un peu plus a l'ouest (cf. stipi a, p. 20, tombes 18, 19,20).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 193
F. 17- 7 A-128
A — - -B
A-B
Fig. 8 - La tombe A. 128 en F IV 7 (rclc\é Ph. de Carbonnières).
1m
f/fP4 ΐξ*;< i^ix 'tf-^^>~¥y>
Fig. 9 - Amphore punique de la tombe A 128 (cl. S.L.).
La présence d'une tombe d'époque archaïque n'est pas pour surprendre en ce point au niveau profond. Mais, au niveau punique supérieur, on ne retrouve aucune trace des structures d'habitat recherchées et, par ailleurs, la dissipation du tissu archéologique en F IV 8 lors de la fouille ancienne de la tombe, ainsi que le bouleversement apporté en F IV 7 par la mise en place à basse époque romaine des lourdes fondations de l'édifice à plan basilical, qui s'enfoncent jusqu'à la cote 50,30/50,40, ne permettent plus de déceler en ce point d'éventuels niveaux de rue ou plans de circulation.
1.1.2) Recherches sur l'angle sud de l'îlot C (fouille en G III 7/11) et sondages profonds en aval - sud-est - de l'îlot C (sondages en H III 2 et H III 5).
1.1.2.1) En G III 7, 10 et 11, la fouille s'est d'abord donné pour objet de contrôler et vérifier la situation de l'habitat punique telle qu'elle avait été fixée par le plan publié par M. Pinard en 1960 (fig. 14, supra, p. 32). Ce plan faisait état d'un mur perpendiculaire au petit côté nord- ouest/sud-est de l'îlot C, débordant sensiblement dans la rue II, espace qui n'était pas alors perçu comme un plan de circulation. D'autre part, ce petit côté lui-même était représenté comme se prolongeant vers le sud-est au-delà de l'alignement de l'îlot B.
Un simple nettoyage du terrain le long du petit côté sud-ouest de l'îlot C suffit à rétablir le plan réel (fig. 10) et à manifester que le mur, comportant sur sa face externe un bel enduit hydrofuge, conforté en outre à sa base par un gros solin à profil en quart de cercle (fig. 11), est bien le mur périmétral de l'îlot, et que le plan de circulation de la rue II, qu'il longe, est bien exempt de constructions d'époque punique. Le gros bourrelet ou solin à la base du mur, en façade, devait avoir pour fonction d'assurer son étanchéité et de protéger le bas du mur des ruissellements qui devaient s'exercer avec violence dans cet axe en pente assez forte.
La fouille poursuivie intra nuiros dans l'angle sud de l'îlot C, en G III 7/11 (fig. 12) fait en effet apparaître une sensible différence de niveau avec les pièces jouxtant au nord-ouest, vers l'amont : le niveau de sol n'était pas atteint à la cote 47,83, alors qu'à angle ouest, à quelque 10 m
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 195
Fig. 11 - Le petit côté sud-ouest de l'îlot C vu de la rue II (cl. S.L.).
de distance, Yopus signinum de la pièce sise en G IV 2 se situe à la cote 48,95. Sur un mètre d'épaisseur, la couche de démolition comporte en abondance des débris architectoniques divers qui attestent la présence d'un étage : nombreux fragments de sols en lithostroton blanc, nombreux fragments de stucs architecturaux; on notera particulièrement6 un chapiteau d'ordre dorique sur demi-colonne à fût lisse (fig. 13); le cœur est en grès d'El Haouaria, revêtu d'une double couche de stuc : d'abord une couche d'apprêt d'une épaisseur de 15 à 20 mm, puis un épiderme fin et très homogène de 3 à
6 En attendant la solution technique de certains problèmes de protection, la fouille a été provisoirement suspendue en ce point. L'ensemble du matériel sera publié par la suite, après la reprise de la fouille.
5 mm. Dimensions : épaisseur de l'abaque : 54 mm; épaisseur de l'échiné : 60 mm; épaisseur du gorgerin (y compris les réglets) : 34 mm7. Pour nous limiter ici à la mention sommaire des éléments du matériel fournissant un terminus post queni, les couches de démolition analysées comportent en abondance de la céramique cam- panienne A, notamment des formes 28, 31, 34 et 55.
1.1.2.2) Sondages profonds en H III 2 et H III 5.
On sait qu'au cours des campagnes de 1974 et 1975 - cf. supra, p. 64-72 - plusieurs sondages
7 Sur d'autres chapiteaux d'ordre dorique déjà recueillis dans les couches de démolition de ce quartier, cf. Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, p. 88, n» 198, pi. XXIII-XXV, et p. 128, n° 316, pi. XLVII.
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 197
G III 11
10 cm
Fig. 13 - Chapiteau dorique en grès stuqué (dessin Ph. de Carbonnières).
avaient été entrepris à partir du niveau du petit plateau supérieur laissé par les fouilles de nos prédécesseurs. En dépit de descentes en niveau avoisinant 4 mètres, ces sondages n'avaient pas permis d'atteindre les sols puniques correspondant aux sols des parties basses des fouilles anciennes. En 1976, deux de ces sondages ont été partiellement approfondis, sur l'axe nord- ouest/sud-est, qui est celui de la plus grande pente. L'objectif était de reconnaître la possibilité d'une éventuelle poursuite de la fouille en profondeur, dans une zone où le remblai augus- téen à traverser risquait d'être d'une exceptionnelle épaisseur.
a) En H II 14/H III 2, l'élargissement du sondage pratiqué en 1974 et qui avait rencontré le comblement d'une ancienne fouille Lapeyre a permis tout d'abord de retrouver le « mur Lapeyre» tel qu'il avait été dégagé entre 1930 et 1934 (fig. 14).
Dans ce secteur, un léger tassement des terres le long d'une pile de fondation romaine à la suite des pluies de l'hiver 1975-1976 a
lisé l'emplacement d'un sondage profond remontant à l'époque qui vient d'être dite, et qui avait été rebouché. Le puits de sondage, d'une largeur d'1,50 m sur 2 m de longueur, dont les terres de remblaiement contenaient un matériel hérétoclite, et des rebuts modernes, aboutissait à la cote 46,17 sur une tête de mur en petit appareil de 0,45 m d'épaisseur; à la cote 45,41 apparaissait la tête d'un second mur parallèle au premier, en petits moellons et chaînages en grand appareil, d'une épaisseur de 0,50/51 m, séparé du précédent par un intervalle de 0,75 m. Les deux murs orientés semblablement reproduisent presque exactement l'orientation sud- ouest/ nord-est des structures puniques tardives des îlots A, Β et C (fig. 15 et 16). Le ressaut de fondation du second mur est bien visible à la côte 44,80, mais la fouille ancienne a surcreusé les niveaux, et le sol de ce qui devait être un couloir entre les deux murs a disparu8.
b) Pour apprécier la dénivellation à mi-distance des deux cotes connues, en choisissant aussi un point où l'on avait chance de reconnaître la situation en limite sud-est de la rue (non encore constatée) qui devait sans doute border en aval l'îlot C (cf. fig. 2), un autre sondage profond a été réalisé en H II 14/H III 5 (fig. 17 et 18).
A la cote de départ du sondage (49,70), la première couche traversée, 8, est une couche sablonneuse rapportée, pratiquement stérile (c'est la couche 5 de la fig. 15, supra, p. 73 qui reproduit avec une numérotation différente une situation pratiquement identique). Avec 9 commence une strate de démolition très riche en
8 La trouvaille de matériel aberrant (fragments de carreaux de terre cuite vernissée modernes, notamment) jusqu'au fond du sondage indique bien que la fouille Lapeyre a été approfondie jusqu'à ce niveau. Au demeurant, le P. Lapeyre signale dans son rapport sur sa fouille de 1930- 1934 que les puits de fondation romains peuvent atteindre jusqu'à 8 mètres de profondeur près de la villa Salammbô (Revue Africaine, 1934, p. 343) : il fait évidemment allusion, sans le signaler plus précisément, à ce sondage le long duquel la pile de fondation romaine, qui s'appuie sur un des murs puniques, a encore près de 7 mètres d'élévation, avec un niveau supérieur - actuellement à la cote 52,20 - écrété par rapport à ce qu'il était à l'époque du P. Lapeyre. On ne sait pourquoi ce dernier n'a pas signalé ces vestiges puniques profonds qu'il n'a pas pu ne pas voir au fond de son sondage.
198 BYRSA I
Fig. 14 - Le «mur Lapcyre» en H III 2 et 3; axe du clicîié : nord-est (cl. S.L.).
matériel, dans laquelle il n'a pas été possible, dans cet étroit sondage, de distinguer des couches différentes les unes des autres. Aussi bien, le matériel apparaît identique sur une épaisseur de plus de 2 mètres. On a distingué toutefois et analysé à part (lot A. 147) le matériel recueilli à partir d'un niveau un peu supérieur à celui du ressaut de fondation (cote 46,32 : cf. fig. 19). Au- dessus, outre de très nombreux fragments de sols qui témoignement de l'effondrement d'un étage - on signalera particulièrement une variété de litlwstroton soigneusement lissé (fig. 20) -, le matériel relevé dans l'épaisseur de la couche 9 présente le facies bien connu maintenant de \' iiistrwnentwn doineslicwn punique de la phase finale :
A.146.1 : écuelle-mortier en calcaire gris à grain fin (carrières du Djebel Djemaâ?); goulot de versement et trace d'une oreillette de préhension. Dim. : haut. : 79 mm; diam. max. : 237 mm. (fig. 21 et 22).
A. 146.3 et A. 146.6 à 25 : nombreux fragments de marmites et pots à feu, à pâte couleur brique et surface gris foncé sur les faces externes;
A. 146.27 à 33 : nombreux fragments de bords, notamment de jattes à marli plat (pour le profil, cf. infra, fig. 62, η" 83, 84, p. 219).
On notera plus particulièrement les éléments suivants : A.146.2 : décor d'applique, en forme de merlon à
gradins, du couvercle d'un grand vaisseau
200 BYRSA I
H II 14 ή πι r ΗΙΠ5 III 9
Η III H I
jllljlllllllllllllllllllllllllllllllllllllW
Remblai augusteen N\'yi^' /'^s ' ',</'''
; Δ' ι
55 ' 60 .
Fig. 1 6 - Coupe au 1/1 00° sur les niveaux puniques entre H III 2 et H III 13.
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 201
"j
7? -Î3 %fr ft* £&£·<->"' ',"
Fig. 17 - Le sondage profond en H III 5; le ressaut de fondation du mur à la cote 46, 32 (cl. S.L.).
fig. 23) (cf. déjà Cahiers de Dyrsa, V, 1955, n° 140, p. 73 et pi. LXXIII).
A. 146.4 : fragment de fond d'un gros vaisseau de profil conique (fig. 24); pâte ocre à fin dégraissant blanc; surface externe blanc rosé, portant en bas de la panse un repeint brun rouge : bande : 20 mm, filet : 4 mm; diam. du fond : circa 250 mm.
A. 146.5 : pied d'une grande coupe (fig. 25); pâte couleur rouge brique, surface blanchâtre; diam. du fond : 101 mm.
A. 146. 16 : peson en terre cuite; pâte marron; diam. : 59 mm; ép. : 12/13 mm; (fig. 26).
A.148.18 : petit balsamaire fusiforme; pâte et surface beige; dim. : hauteur résiduelle : 46 mm; diam. max. : 23 mm.
A. 146. 19 et 20 : deux balles de fronde en terre cuite; pâte verdâtre au cœur, blanchâtre en surface; dim. : long. 45/48 mm; larg. : 36/38 mm; ép. : 26/27 mm.
On notera en outre plusieurs fragments d'embouchures d'amphores de profil Cintas 312/313 (diam. emb. : 270/280 mm) et 315.
Céramique à vernis noir : quelques tessons amorphes de céramique attique finale et pré- campanienne, dont un fragment de fond de patere de forme 42 B. Campanienne A fréquente : 1 tesson de bord de forme 36 (diam. : circa 130 mm); un bord de forme 23 (diam. : circa 170 mm); un bord de forme 28 (diam. : circa 165 mm); deux bords de forme 55 (diam. : c. 220 et 250 mm). Nombreuses imitations de céramiques à vernis noir : à pâte gris foncé et vernis noir mat et mince, à face externe vernissée seulement en haut : plusieurs fragments de fonds de patères, un bord de forme 55 (A. 146.23 : diam. : circa 280 mm); à pâte gris moyen, feuilletée, à vernis noir clair, mat : un bord de forme 28 (A. 146.25); à pâte chamois beige et vernis brun noirâtre : un
1 ** '· Ν' , τ1 -, '
\ ^ . . . * ι ■ 49.70- ■ ^ .ν-·,· . » - - .-:. —, λ V **t %
*-».-< v Ν * :N
Fig. 18 - Le sondage profond en H III 5; le mur a et la stratigraphie (cl. S.L.).
202 BYRSA I
Fig. 19 - Le sondage profond en H III 5; en haut à droite, le «mur Lapejre» (M.L.) prenant appui sur les structures puniques; en bas, le ressaut de fondation et la citerne (c)
(cl. S.L.).
bord de forme 22 (A. 146.24 : diam. : 140 mm), un bord de forme 23 (A. 146.26 : diam. : 180 mm).
Le matériel du lot A. 147 n'est en fait que celui d'une couche théorique puisque l'approfondissement du sondage a révélé, avec la mise au jour du ressaut de fondation à la cote 46,32 (fig. 19), que les sols correspondants à ce mur avaient été détruits. Mais cette couche conserve sa valeur comme témoin de la strate basse de la couche de démolition : Céramiques à vernis noir (fig. 27) : A. 147.1 : fragment de fond de patere; pâte brun-
rouge, vernis noir luisant, bleuté; décor : une feuille dans un cercle de larges guillochures.
Fig. 20 - Lithostroton noir, ocre, vert et blanc (cl. S.L.).
\
\ X :fcS=fcP
'■1' ;>?/}:
*%
1 Fig. 21 - Mortier-écuelle en pierre calcaire (cl. S.L.).
Fig. 22 - Mortier-écuelle en pierre calcaire (cl. S.L.).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 203
"V *.'
i
: '. * 1
»Mt»
I
Fig. 23 - Decor d'applique du comerclo d'un gros \ aisseau en terre cuite (cl. S.L.).
Fig. 25 - Pied de coupe (cl. S.L.).
cFfcftFtFtP
Fig. 24 - Fond de \ase de profil tronconique (cl. S.L.).
Fig. 26 - Balsamaire miniaturise, peson et balles de fronde en terre cuite (cl. S.L.).
A. 147.2 : fragment de fond de patere ou de bol; pâte brun rouge, vernis noir mat écaillé; décor : quatre timbres rudimentaires (sortes de trous), dans un cercle de guillochures.
A. 147.3 : bord de forme 34; pâte ocre rouge, vernis noir luisant, bleuté; diam. bord : 65 mm.
A. 147.4 : bord de forme 28; pâte brun rouge, vernis noir luisant, bleuté; diam. bord : circa 180 mm.
204 BYRSA I
A 147
_\
Fig. 27 - Materiel de la couche A 147 (del Ph. de Carbonnières).
Autres céramiques à vernis noir ou tirant sur le noir :
A.147.5 : fond de patere; pâte gris-beige, vernis noirâtre mat sur la face interne, traces et coulures sur la face externe.
A. 147.6 : bord de forme 55; pâte gris-beige, dure, très cuite, vernis noir mat résistant (peut-être campanienne A?); diam. bord : 260/270 mm.
A. 147.7 : bord de bol à rebord biseauté vers l'intérieur; mêmes caractéristiques que le précédent; diam. bord : c. 200 mm.
A. 147.8 : bord de forme 34; pâte grise, vernis noirâtre à coulures; diam. bord : 70 mm.
Marmites et pots à feu (fig. 28) (pâte couleur brique, surface externe grise) :
A.147.9 : fragment de forme à marli plat; diam. : 340 mm.
A.147.10 : tesson de bord de marmite; diam. 230 mm.
A.147.11 : tesson de couvercle; diam. 220 mm.
Céramiques diverses et objets divers : A. 147. 12 : fragment d'embouchure de forme fe
rmée; pâte ocre clair, engobe brun-rouge. A. 147. 13 : bord de jatte ou de coupe à marli plat
et rebord à bourrelet; pâte ocre rose, surface blanchâtre.
A.147.14 : galet roulé. A. 147. 15 : deux gros fragments de terre cuite
grise au cœur, à gros dégraissant calcaire; ép. 30 à 35 mm; impressions digitées sur la surface externe (peut-être fragments de tabou- nas).
A. 147. 16 : fragment de charnière en os, noirci par le feu.
On remarque la cohérence chronologique de cette strate, dans le matériel de laquelle les éléments dateurs sont les tessons de campanienne A (A.147.1 à 4), qui ne permettent pas de remonter plus haut que les premières années du IIe siècle.
Fig. 28 - Materiel de la couche A 147 (del Ph. de Carbonnières).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 205
Les structures en place mises au jour au fond de ce sondage reproduisent, comme ci-dessus en H II 14/H III 2, l'orientation générale des structures puniques tardives déjà connues dans ce secteur. Le mur a (fig. 16 et 29) est flanqué d'un gros bourrelet ou solin en demi-ogive, 5, dont l'amorce seule a pu être constatée le long de la paroi nord du sondage. Mais c'est assez, si l'on se réfère à une structure identique déjà constatée flanquant en G III 10 le mur sur la rue II de l'îlot C (cf. fig. 11), pour suggérer que ce mur a contreforté par le solin s est vraisemblablement un mur en façade sur une rue d'axe nord- est/sud-ouest (fig. 16). Dans cette hypothèse, le niveau de cette rue se situerait à une cote sensiblement supérieure à celle (46,32) des sols - aujourd'hui disparus - correspondant aux murs mis au jour dans le présent sondage.
De même que ces sols ont été détruits, a disparu également la couverture en dalles de la citerne découverte au fond de ce sondage en
A 148 12
ί>:£~'^ΎΑ?>.<#&?ίέ·
14 bis
Fig. 30 - Matériel (A 148) de la citerne El (del Ph. de Carbonnières).
H III 59. Cette citerne - qu'on appellera E 1 - est orientée nord-ouest/sud-est dans son grand axe, et donc perpendiculairement à l'axe de la rue supposée. Sa margelle s'ouvre à 0,35 m en contrebas du ressaut de fondation du mur. De plan classique dans les maisons puniques tardives, en baignoire, ses dimensions (long. : 1,80 m; larg. : 1,10 m; prof. : 2,70 m) sont sensiblement plus modestes - largeur exceptée - que celles des citernes du même type. Elle contenait un abondant matériel. Céramiques à vernis noir (fig. 30) : A. 148.9 et 10 : fonds de patere de forme 42 B;
pâte beige rosé, vernis noir brillant, solide.
Fig. 29 - Le mura flanqué \ers la rue par le solin s (cl. S.L.).
4 II est \raisemblable que les dalles de cette citerne, entre autres, ont été remployéees dans le «mur Lapeyre» (ML sur la fig. 19), mur de soutènement romain qui coupe les vestiges puniques à cet endroit, et dont la base s'appuie sur eux.
206 BYRSA I
A 148 11
Fig. 31 - Matériel (A 148) de la citerne El {del Ph. de Carbonnières).
Α. 148. 11 : plusieurs fragments, dont un bord avec bec en mufle de lion, d'un guttus à vernis noir; carène marquée, forme cylindrique (fig. 31).
A.148.12 : trois fragments d'une patere à large marli; pâte chamois, un peu rosée, finement grenue, dure, bien cuite; vernis noir profond, faiblement luisant, solide. Il s'agit, semble-t-il, d'un produit local techniquement très réussi, traduisant dans la technique à vernis noir et à parois minces une forme de patere classique dans le répertoire céramique carthaginois.
A.148.13 : fragment de panse de céramique ampuritaine;
A. 148. 14 : forme 1 complète, à pâte grise et vernis brun noirâtre (on signalera un bord de forme 28 - 14 bis - de même matière et, pour les imitations à pâte et vernis gris foncé, trois bords de forme 28 et un fond de petite patere).
A. 148.42 : fond de patere de céramique campa- nienne A, à décor de feuilles, dans un cercle de guillochures.
A. 148.43 : fragment de bord de forme 27. On signalera plusieurs autres fragments de cam- panienne A : quatre bords de forme 28, trois bords et un fond de forme 31, deux bords de forme 55.
Ce sont ces derniers produits qui fournissent pour ces lots de matériel un terminus post quern dans la première moitié du IIe siècle.
On classera à part toute une série de formes miniaturisées, qui relèvent soit du répertoire des céramiques à vernis noir, soit du répertoire de la céramique domestique courante (fig. 32 et 33): A.148.1 : amphorisque (dim. : haut. : 135 mm,
diam. max. : 64 mm), pâte ocre rose, surface lissée ocre à coquille d'œuf (fig. 34).
A. 148.3 : Brasero miniature (dim. : haut. : 48 mm; diam. : 47 mm : fig. 35); ce petit objet dont le fond est percé de trois trous pour la ventilation et qui comporte trois saillies disposées en triangle comme grille de pose rappelle très exactement, à la dimension d'un jouet, un réchaud de même type en pierre volcanique trouvé dans la fouille du secteur Β en 1974 (cf. supra, p. 141).
A. 148.4 : petit pot; pâte chamois, vernis brunâtre écaillé.
A. 148.5 : forme 24 (diam. bord : 47 mm); pâte gris moyen, vernis gris-noir;
A 148
Fig. 32 - Materiel (A 148) de la citerne El (del Ph. de Carbonnières).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 207
Fig. 33 - Objets miniaturisés recueillis dans la fouille de la citerne El (cl. S.L.).
A.148.6 : forme 24 très fermée (encrier?); dim. : diam. max. : 66 mm; pâte grise; vernis noir mat.
A. 148.7 : forme 36 (diam. : 82 mm); pâte grise, vernis noir mat.
A. 148.8 : forme 55 (diam. : 50 mm); pâte gris clair, vernis noir mat.
A.148.15 : petit couvercle conique miniaturisé : diam. 40 mm.
Fig. 34 - Amphorisque (cl. S.L.).
A.148.3
Fig. 35 - Brasero miniature (cl. S.L.).
Céramique domestique commune (fig. 36) : Céramique punique achrome : A. 148.2 : forme complète de balsamaire (fig. 37);
pâte et surface chamois; haut. : 104 mm; diam. max. : 46 mm.
A.148.16 : col et embouchure trilobée d'une forme fermée de grandes dimensions; pâte brique, surface externe grisâtre.
A.148.17 et 18 : deux tessons de bord de jattes à large marli plat; pâte feuilletée verdâtre au cœur, blanchâtre en surface.
A.148.19 : tesson de bord de pot; pâte ocre feuilletée, grise au cœur, blanchâtre en surface.
A.148.20 : tesson de bord de bol; pâte feuilletée ocre, surface blanchâtre.
A. 148.21 et 22 : deux fragments (fig. 38) de grands bassins à bords formant bourrelets; pâte gris- verdâtre feuilletée et boursouflée, surface blanchâtre.
208 BYRSA I
20
Fig. 36 - Matériel (A 148) de la citerne El (del Ph. de Carbonnières).
Marmites et pots à feu (fig. 39) : A. 148.23, 24 et 25 : trois tessons de bords de marm
ites; pâte couleur brique, bien cuite, à fin dégraissant blanc, surface gris foncé sur la face externe;
A.148.26 et 27 : deux tessons de bords de plats allant au feu, à marli plat; même caractéristiques que précédemment.
A.148.28 : fragment de fond de marmite, carène accentuée; mêmes caractéristiques que précédemment;
A. 148.29 : grand fragment d'assiette (plutôt que couvercle); mêmes caractéristiques.
A.148.30 :forme complète d'assiette; diam. bord : 126 mm; haut. : 18 mm; mêmes caractéristiques.
A. 148.31 : fragment d'une assiette (ou d'un couvercle?); paroi côtelée extérieurement, bord s'épaississant en bourrelet;
A. 148.32 et 33 : deux formes complètes de couvercles (diam. : 96 et 72 mm); mêmes caractéristiques que précédemment.
Éléments divers d'instnimentum clomesticum : Débris de trois grandes amphores (trois fra
gments d'embouchures différentes conservées : diam. : circa 250/270 mm) de forme Cintas 312/313 : pâte rosâtre micacée, surface blanche ou blanchâtre; un couvercle d'amphore A. 148.33 bis; une amphore de forme Cintas 268, à pâte brune, noirâtre au cœur (haut, approx. : 0,45/0,50 m). A. 148.34, 35 et 36 (fig. 40) : fragments de pesons
en terre cuite noircis par le feu; pâte brique à gros dégraissant (inclusions de petits cailloux blancs); deux dimensions : 1) diam. : 60/65 mm; ép. : 15 mm : A.148.35 et 36; 2) diam. : 120/130 mm; ép. : 30 mm : A.148.34. On notera sur A.148.35 les deux incisions circulaires de part et d'autre du trou central.
A.148.37 : petite arida (?) en pierre; larg. : 75 mm; haut. : 80 mm (fig. 41).
A.148.38 : cinq chevilles de bronze (fig. 42); long, variant de 50 à 65 mm (objets de compa-
Fig. 37 - Balsamairc fusiforme (cl. S.L.).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 209
22
31
Fig. 38 - Matériel (A 148) de la citerne El (del Ph. de Carbonnières).
Fig. 39 - Matériel (A 148) de la citerne El (del Ph. de Carbonnières).
raison : Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, n» 533).
A.148.39 à 41 : trois petits éléments en os travaillé : A.148.39 : bâtonnet, long. : 41 mm; A.148.40 : bouton, diam. : 21 mm; A.148.41 : rondelle, diam. 26 mm. (cf. Cahiers de Byrsa, IX, n° 548 à 550) (fig. 43). Outre la richesse de son apport en matériel, le
principal intérêt de ce sondage, complétant celui fait précédemment en H II 14/H III 2, est de manifester des structures d'habitat punique tardif qui appartiennent vraisemblablement à un îlot distinct de l'îlot C, de l'autre côté d'une rue d'axe nord-est/sud-ouest dont le tracé ne peut encore être précisé.
Ces deux sondages font enfin apparaître l'importance de la dénivelée dans l'axe perpendiculaire à celui de la rue supposée, c'est-à-dire l'axe nord-ouest/sud-est, qui semble bien être la ligne de plus grande pente de la colline aux
temps puniques (cf. fig. 16). Sur cet axe, la pente moyenne, telle qu'elle peut être actuellement conjecturée par interpolation entre des points reconnus et cotés10, atteint une valeur supérieure à 15%. Les conditions du terrain étant telles, un des objectifs que la fouille des prochaines campagnes devra se fixer sera de déterminer quel parti a été adopté à la basse époque punique pour réaliser l'implantation orthogonale de ce quartier, qui semble cohérente, compte tenu de cette dénivelée. Par ailleurs, l'importance exceptionnelle des descentes en niveau que manifestent nos sondages à partir du sol actuel nous avertit que des choix stricts devront être faits en utilisant au mieux les approches strati-
10 Les profils représentés sur la coupe de la fig. 16 sont dans une certaine mesure hypothétiques, en particulier le profil des plans de circulation supposés en amont du solin S.
210 BYRSA I
Fig. 40 - Pesons de terre cuite (cl. S.L.). Fig. 43 - Objets en os (cl. S.L.).
;i :'■·■■· ,'■»■■■.,■
1
A.14Î.37
Fig. 41 - Arida (?) en pierre (cl. S.L.).
4 -,(
A.148.38
Fig. 42 - Chevilles en bronze (cl. S.L.).
graphiques déjà effectuées en 1974, et qu'une fouille topographique extensive est malheureusement pratiquement exclue dans un avenir immédiat.
1.1.3) Fouille en F II 16, G II 9, 10, 13 et 14.
A la limite de la brèche créée par les anciennes fouilles de Beulé parallèlement au palier inférieur du decumamis I sud d'époque impériale romaine, une fouille a été entreprise à partir du niveau - cote 47,10/47,20 - laissé par les fouilles du P. Ferron et de M. Pinard, dont cette zone marque également la limite vers le sud- est. L'affleurement de gros blocs de grès d'El Haouaria à cet emplacement, occupé jadis par une pile de fondation romaine détruite à la suite de la fouille de nos prédécesseurs, incitait à une reconnaissance qui avait chance d'être fructueuse, dans le même axe nord-est/sud-ouest que les structures déjà mises au jour dans le sondage profond effectué en H III 5 (fig. 44).
La fouille a d'abord abouti au dégagement, à la cote 46,34, (fig. 45, 46 et 47) d'un palier supérieur A, dont le sol est un opus signinum de type rudimentaire, très fragile, fait d'un semis de fragments de terre cuite ocre et verdâtre dans une jetée de béton à forte teneur en chaux. Un bronze de Ptolémée II Evergète (271-246) a été recueilli sous ce sol, en limite de fouille : mais la date de ce pavement est certainement postérieure au terminus suggéré par cette monnaie, comme l'indiquent au demeurant quelques tessons amorphes de céramique campanienne A
212 BYRSA I
G II 9-14
4m
4634
G II 13
Fig. 45 - Secteur G II 9/13 : coupe α-β et γ-δ (relevé Ph. de Carbonnières).
G II 9.13
-Ç
Fig. 46 - Secteur G II 9/13 : coupe ε-ζ (relevé Ph. de Carbonnières).
Fig. 47 - Le palier supérieur en F II 16-G II 13 (cl. S.L.).
recueillis également en ce point. Ce sol est lié en effet aux structures des murs a et b, l'un et l'autre d'une largeur de 0,50/52 m, faits avec des remplois de matériaux caractéristiques des constructions puniques tardives : on remarquera notamment le bloc en grand appareil de grès mouluré et stuqué qui constitue la partie supérieure du chaînage central du mur b : cf. la coupe α-β, fig. 45. Il y a donc lieu de considérer comme tardif - première moitié du IIe siècle - cet aménagement dont on ne peut connaître la suite vers le sud et le sud-ouest, coupée qu'elle a été par la tranchée des fouilles Beulé au siècle dernier.
Au niveau inférieur, vers l'est, se développe une pièce B, dont seul un angle sur quatre a été reconnu, séparée d'une autre pièce C par un mur c, d'une largeur de 0,51/52 m, très déversé dans le sens de la pente. La fouille de cette pièce C a été limitée à un étroit espace pour laisser vers l'aval un talus suffisant pour contenir ces structures très ruinées et difficiles à consolider (fig. 44, 45, 46 et 48). Le sol de ces deux pièces est un opus signinum de type simple, sans inclusion de marbre, fait d'éclats de céramique ocre et verdâtre noyés dans un béton blanchâtre à forte teneur en chaux. Le revêtement de sol de la pièce B se prolonge le long des murs b et c par un enduit de même nature, à composants plus fins et monochromes (éclats beige et ocre, exclusivement).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 213
On remarquera les deux trous de boulin (fig. 46 = coupe ε-ζ, et 48) dans le bloc qui forme le haut du chaînage en grand appareil du mur b, qui limite cette pièce au sud-ouest. Le bas de ces deux encoches qui recevaient des poutres est à la cote 46,70, alors que le sol correspondant est à la cote 44,95 : cette hauteur sous plafond d'1,75 m suggère que la pièce B - sinon les deux pièces B et C- était une pièce de service, plutôt qu'une pièce d'habitation. De fait, le catillus en pierre volcanique d'un moulin à grain est apparu partiellement au cours de la fouille, au niveau du sol; engagé sous l'amoncellement des blocs en grand appareil de grès qui se sont effondrés dans toute la partie nord de la pièce, il n'a pu encore être dégagé. Une utilisation de service pour ce local est encore suggérée par plusieurs trouvailles dans la couche de décombres immédiatement supérieure au sol de B : cf. infra les enclumes en pierre dure A.151.5 et 6, le petit pilon A.151.2, les amphores A.151.32, 33, 34, l'abondance enfin des marmites et pots à feu.
Sur une épaisseur d'environ deux mètres, qui correspond donc à peu près à la hauteur de ce niveau bas de la maison, le matériel est particulièrement abondant. Céramique figurée : A.150.1 : élément avec saillie de préhension d'un
brasero à décor figuré : plan de pose interne constitué par un mufle de vache (fig. 49), lion
::.■■:'.'■>/.-.■.
Fig. 48 - Le niveau inférieur : pièces B et C (cl. S.L.).
' ' ,r v"
·-." -■>·'-'■)
Fig. 49 - Saillie de préhension et plan de pose de brasero (face interne) (cl. S.L.).
stylisé sur la face externe; pâte ocre, feuilletée, à gros dégraissant gris, surface lissée non vernissée, ocre jaune (élément semblable dans Cahiers de Byrsa, V, 1955, n° 144 et à Motyé : cf. en dernier lieu A.-M. Bisi, dans Sicilia Archeologica, 2, 1968, p. 40 et fig. 16 et 17).
A. 150.2 : figurine de terre cuite (pâte ocre à dégraissant siliceux, surface ocre sans trace de peinture ni vernis) représentant un personnage féminin (prêtresse?) tenant une œnochoé dans la main droite, une guirlande dans la main gauche; haut. : 141 mm (fig. 50).
A. 150.3 : fragment d'une grande terre cuite (pâte ocre, surface beige rosé sans trace de vernis ni peinture) : main gauche tenant un objet arrondi; haut. : 60 mm (fig. 51).
Céramiques à vernis noir : Céramique atîique et précampanienne : A. 150.21 : fond de patere, de forme 22, estampillé.
A. 150.22 : forme 24, diam. : 80 mm. A. 150.23 : bord de forme 23 à rebord faiblement
plongeant.
214 BYRSA I
Î
A. 150.2 Fig. 50 - Terre cuite figurée : prêtresse? (cl. S.L.).
A. 150.24 : tesson de panse de forme fermée. A. 150.25 : bord à vernis rouge. A. 150.28 : fragment de lampe tournée, type
Howland 25 (?). A. 150.29 : fragment de lampe tournée, type
Howland 46 c.
Produits divers à vernis noir : A.150.26 : tesson de céramique ampuritaine
grise. A. 150.27 : tesson de céramique godronnée. A. 150.4 : (fig. 52) fragment de bord d'une forme
de jatte (diam. du bord : circa 160 mm) à marli plat; pâte brune, dure, très cuite, vernis noir mat sur la face externe; décor incisé sur la face externe.
Céramique campanienne A (30 à 34 : fonds; 35 à 45 : bords) (fig. 55 et 56) :
A. 150.30 : fond de patere (f. 27 ou 55), pâte brun- rouge clair, vernis noir luisant, bleuté; estampille : feuilles dans un cercle de guillochures.
A 150
Fig. 51 - Fragment de terre cuite figurée (cl. S.L.). Fig. 52 - Matériel A. 150 (del. Ph. de C).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 215
A 150 92
0
Fig. 53 - Estampille sur anse d'amphore rhodienne (del. Ph. de Carbonnières).
IE 'U '
":Mi:':''
■ / .,
Se L-
© -■■•.-4— μ
' · -. ■ i , Κ.
4=i-t= Fig. 54 - Coinercle d'amphore (cl. S.L.).
Α. 150.31 : fond de patere; mêmes caractéristiques que le précédent; estampille : feuilles dans un cercle de larges guillochures.
A. 150.32 : fond de patere ou de plat; pâte brun rouge clair, vernis noir mat écaillé; trace d'une feuille, pas de guillochures.
A. 150.33 : fond de bol (f. 27 ou 31) pâte ocre tirant sur le brun vernis noir mat; rosette centrale dans un cercle d'empilement brun rouge; graffite : A, incisé sur fond externe.
A. 150.34 : fond de patere; pâte brun rouge clair; vernis noir luisant, bleuté; coulures sur le fond externe.
A. 150.35 : bord de forme 36; pâte ocre, vernis noir mat.
A. 150.36 : bord de forme 36; pâte ocre, vernis noir luisant, bleuté.
A. 150.37 : bord de forme 28; pâte ocre, vernis noir luisant, bleuté; diam. bord : c. 210 mm.
A. 150.38 : bord de forme 28; comme le précédent, vernis noir plus mat; diam. bord : c. 220 mm.
A. 150.39 : bord de forme 28; pâte marron, vernis noir luisant, bleuté; diam. bord : c. 230 mm.
A. 150.40 : bord de forme 28; comme précédent; diam. bord : 150 mm.
A. 150.41 : bord de forme 28; vernis noir mat; diam. bord : 160 mm.
30
32 33
35
0 5
Fig. 55 - Matériel A. 150 (del. Ph. de C).
216 BYRSA I
37 A 150
43 A 150
44 45
0 5 Fig. 56 - Matériel A. 150 (del. Ph. de C).
A. 150.42 : bord de forme 27; pâte ocre, vernis noir luisant bleuté; diam. bord : 150 mm.
A. 150.43 : bord de forme 55; pâte marron, vernis noir bleuté; diam. bord : 260/270 mm.
A. 150.44 : bord de forme 55; pâte marron, vernis noir mat; diam. bord : 230/240 mm.
A. 150.45 : bord de forme 55; mêmes caractéristiques que précédent; diam. bord : 240/250 mm.
Ce sont évidemment ces produits qui fournissent le terminus post quem attendu de cette couche, dans la première moitié du IIe siècle. Dans les formes sûrement identifiables, on constatera la prédominance des formes 28 et 55. Imitations diverses de céramiques à vernis noir (fig. 57 et 58) :
Ces produits présentent en général une pâte soit très dure, gris foncé, un peu feuilletée, soit gris-chamois ou encore ocre clair, la différence de couleur pouvant tenir au degré de cuisson ou à sa nature plus ou moins réductrice. A. 150.46 : forme 22; pâte chamois, vernis noirâtre à coulures; diam. bord : 110 mm.
A. 150.47 : forme 22; pâte chamois, bande d'empilement sous le rebord; diam. bord : 140/150 mm.
49 50
51
0 5 Fig. 57 - Matériel A. 150 {del. Ph. de C).
A 150
S, 56 57
0 5
Fig. 58.
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 217
A. 150. 48 : forme 22; comme précédent; diam. bord : 120/130 mm.
A. 150.49 : bord de forme 23; pâte gris foncé, vernis noirâtre très écaillé; diam. 180/190 mm.
A. 150.50 : bord de forme 23; mêmes caractéristiques; diam. 200/210 mm.
A. 150.51 : forme 22; pâte grise à fin dégraissant siliceux, vernis noir à coulures; diam. bord : 105 mm.
A.150.52 : bord de forme 24; pâte chamois, vernis noirâtre à coulures; diam. bord : 80 mm.
A. 150.53 : forme 21/25; pâte grise, vernis noirâtre à coulures; diam. bord : 90 mm.
A. 150.54 : bord de forme 22; pâte gris foncé, vernis noir mat, résistant et régulier sur la face interne; diam. bord : 160/170 mm.
A. 150.55 : forme 28; pâte grise, traces de vernis noirâtre; diam. bord : 145 mm.
A. 150.56 : forme 34; pâte gris foncé, vernis noirâtre à coulures; diam. bord : 75/80 mm.
A. 150.57 : bord de forme 36; pâte gris foncé, vernis noir mat régulier et solide; diam. bord : 260/270 mm.
On notera la prédominance des formes de bol 22.
Céramique domestique commune :
Amphores (fig. 59, 60, 61, 62) :
A. 150.66 à 72 : profils d'embouchures de type Cintas 312/313; pâte ocre rose clair à rouge brique, feuilletée, dure, très cuite, à dégraissant siliceux; surface ocre rose à blanchâtre selon le degré de cuisson, parfois grise; diam. du pavillon de l'embouchure variant entre 280 et 310 mm.
A. 150.73 à 77 : variantes du même type, à rebord simple, et ressaut sous le rebord; mêmes pâtes, mêmes surfaces; diam. emb. entre 160 et 210 mm.
A. 150.78 à 80 : variantes du même type, à ressaut situé plus près du bord; diam. variant entre 190 et 210 mm.
A. 150.81 et 82 : embouchures d'amphores de profil Cintas 315; pâte rouge brique, surface rose; diam. emb. : 100 mm.
A. 150.87 : bord d'amphore carénée en haut de la panse : profil Cintas 301/309; rebord à ourlet extérieur; pâte ocre rose dure, homogène, surface de même couleur; diam. emb. : c. 80 mm.
78
A. 150.92 : (fig. 53) fragment d'embouchure et d'anse d'amphore rhodienne; estampille sur trois lignes dans un cartouche rectangulaire de 17 x43 mm :
Έπί Άθανο/δότου/ΎοοανίΚου Avec des noms de mois différents, plusieurs marques portant le nom de cet éponyme qui se situe dans les années 220-180 ont déjà été trouvées à Carthage : cf. Cahiers de Byrsa, IX, 1960-1961, p. 100, n° 230.
A.150.93 : tesson d'embouchure d'amphore rhodienne; diam. : 130 mm.
A. 150.94 : fragment de bord d'amphore de type Dressel 1 (?); diam. emb. : 150/160 mm; pâte ocre, finement grenue, micacée; surface lissée chamois-beige.
Couvercles d'ampiiores : 2 types constatés : 1. Profil en chapeau conique
aplati, diam. variant entre 95 et 113 mm : A.150.6 (fig. 54) : diam. 98 mm. 2. Profil en forme de toupie, plus rare : A. 150.7 : diam. 85 mm, haut. 53 mm (fig. 52).
218 BYRSA I
Céramique punique achrome : A.150.8 : pied de grande coupe (diam. : 102 mm)
(fig. 52); pâte couleur brique clair, surface blanchâtre.
A.150.9 : pied de coupe (diam. : 86 mm : fig. 52); pâte chamois, traces de vernis noirâtre.
A.150.10 : fragment de haut de kernos : col central et attache de quatre godets; pâte et surface chamois (fig. 64).
A. 150.5 : balsamaire fusiforme; pâte ocre rose, surface blanc grisâtre; haut. : 101 mm; diam. max. : 45 mm (fig. 65); 4 fragments appartenant à des objets différents de même type.
A. 150. 15 : fragment de fond de forme fermée faisant angle aigu avec la panse (forme tronconi- que : cf. A. 146.4); pâte brunâtre très cuite, surface enfumée noirâtre à l'extérieur et à l'intérieur; diam. fond : circa 170 mm (fig. 63).
A 150
87
91
Fig. 61.
A.150.17 : fragment de bord de grand bassin; pâte feuilletée, dure, bien cuite, ocre, à gros dégraissant siliceux, surface lissée de même couleur.
A. 150. 18 : fragment de bord de grand bassin à large rebord plat, de forme carrée ou rectangulaire; pâte ocre rose à marron clair, dure, très cuite, grenue, parfois feuilletée; surface externe et interne blanc verdâtre.
A. 150. 19 : tesson de fond de labrum, pâte feuilletée ocre rose, dure, très cuite, surface blanc verdâtre.
A. 150.20 : grand fragment d'une tabouna portant de grosses encoches digitées sur la face externe; rebord de 6 cm; très grand rayon de courbure; pâte ocre feuilletée comportant de nombreuses impuretés, surface ocre (fig. 66).
A. 150. 16 : deux fragments d'un grand plat (diam. bord : 420/430 mm; diam. fond : 140 mm); pâte ocre rose à brun, grenue, parfois feuilletée, à dégraissant siliceux blanc;
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 219
Fig. 62.
16
surface rose à blanchâtre; large marli plat s'inclinant vers le bas.
A.150.83 à 85 : variantes de la forme précédente; pâte rosée au cœur, blanc verdâtre en surface, marli plus plat, avec des arêtes vives; diam. du bord variant entre circa 320 et 430 mm.
A.150.86 : bord de jatte ou de bassin (diam. bord : 320/330 mm) pâte ocre feuilletée, grise au cœur, ocre en surface; large (35 mm) marli plat portant trois sillons inégaux.
A. 150.89 : bord de grande jatte (diam. : circa 450 mm); pâte ocre rose clair, grenue, surface blanchâtre.
Mannites et pots allant an feu (pâte couleur brique, dure, très cuite, surface externe gris à gris foncé) :
A. 150.58, 59, 60 : trois bords de plats différents à même profil à large marli plat; diam. variant de 360 à 395 mm.
A.150.61, 62 et 63 : trois bords de marmites à panse arrondie et rebord rentrant avec large plan de pose; diam. variant entre 210 et 240 mm.
18 A 150
0 10
Fig. 63.
220 BYRSA I
«T~ * / * V. \ °
g-ΐ Fig. 64 - Element d'un kernos (cl. S.L.).
Fig. 65 - Balsamairc fusiforme (cl. S.L.).
A.150.64 : fragment d'assiette (ou de couvercle?); diam. : c. 180 mm.
Instrwnentwn domestiewn divers :
A. 150. 11 : masse de plomb en forme de tronc de pyramide; larg. des côtés de la base : 40 mm; haut. : 23 mm; poids : 376 gr. (fig. 67).
La couche d'une quinzaine de centimètres immédiatement supérieure aux sols des pièces Β et C tranche sur la masse de l'épaisse strate de décombres analysée ci-dessus par la couleur grise, parfois même franchement noire, que lui donnent les nombreuses particules de charbon qui lui sont incorporées, et qui ont aussi noirci les sols. Le matériel recueilli dans cette couche est analysé à part, ci-dessous :
Céramiques à vernis noir (fig. 68) :
A. 15 1.7 : fond de patere de forme 22; pâte beige rosé, fine, bien épurée, vernis noir un peu bleuté, luisant; palmettes dans quatre cercles de guillochures; graffite en forme d'ancre, incisé sur le fond externe; diam. ext. du pied : 100/110 mm.
A.151.8 : fond de patere; pâte marron ocre clair, grenue; vernis noir faiblement luisant, écaillé; décor : quatre feuilles dans un triple cercle de guillochures; diam. pied : 80 mm.
A. 15 1.9 : fond de forme fermée; pâte marron ocre clair, vernis noir mat;
A. 15 1.10 (fig. 69) : bord de forme 36; pâte marron clair; vernis noir bleuté, très luisant; diam. du bord : 250/260 mm.
A.151.11 : bord de forme 36; pâte ocre clair, vernis noir faiblement luisant; diam. du bord : 120/130 mm.
A. 15 1.1 2 : bord de forme 55; pâte ocre clair, vernis noir luisant à reflets bleutés; diam. du bord : 210/220 mm.
A.151.13 : bord de forme 55; comme précédent; diam. du bord : 250/260 mm.
Les fragments A.151.8 à 13, auxquels s'ajoutent plusieurs tessons amorphes de campanienne A, la plupart du temps à reflets bleutés, sont év
idemment l'élément dateur de la couche, ainsi qu'une monnaie de bronze du monnayage de Carthage (cf. J. K. Jenkins, S.N.G., type 409-413), datable dans la première moitié du IIe siècle.
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 221
A-150-20
5 cm
Fig. 66 — Partie supérieure et rebord d'une tabouna en terre cuite (cl. S.L.).
Imitations diverses de céramiques à vernis noir (fig. 69) :
A. 15 1.14 : forme 23 complète, miniaturisée : diam. : 78 mm; pâte gris moyen, feuilletée; vernis gris foncé.
A. 15 1.1 5 : bord de forme 34; mêmes caractéristiques que le précédent; diam. du bord : 80/90 mm.
A. 15 1.1 6 : bord de forme 55; pâte grise, très dure, bien cuite, vernis noir à légers reflets bleutés; diam. du bord : 280/290 mm.
A. 15 1.1 7 : bord de forme 55; comme le précédent; diam. bord : 190/200 mm.
A. 15 1.1 8 : bord de forme 28; pâte gris moyen, feuilletée, vernis gris foncé; diam. bord : 160 mm.
A. 15 1.19 : fond de patere; pâte beige, grenue, dure, très cuite; vernis noirâtre seulement sur le fond interne.
A. 15 1.20 : bord de forme 22; pâte beige, vernis noir mat; bande d'empilement de 23 mm sous le rebord; diam. bord : 150/160 mm.
A. 150.11
Fig. 67 - Masse en plomb (cl. S.L.).
222 BYRSA I
A 151 7 '«s.
f C
ζ
A 151 8
Fig. 68 - Matériel (A 151) recueilli au niveau des sols des pièces Β et C en G II 9/13 (del Ph. de Carbonnières).
A 151
14 15
10
On classera à part A. 15 1.1 6 et 17, dont la qualité technique tranche sur les autres produits d'imitations locales de céramiques à vernis noir importés, et rappelle le produit analysé plus haut A.148.12. Céramique domestique commune : Amphores (fig. 70) : A. 15 1.32 : embouchure complète d'amphore de
profil Cintas 312/313; pâte couleur brique, surface blanchâtre, rebord arrondi simple; diam. : 216 mm.
A. 15 1.33 : variante du même type, mêmes caractéristiques; diam. : 210 mm.
A. 15 1.34 : variante du même type; surface ocre; listel soulignant le bord plus marqué que sur 32; diam. : 200 mm.
A.151.35 (fig. 71) : fragment d'embouchure d'amphore gréco-italique; pâte ocre, finement épurée, dure, à fin dégraissant micacé; diam. emb. : 150 mm.
A 151
33
Fig. 69 - Materiel (A 151) recueilli au niveau des sols des pièces Β et C en G II 9/13 (del Ph. de Carbonnières).
0 10cm Fig. 70 - Materiel (A 151) recueilli au niveau des sols des
pièces Β et C en G II 9/13 (del Ph. de Carbonnières).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 223
Céramique punique achrome (fig. 71) :
A.151.22 à 25 : bords de grands plats à marli plat et rebord plongeant; caractéristiques communes : pâte feuilletée, parfois boursouflée, rose à gris verdâtre au cœur, blanchâtre ou blanc verdâtre en surface; diam. du bord variant de 320/330 mm (A.151.23) à 380/390 mm (A.151.22).
A.151.26 : bord de jatte; pâte gris verdâtre, surface blanchâtre, petit bourrelet extérieur; diam. bord : 100/110 mm.
A. 15 1.27 : bord de jatte à plan de pose interne, en céramique modelée; pâte rosâtre à gros dégraissant siliceux, surface lissée beige; diam. bord : 210/220 mm.
Marmites et pots allant au feu (fig. 72) :
A. 15 1.1 : forme complète, miniaturisée, de petite marmite à anses appliquées; diam. du bord : 57 mm; haut. : 46 mm.
A 151
Fig. 72 - Matériel (A 151) recueilli au niveau des sols des pièces Β et C en G II 9/13 (del Ph. de Carbonnières).
Fig. 71 - Matériel (A 151) recueilli au nheau des sols des pièces Β et C en G II 9/13 (ciel Ph. de Carbonnières).
A. 15 1.36 : forme complète d'un plat à fond bombé; diam. bord : 170 mm; haut. : 35/40 mm.
A.151.37 : même profil que le précédent; diam. bord : 310 mm.
A. 15 1.38 : même profil, marli plus large; diam. bord : 380 mm.
A. 15 1.39 : forme de marmite (même type que A. 15 1.1) à panse arrondie et rebord rentrant avec plan de pose pour couvercle; diam. bord : 160 mm.
A. 151. 40 : même profil que précédent; diam. bord : 75/80 mm.
A. 15 1.41 : même profil que précédent, mais avec dessin différent du rebord, moins haut; diam. bord : 120 mm.
Instrwnentwn domesticum divers :
A. 151.2 : petit pilon de marbre blanc; haut. : 58 mm; larg. de la base : 45 mm (fig. 73).
224 BYRSA I
A 151 2
A 151. 3
— c
0 5 Ph de C
Fig. 73 - Materiel (A 151) recueilli au niveau des sols des pièces Β et C en G II 9/13 (del Ph. de Carbonnières).
A.151.3, a, b, c, d, e, f : éléments de charnières, manches et viroles en os.
A. 15 1.4 : 5 perles en pâte de verre bleue, jaune et verte; diam. de 7 à 10 mm (fig. 74).
A. 151.5 : enclume parallélépipédique en calcaire dur, gris, parfois légèrement rosé (carrières du Djebel Djemaâ?); dim. : 192x132x120 mm (fig. 75); traces de martelage visibles sur un petit côté.
A. 151. 6 : enclume de même type; dim. : 145x125x110 mm.
A. 15 1.38-31 : quatre pesons en terre cuite, dont deux formes complètes; diam. variant de 66 à 71 mm; ép. variant entre 16 et 21 mm (A.151.29 : cf. fig. 71).
A. 15 1.43 : objet de fer très oxydé, peut-être un petit ciseau à bois ou un burin; long, résiduelle : 110 mm; diam. de la tête : 32 mm (fig. 76).
©)
S-E Fig. 74 - Perles en pâte de verre (cl. S.L.).
A.151.44 : clous en fer à tête ronde; diam. de la tête : 15 mm; long, résiduelle ; 80/90 mm (fig. 77).
A.151.46 : clou en fer à tête ronde; diam. de la tête : 18 mm; long. : 140 mm (fig. 78).
On se limitera à quelques conclusions provisoires sur cette fouille qui doit être poursuivie, après dépose de l'amoncellement de gros blocs résultant de l'écroulement du niveau supérieur à
V — . ' " ''if i
*- ■■»„Vil"—
^
Fig. 75 - Enclume en pierre calcaire trouvée au niveau du sol de la pièce Β (cl. S.L.).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 225
ca O3 ca " ca.
Fig. 76 - Objets en fer recueillis au niveau du sol de la pièce Β (cl. S.L.).
Fig. 77 - Objets en fer recueillis au niveau du sol de la pièce Β (cl. S.L.).
ί . . . . Fig. 78 - Objets en fer recueillis au niveau du sol de la
pièce Β (cl. S.L.).
celui des pièces C et ß. Remarquons tout d'abord que les structures nouvellement dégagées s'inscrivent dans l'alignement des murs puniques tardifs mis au jour dans les sondages profonds réalisés en H III 2 et H III 5. Ces murs et ces sols, évidemment indépendants de l'îlot B, séparé d'eux par la chaussée d'une rue (cf. infra, p. 254), peuvent éventuellement jalonner un nouvel îlot également indépendant des vestiges manifestés par les sondages profonds, si la rue II se prolonge vers le sud-est au-delà du secteur où elle a été sûrement reconnue, c'est-à-dire au-delà de l'alignement des îlots Β et C. Il apparaît donc qu'une des clefs de la compréhension de l'économie du quartier et de la connaissance de la chronologie de son développement doit être recherchée par l'extension de la fouille en profondeur dans les carrés G II 13 et 14, G III 1, 2, 3, 4 et 7, au cours des prochaines campagnes.
S. L.
1.2) Fouilles amis le secteur nord-est de l'îlot C (en H IV 3, 4, 7 et 8) (rapport présenté par J.-P. Thuillier).
Au cours de la campagne de 1976, afin de mieux comprendre l'organisation du quartier de maisons puniques, la fouille a été étendue vers le nord-est, dans le prolongement des anciennes fouilles Ferron-Pinard (carrés H IV 3-4-7-8). De cet îlot C, dans lequel trois «maisons» semblaient déjà pouvoir être identifiées, on ne connaît encore que deux limites, celles du nord- ouest et du sud-ouest. Au nord-ouest, la réalité de la rue I, identifiée par les fouilleurs précédents", a été vérifiée par deux sondages qui ont confirmé l'absence de toute construction (en C IV 12) et surtout révélé la présence d'un nouvel « épi » d'amphores, remarquablement conservé, dans l'angle sud de l'édifice tardif à plan basilical (G IV 1) cf. supra, p. 190.
Au sud-ouest, une seconde voie de passage (rue II), large de plus de 7m, en terre battue comme la précédente, sépare les îlots Β et C12.
11 J. Ferron, M. Pinard, Cahiers de Byrsa, IX, 1960-61, p. 95. 12 La présence d'un épais solin sur le mur en G III 10
n'empêche pas, bien au contraire, de croire ici à la présence d'une rue; les problèmes d'humidité et de ruissellement des
226 BYRSA I
Les deux autres rues limitant Γ« insula» C n'ont pu être atteintes : au nord-est, une nouvelle unité d'habitation a été en partie dégagée, que laissaient d'ailleurs supposer des vestiges de murs déjà mis au jour; mais au sud-est, si les conditions du terrain n'ont pas permis de la retrouver encore, la situation d'une nouvelle rue peut être restituée avec assez de vraisemblance (fig. 79).
Cependant, le point le plus intéressant, lié d'ailleurs à cette question, est que, pour la première fois sur la colline de Byrsa, on peut parler avec sûreté d'un plan élaboré de maison. Jusqu'à présent, comme le faisaient remarquer J. Ferron et M. Pinard, il était d'abord presque impossible « d'assigner à chaque maison son contour exact»13. Et dans le meilleur des cas, pour l'îlot B, où les murs sont particulièrement bien appareillés, G. Charles-Picard pouvait seulement parler d'une «pièce principale et d'un petit vestibule» sans pouvoir mieux préciser les choses14. D'où la conclusion du même auteur, dans sa Vie quotidienne, à un moment où, il est vrai, seule une infime partie du quartier punique était dégagée : «Les maisons de Byrsa ont un plan fort simple : des pièces carrées ou rectangulaires juxtaposées, sans souci d'effet architectural»15. Et de faire la comparaison avec les habitations de Kerkouane, comprenant une cour, parfois même à péristyle. Or, la colline de Byrsa n'est plus totalement en marge de ce mouvement architectural : du fait de la progression de la fouille, qui permet de surcroît un meilleur examen des vestiges déjà connus, on peut en effet considérer que la troisième maison de l'îlot C présente un plan centripète, bien attesté par ailleurs, avec une cour intérieure autour de laquelle sont distribuées les différentes pièces, et un long couloir d'accès donnant sur la rue
eaux en justifient largement la nécessité. Cf. supra, p. 193. Contrairement à l'affirmation du Deutéro-Servius, In Aeneid., 1, 422 - qui faisait peut-être allusion à des routes et non à des rues - on n'a encore retrouvé aucune voie de la Carthage punique pavée. Cf. P. Cintas, Manuel d'Archéologie punique, II, p. 126-7.
" Ibid., p. 96. 14 Un quartier de maisons puniques à Carthage dans RA,
1958, p. 23. 1=5 C. et G.-Ch. Picard, La vie quotidienne à Carthage au
temps d'Hannibal, (IIIe siècle av. J.-C), Paris, 1958, p. 47.
Fig. 79 - La partie nord-est de l'îlot C et les nouvelles fouilles; axe du cliché : nord-est (cl. S.L.).
située au sud-est de Γ« insula». Nous allons examiner successivement cette maison, puis les éléments de la quatrième unité d'habitation venus au jour, vers le nord-est16 (fig. 80).
L'aspect stratigraphique était ici très simplifié. En effet, dans cette partie haute de la colline, le remblai augustéen, déjà moins épais nécessairement, a été complètement écrété lors des fouilles précédentes, de sorte qu'on s'est trouvé directement dans la couche de destruction de 146 17. Les vestiges tardifs, ici représentés par des constructions d'époque musulmane (silo en H III 15, citerne en H IV 4), viennent directement en contact avec le haut de cette couche et même l'entament parfois sur une profondeur de 50 cm à 1 m. Quant aux énormes murs de soutènement, qui délimitent la zone d'est en ouest, ils ont été fondés jusqu'en-dessous des sols puniques. Cette couche de 146 est très typée et parfaitement homogène : terre de couleur brun- rouge, très riche en éléments de démolition, parmi lesquels prédominent les mœllons de grès, les enduits peints, les briques crues et les
16 Si cette quatrième maison était la dernière de l'îlot, on aurait ainsi, grosso modo, une insula de 30 sur 15 m.
17 C'est la couche 7 dans la stratigraphie de S. Lancel, Les fouilles de la Mission Archéologique Française à Caithage sur la colline de Byrsa. Rapport préliminaire (campagnes de 1974 et 1975) dans Ant. Afr., 11, 1977, p. 27.
228 BYRSA I
fragments de pavements divers. La constatation selon laquelle elle se décomposerait en plusieurs strates est illusoire et ne se vérifie pas d'un point à un autre. Ces «strates» ne sont en fait que le résultat de l'écroulement particulier des murs, selon la configuration des constructions. Dans certains cas, on a pu constater que, sur une vingtaine de cm au-dessus des sols, la terre devenait plus noire et plus grasse18. Mais ceci est dû normalement à la chute d'éléments en bois sur le sol : en particulier, nous avons pu observer, à l'emplacement de deux portes de la nouvelle maison, une épaisse quantité de bois calciné, qui correspond évidemment aux linteaux surplombant les passages19.
18 Cf. l'observation de Ferron-Pinard, art. cit., p. 121. 19 La couche de 146 avait été bien reconnue par
G. C. Picard d'après la publication de Ferron-Pinard qui en donnaient une autre interprétation (RA, 1958, p. 26). Mais, selon Picard toujours, cette couche d'incendie aurait déjà été repérée à Carthage dans deux autres endroits, par Ch. Saumagne tout d'abord, sous la Maison du Paon (BCTH, 1934-5, p. 54-55) et par M. Vezat dans la Maison Clariond (BCTH, 1946-9, p. 676-8). En fait, les choses sont moins claires qu'il ne l'affirme, comme il le reconnaissait d'ailleurs dans le compte-rendu qu'il faisait de cette fouille Vézat (ibid., p. 678). Ch. Saumagne a trouvé, au-dessus du sol vierge, les « sédiments de cendres et de plâtras caractéristiques de la période d'abandon pré-augustéenne. Ces déblais, denses mais d'une teneur très pauvre» - ce dernier point peut étonner - «sont épais de 0,40 mal m». Mais, contrairement à ce que dit G. C. Picard, cette couche ne recouvrait pas un sol de briques; elle supportait «le pavement d'une installation romaine ». Il n'y a donc pas ici de sol punique en place, à moins que l'on ne considère ce sol de briques comme pré-romain, mais Saumagne semble sûr de son identification - et qu'en serait-il alors de l'épaisse couche de cendres située au-dessous? En tout cas, en l'absence de sol punique in situ, l'analyse stratigraphique resterait assez délicate. Situation encore plus complexe dans la fouille Vézat. La couche de cendres (a') semble située là entre deux sols manifestement puniques : le sol supérieur b est en effet un opus tessellatum de briques et un lithostroton, lié à la fois à une citerne et à un mur de briques crues. Ce ne serait donc pas la couche de 146 mais une couche d'incendie antérieure, comme on en trouve d'ailleurs aussi à Byrsa. Mais d'un autre côté, le sol inférieur (a), «un dallage grossier de blocs calcaires lûtes à l'argile », semble daté par le matériel de l'époque tardo-punique (anses rhodiennes, etc...); pourtant, il est à 1 m au-dessous de (b), différence pour le moins étonnante. On est donc tenté de penser que ces deux sols sont contemporains et appartiennent à deux constructions différentes ou deux parties d'un même édifice. La couche (a1) - au-dessus de (a) - redeviendrait ainsi la couche de 146. L'absence de plan ou de coupe ne simplifie pas les cho-
1.2.1) La maison à la colonne stuquée20.
a) Le vestibule (fig. 81)
Dégagé sur une longueur de 5,45 m, il constituait sans doute le seul accès à la maison et assurait ainsi à celle-ci une parfaite indépendance (fig. 82). Le mur donnant sur la rue nord-ouest est aveugle et les deux longs côtés sont adossés aux habitations voisines, sans qu'aucune communication ne soit visible21. Large de 85 cm, ce couloir comprend, au pied du mur B, un caniveau lui-même large de 12 cm et profond de 8 cm. Ce caniveau traverse la cour en faisant une légère courbe et rejoint une des trois petites pièces (G), situées au nord-ouest de celle-ci, pièce qui est ainsi désignée comme une salle d'eau. Le couloir ayant une pente fortement accentuée vers le sud-est, c'est donc ainsi qu'étaient évacuées les diverses eaux de la maison, qui se déversaient dans un égout - sans doute à ciel ouvert - de la rue située au sud-est de Γ« insula»22.
Le pavement du couloir, proche de celui de la cour, est fait d'un béton gris, dans la composition duquel on remarque de nombreux éclats de poterie, en particulier verdâtres et jaunâtres; mais il est surtout décoré d'un semis très régulier de fragments de marbre blanc. Quant au caniveau, il est revêtu d'un ciment gris-cendreux,
20 Ainsi appellerons-nous cette maison à cour intérieure, du fait de la présence in situ d'une colonne stuquée dans cette même cour, colonne qui a aujourd'hui disparu (cf. Ferron-Pinard, ibid., pl. 43-44). Il n'est pas question de faire ici une publication exhaustive de la maison : nous n'en décrirons que la partie qui a été concernée, directement ou indirectement, au cours de la dernière campagne, c'est-à-dire la partie sud-est. Nous n'étudierons pas non plus ici l'appareil des murs, qui ne présentent d'ailleurs pas de particularités notables par rapport à l'ensemble de l'habitat de Byrsa.
21 La longueur totale du couloir devait être d'environ 6 m. A Délos par exemple, dans un ensemble comme le Quartier du Théâtre, la longueur des couloirs varie de 2,20 m à 10,30 m : J. Chamonard, EAD VIII. Le Quartier du Théâtre. Étude sur l'habitation détienne à l'époque hellénistique. Paris, 1922, p. 107. Dans certaines maisons particulièrement luxueuses, on atteint des longueurs encore plus grandes : 17,35 m pour la Maison des Masques (BCH, 57, 1953, p. 111. Voir aussi C. Llinas, Inter diias tannas à la Maison du Lac, dans Etudes déliennes (BCH, suppl. 1), Paris, 1973, p. 291 sq.
22 Aucun égout souterrain n'a été jusqu'ici repéré dans le quartier punique.
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 229
H IV 234678
0 1m Carbonnières
Fig. 81 - Le couloir au caniveau et la nouvelle unité d'habitation (relevé Ph. de Carbonnières).
230 BYRSA I
Fig. 82 - Le couloir au caniveau et la pièce α (cl. J.-P. Thuillier).
adapté à sa fonction. Les deux murs du couloir sont enduits soigneusement d'un crépi blanchâtre (fig. 83); mais ils présentent aussi dans leur partie inférieure un décor à bossage : sur une hauteur de 65 cm à partir du sol, un léger relief de 12 mm est détaché, laissant ainsi en saillie une plinthe de couleur nettement rosée, dans laquelle on reconnaît bien sûr la brique pilée. On sait qu'il faut accorder à cet enduit une valeur à la fois décorative et utilitaire, l'humidité étant d'autant plus sensible au pied des murs23.
S'il est loisible de supposer que ce couloir était fermé sur la rue, il est remarquable de constater qu'il l'était aussi sur la cour. Sont encore en place un seuil avec les trous de gond et une autre pierre oblongue comprenant une rainure centrale24. L'ouverture ne se faisait donc pas exactement dans le prolongement du couloir mais à gauche pour qui venait de l'extérieur : on voit que l'intimité était bien préservée. Une hypothèse que l'on peut formuler avec réserve
23 R. Martin, Manuel d'architecture grecque, Paris, 1965, vol. I, p. 435-36.
24 Au moment de la fouille, la fermeture du couloir sur la cour était encore plus nette, puisqu'on avait trouvé un bloc appuyé contre le mur C bloc qui a maintenant disparu. Cf. Byrsa IX, pi. 43-44. D'autre part, la pierre à la rainure posée sur le caniveau était intacte.
est que ce renfoncement du couloir pouvait fonctionner comme latrine : en effet, à Délos par exemple, on a constaté parfois que les latrines se trouvaient dans le vestibule même; d'autre part, on n'a trouvé jusqu'ici, à Byrsa, aucune pièce particulière pouvant servir à cet usage. Enfin, c'est par là que pouvaient être évacuées non seulement les eaux de pluie mais aussi toutes les eaux ménagères".
b) La cour ultérieure (H).
La cour (4 χ 3,50 m environ) avait été qualifiée de salle de travaux ménagers (?) par les fouil- leurs précédents, en raison sans doute de la présence du puits et peut-être du matériel qui y avait été trouvé, mais dont rien n'a été situé
, J *+"*> >^-
fi;-:; - <> ,
Fig. 83 - Le couloir au caniveau : détail de l'enduit (cl. J.-P. Thuillier).
2=1 J. Chamonard, op. cit., p. 185 (habitation VI D).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 231
expressément26. Son pavement est, comme nous l'avons dit, à peu près identique à celui du couloir au caniveau, qui était probablement aussi à ciel ouvert : le semis de fragments de marbre blanc y est simplement moins régulier. En certains endroits, ce pavement a été fortement noirci par l'incendie. Les murs de la cour devaient être soigneusement enduits comme on peut le voir par les photos de la fouille de 1960 mais ce revêtement a maintenant presque entièrement disparu. On note encore la présence de l'enduit de tuileau sur le mur C, près du couloir; cet enduit devait d'ailleurs remonter assez haut, le long de la colonne stuquée.
Les différentes pièces d'habitation sont réparties sur les deux longs côtés, et chacune a conservé son seuil de pierre. D'après l'examen de celui-ci, les trois petites pièces de l'ouest n'avaient pas de portes - elles étaient peut-être simplement isolées par des rideaux27; le seuil avait pour fonction principale d'y empêcher le ruissellement des eaux venues de la cour. En revanche, la pièce située au sud-est était véritablement fermée par une porte : le seuil, long de 1,23 m, en calcaire monolithe, à feuillure, présente à la fois les trous pour les gonds et au milieu (fig. 84) deux cavités plus petites qui recevaient les barres de fermeture. La porte, à deux battants, se fermait de l'intérieur de la pièce, la feuillure de la pierre servant de butée directe28.
c) La pièce d'apparat (I).
Cette caractéristique ainsi que les dimensions de la pièce laissent supposer qu'il s'agissait de la salle d'apparat, de Yœcits maior. On notera encore dans cette perspective qu'une niche a été trouvée dans un des murs, niche qui pouvait
26 Sur la pi. 41 de Cahiers de Byrsa IX, on remarque par exemple dans une pièce située derrière la cour une sorte de grosse vasque-mortier; ibid., n° 322 p. 129.
27 On notera cependant que le seuil de la pièce centrale comporte une feuillure; mais il n'y a pas de trous pour des barres verticales et de toutes façons, vu ses dimensions, la pièce ne peut guère être qu'une cella ciibicularia.
2S Le matériau utilisé pour les seuils ainsi que pour la margelle du puits est remarquable : c'est en effet le seul cas où le calcaire apparaisse dans toute la construction. Il s'agit d'un calcaire gris, présentant des parties rouges et vertes (carrières du Djebel Djemaâ? cf. J. Ferron, Mort-Dieu de Carthage, Paris, 1975, p. 70).
Z2J-Ï
Fig. 84 - La cour H : margelle et seuil de la pièce d'apparat (cl. J.-P. Thuillier).
avoir une fonction soit religieuse, en abritant les «lares» de la maison, soit plus simplement utilitaire, étant destinée à recevoir une lampe pour l'éclairage29. D'autre part, au cours d'un rapide sondage, qui a dû être suspendu pour des raisons techniques, nous y avons trouvé un beau fragment architectonique de grès stuqué, constituant une volute de chapiteau ionique; mais il est vrai qu'on ne peut assurer absolument que le fragment provenait de la pièce30.
Une objection pourrait cependant être faite à l'interprétation de cette pièce comme étant la salle d'apparat : le pavement y est en effet à première vue plus que rudimentaire et cela surprend d'autant plus que d'autres pièces - et la cour elle-même - ont reçu un sol qui, sans être luxueux, est tout de même assez remarquable31. Mais le sol de Yœcus n'était pas en simple terre battue : non seulement le sondage que nous évoquions plus haut a révélé la présence, à l'état de traces, d'un opus signinum mais surtout, le long
24 Ferron-Pinard, ibid., p. 97. Dans la seconde hypothèse, on aurait sans doute dû trouver un nombre plus grand de ces niches.
10 On fera le rapprochement avec un chapiteau «ionique fantaisiste» trouvé il y a plusieurs années à Byrsa. cf. C. Picard, dans Karthago, 3, p. 122-3, fig. 4.
11 N'était cette comparaison à l'intérieur même de la maison, on n'aurait pas trop lieu de s'étonner. Il peut arriver, et cela se voit dans la Délos hellénistique toujours, que Yœcus ait un simple sol de terre battue - avec parfois un plancher· de bois (?). Cf. Ph. Bruneau et J. Ducat, Guide de Délos, Paris, 1965, p. 34-36.
232 BYRSA I
du seuil, au-dessus de ces sols, on a retrouvé in .siiti quelques tesselles de calcaire blanc; c'est donc une mosaïque qui constituait le pavement de Yœcus maior. On peut d'ailleurs s'étonner du nombre infime de tesselles restant en place et se demander si ces pavements n'ont pas fait l'objet d'une destruction systématique. Cela expliquerait le nombre au contraire impressionnant de fragments de mosaïque blanche que l'on trouve dans la couche de destruction, à 1 m ou plus au- dessus des sols en place. Mais ici une autre explication peut évidemment être suggérée : ne s'agit-il pas d'abord des pavements de pièces de l'étage - si étage il y a - qui, d'une manière générale, doivent être plus riches, étant réservées à l'habitation des maîtres? Nous reviendrons sur ce point.
d) La cilerne.
La citerne, située à la fois sous la cour et Yœcus, a été fouillée en partie au cours de cette campagne. Comme presque toutes les autres de la colline, elle est creusée dans la roche et ses parois construites en petits mœllons sont revêtues d'un épais enduit hydraulique gris-cendreux. Son puits carré a été aménagé en pratiquant des cavités dans des dalles superposées de couverture i:. Ces dernières sont posées à plat et non en bâtière, comme cela se produit assez souvent à Byrsa : l'écroulement de certaines dalles a interdit le dégagement complet de la citerne.
Il s'agit là encore d'une citerne appartenant au type de loin le plus courant à Carthage et dans le monde punique : étroite, allongée, avec des extrémités en demi-cercle". La largeur est de 0,90 m pour une longueur de plus de 4 m. Le puits, situé dans la cour, se trouve nettement décalé par rapport au centre de la citerne. Celle- ci ne contenait absolument aucun matériel, à l'exception de quelques détritus modernes. Il faut donc considérer qu'elle était restée hermétiquement close jusqu'à l'époque de sa
verte; on a d'ailleurs pu découvrir au fond les éléments de la margelle, en partie cassés, qui étaient encore en place au moment de la découverte u (fig. 84).
Cette citerne recueillait les eaux de pluie venant sans doute d'une terrasse, par l'intermédiaire d'une canalisation de plomb passant elle- même à travers une colonne stuquée, dans l'angle est de la cour. C'était une façon élégante de dissimuler une conduite peu esthétique en soi et qui se trouvait par là-même protégée3\ A partir du pavement, un tuyau de terre cuite prenait le relais de la conduite de plomb et les eaux rejoignaient la citerne par un coude accentué^6. Le bloc servant de fondation à la colonne a été creusé pour permettre l'installation de ce tuyau.
L'ensemble de la colonne a malheureusement disparu aujourd'hui : sans doute a-t-on voulu récupérer le plomb. Reste simplement, dans le béton de pose, l'empreinte de la plinthe, sur laquelle reposait cette colonne stuquée, qui était dépourvue de véritable base. On peut ainsi au moins restituer les dimensions de cette plinthe, qui présentait une forme trapézoïdale et une moulure arrondie sur son grand côté (nord) : 50x40x34x30 cm. Un détail intéressant apparaît encore sur les photos : la plinthe était percée d'un orifice en forme de feuille de lierre, qui faisait peut-être partie d'un système de trop- plein. On peut supposer que, la citerne étant pleine, les eaux ne pénétraient plus dans la conduite de terre cuite mais refluaient dans la cour pour être finalement évacuées dans la rue. A moins que, plus simplement, cet orifice ait servi à capter les eaux de pluie tombant dans la cour.
1.2.2) La nouvelle unité d'habitation.
Le mur A, sur toute la longueur qui a été dégagée (plus de 11 m), est dépourvu de portes; c'est donc une autre maison, mitoyenne de la maison
X2 Dimensions du puits : 35x35 cm; avec la margelle, 60 χ 60 cm. Plus exactement, le puits est obtenu par le creusement symétrique de deux dalles jointives à l'assise inférieure (ep. 50 cm) et d'une seule à l'assise supérieure, sous le pavement (ép. 35 cm).
" L'autre t\pe est celui de la citerne-bouteille. (Un exemple en G IV 3 cf. supra, p. 00).
'4 Cahiers de Byrsa, IX, pi. 43. L'absence totale de déblais et de matériel exclut l'hypothèse que cette citerne ait déjà fait l'objet d'une fouille clandestine.
" A Délos, dans deux maisons, la conduite recueillant pareillement les eaux de pluie était appuyée contre une colonne du péristyle.
ift Même situation dans Cahiers de Bxrsa V, 1954-55, pi. 90 et p. 80 : «... un regard où le tuyau de descente en plomb {fistula plumbea) est raccordé avec un tubulus fictilis ».
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 233
Fig. 85 - La colonne stuquée /π μ7π au moment de la découverte (cl. G. van Raepenbusch).
à la colonne stuquée, qui se développe au nord- est, à un niveau légèrement supérieur, selon la pente naturelle de la colline". On en connaît déjà trois pièces, même si l'ensemble de leurs dimensions ne peut être donné. La première (a), située directement derrière le mur A, large de 1,10 m, comprend dans son angle nord, un tuyau de descente vertical qui recueillait les eaux du toit pour les conduire à une citerne dont l'emplacement reste encore à déterminer".
î7 49,31 pour α contre 49,10 pour la cour H. Les dénivellations existent aussi à l'intérieur des maisons mêmes; c'est ainsi que le sol de I est nettement en-dessous de celui de la cour, à tel point que l'on peut penser à l'existence d'une marche située derrière le seuil.
" D'après le départ du tu\au, cette citerne devrait se situer plus à l'est. Il semble ainsi se confirmer que chaque maison a\ait sa citerne individuelle et qu'il n'y avait donc
Cette canalisation de terre cuite, de couleur ver- dâtre, ne subsiste plus que sur quelques cm au- dessus du sol, mais on peut voir qu'elle était solidement protégée par un enduit hydrofuge gris-cendreux, sur une épaisseur de 6 cm. Il est encore trop tôt pour s'interroger sur la destination de cette pièce dont le pavement est constitué par un bel opus sigiiimun à inclusion d'éclats de calcaire blanc très serrés, très petits et très irréguliers; on notera cependant qu'ont été trouvés sur le sol même plusieurs objets de fer dont une lame de couteau, une clé et un instrument énigmatique qui pourrait être de jardinage.
La limite sud-est de α n'a pas été atteinte : peut-être même allait-elle jusqu'à la rue, auquel cas elle aurait l'aspect d'un large couloir desservant plusieurs pièces. Si elle est fermée à l'ouest par un petit muret, au-delà duquel il faut perdre l'espoir de retrouver beaucoup d'éléments en place du fait des bouleversements antiques et modernes, la pièce donnait au nord-est sur deux autres pièces β et γ, par deux ouvertures larges de 65 cm environ : celle-ci ne présentent pas de véritable seuil ni de chambranle, mais elles étaient surmontées au moins d'un linteau de bois puisque c'est à leur emplacement qu'ont été trouvées les masses de bois carbonisé, signalées plus haut (fig. 86). La seule dimension que l'on puisse encore établir pour ces deux nouvelles pièces est leur profondeur qui est de 2,42 m. Le mur du fond β' est assez remarquable dans la mesure où il est conservé, avec son revêtement presque intact, sur une hauteur de plus de 2 m, ce qui est exceptionnel dans ce quartier de Byrsa. Un fait étonnant a pu être constaté au cours du dégagement : dans sa partie nord-ouest, seul l'enduit de la paroi nord du mur était resté en place, collé contre la terre, et le reste du mur lui-même s'était écroulé w. La paroi sud de β' présente un certain nombre d'aménagements qui sont liés là encore à des installations de nature hydraulique. En β, par exemple, on note, à environ 1 m au-dessus du sol, une petite niche
pas d'organisation commune. D'autre part, l'importance des vestiges de nature hydraulique n'est évidemment pas le fruit du hasard : on comprend aisément le caractère essentiel de cet approvisionnement sur un site où tout dépendait des eau\ de pluie et donc des citernes.
'" On notera ici encore la belle couleur rose de cet enduit, dans lequel le tuileau est particulièrement visible.
234 BYRSA I
*' . ' ξ ' .' , \ *' ^ ' ̂
Fig. 86 - Passage entre α et γ : poutre carbonisée (cl. J.-P. Thuillier).
rectangulaire soigneusement enduite; or, le pavement correspondant à cet angle de la pièce était un figlinnm tessellatwn tout à fait semblable à celui de la petite salle d'eau E de la maison précédente : la découverte in situ de quelques rares tesselles de poterie au pied même du mur l'atteste parfaitement (fig. 87) mais on remarquera que là encore ce type de pavement a presque entièrement disparu; enfin, au sommet de β'
toujours et sur sa paroi nord cette fois, un début de canalisation, de forme caractéristique, a également pu être repérée. Dans la pièce γ, le mur présente des dessins et moulures qui montrent clairement que des installations - en bois sans doute ou en pierre, telles que des cuvettes - complétaient l'ensemble. Ces installations ont été en tout cas complètement arrachées.
L'examen du mur qui sépare β de γ apporte un élément très intéressant : il s'agit manifestement en effet d'une cloison secondaire, rajoutée postérieurement au plan d'ensemble de la maison, et les deux pièces n'en formaient évidem-
Γ·.·
ν * ^V 15
fr·-''... /
Fig. 87 - Pièce Β : détails du mur Β' et du pavement (cl. J.-P. Thuillier).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 235
ment qu'une à l'origine (fig. 88). Cela se voit très bien en particulier sur le mur β' dont l'enduit est très nettement engagé sous cette cloison et ce n'est pas un hasard si le mur β' présente les aménagements dont nous venons de parler à la fois en β et en γ. D'autre part, Yopus signinum commun de β et de γ a été cassé pour permettre l'installation du mur de séparation. Or, cette constatation, on peut aussi la faire à propos de la première maison : en effet, les trois petites pièces, E, F, G, situées au nord-ouest de la cour (et qui ont une largeur de moins de 1,50 m) sont aussi le résultat d'un réaménagement. Au départ, il n'y avait qu'une seule pièce dont le pavement unique était Yopus signinum que l'on peut encore voir dans la cella (?) centrale. Les deux cloisons, qui entourent cette pièce, larges de 30 cm - celle qui sépare β et γ est encore plus étroite (25 cm environ)40 - sont en effet directement posées sur le sol, qui en a d'ailleurs pris un aspect bombé. Les deux petits seuils latéraux sont le fruit d'une réorganisation tardive : il n'y avait au départ que le seuil central, comme on le voit encore par l'absence de pavement à l'emplacement de l'ancien mur, dans la pièce située au sud (E). En revanche, cette pièce unique était moins profonde que ne le sont les trois petites qui lui ont succédé (2 m contre 2,80 m) : on lit parfaitement la trace de l'ancien mur de fond grâce, d'une part, aux blocs d'angle légèrement en saillie à la limite du signinum et, d'autre part, aux fondations mêmes du mur qui ont été laissées apparentes, d'une façon d'ailleurs surprenante, dans les pièces E et F41.
Il sera évidemment primordial de vérifier si ces nouvelles dispositions de l'habitat se répètent dans tout le quartier et de préciser à quelle date elles ont pu être effectuées. Mais ce ne peut être en tout état de cause que peu de temps avant la destruction de Carthage et on a l'impression que ces remaniements ont été effectués avec une certaine hâte, les sols par exemple
40 On notera en revanche que les murs porteurs ont une largeur de 50 cm environ (une coudée?) - et même 75 cm pour le mur aveugle donnant sur la rue ouest.
41 Mais à Délos aussi, c'est le rocher qui émerge parfois dans certaines pièces, sans qu'on ait pris soin de l'araser et de le recouvrir d'un quelconque pavement {Guide de Délos, p. 52).
—-e
Fig. 88 - Pièce γ : le mur B' et la cloison perpendiculaire (cl. J.-P. Thuillier).
étant restés cassés ou incomplets selon les cas42. Faut-il voir dans cette construction de petites pièces le signe d'un regroupement et d'une concentration de populations sur la colline, au moment de la troisième guerre punique? Dans le cas - probable - où la colline de Byrsa correspondrait bien à la citadelle carthaginoise - mais aucune découverte archéologique ne permet jusqu'à présent de l'affirmer en toute certitude - une telle constatation ne manquerait pas d'intérêt43.
1.2.3) Matériel.
Il n'est pas possible de décrire ici le très nombreux matériel que l'on rencontre habituellement dans la couche de démolition : céramique à vernis noir, céramique de tradition hellénistique et céramique locale. Nous nous contenterons donc de publier quelques objets, qui ne sont pas forcément les plus représentatifs mais qui présentent un caractère intéressant à des titres divers.
42 Encore faut-il nuancer ce jugement puisque la petite salle d'eau (G) a reçu un pavement soigneusement disposé : au fond, une mosaïque de tesselles de terre cuite, avec incrustation de tesselles de pierre blanche à intervalles réguliers, et juste derrière le seuil, à l'emplacement exact du mur primitif, un autre pavement {tessellaium blanc décoré de quelques tesselles gris-bleu).
41 Signalons enfin que presque partout dans ce secteur nord-est de l'habitat punique, on assiste à ce phénomène souvent constaté par ailleurs, à savoir une recharge systématique des sols d'opus signimun, qui se superposent parfois directement.
236 BYRSA I
Céramique
Attique à figures rouges (fig. 89)
A.368/7 : Fragment (6x4 cm; le tesson semble avoir été roulé par la mer). Pâte ocre- clair. Vernis externe noir-brillant, interne marron-rouge avec des stries.
Eros flûtiste; restent la partie supérieure du corps, une partie des ailes et l'aulos double. Bandelette surpeinte en blanc autour du front.
Marques d'amphores rhodiennes (fig. 90)
A. 368/4 : Cartouche rond à double cercle concentrique; diam. 2,6 cm (fig. 91).
Άριστοκλεϋς, rose (cf. Cahiers de Byrsa V, p. 63)
A. 368/5 : Timbre circulaire (fragment); diam. 3 cm.
. . . ]OKP[ . . . ]ΥΣ rose Δαμοκράτευς, plutôt que Ίπποκράτευς, d'après l'apparence de la lettre initiale du fragment. (V. Grace dans Hesperia, 3, 1934, p. 238-9).
A.368/2 : Timbre circulaire (fragment) Ί]π-κ;οκ[ράτευς]
(V. Grace, ibid.).
A 368 1
A 368 2 A 368 3
A 368 4 A 368 5
A 378 2 A 378 4
Fig. 90 - Timbres d'amphores (del Ph. de Carbonnières).
^ '.'A - — '
7L
A.368.7
Fig. 89 - Fragment de céramique attique à figure rouges (cl. S.L.). Fig. 91 - Timbre d'amphore rhodienne (cl. S.L.).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 237
A.368/3 : Timbre rectangulaire (partie gauche légèrement abîmée) 3,7x1,2 cm. Inscription sur deux lignes (fig. 92) :
Έπί Συμμάχου Άρταμιτίου
{Cahiers de Byrsa V, p. 63) A.378/4 : Timbre rectangulaire (fragment); 4x2
cm. Lettres très effacées sur 3 lignes :
Έτ:ί Άρίσ[το] Δάμο[υ]
Ζμ[ιν#ίου] (V. Grace, ibid., p. 219; A. Delattre dans BCTH, 1894, p. 110, n° 15).
«Sombrero de copa»
A.375/3 : Fragment de bord et de panse. Anse plate accolée sous le bord. Bord horizontal et anse décorés de dents de loup. Sur la panse, décoration de filets lie-de-vin, (cf. F. Benoît, Recherches sur l'hellénisatioiì du Midi de la Gaule, Aix, 1965, p. 78, n. 45).
Céramique à vernis Imitation locale
noir.
A.375/1 : Fragment de patere (fond) caractérisée par un large marli évasé et une quasi-absence de pied (remplacé par une base creuse). Pâte ocre. Vernis noir brillant, à reflets bleutés. Cette patere rappelle la forme Lamboglia 36, mais représente surtout l'adaptation en vernis noir de la patere punique à larges bords.
Sur le fond externe, graffito (h. : 3 cm; largeur : 4 cm) représentant le signe de Tanit. Ce signe se présente sous la forme d'un trapèze, supportant une barre horizontale avec des appendices coudés, qui, soutient une «tête» grossièrement circulaire (fig. 94).
C'est une forme tardive du signe, qui peut être comparée par exemple avec la marque estampée sur une anse d'amphore trouvée à Marseille (type C d'Ibiza = Cintas 312-3). Cf. F. Benoît, op. cit., p. 80, pi. 42,15.
Amphores puniques (cf. fig. 90)
Fig. 92 - Timbre d'amphore rhodienne (cl. S.L.).
Fig. 93 - Fragment de «sombrero de copa» (cl. S.L.).
Fig. 94 - Graffito sur fond externe de patere à \ernis noir (cl. S.L.).
238 BYRSA I
A.368/1 : Fragment d'amphore Cintas 312-3 (col) comportant une marque en caractères grecs : Magon (cf. note infra, p. 333-337).
A.378/2 : Fragment d'amphore punique (pâte rouge sombre, surface rouge clair) comportant une marque elle-même fragmentaire. Lettres grecques, en creux (h. des lettres : 1,2 cm) :
Ι ΙΣ
Peut-être faut-il lire ΛΡΙΣ; cf. une marque semblable trouvée dans une fouille de sauvetage au bas de la pente est de Byrsa (renseignement communiqué par F. Chalbi, lors du colloque sur la stratigraphie de Carthage, en juillet 1977); (fig. 95) cf. déjà BCTH, 1915, CCII, n-> 6.
Objet de pierre
A.378/5 : Fragment de mortier circulaire en calcaire rose, avec une oreillette et un bec verseur, sous lequel on a une feuille de lierre en relief, (diam. 19 cm; h. 4 cm), cf. W. Deonna, Le mobilier délien, Paris, 1938, p. 110 sq., pi. 44-5 (dont Β 4168) (fig. 96).
Objets de métal
(Tous ces objets ont été trouvés sur le sol de la pièce a). A.371/1 : Lame de couteau en fer; deux tétons
placés sur la soie retenaient le manche de bois, dont il reste quelques traces. Lg. de la lame : 21,5 cm; largeur : 5 cm (fig. 97).
A.371/2 : Instrument de fer recourbé, comprenant une extrémité en forme d'hameçon; l'autre extrémité, plate, en forme de huit, est percée de deux trous : dans l'un d'eux, il y avait encore la tête d'un clou. Traces de bois. Lg : 22 cm (fig. 98).
A.371/3 : Clé de fer. Lg : 12,5 cm (fig. 99). Exception faite des nombreux clous de formes diverses, en fer et en bronze, les objets métalliques restent relativement rares.
On notera, d'une part, le faciès assez hellénique que laisse encore apparaître ce matériel, et, d'autre part, sur le plan chronologique, le fait qu'aucune trouvaille n'est postérieure au milieu du second siècle avant notre ère. Ce point est confirmé par l'étude de plusieurs monnaies de
FtR-FfcB
Fig. 95 - Fragment de timbre amphorique punique et lettres grecques (cl. S.L.).
Fig. 96 - Fragment de mortier en calcaire (cl. S.L.).
Fig. 97 - Lame de couteau en fer (cl. S.L.).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 239
Fig. 98 - Objet en fer (cl. S.L.).
bronze qui ont été trouvées sur le sol même des pièces α et γ de la nouvelle unité d'habitation.
Ces monnaies sont malheureusement, dans la plupart des cas, très abîmées et elles ne peuvent pas encore être datées avec une très grande précision. A3.7 : 14,28 gr. Cérès. (cf. SNG, 409-413) datation
approximative : 200-146 av. notre ère. A3. 14/1 : 16,67 gr. Cheval entier. Cérès. (cf. SNG,
409-413) datation approximative : 200-146 av. notre ère.
A3.14/2 : 7,90 gr. Tête (de?) (cf. SNG, 226-232) datation proposée : autour de 241 av. notre ère.
A3.16 : 13,52 gr. Cérès (cf. SNG, 409-413) datation approximative : 200-146 av. notre ère.
A3.17 : 3,88 gr. Tête d'homme (cf. SNG, 94-98) datation proposée : fin IVe siècle, début IIIe siècle av. notre ère.
1.2.4) Conclusion
Tous les problèmes concernant les habitations puniques de Byrsa sont loin d'être résolus. En particulier, on peut s'interroger sur la question d'un éventuel étage44. Jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas trouvé le moindre escalier ni la moindre trace d'escalier, lequel pourrait d'ailleurs conduire à une simple terrasse. Pourtant, dans la maison mitoyenne de la maison à la colonne stuquée, au sud de celle-ci, (en H IV 5/9) on peut affirmer avec certitude la réalité d'un étage au moins : il subsiste, sur le mur de façade, les traces du pavement de l'étage, et les cavités d'encastrement des poutres de la pièce située au rez-de-chaussée sont bien visibles (fig. 100, 101, 102). Mais cette dernière pourrait n'être ici, d'après sa hauteur approximative, qu'une sorte de cave.
Fig. 100 - Détail du haut du mur en H IV 5 (cl. J.-P. Thuillier).
A.371.3 D'autre part, la présence de très nombreux
fragments de pavement, en particulier de mosaïque blanche, dans la couche de démolition, à l m et plus au-dessus des sols en place, ne peut guère s'expliquer autrement que par l'existence d'un ou plusieurs étages. On pourrait certes invoquer la très forte déclive du terrain qui aurait fait glisser, d'une maison à l'autre, de tels fragments, mais cette explication est très insuffisante, au vu des très nombreuses trouvailles de
Fig. 99 - Clef en fer (cl. S.L.).
44 On connaît en effet le passage d'Appien dans lequel sont signalées des maisons de plusieurs étages, le long des rues montant à la citadelle (Lib., 128).
240 BYRSA I
Fig. 101 - H IV 5 : cavité d'encastrement dans le mur (cl. S.L.).
Fig. 102 - Départ du pavement de l'étage sur le même mur (cl. S.L.).
mosaïques et autres types de pavement. La mosaïque fait d'autre part penser à de belles pièces d'habitation, qui pourraient être précisément celles d'un étage.
Mais on peut au moins affirmer déjà un certain nombre de points. Avec la maison à la colonne stuquée, le quartier de Byrsa révèle pour la première fois un plan d'habitation déjà bien connu dans le monde punique contemporain, en Afrique même, à Kerkouane, et en Sar- daigne, à Monte Siraï4S. Mais, d'une façon plus générale, la Carthage tardo-punique se rapproche ainsi, dans ce domaine encore, de l'ensemble de la Méditerranée hellénistique : les habitations de Délos par exemple, permettent, nous l'avons vu, de nombreuses comparaisons46. Peut- être même faut-il voir dans la colonne stuquée une tentative pour évoquer les belles cours à péristyle, difficilement imaginables sur la colline de Byrsa, où l'espace était naturellement restreint. Le problème qui se pose est de savoir si cette maison est vraiment exceptionnelle à Byrsa et, dans ce cas, il serait fondamental de connaître sa date exacte de construction : on pourrait supposer alors que ce plan hellénistique n'a été adopté que tardivement, par imitation de ce qui se faisait ailleurs en Méditerranée. En tout cas, les remaniements tardifs qu'a connus cette demeure ne changent rien au plan d'ensemble qui est donc d'origine. A ces questions complémentaires, c'est l'extension de la fouille d'une part et le résultat de sondages ponctuels, pratiqués sous les sols, d'autre part, qui permettront peut-être d'apporter une réponse"
J.-P. Th.
45 J.-P. Morel dans MEFR, 81, 1969, p. 478-9 et F. Barreca, La Sardegna fenicia e punica, Sassari, 1974, p. 245 sq. : « vi si accedeva per mezzo di un corridoio, lungo la parete sinistra del quale scorreva una canaletta che portava le acque di rifiuto fuori della casa dove potevano confluire in una cunetta scoperta oppure versarsi in piccoli canali di scarico, sistemati sotto la sede stradale ». Cf. encore maintenant, R. Martin, Histoire de Sélinonte d'après les fouilles récentes, dans CRAI, 1977, p. 60 sq. (où il s'agit de maisons reconstruites à la fin du IVe siècle av. notre ère).
46 Ph. Bruneau et J. Ducat, op. cit., p. 34-6. 47 Les vestiges déjà dégagés et les trouvailles effectuées ne
portent pas à penser qu'il s'agisse d'une maison exceptionnellement «riche» : on connaît par exemple, dans d'autres secteurs (F III 12-13), des demeures aux murs mieux appareillés, et des fragments architectoniques analogues à la colonne ont été trouvés en divers points de la zone, mais ils n'étaient point en place. Quant au matériel découvert dans la maison elle-même, il ne présente non plus aucun caractère d'exception.
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 241
2) Recherches sur les niveaux puniques antérieurs aux niveaux d'habitat : fouilles en G IV 2 et en F III 3/F II 15 (rapport présenté par S. Lancel).
Les niveaux puniques profonds sous les niveaux d'habitat ont été examinés en deux points : d'une part dans l'angle ouest de l'îlot C, sous des niveaux de sols, en G IV 2, et d'autre part à l'angle sud de l'îlot B, mais à l'extérieur de cet îlot, sous les plans de circulation d'une rue, en F III 3/F II 15.
2.1) Fouille en G IV 2 sous le niveau de sol de l'angle ouest de l'îlot C.
Après dégagement des fondations de l'angle ouest de l'îlot C (cf. supra, p. 191), le sol de la pièce formant angle (G IV 2) est apparu sous la forme d'un opus signinum de type rustique, dont les éléments constitutifs sont de gros fragments de terre cuite noyés dans un béton de chaux blanchâtre. Ce sol lui-même était très délabré, mais le nidus en avait été conservé sur une grande superficie, à l'exception de l'angle ouest de la pièce, où les murs ont été détruits jusqu'aux fondations.
Sous ce niveau scellé la fouille a fait immédiatement apparaître, sans l'intermédiaire d'une couche de nivellement, une strate caractérisée par sa forte teneur en charbons et en scories métalliques (fig. 103 et 104); dans cette strate ont été découverts en place, sensiblement au même niveau, leurs panses sectionnées affleurant au ras du béton de pose du sol postérieur (fig. 105), plusieurs fonds d'amphores de même type, vraisemblablement de profil Cintas 313/314 (fig. 106)48.
La fouille de deux de ces fonds d'amphores (P 1 et Ρ 4 : fig. 105 et 106) a livré plusieurs exemplaires d'objets en terre cuite, fragmentaires, en forme de manchons approximativement cylindriques ou tronconiques. A l'intérieur de
ces manchons sont ménagés deux canaux de section circulaire, d'environ 15 mm de diamètre, qui, soit convergent et débouchent à l'extrémité arrondie du manchon par un seul orifice (fig. 107 : A.312.1 et 3; fig. 108), soit se maintiennent parallèles et débouchent en deux orifices distincts (fig. 107 : A.312.2). Ces objets ou fragments d'objets présentent couramment des extrémités très cuites, vitrifiées, avec des coulures dues à l'action répétée de températures intenses : ces coulures ont parfois bouché partiellement les orifices des canaux. Ce sont donc là des objets de rebut qui ont été jetés dans ces fonds d'amphores qui servaient de poubelles. Quant à l'identification de ces manchons, elle n'est pas douteuse : il s'agit de tuyères de terre cuite utilisées par des fondeurs de métaux qui par l'intermédiaire de ces manchons pouvaient faire approcher presque jusqu'au contact des foyers de leurs fours les extrémités des soufflets qui attisaient les feux des fonderies (fig. 109). Dans cette même strate (fig. 104) ont été également recueillis des fragments de gros vaisseaux en terre cuite, d'une épaisseur moyenne de 30 mm (fig. 110 : A.312.5 et 6), présentant sur leur face interne (concave) des traces de combustion violente : bien que ces éléments n'aient pas été trouvés assemblés suivant une disposition fonctionnelle, mais renversés dans la strate, ce sont là très vraisemblablement des fragments de fours, ou tabounas49. Enfin, outre ces objets, et outre les poches de charbons et les scories métalliques déjà signalées, un dernier trait du facies de cette couche est fourni par la présence de poches d'argile rouge épurée, qui semblent avoir constitué autant de réserves pour la fabrication soit des fours, soit des tuyères, plus vraisemblablement de celles-ci, dont la vitrification rapide au contact du feu intense des fonderies obligeait au remplacement fréquent.
L'analyse par activation neutronique d'une part d'échantillons prélevés dans ces poches d'argile, d'autre part de fragments de tuyères
4S II est impossible de préciser davantage le type auquel appartiennent ces fonds d'amphores, que leurs caractéristiques internes (pâte feuilletée, verdâtre au cœur, blanchâtre ou beige en surface) désignent comme puniques.
4l) Des fragments de même type ont déjà été recueillis par nous-même (cf. supra, p. 81 et 86) et par Ch. Saumagne dans des niveaux d'ateliers des pentes sud et est de la colline (cf. supra, p. 30 et 31). Ch. Saumagne a décrit précisément un de ces fours en terre cuite dans son rapport sur ses fouilles du quartier du Metroôn, publié ci après (cf. p. 303).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 243
■ Λ „""*· -'&:'*
■■vfe *t». *·'
£& · Us
f · f' ,
-
-
χ.
r-:. -\ t*.
•:,.'v-'v: Λ^' ■
Fig. 104 - Amphorcs-poubcllcs PI et P2 émergeant dans la couche d'atelier; en A, la poche d'argile épurée (cl. S.L.).
recueillis dans le même contexte a donné les résultats suivants30.
Echantillons
Poches d'argile Tuyères . . .
Ti
263 279
V
58 54
Hf
9,5 8,5
Co
7,2 7,6
Cr
53 45
Se
5,7 5,3
Cs
2,7 2,4
Citons l'auteur de ces analyses sans rien ajouter à son commentaire empreint d'une nécessaire prudence : «Les résultats obtenus sur les deux échantillons n'étant pas significativement différents, on peut affirmer qu'aucun élément d'analyse ne s'oppose à ce que les tuyères aient
St) L'analyse par irradiation dans un réacteur à haut flux a été faite par M. J. Diebolt, ingénieur au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, sur la base de travaux antérieurs résumés dans une communication intitulée : Recherche d'éléments susceptibles de caractériser une céramique ancienne par activation neutronique, présentée par J.-C. Ricq et J. Diebolt au congrès réuni à Munich en 1976 sur le thème : Modem Trends of Activation Analysis. Les résultats sont exprimés en ppm. poids (1 ppm. = 104o/o), avec la précision suivante : Titane (Ti) : ± 10 ppm; Vanadium (V) : ± 1,5 ppm; Hafnium (HO : ± 0,4 ppm; Cobalt (Co) : ± 0,4 ppm; Chrome (Cr) : ± 1,7 ppm; Scandium (Se) : ± 0,2 ppm; Cesium (Cs) : ± 0,4 ppm.
été fabriquées à partir de l'argile contenue dans les poches d'où proviennent les échantillons prélevés».
Restait à déterminer la nature du minerai qui était fondu dans cet atelier. Des échantillons de
Fig. 105 - Détail de l'amphore PI et de la réserve d'argile A (cl. S.L.).
Fig. 106 - L'amphore-poubelle P4 (cl. S.L.).
244 BYRSA I
A 312
5 cm Carbonn leres
Fig. 107 - Les tuyères en terre cuite de l'atelier de fondeur (del Ph. de Carbonnières).
scories prélevés dans ce contexte ont été soumis à analyse suivant la même méthode d'activation neutronique, avec les résultats suivants : - Fer 87% - Manganèse 3% - Aluminium 5% - Arsenic, cuivre, sodium : traces obser
vées, non dosées.
L'analyse confirme donc nettement ce que suggérait l'observation directe de ces scories
dures, brunes, d'aspect spongieux : le minerai traité dans ces fours était bien du minerai de fer.
On comprend tout l'intérêt de ces résultats, d'abord en eux-mêmes sur ce point particulier du site fouillé en 1976, mais aussi pour la lumière qu'ils apportent rétrospectivement sur un certain nombre de constats faits par nous- même lors de sondages dans un secteur très voisin en 1975 : les terres cuites vitrifiées trop fragmentaires alors pour pouvoir être reconnues sont bien aussi des fragments de tuyères, et
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 245
^lP A- 31 2.1
Fig. 108 - La tuyère A.312.1 (cl. S.L.).
toute ambiguïté est levée sur la nature de l'activité industrielle dont les traces ont été constatées sous les niveaux de sols dans les sondages a, b, c et d (cf. supra, p. 95). Et du même coup s'éclairent aussi et se précisent certains résultats publiés dans les comptes rendus de fouilles anciennes. On rappellera ici que le même facies a été décrit comme in situ, à l'identification près, par Ch. Saumagne dans son rapport des fouilles faites en 1925 en bas de la pente sud de la colline de Byrsa (terrain Khmis-en-Najar : cf. supra, p. 29). On se souviendra aussi que son enquête stratigraphique de 1932 dans le terrain Ploix, à 150 m en contrebas de notre gisement, lui avait révélé les éléments d'un même facies industriel, mais provenant vraisemblablement, par glissement ou rejet, de l'amont, c'est-à-dire précisément de notre secteur ou de ses parages immédiats.
La stratigraphie du gisement, relevée suivant un axe nord-ouest/sud-est (fig. 1 1 1 : coupe B-B') manifeste au-dessus du sol naturel 3 deux couches archéologiques séparées par un sol bien distinct S 2, qui est le sol de l'atelier. Il apparaît clairement à la lecture de cette coupe que, non seulement il n'y a pas de couche de nivellement ou de recharge au-dessus des vestiges de l'atelier préexistant, mais même que les constructeurs de l'habitat postérieur se sont contentés d'écréter et de niveler sommairement ce qui subsistait de l'activité antérieure. Le matériel recueilli dans la couche 1 , de faible épaisseur - 30 à 40 cm - fournit donc tout à la fois un terminus post queni
pour la pose du sol S 1 et pour la phase finale d'activité de l'atelier préexistant. En voici l'essentiel (fig. 112) : A.312.13 : fond de kylix de profil 42 B; pâte beige
rosé, fine, bien épurée, vernis noir luisant, peu épais; décor de palmettes sur le fond interne, reliées entre elles par des arcs de cercles, et inscrites dans cinq cercles concentriques de guillochures.
A.312.14 : bord de forme 24; pâte beige rosé, vernis noir luisant.
A.312. 15, 16,17 : fragments de bords de forme 28; pâte ocre à ocre marron, vernis noir à reflets bleutés, luisant.
A.312. 18 : fond de patere apode (forme 63?); pâte chamois rosé; vernis noir faiblement luisant; fond interne : rosette centrale inscrite dans un décor d'oves et de palmettes.
A.312. 19 : fond de forme 27; pâte ocre foncé, vernis noir brillant à reflets bleutés, rosette centrale sur le fond interne.
A.3 12.20 : bord de forme 27; mêmes caractéristiques que le précédent.
A.312.21 : deux fragments reconstituant un forme 23; mêmes caractéristiques que le précédent.
A.3 12.22 : bord de forme 34; mêmes caractéristiques que le précédent.
Le terminus post quern est fourni par les tessons de campanienne A : A.312.15,16,17, 19,20,21,
Τ
0 15 45 cm
Fig. 109 - Schéma de fonctionnement d'un four de fondeur (d'après R. Tylecote, Metallurgy in Archaeology; Τ : Tuyère; C : charbon; S : scories; L : loupe de métal; M : minerai)
(del S.L.).
246 BYRSA I
A 312.6
5 cm A 312 5
Fig. 110 - Fragments de tabounas ou de fours de l'atelier de fondeur (del Ph. de Carbonnières).
22, qui ne permettent pas de remonter plus haut que les premières années du IIe siècle ou l'extrême fin du IIIe. Outre d'assez nombreux tessons amorphes de céramique punique achrome, autres matériels de cette couche / :
A.312.7 : deux fragments reconstituant presque complètement une forme de marmite basse à anse accolée et plan de pose pour couvercle sur le bord interne; pâte feuilletée ocre, presque brique au cœur, gris à gris-noir en sur-
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 247
G IV 2
0 1 2 3 4m
Fig. Ill - Coupe B-B' (cf. fig. 103 sur les niveaux d'ateliers sous-jacents au niveau d'habitat (relevé Ph. de Carbonnières).
face. Diam. du bord externe : 208 mm (fig. 112).
A.312.9 : sphère (boule de potier?) en pierre calcaire dure façonnée par martelage; diam. : 87 mm (fig. 113).
La couche 2 sous le sol d'atelier est une couche de nivellement assez mince qui va s'épaissis- sant vers le sud-est, dans le sens de la pente naturelle du terrain. Le matériel peu abondant recueilli dans cette couche n'est pas sensiblement différent de celui analysé ci-dessus et comporte également, à côté d'un bronze du monnayage de Carthage datable du milieu ou de la seconde moitié du IIIe siècle (cf. J. K. Jenkins, S.N.G., type 224-225), quelques tessons de cam- panienne A : un fragment de fond de forme 27, un bord de forme 28. Il faut donc admettre que l'atelier établi en ce point a fonctionné durant un espace de temps assez bref datable entre l'extrême fin du IIIe siècle et les premières années du IIe. On notera que ce dernier terminus post quern était déjà celui qu'il fallait retenir
pour une couche de même facies relevée en 1975 dans le sondage a en G III 15, où, sembla- blement aussi, un niveau unique de sol d'habitat postérieur scellait la couche des ateliers (cf. supra, p. 81).
Comme il a été dit plus haut, toute la partie ouest du carré G IV 2 a été bouleversée, dès l'Antiquité, et vraisemblablement à deux reprises : d'abord par les constructeurs augustéens du «mur Lapeyre», bâti au détriment de l'élévation du mur punique voisin (fig. 114), puis par les bâtisseurs des lourdes fondations de l'édifice romain tardif, qui surplombent tout le secteur. C'est plus vraisemblablement aux premiers intervenants qu'on attribuera aussi le bouleversement des couches situées en contrebas des fondations puniques tardives. A ce niveau - cote 48,00-48,10 (fig. 115) - a été recueillie la calotte crânienne d'un adulte de sexe apparemment féminin - à considérer la faible saillie de l'arcade sus-orbitale : fig. 116 -, ainsi que quelques fragments d'os longs, dans un contexte atypique où quelques tessons amorphes de cerami-
248 BYRSA I
Α.ΤΊ2
13 15
19
18
0 5 cm Ph.de Carbonnieres
Fig. 112 - Matériel de la couche d'atelier (Α. 312) (del Ph. de Carbonnieres).
que punique à couverte rouge pourraient suggérer une date haute pour ce qui semble bien avoir été une sépulture bouleversée et pillée. C'est là un premier indice, mais d'une netteté insuffisante, de la nature funéraire du niveau punique le plus profond sous les maisons puniques tardives du secteur A.
2.2) Fouille en F III 3/ F II 15 à l'angle externe de l'îlot B.
Parallèlement à la fouille effectuée en G II 9/13 (cf. supra, p. 210), une recherche strati- graphique a été entreprise en F III 3, en limite sud-est de l'îlot B, et particulièrement à l'angle sud de cet îlot.
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 249
Dans ce secteur, les niveaux puniques et les élévations qui subsistaient encore après la destruction de 146 ont nécessairement été affectés par les terrassements faits à l'époque augus- téenne pour mettre en place les grands soutènements à absides qui limitent de ce côté-ci l'esplanade, en bordure du decwnamis I sud d'époque romaine : les éléments de ces soutènements
Fig. 113 - Matériel de la couche d'atelier : boule de potier (cl. S.L.).
Λ ν
-y Λ • ,ί
*£[;£''' ,. . ·;-_^./Χ..
r:.
\T ' ";»<.
Fig. 115 - G IV 2 : sous le nheau d'atelier, marqué par l'amphore-poubelle P4, les restes osseux d'une tombe anté
rieure (T) (cl. S.L.).
Fig. 114 - G IV 1/2 : le «mur Lapevre» (ML) au nheau des fondations (F) de l'angle ouest de l'îlot C (cl. S.L.).
Fig. 116 - G IV 2 : la calotte crânienne de la couche A. 315 (niveau de la tombe bouleversée (cl. S.L.).
épargnés par la fouille faite par Beulé en 1859 sont visibles en F II 13 et 14. Cette situation explique que non seulement l'élévation du mur périmétral a, en grand appareil à joints vifs, se soit écroulée, mais que la fondation elle-même, pourtant puissante, ait basculé dans la pente (fig. 117 et 118).
La coupe stratigraphique faite au droit du mur a, à l'extérieur de l'îlot, a fait apparaître, au-dessous de la partie basse de la couche de démolition punique laissée en place par nos prédécesseurs (couche /), une succession de strates
250 BYRSA I
·' "" "*"" , - .^■.....,,,^,τ».,^,. .
\% · · — · « . r __r i »4 -if*- ' * -^n, ] „ _ .
.4^.1
;. ;:..^^-·;; _ -- ---r-^^Sè
Fig. 117 - Coupe stratigraphique perpendiculaire au mur périmétral a de l'îlot Β (en F, le ressaut de fondation)/ (cl. S.L.).
approximativement horizontales, avec un léger pendage sud-est; ces couches, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont toutes recoupées par la fosse de fondation (2 a) très apparente du mur a (fig. 119).
La couche 2 est une couche détritique grise, assez mince - 5 à 6 cm -; outre divers tessons amorphes de céramique punique achrome, dont un fragment de jatte à marli plat (pour le profil, cf. fig. 120, A. 13 1.1), ainsi que de nombreux tessons amorphes de pots à feu à pâte brique, cette couche comportait le matériel suivant (fig. 120) :
A. 129.1 : fragment de fond de patere (forme 5 ou 55); pâte ocre brune, vernis noir luisant légèrement bleuté; feuille de lierre et double cercle de guillochures sur le fond interne.
A. 129.2 : fragment de bord de forme 24/25; mêmes caractéristiques que le précédent.
A.129.3 : fragment de bord de forme 28; pâte marron, vernis noir faiblement luisant.
A. 129.4 : fragment de bord de forme 55; pâte ocre marron, vernis noir luisant à reflets bleutés.
A. 129.5 : fragment de bord de forme 34; pâte gris moyen, vernis gris-noir. Une monnaie du monnayage de Carthage,
datable du milieu du IIIe siècle (cf. J. K. Jenkins, S. Ν. G., type 94-98), trouvée également dans la couche, n'en est pas l'élément dateur, lequel est fourni par la céramique campanienne A (A.129.1 à 4), qui ne permet pas de remonter plus haut que le début du IIe siècle.
La couche 3 est une strate d'une épaisseur de 10 à 20 cm, homogène, surtout constituée de sable tassé et damé, contenant peu de matériel : A. 131.1 : fragment de bord de céramique puni
que achrome : bord de jatte profonde à large marli plat obliquant vers l'extérieur; pâte feuilletée verdâtre au cœur, blanchâtre en surface.
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 251
Fig. 118 - Plan partiel au 1/50« du secteur F II 15/F III 3.
A. 13 1.2 : fragment de bord de céramique punique; pâte ocre, surface beige, repeints (palmes) brunâtres. Autres matériels : nombreux fragments d'opus
albarium, plusieurs tessons amorphes de céramique attique tardive, d'imitations à pâte grise de céramique à vernis noir, tessons enfin de campa- nienne A, ces derniers fournissant un terminus post quern identique à celui de la couche précédente.
La couche 4, comme la couche 2, est une couche détritique grise, plus riche en charbons, plus épaisse - environ 10 cm -, comportant des éléments de scories de fer, des éclats de cornaline et un fragment important d'une tuyère de terre cuite (A.132.5). Matériel de cette couche 4 (fig. 121) : A. 132.1 : tesson de pied de patere de céramique
précampanienne (?); pâte beige rosé finement épurée, vernis noir lisse, luisant.
252 BYRSA I
A.132.2 : tesson de fond et de pied d'une petite patere; pâte gris-beige, vernis brunâtre inégalement réparti.
A. 132.3 : bord de forme 25 (?) à pâte beige, vernis brun-noir.
A. 132.4 : tesson d'embouchure d'amphore gréco- italique; pâte ocre feuilletée, dégraissant siliceux blanc, surface blanc-beige.
A. 132.5 : fragment de tuyère de terre cuite, pâte brique au cœur, brunâtre et vitrifiée en surface.
Outre divers fragments amorphes de céramique punique achrome, on ajoutera quelques tessons amorphes de céramique campanienne A qui ne permettent pas, pour cette couche également, de remonter plus haut que le début du IIe siècle.
La couche 5, comme la couche 3, est une couche de sable tassé et damé d'épaisseur inégale, disparaissant en biseau vers le mur a, du côté du nord-ouest. On y relève, outre divers tessons amorphes de céramique punique achrome, quelques scories de fer, un fragment de tuyère en terre cuite, quelques ossements d'animaux. Autre matériel (fig. 120) :
2 3
1
F III 3
Fig. 119 - Coupe perpendiculaire au mur a de l'îlot Β (relevé Ph. de Carbonnières).
5cm
Fig. 120 - Matériel des couches de la coupe stratigraphique perpendiculaire au mur périmétral de l'îlot Β
(del Ph. de Carbonnières).
A. 133.1 : deux petits fragments reconstituant peut-être partiellement une forme 4; pâte beige, vernis noir lisse, brillant.
A. 133.2 : grand fragment de bord de forme 23, à rebord faiblement plongeant; pâte beige rosée, vernis noir peu luisant, rayé.
A. 133.3 : fragment de bord de forme 24/25; pâte beige rosé, vernis noir brillant.
A. 133.4 : fragment de bord de forme 25; même caractéristiques que le précédent.
Ces céramiques à vernis noir suggèrent pour cette recharge de sol sablonneuse un terminus post quern un peu plus haut que précédemment, vers la fin du IIIe siècle.
La couche 6 est, comme 2 et 4, une couche détritique grise, d'épaisseur variable. On y constate, parmi les tessons de céramique punique achrome, deux petits fragments de tuyères en terre cuite. Autre matériel (fig. 121) :
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 253
A. 134.1 : fragment de pied de coupe ou de craté- risque; pâte beige rosé finement épurée, vernis noir brillant.
A.134.2 : tesson de bord de forme 25 ou 21/25 (plusieurs exemplaires identiques); mêmes caractéristiques que le précédent.
On proposera pour cette couche 6, avec prudence, compte tenu du peu de matériel recueilli et analysé, une datation seconde moitié ou fin du IIIe siècle.
Sous la couche 6, le haut de la couche 7, fortement tassé, représente vraisemblablement le plan de circulation initial, fait avec des terres rapportées pour compenser la déclivité du sol naturel (couche 8 : cf. fig. 122). Les seules céramiques à vernis noir recueillies dans cette couche 7 sont deux petits tessons amorphes de céramique attique tardive. La céramique punique est plus abondante et comporte notamment deux fragments de panses de gros vaisseaux (épais-
A132
F 1113
A 133
V
A 134
V
0 5 cm Fig. 121 - Matériel des couches de la coupe stratigraphique perpendiculaire au mur périmétral de l'îlot Β (del Ph. de Carbonnières).
5m
Fig. 122 - Approfondissement de la coupe stratigraphique perpendiculaire au mur périmétral de l'îlot B; 8 : sol naturel; 9 : dalles de couverture de la tombe A 136 (relevé
Ph. de Carbonnières).
seur : 25 à 30 mm) qui rappellent les fragments de parois de tabounas mis au jour en G IV 2 (cf. A.312.5 et 6 : supra, fig. 110). Autre matériel (fig. 123) : A.135.1 et 2 : deux tessons de marli de patères
puniques à godet central; pâte ocre légèrement feuilletée, engobe rouge orangé sur le bord supérieur.
A. 135.3 : bord de jatte; pâte ocre brun, surface beige pâle, repeints de bandes et filets rouges et rouge brun.
A. 135.4, 5 et 6 : fragments de bord d'une jatte (A.135.6), et de formes fermées (A.135.4 et 5); pâte verdâtre au cœur, blanchâtre à beige en surface.
254 BYRSA I
A 135
0 5cm Fig. 123 - Matériel de la couche 7 (del Ph. de Carbonnières).
Cette couche de nivellement 7 contient donc un matériel dont la dispersion chronologique semble assez large, entre le VIe siècle et la fin du IVe siècle.
On est ainsi en présence d'une rue ou chaussée dont le plan de circulation initial, c'est-à-dire la surface de contact des couches 6 et 7, peut avoir été constitué dans la seconde moitié du IIIe siècle, au plus tard à la fin du IIIe siècle. Les recharges successives 5 et 3, et les couches détritiques 4 et 2, accumulations de rebuts jetés à même la chaussée, s'échelonnent entre la fin du IIIe siècle et 146. On soulignera la présence de scories et de tuyères dans les couches 4 et 5, en coïncidence chronologique avec les constats faits en G IV 2 lors de la même campagne, ainsi que précédemment en G III 15 (cf. supra, p. 241 et 77).
Un égout, plutôt qu'un drain, parcourait cette rue dans son axe sous la forme de panses d'amphores emboitées qui ont été partiellement retrouvées (fig. 119 et 124). Cet aménagement repose sur la couche 6 et recoupe toutes les couches supérieures, y compris la couche 2 : il appartient donc au dernier état de la rue, ce que confirme l'analyse d'un prélèvement de matériel fait dans la cavité d'une de ces amphores (fig. 120) :
A. 137.1 : tesson de bord de forme 22, pâte beige, vernis noirâtre écaillé, bande d'empilement sous le bord externe.
A. 137.2 : tesson de bord de forme 28; pâte et vernis gris.
A. 137.3 : tesson de bord de forme 25/26, pâte et vernis gris.
A. 137.4 : tesson, de bord apparenté au profil 22; pâte beige, vernis brunâtre, bande d'empilement sous le bord externe.
A. 137.5 : fragment de bord de jatte à marli plat (céramique punique achrome); pâte feuilletée verdâtre au cœur, blanchâtre en surface.
Ce sont deux petits tessons amorphes de cam- panienne A (non dessinés) qui fournissent pour ce dépôt une datation dans la première moitié du IIe siècle.
De même, on constate que toutes les strates représentant les recharges de sols ou les couches détritiques qui leur sont superposées viennent buter sur la fosse de fondation 2 a an mur périmétral a de l'îlot B, qui les recoupe. On doit
Fig. 124 - Egout fait de panses d'amphores dans l'axe de la rue (cl. S.L.).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 255
en conclure que ce mur en grand appareil a été bâti à la fin de la séquence chronologique observée, ce que confirme l'analyse du matériel recueilli dans cette fosse de fondation.
Le haut de la fosse (lot A.139) comporte un matériel abondant : tessons amorphes de céramique attique tardive, tessons de bords d'imitations à pâte grise (un bord de forme 25, un bord de forme 28), plusieurs tessons de campanienne A, dont un fragment de fond de patere, un bord de forme 31, un bord de forme 21. Ce sont ces derniers tessons qui fournissent le terminus post queni. On retiendra également comme élément dateur une estampille d'anse d'amphore rhodienne (cartouche de 41 χ 16 mm) (fig. 125) : Έτζί Πρατοφάνευς Άρταμιτίου, timbre qui fournit, sous sa forme dialectale rhodienne (Πρατοφάνης = Πρωτοφανής), le nom d'un prêtre d'Hélios en fonction vers 180 av. J.-C.51.
Fouillé séparément, le fond de la fosse (lot A.138), sous le niveau du ressaut de fondation, a livré plusieurs tessons de campanienne A dont (fig- 120) : A. 138.1 : tesson de bord de forme 55; pâte marr
on, vernis noir à reflets bleutés. A.138.2 : tesson de bord de forme 28; pâte ocre
marron, vernis noir à reflets bleutés.
On retiendra donc une datation très tardive, dans le 2e quart du IIe siècle, pour la construction du mur a de l'îlot B, sinon pour la construction de l'îlot Β dans son ensemble.
En un second temps, l'approfondissement du sondage stratigraphique entrepris en F III 3 a mis en évidence, au niveau de la couche 8, et tranchant sur les teintes ocres et blanches de ce sol naturel, les découpes horizontales et verticales d'une fosse remblayée de façon homogène avec du sable jaune, légèrement mélangé de particules d'argile et de charbon de bois (fig. 126 et 127).
A 3,80 m sous le niveau de la couche 2, soit à la cote 42,53, apparaissent au fond de la fosse des dalles irrégulières de tuf de l'Aouina, simple-
S| Cf. RE, suppl. V, col. 839, n° 253. Le nom de ce prêtre apparaît sur huit timbres de Lindos (M. P. Nilsson, Timbres mnplioriqiies de Lindos, p. 475, n° 362) avec d'autres noms de mois : Agrianios, Badromios, Thesmophorios, Theudaisios; a\ec le mois Artamitios, comme ici, sur une anse timbrée de la Pnyx : Hcsperia, suppl. X, p. 144, n° 104.
Fig. 125 - Estampille d'amphore rhodienne recueillie dans la fosse de fondation du mur a (cl. S.L.).
»*.»_»..· . ti» ü **«^ '^L· ' .-.•♦«.11. ■
Fig. 126 - La fosse de la tombe A 136 avant la fouille (cl. S.L.).
256 BYRSA I
méthode de l'activation neutronique^2, a permis
Mangan Titane Sodium
II s'agit donc de sulfure de mercure, ou cinabre, dont on connaît la teinte rouge caractéristique, fréquemment constatée en Afrique du Nord dans des sépultures préromaines de diverses époques53. Les autres éléments - aluminium,
Fig. 127 - La fosse de la tombe A 136 après la fouille (cl. S.L.).
ment posées en couverture sur le rebord d'un caveau creusé dans le tuf argileux (fig. 122 et 128 : tombe A.136). Au môme niveau, à 1,50 m au sud-est, la fouille mettait au jour les dalles de couverture d'une autre tombe à fosse de même type (A.136 bis).
La tombe A.136 est la tombe à inhumation, orientée nord-sud - tête au nord : fig. 129) - d'un adulte de haute stature - environ 1,75 m -, de sexe masculin, âgé de 20 à 30 ans, présentant sur le côté droit de l'os frontal une dépression béante qui peut être la trace d'une plaie mortelle. Le squelette se présente en decubitus dorsal, le crâne légèrement tourné du côté gauche. Le massif facial - os nasal et maxillaire supérieur : fig. 130 - portait des traces abondantes d'un pigment de couleur rouge vif.
L'analyse qualitative puis quantitative d'un échantillon de ce pigment, faite suivant la
A 136 bis Fig. 128 - Les deux tombes avant dépose des dalles
de couverture (relevé Ph. de Carbonnières).
s: Comme les analyses ci-dessus présentées - cf. supra, p. 243 -, cette analyse a été réalisée par M. J. Diebolt grâce au réacteur à haut flux du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble : qu'il veuille bien trouver ici nos très vifs remerciements pour son obligeant concours.
S1 Reprenant les observations très précises faites par E. G. Gobert et P. Cintas dans des sépultures puniques tardives (IIIe siècle) du Sahel tunisien, notamment à Smirat (cf. Rev. Tunisienne, 1941, p. 83-121, notamment p. 110-118), G. Camps a souligné, dans une mise au point d'ensemble sur les diverses manifestations en Afrique du Nord du «rouge
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 257
Fig. 129 - L'inhumation A 136 (cl. S.L.).
funéraire» (Aux origine:, de la Berbérie. Monuments et rites fnnéiaires piotohistoric/ues, Paris, s.d. (1961), p. 522-525), que, dans la plupart des cas, du constat de la présence de fard funéraire sur les ossements, il ne fallait pas conclure à une pratique de decharnement; en fait, après dissolution des chairs, le pigment déposé sur la face se fixe sur les os sous- jacents. Mais rien ne permet d'ajouter (ibid., p. 524) que «cette pratique paraît localisée au Sahel tunisien et limitée à la fin des temps puniques». En Algérie, des dépôts de fard funéraire ont été observés dans plusieurs tombes de la nécropole préromaine de Tipasa, et notamment dans une sépulture datable du début du IVe siècle (cf. S. Lancel, dans Bull. d'Aich. Alg., III, 1968, p. 111); à Djidjelli, M. Astruc a constaté le dépôt de fard sur la face dans une tombe datable du Ve siècle (cf. Rev. Afric, 80, 1937, p. 207). En Tunisie même, en dehors des sites du Sahel, où le rite est particulièrement attesté, la présence de fard funéraire sur les parties saillantes de la face a été signalée à Carthage dans des tombes archaïques de la colline de Junon (cf. Rev. Tunisienne, 1941, p. 1 1 1), et P. Gauckler fait à plusieurs reprises mention de «cinabre» dans ses carnets de fouilles de la nécropole de Dermech (cf. Nécropoles puniques de Carthage, 1er«-* partie, p. 21, 106, 119); à Utique, enfin, le rite a été constaté dans
une tombe du VIIe siècle (cf. Et. Colozier, dans Karthago, V, 1954, p. 159). Bien que la nouvelle attestation ajoute une pièce au dossier du fard funéraire à Carthage, la moindre fréquence du rite dans la métropole punique peut s'expliquer du fait que cette pratique indigène remontant à la protohistoire s'est imposée plus facilement en milieu rural et dans les «provinces».
Pour nous en tenir ici à la haute époque et à Carthage, on peut se demander quel était l'origine de ce cinabre - fard funéraire particulièrement luxueux, à distinguer soigneusement des ocres fournis notamment par des argiles ferrugineuses -, postulé, sinon vraiment attesté par Gauckler dans ses tombes de Dermech, signalé sans certitude dans des tombes archaïques de la colline de Junon, et maintenant reconnu comme tel dans sa composition chimique incontestable dans la tombe A.136. A défaut de mines connues comme exploitées dans l'Antiquité en Afrique du Nord même, on pensera aux mines de Sisapo (Almadén, à 1 18 km au nord de Cordoue), en Bétique, attestées comme fournissant du cinabre depuis l'époque de Théophraste (De Lap., 58), à la fin du IVe siècle (cf. aussi Pline, H.N., XXXIII, 118). Une origine espagnole, à haute époque, ne serait pas surprenante.
258 BYRSA I
* ν.
ι f .
Λ·;. ',<< *
h* Λ/Ϊ'^ϊύ
» /ν Α>ν^ ν* *-»■ «
Fig. 130 - Crâne de l'inhumation A 136; les zones sombres de la région nasales et du maxillaire supérieur étaient
pigmentées de cinabre (cl. S.L.).
manganèse, titane, sodium - sont vraisemblablement des constituants provenant de l'argile qui adhérait à ce fard funéraire.
Probablement en raison du flottement causé par les eaux d'infiltration dans la fosse, le squelette reposait à mi-hauteur du volume intérieur de la tombe, à un niveau supérieur, donc, à celui du mobilier funéraire que la fouille a mis au jour au niveau du fond de la fosse - cote 42,15 -, groupé pour l'essentiel de part et d'autre de la tête (fig. 131). On décrit ici les différentes pièces de ce mobilier funéraire (fig. 132) selon leur ordre d'émergence dans le déroulement de la fouille. A. 136.1 : Œnochoé à collerette largement évasée,
dite oenochoé à bobèche («mushroom vase»), profil Cintas 65 (fig. 133 et 134).
Dim. (en mm) : haut. : 173; larg. de la collerette : 75; larg. max. : 82. Pâte ocre rouge clair, bien épurée, surface lissée de même couleur; deux filets de peinture noire sur l'épaule au-dessous de l'attache de l'anse, un filet noir sur le col, au-dessus de l'attache supérieure de l'anse. L'embouchure ainsi que le haut du col au-dessus du filet noir sont enduits d'un engobe rouge sombre brillant {red slip).
A.136.2 : Aryballe de type protocorinthien subgéométrique, de profil ovoïde (fig. 135 et 136). Dim. en mm : haut. : 65; diam. de l'embouchure : 27; larg. max. : 43. Pâte ocre rose un peu grenue; trois bandes et un filet de vernis rouge orangé brillant sur la panse; une bande de même vernis sur le rebord plat de l'embouchure, traces de vernis sur l'anse.
A. 136.3 : Œnochoé à embouchure trilobée et anse à double boudin, profil Cintas 193
A136
A136bis
Fig. 131 - Les deux inhumations et le mobilier funéraire en place (relevé Ph. de Carbonnières).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 259
»," "<?-■" ;
Fig. 132 - Le mobilier funéraire céramique de la tombe A 136 (cl. S.L.).
(fig. 137 et 138). Dim. en mm : haut. : 228; larg. max. : 119. Pâte ocre rouge bien épurée, surface lissée de même couleur, non engobée, à l'exception de l'embouchure et de la partie supérieure de l'anse, qui fait saillie : l'objet, après tournage, a été trempé la tête en bas dans un bain d'engobe rouge sombre brillant {red slip), geste et procédé constatés ailleurs en Afrique du Nord, à diverses époques54.
A.136.4 : Kotylè de type protocorinthien subgéométrique (fig. 139 et 140). Dim. en mm : haut. : 88; diam. sup. : 108. Pâte chamois clair, fine, sonnante, bien épurée; surface lissée couleur coquille d'œuf. Décor (repeints brun rouge à brun noirâtre) : six dents de loup montant du
S4 Par exemple à Tipasa (Algérie), sur une œnochoé à embouchure trilobée et anse à double boudin, datable seulement du IVe siècle (cf. S. Lancel, dans Bull. d'Arch. Alg., III, 1968, p. 127 et fig. 92).
fond sur la moitié inférieure, puis filets horizontaux surmontés sous le bord par des files de hérons stylisés entre deux rangées de bâtonnets; anses presque exactement horizontales.
A. 136.5 : Bol à une anse sur plan vertical, profil Cintas 58, plan de pose étroit et irrégulier ne permettant pas la stabilité (fig. 141 et 142). Dim. en mm : haut. : 64. Pâte ocre rouge à rouge brique, grenue, bien cuite, surface blanchâtre à rose.
A. 136.6 : Patere à rebord légèrement rentrant, formant carène assez accentuée (pour le profil, cf. D. B. Harden, dans Iraq, IV, 1937, fig. 7, p. 83, forme k). Dim. en mm : haut. : 30; diam. sup. : 142 (fig. 143). Mêmes caractéristiques que 1 et 3; ni engobe ni vernis.
A.136.7 : Bol de même type et de même profil (Cintas 58) que A.136.5; plan de pose permettant la stabilité (fig. 143 et 144). Dim. en mm : haut. : 96; diam. sup. : 112.
260 BYRSA I
A 136 -Vase 1
1
0 5cm
Fig. 133 - Tombe A 136; vase 1 (del Ph. de Carbonnières).
Fig. 134 - Tombe A 136, \ase 1 (cl. S.L.).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 261
A 136 .Vase 2
0 5cm Fig. 135 - Tombe A 136, \ase 2 (del Ph. de Carbonnières). 0 5cm
Fig. 137 - Tombe A 136, vase 3 (del Ph. de Carbonnières).
A 13 6 .Vase 3
Fig. 136 - Tombe A 136, vase 2 (cl. S.L.). 0 5cm
Fig. 138 - Tombe A 136, vase 3 (del Ph. de Carbonnières).
262 BYRSA I
A 136 Vase Λ
A 136
5cm
Fig. 139 - Tombe A 136, vase 4 (del Ph. de Carbonniòres).
0 5cm
Fig. 141 - Tombe A 136, vase 5 (del Ph. de Carbonniòres).
to
-3 -'
"I, ■ Λ- . *■ ·
» ·.. ♦
. . -Λ. / /
r. -y - *' - ' y ' -, ^^p*
Fig. 140 - Tombe A 136, \ase 4 (cl. S.L.). Fig. 142 - Tombe A 136, \ase 5 (cl. S.L.).
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 263
Vase 7
Vase 6
A 136 5 cm
Fig. 143 - Tombe A 136, vases 6 et 7 (del Ph. de Carbonnières).
■ ~*z * ·
• } ν ■ ■ ; · .% ♦ ,
Trois petits objets complétaient ce mobilier funéraire. Ils ont été retrouvés, l'un, le scarabée A. 136.8, le long de l'avant-bras gauche du mort, les deux autres, deux anneaux de bronze (A.136.9 : diam. 23/24 mm : fig. 145; A.136.10 : diam. : 26 mm, fig. 146), respectivement au majeur de la main gauche et parmi les doigts du pied gauche du mort.
Le scarabée A. 136.8 (fig. 147) est en pâte siliceuse blanchâtre, très friable^, sans trace d'émail. La face dorsale, de modelé médiocre, figure le prothorax - ici démesurément développé - et les élytres, mais le clypeus est à peine marqué et les pattes ne sont pas visibles en plan. L'état actuel du plat, peu profondément gravé, rend difficile la lecture de la légende hiéroglyphique au-dessus du signe nbst.
La tombe voisine A.136 bis est également une tombe à fosse non construite, orientée nord- nord-est/sud-sud-ouest, dont la proximité de la grande fouille faite par Beulé dans ce secteur (cf. supra, p. 14 et 62) peut expliquer l'état de conservation sensiblement moins bon que la précédente, plus en retrait par rapport au front de la fouille de Beulé : les dalles de couverture de la tombe A.136 bis se sont effondrées, endommageant le squelette et le mobilier funéraire.
Les restes osseux (fig. 148), sont ceux d'un adulte de sexe féminin, déposé sur le dos, mais apparaissant à l'ouverture de la tombe en décu-
Fig. 144 - Tombe A 136, \ase 7 (cl. S.L.).
" Ce petit objet que son extrême fragilité au moment de la découverte condamnait à disparaître a été consolidé par une méthode de rayonnement à très forte intensité mise au point par le Service d'Application des Radio-éléments et des Ra\onnements du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. Nous remercions très vivement ici de leur aimable concours les ingénieurs du Projet Nucleari de ce Centre. Rappelons qu'entre autres réalisations de consolidations d'objets archéologiques, c'est ce laboratoire qui a piloté l'opération de nettoyage et de consolidation de la momie de Ramsès II, réalisée à Orsay pour des raisons pratiques. M. A. Beschaouch, Directeur Général de l'Institut National d'Archéologie et d'Arts de Tunis, a visité les locaux du Projet Nucleari au CENG de Grenoble le 10 juin 1977, et a bien voulu associer aux nôtres ses propres remerciements à cet organisme.
S6 C'est le type IV a de la classification formelle de New- berry, reprise par J. Vercoutter, Les objets égyptiens et égypti- sants du mobilier funéraire carthaginois, Paris, Geuthner, 1945, p. 72. Il s'agit peut-être d'une imitation de nom royal, ou d'une confusion de noms royaux; cf., pour des gravures très proches, J. Vercoutter, op. cit., p. 102, n" 32 et 33.
264 BYRSA I
Fig. 145 - Tombe A 136, objet 9 (cl. S.L.).
A 136
, ♦ '»/.
?ϊ·.·
'/'""..' ::~ίΖαίϊ?>
/ ..·»
\Ί • /
\ ν
*ί "Ί
Fig. 146 - Tombe A 136, objet 10 (cl. S.L.). Fig. 148 - L'inhumation A 136 bis (cl. S.L.).
1"ä^ t V«: -Sl ^-"5* »^f*
itì «V^^'-J
Fig. 147 - Tombe A 136, objet 8 : scarabée en pâte (cl. S.L.).
bitus légèrement latéral et fléchi sur le côté droit. Après enlèvement des ossements et du matériel on a pu constater distinctement au fond de la tombe la trace rectangulaire de ce qui semble être l'empreinte laissée dans l'argile par un cercueil (fig. 149). Cette empreinte présente une surface jaunâtre, des angles vifs remontant vers le haut, ainsi que la marque de planches dont la plus large mesure 19/20 cm de largeur. Cependant, aucun vestige de bois ni de clous n'a été retrouvé.
Le mobilier, disposé comme précédemment dans la région antérieure de la tombe, a souffert, comme nous l'avons dit, de l'effondrement des dalles de tuf de la couverture. Il est par ailleurs sensiblement plus pauvre, en qualité comme en quantité, que le précédent.
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 265
A 136 bis
«zn
5 cm
Fig. 150 - Mobilier de la tombe A 136 bis; objets 1 et 2 (del Ph. de Carbonnières).
Fig. 149 - L'inhumation Λ 136bis api es depose des ossements; empreinte d'un collie ou cercueil (cl. S.L.).
A.136bis.l : Bol du type à une anse verticale (profil Cinlas 58) (fig. 150). Dim. en mm : haut. : 82; larg. max. : 1 13. Pâte ocre rose, très cuite, surface blanchâtre.
A.136bis.2 : Bol de même profil que le précédent (fig. 150), à simple têton de préhension à la place de l'anse. Dim. en mm : haut. : 81; diam. bord : 92; pâte ocre rose, brunâtre au cœur, feuilletée, à gros dégraissant siliceux, surface blanchâtre.
A.136bis.3 : Patere à bord évasé (pour le profil, cf. D. B. Harden, dans Iraq, IV, 1937, fig. 7, p. 83, type E2) (fig. 151 et 152) dim. en mm : haut. : 34; diam ext. : 106. Pâte ocre rouge, fine, bien épurée, surface lissée de même couleur, sans engobe ni vernis.
5cm
A 1 36 bis
Fig. 151 - Mobilier de la tombe A 136 bis; objets 3 et 4 (del Ph. de Carbonnières).
266 BYRSA I
Fig. 152 - Tombe A 136 bis; vase 3 (cl. S.L.).
A.136bis.4 : fragment d'une patere à large marli (cf. D. B. Harden, dans Iraq, IV, 1937, fig. 7, p. 83, type M1-M2); même pâte et même surface que le précédent.
Le mobilier de cette deuxième tombe A.136bis n'est pas datable, si ce n'est, de façon large, des VII- VIe siècles, en particulier à cause des bols de forme 58, chronologiquement limités à la période archaïque. En revanche la tombe A. 136 comporte dans son matériel au moins un élément dateur sûr, le kotyle A. 136.4, de type subgéométrique contemporain des aryballes ovoïdes : avec ses dents de loup occupant tout le bas de la panse jusqu'à mi-hauteur, ses files de hérons très stylisées sous le rebord, il entre dans cette série standardisée déjà bien représentée à Carthage57, et que l'on date communément du 2e quart ou du milieu du VIIe siècle1'8. Quant à l'ary- balle de profil ovoïde A. 136.2, il est d'un type qu'il n'est pas surprenant de voir daté de cette époque. Il n'est pas certain toutefois que notre exemplaire, un peu lourd, à parois un peu trop épaisses, à pâte un peu trop foncée, soit d'importation corinthienne : une origine étrusque ne serait pas impossible159.
" Cf. S. Boucher, Céramique archaïque d'importation au Musée Lavigerie de Carthage, dans Cahiers de Byrsa, III, 1953, p. 15 et pi II et III (n° 18, 19 et 20).
S!l Cf., outre S. Boucher, citée supra, qui donne aussi ces datations, F. Villard, La chronologie de la céramique protocorinthienne, dans MEFR, 60, 1948, p. 7-34, et F. Villard et G. Vallet, Les dates de la fondation de Megara Hyblaea et de Syracuse, dans BCH, 76, 1952, p. 283-346.
S9 Des imitations étrusques de céramique corinthienne, mais plus tardives (époque des aryballes piriformes) ont été
Cette tombe du milieu du VIIe siècle nous fournit une des dates les plus anciennes, semble- t-il, des niveaux funéraires jusqu'ici fouillés sur la colline de Byrsa60. La composition de son mobilier, en dehors des deux objets d'importation certaine, le kotyle et l'aryballe, appelle quelques remarques provisoires. Notons tout d'abord qu'à cette époque qui est celle des premiers temps de Tanit II61, on constate encore la présence de lustre rouge partiel sur des oeno- choés de profil 65 et 19362, qui figurent au demeurant, avec les bols de profil 58, parmi les composants de base du mobilier des tombes archaïques de Carthage, et notamment à Byrsa63. Mais on n'observe pas dans ce dépôt funéraire cette composition rituelle, pour la première fois soulignée par P. Gauckler64, remarquée depuis dans des tombes datées précisément comme celle-ci par un skyphos protocorin-
constatées dans le mobilier funéraire carthaginois : cf. S. Boucher, dans Cahiers de Byrsa, III, 1953, p. 29-30 et pi. XVI, n" 115 et 116.
M) Deux facteurs limitent malheureusement la portée de cette remarque de chronologie relative, et tout d'abord l'imprécision, parfois même l'inexistence des rapports de fouilles anciens sur ces pentes de la colline (cf. supra, p. 22 et 25 pour les fouilles Delattre et Lapeyre). La seconde raison tient à un problème fondamental non résolu (en dépit des généreux efforts de P. Cintas, en particulier dans Manuel d'Archéologie punique, t. I, Paris, 1970, p. 324-375 et 390-442, lequel a non seulement fait prendre conscience du problème, mais a fourni de bonnes approches de solution) : on hésite encore à proposer des datations absolues pour les tombes carthaginoises quand le matériel ne comporte pas de matériel grec importé; or ces tombes sont les plus nombreuses, dans la série des tombes archaïques, et un certain nombre d'entre elles sont nécessairement antérieures au milieu du VIIe siècle (cf. notamment P. Cintas, op. cit., p. 437- 438). Une étude plus complète de ces objets est réservée à une livraison ultérieure de la présente publication, dans le cadre d'une présentation d'ensemble des céramiques archaïques provenant des niveaux funéraires fouillés.
61 Nous adoptons la chronologie absolue de D. B. Harden, The Pottery from the Precinct of Tanit at Salammbô, Carthage, dans Iraq, vol. IV, 1, 1937, p. 86-87, reprise par P. Cintas, Manuel d'Archéologie Punique, t. I, p. 370-375 et p. 438.
62 On sait que pour P. Cintas, op. cit., p. 375-382, les vases à lustre rouge, même partiel, sont nécessairement importés. Les difficultés d'une telle thèse, pratiquement insoutenable, n'ont pas échappé à R. Rebuffat, Note sur les premici s temps de Carthage, dans Rev. des Et. Ane, LXXIII, 1-2, 1971, p. 169-170.
61 Cf. Ch. Saumagne, dans BCTH, 1932, p. 88-90. 64 Cf. Nécropoles puniques de Carthage, t. I, p. XXI.
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 267
Fig. 153 - Les niveaux puniques sous-jacents aux niveaux d'habitat punique tardif dans le secteur A (état 1976); en pointillé, les zones d'atelier (niveau 2); en poché noir, les tombes archaïques (niveau 3).
(Compléments graphiques S. Lancel sur fond de plan G. Robine).
268 BYRSA I
thien6S, qui a fait adjoindre aux deux œnochoés, toujours de même type, deux jarres ou amphores - dont presque toujours une à épaulement, de profil 235 -, ainsi qu'une lampe et sa patere de support. Mais il est vrai qu'à l'époque où nous sommes avec cette tombe A.136, le rituel commence seulement à se fixer et peut connaître des exceptions66.
S. L.
3) Conclusions : bilan et perspectives.
De cette campagne de fouilles menée en 1976 sur les niveaux puniques du secteur A, on tirera une triple série de conclusions provisoires, en fonction des trois niveaux stratigraphiques maintenant bien perceptibles.
3.1) Au niveau terminal, qui est celui de l'habitat punique tardif, le quartier se dessine maintenant avec une cohérence sensiblement accrue (cf. fig. 2). Aux rues I et II, séparant respectivement les îlots A et C, et Β et C, on peut désormais conjecturer d'ajouter une rue III, croisant la rue II et bordant les côtés sud-est des îlots Β et C. C'est du moins ce que suggère le gros solin en flan- quement du mur découvert dans le sondage profond pratiqué en H III 5, qui déterminerait la limite au sud-est, c'est-à-dire vers l'aval, de cette rue III; et l'on a vu que les plans de circulation de cette rue ont été reconnus en F III 3 (cf. supra, p. 205 et 254). Il y a donc chance de pouvoir bientôt tracer en plan, sur une cinquantaine de mètres, cette rue d'axe sud-ouest/nord-est. C'est l'un des apports que l'on peut escompter de la prochaine campagne.
Dans l'axe perpendiculaire à celui de cette rue III supposée, l'évidence acquise en 1976 est celle d'une ligne de pente très importante vers le sud-
'*> Cf. A. L. Delattre, dans BCTH, 1907, p. 16-19 (tombe de la colline de Junon); P. Cintas, Manuel d'Archéologie Punique, t. II, Paris, 1976, p. 277, fig. 30a (tombe de la colline de Junon).
^ Cf. déjà P. Gauckler, Nécropoles puniques de Carthage, I, p. XXI (introd. de D. Anziani aux carnets de fouilles de P. Gauckler) ; sur la constitution du rite, cf. en dernier lieu les précisions de P. Cintas, Manuel, t. I, p. 438-439.
est pour ces installations puniques finales. On sait maintenant qu'il ne faut pas espérer dégager dans l'immédiat, sous les milliers de mètres cubes de la masse encore conservée du remblai augustéen (cf. fig. 16), l'intégralité des structures du ou des îlots qui font suite aux îlots Β et C vers l'aval, de l'autre côté de la rue III encore hypothétique. Mais les sondages profonds pratiqués en H III 2 et H III 5, ainsi que la fouille déjà menée en G II 9/13 permettront en 1977 et 1978 d'axer avec plus d'efficacité les fouilles ponctuelles envisageables, de manière à parvenir à la restitution graphique la plus complète possible des niveaux puniques tardifs sur cette axe de plus grande pente, et notamment pour tenter de préciser les partis architecturaux adoptés pour racheter les dénivellations.
Parallèlement, la campagne de 1976, grâce à la fouille menée par J.-P. Thuillier dans la partie nord-est de l'îlot C, a permis aussi de préciser sensiblement l'organisation et la distribution internes de cet îlot. Un plan de maison apparaît maintenant assez clairement, sous la forme d'une unité d'habitation d'une largeur de 5 mètres (entre axes), pour une profondeur de 15 mètres, s'ouvrant au moyen d'un long couloir sur la rue III supposée (cf. supra, p. 228-229). Il semble que cette maison - qui serait dans cette hypothèse l'avant-dernière de cet îlot vers le nord-est - soit elle-même flanquée d'une unité d'habitation mitoyenne de largeur égale, dont le mur d'axe nord-ouest/sud-est (le mur B' de J.-P. Thuillier : cf. supta, fig. 81) pourrait marquer la limite nord-est de cet îlot C. Mais pour être plus aifirmatif il iaut attendre la prochaine campagne, qui tout à la lois confirmera ou infirmera ce dernier point et précisera le plan de la nouvelle unité d'habitation en cours de fouille. Nous sommes toutefois déjà fondés à souligner - supra, p. 240 - la mise en œuvre d'un plan élaboré pour ces unités d'habitation dans le développement desquelles il fallait organiser au mieux un espace limité sur un terrain en déclivité assez forte.
Sur le plan des constats chronologiques, nous avons vu qu'il fallait retenir une date très tardive, à la (in du premier quart ou courant deuxième quart du 11° siècle, c'est-à-dire très peu de temps avant la chute de Carthage, pour la construction du mur limitant au sud-est l'îlot B,
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976 269
et donc vraisemblablement pour la mise en œuvre de l'îlot dans son ensemble (cf. supra, p. 255). Avec une précision moindre, c'est aussi une datation très basse qui est suggérée par les derniers développements de la fouille pour les quelques structures d'un îlot, vraisemblablement distinct, mises au jour dans le secteur G II 9/13 (cf. supra, p. 212). Et l'on a noté également que les couches immédiatement sous- jacentes aux niveaux de sols uniques de la partie sud-ouest de l'îlot C, en G IV 2 - supra, p. 246 - et en G III 15 - supra, p. 81 - ne pouvaient être datées antérieurement au début du IIe siècle.
En revanche, de l'autre côté d'un alignement repéré (fig. 153), là où les sondages font apparaître plusieurs niveaux de sols (en G IV 4 et G III 16 : sondages h, c et cl, cf. supra, p. 81-94), les pavements les plus anciens peuvent remonter à la fin du IIIe siècle. Les divers éléments du quartier ne semblent donc pas tous rigoureusement contemporains, même si les écarts constatés sont inférieurs à un demi-siècle. D'autres sondages seront cependant nécessaires pour affiner la chronologie et tenter de préciser dans quelle mesure nous sommes en présence du développement progressif d'un plan orthogonal concerté et cohérent dont le schéma directeur aurait pu être conçu dans la deuxième moitié du IIIe siècle.
3.2) Sous les niveaux d'habitat, les résultats du sondage pratiqué en G IV 2, en manifestant de manière nette les vestiges in situ d'une installation métallurgique, ont donné leur plein sens aux constats incomplets - obtenus sur la base d'un matériel trop fragmentaire pour pouvoir être reconnu avec certitude - faits en 1975 en G III 15 et 16, et en G IV 4. Il est maintenant possible de reporter en plan (fig. 153) une aire assez vaste sur laquelle les fondeurs de fer ont laissé des traces nombreuses et claires de leur activité, déjà décelée, on l'a vu - cf. supra, p. 29 - par Ch. Saumagne au bas de cette même pente sud de la colline.
Cette activité, qui préexiste au développement complet de l'habitat dans ce secteur, a pu partiellement coexister (dans la partie sud-ouest de l'îlot C) avec les maisons en cours
tion à partir de la fin du IIIe siècle. La phase finale d'activité de ces installations se situe donc dans une fourchette chronologique assez étroite, entre la fin du IIIe siècle et les premières années du deuxième. Et l'on ne peut, pour tenter de fixer l'époque à laquelle le quartier a commencé d'être occupé par ces fonderies, remonter plus haut, dans l'état actuel de la fouille, que le début du IIIe siècle. On admettra donc provisoirement que les fondeurs de fer ont exercé là leur industrie durant la majeure partie du IIIe siècle, en débordant légèrement sur le IIe siècle, c'est-à- dire, approximativement, des débuts de la première guerre punique à la fin de la seconde.
3.3) Enfin, il semble désormais assuré que sous les niveaux d'ateliers, eux-mêmes sous- jacents au niveau d'habitat, le niveau profond de ce secteur est un niveau funéraire, et plus précisément, semble-t-il, un niveau funéraire archaïque : les deux tombes du VIIe siècle mises au jour en F III 3/F II 15 confirment les indications insuffisantes fournies auparavant par la fouille en G IV 2. Ajoutons que ces deux tombes ne sont pas isolées : l'examen du terrain alentour a permis de situer d'autres fosses, qui seront fouillées au cours des prochaines campagnes.
Il devient ainsi très probable que la nécropole archaïque attestée de façon dense dans les fouilles Delattre et Lapeyre jusqu'à la limite nord- ouest du quartier qui nous occupe se poursuivait vers l'est.
On sait que sur les autres collines - de Junon, de l'Odèon, de Bordj Djedid - qui forment un arc limitant la petite plaine littorale, les pentes qui font face à la mer ont été occupées par les nécropoles de l'époque archaïque. En était-il de même sur notre colline, dite de Byrsa, comme tendraient à l'indiquer - mais on a vu (supra, p. 35) la fragilité de ces indications - les tombes apparemment perçues par Ch. Saumagne dans ses fouilles du versant est? Dans ce cas, à époque haute, la ville des vivants aurait été pour l'essentiel cantonnée dans la zone basse, près des ports. Mais peut-on admettre, si Byrsa est bien Byrsa, c'est-à-dire l'acropole, que cette acropole ait pu être coupée de la ville basse par
270 BYRSA I
une ceinture de nécropoles? Autant, on le voit, de capitales questions, auxquelles l'occupation moderne du terrain sur la pente qui fait face à la mer à l'est et au sud-est ne permettra pas de donner de réponses certaines.
Pour en revenir de façon plus topique à notre secteur de fouilles, si la nature du niveau profond est incontestablement funéraire, reste maintenant soit à réduire, soit à expliquer l'hiatus d'au moins trois siècles que l'état actuel de la fouille fait apparaître entre ces tombes du VIIe
siècle et les niveaux d'ateliers du IIIe siècle. A défaut d'une exploration exhaustive des couches puniques profondes, qui n'irait pas sans la destruction des niveaux d'habitat tardif, on devra multiplier les sondages ponctuels, en se donnant pour objectif de multiplier aussi les attestations du niveau funéraire, de manière, si possible, à préciser son extension, sa densité et sa dispersion chronologique.
S. L.
RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LA CAMPAGNE
DE L'AUTOMNE 1976 (NIVEAUX ROMAINS)
par PIERRE GROS
La campagne de 1976 a été trop brève pour autoriser des dégagements importants, mais une série d'observations et de sondages permet de présenter sinon des conclusions assurées, du moins des thèmes de réflexion pouvant servir d'hypothèse de travail pour les années à venir. Notre attention s'est essentiellement portée sur le palier supérieur de la colline, celui qui est occupé de nos jours par le jardin du musée, et le cénotaphe de Saint-Louis, et dont la présentation est due aux aménagements imaginés par l'architecte Zehrfuss.
Les seuls vestiges antiques actuellement repé- rables à ce niveau - cote moyenne : 56 - sont deux alignements parallèles de colonnes orientés N.E.-S.W., distants l'un de l'autre de 20,65 m (mesure prise au nu interne des blocs du stylo- bate), dont subsistent plusieurs bases, et la quasi-totalité des assises de réglage. L'alignement le plus proche du cardo IV dominait directement la série des salles semi-circulaires dites absides de Beulé, puisque la face externe des plinthes des colonnes se situe à moins de 35 cm de la ligne tangentielle au sommet des absides.
La cohérence de ces dernières avec la colonnade, suggérée par le voisinage planimétrique, est confirmée par un détail d'implantation : les entrecolonnements apparaissent calculés en fonction de la position des absides, chacun d'eux se disposant symétriquement de part et d'autre de l'axe longitudinal de l'espace voûté, ou de l'espace plein intermédiaire (fig. 1). Aussi toute tentative de restitution de l'ordonnance monumentale du sommet de la colline qui n'intégrerait pas les absides de Beulé, ou du moins
l'espace dont elles constituent l'infrastructure, ne saurait être retenue.
En cela l'hypothèse présentée jadis par G. G. Lapeyre et A. Pellegrin paraît peu satisfaisante : l'idée de réunir les deux files de colonnes, trop éloignées pour avoir appartenu à un même portique, dans une sorte de réplique monumentale des «Piliers de Tutelle» de Bordeaux ou de l'Incantada de Salonique, pose plus de problèmes qu'elle n'en résout '. Sans soulever la question épineuse de la destination de ce genre d'enceinte à claire-voie et à ciel ouvert2, on notera qu'une telle restitution postule à tort l'existence, sur les petits côtés du quadrilatère ainsi défini, de colonnes en retour dont on ne retrouve en réalité aucune trace3, et limite arbitrairement l'étendue de la plate-forme, laissant les absides de Beulé dans une situation inorganique.
La présence d'une file de colonnes dans la proximité immédiate d'une série d'absides en contre-bas ne se justifie, d'un point de vue structurel, que si l'on suppose un portique, dont la largeur correspond à la profondeur des salles sous-jacentes, et dont le pavement repose sur l'extrados de leur couverture voûtée.
1 G. G. Lapeyre, A. Pellegrin, Carthage latine et chrétienne, Paris, 1950, p. 31 sq. et pi. IV. cf. infra, p. 272 et n. 11.
2 Sur les Piliers de Tutelle, « immense clôture à claire-voie qui aurait entouré le forum sévérien », cf. C. Jullian, Histoire de Bordeaux, I, Paris, 1895, p. 186 sq.
3 Le rapport de Lapeyre sur ce point est ambigu (CRAI, 1939, p. 302-303).
272 BYRSA I
Cette composition, caractéristique des sites en terrasse où l'on rachète volontiers les dénivellations au moyen de boutiques, magasins ou galeries couverts, qui, situés en sous-œuvre, servent d'appui aux éléments de façade du niveau supérieur, concilie la recherche de l'espace avec le souci de la monumentalité 4. Aussi en trouve-ton de nombreux exemples dès la fin du IIIe s. av. J.-C. Théoriquement deux solutions sont possibles, qui admettent chacune plusieurs variantes : ou bien le portique supérieur est ouvert sur ses deux faces, et il comporte alors deux nefs, séparées par une colonnade axiale. C'est le cas de la Stoa méridionale du sanctuaire de Demeter à Pergame, dont la nef sud est construite en surplomb, au-dessus d'une série de caves\ Ou bien le portique, fermé du côté de la pente, ne s'ouvre que vers la terrasse, et alors il présente au-dessus de la façade des salles inférieures un mur massif, agrémenté ou non de fenêtres et, éventuellement, d'un ordre engagé à caractère rythmique. C'est le cas du portique Β 5 de l'agora de Cyrène et de celui de l'agora d'Aegae6. Il est certain que cette seconde solution paraît mieux adaptée aux données planimétriques de la partie orientale de la plate-forme de Byrsa.
La profondeur relativement modeste de l'espace disponible au-dessus des absides de Beulé - 8,75 m depuis l'axe des bases de colonnes jusqu'à l'axe du mur externe des pièces en sous-œuvre -, l'absence de toute trace de colonnade vers l'ouest, où le niveau de signinwn s'étend, nous l'avons dit, sans solution de continuité sur plus de 20 m, invitent à imaginer un portique à une seule nef, ouvert du côté de la terrasse, et fermé à l'aplomb de la façade des « absides ».
On peut produire, à l'appui de cette hypothèse, une série de lampes africaines de la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C, dont le médaillon présente un paysage marin dominé
4 Cf. en dernier lieu R. Martin, dans Les cryptoportiques dans l'architecture romaine, Rome, Collection de L'EFR, n° 14, 1973, p. 27 sq.
s G. Gruben, Die Tempel der Griechen, Munich, 1966, p. 413 sq.
6 S. Stucchi, L'agora di Cirene, I, Rome, 1965, p. 147 sq. et Architettura cirenaica, Rome, 1975, p. 119 sq.; H. Lauter, Die hellenistische Agora von Aspendos, dans Bonn. Jahr. 170, 1970, p. 86 sq. et fig. 8.
par une haute façade à deux niveaux7 : celui du bas est constitué d'une série d'ouvertures en arcades, qui conviendraient aisément à des salles voûtées en berceau, celui du haut, d'une file de colonnes dont on ne peut dire si elles appartiennent à un portique réel ou à un ordre engagé; l'ensemble est couvert d'un toit de tuiles. Sur un exemplaire de Cyrénaïque récemment publié, se profile en outre, dans l'axe de la composition, et en arrière-plan, un élément triangulaire qui évoque peut-être le fronton d'un temple8. Sans prétendre que nous avons là une image exacte de la face orientale de la colline de Byrsa, il est raisonnable d'admettre que l'aspect qu'elle présentait, vue de la mer, devait être proche de ce type d'ordonnance.
Techniquement, rien ne s'y oppose : le schéma, éprouvé dans son principe depuis le début de l'époque hellénistique, se trouverait ici renforcé, dans son application, par un système de soutènements voûtés, familiers des architectes romains depuis la fin de l'époque républicaine9. La puissance des murs en opus quadratimi qui ferment à l'est les salles absidées - il en subsiste quelques éléments suggestifs - semble les désigner d'ailleurs comme des fondations destinées à recevoir le poids d'une construction massive. Le rôle tectonique des absides de Beulé s'apparenterait ainsi à celui des substructions de la terrasse du sanctuaire d'Hercules Victor à Tivoli, par exemple10.
Dans ces conditions il convient évidemment de dissocier le second alignement de colonnes du premier"; celui de l'ouest doit appartenir à un quadriportique, dont il constituerait la limite orientale, en liaison sans doute avec le grand
7 J. Deneauve, Lampes de Carthage, Paris, 2e édit., 1974, n" 1049, p. 212 et pi. 95.
8 E. Joly, Lucerne del Museo di Sabratha, Rome, 1974 (= Monografie di archeologia libica, XI), n° 147, p. 1 12 et pi. X. Je remercie J. Deneauve qui m'a signalé cet exemplaire.
y A Palestrina, à Terracine, et dans de nombreuses substructions latiales ou campaniennes. Cf. G. Lugli, Tecnica edilizia romana, II, Rome, 1957, pi. 115, 119 et 120.
lu Cairoli F. Giuliani, Tibur, I, Forma Italiae, I, 6, Rome, 1970, p. 164 sq.
11 La différence de hauteur (8 cm.) entre la seule base conservée de cet alignement (remise en place par Lapeyre, d'après CRAI, 1939, p. 302) et celles du portique des absides de Beulé, impose d'ailleurs à l'observateur le plus inattentif une telle dissociation.
LES NIVEAUX ROMAINS 1976 273
temple que l'on doit supposer à l'emplacement de la basilique St-Louis, si du moins on retient l'hypothèse de A.L. Delattre12. Mais les tentatives que nous avons faites pour retrouver vers l'ouest, à proximité des bâtiments du Musée, les traces d'une colonnade en retour, sont restées jusqu'ici sans succès : deux sondages effectués en J, VII, 3 et J, VII, 7, n'ont pas apporté de résultat décisif puisque nous sommes tombés sur des fosses de débitage, d'époque arabe. Dans la mesure cependant où les « équarisseurs » s'installaient à l'ordinaire au pied même des structures qu'ils destinaient au four à chaux, on est en droit de penser que s'élevaient dans cette zone des éléments d'architecture importants. Plusieurs fragments de colonne, mis au jour par les équipes de A. Ennabli lors de la démolition de l'annexe du Musée, sont à cet égard des indices encourageants.
Le traitement des deux bases conservées en place au NE et au SO de la colonnade orientale, ainsi que des chapiteaux corinthiens qui, de par leurs dimensions et leur situation, semblent appartenir au même ordre, permet de situer la construction du portique dominant les absides à l'époque antonine et, plus précisément, dans la seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C. Sans entrer dans le détail d'une analyse stylistique hors de propos dans un rapport préliminaire, notons seulement que les bases, solidaires de leur plinthe, présentent un profil composite, selon la terminologie de M. Wegner, puisque comportant deux scoties, séparées par une moulure constituée d'une baguette entre deux listels13 (fig. 2, 3 et 4). Leurs proportions comme le détail de leur modénature en font les proches voisines des bases du Capitolium de Thuburbo Maius et du nymphée de Zaghouan14. Celle du NE, la mieux préservée, possède une plinthe munie sur son
12 A. L. Delattre, Inscriptions latines de Carthage, 1884-86, dans Bulletin épigraphique de 1887, p. 3 sq.
" M. Wegner, Schmuckbasen des Antiken Rom, dans Orbis Antiquus, 22, 1966, p. 62. N. Ferchiou préfère l'appellation «corinthienne» {Architecture romaine de Tunisie, Tunis, 1975, p. 28 sq.).
14 Cf. A. Lézine, Thuburbo Mains, 1968, p. 8 sq. et F. Rakob, dans RM, 81, 1974, p. 58,4.
pourtour d'une sorte d'empattement en saillie de 8 mm par rapport au reste du bloc, et haut de 2,3 cm. Ses scoties offrent en outre un profil plus arrondi que sur la base SO, puisqu'elles surcreusent leur listel inférieur, créant ainsi une sorte de gouttière où l'eau a tendance à stagner. Cette particularité, qu'on retrouve au frigidarium des thermes liciniens de Dougga, n'altère pas l'harmonie d'un profil qui reste remarquablement équilibré, et dont les composantes entretiennent entre elles des proportions satisfaisantes : le tore inférieur, qui garde une place prépondérante, est compris quatre fois dans la hauteur de la modénature (plinthe exclue), et la hauteur du tore supérieur, très arrondi et bien dégagé, est intermédiaire entre celle des deux scoties, mesurées sans leurs listels d'encadrement. Comme il arrive souvent sur les bases africaines de cette période, la proiectura, c'est-à-dire le débordement de la base par rapport au fût demeure relativement faible : loin d'atteindre la moitié du diamètre inférieur de la colonne, comme le recommandait un Vitruve, fidèle aux canons hellénistiques IS, elle dépasse de peu, mesurée au niveau de la plinthe, le tiers de ce même diamètre. Le côté de la plinthe oscille entre 133 et 134 cm, le diamètre du listel supérieur de la base est de 104,4 cm; le diamètre inférieur (D) du fût ne peut dépasser 95 cm. Cela entraîne un élargissement appréciable de l'espace utile entre les plinthes. Si le rythme de la colonnade de l'est se situe entre le systyle et le diastyle, la largeur disponible entre chaque support dépasse nettement celle des ordonnances correspondantes du début de l'Empire.
Le lit d'attente de l'assise de réglage de la base n° 3 en partant du NE est presque entièrement visible, les architectes modernes n'ayant pas jugé utile de le recouvrir, comme certains de ses voisins, d'une couche de béton agrémentée de fragments d'inscriptions (fig. 5). On y observe une sorte de scamillus circulaire, inscrit dans le bloc carré, et en saillie d'environ 1 cm. sur le reste de la surface. Nous avons cru un moment y retrouver la trace d'un état antérieur du porti-
IS De architectura, III, 5, 1. Cette proportion semble s'appliquer en fait plus particulièrement aux bases attiques; elle est différente pour les bases ioniques, plus proches de nos bases composites {ibid., Ill, 5, 3).
■-CD
en ο
CD ο 3
9595
Fig. 1 - Plan de situation des absides de Beulé et des colonnes du portique est (Dessin G. Robine).
:_s^^__
Χ '
_---♦,·%. s- ty-ì*"·:»· '- 4
Fig. 2 - La base nord-est. Fig. 3 - La base sud-ouest.
BASE S-O côté de la plinthe: 134.4
Fig. 4a - Profil de la base nord-est (Dessin G. Robine). Fig. 4b - Profil de la base sud-ouest (Dessin G. Robine).
276 BYRSA I
Fig. 5 - Le lit d'attente de l'assise de réglage de la base n° 3.
que, où les bases auraient été dépourvues de plinthes quadrangulaires - indice chronologique précieux qui nous eût reporté, au plus tard, dans la première phase du règne d'Auguste16. Mais il est probable que c'est la face inférieure des plinthes elles-mêmes qui présentait un plan de pose en relief circulaire, comme on l'observe d'ailleurs sur un élément situé dans le jardin, de provenance inconnue, et imposait ainsi le dégagement d'un cercle correspondant sur le lit d'attente.
Les deux chapiteaux corinthiens (fig. 6) qui sont conservés sur ce même alignement ont des dimensions qui s'accordent avec celles des bases : ils mesurent 86,5 cm, abaque compris, soit une hauteur très voisine de D17. Le détail de leurs proportions est le suivant :
abaque : 10,5 calathos (lèvre comprise) : 76 ima corona : 26 sec nuda corona : 47 diamètre supérieur de l'abaque, au niveau
des fleurons : 86 cm.
16 Cf. D. E. Strong, J. B. Ward Perkins, dans PBSR, 30, série 17, 1962, p. 12.
17 En conformité avec un usage fréquemment attesté. (Cf. Vitruve, IV, 1, 11).
Taillés dans un marbre blanc cristallin, ils présentent une facture assez soignée : les lobes de leurs acanthes aux longues digitations arrondies sont, sur le meilleur exemplaire, creusés «en cuiller»; les nervures axiales des feuilles revêtent l'aspect de rigides sillons tracés au trépan; leurs caulicoles cannelés ont une collerette de feuilles d'eau légèrement dentelées orientées vers le haut; du calice souplement incurvé sortent de vigoureuses hélices et volutes à ourlet supérieur. L'abaque est meublé de godrons à coquille surmontés d'un rang d'oves. Vocabulaire et syntaxe apparentent ces chapiteaux aux spécimens tardo-hadrianiques et antonins qui,
Fig. 6 - Chapiteau du portique est.
élaborés à Rome et à Tivoli, sont devenus canoniques dans les provinces occidentales pour plusieurs décennies18. On relève seulement sur les exemplaires carthaginois une tendance au maintien d'une silhouette assez trapue et à la surcharge décorative; cette dernière, sensible sur l'abaque, est un trait commun à beaucoup de chapiteaux africains de la fin du IIe siècle et du début du IIIe siècle19.
|s W. D. Heilmeyer, Konntische Nonnalkapitelle, Heidelberg, 1970, p. 161 sq., pi. 58-59.
19 Chapiteaux de remploi de la mosquée de Zaghouan (F. Rakob, loc. cit., pi. 59, 1); palestre des Petronii à Thuburbo Maius, thermes sévériens de Mactar, etc . . .
LES NIVEAUX ROMAINS 1976 277
Enfin deux fragments de corniche (fig. 7 et 8), l'un situé derrière l'autel en plein air, en face de la statue de Saint-Louis, l'autre à l'extrémité NE des «absides de Beulé», offrent une monumen- talité compatible avec cette colonnade. La mieux conservée est lisible depuis la moulure de base des denticules, qui correspond au couron-
^ 7Ύ tr
•h<',Viî'»V-ivVV
indice d'une datation dans la seconde moitié du IIe siècle22.
L'examen exhaustif des nombreux fragments architectoniques réunis dans le jardin et surtout, espérons-le, des trouvailles au cours des prochaines campagnes, devraient permettre de préciser et de compléter ces premières indications.
β' '
Fig. 7 - Fragment d'une corniche monumentale. Fig. 8 - Fragment de la même corniche.
nement de la frise, jusqu'au registre des caissons; les dimensions de ses composantes (6,5 cm, de haut pour les denticules, larges de 7,5 cm; 9 cm pour la frise d'oves à la base des modulons) laissent supposer une hauteur totale de 60 à 65 cm, ce qui conviendrait sans peine à la corniche d'un entablement supporté par des chapiteaux de 86,5 cm20. Ce qu'on voit du décor est identique, dans le traitement comme dans la succession des motifs, à l'ordonnance de la corniche des thermes d'Antonin publiée par A. Lézine : soulignons en particulier la parfaite identité du motif des perles et pirouettes sur les deux éléments21. C'est là un nouvel et sérieux
20 Bien qu'aucune norme ne puisse être fixée, on observe que le rapport entre la hauteur du chapiteau corinthien et de la corniche modillonnaire, sur les édifices du Haut- Empire où il est observable, se situe entre 1,25 et 1,40. Ici il serait de 1,32 environ.
21 Mêmes perles allongées à extrémités ovales, mêmes pirouettes biconvexes acérées. Cf. A. Lézine, Carthage-U tique,
Le second secteur examiné au cours de cette campagne a été le carré H IV, où subsiste une plate-forme approximativement quadrangulaire d'environ 4,55 x 4,75 m, constituée d'une assise de gros blocs de tuf lithoïde, reliés entre eux par des scellements en queue d'aronde. Cette assise, reposant directement sur l'argile et la roche, était recouverte d'un second lit de blocs à l'époque des fouilles Ferron-Pinard, et il faut postuler
1968, fig. 20, p. 41. Ces corniches n'appartiennent certainement pas au matériel architectonique, de provenance diverse, réuni par les Pères Blancs au début de ce siècle, car elles semblent avoir été vues par Beulé (Fouilles à Carthage, Paris, 1861, p. 76).
22 Sur la syntaxe décorative des corniches de cette période, Cf. P. Gros, Entablements modillonnaires d'Afrique au IIe siècle ap. J.-C, à paraître dans les Römische Mitteilungen, 1978, 2.
278 BYRSA I
l'existence d'une troisième couche, d'après le niveau de plusieurs blocs encore en place vers l'ouest, sur un palier taillé dans le sol naturel à un niveau plus élevé23.
rent 80 cm de large. L'assise n°2 n'offrait pas de bloc de plus de 1,70m de long et la plupart étaient d'un module assez modeste : de 50 à 80 cm de long sur 35 à 60 cm de large.
HY1ÌSA . HIV Assiseb n° 1 et 3 en place ι·· 2 d'après releva Pinard
GR 7X77 Fig. 9 - Les trois assises de la plate-forme de H IV (Relevé G. Robine). l/50e.
La fig. 9 montre les trois assises, dessinées en plan au l/50e par l'architecte G. Robine; la fig. 10 présente une vue de l'assise n° 2 en 1957 et les fig. 11 et 12 donnent une idée de l'état actuel de l'assise n° 1. On constate que cette dernière est faite de blocs beaucoup plus gros que celle qui la surmontait : la longueur des parallélépipèdes de tuf utilisés oscille entre 1,50 m et 2,50 m, exception faite des petits éléments de raccord ou de calage, et 10 blocs sur 14 mesu-
23 Cf. J. Ferron, M. Pinard, dans Cahiers de Byrsa, IX, 1960- 61, p. 96, pi. XL à XLII : dessin et clichés de l'assise n° 2. La hauteur de cette seconde assise oscille entre 0,65 et 0,70 cm., alors que les blocs de la première n'excèdent par 0,50 à 0,52 cm.
Une telle construction, dont on ignore l'extension exacte, pose un problème irritant : située entre les cotes 49,20 et 50,50, elle apparaît très en - dessous des niveaux d'occupation d'époque impériale, situés autour de la cote 56. Elle suppose cependant la destruction préalable des maisons puniques, puisqu'elle en coupe au moins deux, et qu'elle obstrue la rue Nord-Est. Le seul bloc encore en place de la seconde assise a d'ailleurs été pris au piédroit de la maison adjacente, et l'inégalité des modules, ainsi que la disposition assez anarchique des blocs, qui atteste seulement qu'on a cherché à tirer le meilleur parti des éléments disponibles, sans se soucier de couvrir systématiquement les joints d'une assise à l'autre, prouvent que le matériau
Fig. 10 - La seconde assise en 1957. A l'arrière-plan, les maisons puniques (Cliché G. van Raepenbusch).
est, pour l'essentiel, de remploi. Ce qui est constant, en revanche, à tous les niveaux, c'est le mode de scellement horizontal, fait de cavités de 25 à 30 cm de long, destinées à recevoir des pièces de bois taillées en queue d'aronde, chevauchant les joints au lit d'attente. Ce procédé, fréquemment utilisé dans les constructions grecques et hellénistiques24, s'adapte bien, ici, aux pierres relativement tendres qui composent les assises, mais les modalités de son emploi apparaissent déconcertantes : certains blocs sont reliés à leurs voisins par cinq agrafes, alors que d'autres, plus grands, n'en possèdent qu'une. La plupart des petits éléments ne sont pas scellés. On pourrait penser, devant cette ordonnance
relativement anarchique, à la nécessité de contenir les poussées aux endroits les plus sensibles, c'est-à-dire sur les franges sud et est de la plateforme2', mais l'explication n'est que partiellement satisfaisante, dans la mesure où les blocs de la bordure occidentale de la première assise sont également agrafés.
Bien que les scellements en queue d'aronde se trouvent rarement en fondation, et semblent plutôt réservés aux assises de réglage26, on doit cependant supposer que le niveau d'émergence de l'édifice supporté par cette plate-forme se situait au-dessus de la couche de destruction des maisons puniques, et l'on gagne ainsi un terminus post ifiicìii, la date de 146 av. J.-C.
24 R. Martin, Manuel d'architecture grecque, I, Paris, 1965, p. 241, et G. Lugli, op. cit., p. 235 sq. (emploi fréquent à l'époque tardo-républicaine et augustéenne, dans les podiums des grands temples).
" On obsene par exemple, au podium de Mars Ultor, à Rome, que seuls les blocs de bordure sont solidement agrafés (G. Lugli, op. cit., p. 237).
2" R. Martin, op. cit., p. 239.
280 BYRSA I
Pour essayer de préciser davantage, nous avons fait trois sondages sur le pourtour de l'assise inférieure. Le terrain ayant été remué au cours des décennies précédentes, nous n'avons pu retrouver qu'un mince tronçon de la frange résiduelle de la fosse de fondation, en H IV 11,
maire, de 2 à 3cm. Une fouille dans l'angle nord- est de la plate-forme a montré que la fosse de fondation était creusée dans ce secteur, pour sa moitié inférieure, dans l'argile de décomposition de la surface du sol natif. Sur la frange nord- ouest, les blocs paraissent avoir été poussés au
Fig. 1 1 - État actuel de la première assise (Partie est). Fig. 12 - Etat actuel de la première assise (Partie ouest).
sur environ 65 cm. de longueur et sur 7 à 10 cm de largeur; il livra des fragments de céramique grossière tardo-punique, et quelques menus morceaux de pré-campanienne et de campa- nienne A, avec des tessères de mosaïque noire et blanche. Autrement dit la fosse avait été comblée avec les déblais provenant de la destruction des maisons puniques. Dans le même sondage H IV 11 deux blocs de l'assise inférieure s'appuyaient, à la cote 48,68, sur le fond d'un bassin ovale, que son orientation désigne comme un aménagement hydraulique d'époque punique; constitué d'un béton de tuileau très gris comportant beaucoup de cendres, épais de 1,5 à 2 cm, il reposait sur un rudus assez som-
levier de calage directement au contact de l'éperon de tuf, préalablement taillé en palier pour les recevoir.
En l'absence d'indices chronologiques plus positifs, on ne pourra répondre à la question posée par cette structure, ou du moins émettre à son sujet des hypothèses plausibles, que lorsque le problème général des diverses phases de l'aménagement des pentes sud et sud-ouest de la colline, à la fin de la République et au début de l'Empire, aura été éclairci par des investigations systématiques. C'est à quoi nous entendons consacrer une partie des prochaines compagnes sur le site de Byrsa.
Les recherches poursuivies par Ch. Saumagne sur le versant oriental de la colline intéressent directement tous ceux qui s'efforcent d'avoir une vision globale des vestiges romains de l'antique Byrsa, et elles apportent aussi quelques éléments utiles à la restitution de l'économie de ce quartier de la Carthage punique. Si l'article du BCTH de 1924 en avait publié les premiers résultats, les fouilles conduites au cours des deux années suivantes n'ont fait à ce jour que l'objet d'un compte rendu manuscrit. Soucieux cependant de transmettre à ses continuateurs les informations qu'il avait réunies, Ch. Saumagne confia ce manuscrit, ainsi que les plans qui l'accompagnaient, à la rédaction des Cahiers de Byrsa, puis au Centre de recherches sur l'Afrique méditerranéenne d'Aix-en-Provence. C'est ce qui nous a permis de le recueillir, et de l'imprimer ici.
Il est regrettable qu'un tel document n'ait pu paraître du vivant de son auteur; grâce à sa mémoire très fidèle et à son ouverture d'esprit, il aurait su préciser bien des points qui nous restent obscurs, et affiner quelques interprétations, qui paraissent hasardées. Tel qu'il est ce texte offre toutefois l'intérêt le plus vif, car la zone qu'il décrit, aujourd'hui couverte de constructions, est à jamais inaccessible à toute investigation archéologique.
Nous avons considéré qu'il était opportun de présenter en annexe à ce premier volume le texte inédit de Ch. Saumagne. Cette publication, différée pendant plus d'un demi-siècle, nous permet du moins de rendre l'hommage qu'il mérite à celui qui découvrit le tracé urbain de la Colonia Julia, en l'associant aux nouvelles recherches sur Carthage.
A. Ennabli J. Deneauve
P. Gros S. Lancel
LE METROÔN DE CARTHAGE ET SES ABORDS
par t CHARLES SAUMAGNE
Le service des Antiquités et Arts, au cours des années 1925 et 1926, a consacré une très grande partie de ses crédits à poursuivre et à développer, sur le flanc oriental de la colline de Saint- Louis de Carthage, l'exploration méthodique qu'il avait entreprise en 1923 '. C'est sous la haute direction de M. L. Poinssot qu'il m'a été permis de diriger ces fouilles que la disposition du terrain rendait difficiles, sinon périlleuses, et dont les résultats sont exposés et interprêtés dans le présent rapport.
Il n'a pas été possible de réaliser des opérations de dégagement d'édifices; en présence de l'extrême morcellement de la propriété, les hauts prix atteints par la terre, aussi bien, il faut en convenir, que l'état d'anéantissement radical où plusieurs siècles de destruction systématique ont réduit les monuments, il a fallu recourir à la méthode de sondages et de reconnaissance en sape2.
Les résultats acquis au cours de cette campagne de fouilles sont : l'identification du Métroôn; la délimitation de six insulae, réalisée par la découverte de quatre cardines1' (IV, V, VI, VII
1 Ch. Saumagne, Notes de topographie carthaginoise, la colline de Saint-Louis, dans BCTH, 1924, p. 179 à 193.
2 L'application du décret beylical du 8 janvier 1920 a favorisé nos recherches et les propriétaires des terrains concernés ont manifesté une particulière complaisance pour laquelle ils doivent être remerciés.
' On a fait suivre les mots cardo et decumanus par le numéro de la rue calculé suivant l'ordre de sa position relative soit à l'est ou à l'ouest du cardo maximus, soit au nord ou au sud du decumanus maximus. L'adoption de ce mode de désignation des rues a paru offrir, outre l'avantage de la simplicité, celui d'éviter les confusions ou les controverses
est) et de trois decumani (maximus, I nord et I sud); la reconnaissance de nouveaux ouvrages de soutènement de la colline, parmi lesquels un mur d'amphores; enfin l'exploration de deux maisons et d'un vaste édifice, dont la destination demeure inconnue.
LE METROÔN
II avait été possible déjà de présumer4 que le sanctuaire de la Mère des Dieux avait laissé des vestiges aux points C 40 et C 42 (fig. 24). Les fouilles ont vérifié cette conjecture.
1 Dans le plan de la Colonia Julia, le Métroôn absorbait, par sa masse elle-même et par ses abords latéraux, environ la moitié méridionale de l'insula définie d'une part par le decumanus maximus sud et le decumanus I nord, au nord, et, d'autre part, par les cardines V et VI est, à l'ouest et à l'est.
Le soubassement du podium était implanté dans le sol vierge qui dessinait un étroit promontoire à la cote 40.
S'il est relativement aisé de définir le plan du stereobate proprement dit de l'édifice, il ne paraît pas possible de déterminer, autrement
auxquelles peut exposer l'emploi des formules techniques transmises par les Gromatici (cf. Hygin, 173, 12; 174 [édition Lachmann]). Les principes de la cadastration dont il est fait ici état ont déjà été exposés : Ch. Saumagne, Colonia Julia Karthago, dans BCTH, 1924, p. 131 à 140.
4 Ch. Saumagne, op. cit. (BCTH, 1924). Le plan, p. 180, indique les côtes des divers paliers étages au flanc de la colline. La formule abrégée C 40 a, par exemple, signifie : C(ote) 40 (mètres) a (indice distinctif du palier par rapport" à d'autres placés au même niveau).
284 BYRSA I
que par induction, les proportions de ses superstructures.
Deux parties du plan peuvent être distinguées. Au nord, une vaste salle hypostyle paraît avoir utilisé l'espace délimité par le podium; au sud, un puissant noyau de blocage comprimé, jadis encadré par une sorte d'armature en moellons, a soutenu le pronaos et les colonnes de la façade.
La salle hypostyle.
Elle mesure, à l'intérieur, 16,80 m sur 20,50 m, formant un rectangle dont le côté long est orienté à 30° N-NE/S-SO, sur le nord vrai, conformément au plan de la cadastration julienne et parallèlement aux cardines.
Le mur du nord constituait à la fois le parement et le massif de retenue de l'éperon rocheux qui portait le temple; sa face externe se développait sur un front de 20 mètres environ et une hauteur de près de 10 mètres, égale à la brusque dénivellation qui sépare la cote 40 de la cote 30. Son épaisseur actuelle est de 2,50 m; mais en l'état présent, il n'offre qu'un noyau de blocage, primitivement enrobé de pierres de taille; dans son épaisseur étaient insérés des piliers de cubes équarris, aujourd'hui disparus \ La résistance de ce mur a été augmentée, à une date assez éloignée de son édification, par la construction d'un système de contreforts, composé d'un mur d'égale hauteur, qui lui est parallèle et qui se rattache à lui par l'intermédiaire d'un énorme blocage perpendiculaire de 5 m d'épaisseur. Le volume intérieur de ce massif a été réduit par l'aménagement d'une abside de 8 m de rayon; et le vide ainsi déterminé par ce puits semi-circulaire a été comblé de terre battue et de plâtras. En ce dernier état, la façade postérieure du temple n'a plus directement dominé le palier de la cote 30; par contre l'établissement d'une esplanade (9,40 m χ 22 m), a concilié le souci esthétique de maintenir le dégagement des abords septentrionaux du temple avec celui d'en confirmer la stabilité6.
Le mur occidental a été exploré sur une longueur de 24 mètres. Large de 2,30 m, il est
implanté dans le sol naturel de sable et de grès dans lequel il s'empâte par un ressaut débordant de 0,38 m, au-dessus duquel il s'élève de 1,70 m en moyenne. Il est composé de moellons à tranches rectangulaires (0,15 m χ 0,07 m) disposés en assises régulières et liés avec soin. Les pierres (tuf coquille des latomies d'El Haouaria, Cap Bon) proviennent de la destruction d'un édifice, peut-être punique; un grand nombre d'entre elles portent en effet des écailles de stuc blanc et cristallin, encore adhérentes, jusque sur des faces engagées dans l'épaisseur du blocage.
La face externe de ce mur paraît avoir été appareillée en superstructure. Dans sa portion septentrionale, elle a été ensevelie très tôt, sinon tout de suite après son achèvement, sous un remblai destiné à niveler, en l'exhaussant pour le raccorder au plan du cardo V est, le profil naturellement incliné du sol primitif. Ces terres de remblai contiennent des couches de sable et de cendres, des fragments de poterie gréco-punique à vernis noir ou rouge et des tessons de poterie romaine estampillés : NAT, PERT, RVB, ZOILI7. La partie supérieure de ce mur est arasée jusqu'au niveau même du sol antique adjacent, qui est celui du cardo V est. Les premières atteintes d'un délabrement paraissent dater d'une époque ancienne; des travaux de consolidation ont laissé, dans le mur lui-même, des marques importantes. Ce sont des blocs de ciment gris-bleu, épais de 0,50 m, larges de 1,50 m, régulièrement espacés de 3 m d'axe en axe et insérés dans l'épaisseur du podium, comme des coussins destinés à le renforcer en des points où se concentrait la pression de colonnes ou de pilastres sur le stylobate.
A son extrémité septentrionale, ce mur était prolongé par un puissant massif de soutènement, long de 9,40 m, qui retenait le palier de la cote 40 et dominait celui de la cote 30, formant angle droit avec le côté nord du podium. A
s II faut mettre en principe, à Carthage, que les pierres de taille ont été généralement arrachées.
" II est possible que cette abside ait supporté quelque annexe de l'édifice, et peut-être un sanctum (H. Graillot, Le
culte de Cybèle, Mère des dieux, à Rome et dans l'empire romain, dans BEFAR CVII, Paris 1912, p. 530) dont on trouve la mention à Sétif, sur une inscription (CIL VIII, 8457, ligne 9) relative à un temple de la Mère des Dieux. Cf. l'expression « templum a solo, cum sancto quod est a tergo, instituerunt. . . » (S. Gsell, Inscriptions de l'Algérie, I, Insci ιρ- tions de la Proconsulaire, Ed. anastatique Rome 1965, p. 10).
7 Parmi les débris, on doit noter ceux d'une mosaïque composée d'éclats de pierre et de marbre versicolores semés au hasard sur un lit de chaux grise.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 285
l'extrémité méridionale, il semble que le mur ait été bâti en grand appareil jusque dans ses œuvres inférieurs.
Le mur oriental retenait l'éperon naturel qui supportait le temple et s'érigeait en abrupt, dans sa partie nord, au-dessus du palier C 30 et, dans sa partie sud, au-dessus du palier C 36; il a laissé peu de traces. Dans sa portion septentrionale où il subsiste, il a été contreforté par une muraille de 10 m de hauteur et de 5 m d'épaisseur, contemporaine des travaux qui consolidèrent le côté nord du podium*. A la hauteur du palier C 36, il paraît avoir été appuyé par une rangée d'absidioles dont un vestige a été reconnu.
Quant au mur qui limite la salle hypostyle au sud, son tracé a pu être relevé dans une galerie d'exploitation par où les chercheurs de pierres ont extrait les moellons qui le composaient; quelques-uns de ceux-ci, oubliés ou négligés, témoignent de la qualité de la construction, solide et soignée, quoique faite de cubes de remploi. L'épaisseur du mur paraît avoir été de 2,50 m.
Ces quatre murs délimitaient une salle dont le plan cl'ensemble peut être restitué par extrapolation. En l'état de la fouille, une nef centrale, large de 6,90 m, était séparée, sur chacun de ses côtés, d'une nef latérale large de 3,45 m, par des piliers carrés, mesurant 1,48 m de côté et composés de trois à quatre assises de pierres de pierres de taille des «latomies». Chaque pilier était posé sur un socle semblablement construit mais légèrement plus large (1,60 m); dans chaque rangée, ces socles étaient reliés entre eux par une chaîne en pierres de taille, larges de 1 m environ, composant ainsi une substruction longitudinale et continue de 15 m de longueur9.
Les parois des bas-côtés projettent vers l'intérieur, à la hauteur de chaque pilastre, un contrefort saillant de 1,20 m, large de 1,10 m et posé lui-même sur un socle débordant sa base. Les saillants, du côté occidental où ils ont été reconnus, sont du même appareil que le mur qu'ils appuient. Un seul subsiste du côté oriental, suffi-
s Ce mur est visible derrière une villa (aujourd'hui n° 10 rue Astarte), (NDLR).
4 II ne semble pas que ces pilastres aient été reliés transversalement, suit entre eux, soit avec les parois latérales de la salle, ni que les premiers et derniers pilastres aient été rattachés, par ce même moyen, aux parois nord et sud de cette salle.
samment conservé pour témoigner de la symétrie du plan.
Le sol de la salle est le grès primitif de la colline, sans interposition de dalles ni de béton. Les matériaux de remblai, provenant de la ruine de l'édifice, ne composent qu'un couche supérieure de 1 m environ d'épaisseur; au-dessous, la terre dure et tassée, formée d'éléments neutres indéterminables, indique que l'ensevelissement est très ancien. Dans l'angle N-O, deux graffiti à la pointe sur la pierre nous transmettent peut-être les noms de deux ouvriers : ... IT LICINIVS et au-dessous: MARCVS10.
Ainsi qu'il a été dit dans le précédent rapport, une muraille de fortification médiévale a coupé, d'une épaisse diagonale, le champ de la fouille; en fait, cet ouvrage défensif a été construit aux dépens de la partie sud-est de la salle hypostyle et de ses pilastres, dont les éléments s'y retrouvent mêlés à ties marbres et à des colonnes. De la fouille, à cet endroit, ont été retirés quelques pierres équarries appareillées en éléments de plein cintre, des débris de corniches et de frises en marbre blanc, le haut d'un cippe portant une dédicace à la Mère des Dieux et à Attis et des fragments de bas-reliefs.
Les soubassements du pronaos.
Ils sont constitués par deux massifs de blocage parallèles, d'égale longueur, disposés perpendiculairement au grand axe de l'édifice et séparés par un couloir large de 1,40 m, alvéole où s'insérait un mur dont les moellons ont été enlevés. Tous deux sont dans un état extrême de délabrement, mais ils portent l'empreinte des solides revêtements dont ils ont été dépouillés".
Le plus septentrional des deux murs était au contact du mur méridional de la salle hypostyle qu'il soutenait de sa masse épaisse de 1,60 m.
L'autre mur offre une indication intéressante touchant la disposition de l'escalier d'accès au pronaos. Le profil de la face extérieure dessine, en effet, à une distance de 2,50 m, de part et d'autre de l'axe de l'édifice, un retrait de 1,50 m environ qui définit ainsi une sorte de tribune
10 Inscrits a 1,30 m au-dessus du niveau du sol vierge. 11 L'aspect de ces noyaux, privés de leurs parements et de
leur armature de moellons, rappelle celui qu'offrent les infrastructures du temple de Castor et Pollux sur le Forum romain et du temple de la Grande Mère sur le Palatin.
286 BYRSA I
avancée. Les deux retraits latéraux, logeant des gradins développés en pentes divergentes par rapport à l'axe du temple, permettaient d'accéder latéralement à la tribune supérieure. Il est vraisemblable que des gradins, parallèlement à la façade, complétaient l'encadrement de l'étroite terrasse où s'érigeait sans doute un autel, et desservaient le temple.
Suivant l'axe même de l'édifice, un caniveau, large de 0,40 m, creusé dans la crête du blocage, recevait, de part et d'autre de son parcours, des rigoles étroites dont il déversait les apports dans un égout situé au pied de la façade méridionale du massif. Cet égout, après un parcours de 12 mètres, se jetait dans un collecteur latéral du decumanus maximus que dominait le Métroôn. Le sommet actuel du pronaos est situé à 3 mètres environ au-dessus du decumanus maximus.
Essai de restitution du plan. Les dimensions de l'ensemble du temple, cal
culées sur les côtés extérieurs, sont : largeur, 21,40m; longueur jusqu'au front méridional du soubassement de pronaos : 34,40 m12.
La détermination du développement de la cella est liée à l'appréciation que l'on peut se faire de la destination de la salle hypostyle. Celle-ci ne constitue assurément que le sous-sol de l'édifice, la partie creuse du podium. Si un vide aussi vaste a été ménagé, c'est moins, à notre sens, pour être la cave aux accessoires du culte n que pour alléger l'infrastructure en un point de la colline où la pression d'une grande pesée de maçonnerie aurait exercé une poussée dans le sens du glissement vers les paliers inférieurs. Il est difficile d'admettre que nous soyons en présence du fond même de la cella; la double considération que nous posséderions une cella affectant exceptionnellement la disposition d'une basilique judiciaire et que le sol du sanctuaire serait en contrebas du sol extérieur détourne de retenir cette conjecture14.
Mais s'il s'agit bien d'un sous-sol, il faut penser qu'il soutenait le sol de la cella par le moyen d'arcs en plein cintre. A ne se fier qu'au plan positivement révélé par les fouilles, la voûte de la nef centrale n'a pu avoir qu'un rayon de 3,40 m; et si l'on attribue aux pilastres la hauteur de 2 mètres qu'ils ont en effet, l'exhaussement total est de 5,40 m; hauteur excessive. Car, en effet, il semble que le sommet du soubassement antérieur du pronaos identifie le niveau du sol antique grâce au caniveau qui le parcourt; et il est difficile d'admettre que l'extrados de la salle hypostyle ait été surélevé de plus de trois mètres par rapport à celui du pronaos . En outre, un cintre d'un tel rayon, qui entraine une surélévation correspondante des bas-côtés (dont la voûte se satisfait d'un rayon de 1,70 m) comporte une accumulation de matériaux et de blocages dont les témoins effondrés devraient avoir roulé au pied des pilastres; or, on n'en trouve point de trace. Si, par contre, on raisonne en prenant pour élément initial le rayon du cintre des bas- côtés, soit 1,70 m et une hauteur de pilastres de 2 mètres, l'exhaussement du sous-sol, ainsi porté à 3,70 m, confère au podium une surélévation satisfaisante de 4 -mètres environ. Mais dans cette hypothèse, il faut admettre que la nef centrale était elle-même divisée en deux par une rangée médiane de piliers IS dont les proportions, si on les imagine égales à celles des pilastres latéraux, laissent entre eux des intervalles de 3,40 m et admettent à leur tour d'être reliés par des cintres de 1,70 de rayon.
La délimitation périphérique de ce sous-sol peut déterminer le plan de la cella. On doit écarter l'hypothèse que les côtés de celle-ci puissent coïncider avec la rangée des pilastres intérieurs;
12 Le Métroôn de Rome mesure 34,30 m χ 17,10 m (H. Graillot, op. cit., p. 324).
n II n'est pas impossible que, en quelque point non identifié, le vide du sous-sol ait été de quelque utilité pour la célébration des mystères, du taurobole en particulier.
14 Un sanctuaire absidial (plutôt que basilical) conviendrait cependant sans peine à un culte initiatique. Ajoutons
qu'il paraît difficile, en toute hypothèse, de dissocier le plan du sous-sol de celui de la cella, si du moins la construction du puits semi-circulaire est contemporaine de celle du massif du podium (NDLR).
IS Cette rangée n'aurait pas laissé de traces; mais le sol, profondément ravagé aux endroits qu'elle devrait occuper, paraît avoir particulièrement retenu les efforts des chercheurs de pierre.
Il est imprudent de postuler, en sous-œuvre, une rangée de supports qui ne correspondrait à rien au niveau de la cella. Une hypothèse plus économique, et plus conforme aux normes observées dans les substructions des temples d'époque impériale, consisterait à prêter à la voûte couvrant la «nef» centrale un profil surbaissé (NDLR).
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 287
ce dispositif comporterait le développement d'une colonnade péristyle, mais celle-ci, pour être supportée par les bords du stylobate, serait trop exagérément écartée du mur de la cella pour être conciliée avec les exigences de la technique et le canon classique du temple romain. Il paraît plus vraisemblable que la cella se superposait aux murs de la salle inférieure, au moins jusqu'à hauteur de la troisième rangée transversale de pilastres. Dans de telles conditions le temple serait prostyle.
Quant à l'ordonnance et à la proportion des colonnes, les travaux de renforcement latéraux qui ont été pratiqués le long du côté occidental du podium fournissent une indication précieuse. Ces socles de ciment, encastrés dans le mur, sont régulièrement espacés, de centre à centre, par un intervalle de 3 mètres, réductible à 2,96 m, soit dix pieds. En outre, une relation évidente existe entre la position et l'espacement de ces socles et l'espacement des saillies intérieures du mur occidental du podium. On peut donc penser que le temple était octostyle, développant sous son fronton une rangée de huit colonnes hautes d'environ 9,50 m et mesurant à la base un diamètre de 1,05 m. Deux colonnes en retour et des pilastres appliqués aux parois externes de la cella prolongeaient sur les côtés le rythme de l'architecture frontale16.
Architecture.
Parmi les très nombreux fragments de sculpture architecturale trouvés dans l'intérieur et aux abords immédiats du podium, un débris de corniche, en marbre, paraît s'accommoder des proportions déduites ci-dessus : il porte, de bas en haut, un talon orné de rais de cœur que surmontent une plate-bande à denticules, une ligne de perles et un quart de rond à oves. Les autres fragments dépendent d'un grand nombre de compositions ornementales différentes. Ils peuvent cependant être classés en deux catégories :
ceux qui sont en marbre blanc ou gris, caractérisés par la profusion des ciselures, et ceux qui, dans le calcaire ou le marbre roses, sont traités en traits sobres sur de larges plans nus. Ces derniers sont représentés ainsi :
1) sept fragments de fûts de même module, parmi lesquels un tronçon inférieur de 1,80 m mesure de 0,28 m à 0,30 de rayon. Les rayons, au-dessus du congé de la base et au-dessous du congé de l'astragale sont respectivement de 0,295 m et de 0,255-0,260 m. Un essai de réajustement des débris qui paraissent appartenir à une même pièce restitue une hauteur totale de l'ordre de 5,20 m17. A ces colonnes correspondent une base et un fragment de base en khedel rose (diamètre au tore: 0,64m; diamètre à l'empâtement de la colonne, 0,295 m; hauteur, 0,295 m; un tore, un filet, une scotie, un filet, un tore, une plinthe). Une autre base en khedel rose (d. 0,52, hauteur 0,16, sur un dé de 0,30), de même profil, ne trouve pas de colonne qui lui corresponde;
2) un élément de frise, sur la face d'un bloc de 0,47 m de hauteur;
3) un élément de frise composé d'un enroulement de feuilles courant en relief sur la face d'un bloc de khedel; la branche déliée d'une volute ascendante se recourbe pour porter une grenade18, une autre branche s'épanouissait en rose stylisée;
4) un chapiteau de l'ordre corinthien (khedel) à feuilles d'acanthes seulement épannelées (diam. à la base, 0,28; au sommet, 0,225; largeur aux saillants du tailloir, 0,31);
5) une gargouille en forme de tête de lion (khedel) traitée largement et dans un style archaïsant : dans une masse ménagée à la face antérieure d'un bloc haut de 0,31 m, large de 0,70 m, profond de 0,50 m; le mufle, large et saillant, projette en avant un relief de 0,50 environ; la gueule béante prolonge un conduit qui, à travers la pierre, le raccorde à une auge longue de 0,40 m, profonde de 0,15 m, large de 0,19 m;
16 Cette restitution pose un problème typologique, clans la mesure où les temples prostyles octostyles sont rares dans l'architecture romaine occidentale. D'autre part, la faible profondeur du massif de blocage antérieur à la cella rend difficile la localisation d'un escalier à deux volées perpendiculaires et d'un portique pourvu de deux colonnes en retour (NDLR).
17 Une colonne de granit trouvée par le R.P. Delattre et actuellement gisante auprès de la Cathédrale mesure : diam. à la base 0,66; diam. au congé 0,598; hauteur 5,22 m.
IS Sur le malum puniciim dans le culte d'Attis, voir H. Graillot, op. cit. p. 20, 378, et 203, n° 4 sur la confusion qui est facile, même dans le cas présent, entre la grenade et le bulbe du pavot.
288 BYRSA I
6) des éléments de balustrade, en forme de chancel, constitués par des disques rayonnant par huit branches, par des piles carrées à faces lisses surmontées de boules et creusées de mortaises sur leurs côtés. Ces fragments permettent de restituer une balustrade, avec main-courante, de 1,30 environ de hauteur.
La catégorie des marbres blancs et gris contient les éléments d'un pilastre de neuf mètres environ de hauteur subdivisé dans les proportions suivantes: base, haut. 0,416, larg. sup. 0,832, larg. inf. 1,08, composée, de haut en bas, d'un tore, d'un filet, d'une scotie, d'une baguette entre deux filets, d'une scotie, d'un filet, d'un tore, d'une plinthe haute et carrée; fût, haut. 7,50 à 8 mètres, cannelé sans rudenture; chapiteau, haut. 0,90, largeur inférieure 0,70, largeur du tailloir 0,92, corinthien à fleuron ordinaire.
A ce type de pilastre correspondait un modèle de colonne de proportions identiques, dont il n'a été trouvé d'autres traces que quelques acanthes ou quelques fleurons et deux soubassements de base. Ceux-ci sont constitués par une dalle de calcaire, épaisse de 0,30 m environ, destinée à être insérée dans le stylobate, sous la base de la colonne dont elle épousait sensiblement les dimensions à sa partie inférieure (1,04 m χ 1,00). Un cercle, de rayon égal à celui de la colonne à son pied, était inscrit sur le plan supérieur de la dalle, déterminant une surface ronde piquée à la pointe; trois rigoles, creusées dans le sens des rayons et prenant leur origine en trois points équidistants de la circonférence, s'élargissent en cupules rectangulaires. L'ensemble du dispositif, destiné à recevoir et à retenir un lit de plomb fondu, assurait le tassement équilibré de la colonne autour de son axe.
D'autres fragments de bases, de chapiteaux plats et d'éclats cannelés portent à admettre que ce premier ordre d'architecture était complété par un ordre dont les proportions étaient réduites de moitié. Deux bases blanches, dont l'une est intacte, mesurent en effet : 0,412/2 = 0,206 de hauteur, 0,832/2 = 0,416 de largeur supérieure et 1,08/2 = 0,54 de largeur inférieure. A ces pilastres devaient correspondre des fûts ronds dont il n'existe pas de débris mesurables, mais qui s'accommodent de chapiteaux dont subsiste un seul témoin complet (haut. 0,46, diam. inf. 0,36, largeur au tailloir 0,56).
En outre, un chapiteau corinthien (haut. 0,40, diam. inf. 0,295, largeur au tailloir 0,48) et la partie supérieure d'un fût cannelé (diam. 0,55, haut. 2,20), tous deux en marbre blanc et d'un travail soigné, ont été dégagés du bastion médiéval qui recoupe la ruine. Les débris de corniches sont nombreux; ils peuvent être répartis en cinq catégories différentes : leurs hauteurs varient de 0,16 m à 0,235 m.
Identification de l'édifice.
Que ce temple ait été dédié à la Mère des Dieux, la conjecture, fondée sur la teneur de deux dédicaces déjà connues19, est rendue probable infiniment par la découverte de deux fragments épigraphiques qui associent Attis à la déesse.
14)20 plaque de marbre; haut. 0,10; haut, des lettres 0,07; brisée en bas.
de Ο ATTIDI/..
15) Sommet d'un autel hexagonal; longueur des côtés du polygone à la tranche supérieure, 0,20 m. Une face du prisme est consacrée au texte suivant :
MATRI DEVM MAGNAE
IDEAE ET ATTINI AVG (sic)
hauteur des lettres : 0,04, 0,04, 0,037. A droite de cette face, pour le spectateur, sur le premier registre, sous une infida, un pin; sur le deuxième registre, une paire de cymbales reliées par une lanière qui, passant par-dessus une infida, les tient suspendues; un couteau paraît attaché à l'une des cymbales, couteau à manche court, à lame effilée serrée dans une gaine21; au-dessous, s'évase le pavillon recourbé de Yaulos phrygien22. A gauche, sur le premier registre, un tam-
19 A. Merlin, BCTH, 1919, p. CCXXXV et p. 86-87. - A. Merlin et R. Cagnat, Inscriptions latines d'Afrique, Paris, 1923, n°* 355 et 356. - Ch. Saumagne, BCTH, 1924, p. 13. - Les textes du CIL VIII, nos 24521, 24535, 24536 ont été trouvés, entre 1898 et 1900, dans le terrain fouillé par nous.
20 Cette numérotation fait suite à celle qui classe les textes précédemment publiés {BCTH, 1924, p. 187 à 192).
21 Ce n'est pas la harpe classique, l'ensis hamatus de CIL XII, n« 1751 et XIII, n" 573.
22 Le curvus calamus de Catulle, 63, 22.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 289
bourin pendu à une guirlande; sur le deuxième, un pedum, retenu également à une infida. La face opposée au texte est nue2\
16) Fragment de pierre : ADSISTENTE CO . . VIIII /// IOTR/// 01
17) On peut rapporter au temple un fragment d'inscription monumentale sur marbre découvert à quarante mètres au sud, par delà le decu- manus maximus.
iMP CAESAR
Ces mots, achevant la première ligne du texte, s'inscrivent dans l'angle des moulures qui l'encadraient (un listel de 0,04, un talon de 0,08). Les lettres, de belle facture, ont 0,16 de hauteur et sont éloignées du cadre supérieur de 0,12.
L'association d'Attis à la Grande Mère24 est attestée encore par d'infimes fragments de bas- reliefs : une tête d'Attis très mutilée, coiffée du pileus pointu; deux jambes marchant l'une vers la droite, l'autres vers la gauche, revêtues jusqu'aux chevilles de Yanaxyris bouffant et drapé; l'extrémité supérieure des branchages d'un pin chargé de mices pineae2'~", les jarrets et les sabots antérieurs d'un taureau en marche26, devant lequel la tête d'un monstre, la gueule ouverte et garnie de crocs, est écrasée sous un pied humain déchaussé; le tronc et le visage d'une sorte de Silène, ployant sous le poids d'un fardeau plat, en forme d'hexagone allongé, qu'il soutient sur son épaule gauche au moyen de son bras levé.
2i Cf. H. Graillot, op. cit., p. 135, n° 5. Voir les représentations voisines dans : S. Reinach, Répertoire des reliefs grecs et romains, III, Paris, 1912, p. 134 et p. 182; H. Graillot, op. cit., p. 159-160, 167-171; E. Espérandieu, Recueil général des bas- reliefs de la Gaule romaine, Paris, 1908, II, 1267; R. Fabre, Un autel du culte phrygien au Musée du Latrati, dans MEFR, 1923, p. 4 et 5.
24 L'importance de l'expansion de ce culte à Carthage et en Afrique est révélée par la place que lui donnent les apologistes d'origine africaine, comme Min. Felix (oct., 22,1; 22,4), Arnobe (adv. nat., I, 41; V, 16) Lactance (Dm inst., 1, 17, 7; 21, 16), Augustin (de civ. dei, VI, 7; VII, 26); cf. S. Gsell et Ch. A. Joly, Annoiata, Alger, 1918, p. 41 et sq.
25 Cf. dans CIL XII, le commentaire par Hirschfeld de l'autel taurobolique de Valentia, au sujet de l'inscription 1744.
26 Zeus-Attis est transformé en taureau dans Arnobe (adv. Nat., V, 20). La présence d'un monstre écrasé par un être
Au culte du même Attis peuvent être rattachés :
1) un objet très menu, en ivoire, qui paraît avoir composé le couvercle d'un minuscule coffret de section rectangulaire (long. 0,017, larg. 0,006, haut. 0,006); la face supérieure en était ajourée finement; sur l'un des côtés étroits, une petite tête de lion formant saillie;
2) une petite tête de bélier ménagée à l'extrémité d'un bâtonnet cylindrique;
3) un fragment de verre concave portant, gravée à la meule et traitée par larges morsures planes, la silhouette de deux mystes, dressés en adorants, coiffés du bonnet phrygien, vêtus d'une tunique à manches serrée à la taille, les coudes écartés du corps, les avant-bras repliés vers le haut et les mains ouvertes, le visage tourné vers leur gauche et tendu vers le ciel qu'occupent trois étoiles à huit branches27, sous l'arc que dessinent deux traits concentriques entre lesquels se développe une série continue de petits cercles. Un troisième adorant, dont la main est visible, complétait le tableau, à droite, le visage tourné vers sa droite28.
On peut rapporter au Métroôn un important fragment de visage féminin privé de la plus grande partie de sa coiffure, de l'œil et de la joue droite, mais dans lequel la base d'une tour qui le coiffait permet de reconnaître une image de Cybèle29.
Il semble, en outre, que le texte précédemment publié sous le numéro 3, ait commémoré un taurobole accompli dans notre temple si l'on admet de le restituer ainsi :
. . . [ tauroboliu]m public[e/ factum adsiste]ntibus v(iro) c(laris- simo) / [ h]ierophant[a / de]i Lib (eri) [patris et hie] rophan (ta) d (eae) / [Hecatae et] Felici Corace / [ A]rte- mio taurobol (i) ato .... /™.
humain ou divin mérite de recevoir une interprétation que nous n'avons pu trouver.
27 Sur Attis «berger des blanches étoiles» voir H. Graillot, op. cit. p. 213.
2S Les fragments 1 et 3 se sont promptement effrités à l'air.
24 Cf. S. Reinach, Répertoire de la statuaire gtecque et romaine, II, 269-271; III, 83.
w Sur l'autel de Lectoure (CIL, XIII, 522, 525) : «taurobo- lium publiée factum». Le registre, dont la partie droite est
290 BYRSA I
Le prince, pour le salut de qui le sacrifice était accompli, le myste qui en fit les frais (qui fecit) et qui en fut, sans doute, le bénéficiaire (qui susce- pit), le prêtre qui officia (qui tradii) demeurent inconnus. Mais nous voyons que la cérémonie réunit des assistants rituels, des συλλειτουργοί de qualité. Sans doute, l'un d'eux n'était que corax dans la hiérarchie mithriaque. Mais un autre, clarissime par sa classe sociale, occupait parmi les initiés le degré le plus élevé auquel un piétiste pouvait aspirer : il était hiérophante de Liber et d'Hécate. Le cumul de ce rang profane avec ces hautes et pieuses dignités fait de notre anonyme l'égal de ces notables personnages qui illustrèrent les derniers jours du paganisme officiel, au IVe siècle : Vett. Agorius Praetextatus, Fabia Paulina, Sextus Agesilaus, Egnatius Faven- tius, Ceionius Julianus Kamenius qui fut consulaire de Numidie et vicaire d'Afrique31. Et l'on ne peut s'interdire de songer que.Nicomaque Fla- vien, zélateur de la Grande Mère, de Mithra et d'Isis, et vraisemblablement grand dignitaire de leurs ordres, fut vicaire d'Afrique, comme son parent Symmaque, un grand initié lui aussi, a été proconsul32. Tous étaient clarissimes; tous étaient archiboucoles ou hiérophantes de Liber Pater en même temps qu'hiérophantes d'Hécate; et tous avaient reçu le sacrement du sang, sous le signe de la Maglia Mater et d'Attis. Notre inconnu est de leur monde et, sans doute aussi, de leur génération. Le troisième assistant, Arte-
seulement et en partie conservée, n'était pas très large. Les mots (tauroboliitm publiée) suffisent à remplir une ligne. Le lapicide, d'ailleurs maladroit, est à l'étroit; le sigle AT, deux fois répété, le révèle assez en écrasant le mot hierophanta à la fin de la ligne; le D de Deae est juché sur la moulure du cadre et la fin de taurobolato déborde résolument ce cadre, malgré qu'un i ait été économisé et que les lettres, pour être mieux pressées, aient affecté une hauteur exagérément filiforme. Par sa qualité, la pierre ne vaut guère plus que le graveur.
31 CIL, VI, n°»261, 1778 et 1780; XI, n«671. Cf. J. Nistler, Vettius Agorius Praetextatus, Klio X, 1910, p. 473.
32 Cf. Cl. Pallu de Lessert, Fastes de la Province d'Afrique, II, p. 78 et 203; surtout O. Seeck, Q. Aureli Symmachi quae supersunt dans Monumenta Germaniae historica, 2, Auctorum Antiquissimorum VI, 1, p. XXXIX et suiv. - cf. aussi Carmen adv. paganos, dans les Poet. lat. min. de Bahrens, III, p. 289. Ce sont ces mêmes personnages, au nombre desquels brillent de nombreux africains, dont Macrobe recueille dans ses Saturnales, les subtils entretiens sur les choses de la tradition romaine, classique et païenne : Macrobe, Sat. VII, 16 ... Coìisidi initiates, sacris, Liberi, Patris . . .
mius, n'a qu'un titre: il est taurobolié; mais ce titre fait de lui «un dignitaire de haut rang, au même titre que le Père des Pères chez les Mitriastes, que l'archiboucole de Liber Pater ou l'hiérophante d'Hécate»33.
L'intérêt qu'offre la mention d'un «corax» a été relevé par A. Merlin. Notre humble texte permet d'admettre, pour la première fois, qu'un piétiste pouvait, à Carthage, se hausser aux plus hauts degrés de l'initiation aux mystères; un mithriaste y peut être corax; un serviteur de Cybèle et d'Attis, s'y faire taurobolier; un clarissime, y atteindre les hautes dignités de deux ordres différents, celui d'Hécate et celui de Liber.
Mais la question demeure entière de savoir si, à cette collaboration rituelle, correspond une association d'ordre topographique. Il est admis, en effet, que le « culte du dieu iranien et le culte de la déesse phrygienne vécurent en communion intime sur toute l'étendue de l'Empire»34 et qu'il est vraisemblable que « Cybèle accueillit les épouses et les filles des mithriastes». Le plus ancien Mithreum connu en Italie (en 142) est attenant au Métroôn d'Ostie3s; comme en Italie, en Afrique (à Philippeville, à Sétif), les deux cultes coexistent et se relient. Mais c'est vainement que nous avons recherché dans le voisinage du Métroôn, les traces d'un Mithreum. Rien dans l'abside qui a été annexée à la base septentrionale du temple n'a trahi un dispositif, ni révélé d'objets proprement mithriaques; on a vu également que le sous-sol hypostyle du temple n'a rien livré qui permît de définir sa destination spéciale36.
33 H. Graillot, op. cit., p. 171. - cf. J. Toutain, Les cultes païens dans l'empire romain, II, Paris, 1911, p. 142.
34 F. Cumont, Mystères de Mithra, 1913, p. 152. - E. Espé- randieu, art. Taurobolium, dans Daremberg, Saglio et Pot- tier, Diet, des Ant. gr. et rom.
35 F. Cumont, Textes et Monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra, II, Textes et Monuments, Bruxelles 1899, p. 245, 265, 333, 418, 523. Il ne faut voir dans l'étrange fantaisie «chtonienne» esquissée par M. Gastinel dans RA, 1926, 1, p. 70 et suiv. que l'écho d'une affirmation aventurée qu'on lit dans un «guide» publié par feu le Dr. Carton. Ces speleae imaginaires sont en réalité les galeries d'exploration que nous avons creusées pour déterminer le plan des murs de soutènement de la colline.
36 Sur l'improbable disposition hypostyle des Mithraea voir F. Cumont, op. cit., p. 62. Les fragments de bas-reliefs, décrits plus haut, et qui se relient aussi bien au culte de
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 291
Par ailleurs, notre Métroôn peut-il bénéficier de la confusion que quelques textes paraissent établir entre Caelestis et la Grande Mère37? Certes, des philosophes initiés, portés par le besoin de purifier les rites divers en unifiant leur objet, ont réalisé un syncrétisme théosophique où Liber, Mithra, Attis et Cybèle, Cœlestis, Anahita ou Isis, ne composent qu'un seul couple «aux mille noms»; mais la foule qui veut des temples et des statues38 et à la piété de qui la munificence municipale offre, en les distinguant et en les multipliant, des sanctuaires nommément consacrés, n'a pas admis qu'on la frustrât de fêtes particulières, ni qu'on la privât de recours spéciaux à des divinités nettement diversifiées. Proches l'une de l'autre, les deux déesses demeurent distinctes en fait : Augustin oppose la «vierge» Caelestis à la «Mère de tous les dieux»39, la Bérécynthienne, dans la phrase même où il associe, pour les confondre dans une unique réprobation40, les rites par lesquels on les honore et auxquels il participa à Carthage. Cybèle avait ici ses dendrophores parfaitement individualisés41 et ses «porteurs» ou lecticarii*1, les frediani, qui, au début du Ve siècle, constituaient une corporation43. Ces observations suffisent à décourager tout effort d'identification entre notre Métroôn et le hieron de Caelestis
Mithra si on les compare à quelques débris mithriaques énumérés par F. Cumont n° 235, fig. 213, n° 242, fig. 216, n° 245, pi. V), ne suffisent pas à imposer la certitude que Mithra voisine ici avec Cybèle.
" Un taurobole, le plus ancien peut-être qui soit connu (année 134) a pu être accompli sous l'invocation de Caelestis à Pouzzoles (CIL, X, 1586) cf. Espérandieu, op. cit. (art. tauro- bolium), p. 50 et H. Graillot dans RA, 1904, I, p. 334 sq.
is Aujourd'hui encore la piété populaire fractionne volontiers l'unité de la Madone : N.D. de la Mehala, qui perpétue à Carthage l'antique épithète de Salinensis, autrefois donné à Caelestis (Ulpien, fragm., 22, 6), ne laisse pas confondre le culte que lui rendent spécialement les Maltais, avec celui que reçoit, de la part des Siciliens, la Vierge Trapanaise à la Goulette.
^ De Civ. Dei, II, 4. 40 Tertullien, Apoi, 12, distingue Liber, Cybèle et Caelestis. 41 CIL, VIII, 12570. 42 Lecticarii : F. Cumont, CRAI, 1918, p. 320, n° 5 et
S. Gsell, inscriptions de l'Algérie, n°2136 (princeps lecticario- runi).
41 Cf. J.-P. Waltzing, Étude historique sur les corpoi ations professionnelles chez les romains II, Louvain 1896, p. 138 et le commentaire de Godefroy, sous Cod. Théod., XVI, 10, 20, au sujet de ces gestatores.
que décrit, avec une précision peut être trompeuse, l'anonyme du Liber de Promissiofiibus44.
Les cultes, comme les sanctuaires, sont demeurés distincts. Il semble même que la dévotion qu'attiraient les divinités phrygiennes survécut à celle que Carthage vouait à sa protectrice familière, Caelestis. Le temple de celle-ci, abandonné de bonne heure par les païens eux- mêmes, à en croire l'anonyme du Liber, paraît avoir été désaffecté dès l'année 399. Le temple de la Grande Mère et d'Attis attirait encore des fidèles en 415, date de la constitution par laquelle Honorius et Théodore constatent l'existence de leurs rites et de leurs excès; ils auraient ainsi franchi la rude étape de la proscription édictée en 3914\
Restauré entre les années 333 et 337, sous le proconsulat de L. Aradius Valerius Proculus46, le sanctuaire que nous avons tenté d'identifier demeura, durant le quatrième siècle, le théâtre de cérémonies particulièrement pompeuses. Il ralliait autour des mystères qu'il cachait cette population inquiétante de prêtres dont saint Augustin dénonce «la chevelure odorante, le visage fardé, les promenades équivoques à travers les rues et les places de Carthage47. C'est du seuil de notre Métroôn que s'ébranlait le cortège délirant du 28 mars que suivit le même Augustin, du temps où les erreurs de la jeunesse lui permettaient de s'y mêler. La procession des chantres et des danseurs sacrés, entourant la litière où la confrérie des frediani soutenait la Bérécynthienne, descendait vers la mer en suivant la large rue droite du decumanus maxim us. Sur le rivage, un môle spacieux prolongeant l'avenue recevait la déesse; là, à l'abri des vagues qu'arrêtait un épais enrochement, était accompli le rite de la lavano**.
44 III, 38, 44, dans Pair, lai, LI, col. 835. Cf. A. Audollent, Carthage romaine, Paris, 1901, p. 376, n. 3 et p. 383 sq.
^Cod. Theod., XVI, 10, 10, 11. 46 CIL, VIII, 24521. - Cl. Pallu de Lessert, Fastes ... II, 42,
45; cf. J. Toutain, Les cultes païens . . . , II, p. 104; RA, 1898, I, p. 316; CRAI, 1897, p. 723.
47 De civ. Dei, VII, 26 : femineo ingressu per plateas vicos que Carthaginis. L'asiatisme exubérant a pu très tôt déborder, en Afrique, les cadres de haute dignité que Claude imposa au culte phrygien, au moment où il admettait Attis au rang des dieux de Rome (cf. J. Carcopino, MEFR, XL, 1903, p. 134 à 158.
48 De civ. Dei, II, 4 et 5; Arnobe, Adv. Nat., VII, 32; voir Ch. Saumagne, Colonia Julia Karthago, dans BCTH, 1924, p. 134.
292 BYRSA I
Les rues et les insulae
Aux abords du temple, la recherche des rues et des égouts, entreprise a priori, a révélé des vestiges suffisants pour autoriser une délimitation de six insulae, réparties symétriquement au nord et au sud du decwnanus maximus. Le relevé des positions relatives de ces vestiges, accompli d'une manière particulièrement rigoureuse, conduit à considérer comme exacte l'hypothèse précédemment avancée touchant l'orientation, la largeur et le développement des rues49.
Le dallage des rues est, en général, trop délabré pour qu'on puisse en préciser la composition et les formes. Il était fait de pavés plats, en calcaire gris du Djebel Djelloud, polygonaux et juxtaposés sans soin. A intervalles irréguliers, un regard ouvert sur un égout, en révélait le tracé souterrain. Il ne semble pas que des trottoirs aient régné sur les côtés des rues.
La règle rigoureuse de la cadastration rectili- gne ne paraît pas avoir été jamais assouplie aux exigences du nivellement. Le profil des rues est généralement horizontal; la transition entre les paliers étages sur le flanc de la colline était assurée par des degrés, à moins que la rue ne s'arrêtât net au pied des murs de soutènement, sans avoir d'accès à la partie qui en prolongeait le tracé sur un plan supérieur so.
44 Ch. Saumagne fait ici allusion à l'article cité à la note précédente. Nous rappelons qu'à la suite des travaux de P. Davin dont les résultats furent publiés en 1930 (P. Davin, Étude sur la cadastration de la Colonia Julia Carthago, dans Revue Tunisienne, 1930, 2, p. 73 à 85) il devait modifier quelque peu les résultats de ses recherches en se rangeant aux conclusions de ce dernier (Ch. Saumagne, Les recherches récentes sur la topographie de Carthage, Journal des Savants, 1931, 4, p. 152). Les deux auteurs considèrent donc que les insulae mesurent 120 pieds sur 480 (35,28 m χ 141,12 m), la largeur du decwnanus max. et du cardo max. est de 40 pieds (1 1,76 m), celle des autres rues de 24 pieds (7,06 m) (NDLR).
so Toutefois, le sous-sol de cette dernière portion n'était pas parcouru par un égout. Il contenait, au contraire, un jeu de quatre citernes, creusées bout à bout (long. 4,40 m, larg. 2,60 m, profond. 5,00 m), dont l'axe coïncide avec celui de la rue et qui communiquent entre elles. Les canaux d'adduction d'eau paraissent ne faire provenir l'eau qui les alimentait que du côté occidental de la rue, en particulier de l'édifice qui sera décrit plus loin sous le nom de «Maison d'Attis». Chacune des deux chambres extrêmes était rendue accessible par un puisard ménagé dans un angle (angle N-E pour la citerne nord, S-0 pour la citerne sud). Les pièces
Le decwnanus maximus, par exemple, absorbé peut-être, en avant des absides de Beulé, par une place étendue à la cote 46, descendait vers le Métroôn et la cote 40, par une série de larges degrés en pierre rouge; il rejoignait ensuite la cote 36 par un escalier dont les traces ont disparu.
Par contre, le cardo V est, après s'être détaché du decumanus maximus, pour séparer, en courant vers le nord, le Métroôn des grands murs de soutènement de la colline, était interrompu par la brusque dénivellation qui élevait le temple à plus de dix mètres au-dessus de la cote 30. Cette rupture n'empêchait pas que la rue reprit son parcours pour rejoindre, à quatre-vingt-onze mètres plus loin, le tracé du decumanus I nord.
Le système des égouts paraît avoir adapté le plan de voirie à un réseau particulièrement développé d'évacuation des eaux souillées.
A vrai dire, le decumanus maximus n'était pas parcouru, comme on eût pu le prévoir, par un collecteur principal, mais seulement par des cloacae secondaires, tributaires de caniveaux provenant du cardo V est et du Métroôn lui- même, dont les eaux se concentraient sous sa façade et, par un conduit de 0,40 m de section, se jetaient dans un égout de 0,53 χ 0,77, situé sous le decumanus maximus, à 2,50 m environ du bord septentrional de la rue. En aval, cette fosse s'élargissait, après avoir recueilli au passage les eaux que les égouts du cardo VI est recevaient du palier C. 30 a, de part et d'autre du decumanus maximus*1*.
Les eaux évacuées des sommets antérieurs de la colline paraissent donc avoir été conduites d'une manière divergente par rapport à l'axe est-
intermédiaires étaient complètement closes. Ces citernes ont été découvertes vides et en parfait état de conservation. Le radier en était jonché de jarres à col long et étroit qui paraissent avoir échappé aux mains des derniers puiseurs d'eau et qui sont vraisemblablement contemporaines du moment où l'usage de ces citernes a été abandonné. Il semble qu'à ce moment, elles aient été volontairement condamnées et par la suite oubliées sous le dallage de la rue qui vint recouvrir les puisards. L'affectation de ces réservoirs à l'usage public ne paraît pas douteuse. A quelques pas, au sud de la citerne méridionale, s'érigeait une petite chapelle publique qui sera décrite plus loin.
Sl C'est en aval, sous la partie inférieure du parcours du decumanus maximus, que l'égout prit les proportions de grand collecteur, tel qu'il apparaît à son issue dans la mer, sous le môle.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 293
ouest de la cadastration. Il a été possible d'explorer dans le détail l'une de ces grandes artères, sur un développement de 60 mètres environ. Cet égout court parallèlement à l'axe du cardo IV est, au nord du decumanus maximus. Ouvert au pied de la dénivellation qui sépare la cote 50 de la'cote 36, il offre une section rectangulaire, de 0,90 m de large sur 1,35 m de hauteur, surmontée d'une voûte en berceau de 0,60 m de rayon, dont les retombées, débordant légèrement les parois verticales, ménagent de part et d'autre un retrait de 0,15. Suivant une pente régulière de 10%, il aboutit au collecteur qui, placé sous le decumanus I nord, recevait, pour les conduire à la mer, les eaux des collines de Saint-Louis et de Junon.
Cette déclivité régulière n'est interrompue que sur une longueur de 5,60 m, à sept mètres environ du point initial de l'exploration : alors que, dans son ensemble, l'appareil de la construction est fait de moellons médiocres en grés de Sidi-bou-Saïd, liés par une chaux grise et cendrée, dévorée par les acides et par l'humidité, il est, au contraire, composé sur ce parcours horizontal de 5,60 m, de pierres de taille disposées en assises latérales (trois assises, de bas en haut, 0,54, 0,51, 0,30) et couvert de larges dalles de 0,60 sur 1,30 et 0,10 d'épaisseur. Au-dessus, est ménagée une voûte en décharge de 0,45 de rayon, constituée par cinq pierres de taille appareillées en voussoirs, hautes de 0,80. Cinq regards s'ouvrent à la voûte; les deux premiers, couronnés d'un puisard carré, sont percés à chacune des extrémités de la portion horizontale; le troisième à 3,50 m du second, le quatrième à 8,40 m du précédent et le cinquième à 22,60 m de ce dernier; leur diamètre est de 0,60 m.
A 8,70 m du regard le plus éloigné de l'origine, l'égout s'ouvre dans le collecteur qui dépend du decumanus I nord; ce collecteur, ruiné complètement, paraît avoir été spacieux et bâti en pierres de taille; le bouleversement du sol en a interdit l'exploration52.
La confection de voûtes en maçonnerie de blocage, posée à bain de mortier, a été réalisée par l'application de nattes de roseaux sur la
" L'égout ne paraît avoir reçu, sur son parcours de 65 m, que deux affluents venus de l'est (de 0,50 χ 0,50). Il était donc exclusivement destiné à évacuer les eaux du sommet de la colline.
forme donnée par des gabarits cintrés. Ces gabarits étaient dressés à intervalles de 0,47 m, au dessus de la fosse rectangulaire de l'égout, sur les bords de laquelle ils appuyaient leurs extrémités; ils étaient recouverts par des claies composées de cannes de roseaux liées entre elles par des lacets de cordelettes disposées sur trois lignes parallèles. Chacune de ces nattes mesurait 0,84 χ 1,50 m. Le blocage de la voûtelette, coulé sur ce coffrage, s'en incorporait les éléments qui paraissent n'avoir pu être extraits de la masse solidifiée, après achèvement des travaux.
A l'extrémité opposée de notre champ d'investigations, il a été possible de recouper les égouts correspondants aux cardines VI et VII est. L'égout du cardo VI est, reconnu sur un parcours de quarante-cinq mètres environ, est construit suivant deux modes différents. Dans la portion qui est en amont, il offre une section presque carrée de 1,10 m de large sur 1,20 m de hauteur; il est simplement recouvert de dalles rectangulaires dont les extrémités sont posées sur les bords de la fosse maçonnée où elles s'insèrent. Plus bas, le canal se resserre à 0,76 m et se couvre d'une voûtelette en blocage dont le sommet se surélève brusquement à 1,45 m du radier de la fosse. Il est à noter que ce dispositif se rétrécit ainsi avant d'aboutir au collecteur qui, sous le decumanus I sud recevait le tribut de cette cloaca.
La rue, en ces derniers points, était pavée de dalles irrégulières, posées sur une couche d'humus (épaisseur 0,50 m à 0,30 m) qui les séparait du sol vierge.
En ce qui concerne les decumani, le decumanus maximus a été reconnu en divers points et en particulier, en avant du Métroôn, où il offre un dallage soigné, fait de petites dalles rectangulaires de calcaire gris, juxtaposées en rangées parallèles et jointives (0,45 χ 0,48 - 0,40 χ 0,66 - 0,35 χ 0,50).
Le decumanus I nord et le decumanus I sud ne peuvent qu'être restitués. Le premier est suffisamment indiqué par la présence du grand collecteur où se déverse l'égout du cardo IV est. Le second se développait dans le prolongement exact du tronçon qu'en a dégagé le R. P. Delat- tre, à la hauteur de la nécropole punique de Saint-Louis53.
53 A. L. Delattre, BCTH, 1893, p. 100.
294 BYRSA I
Les murs de soutènement
L'exploration des abords septentrionaux du Métroôn a révélé que l'angle N-E de la colline était ceint de murailles qui soutenaient des terres d'apport et des débris des ruines de la ville punique. Parallèlement aux grands murs précédemment décrits54, et légèrement en retrait, un épais revêtement de pierres de taille et de blocages, soutenant le palier C 50 a, surplombait la cote 36, en dessinant un saillant de vingt-cinq mètres environ de côté.
Cet éperon, dont il ne subsiste que d'importantes infrastructures délitées et qui soutient, dans sa partie la mieux conservée, la villa Sau- magness, enrobait un «mur d'amphores» qui forme à cette extrémité de la colline, la réplique de celui que le R.P. Delattre a découvert à l'angle sud-est56.
Les amphores, du type rhodien, sont disposées en quatre assises alternées, les unes constituant un banc de jarres couchées la pointe en dehors, les autres, une palissade de jarres dressées qui s'insère entre les amphores horizontales (entre les cols et les pointes). Il semble que l'épaisseur du mur soit déterminée par une longueur d'amphore couchée et par deux ou trois diamètres d'amphores dressées.
Les empreintes ou sigles suivants ont été relevés :
Estampille : Q. GETAE (cartouche de 0,085 χ 0,022), sigles au pinceau, à la peinture rouge, AT; 7&; \£; Q. Parmi les débris qui paraissent provenir du mur, une cursive au pinceau sur un tesson peut être lue : C APICI CA (P)ITONIS, mots accompagnés d'un sigle.
Le grand mur qui supporte l'hôtel Saint- Louis57 à la côte C 50 b et qui surplombe le cardo V est, au nord du decumanus maximus, a été l'objet d'un examen sommaire. Il mesure à sa base et sur une hauteur de dix mètres, une épaisseur de sept mètres. La partie méridionale seule émerge en plein dégagement, offrant une façade développée sur une longueur de trente-
S4 Ch. Saumagne, BCTH, 1924, p. 177 et suiv. " Emplacement aujourd'hui occupé par la maison de
M. Mansour Moalha, rue P. Mendes France (NDLR). s* A. L. Delattre, BCTH, 1894, p. 89 sq. " Aujourd'hui hôtel «Reine-Didon».
cinq mètres environ; la partie ensevelie sous les déblais paraît se prolonger jusqu'à la hauteur du decumanus maximus. La face externe du mur était consolidée par de hautes harpes en pierres de taille, larges de 1,20 m, épaisses de 0,90 m et séparées par des intervalles moyens de 1,40 m; elle dominait immédiatement, à l'ouest, le cardo V est.
Au-dessus de cet enrochement massif, et à l'aplomb de sa face interne, une muraille de blocage, épaisse de 1,95 m et peut-être anciennement revêtue de moellons équarris, surélevait l'abrupt de quatre mètres environ, jusqu'au niveau de la côte 50, ménageant sur toute la longueur du mur de base et sur une largeur de cinq mètres, une sorte de coursive en terrasse.
A 11,20 m de l'extrémité méridionale du mur, un escalier, large de 2,40 m, conduisait à la partie supérieure du palier par quatre gradins de 0,30 m de hauteur. Ces degrés, encadrés de moellons bien équarris, paraissent avoir desservi un édifice important dont les vestiges délabrés défient cependant tout essai de restitution et n'ont été respectés que dans le sous-œuvre d'une citerne particulièrement profonde.
Ce promontoire paraît avoir été délimité, du côté qui regarde le sud, par une muraille dont la disparition intégrale signifie assez qu'elle était construite exclusivement en pierres de taille, facilement exploitables. Cette muraille, après un parcours de dix-huit mètres environ, rejoignait un autre massif de soutènement qui lui est perpendiculaire et se développe sur près de vingt- deux mètres pour se raccorder ensuite, par une série de deux ou trois redents58 au mur d'amphores qui soutient l'angle S-E de la colline. Ce système de contreforts, déterminant une longue terrasse, ménageait la communication de plain-pied entre les paliers C 50 d et C 50 c, coïncidant, pour une part, avec le tracé du cardo IV est.
Un sondage profond exécuté dans l'épaisseur du promontoire C 50 d, le long de la face interne du grand mur de sept mètres (entre ce mur et la citerne), démontre qu'il est fait de déblais d'époque punique et procède du plan d'aménagement de la colonie julienne. Les terres et gravois provenant du nivellement du sommet du plateau ont été déversés en arrière du grand mur préala-
Enfouis sous la villa située au n° 8 de la rue de l'Algérie.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 295
blement élevé le long du bord occidental du cardo V est.
Ces investigations ont ainsi révélé l'importance exceptionnelle des grands travaux que les Romains durent entreprendre pour modeler le plan de la colline aux règles de la cadastration et pour éviter que l'érosion, particulièrement active au cours de l'abandon séculaire des ruines de la ville, ne compromît la stabilité des édifices.
LES EDIFICES VOISINS DU METROON
Immédiatement au nord-ouest du Métroôn, dans l'insula que délimitent les cours parallèles des cardines IV et V, au niveau de la cote 36 a et appuyés contre les hauts murs qui soutiennent le palier C 50 a, d'importants vestiges, ensevelis sous dix mètres de déblais, marquent l'emplacement d'édifices privés.
Ces vestiges paraissent devoir être systématisés en deux groupes, entre lesquels il demeure malaisé de rétablir le rapport où ils étaient .anciennement.
La «Maison d'Attis». Cette désignation, que nous proposons de lui donner pour la seule commodité, se justifie par l'abondance des figurations picturales qui reproduisent sur ses murs les instruments de musique rituelle du culte phrygien.
Cette maison inscrivait son plan dans une encoignure des hauts murs qui contrefortaient la colline. Sa façade principale se développait le long du cardo V est, sur une longueur de 26,60 m. Par une porte qui s'ouvrait à 4,30 m du pied du mur escarpé contre lequel butait la rue et de l'endroit où s'érigeait une chapelle, on pénétrait dans un vestibule long de 22 mètres, large de. 3,80 m, sorte de couloir spacieux, parallèle à la façade. La porte, large de 1,65 m, était encadrée de piliers en pierres de taille bien appareillées, superposées en assises régulières; elle s'ouvrait dans un mur de 0,55 m d'épaisseur. Couchée sur le sol, gisait la partie inférieure d'une statuette en marbre figurant une nymphe au buste nu et aux jambes drapées, qui porte à bouts de bras une large conque étalée sur son giron.
Ce vestibule donnait accès au corps du logis par deux portes, l'une ouverte à son extrémité
nord, l'autre, au côté opposé à l'entrée principale. Le corps de la maison paraît avoir été composé de cinq pièces, dont trois sont réparties autour d'une courette centrale, les deux autres constituaient l'aile septentrionale de l'édifice.
Cette courette (6,30 χ 6,00 m) délimitée par de beaux murs en moellons cubiques (0,60 χ 0,60 m) revêtus de stucs peints, était pavée d'une mosaïque en grains de marbre noir, semée de rectangles en marbre blanc et encadrant un espace carré (2,30 χ 2,30 m) bordé de longues barres de marbre blanc où se creusait une petite vasque-fontaine. A la base des murs, courait un galon de mosaïque noire, séparé du pavement principal par une bande blanche où s'inséraient deux traits noirs parallèles, l'un fin et simple, l'autre brisé par la projection de den- ticules en forme de créneaux. Il semble que cette pièce ait constitué un cavaedium, sans piliers, éclairé seulement par un compluvium au- dessus de l'aire centrale de Y impluvium.
Par une porte ouverte dans chacun de ses trois côtés, nord, sud et ouest, cette courette communiquait avec les trois pièces qui l'entouraient. Elle paraît avoir été séparée complètement dû vestibule, à l'est. Le seuil des portes était fait de dalles engagées sous les pieds-droits latéraux et il était couvert d'une mosaïque à losanges noirs sur fond blanc.
La chambre adjacente, au nord, était divisée en deux parties inégales par deux solides piliers bâtis à grand appareil et revêtus d'un très beau stuc rouge; leur face antérieure imitait un pilastre à cannelures rudentées.
Des deux pièces qui formaient ensuite l'aile extrême, l'une conserve, dans un angle, les restes d'une mosaïque à dessins géométriques (cercles au centre desquels rayonne une étoile à huit branches).
Cette demeure était ornée de peintures aux couleurs vives. Sur le mur oriental de la courette, dans le premier état de la construction, une plinthe bleue, haute de 1,80 m, était séparée, par une bande verte de 0,10 m, de panneaux à fond jaune qu'ornaient des sujets peints à la fresque (fragments d'un visage, d'une antilope, main tenant une épée).
La chambre aux pilastres rouges paraît avoir été entièrement ornée d'une résille géométrique de branches de laurier, entre lesquelles sont suspendus par de minces rubans, soit des oscilla,
296 BYRSA I
soit des syringes, soit encore des cymbales minuscules liées à des petites trompettes en forme de corne.
Au point où le cardo V est butait le pied du grand mur de soutènement dont le sommet supportait le Métroôn, à quelques pas de la porte d'entrée de la maison d'Attis, une chapelle s'érigeait dont le dos s'appuyait contre ce mur lui- même. Large de 1,96 m, profonde de 2,30 m, elle s'ouvrait sur la rue et presque dans son axe par une porte large de 1,05 m. Le fond de cet édicule était divisé, par une haste de pierres de taille, en deux niches, à sections rectangulaires, larges de 0,74 m et profondes de 0,53 m. Dans le bas de chacune de ces niches, une banquette de maçonnerie était ménagée (haut. 0,73 m, profondeur 0,30 m). Il est vraisemblable que chacune de ces banquettes servait de support à l'une des deux statuettes qui ont été découvertes, incomplètes et mutilées, au pied des niches59 (fig. 3).
Entre la chapelle et la façade de cette maison d'Attis, un sol de mosaïque, exhaussé de 0,75 m par rapport au niveau de la rue témoigne de l'existence d'une pièce annexée au sacellum. C'est là peut-être un sacellum comme on en éri-
^ Dans la niche est : dieu à grande barbe et à chevelure abondante; marbre taché de bleu; travail très médiocre, chevelure grossièrement traitée à l'aide du trépan, pli inguinal exagérément marqué. Le dos, fait pour être appliqué, est seulement ébauché. L. Poinssot discernerait volontiers, au bas de la statuette, l'existence d'une tête de chien et reconnaîtrait ainsi un Pluton accompagné de Cerbère. Dans la niche ouest : corps d'adolescent nu, en marbre blanc à paillettes semblables au Paros. La tête manque, la chevelure retombait en mèches bouclées sur les épaules. Un baudrier en sautoir pend de l'épaule droite sur la hanche gauche. Le long du corps subsiste la trace d'un attribut (un arc?). Le mouvement du torse indique que le personnage reposait sur la jambe droite. Ce torse est très bien traité. D'après L. Poinssot, cette statuette peut être rapprochée de celle qu'il a décrite en ces termes (Catalogue des Musées et Collections archéologiques de l'Algérie et de la Tunisie, Musée Alaoui, supplément, Paris 1909, 3e section C, sculpture par L. Poinssot, p. 53 n° 989 et pi. XXXI, 2): «marbre blanc, statuette d'adolescent (haut. 0,49) qui faisait partie d'un groupe. Chevelure tombant en boucles sur les épaules; une petite draperie sur l'épaule gauche et sur la poitrine nue, un baudrier orné de clous. Autour du cou, le bras d'un second personnage . . . Carthage ». Cf. S. Reinach, Répertoire de la statuaire antique, III, p. 34. Nous pensons qu'il s'agit d'Eros mais, ainsi que le fait observer L. Poinssot, ces caractéristiques conviennent aussi à une représentation d'Apollon, éphèbe, portant sur la hanche gauche la cithare retenue par un baudrier.
geait aux compita, aux croisements des viae publicae et des diverticulae. Et il est possible, en effet, qu'au pied même du mur de soutènement courût une venelle par où étaient reliés, au pied du Métroôn, les cardines V et VI est, et qu'à la façon des Lares qui sont aux carrefours des chemins ruraux, des divinités aient été honorées en ce point comme les protectrices du viens et de la ruelle latérale. Peut-être est-ce à l'existence de chapelles semblables que la via Salutarla, la via Veneria ou Caelestis, le viens Saturni devaient leurs noms60.
La «Maison d'Ariadne». Cette maison a été sommairement décrite par L. Poinssot et R. Lantier à l'occasion de la publication qu'ils ont faite de la belle mosaïque qui l'ornait et dont ils ont identifié le sujet avec un épisode des amours de Bacchus et d'Ariane61.
Les fouilles, poursuivies par dégagement, ne paraissent rendre compte que de la partie méridionale de la maison, dont il se pourrait que l'ensemble ait absorbé l'intervalle entre les cardines IV et V est. Cette portion de l'édifice offre la particularité d'être sensiblement surélevée par rapport au reste de la maison qui a pu s'étendre en contrebas. Elle dessine dans son ensemble un rectangle de 18,80 m sur 7,00 m (murs compris), dont l'un des côtés longs coïncide avec le grand mur de soutènement derrière lequel s'entassent les massifs d'amphores, et dont le côté court occidental borde le cardo IV est.
A l'intérieur de ce rectangle s'inscrivaient quatre pièces de dimensions sensiblement égales : longueur, 6,42 m; largeurs, de l'ouest à l'est, 3,75 m, 4,40 m, 4,45 m, 3,30 m.
La plus occidentale d'entre elles est ensevelie sous le bastion qui, à une époque postérieure, paraît avoir protégé l'accès ouvert par la rue à la citadelle. La suivante, coupée en son milieu par les soubassements du même bastion, semble avoir été divisée, sinon en deux salles, du moins en deux parties, distinguées par la variété des panneaux de mosaïque qui revêtaient leur sol.
60 II subsiste quelques traces d'un édifice plus ancien enseveli sous la chapelle et sous la mosaïque voisine (voir A. Audollent, Carthage romaine, p. 310-311).
61 L. Poinssot et R. Lantier, Les mosaïques de la «maison d'Ariadne» à Carthage, dans MM AI, XXVII, 1924, p. 69 et suiv.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 297
Celui qui couvrait la partie nord (3,50 m χ 4,40 m) comportait douze médaillons, dont chacun figurait, dans un encadrement de guirlandes, une tête d'animal (mulet, panthères, etc. . . ). L'autre partie de la salle a été complètement dépouillée de son pavement dont une tête de Glaucus, étalée sur un seuil, demeure le seul témoin62.
Cette salle s'ouvrait par deux portes, pavées de mosaïques (tête de Glaucus précitée, chevaux de course affrontés), sur une pièce vaste (6,42 m x 4,45 m) dont le sol était revêtu de trois panneaux de mosaïques à dessins géométriques, pareils à trois tapis juxtaposés, l'un d'eux recouvre le fond de la salle, le long du mur de soutènement, d'un revêtement d'écaillés polychromes (2,06 x 3,82 m). Des deux autres, l'un s'étend immédiatement devant les chevaux affrontés sur le seuil, étalant une surface de 1,38 x 3,80m une «juxtaposition de chevrons» ou plutôt, à notre sens, de cubes de cristal translucide de 0,20 m de côté, dans l'épaisseur desquels se brise et se réfracte une exubérante profusion de rayons (rose, lie de vin, ocre, jaune clair, marron, gris-vert). Ce registre et le précédent, perpendiculaires l'un à l'autre, sont unis dans une même intention ornementale, par un cadre composé d'un trait gris et d'une ligne onduleuse dans les courbes de laquelle se dégradent, en alternant, des gris et des roses. Le troisième panneau offre des dents de loup réparties en quatre séries de bandes brisées.
Dans l'angle où ce dernier registre s'insère, entre les côtés intérieurs des deux premiers, une base (0,40 x 0,40 m, diam. 0,33 m) soutenait une colonnette disparue.
La quatrième pièce (3,30 x 6,42 m), la plus orientale, était également divisée en deux secteurs dont l'un (3,30 x 3,90 m) était occupé par la grande figuration historiée du « Triomphe d'Ariadne» et l'autre (3,30 x 2,60 m) contient un décor géométrique. En arrière du «Triomphe d'Ariadne» une banquette légèrement surélevée
62 A l'époque indéterminée où fut élevé le bastion de défense, cette deuxième partie de la pièce fut séparée de la précédente par une murette percée d'une porte et fut réduite aux dimensions exiguës de 1,40 m x 2,30 m. Plus tard, le réduit, dépouillé de sa mosaïque, fut condamné et les portes en furent obstruées par des cloisons en briques de toub.
semble avoir été superposée à un premier motif en dents de loup. A l'angle N-0 de cette dernière salle, un regard circulaire, percé dans une dalle de calcaire, s'ouvrait sur une citerne voûtée dont l'arête supportait la murette antérieure de la pièce63.
Il semble que cette partie de l'immeuble ait constitué des caenaciila surélevés par rapport au corps principal de la demeure, qu'ils dominaient peut-être à la façon d'un solarium. On y accédait par un escalier ouvert sur un vestibule, en avant de la chambre d'Ariadne. L'exploration de la partie inférieure, conduite en galerie, permet de supposer qu'un atrium était entouré de chambres, peut-être en arrière d'une colonnade péristyle, du type dit corinthien. Les murs étaient ornés de peintures où dominait la couleur bleue, l'ordre architectural en était à la fois varié et soigné, comme l'indique la découverte de fragments importants de quatre chapiteaux de marbre blanc, diversement stylisés, correspondant à des colonnettes engagées, et sur lesquels subsistent des traces d'or appliqué sur un mordant rouge. Trois des chambres qui séparaient cette cour du cardo IV est ont été reconnues; la mieux conservée d'entre elles était ornée d'un revêtement de stuc peint (rouge et bleu), elle s'ouvrait sur le portique par une porte (larg. 1,65 m) entre deux montants en pierre de taille.
Dans la couche la plus élevée des déblais qui recouvraient la maison d'Ariadne, au-dessus même du niveau supérieur du mur d'amphores, trois empreintes en relief ont été relevées sur des fragments de grandes tuiles :
a) perel I HEDVLI (HED liés) b) pe RELI HEDVLI (id.) e) pere LI HEDVLI (id.)
L'une d'elles était surmontée d'un cartouche circulaire où la syllabe .... CHI révèle le nom de C. Julius Antimachus. Deux débris semblables, l'un au nom d'Hedulus, l'autre où ce nom est accompagné celui d'Antimachus, ont été découverts, en 1903 et en 1902, à une cinquantaine de mètres au-dessus de la villa d'Ariadne64. Ainsi cinq empreintes, trouvées en un même
61 Long. 6,30 m; larg. 2,00 m; prof. 4,00 m. "CRAI, 1913, p. 685 et Revue Tunisienne, 1904, p. 276,
n°58.
298 BYRSA I
point de Carthage, nous transmettent le nom de Perelius Hedulus. En outre, c'est de la partie haute des terres qui comblaient l'une des chambres du grand bastion bâti aux dépens de la villa d'Ariadne, que provient la belle dédicace où nous lisons que «P. Perelius Hedulus sacerdos perpetuus» fut le premier qui, sur sa propriété privée et à ses frais, ait élevé un temple à la Gens Augusta6S.
De la fréquence du nom et de l'ancienneté du texte, on peut déduire sans témérité que Perelius fut le propriétaire et peut-être le premier bénéficiaire du lot colonial qui s'étendait à la cote 50 a, dominant de quatorze mètres environ le palier sur lequel s'élevaient les maisons dites d'Attis et d'Ariadne66. Avait-il affecté la superficie totale de sa sors à ce templuni recouvert de tuiles à son nom et s'était-il ainsi dépouillé de son fonds pour le placer, hors commerce, au rang des choses divini juris? Avait-il, au contraire, consacré une partie du lot à sa demeure privée67· Nous rappellerons que nous avons reconnu, en 1907, dans un secteur très proche68, une absidiole de 2,50 m environ de diamètre, bâtie en pierres de taille et enduite intérieurement d'un revêtement de stuc peint à la fresque, sur lequel étaient figurent les plis tombants d'une draperie rouge69. Là fut trouvée aussi une estampille au nom de Perelius. D'autre part, à l'extrémité orientale du plateau C 50 a, au-dessus du mur d'amphores, deux autres empreintes au même nom gisaient parmi des blocs équarris revêtus de fleurs peintes en rouge sur fond blanc70. A notre sens, le templuni où il
6<i R. Cagnat et A. Merlin, Inscriptions latines d'Afrique, Paris, 1923, n» 353.
66 Trop d'incertitudes subsistent touchant la délimitation de chacune des maisons reconnues pour qu'on puisse utilement rechercher quelle unité de mesure a été choisie pour présider à la répartition des sortes à l'intérieur de chaque insula.
67 Le caractère public de cette consécration est douteux, et peut-être le bien est-il demeuré tout entier profane.
68 Jardin de la maison située entre les rues Pierre Vienot et P. Mendes France (NDLR).
69 D'après le plan de Ch. Saumagne, son emplacement coïnciderait avec le parcours du cardo IV (NDLR).
70 Nous ne tenterons pas de répondre à la question que posait R. Cagnat, lorsqu'il rendait compte à l'Académie de la découverte de la dédicace Genti Angus tae (CRAI, 1913, p. 685). R. Cagnat constatait, d'une part, que le nom de Perelius Hedulus nous était donné par des marques trou-
ne faut peut-être voir qu'un édicule, se dressait dans la partie méridionale de la cote 50 a, qui coïncidait sensiblement avec le lot de Perelius; il dominait ainsi la place C 46 a, sur laquelle était érigé l'autel de Rome et d'Auguste, lui-même renversé plus tard de sa base et culbuté sur la place C 40 où il fut découvert par I. Saumagne, le 27 février 1916, contre le pronaos de temple de Cybèle71.
vées exclusivement à Carthage et que, d'autre part, quelques unes d'entre elles portaient, «à côté de la marque rectangulaire au nom de Perelius Hedulus, une autre marque, celle-là circulaire au nom de C. Julius Antimachus». Mais il notait que cette dernière marque avait été, par ailleurs, « rencontrée seule en Italie, aussi bien qu'à Carthage ». Ces remarques impliquaient la possibilité de conclure à l'existence, entre Hedulus et Antimachus d'une association commerciale limitée à la place de Carthage. Mais R. Cagnat observait: «Toute la question est de savoir si les briques estampillées au nom d'Antimachus sont entières et si le nom d'Hedulus ne figurait pas jadis, à côté, quand la pièce était complète; c'est ce que les éditeurs n'ont jamais indiqué, faute de deviner l'intérêt de cette constatation ». Il semble cependant qu'une indication ait échappé à l'illustre savant : une brique trouvée à Rome porte seulement le nom d'Antimachus et elle est donnée comme entière (CIL, XV, n° 1202, brique bipedalis de 0,59 χ 0,595 m). Antimachus pouvait donc figurer seul à Rome. A Carthage, sur les empreintes mutilées, au nom d'Hedulus, quatre associent ce nom à celui d'Antimachus. Sur les cinq empreintes provenant du gisement de la côte 50 a, deux offrent simultanément les deux noms : il y a lieu d'admettre que toutes les briques à cet endroit étaient frappées de la double empreinte. Parmi les cinq autres marques d'Hedulus, toutes de Carthage, une seule est éditée avec une indication d'origine précise (nécropole punique, entre les citernes de Bordj djedid et la mer, fouilles Vernaz) ; elle porte également la marque d'Antimachus. Ces constatations suffisent-elles à faire admettre que les deux noms ne sont associées qu'à Carthage et que, à Carthage, ils ne le sont que dans le gisement de la cote 50 a, propriété privée de Perelius Hedulus, sacerdos perpetuus? S'il en était ainsi et si les découvertes ultérieures confirmaient cette localisation étroite, on pourrait songer à trouver ici un cas d'application des dispositions des chapitres 76 de la Lex Colonia Genativae et 3 de la Lex munie. Tarentini touchant le recensement des figlinae tegulariae, considérées comme des indices de la fortune extérieure, (cf. Mommsen, Gesammelte Schriften, I, Berlin 1905, p. 158, où il rectifie l'opinion erronée qu'il avait émise à propos de la Lex munie. Tarent, dans YEph. Epigr. 3, p. 112; et surtout, Scialoja, dans le Bull. Istit. di Diritto romano XI, 1898 et Rendiconti Accad. Lincei, 1898, p. 216).
71 A. Merlin, BCTH, 1917, p. 85, n° 1 et 1919, p. XIV et suiv. Nous nous séparons ici de l'avis émis par A. Merlin; il semble que si l'autel avait été érigé dans le sanctuaire privé de Perelius, il eût été déplacé sensiblement dans la même direction que la dédicace. Les deux pièces ont été découvertes à près de 100 mètres de distance.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 299
Dans les déblais qui nous paraissent provenir de la maison de Perelius ou du templum Genti Augiistae un tronçon de colonne sectionnée au burin, porte les dernières lignes d'une inscription latine72 :
cv mu il mi sis secre RIS INPENSAETCVRA (sic) SVA INSTITVIT
La regrettable mutilation de ce texte nous prive d'un renseignement topographique très précieux. Nous avons déjà signalé un fragment découvert aux abords septentrionaux du Métroôn qui mentionne un Secretanti m73. Les deux textes sont d'une facture qui peut les faire attribuer à une époque relativement tardive. Un secretarium était annexé au palais proconsulaire au milieu du IIIe siècle74. Mais l'importance de la salle de justice que désigne ce mot ne s'affirme que comme un corollaire de l'organisation judiciaire au cours du IVe siècle et au début du Ve siècle. Et cette organisation, qui concentre le pouvoir judiciaire aux mains du Gouverneur^, rend probable l'opinion que le terme de secretarium s'appliquait par excellence à la salle d'audience du proconsul, dans les dépendances mêmes de sa résidence. Cette chambre de justice, où le huis-clos qui doit entourer les délibérations du gouverneur n'est levé qu'en faveur de quelques privilégiés laïcs ou ecclésiastiques et dans certaines causes, se serait donc élevée dans la partie N-E du sommet de la colline, un peu au nord des absides de Beulé et au-dessus du palier C50a (cote55)76.
72 Lettres : Haut. 0,05 m, écriture grêle et gravée sans soin; les mots sont jointifs. diamètre de la colonne 0,54 m, haut, du tronçon 0,52 m.
1%BCTH, 1924, p. 191, n° 12. 74 Saint Cyprien est interrogé par le proconsul in secretano (Acta proconsul.,^) lieu qu' Audollent (Carthage romaine, p. 286, note 9) identifierait volontiers avec le praetorium de la Vita Cy priant, 12.
75 Cf. E. Cuq, Inst. juridiques des romains, II, p. 867 et suiv. 7(1 Sur la règle du huis-clos, Salvien, De gubern. Dei, 111,
82 : « januas . . . non omnes fassim intrare praesumuent, nisi quos ant judex vacaverit, ant . . . ipsa honoris proprii digni- tas introire permiserit». Sur les privilèges, Cod. Just., I, 48, 3 (ann. 389); Cod. Théod., 1, 8, 1. Sur le privilège ecclésiastique, voir Matroye, Bull, des Ant. de France, 1921, p. 241, et son commentaire de la 5e décision du Concile d'Afrique de 407 (can. 97) et du Cod. Théod., XVI, 2, 38 (ann. 407). Une espèce
L'emploi du mot au pluriel (secretar i is) laisserait entendre que le palais proconsulaire contenait une aile où étaient groupées plusieurs salles d'audience.
Vers l'extrémité méridionale du champ d'exploration, entre les cardines IV et V est et dans une position symétriquement opposée à celle de la maison d'Ariadne par rapport au decumanus maximus, s'étendait, au niveau de la cote 36 b, un vaste édifice couvrant une superficie de 800 m2 environ. Relativement bien conservé dans ses parties les plus profondément ensevelies (à quinze mètres, en certains points) il a été anéanti partout ailleurs (fig. 4).
Il semble qu'il ait comporté deux parties distinctes : l'une immédiatement surplombée par les massifs* de soutènement dont le parcours77 coïncidait avec celui du cardo IV est, l'autre, plus modeste, disposée en bordure du cardo V est.
La première de ces parties, la plus occidentale, était composée, autant qu'il puisse paraître, d'une vaste cour dallée grossièrement de gros moellons de calcaire gris qui précédait un parvis soigneusement dallé de marbre. Sur ce vestibule prenaient accès trois salles, celle du milieu par deux portes, les pièces latérales chacune par une porte, toutes larges de 1,18 m; ces salles ne paraissent pas avoir communiqué entre elles.
L'appareil de la construction est imposant et soigné : les murs séparatifs sont faits de larges pierres de taille des «latomies» superposées en assises réglées de hauteur; les murs latéraux sont composés de moellons taillés joignant des pilliers en pierres de taille appareillés en besace aux angles.
L'art et le soin apportés au pavement retiennent l'attention. Le sol du parvis est revêtu de carreaux rectangulaires de marbre, de schiste et de calcaire (0,295 χ 0,595 m), taillés dans des brèches rubannées et juxtaposés avec une précision et une netteté parfaites. Le sol des pièces latérales est revêtu de carreaux rectangulaires
judiciaire, particulière peut-être à l'Afrique et pour laquelle l'audience est tenue levato velo est rapportée par Cod. Théod., XIII, 9, 6, en matière de submersis navibus (ann. 412, constitution adressée naviculariis per africani).
77 Ch: Saumagne précise «sous la villa Driant», il s'agit d'une maison qui occupe l'angle S-E du plateau de Byrsa (aujourd'hui n° 9 de la rue de l'Algérie.
300 BYRSA I
(0,285 χ 0,142 m), alternativement blancs et noirs, répartis en damier78.
La pièce que nous appelons le vestibule communiquait, à droite, avec une salle dont l'aire a été dévastée.
La portion orientale de l'édifice, bâtie dans le même appareil que la partie occidentale, mais qui paraît avoir eu une destination indépendante, était composée d'une vaste pièce carrée de 8,40 m de côté communiquant par une porte à un degré, ouverte dans sa paroi septentrionale, avec une vaste salle où ne subsistent in situ, au milieu du bouleversement, que deux fûts mutilés de colonnes de pierre revêtues de stuc. Dans la première de ces deux chambres, une colonnette monolithe en calcaire fin, dont il subsiste un tronçon de 2,25 m de longueur, constitue le seul témoignage de décoration architecturale découvert au cours de cette fouille difficile79.
Aucun indice ne paraît autoriser un essai d'identification de l'édifice. La disposition des trois cellae précédées d'un parvis ouvert lui- même sur une area dallée grossièrement peut évoquer l'image de quelque sanctuaire où une triade aurait été honorée. Le seul fragment d'inscription découvert, et qui gisait au niveau des dalles de l'area, rappelle une dédicace dans les termes suivants : «... 5/ aug sac /. . . h] onoratns L Grassianus AI... C Cererius Rogat. . . » Mais la divinité dont le nom ou le qualificatif s'achève par. . . 5/ demeure mystérieuse80.
Vestiges puniques et pre- juliens
Les sondages, qui ont été poussés au contact constant du sol vierge, n'ont rien révélé qui nous renseigne sur la topographie punique. Indépendamment des trois grands tombeaux violés et
78 II est à observer que les dimensions des éléments de cet édifice sont généralement des fractions ou des multiples du pied romain : épaisseur des murs 0,59 m = 2 p.; largeur des portes 1,18 m = 4 p.; distance entre l'angle de la salle latérale et la porte 1,44 m = 5 p.; dimensions des carreaux 0,285; 0,295; 0,296; 0,142; 0,595; 0,394 m.
79 Les galeries d'exploration ont eu un développement total de 60 m. environ et ont comporté l'extraction de près de 250 m3 de terre.
80 Texte dans BCTH, 1924, p. XIX. Ce n'est qu'avec la plus grande timidité que nous songeons à rappeler qu'une variante d'Ulp. Fragm., 22, appelé Salinensis, Caelestis, dea Carthaginis, (cf. Audollent, Carthage romaine, p. 264, note 3
ruinés qui ont déjà été signalés, deux puits puniques, quelques citernes et un édicule maçonné ont été découverts.
Des deux puits, l'un est situé à proximité de l'enceinte est du Musée de Carthage, près de l'extrémité d'un long et puissant massif de soutènement qui prolongeait, vers les absides de Beulé, le mur M 4. L'autre puits s'ouvre près de l'angle N-0 du Métroôn, entre l'abside et le cardo V est.
Tous deux, de section carrée, sont revêtus de dalles rectangulaires uniformément taillées et superposées de champ. Deux des quatre pierres qui constituent une assise sont taillées de manière à recevoir les arêtes latérales de deux autres pierres. Des encoches régulièrement ménagées sur deux parois opposées, à la hauteur des joints, permettent la descente dans la cheminée. Le puits voisin du Métroôn a été déblayé jusqu'à sa profondeur antique, à 32,60 m (cote 42); un éboulement a empêché d'achever l'exploration de l'autre puits. Tous deux ont été utilisés jusqu'à une époque tardive, l'un (celui proche de l'enceinte du Musée) n'a été obstrué que par les travaux de fortification du moyen-âge; l'autre contenait, jusque dans son extrême profondeur, des débris d'architecture arrachés au Métroôn, en particulier des fragments de chapiteaux monumentaux provenant des pilastres latéraux du temple81.
Les citernes ont toutes la forme de baignoires profondes et longues. L'une d'elles82, isolée, orientée N-E - S-0 (51° N-E), est longue de 3,58 m, large de 1,20 m, profonde de 3,45 m. Elle ne paraît pas avoir été recouverte par un appareil maçonné; l'arête du bord est cimentée et arrondie uniformément sur tout le pourtour du bassin. Ce rebord, les parois ou le fond ne présentent d'ouverture de canal d'adduction ou d'évacuation8'.
et p. 371, note 2), peut faire songer à une restitution : Cae- lesti Salinen]i>i aitg(ustae) sac(rum).
Sl Entre le revêtement de pierre et la paroi du rocher (0,08 - 0,10 m) l'intervalle est rempli de sable comprimé d'où a été extrait un tesson de poterie à vernis noir luisant.
82 A une trentaine de mètres à l'est des soutènements romains au-dessus desquels est construit l'hôtel « Reine Didon» (NDLR).
81 Cette arête est à 2,20 m sous le niveau du sol moderne et à 1,10 m environ sous celui du sol romain. Elle est à peine surélevée par rapport au niveau du sol vierge.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 301
Les autres bassins, situés dans la région ouest et nord-ouest du Métroôn, sont répartis suivant deux systèmes d'orientation différents. Le premier de ces deux systèmes semble dépendre d'un ensemble qui s'étendait entre le decwnanus maximus, au sud, et la maison d'Attis, au nord. Deux groupes de citernes, en effet, l'un placé sous le nœud de maçonnerie qui unit le grand mur de soutènement M 2 au bastion, l'autre engagé dans les substructions de la maison d'Attis, paraissent disposés de part et d'autre de l'axe idéal du plan d'un ensemble disparu. Chacun de ces groupes est lui-même subdivisé en deux systèmes de citernes jumelées suivant des axes perpendiculaires les uns aux autres et qui se rapprochent sensiblement des axes de la cadastration julienne.
Aucun de ces bassins ne peut être mesuré dans sa longueur ni dans sa profondeur. Leur largeur est de 0,87 m à 0,90 m. Ils sont construits suivant une même formule : un revêtement de ciment est posé en feuille de 0,002 m sur une épaisseur de ciment bleu, très dur, épais de 0,16 m environ, qui lui-même adhère à un mur composé de petites pierres de tuf de l'Aouina liées à la chaux. Une gaine de 0,30 m enrobe le tout, faite d'une superposition de gros moellons de tuf de l'Aouina liés à l'argile plastique de Sidi- bou-Saïd; la pièce entière est insérée dans le sol vierge.
Le second système de citernes est enseveli sous l'extrémité N-0 de la maison d'Attis, le mur d'amphores et la maison d'Ariadne. En ce dernier point, l'un des bassins a été comblé par les substructions du grand mur de soutènement qui forme également le mur de fond du solarium de la maison d'Ariadne. Il offre des dimensions comparables avec celles du bassin cité en premier lieu, en particulier dans sa largeur qui est de 1,03 m.
La seconde citerne appartenant à ce système doit, à l'usage qui en a été fait par les Romains et à l'éboulement qui l'a très tôt ensevelie après le dernier abandon de Carthage, d'avoir été conservée dans son premier état et absolument vide de toute terre. Elle mesure 5,74 m de longueur sur 1,03 de largeur et 4,20 de profondeur. Ses extrémités sont irrégulièrement arrondies, l'une d'elles s'élargit à 1,74 m, d'un côté seulement, pour recevoir l'air d'un puisard. Elle n'est pas couverte régulièrement : dans sa moitié
tale, cinq dalles butées forment un arc en mitre, puis, vers son milieu, une énorme pierre de taille horizontale déborde les bords du bassin. L'extrémité élargie est recouverte de dalles horizontales superposées dans lesquelles la cheminée du puisard est dégagée. Il se peut, qu'à ce point, la réutilisation romaine ait exhaussé le niveau du regard punique pour qu'il affleure au niveau du pavement de la salle extrême de la maison d'Attis. Un arc en décharge, réservé dans la base du grand mur de soutènement, trahit le souci que les constructeurs romains ont eu, dès l'origine de la colonie, de conserver autant que possible les installations hydrauliques de leurs prédécesseurs84.
Les traces de constructions qui peuvent être attribuées, soit à l'époque punique, soit à la période plus ancienne de l'occupation romaine, sont rares. Il en sera fait état dans un prochain rapport où l'on se propose d'examiner quelques autres vestiges de date ancienne découverts au cours d'une compagne de fouilles exécutées aux abords de l'amphithéâtre, au lieu dit «Ard Joui- lia»85.
84 Nous donnons les dimensions de quelques citernes puniques qu'il nous a été possible de mesurer avec précision :
Position Largeur Longueur Profondeur Métroôn 0,92 ? ? Gaa el Oued 0,93 2,85 2,05 Dermech-Station 0,95 (jeu) 4,73 ?
id. 1,00 3,10 2,60 Gaa el Oued 1,00 2,85 2,05 Douimes (Delattre) 1,02 4,09 ? Saint-Louis (est) 1,03 3,60 3,40 Maison d'Attis 1,03 5,71 3,90 Maison d'Ariadne 1,03 ? ? Saint- Louis (est) 1,05 ? ? au S-0 de Bordj , Djedid 0,91 6,30 4,55 II est à observer que ces chiffres sont généralement un multiple de l'une ou de l'autre des deux coudées égyptiennes (0,525 et 0,45). Les parois et le fond sont uniformément appareillés suivant un procédé constant : un enduit de ciment dur, gris clair, à grains de gravier, épais de 0,04 m, appliqué contre un lit de ciment gris bleu, très fin et légèrement pulvérulent (0,04 à 0,07), lui-même plaqué contre un mur fait de dalles de tuf de l'Aouina, posées en assises irré- gulières et liées à l'argile grasse; un matelas de cette même argile sépare la face externe de ce mur de la paroi de sol naturel dans lequel a été creusée l'alvéole destinée à recevoir la citerne. L'épaisseur totale de ce dispositif varie de 0,60 à 0,80 m.
ss Ch. Saumagne, Vestiges de la colonie de G. Gracchus à Carthage, dans BCTH, 1928-1929, p. 648 à 664.
302 BYRSA I
Conclusions
Les travaux dont nous venons de rendre compte permettent, sinon de restituer l'aspect architectural des édifices étages sur le flanc oriental de la colline de Saint-Louis, du moins de fixer la distribution topographique et même l'identité de quelques-uns d'entre ceux qui furent érigés sous l'Empire.
De l'époque punique, nous n'avons pas reconnu de traces monumentales. Il est certain que des tombes spacieuses ont été creusées dans les profondeurs du sol vierge, et qu'à l'une d'elles, au moins, on accédait par un long couloir incliné, coupé de gradins. Il semble, en outre, que ces sépulcres aient été vidés de leur contenu par les Carthaginois eux-mêmes, puis comblés et nivelés, et que l'application d'un large plan d'ensemble soit attesté par la régularité d'un système de citernes en forme de baignoires, parallèles ou perpendiculaires et équi- distantes entre elles. On peut admettre encore que vers l'angle N-E de la colline un édicule au pied d'un mur (fig. 5), un fragment de tarif des sacrifices et deux chapiteaux doriques, en grès couvert de stuc et ornés de roses en relief sous les angles de l'abaque, sont les vestiges de quelque monument religieux.
De l'époque romaine, les murs et les rues dépendent de l'orientation imposée par la Lex Coloniae d'Octave. Si l'épaisseur des strates intactes, accumulées ailleurs par le ruissellement et l'érosion au cours d'un siècle d'abandon, est ici réduite à un mètre environ, c'est que les fouilles n'ont attaqué qu'un rebord de la colline livré à la denudation et non à l'ensevelissement. Mais il n'a rien été découvert qui trahisse une occupation ou une installation intermédiaires, soit contemporaine de la colonie sempronienne soit antérieure à la déduction octavienne.
Celle-ci, par contre, a marqué le sol d'une empreinte définitive. C'est à elle, en effet, qu'on doit faire remonter la date de l'aménagement initial de la colline de part et d'autre des grands axes déterminés par les cardo et decumanus maximi et par le lotissement des insulae.
Les ruines puniques qui couvraient le sommet de Byrsa furent d'abord vidées de tous les matériaux susceptibles d'être utilisés dans de nouvelles constructions; les déblais furent aplanis,
nivelés et rejetés sur les bords du mamelon qui affecta ainsi la forme d'un vaste plateau quadrilatère. Une ceinture de murailles de soutènement encadra l'esplanade supérieure; à l'ouest de vastes citernes, ménagées en contre-bas, la soutinrent et, par le développement considérable de leur extrados, en étendirent sensiblement la superficie; au nord, au sud, à l'est, de longs épaulements en blocage la délimitèrent, tantôt simples, mais contrefortés régulièrement (fouilles récentes d'A. L. Delattre, du côté qui regarde le nord), tantôt droites et nues, mais doubles, (vers le Métroôn) ou bien renforcées d'absidio- les (vers le sud) ou d'absides (péribole de Beulé), ou bien, enfin, consolidées par des massifs d'amphores. Aux points où le plan de la colonie prévoyait le parcours d'une rue, les murs livraient passage à des gradins ou à des rampes par où l'on accédait au palier supérieur.
Dans le cadre des lots déterminés par le réseau géométrique du plan d'aménagement et de voirie initial, l'initiative privée et la munificence municipale insérèrent des maisons, des temples, des édifices publics, toujours uniformément orientés.
Du haut de la place qui, du sommet de la colline dominait la ville et le golfe de Carthage, un contemporain de la jeunesse de saint Augustin, cet Alype, par exemple, «qui avait coutume de déambuler vers midi, seul, avec ses tablettes et son stylet» pouvait embrasser dans son ensemble le spectacle bien ordonné qu'offrait Carthage valde gloriosissima. . . in directione et piate antm aequalibus lineis currens.
A ses pieds s'ouvrait, par quelques degrés de pierre rouge, le grand decumanus piquant droit vers la mer, en pente douce ou bien en longs paliers reliés par des gradins. Du côté du nord, soulevée par une terrasse que soutenaient d'épaisses murailles et des massifs d'amphores, se dressait la grâce corinthienne d'un petit sanctuaire privé dédié à la Gens Augusta; un des plus anciens propiétaires du sol, P. Perelius Hedulus, l'avait élevé à ses frais; gravé sur une large dalle de marbre blanc, un texte magnifique attestait encore, après quatre siècles, que cette onéreuse initiative avait été originale : «primus pecunia sua fecit».
Mais en proclamant que lui, prêtre municipal, avait bâti «solo privato» et en marquant qu'il détenait, dès les débuts de l'installation romaine,
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 303
un lot colonial, il prouvait, mieux que par les tria nomina, que sa romanité lui permettait d'exercer la plénitude du droit de propriété au cœur même d'une ville purement quiritaire. Aussi, lorsqu'il avait édifié sa maison auprès du sanctuaire et au-dessus de huit vastes réservoirs, par lesquels il manifestait son loyalisme et sa prévoyance, avait-il marqué à son nom les tuiles de son toit, autant peut-être pour affirmer son dominium que pour satisfaire aux prescriptions d'une loi municipale.
Si, traversant le jardin qu'entourait la villa de Perelius, le spectateur s'avançait jusqu'au bord de la terrasse, il pouvait plonger son regard dans la cour intérieure de cette maison dont le propriétaire tirait orgueil de posséder la belle mosaïque d'Ariadne, ainsi que dans le cavaedium d'une vieille villa conçue dans le goût des premiers temps de la colonie et où étaient peints à profusion les symboles d'un culte phrygien.
A l'ouest, un édifice de grandes proportions élevait une colonnade de granit gris au-dessus d'une esplanade qui surplombait la place et que soutenaient de hautes et vastes absides ouvertes aux oisifs comme autant d'exèdres où ils trouvaient le repos, l'ombre et l'abri. Puis, le promeneur atteignait vers le sud une terrasse contre- fortée de murs puissants et d'amphores entassées; projetée en promontoire vers l'orient, elle découvrait aux regards le quartier des ports.
A ses pieds, sur la gauche, par delà le grand decumanus, il pouvait admirer ce que le temple de la Mère des Dieux devait d'embellissements aux restaurations qu'avait ordonnées et dirigées le zèle encore païen d'un récent proconsul. Plus près de lui, jusqu'à l'aplomb du grand mur, une petite église protégeait une crypte où le piété chrétienne vénérait l'image de quelque ancien confesseur. Vers le sud, enfin, s'élargissait la cour dallée d'un spacieux édifice.
Et lorsqu'il admirait le dessin régulier de ces rues, interminablement droites et toutes recroisées à angle droit, peut-être vouait-il quelque pensée de gratitude à ce « gouvernement très florissant des Seigneurs Empereurs», à la faveur duquel une édilité entreprenante, après avoir de toutes parts sillonné le sous-sol de la ville, pour en drainer les souillures vers la mer, d'un réseau d'égouts long de près de cent cinquante mille pieds, l'avait partout revêtu de dalles neuves. Peut-être encore ne pouvait-il se soustraire à
l'orgueil de se compter parmi les «viri Carthagi- nienses, à tout jamais chefs de l'Afrique, vetustate nobiles novitate felices»*6.
Inventaire succinct des objets et fragments87
Les découvertes d'objets ont été peu abondantes. Les tessons de poterie à vernis noir, les débris de vases, plats ou aiguières de petites dimensions, les fragments de lampes à deux ou trois becs, n'ont offert d'intérêt que dans la mesure où ils ont contribué à caractériser les couches d'ensevelissement et à dater les vestiges monumentaux ou les rares pièces intéressantes.
Parmi celles-ci nous choisirons un four à pain ou «tabouna», de nombreux fragments de réchauds, une tête d'adolescent sculptée en ronde bosse dans le bois, un unguentarium en plomb, quelques fragments de lampes romaines à sujet.
1) «Tabouna»**.
Fragments découverts dans les terres extraites des deux tombeaux puniques (T 1 et T2)89.
Il s'agit d'un four composé de trois segments d'ogive formant un cône de révolution tronqué à son sommet. L'ouverture supérieure est cerclée
86 Tertullien, De Pallio, 1. *87 Quelques pages de cet inventaire sont rayés d'une trait
oblique dans l'exemplaire du texte de Ch. Saumagne que nous avons utilisé. L'auteur semble donc avoir eu l'intention de revoir cette partie ou d'en éliminer certains commentaires. Nous ne l'avons donc primitivement pas inclu dans ce Byrsa I. L'intérêt que semblent présenter les objets puniques décrits, en fonction de ce quartier, a finalement incité à le joindre à cette publication.
88 C'est ainsi qu'est désigné ce type de four encore utilisé dans les campagnes tunisiennes pour la cuisson de galettes. Celles-ci sont enfournées par l'ouverture supérieure et plaquées contre la paroi. (Représentation de ce four dans une figurine de terre cuite : cf. M. Fantar, Carthage, la prestigieuse cité d'Elissa, Tunis 1969, p. 291.
"" Au sujet de ces tombes cf. BCTH, 1924, p. 185 et suiv. La tombe (T 2) a été rendue impraticable par sa profondeur et l'extrême fragilité de sa structure. S'il s'agit bien toutefois d'un tombeau. Le puits qui, au début de la fouille, paraissait composer la chambre funéraire elle-même, a été vidé jusqu'à une profondeur de 18 m. La nature de ses parois (sable friable et fluide) et les conditions dans lesquelles la fouille devait être conduite (par un couloir coudé de 20 m de long creusé dans une épaisseur de 8 m de déblais) ont interdit de poursuivre ce travail périlleux.
304 BYRSA I
d'un épais bourrelet d'argile dont le dessus est festonné par une série d'empreintes profondément imprimées au pouce. Les flancs externes des segments du cône sont semés d'encoches, régulièrement disposées suivant les cercles de révolution, exécutées d'une pression du pouce conduite de haut en bas de manière à former des aspérités. Les angles inférieurs de chacun des segments sont rognés par des ouvertures en quart de cercle qui, par la juxtaposition des trois segments, ménagent, à la base du cône, trois petites portes d'aération. Au-dessus du bourrelet supérieur, sur le bord de chacun des segments, des traits au couteau, droits ou terminés en pal- mettes, indiquent les points de coïncidence suivant lesquels l'adhérence des éléments peut être réalisée parfaitement.
Il est très probable que les aspérités étaient destinées à retenir le glissement de la terre appliquée contre le four.
Dimensions: haut. 0,75m; diam. à la partie inférieure 0,94 m; diam. de l'orifice supérieur 0,67 m; larg. des portes 0,15 m, haut. 0,21 et 0,18 m.
P. Gauckler signale un tesson de ce genre découvert dans les fours à potier de Dermech- Douimes90. Ces pièces peuvent être datées des derniers temps de la ville punique, période à laquelle sont attribués ces ateliers de poterie.
2) Fragments de réchauds.
Découverts dans le même gisement que les fragments de «tabouna».
Ce sont des fragments de vases hémisphériques, à paroi épaisse, dont le bord supérieur, en trois ou quatre points équidistants entre eux, projette, vers le centre du plan circulaire, des becs proéminents destinés à supporter une marmite.
Ces becs sont parfois formés d'une sorte de pincement de l'argile, sur quelques fragments ils affectent la forme d'une tête dont la barbe, très en saillie, servait de support91.
3) Applique de bois figurant une tête d'adolescent.
Découverte à l'angle du decwnanus maximus et du cardo V est, sous le niveau d'occupation romaine, dans une couche de destruction et d'incendie.
Cette petite applique, vestige du décor d'un meuble, a été décrite par L. Poinssot et R. Lan- tier92.
4) Unguentarium en plomb.
Une alvéole cylindrique (diam. 2 cm, prof. 2,5 cm) est creusée dans une masse de plomb tronconique (diam. sup. 3,3 cm, diam. inf. 4 cm). La partie inférieure de cette ampoule est convexe, creusée d'un orifice profond de 1,8 cm, d'un diamètre de 0,6 cm, destiné à recevoir la pointe d'un support. Cinq encoches, équidistan- tes entre elles, profondes de 0,15 cm, sont disposées en cercle autour de ce centre. Il semble que le support ait comporté une tige axiale autour de laquelle rayonnaient cinq tiges recourbées vers le haut, composant un système à la fois léger et solide sur lequel était posé X unguentarium. Une coiffe était faite d'une feuille de plomb emboutie^.
Dans l'alvéole subsistait une pastille résineuse. A l'examen elle a provoqué l'observation suivante : «résine ou baume très oxydé; le dégagement d'odeur agréable lors du chauffage de ce résidu indiquerait la présence d'acide cinnami- que et donnerait à penser que le produit primitif était constitué par du styrax calamitus qui devait être utilisé, comme encore actuellement, mélangé d'huile d'olive».
5) Poids en plomb.
Deux poids trouvés dans les couches profondes du sous-sol affectent la forme de pyramides tronquées. La couche de carbonate de plomb qui les oxyde est très faible, quelque arêtes paraissent avoir été rognées à la lime. Leurs
*' P. Gauckler, Nécropoles puniques, lcre partie, Paris 1915, pi. CCXXIV.
1)1 Le Musée de Carthage conserve une vingtaine de fragments du type le plus évolué (tête barbue) : Catalogue du Musée Lavigerie, I, Paris 1900, p. 120-121. Ils ont été trouvés en grand nombre à Délos : cf. F. Mayence, dans BCH, Paris 1905, p. 396-397.
92 L. Poinssot et R. Lantier, Tête d'applique en bois trouvée à Carthage, CRAI, 1927, p. 206 à 210.
93 Un unguentarium tout à fait comparable a celui-ci a été découvert dans une tombe punique par A.L. Delattre. On peut en rapprocher aussi les boites de forme cylindrique décrites par A. Merlin et R. Lantier dans Cat. du Musée Alaoui, suppl. 2, Paris 19 — , p. 157 (Carthage, nécropole punique de Dar el Morali, fouilles de 1917-1918).
ETUDES ET NOTES COMPLExMENTAIRES 305
dimensions et leurs poids respectifs sont, pour l'un, à la base, 6,2 χ 6,5 cm, au sommet, 5,1x5,3 cm, haut. 4,1, poids 1,520 kg; pour l'autre, à la base, 5,1x5,1 cm, au sommet, 4,25 x 4,25 cm, haut. 3,6 cm, poids 0,864 kg.
Le premier porte à sa base deux estampilles, le second, une seule. Le poinçon figure une rose en relief, du type rhodien, (diam. 0,65 cm) faite de petits lobes en ellipse rayonnant autour d'un bouton central (9 lobes sur le premier, 8 sur le second). Ces poids sont, à notre connaissance, les plus lourds qui aient été trouvés à Carthage. Il ne parait pas douteux qu'ils doivent être attribués à la période punique94.
6) Décors estampés sur fonds de plats à engobe rouge clair.
Sur un fragment concave, à l'intérieur d'un cercle, une croix pattée entre deux colombes.
A l'intérieur d'un cercle, un homme imberbe ou un enfant, la tête de face, marche vers sa droite à grande enjambée; il tient sur son épaule droite une outre qui déborde sur son dos et lève le bras droit, la main ouverte.
A l'intérieur d'un cercle, homme debout, de face, vêtu d'une tunique tombant au genou et d'un manteau court rejeté sur l'épaule gauche; il s'appuie, de sa main droite relevée, sur une
lance et parait poser son poing gauche sur sa hanche. De chaque côté du personnage, un poisson.
7) Fragments de lampes.
Parmi les débris de lampes, généralement insignifiants et singulièrement peu nombreux nous signalerons deux fragments de décor appartenant au type dit «chrétien».
Le buste d'un personnage barbu, de profil, est juché au sommet d'une colonnette. La tête nue, à la chevelure épaisse, est ceinte d'une bandelette. Le buste domine de toute sa hauteur les personnages de la scène; ceux-ci sont au nombre de trois dont l'un à droite, un autre à gauche du buste; tous sont de face, la tête entourée d'une sorte de capuchon rigide; le personnage de droite tend une main vers le frêle piédestal9\
Un faune est juché au haut d'un tronc d'arbre sans branches ni feuilles; il est assis, tourné vers sa gauche et embouche une flûte. Sa silhouette se détache sur un fonds constitué par la représentation schématique d'un édicule à fronton triangulaire. Un petit personnage suspendu au sommet du tronc d'arbre semble faire effort pour se hisser96. Au revers, estampille représentant un animal marchant vers la droite.
"4 Une enumeration de poids semblables dans Cat. du Musée Lavigerie I, p. 193-199 et pi. XXVIII, 6. On peut aussi noter que le deuxième de ces poids représente peut-être la mine attique (0,864 pour 0,873).
^ II s'agit très probablement de la scène représentant Nabuchodonosor forçant les trois Hébreux à adorer son image, cf. A. Ennabli, Lampes chrétiennes de Tunisie, Paris 1976, p. 45 n" 27 et pi. I (NDLR).
"h Cf. A. Ennabli, op. cit., p. 52-53 n° 76 et suiv. et pi. III (NDLR).
α π aaaaaauana απα □ □ α
αααααηηαππαππηππαα
%^^^^^
Fig. 1 - Ensemble des vestiges découverts sur le flanc est de Byrsa. Le plan relevé par Ch. Saumagne a été complété par celui des absides effectué après les fouilles de G. G. Lapeyre.
308 BYRSA I
Plan
i_
Coupe
S
*//////' ΙΠΙΙΙΙ1* mil
5m
Fig. 3 - Plan et coupe N-S du mur de soutènement coupant le cardo V devant la maison d'Attis. Edicule dans lequel ont été découverts les fragments de deux statues. (Mise au net Ph. de Carbonnières, d'après le dessin de Ch. Saumagne).
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 309
Cardo IV E
e 30
Cardo V E
Fig. 4 - Edifice situé entre les cardines IV et V est, au sud du decwnanus maximiis. (Mise au net Ph. de Carbonnières, d'après le dessin de Ch. Saumagne).
310 BYRSA I
Edicule punique
Fig. 5 - Édicule punique découvert sous l'amoncellement d'amphores, en arrière du mur de soutènement et de la maison d'Ariadne. (Mise au net Ph. de Carbonnières
d'après le dessin de Ch. Saumagne).
UN BRÛLE-PARFUMS TROUVÉ À CARTHAGE
par JEAN-MICHEL CARRIÉ
Notre participation aux travaux de la Mission archéologique française à Carthage nous a conduit à explorer un secteur du flanc sud de la colline de Byrsa, et en particulier à préciser la succession des aménagements pré-romains et romains du site. L'archéologie a cessé d'avouer - sinon de poursuivre - comme but la recherche de l'objet, et la richesse du matériel retrouvé dès la première campagne (juin-juillet 1974) n'a pas fait dévier notre attention des problèmes historiques généraux auxquels nous confrontait l'exploration du terrain. Il ne nous a pas semblé inutile, cependant, en marge de la problématique du site, mais en étroite relation avec elle, de consacrer une étude quelque peu détaillée à un individu trouvé lors des fouilles de 19741.
Cet objet n'est déjà plus totalement inédit, puisqu'une photographie en a été donnée avant la publication du présent rapport préliminaire2. Au demeurant, les questions qu'il soulève dépassent le cadre de tout rapport de fouilles.
1 En cours d'élaboration, cette étude a bénéficié des suggestions de Marie-Odile Jentel (Centre de Documentation sur les Céramiques hellénistiques à relief, Université Laval, Québec) et de Giovanni Tore (Université de Cagliari). Filippo Coarelli a bien voulu lire un premier manuscrit, qui a bénéficié de ses remarques et suggestions. Qu'ils trouvent tous ici l'expression de mon amicale gratitude.
2 S. Lancel, Nouvelles fouilles de la mission archéologique française à Carthage sur la colline de Byrsa : Campagnes de 1974 et 1975, dans CRAI 1976, p. 69 et fig. 6. Présentation sommaire de l'objet dans Ant. Afr. 11, 1977 par J.-M. Carrié, p. 91 et fig. 19.
Circonstances de la découverte et contexte archeologique
II s'agit d'un brûle-parfums en terre cuite, d'un type dénué de parallèle exact (fig. 1, 2, 3, 4). Les circonstances mêmes de sa découverte, en deux épisodes que sépare un intervalle de quelque vingt années, ne laissent pas d'être singulières. Il est apparu en effet, dès le premier examen de l'objet, que lui appartenaient deux fragments déjà trouvés par le P. Ferron dans ses fouilles de Byrsa. Ces deux fragments figuraient dans la publication de MM. Ferron et Pinard3, et portaient de la main de Jean Deneauve leur numéro d'inventaire dans les collections du Musée de Carthage4. La netteté des cassures - pourtant aussi anciennes que l'ensevelissement même - permit un remontage satisfaisant au point d'en rendre les sutures quasi imperceptibles.
Le P. Ferron décrivait en ces termes les deux fragments trouvés par lui5 :
«Fragments de bas-reliefs en terre cuite. Les deux pièces proviennent d'un même moule et figurent une scène de combat, limitée par deux colonnettes ioniques... Ces débris ornaient peut-être une arida ... ».
3 Cah. Byrsa 5, 1955, n° 158-159, p. 77 et pi. LXXXIV. 4 Ibid., n° 158 = Inventaire n° 55-1-46-2.
n° 159 = Inventaire n° 55-1-46-1. Je remercie M. Abdelmajid Ennabli, Conservateur en chef du Musée et du site de Carthage, d'avoir autorisé l'insertion de ces deux fragments dans le remontage de l'objet.
5 Loc. cit., p. 77.
312 BYRSA I
Fig. 1 - Brûle-parfums de Bvrsa (Cliché A. Chêne, IAM). Fig. 2 - Brûle-parfums de Bvrsa : plaque publiée par le P. Ferron (Cliché A. Chéné, IAM).
.*2S#
Fig. 3 - Brûle-parfums de Bvrsa (Cliché A. Chéné, IAM). Fig. 4 - Brûle-paifums de Bvrsa (Cliché A. Chéné, IAM).
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 313
Notre propre découverte donne, en un sens, raison à cette hypothèse. Mais au lieu d'une arida du type de celles de Motvé, à laquelle pensait le P. Ferro n <\ c'est une forme tout à fait originale qui est venue déjouer le pronostic.
Les nouveaux fragments du brûle-parfums ont été retrouvés dans le sondage 1 1 du secteur B7 pratiqué au sud du mur à arches dégagé et décrit par le P. Lapeyre8, à la limite ouest des fouilles de MM. Ferron et Pinard. Les nouveaux fragments du brûle-parfums ont cependant été trouvés à deux mètres au delà de la ligne d'arrêt des fouilles précédentes. L'objet était enfoui dans la couche 3 sur la coupe relevée au nord du sondage (cf. supra, fig. 20, p. 118). Il s'agit de l'une des couches, riches en matériel d'époque hellénistique, qui ont coulé après la destruction de la cité punique en 146, mais avant le démantèlement systématique qui fut opéré ensuite, et qui fit effondrer les murs et colonnes subsistant des maisons effondrées1'. La date de 146 constitue donc un terminus aule quern impératif. Le matériel associé, qu'il soit importé ou produit localement, est chronologiquement homogène : il nous situe dans le IIIe siècle et la première moitié du IIe siècle av. n.è..
Forme, technique, matière
Notre brûle-parfums est constitué de pièces moulées ou façonnées séparément, ensuite assemblées à la barbotine. Avant de décrire les divers éléments du décor, nous décomposerons l'ensemble de la façon suivante :
- quatre pieds, en forme de sphinge reposant sur un simple boudin d'argile de section ovale. Un seul de ces pieds est intégralement conservé. Il y a lieu de penser qu'ils étaient tous identiques;
- une base quadrangulaire. Elle résulte de l'assemblage de quatre plaques décorées issues d'un même moule (15,5 cm de longueur χ 5,7 cm
6 Ibid., n. 2. 7 Cf. J.-M. Carrie et N. Sanviti, Le secteur B, dans /1;//.
Afr. 11, art. cité, et stipici, p. 115-122. " G.G. Lapc\rc. Rew Afr., 1934, p. 336-353. C'est le Mur C
de notre rapport de fouilles». 4 Cf. notre commentaire stratigraphique dans Ani Afr. 1 1,
art. cité, p. 79, et ici même, supia, p. 119.
de hauteur), entourées d'une bordure en relief. Aux angles de cette base, et surmontant donc les pieds, sont rapportées des colonnes ioniques, dont les chapiteaux sont visibles sur chacune des faces qu'elles délimitent;
- à l'intérieur du caisson ainsi formé s'adapte une sorte de couvercle, largement percé aux dimensions du manchon qui vient s'y superposer (fig. 5);
Fig. 5 - Brûle-parfums de B>rsa \u de dessous (Cliché J.-M. Carrié).
- ce manchon forme une collerette de 9 cm de hauteur, extérieurement creusée de 14 godrons séparés par autant de côtes sillonnées d'un filet médian. La base de la collerette vient reposer directement sur le caisson carré sans qu'un socle circulaire en assure la transition. Simplement, la base des godrons comme celle des arêtes intercalaires s'épaissit en une forte semelle. L'ensemble crée un jeu violent d'ombres et de lumières contrastées;
- le sommet de la collerette s'évase, et son bord retombe en un listel décoré d'une frise d'oves surmontée d'incisions obliques (profil discernable sur le côté droit de la fig. 1). Un fragment isolé de cette partie (2,5 x 3,5 cm) a été retrouvé en outre; il ne se raccorde pas aux parties remontées de l'objet;
- l'embouchure du tuyau constitue un anneau aplati, rapporté sur la collerette cannelée, puis vraisemblablement tourné une fois fixé
314 BYRSA I
à l'ensemble. Elle s'implante en arrière du listel, ménageant comme une gorge concentrique au revers des oves. La paroi marque d'abord un léger pincement, puis se prolonge droite, en s'évasant très légèrement. Le sommet est décoré d'incisions verticales.
La forme est, dans son ensemble, assez ramassée. La largeur totale reconstituée (pieds compris) atteint 19,4 cm pour une hauteur conservée de 21,5 cm. Le manchon godronné mesure 9 cm en hauteur, pour un diamètre de 13,5 cm (sans compter le listel). Les pieds, relativement hauts (5,4 cm), contribuent à alléger la silhouette de ce brûle-parfums, qui se complétait certainement d'un couvercle dont nous restituerons plus loin la forme.
Le fragment 159 des Fouilles Ferron-Pinard est visible, après remontage, sur notre fig. 2. Il demeure le plus complet des quatre reliefs, et offre en particulier la colonne ionique la mieux conservée. Le fragment 158 est venu, quant à lui, se raccorder à la face visible sur notre fig. 3.
Pour compléter cette présentation technique, donnons quelques précisions sur la terre utilisée. C'est une argile à léger grain, dont la couleur varie du rose vif (au cœur de la pâte) au vert pâle. La surface est blanc verdâtre (n° 330 du Code Universel des Couleurs de E. Séguy), sans grésage aucun. C'est cette même terre qu'on trouve utilisée à Carthage pour des objets assez communs, mais de grandes dimensions : certaines amphores puniques, des vasques de baignoires, et de grands plats ronds à large marli horizontal10. L'argile fournit donc un argument à notre avis définitif en faveur d'une fabrication locale de ce brûle-parfums.
Typologie formelle L'Egypte, Tarente, Carthage
Arrêtons-nous d'abord à ce point de la description, réservant pour plus tard l'étude du décor figuré. Et considérons le type auquel se rattache, par sa forme, le brûle-parfums de Byrsa. La classification proposée par Wigand, au début de ce siècle", demanderait naturellement
à être reprise, en tenant compte du matériel découvert depuis. Nous pouvons cependant y recourir comme point de départ. Notre exemplaire y entrerait dans la catégorie des «Thymia- teria von kurzer, gedrungener Form aus der hellenistischen und der Kaiserzeit»: «brûle-parfums de forme courte et ramassée, d'époque hellénistique et impériale».
Fig. 6 - Brûle-parfums de Toukh el Garmous (d'après K. Wigand, Thymiateria, Tafel V, n° 4-5).
10 Cah. Byrsa 9, n° 435 et pi. LXXV. 11 K. Wigand, Thymiateria, dans Bonn. Jahrb. 1912, p. 1-97
et pi. I-VI. Cette étude considère essentiellement la
tion hellénistique sous l'angle de l'invention des modèles qui furent ensuite diffusés à l'époque romaine. Notre recherche nous a convaincu au contraire de la nécessité de remonter à partir des productions hellénistiques jusqu'à leurs antécédents ou archétypes, qu'ils soient grecs classiques ou qu'ils soient non-helléniques.
ETUDES ET KOTES COMPLEMENTAIRES 315
§ééaììììi
Fig. 7 - Brûle-parfums de Toukh el Garmous (d'après G. Maspéro, Le Musée égyptien . . . , t. 2, Le Caire, 1907, planche XXIV). Au sein de cette catégorie, la comparaison s'impose entre notre exemplaire et deux tliytnia- tcria d'argent trouvés dans un trésor de temple, à Toukh el Garmous, forteresse de la frontière orientale de l'Egypte12. Leur forme est assez semblable, quoiqu'ils diffèrent entre eux par quelques détails (fig. 6 et 7). La base est constituée d'un socle triangulaire, rel
ativement peu épais, supporté par trois pieds rapportés appliqués à chaque angle. Ces pieds ont la forme de sphinges portées par une patte de fauve (fig. 6) ou un sabot de cheval (fig. 7). Le support du foyer est un manchon cannelé fortement élargi à la base, et surmonté d'une frise d'oves. Le fover constitue, sur
12 C.C. Edgar dans G. Maspéro, Le Musée égyptien . ... 2, Le Caire, 1907, p. 57-62 et pi. XXII-XXVIII. Cf également K. Wigand, art. cité, p. 72-73, qui donne seul (pi. V, nos 4-5) une photographie du deuxième autel (notre Fig. 6).
l'un des deux exemplaires (fig. 6), un dispositif assez proche de celui qui pourrait être restitué sur le thy- miatérion de Byrsa : un récipient en forme de koüion, selon la description d'Edgar, à parois droites, entouré vers le premier tiers de sa hauteur par une sorte de marli, anneau circulaire débordant largement du corps. Sur l'autre exemplaire, cet anneau constitue le rebord plat d'une coupe à parois épaisses formant foyer.
Les deux exemplaires sont coiffés d'un couvercle en dôme surélevé. Le premier (fig. 6) est plein, décoré de deux registres superposés de lions ailés et de têtes de Bès'\ la partie supérieure seule étant percée de trous d'évent. L'autre couvercle est ajouré, le décor (fleurs de lotus, palmettes stylisées, rangées d'anneaux) ménageant lui-même les ouvertures. Il
" Ou de Men? La réponse dépend de l'origine géographique qu'on assigne à l'objet : cf. infra, p. 317.
316 BYRSA I
était peut-être surmonté du eoq qui le couronne sur le cliché14.
Les monnaies qui aceompagnaient ces objets permettent de dater le trésor de Toukh el Gar- mous des règnes de Ptolémée Soler et Ptolémée Philadelphie.
TARENTE
La forme de ces thymiateria, abstraction faite des pieds, se trouve dans l'ensemble reproduite par le célèbre brûle-parfums de Tarente IS. Cet objet en argent partiellement doré faisait lui- même partie d'un trésor d'argenterie (fig. 8).
Il présente lui aussi un fût cannelé, mais reposant sur une base circulaire. Le foyer forme comme une capaci à parois droites, se raccordant au support par l'intermédiaire d'un plateau débordant cerné d'un listel décoré d'oves. Un couvercle vient s'ajuster au foyer, en dôme, décoré de plumetis; il était originellement muni d'un bouton central. Des anses mobiles facilitaient le transport de l'objet.
Outre la sveltesse de l'ensemble, le brûle-parfums de Tarente se distingue de ceux de Toukh el Garmous essentiellement par l'absence de pieds. On remarquera cependant qu'une pyxis en argent appartenant au même trésor présentait trois pieds en forme de sphinges montées sur des griffes16.
La datation proposée par M. Wuilleumier pour le dépôt de ce trésor - antérieur à 272 av. n. è. - a été plusieurs fois contestée. Dans un ouvrage dont la publication est imminente, F. Coarelli reprend la discussion17. Du nouvel
14 C.C. Edgar, loc. cit., p. 60 : «On plate XXIV the small cock is placed conjecturally on the top of the lid. It was found separately but has evidently been attached to some article, and this is the only place which it seems to fit».
15 P. Wuilleumier, Le Trésor de Tenente (Collection Edmond de Rothschild), Paris, 1930, et en particulier p. 48-55 et pi. VI; Tarente des origines à la conquête romaine, Paris, 1939, p. 353-356 et pi. XXII, 2. La pièce est également reproduite dans l'EAA, s.v. Toreutica, p. 936, 111. 1054.
16 P. Wuilleumier, Le Trésor. . . , p. 9-33 et pi. I-II. 17 F. Coarelli, Toreutica, dans Storia e Civiltà dei Greci,
\ol. 5, La cultin a ellenistica, t. 10, Le arti figurative (à paraître), p. 258-275. Je remercie F. Coarelli de m 'avoir donne à lire en épreuves le texte dont j'ai extrait les citations ci-dessus {ibid., p. 264-265).
Fig. 8 - Brûle-parfums de Tarente (d'après P. Wuilleumier, Tarente ..., planche XXII, 2).
examen des monnaies accompagnant le lot d'argenterie, effectué par N. Parise, il ressort que certaines d'entre elles «semblent pouvoir descendre jusqu'aux années centrales du IIIe siècle». F. Coarelli rejette d'autre part la datation insoutenable du Ier siècle av.n.è. qu'à proposée H. Küthmann18. En avançant l'hypothèse d'un
18 H. Küthmann, Untersuchungen zur Toreutik des zweiten u. eisten Jalu widens ν. Chr., Diss. Basel 1959, p. 23 s.; datation tardive «più attendibile» selon E. Simon, auteur de la notice Tot etilica, clans EAA VII, p. 947. Encore faudrait-il que la constitution de ce «trésor» ne soit pas l'œuvre d'un antiquaire moderne : idée originellement exprimée par Orsi, reprise par E. Lepore dans Atti X" Com: Studi Magna Giecia (Taranto, 4-11 ou. 1970), Naples, 1971, p. 197.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 317
ensevelissement en 209, lors de la conquête romaine, il rejoint la position exprimée par L. Byvanck1".
Si l'ensemble des auteurs s'accordent à rapprocher entre eux ces divers matériels, une vive controverse s'est en revanche élevée sur l'origine du type, et en particulier sur la part qui reviendrait à la toreutique alexandrine. La question est devenue fort embrouillée. Edgar n'a pas un seul instant douté que les ihymiateria de Toukh el Garmous ne fussent égyptiens20, et a accrédité l'idée d'une créativité alexandrine spécialement active dans ce domaine. Dans un esprit semblable, Theodor Schreiber a cru pouvoir définir trois types spécifiquement égyptiens de brûle-parfums : un type à corps grossièrement biconique, étranglé par le milieu, à socle plat ou sur pieds, cannelé ou non; un type en forme de pilier, à sommet dentelé; et un type intermédiaire, à foyer crénelé porté par un fût monté sur socle21. Un exemplaire de ce dernier type (fig. 9), conservé au Musée du Caire, a été décrit par Perdrizet22. La partie supérieure présente des caractères égyptiens fortement marqués (les uraei en particulier), qui contrastent avec l'hellénisation des pieds (en forme de Silènes ailés), plus marquée que sur les pieds des exemplaires de Toukh el Garmous. Pour expliquer ces Silènes ailés, Perdrizet a recours à une théorie trop ingénieuse : les Silènes feraient référence à Dionysos, dont les ailes expriment symboliquement la marche rapide et victorieuse. Il est plus simple de penser que les Silènes sont ici une variation sur un thème tant décoratif que fonctionnel (les ailes raccordant les pieds au socle) pour lequel le sphinx était plus naturellement adapté.
|y L. Byvanck-Quarles van Ufford dans Babesch 33, 1958, p. 49 («vers le milieu de la seconde moitié du IIIe siècle av. J.-C»), et p. 52.
20 Loc. cit., p. 62 : «So we may conclude that . . . perhaps all and certainly most of the objects in the Toukh treasure are the work of early Ptolemaic goldsmiths and siher- smiths, native and immigrant».
21 Th. Scheiber, Die alexamh wische Toieiitik, dans Abhamll. Konigl. Sachs. Gesells. Wiss. (Phil.-hist. Classe), XIV, 5, 1894, p. 444-446 = éd. séparée, p. 174-176.
:: = Caire n° 27.813; cf. P. Perdri/et, Bionzes giecs d'Egypte ile la Collection Foiiqiiet, Paris, 1911, p. 18-19 et pi. XL.
Si les pieds sphingiformes étaient typiques de ces thymiaieria égyptiens, faut-il voir là le modèle dont se serait inspiré l'exemplaire de Byrsa? L'argument se détruit de lui-même, parce que ces sphinx sont en fait des sphinges. Féminin, le monstre ne suggère plus l'Egypte, mais l'Asie Antérieure. Il apparaît pourtant sur l'un des brûle-parfums de Toukh el Garmous. Mais rien, justement, ne prouve que ces derniers soient égyptiens. Wigand en a douté, pour d'autres raisons, mais tout aussi convaincantes, qui orientent la recherche vers la Syrie2* : ce qui ne l'a pas empêché, assez contradicloirement, de rattacher le type de Toukh el Garmous - ainsi que la série punique dont nous allons bientôt parler - à la forme égyptienne typique, à fût étranglé24.
Fig. 9 - Brûle-parfums du Musée du Caire (d'après P. Perdrizet, Bionzes giecs d'Egypte de la Collection Fonquet, Paris,
1911, pi. XL).
2ί Κ. Wigand, op. cit., p. 78-79; au\ critères st\listiques s'ajoute la présence dans le même trésor de monnaies d'origine phénicienne.
24 Cette forme serait directement liée au culte d'Isis. Les aspects archéologiques de la religion isiaque exigeraient de nouvelles études. Ils demeurent à l'écart du propos de F. Dunand, Le culte d'I bis dans le bassin υι tentai de la Mèdi-
318 BYRSA I
Quoi qu'il en soit, ces conclusions nous dispensent de rechercher dans le brûle-parfums de Tarente la part de l'influence alexandrine25, et plus encore de le verser au dossier tant controversé des relations entre Tarente et Alexandrie26.
Carthage Ces rapprochements avec des exemplaires
orientaux ou tarentins ne nous fournissent pas encore des parallèles exacts pour notre thymiate- rion punique. Ils nous permettent du moins de reconstituer avec quelque vraisemblance les parties manquantes de l'objet. Restituons lui d'abord un couvercle en dôme, percé d'orifices donnant passage à la fumée27; mais aussi un fourneau, s'emboîtant au dessus du support, comme sur le brûle-parfums de Tarente. Cette pièce était probablement mobile : c'était également le cas sur une autre série de thymiateria en terre, par ailleurs tout à fait différente typologi- quement (fig. IO)28.
La silhouette de l'objet, ainsi complétée, ne nous est pas inconnue à Carthage. Nous l'y
terranee, Leyde, 1973, qu'on pourra cependant consulter sur les rites d'encensement (t. I, p. 199-200) et sur la nomenclature des «objets servant aux fumigations» (t. 3, p. 219-220).
25 P. Wuilleumier, Le Trésor . . . , p. 52, n'exclut pas « que Tarente ait emprunté à l'Egypte le type général du vase»; mais il reconnaît surtout des influences de la Grèce propre, originellement développées et transposées dans l'ambiance apulienne. L. Byvanck-Quarles van Ufford, art. cité, p. 49, y retrouve «aussi des détails qui pointent vers l'art de l'Asie Mineure ...»
26 Une mise au point sur ce sujet est esquissée par A. Adriani, La Magna Grecia nel quadro dell'arte ellenistica, dans Atti IX° Conv. Stud. Magna Grecia (Taranto, 5-10 Ott. 1969), Naples, 1970, p. 87-88, où l'on trouvera les principales références bibliographiques. Réagissant contre les excès antérieurs, G.M.A. Richter, Three critical periods in Greek sculpture, p. 33-35, avait déjà ramené à de plus justes proportions la part d'Alexandrie dans la production artistique du IIIe siècle, en particulier dans le domaine de la toreuti- que.
27 On pensera également à certains couvercles de kernoi puniques: P. Cintas, Céramique punique, Paris, 1950, p. 539, fig. 43 = pi. XLVII, n° 63).
28 B. V. Farmakowski, Trouvailles dans l'antique nécropole d'Olbia en 1901 (en russe)), dans IAK 8, 1903, p. 90. L'illustration est tirée de I. D. Marcenko, Nouveaux aperçus sur la céramique hellénistique du Bosphore (en russe), dans Akade- mija Nauk SSSR, Kratkie Soobscenija, 1976, p. 52, fig. 6; l'auteur a omis d'indiquer que cet objet est conservé au Musée de l'Ermitage.
0 6 cm
Fig. 10- Brûle-parfums d'Olbia (d'après I. D. Marcenko, Aka- demica Nauk SSSR, Kratkie Soobscenija, 1976, p. 52, fig. 6).
retrouvons en effet, sur des stèles hellénistiques jusqu'ici mal interprétées, auxquelles désormais notre brûle-parfums restitue leur véritable signification29.
Stèle CIS 2652™ (fig. Ila).
Hauteur 0,33 m; largeur 0,15 m. Musée de Carthage.
29 Pour des raisons de commodité, nous désignerons les stèles par leur référence dans le CIS, seul répertoire photographique complet. Nous utiliserons par ailleurs les abréviations suivantes: Hours-Miédan = M. Hours-Miédan, Les représentations figurées sur les stèles de Carthage, dans Cah. Byrsa I, 1951, p. 15-160; Bisi = A. M. Bisi, Le stele puniche, Rome, 1967; C. Picard = C. Picard, Thèmes hellénistiques sur les stèles de Carthage, dans Ant. Afr. I, 1967, p. 9-30.
30 R. P. Delattre, Musée Lavigerie de Saint-Louis de Carthage I, Paris, 1900, p. 13 et pi. I, fig. 2 = CIS I, 2, 3 et pi. LV = Hours-Miédan, pi. XXXIa. Dans le catalogue de Delattre, la référence réelle de l'illustration (pi. 1,2) devient dans le texte (p. 13) : «planche 1,5».
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 319
Fig. 1 1 - Brûle-parfums sur des stèles de Carthage - a : Stèle CIS 2652 (Cliché J.-M. Carrié); - b : Stèle CIS 2017 (d'après CIS I, 2, 3, pi. XL); - c : Stèle CIS 2150 (d'après CIS I, 2, 3, pi. XLIV).
Stèle en obélisque, à acrotères latéraux. La pointe médiane, originellement décorée d'une rosace, est mutilée. Delattre décrit ainsi le décor représenté sous l'inscription :
«La partie inférieure est occupée par une sorte de ruche portée sur une base évidée qui rappelle les manchons dont il sera question plus loin» (Delattre entend par là les supports associés à de «grands vases», et plus souvent encore au «signe de la bouteille»).
Encore hypothétique chez Delattre, l'interprétation comme ruche a été fréquemment acceptée sans plus de critique, et c'est elle qu'a reprise le C7S31. On a également proposé de voir une offrande présentée sur un socle'2.
" G. G. Lapeyre et A. Pellegrin, Carthage punique, Paris, 1942, pi. IVa; légende d'illustration dans Archéologie Vivante, vol. I, n° 2 (déc. 1968-fév. 1969): Carthage, sa naissance, sa grandeur, p. 145; CIS 1, 2, 4 : «figura in modum alvearis, basi \el altari impositi».
;: Hows-Miédan, p. 58, qui avait cependant pensé à la possibilité d'un thymiatérion: «cette figure est à rapprocher d'un trépied recouvert d'un dôme ajouré et qui devait contenir des charbons (brûle-parfums)»; mais sans exclure pour autant l'identification comme ruche.
Stèle CIS 20I7" (Fig. lib)
Hauteur 0,26 m; largeur 0,17 m. Vienne, Kunsthistorisches Museum.
La notice du CIS décrit ainsi le décor figuré : «altare mola coronatum, capsa et vas». Selon Mme Hours-Miédan, «ce sont probablement des offrandes que nous retrouvons présentées sur un socle assez haut, incurvé sur les côtés et reposant sur de petits pieds ... ; sur l'un d'eux on distingue un ananas analogue à ceux qui se trouvent sur les stèles égyptiennes . . . »34.
Stèle CIS 2150" (fig. lie).
Hauteur 0,36 m; largeur 0,13 m; Paris, Cabinet des Médailles.
Description dans le CIS: «tabula oblationum et vas, cum capsa in medio». Mme Hours-Miédan: «II est possible que nous ayons là des coffrets analogues
" = Hours-Miédan, pi. XXXIb. " Ibid., p. 58. " Ibid., pi. XXXIc.
320 BYRSA I
par la matière à ces corbeilles tressées de l'époque grecque nommées «cista mistica»16.
S'il pouvait encore y avoir un doute sur la nature des objets ainsi représentés, la découverte de Byrsa est de nature à le dissiper définitivement. Ils constituent une série homogène, typologiquement plus proche de l'exemplaire de Byrsa que tout autre des thymiateria auxquels nous avons fait jusqu'ici référence. La seule différence - mais elle demeure notable - réside dans la base du support, qui sur les stèles reste proche 'du type de Toukh el Garmous. Une évolution semble pourtant déjà se dessiner. Sur CIS 2150 (fig. Ile), très stylisée, trois pieds sont nettement représentés, ce qui implique une base triangulaire. Le dessin de CIS 2017 (fig. lib), plus réaliste, fait apparaître une base circulaire, simple prolongement du support cannelé, reposant sur des pieds en forme de griffes, rapportés à la manière de ceux de la pyxis de Tarente, et vraisemblablement au nombre de trois. Par contre, sur CIS 2652 (fig. 1 1 a), il semble que le graveur ait voulu, entre les pieds, figurer par un croisillon l'amorce d'un caisson carré. Les pieds sont eux-mêmes en saillie par rapport à la base, comme sur l'exemplaire de Byrsa. Il est tentant d'imaginer une évolution interne à partir de CIS 2150 et 2017, aboutissant au type de Byrsa, dans lequel la base du brûle-parfums, d'élément purement fonctionnel, serait devenue le principal élément décoratif de l'ensemble : évolution dont CIS 2652 nous aurait conservé une étape intermédiaire.
L'hypothèse de Γ« ananas», sur CIS 2017, ne fait pas violence au tracé du dessin. Mais on remarquera que l'association capsa-vasc rituel- brûle-parfums constitue un thème canonique. Nous le retrouvons sur la stèle CIS 2050, mais aussi, pensons-nous, sur CIS 5775 (fig. 12)": iirceiis à tête d'animal, capsa et brûle-parfums candélabre stylisé sous la forme du «caducée» punique38. Les «écailles d'ananas», sur CIS 2017,
16 Ibid., p. 58. Sur cette stèle, le vase nous apparaît plutôt corne un lécythe lagynoïde que comme «une puisette à fond arrondi» (p. 59).
17 = G. Ch. Picard, Cat. Alaoui N. S. (Coll. puniques) I, Cb701.
^ Une telle interprétation, qui nous paraît du moins s'imposer dans le cas de CIS 5775, a été plus systématique-
sont en fait des ouvertures en chevrons comparables à celles du couvercle du deuxième brûle- parfums de Toukh el Garmous (fig. 7), avec lequel la ressemblance est des plus complètes, puisque la «queue de l'ananas» reproduit le bouton sommital. Par contre des croisillons représentent, sur CIS 2150 et 2652, un décor d'écaillés identique à celui du brûle-parfums de Tarenle (fig. 8).
Wigand, apparemment peu lu par les archéologues puniques, avait correctement interprété
Fig. 12 - Vase rituel, capsa et candélabre-caducée (d'après CIS 5775).
ment a\ancee par G. Garbini, / Fenici hi Occidente, dans St. Eu: 34, 1966, η. 80 p. 138-139.
ETUDES ET NOTES COiMPLEMENTAIRES 321
ces trois bas-reliefs comme figurant des brûle- parfums^ et les avait rapprochés de ceux de Toukh el Garmous. Cependant, il a été intrigué par leur forme. Il pensait que le fût cannelé constituait le foyer proprement dit, sur lequel le couvercle aurait dû reposer directement, comme sur les brûle-parfums à fût étranglé (nos 113-117) auxquels il les rattache typologi- quement. Cette particularité viendrait, selon cet auteur, de ce que Phéniciens et Egyptiens figuraient le fourneau du thymiaterion ouvert, et le couvercle suspendu au dessus. Les sculpteurs puniques, se méprenant sur cette représentation, auraient ajouté un élément intermédiaire entre le fourneau et le couvercle.
La découverte de Byrsa nous prouve que c'est au contraire cette partie supérieure, à bords lisses, qui constitue le foyer. Le fût cannelé est un simple support, à la différence des autres exemplaires dont Wigand les rapproche. D'autre part, Wigand voyait uniformément sur ces stèles des brûle-parfums à trois pieds, dont deux seulement auraient été représentés40. Nous avons reconnu, pour notre part, une plus grande diversité.
Une fois rectifiées ces deux inexactitudes, l'originalité du type carthaginois apparaît mieux. Plutôt que de le réduire à d'autres types, comme faisait Wigand, il faut donc le constituer en un modèle spécifique, au plus apparenté à ou dérivé de types connus par ailleurs.
Situation chronologique
Les thymiateria de Toukh el Garmous situent du côté de la Syrie, semble-t-il, l'origine géographique du modèle initial. L'hypothèse la moins improbable serait donc que Carthage ait hérité cette forme de la Phénicie même, qui l'aurait auparavant adoptée. A quelle date? Les représentations sur stèles sont reconnues comme «hellénistiques». Tentons de serrer de plus près leur chronologie d'après les critères généralement admis. Sur ces stèles-obélisques, qui ne sauraient donc remonter plus haut que le IVe
siècle41, la division de la pierre en deux registres est typique du IIIe siècle42. Le décor architectural qui couronne l'inscription sur la stèle CIS 2652, si caractéristique soit-il, n'a pas été jusqu'ici étudié ni daté41. Par contre, le décor végétal stylisé qui encadre le brûle-parfums sur la même pierre serait caractéristique des IIIe-IIe siècles44. Enfin, la technique de sculpture en très bas-relief du motif principal et de l'encadrement, se détachant sur un fond neutre, apparaîtrait au milieu du IIIe siècle4\ La stèle CIS 2652 se situerait donc plutôt dans la deuxième moitié du IIIe siècle. Les autres stèles ne lui sont pas nécessairement antérieures, le décor incisé à la roulette demeurant pratiqué jusque sous les Barcides46. Elles figurent, certes, des brûle-parfums moins avancés dans l'évolution typologique que nous avons proposée. Mais aussi pouvait-on continuer à produire simultanément l'ancien et le nouveau type. En tout état de cause, aucune de ces représentations ne saurait remonter plus haut que le début du IIIe siècle.
Brûle-parfums de Salammbô
Nous ne sommes pas certain cependant de tenir, avec les représentations sur stèles, le premier maillon de la série. Nous pouvons en effet préciser l'identification d'un objet autrefois décrit par Carton (Fig. 13). Cet objet provenait de la «cella» d'un temple punique fouillé par Carton à Salammbô, temple détruit en 146 av. n.è.47. L'inventeur le décrivait ainsi :
'9 K. Wigand, op. cit., p. 73. La fig. 112, Pi. IV, était censée représenter CIS 2017, assez imaginativ ement interprétée.
wIbid., p. 79.
41 Bisi, p. 58 et 214-215. 42 Bisi, p. 72-73. 41 Une proche parenté nous paraît lier le décor architec
tural de cette stèle à l'entablement du naos de Thuburbo Majus : cf. A. Lézine, Λ ptupos du naos de Thubuiho Majus, dans Aichitecture punique, Paris, s.d., p. 7-26. Cet auteur revient à la datation de la première moitié du IIe siècle av. n.è. (p. 19).
44 Bist, p. 87. 45 C. Picard, p. 29-30. 4"C Piccud, p. 28 et 30. 47 L. Carton, Sanctuaire punie/ne découveit a Canhage,
Paris, 1929, p.ll-li (Catalogue des terres cuites, n° 43), et pi. III, 5. Conservé au Musée de Carthage, où j'ai pu le photographier grâce à l'amicale autorisation de M. Abdelmajid Ennabli. Le lieu de la découverte pourrait être utilement comparé au sanctuaire publié par V. Tusa, Edificio sacio a Solini tu dans Palladio 16, 1967, p. 155 s..
322 BYRSA I
Fig. 13 - Brûle-parfums de Salammbô (Cliché J.-M. Carrié).
«Un beau socle de candélabre, en terre rouge . . . , de forme triangulaire, mesure 0 m 26 de hauteur, sur 0 m 23 de côté. Il était porté par trois pieds en forme de sphinx ailé ... La tête de ces sphinx est ornée d'une Stéphane à rayures verticales; les ailes, recourbées vers la tête, ont le type assyrien; le buste repose sur une grosse patte de lion, unique . . . Sur cette base triangulaire s'élevait un tube de forme très légèrement tronconique, orné à mi-hauteur d'une zone de décoration noire, indistincte. L'orifice supérieur est de 0 m 09 de côté. Il devait recevoir probablement le montant du candélabre».
Carton propose pour l'ensemble des objets trouvés dans le sanctuaire la date des IVe-IIIc siècles.
Il s'agit ici encore d'un thymiaterion. En l'absence de parallèles connus, on comprend que Carton ait pensé à un candélabre; Schreiber, d'ailleurs, proposait le terme de « Kandelaberaltar» pour désigner les brûle-parfums de ce type48.
L'exemplaire de Salammbô est plus proche des brûle-parfums de Toukh el Garmous que de ceux de Carthage. Il pourrait môme reproduire
leur prototype, proche encore du modèle oriental, et qui aurait ensuite été transformé dans un sens résolument hellénique par l'adoption d'un fût cannelé49.
Sur ce même exemplaire pourtant la configuration des pieds - en forme de sphinges (fig. 14 c) - atteste la transformation du langage artistique. C'est déjà le type de la sphinge hellénique, mais encore coiffée du klaft, que nous retrouvons sur l'exemplaire de Byrsa (fig. 14b) : chevelure également répartie de part et d'autre de la tête, buste trappu, ailes recourbées vers l'avant. Mais montée cette fois sur de hautes pattes, cette sphinge s'apparente plus encore au type qui apparaît sur une stèle punique datable du milieu du IIIe siècle (fig. 14a)50, et plus tard encore, dans la première moitié du IIe siècle,
Fig. 14a - Stèle punique avec sphinx (d'après An t. Afr. I, 1967, pi. VI, 2).
1 T. Schreiber, op. cit., p. 445 (p. 175 de l'éd. séparée).
49 Comme sur le fragment de stèle Hours-Miédan pi. XXVIII, fig. d.
so CIS 4044 et pi. I, 3, 2, XXX, n° 4 = Hours-Miédan, p. 54- 55 et pi. XXVII, c et d = C Picard, pi. VI, 2; p. 20 (description) et 30 (datation). Mmc Picard a proposé d'y reconnaître le sphinx de l'ex-voto des Naxiens à Delphes.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 323
Fig. 14b - Pied du brûle-parfums de Byrsa (Cliché J.-M. Carrié).
sur la base du trône d'un Baal Hammon en terre cuite51.
Le sphinx punique a toujours été de type féminin, avant toute influence grecque, parce que tel était le sphinx phénicien, introduit à Carthage dès l'époque archaïque52. Mais il avait jusque là conservé les conventions orientales de représentation. A cet égard, les brûle-parfums nous montrent mieux que tout autre exemple à quel point le langage artistique de Carthage a subi l'ascendant des modèles hellénistiques dominants.
Brûle-parfums et supports de vases
Cette mutation de la sphinge punique fut sans doute l'une des dernières étapes franchies sur la voie de l'hellénisation. L'évolution typologique à partir du brûle-parfums de Salammbô a dû se marquer tout d'abord par la substitution
S1 Description dans L. Carton, Sanctuaire punique, op. cit., p. 17-18; photographie dans C. Picard, Victoires et trophées puniques, Studi Magrebini 3, 1970, pi. II, fig. 7.
S1 Bisi, p. 89.
Fig. 14c - Pied du brûle-parfums de Salammbô (Cliché J.-M. Carrié).
au fût droit d'un manchon cannelé, déjà réalisée dans les exemplaires figurés sur les stèles.
De fait, le fût cannelé constitue l'un des éléments les plus caractéristiques du mobilier hellénistique, dans lequel il remplit la fonction de support. Son origine est à rechercher, vraisemblablement, dans la toreutique, qui l'utilisa tout particulièrement dans les supports de cratères à godrons (fig. 15 et 18). De cet emploi, il passa dans les arts céramiques, quand on imita en terre ces mêmes vases métalliques (fig. 16); une autre utilisation très fréquente fut comme support de loutron™. Les premières représenta-
S3 E. Pernice, Die lielletiistische Kunst in Pompeji, 5, p. 38- 54 («Beckenuntersätze») et pi. 24-34. Le nom grec de tels supports apparaît dans la documentation papyrologique : βασίδιον (BGU 781, III, 6); βάσις δακτύλιος (BGU 1300, 11); βασίδιον δακτύλιον (P. Fonaci Ι ην. 45 = Chron. d'Eg. 27, 1952, p. 196-204).
324 BYRSA I
Fig. 15 - Support de cratère en bronze du Musée de Naples (Cliché Germanico 1936-2503).
tions figurées de ce type de support, sur des reliefs ou en peinture, datent de la fin du IVe et du début du IIIe siècle SA, et les premiers vases céramiques godronnés à support cannelé sont eux-mêmes datés du troisième quart du IVe siècle.
Dans leur réalisation métallique, ces supports reposent sur une base à pieds, comme c'est le cas sur la fig. 15S\ On notera alors la ressem-
^4 Cratère avec support cannelé sur un antéfixe du «ske- non» de Némée : JHS Suppl, Arch. Rep. for 1964-1965, p. 10, fig. 9; de môme sur un moule de motif d'applique du Louvre : S. Besques, Catalogue raisonné des figitie.s cl icliefs en lene cuite grecs, étrusques et loinains 3, Epoques hellénistique et loinaine. Grèce et Asie Mineure, Paris, 1972, pi. 99 a (D452), et p. 72-73 : fin du IV* siècle av. J.C.
" Cratère et support du Musée de Naples : cf. E. Pernice, Die hellenistische Kunst in Pompeji, 4, pi. XII.
blance avec les brûle-parfums de Toukh el Gar- mous, et l'on pourrait considérer les tliymiateria de ce type comme une variante des supports de vases.
Pour des raisons techniques aisément compréhensibles, les céramistes n'ont pu reproduire le délié des pieds métalliques. Ils se sont donc généralement limités à des bases plates, carrées, à profil en gradins. Ainsi se présentent les innombrables supports de vases fabriqués tant en Grèce qu'en Italie méridionale (fig. 16), et tout particulièrement dans les productions dites «de Calés» et «de Gnathia» (fig. 17)S6 II semblerait que cette forme de support ait été parfois exécutée en métal, par un effet d'imitation en retour : c'est le cas, par exemple, d'un support en bronze inédit conservé au Musée d'Istanbul (fig. 18)S7.
Fig. 16 - Support de cratère de Gnathia (d'après E. Pernice, Die hellenistische Kunst in Pompeji, 4, pi. XIII).
S6 A défaut de citer les innombrables publications présentant un matériel de ce type, retenons à titre d'exemples : Corp. Vas. Ant., Italie, fase. 22, Mus. Naz. Napoli, fase. Il, IV, E, tav. 22 : céramique «de Calés»; L. et J. Jehasse, La necio- pole preiomaine d'Aleria (1960-1968), Gallici Suppl. XXV, Paris, 1973, pi. 95, n° 324 : céramique «de Gnathia».
"7 Je remercie M. Nezih Firath, Conservateur des Antiquités grecques et romaines au Musée Archéologique d'Istanbul, à l'obligeance de qui je dois de pouvoir faire ici état de
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 325
iÄ-j-v - - " _
Fig. 17 - Support de vase de Cales (d'après Coip. Vas. Am. Italie, fase. 22, Λ/n.s. Λ'αζ. Mipo//, fase. II, IV, E, pi. 22, 5).
ν- -
;/ f·
■ ( t .
Fig. 18 - Support métallique du Musée d'Istanbul (Cliché Musée Archéologique d'Istanbul).
A Carthage même, les fouilles du P. Ferron sur Byrsa ont livré des fragments céramiques pouvant appartenir à des supports cannelés de ce type (fig. 19a), ou à des modèles apparentés (fig. 19b) ss. Sur ce second exemplaire, on
cet objet, qui m'a fourni la photographie publiée ici, et qui m'a communiqué les renseignements suivants : Inv. n° 1263; pro\enance : Çarsamba ilçesi, Yaka Kövü.
"Cfl/i. Byrsa 9 (1960-1961), pi. LXXX, n"- 454-455. N° 454 : « Fragment de la partie inférieure d'un pied orné de
f'
V;
>>
■0
; - Μ* Α
Fig. 19 - Supports de vases provenant de Byrsa (d'après Calu Byrsa 9, pi. LXXX - a : η" 454 - b : η" 455).
326 BYRSA I
retrouve un décor d'oves très comparable à celui de notre brûle-parfums. La fréquence particulière de ce motif en Italie du sud, et sa diffusion probable à partir de l'Apulie, lieu de production de la «céramique de Gnathia», nous font ici de nouveau prononcer le nom de Tarente, déjà évoqué à propos d'un thymiaterion qui n'est pas sans rapports avec ceux de la série carthaginoise. De Tarente, Carthage n'aurait-elle pas emprunté tout à la fois supports de vases et brûle-parfums?
Carthage et Tarente
Nous nous défendons de cette tendance fort répandue qui consiste à porter au crédit de Tarente l'invention et la diffusion de tout ce qui n'est pas réputé d'origine alexandrine59. Mais la question se pose effectivement de ce qui, dans la Carthage hellénistique, dénote des influences et des emprunts en provenance de Tarente. Mme Picard en a indiqué certains aspects60. Dans le même sens, nous voudrions signaler un autre rapprochement, par lui-même mineur, mais d'un plus grand relief pour le sujet qui nous occupe ici. Dans la série des stèles puniques représentant des objets de culte figurent, outre les thymiateria, des canthares rituels61. Or ces canthares reproduisent la forme tarentine du vase, à l'époque même - IIIe siècle - où le canthare constituait à Tarente le type céramique le plus apprécié62. On conçoit dès lors la nécessité de poser au moins la question.
A propos des brûle-parfums, pourtant, il nous semble qu'une telle influence doive être récusée, cela pour deux raisons. La première tient à
cannelures... »; n°455: «support fragmentaire, décoré en haut d'une file d'oves appliquées à la barbotine.
59 A. Adriani, La Magna Grecia . . . , loc. cit., p. 87 : «... una specie di « pantarantinismo » dal quale sarà opportuno guardarsi ».
60 C. Picard, intervention au X° Conv. Stud. Magna Grecia (Taranto, 4-11 Ott. 1970), Naples 1971, p. 285-286.
61 CIS 4808 (pi. XXIX, 2) = Hours-Miédan, pi. XXII, h = C. Picard, pi. VIII, 1; CIS 4065 (pi. XXXI, 12: complète) = C Picard, pi. IX, 4 (incomplète); CIS 5730; CIS 2187 (très fragmentaire).
62 F. Tiné-Bertocchi, La pittura funeraria apula, Naples, 1964, p. 117, η. 92 ad p. 90. On comparera la forme avec P. Wuilleumier, Le Trésor. . . , p. 41 sq. et pi. V-VI.
ce que les exemplaires représentés sur les stèles puniques comportent tous une base à pieds, qui affirme la continuité évolutive par rapport au type du brûle-parfums de Salammbô. Inversement, il semble que tous les supports céramiques apuliens et, plus généralement italiques, reposent sur une base plate, apode. La deuxième raison nous conduit à situer l'originalité principale du thymiaterion de Byrsa : dans cette association d'un fût cannelé, d'une base à décor en relief et de pieds évoquant un prototype métallique, association dont nous ne connaissons pour le moment d'exemple ni à Tarente, ni même ailleurs.
Thymiaterion et arula turicrema
Sur notre exemplaire, donc, la base du support s'est développée d'une façon autonome, pour former un caisson adapté à l'adjonction de pieds, et créant un espace propre à recevoir un décor. Pour punique qu'elle paraisse, cette création ne s'est pourtant effectuée que par un emprunt supplémentaire à l'hellénisme. Il semble en effet difficile de ne pas reconnaître dans ce caisson décoré l'influence des brûle-parfums helléniques du type arula turicrema63.
W. Deonna avait le premier appelé l'attention sur ces petits autels quadrangulaires à décor en relief, qu'il pensait être de fabrication grecque64. Leur fréquence particulière en Grande Grèce avait conduit M. Wuilleumier à situer à Tarente le principal centre de production de ce mobilier aux IVe-IIIe siècles65. La forme hellénistique finale serait, le produit de l'influence alexandrine sur une forme propre au monde grec d'Occident, diffusée dès le VIe siècle en Sicile, et gagnant l'Italie du Sud au Ve siècle.
M Dans un esprit assez voisin, on pourrait également penser aux bases de statues ornées de reliefs : cf. S. Besques, Un groupe d'Aphrodite au dauphin, dans RA 1976, I (Mél. P. Demargne I), p. 121-132. Mais s'agissant d'un thymiaterion, la contamination par les arulae est plus vraisemblable.
64 W. Deonna, Brûle-parfums en terre cuite, dans RA 1907, 2, p. 245-256, et Fouilles de Délos XVIII, p. 386.
^ P. Wuilleumier, Brûle-parfums en terre cuite, dans MEFR 46, 1929, p. 43-76; Tarente... , p. 432-436. Nombreux exemplaires dans G. Foti , // Museo Nazionale di Reggio Calabria, Naples, 1972, provenant de Locres, Medma, Caulo- nia, Crotone.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 327
Nous faudra-t-il, par ce biais, réintroduire Tarente dans la généalogie du brûle-parfums de Byrsa? Encore une fois non, parce que la théorie de l'origine tarentine de cette production n'est plus admise 66. On la rattache de nouveau à la Grèce, et plus particulièrement à l'Attique, d'où Tarente aurait tiré les modèles de ses imitations.
A Carthage également, il semble qu'aient été fabriquées à l'époque hellénistique des arulae quadrangulaires inspirées des types grecs. Des fragments céramiques trouvés à Byrsa, et publiés par MM. Ferron et Pinard67, sont en effet attribuables à des autels brûle-parfums du type VII de la classification de M. Wuilleu- mier : forme oblongue, corniche et plinthe à bande d'oves, sans qu'on puisse dire s'ils portaient un décor en relief.
Carthage n'avait pourtant pas subi l'influence des arulae archaïques gréco-occidentales, à la différence de la Sicile punique où elles étaient au contraire passées de très bonne heure68. Mais cela n'est nullement contradictoire, puisque la dérivation des arulae tarentines à décor historié des arulae archaïques de Sicile et Grande Grèce n'est plus prouvée. Carthage n'a donc pas forcément imité les exemplaires taren- tins de cette production : elle peut tout aussi bien avoir suivi leurs modèles de Grèce pre t
LE DECOR
Nous pouvons maintenant aborder l'étude du décor. Nous l'avons retardée volontairement, tant il nous semble que ce domaine est celui
"6 D. B. Thompson, Three centuries of Hellenistic terracottas, II C : The Satyr Cistern , dans Hesperia 31, 1962 p. 244- 262, et en particulier p. 259-260. Cf. déjà W. Schwabacher, Hellenistische Reliefkeramik im Kerameikos, dans AJA 45, 1941, p. 182-228, et en particulier la conclusion.
67 Cah. Byrsa 9, nos 339-340 et fragments nos 341-343. 68 J. I. S. Withaker, Motya, a Phoenician colony in Sicily,
Londres, 1921, p. 322-330. ^ Exemples d'importations attiques à Carthage, contemp
oraines du brûle-parfums : un vase West Slope trouvé par le P. Ferron (Cah. Byrsa 9, n° 395 et pi. LXVIII); un autre, à Byrsa toujours, en 1975: cf. J.-M. Carrié et N. Sanviti, An t. Afr., art. cité, Fig. 17, et ici même, supra, p. 140, fig. 42. Cf. également, dans une aire voisine, une statuette d'Artémis, dont une réplique exacte avait été trouvée à Erétrie : ibid., fig. 18, et dans le présent volume, supra, p. 138, fig. 40.
que menacent le plus les dangers de la subjectivité impressionniste. Le risque serait particulièrement grand dans le cas présent, tant le décor de notre objet exprime une banalité autorisant toutes les hypothèses sur son origine.
LA SCENE DE COMBAT
II convient tout d'abord de définir avec exactitude le sujet représenté, tel qu'il apparaît dès le premier examen. Dans la communication déjà citée au début de notre étude, l'objet est présenté comme «un brûle-parfums en terre cuite de plan carré dont les côtés sont ornés d'une amazonomachie en relief»70. L'amazono- machie est certes l'une des formes les plus fréquemment prises par le thème plus général de la frise de combattants71. Mais dans le cas présent, le détail du relief, identiquement répété sur les quatre faces, n'est pas à ce point émoussé qu'on puisse hésiter à attribuer le sexe masculin à l'ensemble des personnages représentés72. Dans le cas du cavalier, le vêtement, qui nous prive de l'argument anatomique, nous en fournit un autre; il ne reproduit aucun des types de représentation de l'Amazone à cheval".
Chaque plaque de la base met en scène les quatre mêmes combattants.
Au centre, un cavalier, progressant vers la gauche. Il est vêtu d'une tunique courte peut-être, mais plus vraisemblablement d'une cuirasse, d'où pendent, au dessous de la taille, des lambrequins (pteryges). Attaché à ses épaules, un balteus flotte au vent. La tête du cavalier est très indistincte : porte-t-il ou non un casque? De la main gauche, il tient les rênes de sa monture. Il se peut que le bras droit, caché par la tunique déployée, brandisse un javelot qui apparaîtrait partiellement derrière la tête. Les jambes traînent presque à terre.
Le modelé du cheval est des plus malhabiles. Représenté au deuxième temps du galop («cheval en
711 S. Lancel, loc. cit., p. 69. 71 Cf. E. Bielefeld, Amazonomachia, Halle, 1951; D. Von
Bothmer, Amazons in Greek art, Oxford, 1957. 72 Point d'Amazones pour le P. Ferron, Cah. Byrsa, loc.
cit., p. 77 : « Les deux pièces . . . figurent une scène de combat ».
7i Les «cartons» de base de l'amazonomachie ont été répertoriés par E. Bielefeld, op. cit..
328 BYRSA I
l'air»), il semble malheureusement raser le sol, l'arrière-train presque à l'horizontale, la queue virevoltant en un panache rendu avec une relative précision. Les seuls autres détails retenus par le relief sont l'œil, le mors, la bride et la crinière.
Les trois autres personnages sont des fantassins, tous équipés d'une façon semblable, quoique traités avec plus ou moins de soin. Ils combattent nus, mais la chlamyde posée sur l'épaule gauche : celle du personnage de droite retombe en plis particulièrement abondants. Ils portent, semble-t-il, un casque à cimier (premier personnage à g., personnage de dr.), et sont armés, à la main dr., d'un glaive droit, large et court; à la main g., d'un bouclier rond variable- ment déformé par la perspective, avec anse au centre et poignée à la périphérie.
Les attitudes sont véhémente, mais la composition est faible. Les trois fantassins se déplacent tous dans la même direction (vers la dr.), ce qui ne va pas sans déséquilibrer la scène. Celle-ci ne comporte en fait qu'un seul groupe antagoniste, constitué par l'affrontement du cavalier et du deuxième fantassin de g.. Ici seulement, le décor emprunte à l'art international un modèle de composition. Mais ce thème majeur est décentré vers la g. De plus le coroplaste n'a pas su intégrer les autres personnages : le fantassin de g. n'a pas encore part à l'action, que celui de dr. semble déjà quitter. Ce déséquilibre apparaît davantage encore lorsqu'on restitue à la frise la continuité de son déroulement sur les quatre faces de la base.
On reconnaît dans ces figures des conventions diffusées dans l'ensemble de la koinè hellénistique. Mais leur groupement ne manque pas d'incohérence. L'armement du cavalier, en effet, n'est pas sans rappeler celui des cavaliers italiens tel qu'il apparaît à la même époque sur des urnes étrusques ou des reliefs de Tarente74, cependant que les fantassins se meuvent dans l'irréalité du monde héroïque.
che : les pressions exercées au cours du montage les ont quelque peu déformées.
Malgré ces imperfections, on peut reconnaître le même type de colonne ionique que Mme Picard a décrites sur les stèles : « base attique, fût cannelé surmonté d'un gorgerin, chapiteau aux volutes retombantes et reliées par un canal dont le rebord inférieur s'infléchit assez fortement ... Le modèle paraît reproduire la réalité . . . »7\
II paraît inutile, ici encore, de souligner le caractère hellénistique de ce type d'encadrement. L'emploi de colonnes ioniques sur des autels et des brûle-parfums est des plus fréquents à cette époque. Sur les formes cylindriques, elles rythment la paroi76. Sur les formes rectangulaires, elle soulignent les angles : en particulier sur les aritlae de Tarente. La prédilection pour ce motif ne peut être séparée de la vogue plus générale qui le fait apparaître encore sur la céramique à reliefs77, sur des tablettes céramiques78, ou des autels et reliefs funéraires en pierre79. A Carthage même, des colonnes ioniques encadrent les chapelles à fronton représentées sur les stèles80, ou délimitent les côtés de petits autels cubiques81.
DECOR EN RELIEF ET SURMOULAGE
C'est cependant le décor des plaques qui sollicite le plus naturellement notre curiosité. Une première question se pose à son propos : ne résulterait-il pas du surmoulage d'un original métallique? Au cours des vingt cinq dernières années, de nombreuses études ont établi combien ce procédé était utilisé pour imiter en terre des pièces d'orfèvrerie ou de toreutique,
Les colonnes ioniques
Les colonnes encadrant chaque face constituent l'élément le plus grossier de la réalisation. Il semble qu'elles aient été appliquées en fin d'assemblage, après la fixation des pieds à la base carrée. A la différence des autres éléments, elles ont dû être rapportées à l'état d'argile fraî-
74 Cf. infra, p. 329.
7=i C. Picard, p. 10. 76 N. Breitenstein, Catalogue of terracottas (Danish Natio
nal Museum), Copenhague, 1941, n°470 et pi. 59 (Smyrne); W. Deonna, Fouilles de Délos, XVIII, p. 379 et pi. CVI, nos 941 et 943.
77 U. Hausmann, Hellenistische Reliefbecher aus attischen und boötischen Wetkstatten, Stuttgart, 1959, pl. 38-39.
78 C. Belli, // tesoro di Taras, Milan, 1970, p. 128. 79 P. Wuilleumier, Tarente . . . , pl. XL, n° 4; etc.. s" C. Picard, pl. I, nos 1-3-4; etc.. Sl L. Carton, Le sanctuaire de Tarnt à El-Kénissia, Paris,
1907, p. 137 et pl. V, 28.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 329
et en particulier des brûle-parfums s:. Carthage l'a très certainement pratiqué à l'époque hellénistique. Un exemple suffira, celui d'un médaillon d'applique représentant une tête de Zeus, trouvée par nous à Byrsa dans les mêmes niveaux de destruction de 146 (cf. fig. 38 p. 138). Il décorait sans doute un départ d'anse torsadée, sur un vase punique d'imitation hellénistique^. On rapprochera le modelé des traits, la chevelure, l'expression, de médaillons de l'orfèvrerie grecque84, à leur tour reproduits dans la production céramiques\
Concernant notre brûle-parfums, il nous semble exclu que les plaques résultent telles quelles d'un surmoulage. Une copie n'est concevable que si elle reproduit un original de haute qualité, ce qui n'est pas le cas ici, tant s'en faut. Tout au plus pourrait-on supposer que la matrice qui a formé ces plaques ait été préparée à l'aide de sceaux obtenus par surmoulage d'éléments isolés, ce qui expliquerait au moins la maladresse de la composition.
LE DECOR DE COMBATTANTS DANS L'AMBIANCE HELLENISTIQUE
Plus probable reste cependant l'hypothèse de la simple imitation d'un original hellénique, sinon de la contamination de plusieurs sources d'inspiration. Mais à ce point de banalité des motifs, et de négligence dans l'exécution, le jeu délectable de recherche des influences deviendrait dérisoire. Quelle signification donner, par exemple, à la ressemblance fortuite entre le
82 G. M. A. Richter, Ancient plaster casts of Greek metal- ware, dans AJA 62, 1958, p. 369 s.; Calenian pottery and classical Greek metahvare, dans AJA 63, 1959, p. 241 s.; S. Besques, RA 1976, art. cité, p. 131, et Cat. terres cuites Louvre, op. cit., 3, p. 72-73.
81 Forme Cintas (Céramique punique) 147, par exemple. 84 Pensons aux médaillons à tête de Zeus inscrits dans les
volutes du cratère de Derveni. ss Sur des guttus de Calés par exemple : Corp. Vas. Ant.,
Italie, fase. 22, Mus. Nat Napoli, II, IV, E, tav. 24, n° 15 et 34, n° 2. Cf également un oscillum de Gela : P. Orlandini dans Arch. Class. 9, 1957, p. 164-165 et tav. LXVI, 2 (matériel d'entre 311/310 et 228), qui est lui-même à rapprocher d'un oscillum de Liljbée = A. M. Bisi dans NS 25,2. 1971, fig. 33 p. 702.
décor de Byrsa et un cavalier figuré sur telle plaque en terre de Cymé86?
Nous trouverions plus difficilement encore sur ce modeste relief un écho des grandes créations de la sculpture hellénistique, affaibli à travers des imitations successives. Tout au plus remarquerons-nous que certains caractères : convention un peu figée des attitudes, lourdeur des chevaux à l'arrière-train surbaissé, n'affectent la grande sculpture à frises qu'à une époque postérieure à celle de notre brûle-parfums : sur la frise de l'Artémision de Magnésie par exemple87. Cela tient pour une part au vide documentaire qui subsiste entre la première sculpture hellénistique et les frises de la deuxième moitié du IIe siècle. C'est en Occident que nous est conservée l'étape intermédiaire, en particulier dans les reliefs en pierre tendre de Tarente88. De fait, le cavalier de notre décor n'est pas sans évoquer tel de ces reliefs89, où le cheval plane, pattes en arrière, où les pieds de l'homme traînent à terre, où la tunique flotte au vent. Pour ce qui est de l'armure, la ressemblance est plus nette avec un autre relief de Tarente, conservé à La Haye90.
Nous pourrions, à travers d'autres rapprochements, évoquer cette ambiance artistique diffuse en Méditerranée occidentale, qui reproduit souvent des thèmes élaborés en Grèce propre. Cette ambiance s'exprime encore dans la céramique à reliefs91. Les scènes de combat ou
s" S. Besques, Cat. terres cuites Louvre, op. cit., 3, D 598, p. 101 et pi. 126, g.
"7 G. Mendel, Cat. Sculpt. (Mus. Imp. Ottomans), I, p. 369- 419. Hermogenes aurait travaillé à Magnésie vers 150-130: M. Bieber, The sculpture of the Hellenistic Age1, New York, 1961, p. 164-165, reprenant la datation proposée par A. von Gerkan, Der Altar des Attemis-Tempels in Magìiesia ani Mander, Berlin, 1929, p. 253. En dernier lieu, conclusion identique au terme d'une longue démonstration par A. Yaylah, Der Flies des Ailemisions von Magnesia am Mäander (Ist. Mitt. 15), Tübingen, 1976, p. 106-173.
8S Cf. en dernier lieu J. C. Carter, The sculpture of Taras, Philadelphie, 1975, qui situe cette production dans les années 330-275 (p. 23-24).
M H. Klumbach, Tarentiner Grabkunst, Reutlingen, 1937, n° 56, p. 13 et pi. 11 (Musée de Bari) = J. C. Carter, op. cit., n" 138 et pi. 30, a.
4" H. Klumbach, op. cit., n° 16, p. 4 et pi. 4 = J. C. Carter, op. cit., n° 185 et pi. 30, c.
41 F. Courby, Les vases grecs à reliefs, Paris, 1922, p. 346, fig. 71, n° 28, a-q. Cependant, aucune de ces figures ne ressemble vraiment à notre décor.
330 BYRSA I
d'amazonomachie sont fréquemment représentées sur la céramique de Calés, qui reprend elle- même, par surmoulage, le décor d'originaux métalliques92; ou bien encore sur les séries « argentées » de la céramique produite non pas à Orvieto, comme le voulait Furtwängler, mais à Bolsena93. Parmi les formes les mieux représentées de ce groupe figure l'amphore à col décoré d'une frise d'amazonomachie94. La chronologie de ces vases demandant à être remontée95, leur décor serait contemporain des amazonoma- chies décorant des vases métalliques, cistes en particulier96.
Ces rapprochements n'ont pas pour objet de suggérer une direction géographique dans laquelle chercher l'inspiration du décorateur punique. Du moins nous font-ils saisir l'unification esthétique de la koinè hellénistique, et l'intégration croissante de Carthage à cet espace économico-artistique.
Le décor en relief dans la coroplastie punique
On rappellera enfin la diffusion dans la Carthage hellénistique des plaques de terre cuite à décor en relief, dans diverses utilisations : décors architecturaux, appliques de meubles, ornements de trônes de statues97. Notre frise de combattants n'est pas dépourvue de parenté stylistique avec l'une de ces plaques, trouvées dans une favissa de Borj Jedid, et représentant une Néréide chevauchant un hippocampe98.
92 G. M. A. Richter, AJA, 1959, art. cité. Le début de la céramique «de Calés» doit être remonté, contre Pagenste- cher, à la fin du IVe siècle : ibid., p. 242, n. 12.
93 I. de Chiara, La ceramica volsiniese, dans St. Etr. 27, 1959, p. 127-135 et pi. VI-IX.
94 G. Camporeale, L'arnazzonomachia in Etruria, dans St. Etr. 27, 1959, p. 107-137 et pi. XIV-XIX. Les meilleurs exemplaires figurent dans la Collection Castellani : cf. M. Moretti, The National Museum of Villa Giulia, Rome, 1963, p. 153.
95 D. Rebuffat-Emmanuel, A propos d'une coupe étrusque récemment acquise par le Musée de Leyde, dans MEFRA 87, 1976, p. 589.
96 Ciste ovale de Vulci, par exemple : G. Camporeale, art. cité, pi. 15-16 = R. Bianchi-Bandinelli et A. Giuliano, Les Etrusques et l'Italie avant Rome, Paris, 1972, fig. 299 p. 261.
97 C. Picard dans Studi Magrebini 3, 1970, art. cité. 98 Ibid., p. 58-59 et pi. II, fig. 5.
Ce goût marqué pour les décors en relief, nous le retrouvons dans d'autres secteurs de l'aire punique, dans des productions de qualité fort variable, parmi lesquelles figurent précisément des brûle-parfums. Nous pensons tout d'abord à deux arulae siciliennes, trouvées à Solunto, et décrites par V. Tusa". Le décor, appliqué, associe des figurines rapportées, des médaillons, et des symboles dont le caractère punique ne peut faire de doute : signe de Tanit, caducée, coq. Ces deux thymiateria auraient été trouvés dans une maison d'époque augus- téenne, mais ils ne sauraient s'accommoder eux- mêmes d'une telle datation, contredite à la fois par la punicité de leur décor et par la typologie même dans laquelle ils trouvent place. Ce sont des variantes d'une forme bien répertoriée en Sicile tout au long de l'époque hellénistique : thymiaterion cylindrique, orné au sommet de gorges, de filets, de denticules ou d'oves, et sur les parois de décors en relief, végétaux ou géo
métriques100. En Calabre également, un exemplaire du même type, portant un décor en relief de têtes rapportées séparées par des triglyphes, fort comparable au décor des thymiateria de Solunto, a été trouvé à Monasterace Marina (l'antique Caulonia) dans un niveau daté du IIIe siècle av n.è.101. L'objet aura peut-être été importé de la Sicile punique.
Conclusion
Le thymiaterion retrouvé à Byrsa nous paraît marquer le terme du processus d'hellénisa-
99 V. Tusa, Kokalos 1964-1965, p. 569 et pi. LXXI, fig. 24 et 25; Idem, Sicilia Archeologica 17, mars 1972, p. 42-43 et fig. 21-22: «Si tratta di due cilindri di terra cotta vuoti all'interno, con una piccola apertura, chiusa da uno sportellino di terracotta».
too ρ Orlandini, Tipologia e cronologia del materiale archeologico di Gela dalla nuova fondazione di Timoleonte all'età di Ierone II, dans Arch. Class. 1957, spécialement p. 163 et pi. LXIV, 3; p. 165 et pi. LXVII, 2; p. 169-170 et pi. LXXV, 2 : matériel appartenant dans sa totalité au niveau 311/310-282 av. n.è.; Idem, NS 1960, p. 176 et fig. 15; de même A. M. Fallico, NS 1971, 2, p. 618-619 et fig. 41 : matériel de Syracuse, daté du IIIe siècle av. n. è..
101 E. Tomasello dans NS 1972, p. 641 et fig. 152: décrit comme un vase hellénistique à décor en relief. Il s'agit bien, en fait, d'un thymiaterion.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 331
tion102 d'un type d'origine orientale, peut-être directement transmis à Carthage par la Phéni- cie. Il amalgame une série d'emprunts extérieurs. Pourtant, ces emprunts successifs se sont superposés à une évolution typologique interne dont nous avons tenté de suivre les étapes, depuis le brûle-parfums de Salammbô jusqu'à celui de Byrsa, en passant par les exemplaires représentés sur des stèles. La dernière étape pourrait se situer dans la première moitié du IIe siècle seulement.
Le résultat final de cette évolution est une synthèse morphologique dont nous ne connaissons aucune autre illustration hors de Carthage. A Carthage même, on peut s'étonner qu'un type d'objet aussi manifestement adapté à une production en série n'ait pas livré d'autre exemplaire. Il est vrai que le programme de fouilles actuellement en cours marque la découverte véritable de la Carthage hellénistique, et qu'il ne manquera pas d'élargir considérablement notre connaissance du mobilier punique tardif.
Le décor de notre thymiaterion montre l'adoption par Carthage du répertoire international. L'origine géographique de ces influences helléniques nous paraît cependant impossible à cerner, pour des raisons qui tiennent tant à la banalité stylistique de ce décor particulier que,
plus généralement, aux conditions de la production artistique de la période. Il eût été facile de construire une convergence persuasive à partir des diverses allusions tarentines rencontrées en cours d'analyse, et dont plusieurs étaient en fait trompeuses. Il ne fait aucun doute pourtant que Carthage a entretenu des relations économiques et artistiques avec Tarente, de même qu'avec la Campanie103 et l'Etrurie104. Mais son rapport à l'hellénisme passait également par les centres créateurs traditionnels, Athènes en particulier, sans doute aussi Corinthe105. L'apport original de ces différents centres est encore trop mal connu; et la circulation internationale des thèmes et schémas esthétiques, à l'époque hellénistique, brouille les circuits de l'invention et de l'imitation.
Qu'une hellénisation aussi marquée des formes affecte jusqu'à des productions liées à la religion traditionnelle comme le sont les thy- miateria témoigne, au demeurant, de la remarquable ouverture et disponibilité spirituelle de Carthage durant les deux derniers siècles de son histoire.
102 En employant ici, très conventionnellement, le terme d'« hellénisation», nous demeurons conscient des problèmes multiples qu'il soulève, et que signale fort bien Ph. Bruneau, Situation méthodologique de l'histoire de l'art antique, dans AC 44, 1975, en particulier p. 467-475.
"H Cuirasse campanienne trouvée près de Mahdia : E. Pernice, op. cit. 4, p. 6 avec référence fausse.
11)4 La question des rapports commerciaux entre l'Etrurie et Carthage, de nouveau actifs au IVe et au début du IIIe siècles, demanderait à être reconsidérée, en prolongeant l'étude d'Et. Colozier, Les Étrusques et Carthage, dans MEFR 65, 1953, p. 63-98.
"):i Sur le rôle important joué par Corinthe dans la diffusion des céramiques à décor en relief, cf. S. S. Weinberg, Corinthian relief ware : pre-hellenistic period, dans Hesperia 23, 1954, p. 109-137.
N.B. : Aux références bibliographiques indiquées dans les notes 50-52 à propos de la sphinge tardo-punique, on ajoutera : C. Poinssot, Éléments architecturaux punicisants de Thugga, dans RA 1967, p. 113-126, où l'on notera particulièrement les similitudes entre des chapiteaux historiés de Chemtou et des parallèles tarentins datés des IIIe-IIe siècles.
UNE MARQUE AMPHORIQUE AU NOM DE MAGON, EN GREC
par JEAN-PAUL THUILLIER
Dans une communication récente à l'Institut1, M. J. Heurgon a attiré de nouveau l'attention sur le personnage et l'œuvre de l'agronome carthaginois Magon. Celle-ci nous est un peu connue grâce à divers extraits et renseignements que l'on peut trouver chez plusieurs auteurs romains. En revanche, le personnage reste très mystérieux puisqu'on ne possède presque pas d'indications directes le concernant. Or, il se trouve qu'à l'époque où M. Heurgon présentait sa communication, au cours de la campagne 1976 des fouilles françaises de Carthage-Byrsa, on a découvert un fragment d'amphore portant le nom de Magon (fig. 1). Peut-on établir un rapprochement entre ces deux noms? Et quelles conclusions peut-on tirer de cette trouvaille, quelle que soit la réponse donnée à la première question?
Le fragment d'amphore sur lequel a été lue la marque Magon a été découvert dans ce qu'il est convenu d'appeler la couche d'incendie de 146 avant notre ère, au cours du dégagement d'un îlot d'habitation punique tardive, sur la pente sud-est, de la colline de Byrsa2. Si l'amphore en question est assez banale - c'est la forme 312-3 dans la typologie de P. Cintas -\ en revanche,
1 J. Heurgon, L'agronome carthaginois Magon et ses traducteurs en latin et en grec, dans CRAI, 1976, p. 441 sq.
2 Exactement dans le carré HIV 3 du quadrillage de chantier. Le dégagement de cette insula constitue le prolongement des fouilles J. Ferron-M. Pinard (Cahiers de Byrsa, V, 1955, p. 31 sq. et IX, 1960-61, p. 77 sq.).
' Céramique punique, Paris, 1950, p. 331. La pâte de cette amphore est rougeâtre comme c'est le cas généralement et la surface en est blanchâtre : contrairement à ce que l'on
on doit noter que la marque, imprimée sur une amphore punique, est rédigée en caractères grecs4. Disons tout de suite que ce n'est pas là une trouvaille originale : en effet, avant même la fin du siècle dernier, plus de cinq marques quasi-identiques avaient déjà été découvertes sur le site de Carthage par le P. Delattre5. Et un peu plus tard, une marque semblable est signalée par P. Gauckler6.
Apparemment - et de façon certaine pour deux d'entre eux au moins - ces timbres ampho- riques ont été découverts dans des nécropoles puniques récentes, sur les collines de l'Odèon et de Sainte-Monique7. Il semble donc que ce soit la première fois que l'on en trouve au cours d'une fouille d'habitat, mais après tout à Carthage, les fouilles de ce type ne sont pas encore
croit habituellement (cf. Delattre, Bull. d'Hipp., 18, 1882, p. 51) il n'y a pas là d'engobe mais simplement une conséquence de la cuisson: «... Cette pellicule n'est pas un engobe ni une couverte. Elle n'est qu'une zone superficielle presque sans épaisseur que la flamme du foyer a décolorée ».
4 Les lettres, hautes de 8 mm, sont inscrites profondément en creux, dans un rectangle. On a également trouvé la marque Magon peinte sur une amphore en punique (cf. Delattre, Menu des Antiq. de Fr., 56, 1897, p. 273).
s CIL, VIII, n" 22639, 103 (p. 2195). 6 Nécropoles puniques, Paris, 1915, p. 592. 7 Un exemplaire a été trouvé lors de la fouille de «sépul
tures de basse époque punique, dans un terrain situé entre le Palais du Cardinal Lavigerie et la route carrossable qui monte de La Marsa à Sidi Bou Said». (BCTH, 1893, p. 121, n. 1). D'autres exemplaires ont été découverts dans la nécropole punique voisine de la colline de Sainte-Monique (CRAI, 1900, p. 509). Enfin, un exemplaire a été trouvé par Gauckler dans la nécropole de l'Odèon (op. cit., p. 590).
334 BYRSA I
Fig. 1 - Timbre amphorique au nom de Magon, en grec (cl. S.L.).
tellement nombreuses pour qu'on puisse s'en étonner. En tout cas, il suffit de considérer le nombre des estampilles déjà répertoriées pour comprendre que les amphores portant cette marque constituaient une série relativement importante. Leur vocation principale n'était évidemment pas funéraire et ce n'est que dans un second temps qu'elles faisaient partie du mobilier funéraire, d'ailleurs modeste, des tombes puniques d'époque hellénistique.
Que faire de ce Magon? Avait-il le moindre rapport avec l'agronome? A vrai dire, il peut paraître sans objet de chercher à identifier un personnage carthaginois portant ce nom. Le nombre des seuls Magons, depuis la dynastie des Magonides jusqu'aux guerres puniques, qui soient passés à la postérité, est considérable. Il semble bien que toutes les branches les plus importantes de l'activité carthaginoise aient vu s'illustrer un Magon, même si ce sont les chefs
militaires qui ont le plus marqué - mais cela est dû à l'état de notre documentation8. Dans ces conditions, il est seulement tentant d'identifier les deux Magons; et de supposer que l'agronome aurait voulu mettre en pratique ses théories et prouver que les produits de ses cultures pouvaient être vendus à l'étranger; ou bien encore, son traité pourrait être une réflexion sur sa propre expérience de paysan, de propriétaire terrien, théorie et pratique n'ayant finalement aucune raison d'être séparées. De la même
8 Pour ne citer que celui-là, c'est par exemple un Magon qui vient mouiller à Ostie avec cent vingt navires au moment de la guerre contre Pyrrhus (cf. J. Heurgon, Rome et la Méditenanée occidentale . . . , Paris, 1969, p. 340). Et dans la série des grands voyages, où les Carthaginois se sont illustrés, on connaît un Magon qui «se \antait d'a\oir traversé trois fois le désert sans boire». (G. et C. Charles-Picard, La vie c\uotidienne . . . , p. 220).
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 335
façon, Caton l'Ancien, l'agricola sollers9, était aussi un spécialiste d'agronomie; et dans d'autres domaines, on verra par exemple un Vitruve construire la basilique de Fano et rédiger un célèbre traité d'architecture - pour rester dans le seul monde antique.
Ne nous leurrons pas et ne faisons pas de roman archéologique : nous n'avons évidemment aucune preuve à avancer. Simplement, on peut dire un mot de la question chronologique pour montrer qu'il n'y a pas d'objection majeure. Les fragments d'amphores portant la marque Magon peuvent être datés de la fin du IIIe siècle ou mieux de la première moitié du IIe siècle avant notre ère. Cela apparaît d'après les indications laissées par Delattre et Gauckler sur leur provenance et surtout d'après la situation de notre tesson dans la couche de destruction. Là en effet, il a été trouvé au milieu d'un matériel remarquablement homogène, dans lequel on peut signaler l'abondance, au point de vue de la céramique, de la «campanienne A», et pour ce qui concerne les importations, d'amphores rho- diennes aux anses estampillées : celles-ci doivent dater, pour la plupart, selon les études de V. Grace, de la période 220-180 avant notre ère10. Quant à Magon l'agronome, il a, si l'on peut dire, beaucoup voyagé à travers l'Histoire, mais l'on s'accorde maintenant pour en faire un contemporain des guerres puniques. Si Heeren le plaçait encore au VIe siècle, F. Speranza, pour des raisons d'ailleurs peu claires, verrait assez volontiers en lui un frère d'Hannibal11. Là encore, aucun élément nouveau n'est en mesure d'éclaircir une question qui reste une res incertissima selon l'expression de ce même Speranza.
Nous ferons simplement une remarque tenant à la vraisemblance. Outre le fait que Magon a rassemblé en un traité unique des connaissances avant lui éparses et qu'il se place ainsi fatalement à la fin d'une lignée12, on peut surtout se
demander pourquoi le Sénat romain, dans une décision tout à fait exceptionnelle, aurait fait traduire cette œuvre en latin?13. On peut bien sûr penser à une sorte d'œuvre-clé, entourée de respect et de solennité, qui aurait gardé, à travers les années, une grande célébrité; en somme, une Iliade ou mieux, Les Travaux et les Jours carthaginois, que Rome aurait adopté, comme elle évoquait les dieux étrangers. Mais, de préférence, il paraît naturel de supposer que les sénateurs romains ont voulu connaître et faire connaître un traité dont l'utilisation pratique était évidente - et cela à une époque où Caton avait déjà livré lui-même ses réflexions et conseils sur le sujet. Or, une telle utilisation ne se comprend que s'il s'agit d'une œuvre récente, adaptée aux nécessités du temps, étant donné que les conditions de l'agriculture avaient grandement évolué depuis les débuts de la nouvelle Tyr. Les raisons pratiques de ce sénatus-consulte constituent de loin la meilleure explication. Ainsi n'y a-t-il pas d'incompatibilité entre ces deux Magons dont nous avons gardé la trace : s'ils n'étaient pas identiques, ils devaient être en tout cas contemporains.
Agronome ou simple négociant, le Magon qui signait ses amphores en grec révèle une situation bien intéressante sur le plan économique. S. Gsell, rappelant le fait, émettait l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'une marque de potier14. Mais cela n'est guère plausible : pourquoi en effet avoir rédigé cette marque en caractères grecs? La seule explication réelle, d'ailleurs suggérée également par le même Gsell, est que ces amphores étaient destinées à l'exportation. Si le grec a été choisi, c'est parce que dans la Méditerranée hellénistique, il constituait la langue internationale des échanges économiques, comme l'anglais peut l'être actuellement pour nos sociétés. C'était aussi la langue de la diplomatie internationale comme le montre l'attitude
9 Cornelius Nepos, Cato, 3,1. 10 V. Grace, dans Hesperia, 3, 1934, p. 214 sq. cf. en revan
che la situation de Kerkouane décrite par J.-P. Morel, MEFR, 81, 1969, p. 473 sq. (surtout p. 509-510).
11 F. Speranza, Scriptortim romanorum de re rustica reliquiae, Messine, 1974, p. 75 sq. cf. J. Heurgon, art. cit., p. 442.
l2Varron, RR, 1, 1, 10.
" Pline l'Ancien, HN, 18, 22. On sait que tous les autres ouvrages des bibliothèques de Carthage ont été dispersés entre les princes africains.
14 S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, Paris, 1914-1920, 4, p. 63 et n. 3. Cf. aussi Delattre, MEFR, 1891, p. 65.
336 BYRSA I
de certains dirigeants romains15. C'est d'ailleurs une vérité banale de constater qu'une grande partie du Bassin Méditerranéen plonge, à l'aurore du IIe siècle, dans une ambiance très hellénisée; sur le plan de l'urbanisme par exemple, la Carthage hellénistique ressemble, même si elle a gardé des caractères originaux, à beaucoup d'autres villes de la Méditerranée. Pour en revenir à l'aspect proprement économique, de même que l'on trouve un peu partout et à Carthage en particulier, dans les années 220-180 av. notre ère, beaucoup d'anses d'amphores rhodiennes estampillées16, de la même façon, des amphores puniques devaient aussi, sous une marque punique mais rédigée en grec, apporter sur d'autres rivages, les produits africains.
Il serait naturellement précieux de retrouver, hors de Carthage un exemplaire ainsi libellé mais jusqu'à présent, si l'on a bien trouvé des amphores puniques exportées, aucune ne présentait une telle marque. Cela nous permet cependant de connaître déjà les régions où les Carthaginois pouvaient exporter17. C'est le cas en particulier du littoral français, à l'ouest du Rhône, et de l'Espagne : ainsi, à Ruscino, a-t-on trouvé trente-cinq amphores de la forme Cin- tas 312 qui avaient servi à constituer une canalisation18. Tout cela confirme que, dans certains domaines au moins, l'agriculture - et le commerce - puniques, étaient restés ou redevenus florissants après la seconde guerre punique : le «vieux» Caton n'avait donc pas tort de se méfier de la puissance carthaginoise.
Mais justement quels étaient ces domaines? Que pouvaient exporter les Carthaginois parmi
15 H.-I. Marrou, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, Paris, 19646, p. 359.
16 Cf. Ferron-Pinard, art. cit. Depuis, les nouvelles fouilles de Byrsa ont livré une vingtaine d'exemplaires supplémentaires (campagnes 1974-1976).
17 F. Benoît, Recherches sur l'hellénisation du Midi de la Gaule, Aix, 1965, p. 77 sq.
1S G. Claustres dans Gallia, 14, 1956, p. 204, fig. 1. TSVP. Cette amphore constitue aussi le type C2 de Mana (J. M. Mafia, Sobre tipologia de anforas pûnicas, Cronica del VI Congresso Arqueologico del Sudeste (Alcoy, 1950), 1951, p. 205.
leurs différentes productions? G. et C. Ch-Picard semblent admettre que les amphores en question, sur lesquelles on trouve la marque Magon, étaient des amphores vinaires. D'ailleurs, nous indiquent-ils, les Carthaginois envoyaient leur vin aux indigènes des Baléares19. Ils faisaient ainsi un échange complexe, puisqu'ils recevaient également des vins de bonne qualité, tels celui de Rhodes, comme en témoigne l'abondance des amphores rhodiennes trouvées sur le site même de Byrsa. Après tout, une telle situation n'a rien d'étonnant, et l'on trouve bien des vins italiens dans notre pays, qui est pourtant un des meilleurs producteurs du monde. N'oublions pas non plus, comme nous l'apprend Columelle d'après un passage de Magon lui-même, que les Carthaginois faisaient un vin particulier, très doux et très sucré, qui pouvait constituer un produit tranchant sur la production courante et donc intéresser des consommateurs étrangers20. Enfin, un passage des Géoponiques - dont le compilateur a utilisé Diophane, l'abréviateur de Magon - apporte des révélations précieuses : on peut y lire en effet plusieurs notations sur la conservation du vin durant son transport par mer. Et, comme le note R. Martin, cela montre l'importance attachée par les Carthaginois aux problèmes de l'exportation21. Nous ajouterons simplement : aux problèmes de l'exportation du vin.
Mais était-ce bien la seule exportation possible? On notera par exemple qu'une amphore trouvée dans l'épave du Dramont, plus tardive il est vrai, mais d'un type très proche, contenait des olives22. L'huile pourrait constituer aussi cette matière précieuse et là encore, les quelques textes que l'on possède sur le traité de Magon nous montrent que l'oléiculture était au
19 Vie quotidienne à Carthage, Paris, 1958, p. 188 et n. 49, p. 266.
2" M. Sznycer, La littérature punique, dans Archéologie vivante, vol. 1, n° 2, Paris, 1969, p.. 148.
21 R. Martin, Recherches sur les agronomes latins et leurs conceptions économiques et sociales, Paris, 1971, p. 47, n. 2. Les Géoponiques sont un ouvrage du Xe siècle.
11 F. Benoît, op. cit., pi. 16,2 et 42,14.
ETUDES ET NOTES COMPLEMENTAIRES 337
centre des préoccupations carthaginoises23. D'ailleurs, ces amphores de forme Cintas 312-3 étaient-elles destinées à contenir toutes un même produit spécifique? On peut en douter lorsqu'on voit leur nombre tout à fait considérable dans les fouilles de Carthage-Byrsa par exemple. Dans la couche de destruction de 146 av. J.-C, ce type de jarres, très reconnaissable à sa panse cylindrique, son col resserré, son rebord évasé en collerette, voire à ses petites anses verticales, ce type de jarres apparaît en effet comme une des composantes caractéristiques du matériel. Dans ces conditions, cette jarre, élément indispensable de la vie quotidienne en Afrique punique, était à même de servir à plusieurs usages. Il est donc bien possible que les amphores de Magon l'exportateur aient contenu soit du vin soit de l'huile, soit encore les deux, productions florissantes à Carthage en
23 R. Martin, op. cit., p. 47 : sur vingt-cinq citations connues de Magon, douze ont trait à l'arboriculture fruitière et à la viticulture.
tout état de cause. Là encore, la découverte de cette marque sur un sol étranger pourra peut- être nous apporter quelques éclaircissements.
Magon, un ancien général (frère d'Hannibal, pourquoi pas?), qui, après avoir illustré un nom déjà célèbre sur divers rivages de la Méditerranée Occidentale, Magon donc, dans sa « retraite » active, n'aurait pas voulu que ce nom fût définitivement enterré. En vendant à l'étranger ses produits (vin et/ ou huile), Magon faisait encore connaître, sous un label gréco-punique, son nom dans un nouveau domaine, plus pacifique, mais qui ne devait pas moins témoigner, aux yeux de certains, d'un danger réel pour Rome. C'est là une vérité, vraie au moins symboliquement. Magon, un nom qui, militairement ou économiquement, faisait frémir des sénateurs comme Caton. Plus tard, en traduisant son œuvre, Rome allait définitivement récupérer cet adversaire, montrant ainsi une nouvelle fois sa capacité d'accueil . . . après avoir vaincu naturellement.
TABLE DES ILLUSTRATIONS
INTRODUCTION
Fig. Pag. 1 - Plan de situation des fouilles françaises à Carthage 6 2 - Mise en place du carroyage sur la pente sud et sud-ouest de la colline de Byrsa 7
PREMIÈRE PARTIE
HISTORIQUE DES RECHERCHES SUR LES NIVEAUX PUNIQUES
1 - Les fouilles de Beulé à Byrsa 15 2 - La nécropole de la pente sud-ouest (ass. S. Lancel) 16 3 - La nécropole de la pente sud-ouest (ass. H. Bénichou-Safar) 18 4 - Vue partielle, à la fin du XIXe siècle, des tombes des fouilles Delattre 20 5 - Vue partielle, en 1935, des tombes des fouilles Delattre 21 5 bis - Vue partielle, en 1975, des tombes des fouilles Delattre 22 6 - Plan des fouilles du P. Lapeyre 24 7 - Le secteur des fouilles Delattre et Lapeyre vers 1950 26 8 - Les fouilles Delattre, Lapeyre et Ferron- Pinard en 1960 27 9 - Coupe stratigraphique faite par Ch. Saumagne 28
10 - Tombes Saumagne au bas de la pente sud de Byrsa 29 1 1 - Plan des tombes du terrain Ploix 30 12 - Coupe sur les tombes du terrain Ploix 31 13 - Stratigraphie relevée par Ch. Saumagne sur le terrain Ploix 31 14 - Plan des fouilles du P. Ferron et de M. Pinard de 1952 à 1959 32 15 - Le secteur des fouilles Ferron-Pinard en 1960 34 16 - Plan partiel des fouilles de Ch. Saumagne sur le versant est 36 17 - Plan partiel de Ch. Saumagne (détail des fouilles du versant est) 37 18 - Les vestiges puniques de Byrsa : plan état 1974 37-38
HISTORIQUE DES RECHERCHES SUR LES NIVEAUX ROMAINS
1 - Situation des structures romaines sur la colline de Byrsa 43 2 - Emplacement présumé du temple à la Gens Augusta 45 3 - Vestiges des absides du soutènement sud 49 4 - L'intérieur du « quadrilatère » après les fouilles Delattre 50
340 BYRSA I
Fig. Pag. 5 - Le mur sud et les tombes puniques 51 6 - Coupes N-S et E-0 sur les fouilles Delattre 52 7 - Structures romaines de la zone sud de la plate-forme 53 8 - Le soubassement du dallage 53 9 - Vestiges situés à l'ouest du cardo maximus 54
DEUXIÈME PARTIE
LE SECTEUR A (1974-1975)
1 - Les trois secteurs de fouille : plan état 1975 60 2 - Le secteur A après la campagne de l'été 1975 61 3 - Vue du secteur A à l'automne 1973 62 4 - Vue du secteur A depuis le palier du decumanus I sud 62 5 - État des structures puniques avant la reprise de la fouille 63 6 - Vue du secteur A en juillet 1974 65 7 - Les sondages H II 13 et G II 16 65 8 - Sondage H II 13, coupe sur talus ouest 66 9 - Sondage H II 13, coupe sur talus sud 67
10 - Sondage H II 13, vue du talus sud 68 1 1 - Estampille sur anse d'amphore rhodienne 69 12 - Estampille sur bord externe d'amphore punique 69 13 - Sondage G II 16, coupe sur talus ouest 71 14 - Tête de figurine féminine en terre cuite 72 15 - Vue des talus est en G III 4 et G III 7 73 16 - Tronçon de la pseudo-enceinte punique 73 17 - Sondage H III 5, talus sud 74 18 - Sondage H III 15, talus nord : silo d'époque musulmane 75 19 - Fragment d'inscription latine 75 20 - Emplacement des sondages a, b, c et d 76 21 - Partie supérieure d'une amphore gréco-italique 76 22 - Citerne en G IV 3 77 23 - Plan des sondages a, b, c et d 78 24 - Mosaïque en opus tessellatum 79 25 - Sondage a sous le béton de pose de la mosaïque 79 26 - Sondage a : coupe sur talus est 79 27 - Matériel du sondage a : enclume en pierre 80 28 - Matériel du sondage a 80 29 - Matériel du sondage a 81 30 - Matériel du sondage a 81 3 1 - Vue du sondage b 82 32 - Coupe est-ouest du sondage b 82 33 - Débris d'opus signinum 83 34 - Matériel du sondage b; couche A. 106 83 35 - Matériel du sondage b; couche A. 106 83 36 - Matériel du sondage b; couche A. 106 84 37 - Matériel du sondage b; couche A. 106 84 38 - Matériel du sondage b; couche A. 106 85 39 - Matériel du sondage b; couche A. 106 85
TABLE DES ILLUSTRATIONS 341
Fig. Pag. 40 - Matériel du sondage b; couche A. 106 85 41 - Matériel du sondage b; couche A. 107 86 42 - Matériel du sondage b; couche A. 107 86 42 bis - Coupe sud-nord des sondages d et c 87 43 - Sondage c, coupe nord-ouest - sud-est 88 44 - Vue du sondage c 89 45 - Autel brûle-parfums en terre cuite 89 46 - Sondage c; matériel de la couche 1 (A. 108) et 2 (A. 109) 89 47 - Sondage c; matériel de la couche 3 (A. 1 10) 90 48 - Sondage c; matériel de la couche 3 (A. 1 10 bis) 90 49 - Mosaïque en opus figlinum 91 50 - Sondage d, vue du talus nord-ouest 91 51 - Sondage d, coupe du talus nord-ouest 91 52 - Fragment d'opus signinum 92 53 - Matériel du sondage d, couche 1 (A. 1 1 1) 92 54 - Sondage d, couche 3a, lampe grecque 93 55 - Sondage d, couche 3b, petite enclume en pierre 93 56 - Sondage d, couche 3b, patere punique 93
LE SECTEUR B (1974-1975)
1 - Plan des fouilles Lapeyre 98 2 - La partie sud du secteur B, vue du Secteur A 99 3 - Relevé des fouilles 1974-1975 dans le secteur B 99-100 4 - Implantation des sondages 1974-1975 dans le secteur B 99-100 5 - La « butte Lapeyre », vue d'ensemble 101 6 - « Butte Lapeyre » : structures tardives 102 7 - Coupe sur le flanc est de la « butte Lapeyre » 103 8 - Flanc est de la « butte Lapeyre » : la stratigraphie 105 9 - Coupe perpendiculaire au mur D 108
10 - Coupe au nord du mur D 109 1 1 - Plan du sondage 9 111 12 - La face sud du mur D 111 13 - Le mur D sous les fondations du monument basilical 112 14 - Intersection du mur punique M et du mur D 113 15 - Élévation de la face est du mur punique M 1 14 16 - Le mur punique M, tronçon sud 115 17 - L'édifice effondré, vu du nord 116 18 - L'édifice effondré, colonne lisse et colonne stuquée 116 19 - L'édifice effondré, éléments d'architecture 117 20 - L'édifice effondré, coupe sur le côté nord du sondage 11 118 21a - L'édifice effondré : coupe sur les blocs 120 21b - Croquis de situation de la coupe sur les blocs 121 22 - La citerne J, plan 123 23 - La citerne J : extrémité ouest 124 24 - La citerne J : extrémité est 124 25 - La citerne J : coupe 125 26 - Reconnaissance topographique dans la partie nord du secteur 128 27 - La partie nord du secteur B 129
342 BYRSA I
Fig. Pag. 28 - Restitution hypothétique de nouvelles insulae puniques 131 29 - Les terrassements romains sur le flanc sud de Byrsa 134 30 - Un arc du mur C 135 31 - Disque à relief en terre cuite 137 32a - Cruche punique 137 32b - Cruche punique 137 33 - Céramique punique à décor incisé 137 34 - Céramique punique à décor peint 137 35 - Vase miniature 137 36 - Amphore punique 138 37 - Estampille d'amphore punique 138 38 - Médaillon d'applique 138 39 - Guttus 138 40 - Statuette d'Artémis 138 41 - Tête de statuette en terre cuite 138 42 - Céramique West Slope 140 43 - Poignée de couvercle de lékané 140 44a - Lampe grecque 140 44b - Lampe grecque 140 44c - Lampe grecque 140 45 - Amphore gréco-italique 140 46a - Timbre d'amphore 141 46b - Timbre d'amphore 141 46c - Timbre d'amphore 141 46d - Timbre d'amphore 141 46e - Timbre d'amphore 141 47 - Fragment de baignoire 141 48a - Réchaud en pierre 141 48b - Réchaud en pierre 141
LE «CARDO MAXIMUS» ET LES ÉDIFICES À L'EST DE LA VOIE (1974-1976)
1 - Plan 144-145 2 - Limite des fouilles antérieures 145 3 - Le trottoir est, les dalles E et la canalisation, du temple 146 4 - La canalisation secondaire ouest 147 5 - La canalisation nord à son arrivée dans l'égout 147 6 - Le cardo maximus 148 7 - Profil d'une base du portique 149 8 - Fondation d'une base du portique et degrés de l'escalier 150 9 - Extrémité nord de la canalisation du temple 151
10 - Les degrés de l'escalier, une base du portique et le mur tardif 152 1 1 - Emplacement des sondages 153 12 - Mur tardif 154 13 - Base du portique et mur tardif 155 14 - Aire A, coupe a-b 155 15 - Aire C, coupe transversale sur le cardo c-d 157 16 - Aire C, zone F, coupe e-f 158 17 - Fondations des degrés de l'escalier 158
TABLE DES ILLUSTRATIONS 343
Fig. Pag. 18 - Zone F, pavement tardif du chemin de Douar-Chott (?) 158 19 - Limite est des fouilles 159 20 - Cardo, partie nord de la zone fouillée 159 21 - Sondage dans les fondations du cardo g-h 160 22 - Coupe transversale sur le cardo I-J 161 23 - Coupe transversale sur le cardo, K-L 161 24 - Coupe longitudinale sur le cardo 163 25 - L'édifice formant l'angle du cardo maximus et du decumanus I 164 26 - Vestiges de la face ouest 165 27 - Vestiges du mur réticulé nord 165 28 - Comblement du bassin nord-est, vu de l'ouest 166 29 - Le bassin nord-est, vu de l'est 166 30 - Le mur tardif, vu de l'est 167 31 - Abside du soutènement ouest, vue de l'ouest 167 32 - Fragment du mur de la première abside ouest 168 33 - Blocs de fondation du mur nord de la première abside ouest 168 34 - Essai de restitution des absides de soutènement ouest et sud 168-169 35 - Dalles du cardo maximus 169 36 - Mur à deux courbures établi sur la fondation de l'abside 169 37 - Vestiges d'une chambre funéraire punique 172 1, 2, 3, 4 - Fragments d'architecture 177 5, 6, 7 - Fragments d'architecture 178 8, 9, 10 - Fragments d'architecture 179 11,12 - Fragments d'architecture 180 13 - Le portique des Petronii à Thuburbo Maius 181 14 - Chapiteau du Musée de Carthage 181 15 - Chapiteau du théâtre de Carthage 181 16, 17 - Corniche du théâtre de Carthage 182
TROISIÈME PARTIE
LES NIVEAUX PUNIQUES 1976
1 - Plan du secteur après la campagne de 1976 186-187 2 - Plan schématique du quartier de maisons puniques après la campagne 1976 188 3 - Plan partiel au l/50e du secteur G IV 1-2 189 4 - Coupe de la rue I 190 5 - Alignement d'amphores dans la rue I 190 6 - Alignement d'amphores dans la rue I 190 7 - Plan partiel au l/50e du secteur F IV 7-8 192 8 - La tombe A. 128 en F IV 7 193 9 - Amphore punique de la- tombe A. 128 193
10 - Plan partiel au l/50e du secteur G III 7-1 1 194 1 1 - Le petit côté sud-ouest de l'îlot C, vu de la rue II 195 12 - Fouille de l'angle sud de l'îlot C 196 13 - Chapiteau dorique en grès stuqué 197 14 - Le « mur Lapeyre » en H III 2 et 3 198 15 - Plan partiel, au 1/100«, du secteur H III 2, H III 5 199 16 - Coupe au 1/ 100e sur les niveaux puniques entre H III 2 et H III 13 200 17 - Le sondage profond en H III 5 201
344 BYRSA I
Fig. Pag. 18 - Le sondage profond en H III 5; le mur a et la stratigraphie 201 19 - Le sondage profond en H III 5; le «mur Lapeyre» et les structures puniques 202 20 - Lithostroton punique 202 21 - Mortier-écuelle en pierre calcaire 202 22 - Mortier-écuelle en pierre calcaire 202 23 - Décor d'applique d'un gros vaisseau 203 24 - Fond de vase de profil tronconique 203 25 - Pied de coupe 203 26 - Balsamaire, peson et balles de fronde 203 27 - Matériel de la couche A. 147 204 28 - Matériel de la couche A. 147 204 29 - Le mur a flanqué vers la rue par le solin s 205 30 - Matériel A. 148 de la citerne El 205 31 - Matériel A. 148 de la citerne El 206 32 - Matériel A. 148 de la citerne El 206 33 - Objets miniaturisés de la citerne El 207 34 - Amphorisque 207 35 - Brasero miniature 207 36 - Matériel A. 148 de la citerne El 208 37 - Balsamaire fusiforme 208 38 - Matériel A. 148 de la citerne El 209 39 - Matériel A. 148 de la citerne El 209 40 - Pesons de terre cuite 210 41 - Arula (?) en pierre 210 42 - Chevilles en bronze 210 43 - Objets en os 210 44 - Plan partiel au l/50e du secteur G II 9/13 211 45 - Secteur G II 9/13, coupes est-ouest 212 46 - Secteur G II 9/13, coupe nord-sud 212 47 - Le palier supérieur 212 48 - Le niveau inférieur; pièces Β et C 213 49 - Plan de pose de brasero, face interne 213 50 - Terre cuite figurée 214 5 1 - Fragment de terre cuite figurée 214 52 - Matériel A. 150 214 53 - Estampille sur anse d'amphore rhodienne 215 54 - Couvercle d'amphore 215 55 - Matériel A. 150 215 56 - Matériel A. 150 216 57 - Matériel A. 150 216 58 - Matériel A. 150 216 59 - Matériel A. 150 217 60 - Matériel A. 150 218 61 - Matériel A. 150 218 62 - Matériel A. 150 219 63 - Matériel A. 150 219 64 - Elément d'un kernos 220 65 - Balsamaire fusiforme 220 66 - Partie supérieure et rebord d'une tabouna en terre cuite 221 67 - Masse en plomb 221
TABLE DES ILLUSTRATIONS 345
Fig. Pag. 68 - Matériel A. 151 222 69 - Matériel A. 151 222 70 - Matériel A. 151 222 71 - Matériel A. 151 223 72 - Matériel A. 151 223 73 - Matériel A. 151 224 74 - Perles en pâte de verre 224 75 - Enclume en pierre calcaire 224 76 - Objets en fer 225 77 - Objets en fer 225 78 - Objets en fer 225 79 - La partie nord-est de l'îlot C 226 80 - Plan partiel au l/50e du secteur H IV 227 81 - Le couloir au caniveau et la nouvelle unité d'habitation 229 82 - Le couloir au caniveau et la pièce a 230 83 - Le couloir au caniveau; détail de l'enduit 230 84 - La cour H; margelle et seuil de la pièce d'apparat 231 85 - La colonne stuquée in situ 233 86 - Passage : poutre carbonisée 234 87 - Pièce Β : détail du mur B' et du pavement 234 88 - Pièce γ : le mur B' et la cloison perpendiculaire 235 89 - Fragment de céramique attique à figures rouges 236 90 - Timbres d'amphores 236 91 - Timbre d'amphore rhodienne 236 92 - Timbre d'amphore rhodienne 237 93 - Fragment de « sombrero de copa » 237 94 - Graffito sur fond externe de patere à vernis noir 237 95 - Fragment de timbre amphorique punique 238 96 - Fragment de mortier en calcaire 238 97 - Lame de couteau en fer 238 98 - Objet en fer 239 99 - Clef en fer 239 100 - Détail du haut du mur en H IV 5 239 101 - H IV 5 : cavité d'encastrement dans le mur 240 102 - Départ du pavement de l'étage sur le même mur 240 103 - Niveaux d'atelier en G IV 2 242 104 - Amphores PI et P2 dans la couche d'atelier '. . . . 243 105 - Détail de l'amphore PI et de la réserve d'argile A 243 106 - L'amphore P4 243 107 - Tuyères en terre cuite 244 108 - La tuyère A.312.1 245 109 - Schéma de fonctionnement d'un four 245 1 10 - Fragments de tahounas ou de fours 246 1 1 1 - Coupe sur les niveaux d'atelier 247 1 12 - Matériel de la couche d'atelier 248 1 13 - Matériel de la couche d'atelier 249 114 - Le «mur Lapeyre» au niveau des fondations de l'angle ouest de l'îlot C 249 1 15 - Sous le niveau d'atelier, restes osseux d'une tombe antérieure 249 116 - La calotte crânienne du niveau funéraire 249 1 17 - Coupe stratigraphique perpendiculaire au mur a de l'îlot B 250
346 BYRSA I
Fig. Pag. 118 - Plan partiel au l/5Oe du secteur F II 15 - F III 3 251 1 19 - Coupe perpendiculaire au mur a de l'îlot Β 252 120 - Matériel des couches de la coupe stratigraphique 252 121 - Matériel des couches de la coupe stratigraphique 253 122 - Approfondissement de la coupe stratigraphique 253 123 - Matériel de la couche 7 254 124 - Égout fait de panses d'amphores dans l'axe de la rue 254 125 - Estampille d'amphore rhodienne dans la fosse de fondation du mur a 255 126 - La fosse de la tombe A.136 avant la fouille 255 127 - La fosse de la tombe A.136 après la fouille 256 128 - Les deux tombes avant dépose des dalles de couverture 256 129 - L'inhumation A.136 257 130 - Crâne de l'inhumation A.136 258 131 - Les deux inhumations et le mobilier funéraire en place 258 132 - Le mobilier funéraire céramique de la tombe A.136 259 133 - Œnochoé A.136.1 (dessin) 260 134 - Œnochoé A.136.1 (cliché) 260 135 - Aryballe A. 136.2 (dessin) 261 136 - Aryballe A. 136.2 (cliché) 261 137 - Œnochoé A.136.3 261 138 - Œnochoé A.136.3 261 139 - Kotyle A.136.4 (dessin) 262 140 - Kotyle A.136.4 (cliché) 262 141 - Vase A.136.5 (dessin) 262 142 - Vase A.136.5 (cliché) 262 143 - Vases A.136.6 et 7 263 144 - Vase A.136.7 (cliché) 263 145 - Objet A.136.9 264 146 - Objet A.136.10 264 147 - Scarabée A.136.8 264 148 - Inhumation A.136 bis 264 149 - L'inhumation A.136 bis après dépose des ossements 265 150 - Mobilier de la tombe A.136 bis 265 151 - Mobilier de la tombe A.136 bis 265 152 - Mobilier de la tombe A.136 bis 266 153 - Plan de situation des niveaux puniques sous-jacents aux niveaux d'habitat dans le
secteur A, état 1976 267
LES NIVEAUX ROMAINS 1976
1 - Plan de situation des absides de Beulé et des colonnes du portique est 274 2 - La base nord-est 275 3 - La base sud-ouest 275 4a - Profil de la base nord-est 275 4b - Profil de la base sud-ouest 275 5 - Le lit d'attente de l'assise de réglage de la base n° 3 276 6 - Chapiteau du portique est 276 7 - Fragment d'une corniche monumentale 277
TABLE DES ILLUSTRATIONS 347
Fig. Pag. 8 - Fragment de la même corniche 277 9 - Les trois assises de la plate-forme de H IV 278
10 - La seconde assise en 1957 279 1 1 - État actuel de la première assise 280 12 - État actuel de la première assise (partie ouest) 280
QUATRIÈME PARTIE
ÉTUDES ET NOTES COMPLÉMENTAIRES LE MÉTROÔN DE CARTHAGE ET SES ABORDS
1 - Ensemble des vestiges découverts sur le flanc est de Byrsa 306 2 - Vestiges situés au nord du decumanus maximus 307 3 - Plan et coupe nord-sud du mur de soutènement coupant le cardo V devant la maison
d'Attis 308 4 - Édifice situé entre les cardines IV et V est, au sud du decumanus maximus 309 5 - Édicule punique en arrière du mur de soutènement 310
UN BRÛLE-PARFUMS TROUVÉ À CARTHAGE
1 - Brûle-parfums de Byrsa 312 2 - Brûle-parfums de Byrsa : plaque publiée par le P. Ferron 312 3 - Brûle-parfums de Byrsa 312 4 - Brûle-parfums de Byrsa 312 5 - Brûle-parfums de Byrsa vu de dessous 313 6 - Brûle-parfums de Toukh el Garmous 314 7 - Brûle-parfums de Toukh el Garmous 315 8 - Brûle-parfums de Tarente 316 9 - Brûle-parfums du Musée du Caire 317
10 - Brûle-parfums d'Olbia 318 1 1 - Brûle-parfums sur des stèles de Carthage 319 12 - Vase rituel, capsa et candélabre-caducée 320 13 - Brûle-parfums de Salammbô 322 14a - Stèle punique avec sphinx 322 14b - Pied du brûle-parfums de Byrsa 323 14c - Pied du brûle-parfums de Salammbô 323 15 - Support de cratère en bronze du Musée de Naples 324 16 - Support de cratère de Gnathia 324 17 - Support de vase de Calés ' 325 18 - Support métallique du Musée d'Istanbul 325 19 - Support de vases provenant de Byrsa 325
UNE MARQUE AMPHORIQUE AU NOM DE MAGON, EN GREC
1 - Timbre amphorique au nom de Magon, en grec 334
TABLE DES MATIÈRES
Pag. Avant-propos, par A. Beschaouch et G. Vallet 3 Introduction, par S. Lancel 5 Avertissement 9
PREMIÈRE PARTIE
UN SIÈCLE DE FOUILLES SUR LA COLLINE DE BYRSA. HISTORIQUE DES RECHERCHES
Les niveaux et vestiges puniques de la colline de Byrsa. Historique des recherches, par S. Lancel 13
Le plateau et les pentes sud et sud-ouest 14 Les fouilles de Beulé 14 Les fouilles du P. Delattre 17 Les fouilles du P. Lapeyre 25 Les fouilles de Ch. Saumagne 28 Les fouilles de C. Picard, P. J. Ferron et M. Pinard 31
Le versant est et les fouilles de Ch. Saumagne 35 Conclusions et bilan 38 Les structures romaines de Byrsa. Historique des recherches, par J. Deneauve 41
Le versant est 42 Le versant nord 46 Le versant ouest 47 Le versant sud 48
DEUXIÈME PARTIE
LE SECTEUR A (1974-1975), LE SECTEUR Β (1974-1975) LE CARDO MAXI MO S ET LES ÉDIFICES À L'EST DE LA VOIE (1974-1976)
Le secteur A (1974-1975), par S. Lancel 59 État du secteur en 1974 59 Les travaux de 1974 et 1975 64
Sondages stratigraphiques dans les parties hautes 64
350 BYRSA I
Pag. Sondages au niveau bas 76 Sondage a 77 Sondage b 81 Sondage c 87 Sondage d 90
Conclusions 94 Le secteur Β (1974-1975), par J.-M. Carrié et N. Sanviti 97 Présentation topographique 97 Les niveaux tardifs 100 Le terrassement augustéen 101 Le mur D 106 Les niveaux puniques 113
Le mur punique m 113 L'édifice effondré 115 La citerne punique 122
Reconnaissance topographique au nord du secteur 127 Hypothèses et perspectives 130 Le matériel 136 Conclusion 142 Le cardo maximus et les édifices à l'est de la voie, par J. Deneauve et F. Villedieu 143 Le cardo maximus 144
Les fouilles de 1975 144 Déroulement de la fouille 152 Conclusions à l'étude du matériel 160
L'édifice situé à l'angle du cardo maximus et du decumanus I sud 164 Le soutènement ouest 167 Le temple prostyle 168 Vestiges situés au nord du temple prostyle 172 Les fragments d'architecture 173
TROISIÈME PARTIE
LES NIVEAUX PUNIQUES ET ROMAINS 1976
Avertissement 185 Rapport préliminaire sur la campagne de 1976 (niveaux puniques), par S. Lancel et J.-P. Thuillier. 187 Recherches sur les niveaux d'habitat 187
Les niveaux des rues I et II et l'angle ouest de l'îlot C 187 L'angle sud de l'îlot C 193 Sondages profonds en H III 2 et H III 5 195 Fouille en F II 16-G II 9 210 Le secteur nord-est de l'îlot C 225
La maison à la colonne stuquée 228 La nouvelle unité d'habitation 232 Le matériel 235
TABLE DES MATIERES 351
Pag. Recherches sur les niveaux puniques antérieurs aux niveaux d'habitat 241
Fouille à l'angle ouest de l'îlot C 241 Fouille à l'angle sud de l'îlot Β 248
Niveaux de rue 249 Niveaux funéraires profonds 255
Conclusions : bilan et perspectives 268 Rapport préliminaire sur la campagne de l'automne 1976 (niveaux romains), par P. Gros 271 Le portique à l'ouest des absides de Beulé 271 La plate-forme de fondations en H IV 278
QUATRIÈME PARTIE
ÉTUDES ET NOTES COMPLÉMENTAIRES
Le Métroôn de Carthage et ses abords, par f Ch. Saumagne 283 Le Métroôn 283 Les rues et les insulae 292 Les murs de soutènement 294 Les édifices voisins du Métroôn 295 Vestiges puniques et pré-juliens 300 Conclusions 302 Inventaire succinct des objets et fragments 303
Un brûle-parfums trouvé à Carthage, par J.-M. Carrié 311 Contexte archéologique 311 Forme, technique, matière 313 Typologie formelle 314 Situation chronologique 32 1 Brûle-parfums de Salammbô . . . * 321 Brûle-parfums et supports de vases 323 Le décor 327 Conclusion 330
Une marque amphorique au nom de Magon, en grec, par J.-P. Thuillier 333
Table des illustrations 339
Table des matières 349