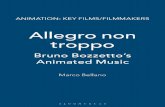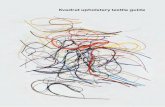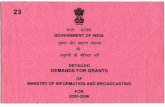Bruno Serralongue : Ar(t)chéologue de la présence
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Bruno Serralongue : Ar(t)chéologue de la présence
Bruno Serralongue, ar(t)chéologue dela présence
Bruno Serralongue est un artiste contemporain et,s’il utilise la photographie pour créer son œuvre, c’estparce qu’il estime que cette technique est la pluspertinente pour pratiquer son art. D’un point de vuetechnique, ce photographe n’est pas à proprement parlerun révolutionnaire puisqu’il utilise comme appareils, enfonction des circonstances et de ses intentions, soit unechambre photographique Linhof Master Technika pour films 10 x12 cm, soit une chambre Sinar P2 pour films 10 x 12 et 20 x25 cm. Ce ne serait pas un simple cliché d’affirmer queces appareils sont l’essence même de la photographie. Unechambre est un instrument plutôt volumineux, constituéd’une optique pour composer l’image, d’un châssis pourl’enregistrer et d’un soufflet entre les deux.L’ensemble, souvent, est relié par un rail. Un verredépoli permet de cadrer et de faire la mise au point. Par l’utilisation intentionnelle de ces chambres,Bruno Serralongue s’inscrit dans une filiationrevendiquée qui renoue avec les pionniers de laphotographie. La pratique qu’impose ces chambresphotographiques est désormais ancestrale, elle demandeune maîtrise de l’outil aussi délicate qu’exigeante :pour la réalisation d’une seule photographie, il estnécessaire d’installer un trépied, de fixer sur son soclela chambre, de la recouvrir d’un voile opaque, rideauoccultant. Une fois l’œil fixé sur le dépoli, lesréglages pour la photographie à venir commencent : c’està la fois un travail de technicien et de représentationmentale puisque ce qui est vu sur le verre est une imagerectangulaire et inversée de la réalité visée. La mainguidée par l’œil doit alors déplacer un cadre dans cetteimage, ce cadrage s’effectue sans zoom, en fonction d’unobjectif large qui requiert un temps d’exposition long.Cela ne signifie pas pour autant que la mise en œuvresoit lente, au contraire, une certaine rapidité estrequise, ce qui demande un savoir-faire empirique pourpouvoir obtenir une photographie identique à celle que
1
l’on se représente avant même les réglages nécessaires.L’intérêt qu’offre une chambre photographique par rapportaux appareils traditionnels est une maîtrise de lanetteté des différents plans de l’image et l’obtention dela perspective souhaitée selon le point de vue désiré.Grâce à ces deux caractéristiques permises uniquement parces chambres, l’artiste devient comme le metteur en scènede son propre travail. Tout ce protocole technique complexe et exigeantm’évoque la métaphore stoïcienne du tireur à l’arc. Avantde lâcher la corde qui retient sa flèche, le tireuraguerri doit s’être enquis que tout ce qui dépend de luiest maîtrisé (non seulement sa technique mais aussi laqualité du bois de son arc et de sa flèche, l’élasticitéde sa corde etc.). Les paramètres qui procèdent à laréussite de son tir sont si nombreux qu’il se doit den’en oublier aucun, mais, une fois la flèche lancée, satrajectoire et le point de la cible qu’elle atteindra nedépendent plus du tireur. Ce dernier n’a donc pas às’irriter des possibles aléas qui peuvent venir troublerla trajectoire voulue. Il en va de même pour la chambrephotographique : dès lors que l’artiste a vérifié quetoutes les conditions qui dépendent de sa maîtrisetechnique sont assurées, l’image qui se révèlera sur lepapier ne dépendra plus de lui. Dans ces conditions où les contingences techniquesdéterminent la qualité des images, il appert que lesintentions artistiques de Bruno Serralongue ne sauraientporter sur l’instantanéité, sur la recherche de lacaptation d’un mouvement, d’un geste fugaces etéphémères, sur la fixation d’un instant fécond. Alorsquoi ? Que captent les images artistiques de cet artisteet à quelles intentions répondent-elles ? Pourquoi cettetechnique photographique, à la fois précise etcontraignante, est-elle la mieux à même pour la pratiquede son art ? En quoi consiste cet art sériel qui tient –selon mon hypothèse – d’une archéologie de la présence ?
2
D’un dispositif artistique pour manifester une présence
Le dispositif/la série
Ma méthode consiste à partir des informations publiéeset diffusées dans les journaux – qu’ils soient papiers,Internet, télévisés et radiophoniques. On pourraitfaire une analogie avec les agences de presse, du typeAFP (Agence France Presse), qui réceptionnent etdiffusent au quotidien des informations à l’attentiondes rédactions. Mon AFP à moi, ce sont tous lesjournaux accessibles par un lecteur/spectateur. Je n’aidonc pas accès aux informations brutes – les dépêches –mais à une information triée et sélectionnée par lesrédactions. J’effectue à mon tour une sélection et, siune information se réfère à un événement – quelle quesoit sa localisation géographique – qui va se dérouleret qui m’intéresse, je cherche à m’y rendre par mespropres moyens pour y réaliser des photographies1.
Bruno Serralongue est un curieux des événements qui
apparaissent dans le monde mais un curieux insatisfait etce, pour plusieurs raisons. L’une d’entre elles est queles informations qu’il récolte par les médias sonttoujours déjà triées, sélectionnées par les journalistesdes rédactions. C’est moins la nécessité du tri qui estinsatisfaisante que ses conséquences : sans doute cetartiste soupçonne-t-il qu’il peut rater un événementparce qu’il n’a pas été sélectionné. Une autreconséquence possible est que l’événement soit traité encatimini -- en fin de journal, en quelques secondes ouquelques lignes -- sa place médiatique n’étant pasnécessairement proportionnelle à son importance. Enoutre, si Bruno Serralongue se rend, par ses propresmoyens, sur le lieu d’un événement qui l’intéresse, sonintention n’est pas de vérifier si ce dernier estconvenablement traité par les médias. Sa curiosité n’estpas naïveté car il sait qu’un événement n’est pas un
1 Bruno Serralongue, Catalogue pour l’exposition au musée du Jeu de Paume, Feux de camp, Paris, 2010, éd. Jeu de Paume, p. 139.
3
« objet » médiatique, qu’une véritable objectivité est detoute manière impossible, que ce soit dans le monde del’information ou dans le domaine de l’histoire car cesont toujours des sujets pensants qui traitent unévénement ; aussi est-ce en toute subjectivité qu’il serend là où l’événement se déroule. Mais pourquoi s’yrend-il ? Je pense que l’insatisfaction de sa curiosité apour origine une absence, sa propre absence vis-à-vis del’événement si précisément il ne se déplace pas là où ila lieu, non pas pour y participer, mais pour l’observer.Son éventuelle absence signerait son incapacité à sereprésenter l’événement par et pour lui-même, sans lamédiation d’un traitement médiatique. Cette aversionenvers l’absence est peut-être de l’ordre de lafrustration mais elle révèle en filigrane la volonté de« faire présence ». Dans le Vocabulaire technique et critique de laphilosophie de Lalande, Louis Lavelle dans une notice dédiéeà la notion de présence remarque que
Le mot présence pourrait être mis en parallèle avec lemot absence. Nous parlons de présence de l’objet(révélée par la perception), que nous opposons à sonabsence, bien que cette absence elle-même ne puisseêtre connue que par une autre présence, qui est cellede son image. Mais alors il y a une présence quienveloppe tous les objets possibles de la pensée ; etle temps, au lieu d’être une conversion de l’absence enprésence et de la présence en absence, est plutôt laconversion d’une des formes de présence en une autre2.
La curiosité de Bruno Serralongue qui le pousse à serendre présent sur le lieu d’un événement comble nonseulement son absence et celle-ci sera d’autant pluscomblée que les images prises en ce lieu manifesteront la« présence de l’événement ». Par cette dernièreexpression, j’entends ce qui donne et confère uneprésence à un événement, c’est-à-dire de quoi est faîtela présence d’un événement pour qu’il prenne place,
2 Louis Lavelle, in Vocabulaire technique et critique de la philosophie d’André Lalande, Paris, éd. P.U.F., coll. Quadrige, vol. 2, 1991, p. 818. C’est moi qui souligne.
4
s’affirme comme tel dans le monde. Ces images qui sontdestinées à être exposées à un public – présent dans lagalerie ou le musée mais absent lors de l’événement –présentent des séries. A chaque événement, sa séried’images. L’artiste réalise une à deux séries par an, lenombre d’images par série variant d’une dizaine à unecinquantaine. En fonction de la durée de l’événement,certaines séries sont achevées, d’autres sont encore encours. Quels sont les événements dont chaque série témoigneet restitue quelque chose de leur présence ? Cela peutêtre la manifestation des sans-papiers qui s’est tenuechaque Samedi, durant deux années, sur la place duChâtelet à Paris. Cela peut être aussi ce que leursorganisateurs nomment des sommets internationaux, commecelui de La Terre à Joannesbourg en 2002 ou encore celui dela Société de l’Information qui s’est tenu successivement àGenève en 2003 puis à Tunis en 2005 sous l’égide de l’ex-président Ben-Ali. L’événement à restituer en saprésence, c’est également le Forum mondial social de Mumbaien Inde, qui, selon José Bové a offert, en cette année2004, « une tribune à des gens dont certains ne s’étaientjamais exprimés de façon aussi visible3. » D’autresévénements à portée mondiale ont donné lieu à desséries : ainsi la Otra, la première campagne politiqueouverte au public organisée dans tout le Mexique par lesous-commandant Marcos en 2006 ; mais aussi Tibet in exile,session de la 14e Assemblée de la diaspora des députéstibétains ; Rise up, Resist, Return, manifestations organiséestout au long du parcours de la flamme olympique (de laGrèce à la Chine) afin de protester contre l’invasionchinoise au Tibet ; ou encore la (re)naissance du Kosovo,cette série, d’ailleurs, est toujours en cours, ellecommence avec les cérémonies festives lors descélébrations du premier anniversaire de la naissance decette nouvelle république. Enfin, Bruno Serralongue serend présent sur des événements dont la portée mondialeest moindre mais dont l’intensité est tout aussi digned’intérêt, telle la série Calais consacrée aux réfugiés danset autour du centre de Sangatte ; ou encore la série
3 Bruno Serralongue, Catalogue pour l’exposition du Jeu de Paume. Op. cit.5
intitulée New Fabris du nom de l’usine de Châtellerault,occupée par ses ouvriers en grève qui menacèrent de faireexploser les locaux si leurs revendications n’étaient pasentendues. Si cette liste est loin d’être exhaustive,elle montre néanmoins la nature des événements quiintéressent cet artiste.
Justification du dispositif
Le dispositif inventé par Bruno Serralongue, toujoursle même, se justifie par un constat : si, comme le jargonjournalistique le dit, les médias couvrent l’événement àforce d’images fixes ou en mouvement, ce sont ces mêmesimages qui le recouvrent puisque leurs spectateursarrivent, au final, à oublier l’événement une fois qu’ilest traité. Comment cela est-il possible ? Comment unsommet mondial, par exemple, se retrouve finalement voilépar les images médiatiques qui le couvrent ? Un élément de réponse à ces interrogations peut êtreproduit à partir des analyses que fait Michel Foucaultsur les notions de continuité et de discontinuité enhistoire. On sait que la thèse générale qui animeL’Archéologie du savoir est que chaque époque produit undiscours dominant censé dire la vérité sur le monde etque ce discours, en réalité, impose ses normes. L’un desdiscours dominant majeurs est celui des informations« données » par les médias appartenant à des industriesculturelles et leurs discours sont dominateurs parce queleurs images s’inscrivent toujours dans une continuité,celle du flux ininterrompu des informations. Lesphotographies ou reportages montrés par les médiasrestituent bien une certaine idée de l’événement traité ;certes ce sont des images toujours orchestrées selon unpoint de vue et un montage déterminés qui font qu’ellessont pauvres en objectivité mais si, au final, lors deleurs réceptions par le public, l’événement est voilévoire dénaturé, la raison majeure est autre : l’événementne peut être restitué en sa présence pour une question detemps et cette imposition temporelle se manifeste selondeux aspects complémentaires. Si le temps consacré àcouvrir et à « restituer » l’événement est souventproportionnel à son importance décidée par les
6
rédactions, ce temps est néanmoins nécessairement compté,limité. Le monde médiatique ne peut se permettre detraiter un événement sur une longue durée, de le suivre,de pénétrer en son processus au cours duquel il s’affirmecomme tel. Le traitement médiatique exige qu’uneinformation soit restreinte à des images explicitementsignifiantes, traitées dans une courte durée. Le secondaspect est le complément du premier : si la duréemédiatique d’un événement est brève c’est parce que lesrègles qui régissent le monde de l’information imposentqu’un événement en chasse un autre, avec si possible desdifférences de nature entre deux sujets traités afin quele public – supposé impatient – ne se lasse pas de cetteactualité, afin qu’il se fasse une représentation globaledes actualités comme un flux diversifié mais continud’informations. Cependant, en inscrivant les images d’un événementdans une continuité informative, les médias sacrifient cequi fait présence dans l’événement, ce qui le rendirréductible à un autre. Au contraire, les sériesd’images de Bruno Serralongue instaurent unediscontinuité dans cette continuité entretenue par lesmédias. En ce sens, ce travail répond à un impératifénoncé par Foucault : « il faut renoncer à tous cesthèmes qui ont pour fonction de garantir l’infiniecontinuité du discours et sa secrète présence à soi dansle jeu d’une absence toujours reconduite4. » En d’autrestermes, lorsque les industries médiatiques martèlent àleur public, par l’orchestration et l’agencement de leursinformations, que l’histoire du monde ne s’arrête jamais,qu’elle n’est qu’un discours continu scandé par desinflexions événementielles, cette prétendue continuité del’histoire du monde n’est qu’une illusion qui repose surl’idée d’une présence secrète – heureusement révélée parles médias – de cette histoire qui ne saurait être quecontinue. Cependant, constate Foucault, la présence mêmede cette continuité dans le discours des événements ne sedonne jamais à son public dans la mesure où la réalité decette présence est faite d’une absence toujours
4 Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, éd. Gallimard, coll. nrf, 1969, p. 37
7
reconduite, présence factice qui ne peut se manifesterpour la simple raison que cette continuité est absentedans le monde. D’un événement à l’autre, il y a certes letemps qui passe mais tout se passe comme si dansl’univers des informations, ce simple enchaînementtemporel suffisait à ordonner l’ordre des événements. Cequi donne une présence au monde à un événement n’est doncpas à chercher dans les images médiatiques qui,constamment, s’inscrivent dans cette prétendue continuitédu flux des informations. En proposant des sériesautonomes, ayant leur durée respective – celle que prendchaque regardeur pour voir, contempler une série dans sonensemble – le travail de Bruno Serralongue débarrassel’esprit du regardeur de ces formules lancinantes maisillusoires, ces formules qui nous trottent dans la têtedès que nous ouvrons notre téléviseur ou ordinateur :« quoi de neuf aujourd’hui ? Comment l’histoire du mondecontinue-t-elle ? Qu’ai-je manqué ? » Les séries de BrunoSerralongue, en instaurant et assumant une discontinuitédans le flux des images médiatiques, nous montrent que laprésence de l’événement se situe ailleurs que dans ceflux, qu’elle réside au cœur du monde réel et qu’ellen’est pas faîte que d’événementiel. Dès lors, ledispositif imaginé par cet artiste apparaît comme unevéritable méthodologie de dévoilement de cette présence.
Finalité du dispositif Ce dispositif qui consiste pour l’artiste à se rendreprésent sur un événement « couvert » par les médiasdévoile deux finalités, intriquées l’une dans l’autre, ouplus précisément une même finalité qui se déploie suivantdeux modalités : esthétique pour l’une, ontologique pourl’autre. Aussi, est-ce par l’expression « esthétique dela présence » que je nommerai cette finalité duale. C’estici qu’il faut souligner que Bruno Serralongue n’est pasun photographe de presse mais bien un artiste et quec’est dans des lieux dédiés aux arts que ses séries sontexposées. Mais où situer la dimension esthétique de sontravail ? L’artiste précise souvent que la valeur de sesphotographies ne réside pas dans une seule image. Il estcertes possible d’isoler telle ou telle image pour sa
8
valeur esthétique – comme, par exemple, le portrait d’unfan de Johnny Halliday dans les rues de Las Vegas –photographie qui évoque d’autres portraits, tels ceuxréalisés par Diane Arbus, mais l’intérêt de chaque imagese situe en ce qu’elle est partie prenante d’une sériedéterminée, et la valeur esthétique d’une série se trouvedans la restitution de la présence de l’événement traité.Il s’agit toujours, en effet, de restituer à l’événementmis en série ce qui fait qu’il est présent dans le monde,de restituer la teneur de sa présence. Mais de quoi uneprésence est-elle constituée ?
La notion de présence est polysémique, elle désigned’abord le fait d’être présent, de se tenir dans un lieu,ensuite la présence est aussi de l’ordre d’un caractère,celui d’être présent à un esprit, à une conscience. Cettepolysémie peut encore être élargie si l’on remonte àl’étymologie : praesentia dit le latin pour dire ce qui estdevant ou bien en avant. Et, si nous suivons ce filétymologique, faire et rendre présent devient alors del’ordre d’un acte de résistance. Il n’y a, en effet,qu’un pas entre les notions de présence et de résistancepuisque, à l’origine, cette dernière désigne l’acte de setenir en faisant face. Suivant cette perspective, ce quiest présent est ce qui résiste, c’est une fermeté, unepuissance, une force qui s’affirme dans la présence, desorte que celle-ci revêt à ce qu’elle désigne un importnoble, une dignité, une valeur qui signe un rangsupérieur. Etre présent, désigner le caractère de ce quifait présence à l’esprit, présence d’une force de ce quise tient en avant et qui résiste, ce sont tous ces sensde la présence qui se trouvent présents dans le travailde Bruno Serralongue.
Esthétique de la présence/enveloppement de l’événement
Ce qu’est une série
Constituer une série afin de restituer la présenced’un événement passé est une tâche d’une double nature.C’est d’abord un travail éminemment artistique quinécessite que les photographies ne soient pas de simples
9
reproductions, c’est-à-dire des illustrations del’événement choisi mais de véritables images. Cettedistinction dans le champ de la photographie entrereproductions et images, nous la devons à WalterBenjamin, lequel relevait dès 1931 « que la reproduction,telle que le journal illustré et les actualitéshebdomadaires la mettent à disposition, se distingue del’image. Unicité et durée sont dans celle-ci étroitementimbriquées, autant que la fugacité et le caractèrerépétitif le sont dans la reproduction5. » En ce sens, lesphotographies de Bruno Serralongue sont bien des images :outre le fait qu’elles déploient une temporalité qui leurest propre, laquelle leurs confère leur unicité – nous yreviendrons – elles ne cherchent jamais à reproduirel’événement mais à produire ce qui lui permet d’affirmersa présence dans le monde.
C’est ensuite un travail d’archéologue. Ce termed’archéologue, il faut l’entendre comme Michel Foucaultl’emploie dans son ouvrage l’Archéologie du savoir. Ce livreest un véritable instrument de travail car il dévoile unenouvelle méthodologie pour faire de l’histoire, pourredonner du sens aux événements passés, des pluslointains aux plus récents. Ce que reproche Foucault àl’histoire traditionnelle est qu’elle était par tropglobalisante, qu’elle « se donnait pour tâche de définirdes relations (de causalité simple, de déterminationcirculaire, d’antagonisme, d’expression) entre des faitsou des événements datés : la série étant donnée, ils’agissait de préciser le voisinage de chaque élément6. »Dans cette histoire globale, le concept de causalitéselon lequel tout événement est à la fois effet d’unprécédent et cause d’un suivant, était la notiondominante pour la simple raison qu’il respectait lachronologie des faits. La conséquence de l’applicationd’un tel principe était qu’il assurait une continuité auxévénements : chaque fait historique n’avait, pour ainsidire, qu’à prendre sa place dans cette chaîne causalecontinue. L’inconvénient de cette manière traditionnellede faire de l’histoire était que les événements
5 Walter Benjamin, Petite Histoire de la photographie, éd. Allia, Paris, 2012, p. 41
6 Michel Foucault, op. cit. p. 1510
devenaient tels des monuments alignés les uns à côté desautres, constituant des séries pré-données de sorte quelorsqu’un événement oublié, enfoui dans le passéressurgissait, l’historien n’avait plus qu’à déterminerdans quel voisinage d’un événement majeur (monument) ildevait le situer ou alors s’il ne le localisait nullepart, l’événement se devait d’être rejeté, rangé sous lacatégorie de « fait mineur », il disparaissait de lasérie. Vouloir conserver un tel événement dans une sériede causes à effets était prendre le risque de rompre lacontinuité de la chaîne, il fallait donc évacuer toutfacteur de discontinuité car « pour l’histoire dans saforme classique, le discontinu était […] l’impensable :ce qui s’offrait sous l’espèce des événements dispersés –décisions, accidents, initiatives, découvertes ; et cequi devait être, par l’analyse, contourné, réduit, effacépour qu’apparaisse la continuité des événements. Ladiscontinuité, c’était ce stigmate de l’éparpillementtemporel que l’historien avait à charge de supprimer del’histoire7. » Au contraire, le travail d’historien quepréconise Foucault « tend à l’archéologie » puisqu’ilpeut être comparé à la « description intrinsèque » d’unévénement quel que soit son importance dans cetteprétendue chaîne de causalité. L’archéologie foucaldienne« ne semble traiter l’histoire que pour la figer8 », ainsi« la description archéologique est précisément abandon del’histoire des idées, refus systématique de ses postulatset de ses procédures, tentative pour faire une tout autrehistoire de ce que les hommes ont dit9. » Comment cettearchéologie procède-t-elle afin de décrire et d’analyserun événement ? En constituant précisément des séries,lesquelles sont elles-mêmes composées d’une suited’événements ou bien d’un seul événement s’il possède lepoids d’un monument. En ce cas, l’événement peutengendrer une série, constituée alors des faits, desactes, des idées et des intentions qui le composent, toutun ensemble de circonstances et de concepts ayant un
7 Michel Foucault, op. cit. p. 16
8 Ibidem, p. 216
9 Ibidem, p. 18111
rapport constitutif de l’événement. Cependant, pourqu’une série existe, il faut que l’historien procède à unmontage au cours duquel il pense, choisit, sélectionne ouélimine les matériaux dont il dispose afin d’affirmer sapropre description intrinsèque de l’événement qu’il adécidé de traiter. Ce montage se structure alors comme undiscours, conçu comme un fragment formant une unité àpart entière, cette unicité marquant une discontinuitédans l’histoire.
Temporalités des présences
Le travail de Bruno Serralongue s’inscritindéniablement dans cette description archéologique.Chacune de ses séries concerne, en effet, un événementqui lui apparaît tel un monument à traiter. L’aspectmonumental de l’événement à photographier dépend de deuxcritères indépendants l’un de l’autre. Soit, c’estl’intention de l’artiste qui confère à l’événement samonumentalité, en ce sens, la série paradigmatique est lamanifestation récurrente des sans-papiers sur la place duChâtelet à Paris. La ronde de ces anonymes ayant fini parlasser les médias, il fallait l’intention d’un artistepour restituer à cette manifestation hebdomadaire saprésence dans le monde. Soit, la monumentalité del’événement se situe en amont de l’intentionnalité del’artiste, les grands sommets internationaux faisantl’objet d’une importante couverture médiatiqueappartiennent, par exemple, à cette seconde catégorie demonuments.
L’événement, une fois choisi, est alors traité pourlui-même sous la forme d’une série de photographies. Parce procédé sériel, il acquiert son autonomie puisqu’il seretrouve extirpé de la continuité du flux médiatique ;accrochées sur les murs d’une galerie ou d’un musée, lesimages forment un tout, une unité qui propose unedistance, un suspens du temps quotidien et social, scandépar la succession des informations livrées par les fluxmédiatiques. L’espace de l’exposition propose alors à sonregardeur un temps autre, une temporalité qui n’est plussoumise à la chronologie, à l’enchaînement temporel desévénements. Michel Foucault ne dit pas autre chose
12
lorsqu’il décrit ses séries historiques : « chaque sérieest un fragment d’histoire, unité et discontinuité dansl’histoire elle-même, posant le problème de ses propreslimites, de ses coupures, de ses transformations, desmodes spécifiques de sa temporalité plutôt que de sonsurgissement abrupt au milieu des complicités dutemps10. » Quelle est la nature des temporalitésrestituées par Bruno Serralongue ? Chaque série proposesa temporalité respective, parce que chacune se déploieselon son propre rythme. Dès lors, c’est au regardeurd’une série de prendre conscience que si l’ordre desphotographies exposées forme une unité, en revanche lelien entre les photos ignore la causalité et lachronologie. Au contraire, le montage archéologique quepropose chaque série photographique « décrit un niveaud’homogénéité énonciative qui a sa propre découpetemporelle, l’ordre archéologique n’est pasnécessairement celui des successions chronologiques11. » Achaque série, son propre rythme, son propre tempo, celuidu déroulement et de la constitution de l’événement quifait que ce phénomène affirme une présence dans le monde.Pour reprendre l’exemple de la série des sans-papiers, latemporalité des manifestations de ce collectif estéminemment cyclique : toujours tenue dans le même espace,les manifestants se sont retrouvés chaque Jeudi etSamedi, de 17 à 19h, pour tourner autour de la fontainede la place du Châtelet. Cette série restitue ce qui faitprésence dans et par cet événement, le ressenti de cetteprésence pour le regardeur se situe moins dans chaquephotographie qui correspond à une manifestationdifférente que dans la prise de conscience – obtenue parle passage du regard d’une photo à l’autre -- du cycletemporel que forme l’événement. Autrement dit, montrerdes manifestants, ce n’est pas simplement représenterleur manifestation mais la présence d’une force qui semanifeste selon la même fréquence, d’une force quiaffirme sa puissance selon la logique du cercle. Et,c’est grâce au phénomène de la série que cette forcemanifeste sa présence puisque la série renforce, décuple
10 Ibidem, 153
11 Michel Foucault, op. cit. p. 19413
cette présence d’une manière beaucoup plus intense que nesaurait le faire une unique photo. L’intensité de cetteprésence cyclique est formée par tout un ensemble deforces invisibles, constitué de patience, d’obstination,d’abnégation, de colère calme et ce sont ces forces quisont soudainement présentes à notre regard. Rendreprésentes ces forces invisibles est un acte derésistance. Si ce qui est présent est ce qui résiste ; enrestituant la présence de cette manifestation cyclique,le travail de Bruno Serralongue devient celui d’unpasseur qui se joue en trois temps, lesquels manifestentla résistance d’une même force. Le premier moment estcelui de la résistance qu’opposent les manifestants àl’Etat français, le second temps est celui de larestitution dynamique de cette force résistante qui seréaffirme par la série cyclique des photographies. Enfin,le troisième moment signe la présence de cette force quise tient en avant et qui continue de résister dès lorsque cette présence affecte l’esprit du regardeur de cettesérie. « Passeur de forces invisibles » pour leurrestituer leur présence visible dans le monde, tel est letravail de Bruno Serralongue.
Mais ce n’est pas tout. Cette série dévoile une autrefinalité, peut-être la plus importante, et cette finalitéest encore du registre de la présence, envisagée cettefois-ci dans sa dimension morale. Restituer la présenced’une force qui cherche à affirmer sa puissance, c’estégalement rendre hommage aux êtres qui sont à l’originede cette force, c’est leur redonner une présenceostensible dans ce monde qui s’efforce de les ignorer. End’autres termes, rendre présent une force résistanterevient à conférer, à restituer aux manifestants anonymesla dignité que la société leur refuse. Par la désignationde forces résistantes – je pense également à la sérieCalais consacrée aux réfugiés du centre de Sangatte, maisaussi à celle consacrée au World Social Forum de Mumbaï –Bruno Serralongue redonne à tous ces anonymes leur amour-propre et leur dignité d’homme. En leur donnant uneprésence visible au sein de leur société, ces séries sontun appel au respect que méritent ces hommes et cesfemmes, un rappel qu’il existe une grandeur dans leursactes d’êtres fragilisés par des forces économiques,
14
politiques qui les dépassent : la noblesse des faibles,telle est l’ultime présence qu’affirme le précieuxtravail de cet artiste, lequel s’inscrit dans uneconception de l’histoire défendue par Walter Benjamin :« Il est plus difficile d’honorer la mémoire des sans-noms que celle des gens reconnus. A la mémoire des sans-noms est dédiée la construction historique12. »
La présence que manifeste la série de photographiesconsacrée au Sommet mondial sur la société de l’information est d’uneautre nature. Qu’est-il donné à voir au regardeur de cetévénement qui s’est tenu à Genève en décembre 2003 ? Cesommet ayant réuni plus de seize mille déléguésreprésentant les gouvernements, la société civile et lesecteur privé de cent-soixante-seize pays, on peut penserce sommet comme étant un lieu où règne une activitéincessante, composée de forums, de conférences, de table-rondes, de personnes courant d’une réunion à une autre,de journalistes accrédités travaillant dans l’urgence.Les images d’archive des informations diffusées à cetteépoque montrent cela j’imagine, cette agitationpermanente de gens déclamant plus ou moins sincèrementleurs opinions et convictions. Or, la série de BrunoSerralongue fait ressentir tout autre chose : des grandestravées de casiers majoritairement vides, des tables oùtrônent des écrans d’ordinateur avec leur clavier, oùtraînent des canettes, des bouteilles vides, des verres,des cendriers. Derrière les tables, une myriade de filset de câbles qui se chevauchent et s’entrecroisent. Cequi est montré est moins l’envers de l’événement que lasubstance même qui constitue sa présence, une présencefaite d’absence, celle des protagonistes de l’événement,mais aussi de temps creux, de pauses, d’attentes, deconversations plus ou moins soutenues, informelles. Cequi est saisi par la série est le temps long de cetévénement, sa lenteur de rythme d’accomplissement. Cesommet est d’ailleurs celui de la présence de la fatiguequi lentement s’installe, de la fréquence élevée detemps, de durées durant lesquelles il ne se passe rien,ou si peu. En d’autres termes, ce qui rend présent
12 Walter Benjamin, Paralipomènes et variantes des « Thèses sur le concept d’histoire », Ecrits français, Paris, Gall. 1991, p. 356
15
l’événement est aussi tout un ensemble constituéd’absences, de temps vides et creux qui déterminent unrythme lent et, seule une série de photographies pouvaitrestituer cette temporalité de la vacuité.
Ainsi, chaque série restitue les temporalitésspécifiques d’accomplissement des événements et montre lamanière et l’intensité dont fait preuve chaque événementpour affirmer sa présence dans le monde et se constituercomme tel. Il reste au regardeur de sentir cette présenceenfouie dans chaque événement.
Spatialités des présences
Ce qui actualise la présence possible d’un événementest, outre sa temporalité, la manière dont il traite etoccupe l’espace. Cette dimension spatiale de la présenceest également pensée dans et par les sériesphotographiques. En effet, c’est précisément le souci derestituer la dimension spatiale – laquelle participe aurendu de la présence de l’événement – qui justifiel’emploi des chambres photographiques à la place desappareils numériques traditionnels. Seules de telleschambres permettent de travailler avec de grands négatifsqui autorisent un agrandissement des images sans pertedes détails. Grâce à cette prouesse technologique, BrunoSerralongue photographie aussi dans ses séries la manièredont l’événement est mis en scène, laquelle participe àlui conférer une présence dans le monde. Faire apparaîtrece qui donne à l’événement une présence autonome consistealors à révéler « la mise en scène autour de l’événement,chose qui échappe peut être un peu plus à la photographiede reportage qui, elle, focalise sur l’événement13. »Ainsi, dès qu’un événement use d’un artifice de mise enscène afin d’affirmer sa présence dans le monde, BrunoSerralongue, à son tour, met en scène et dévoile, grâce àses chambres photographiques, cette mise en scène.
Tel est le cas pour le Sommet de la Terre de Johannesburgoù l’artiste théâtralise la mise en scène de la scèneprincipale, celle-là même où le sommet eut lieu. L’unedes photos de cette série est particulièrement
13 Bruno Serralongue in Revue Arts16
éloquente ; à première vue, l’image est complexe àinterpréter car elle restitue un espace gigantesque,celui de la salle des congrès, orchestré selon la volontédes organisateurs. Ce gigantisme de l’espace fut sansdoute pensé comme devant être le reflet de l’importancede ce sommet. Cependant, la photo suggère quelque chosede plus que ce gigantisme, elle restitue surtout sa miseen scène, laquelle a pour effet la mise en évidence d’unvide circonscrit, à la fois, par l’espace clos del’immense salle et par les différentes barrières agencéessur le sol de cet espace. Cette sensation de vide estrenforcée par la tonalité chromatique dominante, un bleuélectrique obtenu par une multitude de lumièresartificielles. Sur la droite, la grande scène viden’occupe qu’une petite partie de l’image, elle n’estqu’une composante de la mise en scène du sommet révéléepar le grand angle de la chambre photographique. La forcede cette photographie est qu’elle rend visible cetinvisible qu’est le vide. Cette omniprésence du vide,tout reportage destiné à un grand public se doit de lamasquer, de la conserver invisible ; ce vide, pourtant,est essentiel puisqu’il est partie prenante du phénomèneet participe pleinement à la présence dans le monde decet événement14.
Quant à la série dénommée Kosovo, commencée en 2009, satemporalité est ouverte puisqu’elle est toujours encours, son sujet est la restitution de la manière dontcette nouvelle petite république se met en scène afind’afficher, d’affirmer sa présence comme nation à partentière. Dans cette série, la photographie de lagigantesque installation Newborn est révélatrice de cettethéâtralité. L’image a été prise le jour des célébrationsdu premier anniversaire de la naissance officielle de laRépublique du Kosovo. Ses dirigeants voulaient cettejournée festive, digne de rester dans les mémoires. Là oùles photos de presse s’empressaient de montrer qu’uneimmense sculpture composée de grandes lettres jaunes,Bruno Serralongue souligne son lieu d’exposition etl’ensemble du dispositif qui l’encadre. Le regardeur
14 La même stratégie du vide se retrouve dans la série consacrée au Forum social de Mumbai (Bombay)
17
comprend alors que la République du Kosovo, c’est aussides immeubles modernes sans âmes, une foule clairsemée etde faméliques feux d’artifice censés célébrés la nouvellejoie républicaine mais qui trahissent surtoutl’artificialité et la banalité de la cérémonie. De même,la photographie d’une petite statuette d’une déessekosovare datant du XVe siècle en dit long sur les effetsde mise en scène dont font preuve les autorités pourlégitimer la présence du Kosovo sur la scèneinternationale. Toute nation se doit d’avoir son histoirepropre, jalonnée par des événements et des œuvresmarquant la continuité de cette histoire. Or, d’un pointde vue historique, le Kosovo, petite province d’Europe del’Est ne possède pas cette histoire : cette nouvellerépublique est une création ex-nihilo : non seulement ellen’a pas une histoire faisant foi de son identité maiselle n’est forte d’aucune industrie, d’aucune économie,d’aucun art spécifiques. Cette république – conséquencede la guerre dans l’ex-Yougoslavie – ne doit sonexistence qu’à une poignée d’indépendantistes, qu’auxfinances de la communauté européenne et de l’ONU. Aussi,toute trace historique ayant un rapport avec ce queserait l’identité kosovare est ostensiblement affichée.Tel est le cas pour cette statuette exposée, exhibée aumusée d’histoire de Pristina. Un touriste, un photographede reportage saisiraient, dans un plan rapproché, cettestatuette pour elle-même. Au contraire sa photographiepar Bruno Serralongue montre l’excessif dispositiforchestré autour de cette statuette afin de la mettre enscène. Unique témoignage statuaire d’une identitékosovare, la photo montre, déconstruit et dénonce cettemise en scène. L’objet de petite taille est exposé dansune immense vitrine, elle-même située sur un grandprésentoir juché sur un piédestal, l’ensemble étantmontré dans une pièce aux grands volumes. La présence duKosovo sur la scène internationale n’est donc due qu’àune volonté politique qui s’appuie sur une mise en scènede l’espace qui se veut efficace ; ce que nous montre lasérie Kosovo est qu’en réalité, cette présence ne seconstruit que sur un vide, une absence historique.
Envelopper la présence pour mieux la perpétuer18
Si la question de l’origine d’une série estrelativement claire, il me semble que celle de sa finl’est moins, à commencer pour l’artiste lui-même qui aimeet entretient l’idée que ses séries sont ouvertes àtoutes interprétations, qu’il revient à chaque regardeurd’interpréter à sa guise le ou les sens qu’il décèle lorsde la contemplation d’une série. Cette ouverture dans lechamp interprétatif est obtenue et entretenue par lenombre de photographies qui compose chaque série. Cenombre, bien entendu, est variable, il dépend simplementdu nombre de photographies prises in situ. Bruno Serralongues’interdit, en effet, d’effectuer une sélection desimages constitutives d’une série15 afin de démarquer sadémarche artistique du travail du photographe de presse,qui, lui, choisit soigneusement la « bonne »photographie, celle qu’il juge être la plusreprésentative et expressive de l’événement. Aucontraire, une série se construit précisément parce qu’ily a un refus de sélection de la part de l’artiste, ce quiexplique que le regardeur peut évaluer qu’une image estplus ou moins réussie d’un point de vue esthétique. Maisl’intérêt des images se situe d’abord dans le faitqu’elles possèdent toutes la même valeur parce qu’ellestémoignent d’une présence identique. Cette méthode abolitainsi la recherche de la meilleure image. Une séries’achève donc d’elle-même lorsque toutes lesphotographies prises sur le site de l’événement sontagencées pour la constituer mais ce qui est remarquableest que cet achèvement n’empêche pas de conférer à chaquesérie, une dimension d’infini. Cette distinction entrel’achevé et le non-fini, nous la devons à Baudelaire16,qui déplorait l’opinion de certains critiques d’art quin’aimaient pas les tableaux de Corot car ils lestrouvaient jamais « faits », jamais véritablementachevés. Baudelaire, toujours en avance et en résistance
15 Seuls les ektas montrant un défaut technique non rattrapable au tirage sont éliminés.
16 Charles Baudelaire, Les Salons in Œuvres complètes, Salon de 1845, tome 2, Paris, éd. Gall. 1976, col. de la Pléiade, pp. 389 & 390
19
face aux forces réactives, rétorquait que ces tableauxétaient bel et bien achevés tout en étant non-finis dansle sens où il revenait à l’œil du spectateur de lescompléter, de les prolonger, ce prolongement étant lui-même sans fin, à la fois, dans l’esprit de chaquespectateur et d’un spectateur à un autre. La mêmedistinction peut être perçue dans les séries de BrunoSerralongue : l’achèvement d’une série ne signe pas safin ; mieux c’est cet achèvement qui lui procure soncaractère d’œuvre infinie et ouverte. Mais pourquoi etcomment le nombre limité de photos entretient-il etparticipe-t-il au caractère d’ouverture d’une série ? Laréponse est dans le talent propre de l’artiste quiparvient à instaurer un lien entre son regardeur et sasérie. De quoi ce lien est-il fait et comment seconstitue-t-il ? Par les effets de présence del’événement traité que seule une série est en mesure degénérer. En effet, ce qui rend présent l’événement àl’esprit du regardeur ne peut être localisé dans unephoto précise mais dans la position qu’elle vient occuperdans la suite sérielle. Cette position, d’ailleurs, n’estpas due à un strict enchaînement temporel car la réellechronologie des photos revêt peu d’importance par rapportà l’effet de présence de l’événement tel qu’il estrestitué. Le travail de Bruno Serralongue n’est pas celuid’un chroniqueur qui perpétrait l’ordre du temps maisbien celui d’un archéologue dans le sens où MichelFoucault souligne l’idée que l’archéologie met toujoursen suspens la pure chronologie, écarte le schème de lasuccession, qui n’est plus désormais un absolu àrespecter : « Les formations discursives [en l’occurrenceles séries] n’ont pas le même modèle d’historicité que lecours de la conscience ou la linéarité du langage17. » Laplace d’une photo au sein d’une série n’est pas non plusréductible à l’espace qu’elle occupe sur le mur del’exposition qui propose un ordonnancement noncontraignant pour le regardeur. Aussi, est-ce la tâche dece dernier de décider qu’elle est la place, la fonctionde la photo qu’il contemple dans sa capacité àstructurer, envelopper la série afin que celle-ci dévoile
17 L’Archéologie du savoir, op. cit. p. 22020
sa cohésion, son homogénéité. C’est donc au spectateur detisser librement le lien entre son esprit et les imagesqui lui sont données à percevoir. Ce lien est comme unjeu dont les règles ne sont pas prédéfinies mais dont lescomposantes sont les affects, le vécu et la mémoire duspectateur mais aussi ses intuitions, ses pensées, bref,tout un monde imaginaire et spirituel suscité par lesphotographies. Ce que saisissent les facultés de l’œilqui regarde, en passant d’une image à une autre et enenveloppant, lentement, progressivement, l’ensemble de lasérie, est de quoi l’événement est fait, qu’elle est lamanière dont il s’invente sa présence singulière dans lemonde, comment sa force s’affirme dans la réalité pour seconstituer en présence. L’intérêt des séries de BrunoSerralongue est qu’elles ne donnent aucune visibilitéimmédiate à cette présence de l’événement mais que celle-ci se trouve enfouie entre les photographies. Et, c’estlorsque la présence de l’événement n’est ni visible, nidonnée, non identifiable en une seule image mais qu’elleest une lente conquête pour le spectateur, qu’elledevient progressivement présente à son esprit. End’autres termes, la présence de l’événement ne seprésente en tant que telle que lorsqu’elle est a-prioriinvisible et que son invisibilité devient le symptômed’une conquête pour le spectateur. Par suite, il suffitque l’esprit d’un seul spectateur soit saisi, voire« habité » par la présence de l’événement pour que lecaractère infini de la série prenne alors tout son sens.En effet, l’événement faisant présence à son esprit, ilpeut alors perpétuer cet événement, il en devient mêmepartie prenante dans la mesure où, dès qu’il sort du lieud’exposition de la série, il emmène et propage cetévénement avec et en lui, perpétuant – par-delà sonachèvement temporel – son existence. Ainsi, l’événementoriginel peut bien être fini dans le temps, sa présencepeut se transmettre et se perpétuer à l’infini par lesspectateurs qui ont su voir et s’approprier les sériesque l’artiste nous donne à percevoir.
Typologie des présences. La série des séries.
21
Bruno Serralongue a commencé son travail artistiquesur les séries à la fin de l’année 1993, enphotographiant les lieux où s’étaient déroulés des faitsdivers dans la ville de Nice et ses environs. Les sériesse multipliant, une typologie des formes de présence sedessine : présence d’une force résistante qui semanifeste, présence d’un vide au cœur de l’événement,présence de l’événement dans et pour l’imaginaire duregardeur, présence en tant qu’hommage, dignité etnoblesse de ceux qui font l’événement. Cette typologiedévoile la polysémie inhérente à la notion de présence.Mais d’où sourd cette typologie ? Elle ne provient pasd’un plan, d’un projet préétabli dès 1995 mais des thèmesrécurrents que l’artiste fut amené à capter pour dévoilerce qui fait présence dans les événements, afin de« ressaisir leur irruption même, au lieu et au moment oùchaque scène s’est produite. Pour retrouver leurincidence d’événement18. »
Aux galeries nationales du Jeu de Paume de Paris,Bruno Serralongue a exposé, durant l’été 2011, ces thèmesrécurrents qui font que des séries de différentes naturess’entrecroisent. L’originalité de cette exposition estqu’il n’est plus donné à voir des séries définies maissept ensembles de photographies dont les thèmesapparaissaient dans différentes séries antérieures. Lespectateur de cette exposition pouvait donc contemplerles thèmes Conférences de presse, Rassemblements, Manifestations,Feux d’artifices, Feux, Portraits, Scénographie/spectacle et A lire. Cesthèmes définissent alors comme un répertoire des moyensmis en œuvre pour créer des effets de présences. Cerépertoire, l’artiste le définit en ces termes :
Un réseau de références, de « figures », se découvre deséries en séries jusqu’à former un « répertoire del’action collective ». […] C’est comme cela, en pensantles répétitions signifiantes qui finissent par formerun répertoire, que j’ai organisé l’exposition du Jeu dePaume. L’existence de ce répertoire, je ne l’ai perçuque récemment. Il a d’abord fallu qu’il se crée, petit
18 Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, op. cit. p. 15922
à petit, à l’ombre des séries. Mais je crois néanmoinsque c’est un projet présent dès le départ, même si jene le formule clairement qu’aujourd’hui19.
Ce répertoire qui s’est créé de lui-même par lecroisement des séries déjà constituées, apparaît comme untableau de ces dernières, comme de nouvelles séries àvenir : les séries des séries. En prenant aujourd’huiconscience de ce tableau des séries inscrit en puissancedans son projet, l’artiste continue d’inscrire sontravail dans une démarche archéologique, laquelle aprécisément pour finalité de dresser de tels tableaux.Mais, de quoi le tableau archéologique est-il lerévélateur ? Pour Michel Foucault, toute démarched’archéologue repose sur l’hypothèse suivante :
On suppose qu’entre tous les événements d’une airespatio-temporelle bien définie, entre tous lesphénomènes dont on a retrouvé la trace, on doit pouvoirétablir un système de relations homogènes : réseau decausalité […], rapports d’analogie montrant comment ilsse symbolisent les uns les autres, ou comment ilsexpriment tous un seul et même noyau central ; onsuppose d’autre part qu’une seule et même formed’historicité emporte les structures économiques, lesstabilités sociales, l’inertie des mentalités, leshabitudes techniques, les comportements politiques, etles soumet tous au même type de transformation20.
Le répertoire d’actions collectives exposé aux galeriesdu Jeu de Paume apparaît comme la manifestationartistique du projet foucaldien : établir un système derelations homogènes qui révèle une histoire contemporainenouvelle, celle qui est à l’œuvre dans les séries deBruno Serralongue. Cette histoire nouvelle, celle-là mêmeque Foucault nomme « générale », nécessite uneméthodologie qui s’oppose à cette manière désuète etrassurante de faire de l’histoire, une manièreglobalisante. Suivant cette perspective, l’exposition du
19 Bruno Serralongue, Catalogue pour l’exposition du Jeu de Paume, op. cit. p. 142
20 L’Archéologie du savoir, op. cit. p. 1823
Jeu de Paume révèle artistiquement cette nouvelle manièrede faire de l’histoire, une démarche archéologique quirésout de nombreux problèmes auxquels les historiens seheurtaient, à commencer par celui de la continuité entreles événements. N’est-ce pas, en effet, une archéologiedu savoir historique contemporain que met en œuvre lerépertoire des séries lorsque Foucault écrit :
Le problème qui s’ouvre alors – et qui définit la tâched’une histoire générale – c’est de déterminer quelleforme de relation peut être légitiment décrite entreces différentes séries ; quel système vertical ellessont susceptibles de former ; quel est, des unes auxautres, le jeu des corrélations et des dominances ; dequel effet peuvent être les décalages, les temporalitésdifférentes, les diverses rémanences, dans quelsensembles distincts certains éléments peuvent figurersimultanément ; bref, non seulement quelles séries,mais quelles « séries de séries » -- ou en d’autrestermes, quels « tableaux » il est possible deconstituer. Une description globale resserre tous lesphénomènes autour d’un centre unique – principe,signification, esprit, vision du monde, formed’ensemble ; une histoire générale déploierait aucontraire l’espace d’une dispersion21.
Les séries de Bruno Serralongue proposent une histoiregénérale de ce que furent les dernières années du XXe etles premières du XXIe siècle. Le tableau des séries duJeu de Paume met en évidence les phénomènes symboliquesou réels qui permettent à un événement d’affirmer saprésence dans le monde. Par suite, on comprend la raisonpour laquelle les séries dévoilent un répertoire, unetypologie de toutes les présences possibles parlesquelles des événements dessinent leur propre espace etleur propre temporalité dans le monde. Cette typologiedéploie, en effet, une description générale – et nonglobale – des formes de présence ; ce qui signifie queces formes se diversifient, se dispersent en fonction dela singularité de l’événement choisi. Ces séries
21 L’Archéologie du savoir, op. cit. p. 1924
artistiques montrent également qu’il faut désormaisrenoncer à rechercher l’essence d’une présence mais queles formes de présence sont par essence multiples,qu’elles déploient, selon l’expression de Foucault – « unespace de dispersion » -- et qu’il est vain de chercher àréduire, globaliser cet espace.
Les communautés/la mondialisation.
Regarder, contempler une série de Bruno Serralongueest une véritable expérience d’appropriation del’événement photographié. Le signe que cetteappropriation est effective se manifeste lorsque lespectateur, saisi par la présence singulière del’événement, devient partie prenante de cet événement,perpétuant sa présence dans le monde lorsqu’il quitte lasalle d’exposition. En devenant, par ce biais, acteur del’événement, il n’est pas insensé de penser que lespectateur rejoint la communauté de ceux qui créèrentl’événement. Ce concept de communauté est déterminantpour appréhender le travail de l’artiste :
Dès 1995, c’est la notion de communauté qui a guidé montravail. Placer le lieu de la photographie au seind’une communauté plus qu’au moment d’un événement étaitce qui m’intéressait. Puis, je me suis très vite aperçuque les deux ne faisaient qu’un22.
Après avoir contemplé plusieurs séries, je pense que cequi fait le lien, la fusion entre la communauté etl’événement est précisément la forme singulière etl’intensité de présence que la première donne et insuffleau second. Dès lors, regarder une série de photographiesenveloppant le même événement procure un fort sentimentd’être présent dans l’espace de cette communauté, d’enêtre partie prenante. Cependant, ce que montre égalementune série est que chaque communauté développe sa propreforme de présence au monde, le spectateur devient donc
22 Bruno Serralongue, Catalogue pour l’exposition du Jeu de Paume, op. cit. p. 141 25
présent au monde mais non pas un monde structuré autourd’un centre unique médiatisé, non pas un monde globalisémais un monde dispersé en vertu des communautés qui lepeuplent par leur présence spécifique. Ainsi, nousapprenons en regardant les séries de Bruno Serralongue ouen contemplant son répertoire des actions collectives quela mondialisation – l’autre nom pour dire laglobalisation – n’est qu’un produit de l’histoireglobale, critiquée par Michel Foucault. Le pouvoir decette mondialisation n’est qu’une création des forceséconomiques et médiatiques mais ce pouvoir n’a pasl’intensité nécessaire pour faire taire, recouvrir lespuissances émanant des communautés photographiées parBruno Serralongue. Faire jouer les communautés et leurscapacités d’affirmer leur présence dans le monde contreun monde globalisé, tel est l’ultime pari auquel letravail de l’artiste nous demande d’adhérer : un travailde résistance.
Pierre J. Truchot
26