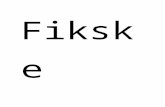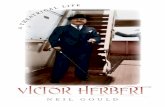BELHOSTE Victor Master definitif
Transcript of BELHOSTE Victor Master definitif
Mémoire de master 1 préparé sous la direction de Mme Françoise
MICHEAU
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Master d'Histoire médiévale du monde byzantin, des pays
d'Islam est de la Méditerranée
spécialité Histoire de l'Orient musulman
année 2012-2013
Tant de jours... qui faisaient la vie suave, exquise,
Tant de jours... Je traînais des habits fastueux,
Tant de jours... Je suivais ou raison ou sottise,
Tant de jours... entre amis... qui donc boirait le mieux ?
Tant de jours... se vouloir jeune, jouer l'amour...
Et puis se retrouver en plein cœur de la cible !
[…]1
1 ABÛ L-‘ATÂHIYA, Poèmes de vie et de mort, trad. de l'Arabe, présentés et 2
Illustration de la page de couverture :Livre des chants (Kitāb al-Aġānī), tome 17: Monarque sur son trône entouré de sa suite – origine probable : Nord de l'Irak (Mossoul), vers 1218-1219 (615 de l'hégire) – (170 mm x 128 mm.).Istanbul, Millet Kütüphanesi, Feyzullah Efendi 1566, folio I recto (page de frontispice).
annotés par A. MIQUEL, Arles 2000 (La petite bibliothèque de Sindbad), 96 p.
3
La pratique de la poésie à la cour
abbasside
(132 h/750 – 334 h/945)
Introduction
Dans la culture arabe, la poésie (en arabe ši‘r) est l'art par
excellence, elle jouit d'un très grand prestige dans tous les
milieux et la cour abbasside n'y fait pas exception. Ainsi de
nombreux courtisans y produisent de la poésie. En fait, la
poésie y tient une place fondamentale. Elle était déjà
traditionnellement la mémoire du groupe, de la tribu, la
mémoire des Arabes (« Ayyām al-‘Arab », littéralement les
« journées des arabes »).La poésie est, à la cour abbasside,
le fondement même de toute littérature et à l'origine de cette
poésie sont les œuvres des poètes de la ǧāhiliyya, la période anté-
islamique, dont les poèmes les plus célèbres sont réunis dans
un recueil : les Mu'allaqāt, à commencer par le plus grand d'entre
eux, Imrū al-Qays (m. v. 550).
La poésie fait ainsi partie de l'héritage spécifiquement arabe
du monde islamique, dans sa structure et dans ses thèmes, elle
se rapporte au monde bédouin. Dans cette poésie, la forme
poétique reine est la qaṣīda (pluriel qaṣā'id) ou ode. Il s'agit
d'un poème monorime qui est structurée en plusieurs parties.
D'abord le prélude élégiaque appelé naṣīb où le poète se
lamente sur les traces du campement abandonné où se trouvait
4
sa bien-aimée. Puis le raḥīl, un récit d'un parcours d'allure
initiatique à travers le désert avec une évocation plus ou
moins détaillée de sa faune et de sa flore. Enfin le ġaraḍ qui
est ce que certains considèrent comme « L'objet effectif du
poème », le panégyrique adressé à un groupe (clan, tribu) ou à
un personnage, parfois la satire et l'invective2.
Après cette poésie issue de l'âge « héroïque » de la ǧāhiliyya
qui restera à travers les âges comme un idéal insurpassable se
développent de nouveaux goûts poétiques à l'époque omeyyade
mais surtout abbasside, moment clé dans l'Histoire du monde
musulman. On peut ainsi se demander comment se constitue la
poésie à la cour abbasside à partir à la fois de l'héritage
proprement arabe issu de la ǧāhiliyya et des apports des
civilisations antérieures à l'Islam et conquises par lui, en
particulier Byzance et surtout la Perse sassanide. En effet,
dans le cadre de l'immense empire gouverné par les Abbassides
qui s'étend de l'Ifrīqiya au Sind et du Ḫwarezm au Yémen a
lieu une gigantesque synthèse entre des éléments issus des
cultures diverses de l'Empire et qui est à l'origine de la
culture islamique classique. Ainsi la cour abbasside se trouve
au cœur d'une véritable effervescence intellectuelle et
culturelle.
On peut se demander ce qu'est une cour ? Il s'agit de
l'entourage du calife. Pour Dominique Sourdel, cette élite
abbasside est constituée de « tous ceux qui entouraient le
calife, qui avaient accès auprès de lui, qui faisaient partie
de la cour ou de l'administration, qui agissaient comme ses
2 H. TOELLE, K. ZAKHARIA, A la découverte de la littérature arabe, Paris 2003, (Champs essais), 388 p. p. 63-64.
5
délégués dans l'armée ou dans la judicature3 ». Cette cour est
ainsi constituée de nombreuses catégories de personnes :
administratifs (kuttāb), soldats, juges (qāḍi) et bien d'autres
encore. Autre notion d'importance, la distinction entre la
ḫāṣṣa, l'élite comprenant l'aristocratie et les notables, et
l'āmma, masse anonyme des gens du commun, en effet, les
membres de la cour abbasside, même s'ils venaient de milieux
modestes avait tous le sentiment aigu d'appartenir à la
première catégorie au point que le terme lui-même de ḫāṣṣa est
parfois traduit directement par cour4.
Sous les Abbassides la cour se tient d'abord, après quelques
essais sans lendemain dans d'autres sites mésopotamiens, à
Bagdad, ville fondée par le calife al-Manṣūr (règne de 136 h/
754 à 158 h /775) sur les rives du Tigre au centre de la
Mésopotamie sur un site stratégique parce qu'au croisement de
nombreuses routes commerciales, de 144 h/762 à 221 h/836. Puis
la cour se déplace à Sāmarrā', ville construite sur ordre du
calife al-Muʿtaṣim (règne de 218 h/833 à 227 h/842) et située
sur le Tigre à 125 km en amont de Bagdad, de 221 h/836 à
279 h/892 avant de revenir à Bagdad en 279 h/8925.
La période concernée par notre étude va de 132 h/750 avec la
fondation du califat abbasside jusqu'à 334 h/945, date de la
perte du pouvoir réel par les califes au profit des émirs
bouyides (règnent de 334 h/945 à 447 h/1055).
Concernant les types de praticiens de la poésie à la cour
3 D. SOURDEL L'état impérial des califes Abbassides VIIIe-Xe siècle, PUF, Paris 1999 (Islamiques), p. 212.
4 M.A.J. BEG, "al-K̲h̲āṣṣa wa-l-ʿÂmma", dans Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, comité de rédaction : H.A.R. GIBB, J.H. KRAMERS, E. LEVI-PROVENCAL, J. SCHACHT, Leyde Paris 1991, 13 tomes, suppléments et index.
5 A. NORTHEDGE, " Sāmarrāʾ", dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
6
abbasside, on remarque que parce qu'ils ont une pratique de la
poésie différente, la nature de la poésie qu'ils produisent
est différente. Dans la cadre de ce mémoire, nous introduirons
une typologie, c'est-à-dire un système de classification d'un
ensemble de données empiriques concernant un phénomène social
en types distincts6, de ces praticiens de la poésie à la cour
abbasside. Une fois ce travail accompli nous étudierons les
interactions existantes entre ces types définit de praticiens
et nous interrogerons sur la pertinence de cette typologie.
Dans cette étude, une des sources les plus importantes est le
Kitāb al-Aġānī d'Abū-l-Faraǧ al-Iṣfahānī (m. 356 h/967), le
« livre des chansons » qui n'est malheureusement disponible
qu'en arabe. Cependant, il est possible d'avoir accès à
certaines notices de cet ouvrage notamment grâce à l'ouvrage
de Jacques Berque : Musiques sur le fleuve : Les plus belles pages du Kitâb al-
Aghâni, à la thèse de Nacheat El-Khatib, Etude historique de l'époque
Abbaside à travers le Kitâb al-Aghânî, à l'article de Hilary Kilpatrick,
« Abū l-Faraǧ's Profiles of Poets A 4th/10th Century Essay at
the History and Sociology of Arabic Literature » et d'autres
travaux.
Cependant, il existe aussi des sources arabes traduites, que
ce soit en français comme Les prairies d'or de Mas‘ūdi, œuvre
fondamentale de l'adab, chronique universelle relatant
l'histoire du monde depuis les origines jusqu'à 945, date de
la perte du pouvoir réel des califes abbassides et dans
laquelle les citations de vers sont très nombreuses. Egalement
en français, l'Akhbar al-Radi Billah wa al-Muttaqi Lillah, histoire de la dynastie
6 « Typologie », Dictionnaire Français Larousse [en ligne], Paris 2013 (http://www.larousse.com/en/dictionnaires/francais/typologie/80387).
7
abbaside de 322 à 333/934 à 944 de Muḥammad b. Yahyā al-Ṣūlī (m. 335
h/946-7) donne en particulier des informations sur
l'utilisation de la poésie par les membres de la cour.
En anglais, The Fihrist of al-Nadīm, a tenth century survey of muslim culture
d'Ibn al-Nadīm (m. v. 385 h/995) nous donne des notices sur
toute sorte de praticiens de la poésie de cette époque.
Toujours en anglais, la traduction de l'ouvrage de Hilāl al-
Ṣābi', Rusūm Dār al-Khilāfah (The Rules and Regulations of the ‘Abbāsid Court)
nous donne des informations concernant les praticiens de la
poésie face au protocole de la cour.
Enfin, dernière source d'information concernant la pratique de
la poésie à la cour abbasside, les poèmes eux-mêmes, dont
certains de ceux des plus célèbres poètes de l'époque sont
traduits en français comme la sélection de poèmes d'Abū Nuwās
Le vin, le vent, la vie, celle du poète imaginaire Majnūn, dont le
recueil (dīwān) a été constitué sans doute à l'époque omeyyade
mais qui est le modèle de la poésie amoureuse d'époque
abbasside, dans L'amour poème. D'autres sélections, plus
nombreuses encore, de célèbres poètes de langue arabe de
l'époque abbassides existent en anglais notamment celle de
Baššār b. Burd : Selections from the poetry of Baššār,et celles d'autres
poètes traduits et expliqués dans l'ouvrage de Suzanne
Stetkevych, The Poetics of Islamic Legitimacy : Myth, Gender, and Ceremony in
the Classical Arabic Ode qui ont tous deux servis à cette étude.
Une série d'informations concernant les poètes cités dans le
cadre de ce mémoire est regroupée dans une base de données
située en annexe dans lequel est réalisé un travail de
prosopographie, celle-ci étant définie comme une science
auxiliaire de l'histoire, qui étudie la filiation et la
8
carrière des grands personnages7.
Dans une première grande partie, nous verrons en quoi il est
possible de différencier différentes pratiques de la poésie
qui sont chacune caractéristiques de différents types de
praticiens de cette poésie.
A l'intérieur de cette grande partie, nous nous intéresserons
dans une première sous-partie aux poètes « professionnels »,
c'est-à-dire à ceux qui font un métier de leur production
poétique. Nous verrons en quel sens peut-on parler de
« professionnalisation » de ces poètes, dans quel cadre social
cette pratique s'exerce-t-elle, et quels sont les types de
poésie produites par ces poètes professionnels.
Ainsi, cette production consiste essentiellement en
panégyriques qui sont généralement récités publiquement, dans
le cadre d'un cérémonial, à leur protecteur auquel est dédié
ce poème. Les protecteurs étant des grands de la cour ou le
calife lui-même qui est le protecteur par excellence. Cette
récitation publique de poésie va donner lieu à des récompenses
somptueuses d'ordre financière qui permettent aux poètes de
subvenir à leurs besoins voire d'amasser des fortunes dans
certains cas ou plus rarement permettre au poète d'obtenir un
poste dans l'administration califale.
Par contre, si le protecteur d'un poète professionnel est
considéré par celui-ci comme manquant de générosité, ce
dernier peut s'octroyer le droit de composer des poésies
satiriques ayant pour but de l'humilier, chose crainte par
tous les membres de la cour.
7 « Prosopographie », Dictionnaire Français Larousse [en ligne], Paris 2013 (http://www.larousse.com/en/dictionnaires/francais/prosopographie/64466
9
Enfin, nous nous pencherons sur les relations des poètes
envers leurs protecteurs, qui, si elles semblent de prime
abord être de pure sujétion, peuvent s'avérer nettement plus
complexes.
Dans une seconde sous-partie, ce sont les poètes-secrétaires
(kuttāb) qui retiendront notre attention. Ceux-ci forment le
sommet de l'administration de l'empire. On s'interrogera sur
le contexte dans lequel ils font usage de la poésie et s'il
existe un type de poésie spécifique produite par eux. En
effet, ces kuttāb voient avant tout la poésie comme une partie
de l'adab, c'est-à-dire comme faisant partie de la bonne
éducation que chaque secrétaire se doit de connaître. La
production poétique de ces kuttāb se distingue par suite de
celle des poètes professionnels en ce qu'elle se donne comme
objectif premier l'agrément. Parmi cette abondante production,
on remarque l'importance de la poésie amoureuse élégiaque qui
obéit à des codes bien précis. De plus ceux-ci se targuent de
connaître fort bien la poésie arabe et d'être capables de
réciter des vers lors de circonstances appropriées. Pour les
kuttāb, les vers peuvent également servir de moyen de
communication élégant, en particulier lors de l'échange de
billets, pour exprimer une opinion d'ordre politique ou pour
formuler une requête.
Autre catégorie de praticiens de la poésie à la cour
abbasside, les qiyān, qui sont l'objet de la troisième sous-
partie de ce mémoire. Celles-ci sont en effet réputées pour
leurs nombreux talents, dont celui de la composition poétique.
Enfin dans la quatrième et dernière sous-partie, nous nous
intéresserons à un phénomène fondamental dans l'histoire
littéraire du monde musulman qui se produit lors de la période10
abbasside, il s'agit de la mise en forme de la poésie pré-
islamique qui servira de référence commune pour toute la
poésie arabe. Cette mise en forme est l'œuvre d'autres types
de praticiens de la poésie sur lesquels nous nous pencherons :
les transmetteurs (rāwī) qui connaissent par cœur les poèmes
préislamiques et qui vont communiquer leur savoir à des
philologues qui mettront par écrit cette poésie ce qui aura
pour conséquence de la conserver inchangée jusqu'à nos jours.
Ayant ainsi établi le cadre, dans la première grande partie,
de la pratique et des praticiens de la poésie à la cour
abbasside, nous tâcherons, dans une deuxième grande partie,
d'analyser quelles sont les différentes modalités
d'interaction entre ces différents groupes de praticiens à
savoir dans quels contextes et pourquoi ceux-ci vont-ils être
amenés à interagir.
Dans une première sous-partie nous nous pencherons sur une
institution fondamentale pour ce qui concerne les interactions
entre les groupes de praticiens de la poésie : les cénacles
(maǧlis) qui sont le lieu d'une pratique poétique d'ordre plus
ou moins privée mettant en jeu les types de praticiens vus
plus haut. Ces cénacles sont aussi le lieu privilégié
d'élaboration de la poésie bachique (ḫamriyya), la poésie
amoureuse (ġazal) et de joutes poétiques entre poètes
auxquelles assistent les grands ou même le calife et dont ils
sont très amateurs. Ces joutes étant basées sur la capacité
d'improvisation de ces poètes. Ce sont également dans ces
cénacles que s'élabore une production poétique d'agrément qui
est souvent considérée comme caractéristique des secrétaires.
Dans une deuxième sous-partie, nous nous pencherons sur
quelques clivages existant chez les poètes de l'époque11
abbasside et qui vont les opposer les uns aux autres. Cette
opposition peut être d'ordre stylistique comme pour la
querelle entre les anciens, les modernes, et les
néoclassiques. D'ordre religieux, les sunnites s'opposant aux
chiites, les mu‘tazilites aux hanbalites. Il existe aussi de
nombreuses accusations de zandaqa (hérésie ou athéisme) faites
parmi les poètes et qui conduiront certains jusqu'à la mort.
D'ordre « ethnique » avec la rivalité existant entre Arabes du
Nord et Arabes du Sud. Ainsi que le mouvement de la šu‘ūbiyya,
qui oppose les non-Arabes, principalement les Persans, aux
Arabes de « souche ».
A) Différentes pratiques de la poésie -
Différents types de praticiens
Nous distinguerons ici différentes pratiques pour différents
types de praticiens.
I) Les poètes professionnels
12
Durant la période abbasside, les poètes que l'on peut
qualifier de « professionnels », c'est-à-dire ceux qui vivent
13
Figure 1 : Les séances (Maqāmāt) d'al-Harīrī : Prince sur son trône(page de frontispice), détail – origine probable : Egypte, 1334 (734de l'hégire) – (192 mm x 175 mm.). Vienne, Nationalbibliothek, A.F.9, folio I recto.Le détail de cette miniature nous montre un prince se divertissantdans un cadre public, celui des audiences. C'est ce cadre qui estégalement le lieu de la récitation du panégyrique officiel par lespoètes professionnels.
de leur poésie, sont avant tout des poètes de cour dépendant
financièrement de la faveur d'un ou plusieurs protecteurs.
Cependant, pendant toute cette période, toute personne
cultivée se devait de participer à la communication poétique,
au moins comme auditeur ou lecteur réceptif. Ainsi, la
production poétique des poètes professionnels ne forme qu'une
partie de la poésie composée à cette époque à la cour
abbasside8.
1) Le panégyrique et son cérémonial – Une pratique publique de
la poésie
Les poètes professionnels se caractérisent par une forme clef
de composition poétique : le panégyrique.
- Le panégyrique
En arabe, le poème panégyrique se dit le madīḥ. Il s'agit de
l'éloge d'une personne (mamdūh), d'un groupe, ou d'un lieu
(ville, pays, palais...). En poésie, il se présente soit comme
le ġaraḍ dans une qaṣīda, c'est-à-dire la troisième et dernière
partie de l'ode, soit comme l'objet d'un poème entier, la
‘umdūḥa.
Le madīḥ, dont la récitation était autorisée lors des audiences
publiques, domine la production poétique classique. Il est en
général composé dans l'espoir d'obtenir une récompense
financière ; c'est pourquoi l'essor de cette poésie a été
largement favorisé par la relation des mécènes aux poètes de
8 T. FAHD, « Shā‘ir, De l'époque ‘abbāside à la Naḥda », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit., (Supplément).
14
métier dont la plupart avaient pour ambition de vivre de leur
poésie. La plupart des poètes se sont exercés, avec plus ou
moins de bonheur, à l'art de la louange, dans l'espoir d'en
obtenir des avantages. Le panégyriste tirait surtout honneur,
succès et richesse d'être rattaché spécifiquement à un prince
en tant que poète particulier9.
La plupart des panégyriques de cette époque sont constitués
de deux parties : une introduction contenant un certain nombre
de thèmes, et une partie de louanges (le panégyrique
proprement dit) , le madīḥ10.
La récitation de panégyriques à la gloire des califes et des
notables fait incontestablement partie des caractéristiques de
la cour abbasside. Ces panégyriques doivent suivre des règles
de composition très précises, et lors de leur récitation
publique devant l'ensemble de la cour, les poètes étaient
généralement richement récompensés en argent et en robes
d'honneur11.
En fait, les poèmes panégyriques formèrent le discours
politique le plus important durant une grande partie de
l'histoire islamique. Dans ceux-ci, le personnage qui en était
l'objet (le mamdūḥ) était présenté comme l'incarnation de la
vertu royale, surtout pour ce qui concerne les prouesses
militaires et la générosité. Rappeler ces vertus les
confirmait et les renforçait, aux yeux de la société comme à
ceux du souverain lui-même12.
9 H. TOELLE, K. ZAKHARIA, A la découverte de la littérature arabe, Paris 2003 (Champsessais), p. 81-82.
10 S. SPERL, « Islamic Kingship and Arabic Panegyric Poetry in the Early 9th Century », Journal of Arabic Literature, Vol.8 (1977), p.20-35, Brill. p. 25.
11 Ibid, p. 20.12 T. FAHD, « Shā‘ir, De l'époque ‘abbāside à la Naḥda », dans Encyclopédie de
15
Sous les Omeyyades, la dynastie califale précédente qui régna
de 41 h/661 à 132 h/750 les poètes se présentaient à Damas, la
capitale, afin de réciter leur production poétique à la cour,
mais repartaient ensuite, notamment vers la steppe (en arabe
badina). Avec les Abbassides et l'essor de Bagdad ou Sāmarrā',
califes, émirs et grands personnages de l'Etat s'entourent
d'un cercle permanent de panégyristes qu'ils entretiennent et
dont certains amassent des fortunes colossales et mènent un
train de maison princier.
Le mécénat favorise le développement d'une poésie solennelle
et, la poésie laudative (panégyrique et thrène, ou marthiya),
devient, quantitativement, le genre majeur, suivie de près par
la satire, l'arme par laquelle les poètes se défendent contre
les abus de leurs bienfaiteurs et les ambitions de leurs
concurrents, que nous étudierons plus loin.
La prolifération des panégyriques ne porte pas préjudice à
leur qualité : les poètes qui marquent l'époque, quels que
soient les genres dans lesquels ils ont composé, sont d'abord
de grands panégyristes. De plus en plus, ils louent les vertus
du plus puissant ou du plus offrant. Ainsi, après avoir été le
commensal de l'Omeyyade al-Walīd ibn Yazīd (règne en 125-126
h/743-744), Hammād ‘Ajrad (m. v. 161) devient, un temps, le
protégé du calife al-Mansūr (qui règne de 136 h/754 à 158
h/775).
De par leur munificence, les Abbassides s'entourent des
principaux poètes de l'époque, même les opposants et les
récalcitrants. La récitation publique des panégyriques se
déroule selon un cérémonial bien précis. Mais les califes,
l'Islam, op. cit., (Supplément).16
sous l'effet de la colère ou la contrainte des bien-pensants,
sévissent parfois de manière imprévisible avec leurs poètes,
autant qu'ils les traitent généreusement. Baššār b. Burd (m.
v. 167 h/784), Abū Nuwās (m. v. 200 h/815) ou Abū al-‘Atāhiya
(m. 210 h/825) en firent l'expérience. Le premier finit noyé
dans le Tigre pour avoir écrit un poème attaquant le calife
al-Mahdī13 (règne de 158 h/775 à 169 h/785). Le second et le
troisième payèrent leur insolence de nombreux séjours en
prison. En effet, Abū Nuwās, alors même qu'il était le
commensal du calife al-Amīn (règne de 193 h/809 à 198 h/813),
fut incarcéré un temps par celui-ci à cause de sa consommation
excessive de vin14. Quant à Abū al-‘Atāhiya, son amour
malheureux pour l'esclave ‘Utba, dont il rendit responsable le
calife al-Mahdī, lui valut le fouet et un exil dans la ville
irakienne de Kūfa15.
Tous les membres influents de la cour, princes de sang, vizirs
(comme les Barmécides), secrétaires, commensaux, musiciens,
ont leurs laudateurs16.
Une fois au pouvoir, les Abbassides eurent besoin de
propagandistes pour leur propre prétention au Califat contre
les ‘Alides. Cette prétention était fondée sur leur ascendance
de l'oncle du prophète de l'islam al-‘Abbās, et un des poètes
qui fut leur champion est Abān b. ‘Abd al-Ḥamīd al-Lāḥiqī (m.
13ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHÂNĪ, Kitāb al-Aġāni, t. III, p. 219, 243 cit.é dans la thèse de N. EL KHATIB, Etude historique de l’époque abbasside à travers le Kitâb al-Aghânî, Paris 4, 1975, 356 p., (dact.).14 E. WAGNER, « Abū Nuwās », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.15 A. GUILLAUME, « Abū al-‘Atāhiya », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.16 K. ZAKHARIA, « Chapitre XXIII : La poésie solennelle », dans T. BIANQUIS,
P. GUICHARD, M. TILLIER (sous la direction de), "Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes", Paris 2012 (Nouvelle Clio), 704 p.
17
200 h/ 815-16), dont les vers déclamés devant le calife Hārūn
al-Rašīd à la demande pressante des Barmécides sont restés
célèbres17 :
Which is more closely related to the Prophet of God, his uncle
or his nephew ?
Which of them has more claim on him and his legacy ; who is
rightful heir ?
If ‘Abbās has the sounder claim, then despite ‘Alī's claim,
The sons of ‘Abbās, are his heirs, just as an uncle's claim on
an inheritance debars a nephew's.18
Quelque temps plus tard le calife al-Mutawakkil, pour un
« cachet » de 10 000 dirhams, eut la satisfaction d'entendre
une autre ode édifiante sur les droits héréditaires de la
famille abbasside composée par Marwān b. ‘Abī al-Ǧanūb 19:
Yours is the inheritance of Muḥammed, and by your justice is
injustice banned,
The daughter's children desire the rights of the caliphate but
theirs is not even that which can be put under a nail ;
The daughter's husband is no heir, and the daughter does not
inherit the Imamate ;
And those who claim your inheritance will inherit only
repentance.20
17 R. RUBINACCI, “Chapter 11 : Political Poetry”, p. 185-201, dans ‘Abbasid Belles-Lettres, ed. J. ASHTIANY, T.M. JOHNSTONE, J.D. LATHAM, R.B. SERJEANT, G.R. SMITH, Cambridge 1990 (The Cambridge History of Arabic Literature), 517 p.
18 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al-Aġānī, t. XX, p. 76 trad. GOLDZIHER, Muslim Studies, II, 100 d'après R. RUBINACCI, “Chapter 11 : Political Poetry”, p. 194, dans ‘Abbasid Belles-Lettres, op cit.
19 R.RUBINACCI, “Chapter 11 : Political Poetry”, p.194 dans ‘Abbasid Belles-Lettres, op cit.
20 Traduction : GOLDZIHER, Muslim studies, II, 100-1 d'après R. RUBINACCI, 18
Autres grands thèmes des panégyriques dédiés aux califes,
leurs devoirs à la fois d'ordre religieux et militaire d'obéir
et de faire obéir à l'islam dans le Dār al-Islam (les pays
d'Islam) et de répandre celui-ci par le ǧihād (guerre sainte),
en particulier contre l'éternel ennemi non musulman des
Abbassides : l'Empire byzantin.
Ainsi al-Rašīd ne perdit jamais intérêt pour le ǧihād contre les
Byzantins et dans les années qui suivirent la chute des
Barmécides, il remplit très consciencieusement son rôle de
chef de l'Umma (la communauté des musulmans) contre l'ennemi
héréditaire. Il avait une qalansūwa (haut chapeau conique)
spécialement conçue pour lui avec dessus une inscription le
déclarant ġāzī wa ḥāǧǧ (guerrier de la foi et pèlerin)21, et il
consacra beaucoup de temps et d'énergie à conduire à la guerre
les musulmans en personne. Et bien sûr les poètes l'ont
célébré dans ces deux grands rôles de sa charge, tel Abū al-
Ma‘ālī al-Kilābī (dates inconnues) dans les vers suivants22 :
He who seeks you or wants to find you
Must look in the Holy cities or the remotest frontiers
In the land of the enemy, on a fiery horse
Or the land of wellbeing (?) on a camel's saddle23.
La légitimité, la justice, etc...sont les thèmes habituels
“Chapter 11 : Political Poetry”, p.194, dans ‘Abbasid Belles-Lettres, op. cit.21 AL-ṬABARI, Muhammad ibn Jarīr, Annales, éd. M.J DE GOEJE et al. Vol. iii
(Leyde, 1879-1901), p. 709 d'après H. KENNEDY, The Court of the Caliphs : The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty, Londres 2004, p. 79-80.
22 H. KENNEDY, The Court of the Caliphs : The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty, op. cit., p. 79-80.
23 AL-ṬABARI, Muhammad ibn Jarīr, Annales, op. cit., p. 710 d'après H. KENNEDY,The Court of the Caliphs : The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty, op. cit. p. 79-80.
19
des panégyriques dédiés aux Abbassides, leurs administrateurs
et généraux, et la plupart contiennent également des éléments
que l'on pourraient décrire comme d'ordre « politique » ; on
observe aussi que les deux partis dans la polémique opposant
les Chiites aux Abbassides employèrent des armes plus
insidieuse que les vers, comme des faux ḥadīṯ ainsi que des
accusations de falsifier le texte du Coran. Cependant, la
propagande de la dynastie n'était pas dirigée contre les seuls
Chiites. Déclarant avoir inauguré un régime calqué sur celui
du prophète de l'islam et des premiers califes, les souverains
abbassides, particulièrement al-Mahdī (règne de 15 h/775 à 169
h/785), persécutèrent impitoyablement à la fois les hérésies
et la résurgence des croyances préislamiques sous le nom vague
de zandaqa. Ainsi le poète Marwān b. Abī al-Ǧanūb b. Abī Ḥafṣa
(m. 181 h/797-98), qui gagna plus tard la faveur de Hārūn al-
Rašīd en composant des vers contre les Chiites, se gagna les
bonnes grâces du calife al-Mahdī au moyen du compliment
suivant 24:
The commander of the Faithful Muḥammad [al-Mahdī] has revived
the sunnah
of the Prophet regarding what is unlawful (ḥarām) and what
is lawful (ḥalāl) !25
En revanche, ce fut au nom de la sunna, parce qu'il avait
compris le danger pour l'Etat de doctrines contraires au
sunnisme, qu'al-Mahdī ordonna la mise à mort de Baššār b. Burd
24 R. RUBINACCI, « Chapter 11 : Political Poetry », p.194-195, dans ‘Abbasid Belles-Lettres, op. cit.
25 ABŪ 'L-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al-Aġānī, IX, 45 d'après The Cambridge History of Arabic Literature, ‘Abbasid Belles-Lettres, op cit., Chapter 11 : Political Poetry, R. Rubinacci, p.195
20
et Ṣāliḥ b. ‘Abd al-Quddūs ; en effet, Baššār ne dissimulait
pas ses sympathies pour les mawālī persans et on dit qu'il
professait une doctrine hétérodoxe qui incluait apparemment
des croyances manichéennes teintées de zoroastrisme ; Ṣālīḥ b.
‘Abd al-Quddūs, lui fut accusé de dualisme (thanawiyya), et l'on
raconte qu'il scella son sort en avouant à al-Mahdī qu'il
était bien l'auteur des vers suivants :26
The greybeard will not leave what in the bone is bred
Until the dark tomb covers him earth o'erspread ;
For, tho'deterred awhile, he soon returns again
To his folly, as the sick man to his pain.27
Mais le calife, malgré son importance, n'était pas le seul
membre de la cour auquel était dédié des panégyriques, les
fameux Barmécides, par exemple, avaient un véritable génie
pour la publicité et la promotion de leurs succès. Ainsi, s'il
y eût de nombreux gouverneurs du Khorassan durant le règne de
Hārūn al-Rašīd mais pour la grande majorité d'entre eux ce ne
sont guère plus que des noms : seul Faḍl le barmécide a eu ses
exploits enregistrés dans les chroniques et seul Faḍl fut loué
dans un long poème au rythme sonore par le plus grand
panégyriste du moment, Marwān b. Abī al-Ǧanūb b. Abi Hafṣa28 :
Gentle he was to all who gave the Caliph obedience
But he poured the blood of rebels for Indian swords to drink
His blades brought hypocrites and unbelievers low26 R. RUBINACCI, « Chapter 11 : Political Poetry », p. 195, dans ‘Abbasid
Belles-Lettres, op. cit.27 Traduction : Nicholson, Literary History, p. 374 d'après R. RUBINACCI,
« Chapter 11 : Political Poetry », p. 195, dans ‘Abbasid Belles-Lettres, op. cit.28 H. KENNEDY, The Court of the Caliphs : The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty, Londres
2004, p. 64.21
An ever lasting glory for the people of the Faith29.
Cette évocation martiale des « épées indiennes buvant le sang
versé des rebelles » (l'Inde était à l'époque réputée pour la
qualité de son fer) au deuxième vers et des « lames qui
jettent à bas les hypocrites et les incroyants » est typique
de la rhétorique du panégyrique officiel qui avait une
prédilection certaine à exalter les vertus guerrières du
mamdūḥ.
Autre célèbre exemple de qaṣīda dans une forme on ne peut plus
classique, car tripartite, est donné par le poème d' Abū Nuwās
à la gloire de al-Faḍl b. al-Rabī‘, ennemi juré des Barmécides
qui remplaça Ǧa‘far comme vizir après la terrible disgrâce de
ce dernier.
Voici un extrait de la troisième partie du poème, le madīḥ, qui
est un éloge de Faḍl :
[…]
29 O Fadl ! Tes bienfaits sont inappréciables.
Quand les gens n'ont aucun recours contre la peur
30 et nul asile en cas de sourd malheur,
31 ils gémissent, deviennent méfiants, irritables.
Ils n'ont plus que ton bras pour chasser leurs soucis.
32 C'est par toi seulement que s'arrangent, en somme, nos
affaires. A toi merci !
33 Tu es comme un soleil incarné dans un homme !
[…]30
29 AL-ṬABARI, Muhammad ibn Jarīr, Annales, éd. M.. J. DE GOEJE et al. Vol. III (Leyde, 1879-1901), p. 635-637 d'après H. KENNEDY, The Court of the Caliphs : The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty, Op. Cit., p. 64.
30 ABÛ-NUWÂS, Le vin, le vent, la vie, trad. fr. V. M. MONTEIL, Arles 1998 (La petite bibliothèque de Sindbad), 190 p. (éd. Précédentes 1979, 1990), p.
22
Le destin ou temps (al-dahr, al-ayyām, al-layālī, al-zamān, etc...) est
la force majeure du monde décrit dans l'introduction, c'est-à-
dire dans la première partie d'une qaṣīda. Ceci est
particulièrement vrai dans le cas où l'ode commence par la
traditionnelle description des vestiges du campement abandonné
par la bien-aimée ; alors que dans le madīḥ, la deuxième partie,
le calife, en tant que représentant de Dieu sur terre, est le
pouvoir suprême.
Ainsi, le destin ne suit aucun principe d'ordre. Il crée la
vie et sème la mort de façon indistincte, et dans toutes les
situations, le bon et le mauvais, le négatif et le positif
s'annulent. L'être humain est ainsi laissé à la merci des
éléments et ne peut pas s'épanouir comme on le voit lors de la
séparation entre le poète et sa bien-aimée.
Au contraire, le pouvoir du calife n'est pas arbitraire mais
en accord avec la vertu, la justice et la volonté divine. Son
accession au trône marque la défaite de la fatalité ; comme
prix, il acquiert un pouvoir de vie ou de mort sur ses sujets.
Avec ses pouvoirs de force vitale, il protège et nourrit ses
sujets, et tourne les forces de mort contre ses ennemis.
Ceci est illustré par les vers suivants d' Abū Tammām (m. v.
231-232 h/845) :
« Nous prenons plaisir dans son pouvoir malgré la fatalité.
Quelqu'un peut-il s'opposer à un ordre prononcé par celui qui
est sur le trône ?
Il va mourir celui qui offre son cœur au bord d'un fer de lance
dont le manche est mis en action par la main de Dieu »31.
127.31 S. SPERL, « Islamic Kingship and Arabic Panegyric Poetry in the Early 9th 23
Cependant, la relation entre le destin et le souverain a un
« contrepoint élégiaque ». Même doté d'un très grand pouvoir,
le calife ne peut finalement jamais conjurer la fatalité.
Comme le héros pré-islamique, il est empêtré dans un combat
permanent : Il est incessamment forcé de réaffirmer l'ordre
divin face à un chaos qui peut revenir à tout moment.
Dans cette lutte sans fin, le panégyrique (qaṣīda) a sa place.
En effet, dans celui-ci, la fatalité est toujours défaite à
chaque fois, la souveraineté du monarque réaffirmée, la
victoire finale est ainsi rendu possible.
Ces panégyriques « royaux » sont ainsi l'expression rituelle
des valeurs fondamentales et de l'idéal politique de l'état
abbasside. Ils possèdent une structure stéréotypée avec
beaucoup de répétitions et un grand formalisme car il n'était
pas dans la tâche du poète de prouver sa capacité à être
inventif. En effet, celui-ci devait plutôt « ré-explorer » et
remanier les éléments préexistant de la qaṣīda afin de mettre
l'emphase sur les significations fondamentales de sa
structure32.
En tout cas, il est certain que le panégyrique ne cherche pas
à faire le portrait du monarque en tant qu'individu. Au lieu
de cela, il exalte le rôle du califat qui est rempli par un
individu.
En fait, tous ces éléments suggèrent que la récitation
publique de panégyriques est un acte rituel qui célèbre une
certaine vision de l'autorité politique dans l'état
abbasside : une monarchie de droit divin, unique garantie de
Century »,op cit., p. 32.32 Ibid, p. 33.24
paix et de stabilité pour le royaume.
Les récompenses somptueuses du poète de cour font partie
intégrante de la cérémonie rituelle : il s'agit d'une
manifestation publique de la générosité du calife et symbolise
la fonction de « donneur de vie » du monarque.
Les conclusions précédentes sur la forme et la fonction des
poèmes dédiées aux califes peuvent aussi être appliquées, avec
des modifications mineures, aux autres panégyriques qui
remplissent les dīwān-s, les recueils de poésie, des poètes
professionnels Abū Tammām et de son élève al-Buḥturi (m. 284
h/897). Ceux-ci faisant l'éloge de notables, de chefs
militaires ou de gouverneurs des provinces de l'empire. Leurs
structures thématiques diffèrent à peine de celle des poèmes
adressés au calife, et l'idéal humain de responsabilité
sociale et de bonne gouvernance qu'ils déclament reste pour
l'essentiel la même. La différence entre les panégyriques
adressés au calife et les autres est de degré, non de nature :
ils sont tous représentatifs de l'autorité de l'état, de
personnes ayant des pouvoirs importants, de leaders33.
De plus, ce modèle de poème avec une interaction entre
strophes et antistrophes n'est pas spécifique des panégyriques
abbassides. En fait, on peut faire remonter les origines de ce
modèle aux poèmes arabes les plus anciens. Même chose
concernant le caractère rituel des panégyriques. La
résurrection de la société provoquée par le souverain est un
thème aussi important dans les poèmes que al-Nābiġa (m. v.
600), un des poètes les plus célèbres du temps de la ǧāhiliyya, a
écrit pour les souverains Ġassānides, une dynastie arabe pré-
islamique, vassale des Byzantins, dont le territoire33 Ibid, p. 34.25
s'étendait aux confins syriens de l'Arabie, que dans le dīwān
d'Abū Tammām en pleine période abbasside.
En fait, les véritables origines de ce rituel et de ces
métaphores par lesquelles s'expriment les éloges doivent être
recherchées dans la vision de l'autorité politique qui était
traditionnellement célébrée dans le proche orient antique.
Dans leurs panégyriques adressés au calife abbasside, les
poètes redonnent vie à cette tradition avec majesté et
splendeur. Ce qui les distingue de tous les autres
panégyriques en arabe est l'image qu'ils montrent de
l'autorité du calife : comme les rois de Babylone ou les
pharaons d'Egypte, il est le souverain du monde, celui qui est
choisi par Dieu pour apporter la prospérité et la justice dans
son royaume.
Cette toute-puissance du calife est illustrée par l'extrait
suivant du poète al-Buḥturī au calife al-Mutawakkil (règne de
232 h/847 à 247 h/861):
Tu es pour toujours une mer de nourriture pour ceux qui en ont
besoin parmi nous !
Comment cela peut-il se faire, puisque vous vous tenez devant
nous possédant le monde et tout ce qu'il contient ?Dieu vous l'a octroyé comme un droit car il vous en a jugé
digne,
Et vous, de droit divin nous l'a octroyé34.
Toute cette impressionnante production de poésie n'est pas
gratuite. Elle est rétribuée, souvent à la mesure de l'effet
produit sur le mécène. C'est à ce phénomène de rétribution des
34 Ibid, p. 35.26
poèmes
panégyriques produits par les poètes professionnels que nous
allons maintenant nous intéresser.
- Récompenses et châtiments
D'une manière ou d'une autre, les panégyriques produits par
les poètes professionnels sont rétribués. A l'époque
abbasside, comme le suggère J.E. Bencheikh, « le mécénat règne
et contrôle la majeure partie d'une production poétique mise
au service de ceux qui ont les moyens de se la voir offrir, et
d'ailleurs qui la paient »35. Il s'agit en général d'une
rétribution d'ordre financier, mais celle-ci peut également
exister sous une autre forme, comme celle de postes dans
l'administration califale ou même celle de dons plus ou moins
excentriques.
Le premier des mécènes est, bien entendu, le Calife lui-même.
Ainsi, d'après le Kitāb al-Aghāni d'Abū-l-Faraǧ al-Iṣfahānī, le
poète Ašǧa‘ b. ‘Amr al-Sullamī (m. 195 h/811), récemment
arrivé de Baṣra, la métropole de la Basse-Mésopotamie située
sur le Chatt el-Arab, estuaire commun des fleuves Tigre et
Euphrate dans le golfe Persique, sut conquérir, à Bagdad,
l'agrément du calife Hārūn al-Rašīd (règne de 170 h/786 à 193
h/809). Lors d'une récitation collective de poésie à la cour,
il reçut en cadeau du calife la somme énorme de 20 000
dirhams, une monnaie d'argent, soit le double de celle qu'ont
35 J. E. BENCHEIKH, « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil (m.247) contribution à l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires », Bulletin d'études orientales, XXIX, Damas, 1977, p. 33-52.
27
reçue les autres poètes36.
De même, le célèbre poète Abū al-‘Atāhiya quitte Kūfa où il
exerçait le métier de potier pour Bagdad où il devient
rapidement membre du cercle du calife al-Mahdī. Arrivé au
pouvoir, al-Rašīd lui attribue une allocation de 50 000
dirhams, à laquelle s'ajoutent les récompenses ponctuelles du
calife ou de ses proches, dont certains lui assuraient
également une allocation annuelle37. En effet, ce calife était
connu pour faire bénéficier ses poètes panégyristes de
pensions parfois importantes, cependant cette politique semble
avoir été peu à peu abandonnée par ses successeurs38.
De cette manière, certains grands poètes panégyristes
deviennent très riches, tels al-Buḥturi qui chanta les califes
al-Mutawakkil (règne de 232 h/847 à 247 h/861), al-Muntasir
(règne de 247 h/861 à 248 h/862), al-Musta‘īn (règne de 248
h/862 à 252 h/866), al-Mu‘tazz ( 252 h/866 à 255 h/869), al-
Muhtadī (règne de 255 h/869 à 256 h/870), al-Mu‘tamid (règne
de 256 h/870 à 279 h/892) et al-Mu‘tadid (règne de 279 h/892 à
289 h/902). Il acquit ainsi une fortune immense39 qui lui
permit d'acheter des propriétés et il usa même de son
influence à la cour pour tenter de se soustraire à l'impôt
foncier du ḫarāǧ auquel il était astreint40.
36 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al -aġānī, t. XVIII, p. 219-221 d’après J. BERQUE, Musiques sur le fleuve Les plus belles pages du Kitāb al-Aghāni, Paris 1995, op. cit., p.127-128..
37 K. ZAKHARIA, « Chapitre XXIII : La poésie solennelle », p. 350, dans T. BIANQUIS, P. GUICHARD, M. TILLIER (sous la direction de), Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, Paris 2012 (Nouvelle Clio), 704 p.
38 D. SOURDEL, L'état impérial des califes Abbassides VIIIe-Xe siècle, Paris 1999 (Islamiques), p. 215.
39 Ibid.40 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au IIe
et IIIe siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique », Journal asiatique, 263, Paris, 1975, p. 265-316.
28
Cependant, les califes n'ont certainement pas l'apanage du
panégyrique, et les poètes de métier peuvent aussi gagner leur
vie en louant les grands de la cour dont les cadeaux peuvent
également être somptueux.Par exemple, le poète Abū l-Simṭ
Marwān b. Abī al-Ǧanūb b. Abī Ḥafṣa (m. 181 h/797) se retrouve
récompensé de la somme de 100 000 dirhams pour avoir exalté
les prouesses guerrières du chef militaire Ma‘n b. Zā'ida (m.
152 h/769-70). En effet, ce dernier a porté secours au calife
al-Manṣūr, alors assiégé dans sa résidence d'al-Hāšimiyya,
ville située dans les environs de Kūfā, par des extrémistes
chiites, les rāwandiya41. Comme le poète le décrit dans les vers
suivants, où le calife est nommé « le vicaire du Dieu
clément » :
A la journée d'al-Hāšimiyya, tu n'as cessé de brandir ton
sabre pour protéger le vicaire du Dieu clément.
Tu as interdit son abord et défendu sa vie contre l'atteinte
des glaives acérés et des lances42.
De même al-Faḍl b. Yaḥyā le Barmécide (m. 193 h/808), le
célèbre vizir du calife Hārūn al-Rašīd, récompense le poète
‘Abdallah al-Taymī en lui allouant la somme de 8 000 dirhams
pour un poème à sa gloire qui lui a été transmis43.
Cependant, ces sommes que les poètes reçoivent des grands de41 D. SOURDEL, L'état impérial des califes Abbassides VIIIe-Xe siècle, Paris 1999
(Islamiques), p. 33.42 MAS‘ŪDI, Les prairies d'or, trad. fr. C. BARBIER DE MEYNARD et A. PAVET DE
COURTEILLE revue et corrigée par C. PELLAT, Paris 1962-1997 t. IV 1989 t. V 1997, (Société Asiatique collection d'ouvrages orientaux), 5 tomes, t. IV, p. 966, § 2380.
43 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ , Kitāb al-aġānī, t.XX, p. 264-266 d’après J. BERQUE, Musiques sur le fleuve Les plus belles pages du Kitāb al-Aghāni, Paris, 1995, p. 61.
29
la cour abbasside se doivent d'être mesurées et rester
toujours inférieures à celles accordées par le calife. Ceci
est d'ailleurs dit explicitement dans un extrait des Prairies d'Or
de Mas‘ūdi que voici :
[…] le poète al-Husayn b. ad-Dahhâk (al-Ḥusayn b. al-
Ḍaḥḥāk) al-Khalî‘ se tenait devant le calife. Ce dernier fit
signe à un jeune esclave doué d'une physionomie charmante de
verser une coupe de vin et de le saluer en lui offrant une rose
(var. : « une pomme ») d'ambre gris ; après quoi al-Mutawakkil,
se tournant vers le poète, lui demanda quelques vers de
circonstance ; al-Husayn improvisa ceux-ci :
[Beau] comme une perle brillante, il m'a salué en me donnant une rose
d'ambre ; il marchait vêtu d'une tunique couleur de rose.
Les œillades qu'il mêlait à chacun de ses saluts jetteraient le trouble
dans le cœur d'un sage.
[VII, 278] Je voudrais que sa main me versât la douce liqueur qui me
rappelle des serments maintenant oubliés.
Bénis soient ces temps fortunés où, à chaque heure de mes nuits, se
réalisait une promesse d'amour !
Al-Mutawakkil le complimenta et lui fit donner cent dinars pour
chaque vers. Mohammad b. ‘Abd Allâh dit alors au calife : « Cet
homme a répondu avec empressement [à ton ordre], il a rappelé
des souvenirs et avivé [notre] douleur ; en vérité, s'il
n'était défendu qu'une main se montrât plus généreuse que celle
du calife, je ferais au poète un magnifique cadeau, dussé-je y
consacrer ma fortune entière ». A la suite de cette
[observation], al-Mutawakkil fit donner au poète mille dinars
par vers.44
44 MAS‘ŪDI, Les Prairies d'or, Op cit., tome V, p. 1209, § 2962.30
La récompense du poète Ḥusayn b. al-Ḍaḥḥāk pour la description
d'un échanson se voit ainsi décuplée par l'observation d'un
courtisan qui se garde bien d'enfreindre le tabou de donner au
poète une somme supérieure à la faible récompense donnée par
le calife mais qui a néanmoins l'audace de déclarer qu'il le
ferait s'il en avait la possibilité. Ceci entraîna une réponse
immédiate du calife consistant en un don beaucoup plus
important que celui prévu initialement.
Autre cas illustrant cette règle quasi-sacrée du don califal
supérieur à tout autre : lorsque le poète et érudit al-Naḍr b.
Shumayl (m. 204 h/820) se voit récompensé, non pas pour un
panégyrique, mais pour ses connaissances poétiques en langue
arabe par le calife al-Ma'mūn (règne de 197 h/813 à 218 h/833)
lors de son séjour à Merv, dans le Khorassan (l'Iran
oriental), de la somme de 50 000 dirhams alors qu'al-Faḍl b.
Sahl (m. 202/818), son vizir, ne lui en donne que 30 00045.
Si les récompenses des panégyristes les plus communes sont
d'ordre financier, elles peuvent également se concrétiser en
don de terres comme dans le cas du poète esclave noir
affranchi par al-Mahdī Nuṣayb al-Aṣġar (m. 175 h/791) dont il
était devenu le familier et qui, une fois sur le trône, lui
offrit une propriété dans le Sawād (Basse-Mésopotamie)46.
Les récompenses peuvent même être des postes dans
l'administration califale, par exemple, sous le califat d'al-
Ma'mūn, le célèbre vizir al-Faḍl b. Sahl est le protecteur du45 HILĀL AL-ṢĀBI' (ṢĀBI', Hilāl ibn al-Muhassin) Rusūm Dār al-Khilāfah (The Rules
and Regulations of the ‘Abbāsid Court), trad. de l’arabe avec introduction et notes de E. A. SALEM, Beyrouth 1977 (UNESCO collection of representative works:Arabic series), p. 47-48.
46 C. PELLAT, « Nuṣayb », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
31
poète Muslim b. al-Walīd (m. 208 h/823) et obtient pour lui
auprès du calife une fonction publique, vraisemblablement le
poste de ṣāhib al-barīd, c'est-à-dire de responsable des postes47, à
Ǧurğān, une province d'Iran située à l'angle sud-est de la mer
Caspienne48. De même le calife al-Mutawakkil, protecteur du
poète Marwān b. Abī al-Ǧanūb b. Abī Ḥafṣa qui est admis dans
son cénacle, n'hésite pas à lui accorder le gouvernorat d'al-
Yamāma et de Baḥrayn en Arabie49.
Dans certains cas, la poésie peut même s'avérer être un
tremplin vers une brillante carrière de secrétaire. Ainsi le
futur vizir Muḥammad b.‘Abd al-Malik al-Zayyāt (m. 233 h/847)
voit-il sa carrière s'amorcer grâce à une qaṣīda en l'honneur
d'al-Ḥasan b. Sahl (m. 236/850-1), influent secrétaire et
gouverneur du calife al-Maʾmūn et frère du vizir al-Faḍl b.
Sahl50.
Enfin, les rétributions attribuées au poète panégyriste
peuvent être plus ou moins excentriques selon le bon vouloir
du mécène. Ainsi l'histoire du sabre as-Ṣamṣāma, « Al-Mahdī
avait donné à son fils Mūsā [le futur calife al-Hādī qui régna
de 169 h/785 à 170 h/786] le [fameux] sabre nommé as-Ṣamṣāma,
qui avait appartenu à ‘Amr b. Ma‘dīkarib [célèbre guerrier
arabe et poète muḫaḍram, c'est-à-dire contemporain du prophète
de l'islam. Il est représenté comme un guerrier doté d'une
force physique peu commune qui participa à de nombreux combats
47 D. SOURDEL, « Barīd », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.48 I. KRATSCHKOWSKY, « Muslim b. al-Walīd », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.49 J. E. BENCHEIKH, « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil (m. 247)
contribution à l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires », Bulletin d'études orientales, 29, Damas 1977, p 39-40
50 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au II e et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique », op. cit.
32
pendant la Ǧāhiliyya51]. Devenu calife, al-Hādī se fit, un jour,
apporter ce sabre, le plaça devant lui, avec un panier plein
de dinars [monnaie d'or] et, ayant ordonné à son chambellan de
laisser entrer les poètes, il les invita à choisir le sabre
pour sujet de leurs vers.
Ibn Yamīn al-Baṣrī prit le premier la parole et dit :
Mūsā al-Amīn, seul entre tous les hommes, possède la Ṣamṣāma de ‘Amr az-Zabīdī,
Le sabre de ‘Amr, qui fut, d'après la tradition, la plus noble lame que fourreau ait
renfermée.
La foudre lui a communiqué ses étincelles, la mort l'a trempé dans son poison
foudroyant.
Quand tu le tires du fourreau, c'est un soleil dont la splendeur peut à peine être
contemplée.
L'éclat et la trempe qui circulent sur ses deux faces ressemblent à une eau limpide ;
Et quand vient le moment de frapper, peu importe que ce soit avec le tranchant de
droite, ou celui de gauche.
« Prends le sabre et la corbeille de dinars, dit le calife au
poète ; je te les donne l'un et l'autre ». Celui-ci distribua
l'or aux autres poètes en leur disant : « Vous étiez venus en
même temps que moi ; c'est à cause de moi que vous n'êtes pas
récompensés ; et ce sabre me tient lieu de tout autre
salaire ». Le calife le lui fit racheter au prix de cinquante
mille [dirhams] »52.
Cette anecdote nous montre bien que le don du sabre constitue
une source de revenu non négligeable pour un poète
professionnel étant donné qu'il le revend pour la somme
importante de 50 000 dirhams.
Dans le même ordre d'idées, le poète Ḥusayn b.al-Ḍaḥḥāk al-51 C. PELLAT, " ʿAmr b. Maʿdīkarib" dans Encyclopédie de l’Islam, op. cit.52 MAS‘ŪDI, Les Prairies d'or, op cit., p. 1014, § 2490-2491.33
Bāhilī, surnommé al-Ḫalīʿ « le débauché » (m. v. 250 h/864)
reçoit en 218 h/832 comme récompense pour son premier
panégyrique sous le califat d'al-Mu‘taṣim qu'on lui remplisse
la bouche de perles dont on fit ensuite un collier, sur ordre
de celui-ci, « afin que personne ne pût ignorer l'estime en
laquelle il tenait le poète »53. Là encore il s'agit du don
d'objets précieux, des perles, que le poète pourra conserver
pour rappeler à tout un chacun la faveur dont il jouit auprès
du calife ou revendre.
Enfin, autre exemple, lors d'une récitation de vers dont le
début est cité par le calife Hārūn al-Rašīd et la suite par le
poète aveugle Baššār b. Burd, ce dernier reçoit comme
récompense pour sa mémoire phénoménale la cape du calife qu'il
revend 400 dinars54.
Malgré le fait que la générosité du protecteur fasse partie
intégrante, même si ce n'est pas explicité, du rituel de
récitation d'une ode panégyrique, les exigences du poète ne
sont pas systématiquement couronnées de succès, surtout
lorsqu'elles se heurtent au pouvoir de la fonction califale.
Comme l'illustre cette anecdote biographique (aḫbār) concernant
Abū al-‘Atāhiya, qui vise à nous présenter une histoire vraie
de désir et de renoncement. En effet, dans le Kitāb al-Aġānī, on
peut lire la passion qu'éprouve Abū al-‘Atāhiya pour ‘Utba,
une esclave appartenant à une parente du calife al-Mahdī, et
les efforts du célèbre chanteur Yazīd Ḥawrā' pour aider le
poète fou d'amour :
53 C. PELLAT, « Ḥusayn b. al-Ḍaḥḥāk », dans Encyclopédie de l’Islam, op. cit.54 BERQUE Jacques, Musiques sur le fleuve Les plus belles pages du Kitāb al-Aghāni, op cit.,
p. 141.34
Yazīd Ḥawrā' était un ami d'Abū al-‘Atāhiya. Ainsi Abū
al-‘Atāhiya composa des vers au sujet de‘Utba dans lesquels il
demande à al-Mahdī de tenir sa promesse de le marier à ‘Utba,
ainsi quand [Yazīd] trouverait al-Mahdī de bonne humeur, il
pourrait les lui chanter. Les voici :
J'ai respiré à plein poumons le vent en espérant y sentir
le parfum dont je me languis
Et je l'ai trouvé dans la brise de tes deux mains.
J'ai entraîné mon âme à boire l'espoir en toi
Qui m'a porté vers toi au trot et au galop,
Et je jette mon regard au ciel de ta nuée d'orage,
Regardant la foudre, regardant la pluie,
J'étais sur le point de désespérer, puis je me suis dit,
« Non,
Assurément, celui qui est la source de tout succès est
généreux. »
Donc [Yazīd] composa une mélodie pour aller avec les paroles,
attendit le moment où il trouverait al-Mahdi de bonne humeur et
la lui chanta. Dès lors [al-Mahdī] appela Abū al-‘Atāhiya et
lui dit : « Concernant ‘Utba, tu ne l'auras jamais car sa
maîtresse l'a interdit. Mais voici cinquante mille dirhams.
Utilise les pour acheter [une esclave] meilleure que ‘Utba. »
On lui donna l'argent et il s'en alla.55
55 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al-Aġānī, 3:1097-98 d'après PINCKNEY STETKEVYCH Suzanne, The Poetics of Islamic Legitimacy : Myth, Gender, and Ceremony in the Classical Arabic Ode, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2002, p.150-151
35
Cette anecdote fait partie d'une série créant une sorte
d'histoire d'amour qui culmine au moment où Abū al-‘Atāhiya
renonce à obtenir l'objet de son désir, sa bien-aimée ‘Utba,
et quitte la cour pour se consacrer à la poésie ascétique. On
peut ainsi considérer du fait de cette tradition que l'esclave
du calife évoquée dans le poème «Ma maîtresse timide » n'est
autre que ‘Utba. Finalement, cette anecdote est un exemple
d'échec du cérémonial de récitation de la qaṣīda. Comme nous
l'avons vu, la cérémonie de récitation du panégyrique nous
montre que, en particulier pour ce qui concerne les rituels
d'échange, le poète a toutes les raisons de s'attendre que sa
requête soit tenue ; car il s'agit du rôle du mécène dans la
cérémonie, sa part du contrat. En effet le dernier vers du
poème chanté par Yazīd signifie quelque chose de très proche
de « le calife n'est pas quelqu'un qui ne tient pas ses
promesses », alors que c'est exactement ce qu'il fait. Ici le
point important est bien que les droits du calife annulent les
exigences sous-entendues par le cérémonial de la récitation de
la qaṣīda car dans ce cas précis le calife choisit sciemment de
ne pas outrepasser les droits de sa parente concernant
l'avenir de son esclave. Il est ainsi possible d'en déduire
que, dans certains cas, en particulier celui du calife, le
patron a une autorité suffisante pour ne pas tenir compte des
exigences du rituel et du cérémonial et donc le pouvoir de
frustrer les espérances du poète.56
Cependant, si généralement, les protecteurs se montrent
généreux à l'égard de leur poète, dans certains cas, ceux-ci
56 S. PINCKNEY STETKEVYCH, The Poetics of Islamic Legitimacy : Myth, Gender, and Ceremony in the Classical Arabic Ode, Bloomington Indianapolis 2002, p. 151.
36
peuvent au contraire se montrer féroces envers eux. Ainsi
Aḥmad b. Muḥammad al-Mudabbir (m. v. 270-271 h/883) a la
réputation d'être peu amène avec les poètes qui osent faire
son panégyrique, en effet il leur infligeait, s'il les jugeait
mauvais, une prière de cent rak‘a57. D'une manière peut-être un
peu plus subtile, on trouve dans Les Prairies d'Or un cas flagrant
de désintérêt, voire de mépris, du calife al-Mutawakkil pour
un panégyrique du grand poète al-Buḥturi.
En arrivant à Sâmarrâ, je fus introduit chez al-Mutawakkil ;
[…]. Ensuite le poète al-Buhturî (al-Buḥturī) qui se tenait
debout devant le calife, commença à réciter un poème à sa
louange : […]. Voici le début de la qasîda d'al-Buhturî :
De quelle bouche tu souris, de quel regard [sévère] tu
rends tes jugements !
Ta beauté brille de son propre éclat, et la beauté
convient bien à ta munificence.
Dis au calife Dja'far al-Mutawakkil, fils d'al-Mu'tasim,
[VII, 203] Au [souverain] bien-aimé, fils de l'Elu, au
bienfaiteur, fils du vengeur :
Quant à tes sujets, leur bonheur est inviolable, sous
l'égide de ta justice ;
Mais toi qui as relevé l'édifice de la gloire renversé et
en ruine,
Conserve-toi pour la religion de Muhammad, car son salut
dépend du tien.
Après l'aveuglement, nous avons trouvé, grâce à toi, la
lumière, et après le dénuement, la richesse.
57 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au IIe et IIIe siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique » , op. cit., p. 289.
37
Quand il eut dit ce dernier vers, le poète marcha à reculons
pour se retirer, mais Abû l-‘Anbas, se levant vivement de sa
place, dit au calife : « Commandeur des Croyants, ordonne qu'on
le ramène, car en vérité j'ai trouvé la parodie de son poème ».
Sur l'ordre d'al-Mutawakkil, le poète revint sur ses pas, et
Abû l-‘Anbas se mit à débiter les vers suivants que nous
eussions passés sous silence si ce n'était tronquer
l'anecdote :
Dans quelle fange es-tu embourbé ? De quelle main
pourras-tu manger ?
Tu as introduit dans une matrice la tête d'Abû ‘Ubâda al-
Buhturî ...
Et il ajouta d'autres vers pleins d'injures du même genre.
Al-Mutawakkil fut pris d'un tel accès de rire qu'il tomba en
arrière en trépignant du pied gauche, puis il gratifia Abû
l-‘Anbas d'un don de dix mille dirhams. Al-Fath b. Khâqân lui
dit alors : « Sire, et al-Buhturî ? Après avoir été accablé
d'invectives et abreuvé d'injures, faut-il qu'il s'en aille les
mains vides ? ». Le calife lui fit donner dix mille dirhams.
[…] Nous nous retirâmes ainsi sous les auspices de cette
bouffonnerie, sans qu'al-Buhturî ne tirât aucun avantage
particulier de son application, de ses efforts et de son
talent.58
En effet, sans l'intervention du vizir et intime d'al-
Mutawakkil al-Fatḥ b. Ḫāqān, le poète al-Buḥturi se serait vu
privé d'une rétribution à laquelle il a légitimement droit de
58 MAS‘ŪDI, Les Prairies d'or, op. cit., tome V, p. 1180-1181, § 2885 à 2887.38
par la tradition du rituel de récitation de la qaṣīda, alors que
son agresseur, l'amuseur Abū al-‘Anbas, a été immédiatement
récompensé par un calife riant aux éclats de cette parodie
d'un goût douteux.
Un cas extrême est même relaté dans le Kitāb al-Aġānī où personne,
même Yaḥya b. Ḫālid le Barmécide (m. 190 h/806), n'ose
informer le calife al-Rašīd de la trahison d'un certain Naqfūr
(appelé étrangement « roi des byzantins »), tous les poètes,
malgré les promesses d'être généreusement rétribués,
refusèrent de chanter un poème de leur composition annonçant
au calife la nouvelle. Pourtant, finalement, un poète de
Djadda, une ville d'Arabie, du nom d'Abū Muḥtamad accepta car
il était doté « d'une audace à toute épreuve ». Il reçut alors
des Barmécides la somme de 100 000 dirhams et s'acquitta de sa
mission en chantant au Calife des vers l'informant de « La
trahison de Naqfūr et l'invitation au calife de reprendre le
combat ; la victoire lui étant assurée »59
Cependant, lorsque les rétributions sont jugées médiocres par
le poète, celui-ci a toujours la possibilité de composer un
poème satirique afin d'humilier le mécène qui l'a déçu, c'est
ce que nous allons voir dans la prochaine partie consacrée au
genre satirique.
2) Le genre satirique
Arme ultime du poète de cour, la satire ou poésie injurieuse59 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHÂNĪ, Kitāb al-Aġāni, t. XVIII, p. 239, 240,240,241,242
cit.é dans la thèse de N. EL KHATIB, Etude historique de l’époque abbasside à travers le Kitâb al-Aghânî, Paris 4, 1975, 356 p., (dact.).
39
se nomme en arabe hiǧā' et est, selon Qudāma b. Ǧa'far (m. v.
328/939-40), le célèbre philologue, historien et critique qui
fut l'un des premiers à introduire l'étude systématique des
figures de rhétorique dans la littérature arabe60, « le
contraire du madīḥ ». C'est même, pour Ibn Manẓūr (m. 711/1311-
12), auteur du célèbre dictionnaire le Lisān al-‘Arab61, « l'injure
au moyen de la poésie ». Il peut avoir la forme d'un court
poème ou constituer la troisième partie d'une qaṣīda62.
Personne d'autre que le poète Di‘bil (m. 246 h/860), célèbre
pour ses satires, n'explique plus clairement le rôle joué par
ce genre poétique à la cour abbasside :
« Selon une information de Muhammad b. ‘Imrān, à lui venue deAbū Ḫālid al-Ḫūzā'ī, celui-ci rapportait :
J'ai dit à Di‘bil : « Misérable ! Tu as écrit force satires
contre les califes et les vizirs et les généraux, soulevant
contre toi la vindicte générale. Aussi, te voilà pour toujours
un vagabond traqué, apeuré ! Que ne te retiens-tu de cette
manie et ne t'épargne-tu cette disgrâce ?
Moi, misérable ? En quoi ? C'est à bon escient que je fais tout
cela. J'ai remarqué que de la plupart des gens on ne tire parti
qu'en leur faisant peur. On ne se soucie du poète, même
talentueux, que si l'on craint sa malfaisance. On a pour lui
plus d'égard pour sauver sa réputation que de gratitude à être
encensé. Car les vices des gens sont plus nombreux que leurs
qualités. Qui tu honores n'en est pas plus honorable, non plus
que quiconque tu qualifies de généreux, de glorieux, de
courageux sans qu'il le soit ne profite de l'éloge. Tandis que
60 S. A. BONEBAKKER, « Ḳudāma Ibn Ḏja‘far », dans Encyclopédie de l’Islam, op. cit.61 J. W. FÜCK, « Ibn Manẓūr », dans Encyclopédie de l’Islam, op. cit.62 H. TOELLE, K. ZAKHARIA, A la découverte de la littérature arabe, op. cit., p. 84.40
s'il te voit blesser l'honneur d'un autre et le mettre à mal,
il te comblera d'égards dans son propre intérêt, de peur que
l'attaque ne se reporte sur lui-même. Misérable, Abū Ḫālīd ! La
satire mordante renforce le bras du poète plus efficacement que
l'humiliant panégyrique. »
Ce propos me fit rire, et je lui répondis : « Voici certes le
langage de quelqu'un qui ne mourra pas de mort naturelle ! »63
En effet, une hiǧa' pouvait s'avérer être une autre source de
revenu que le madīḥ car si un poète réussissait à se faire un
nom en tant que satiriste impitoyable, il pouvait envisager
que des personnalités riches et puissantes de la cour achète
son silence par des dons. De fait, on ne sait pas vraiment si
une carrière de satiriste provenait d'une inclinaison
naturelle pour ce genre poétique ou si elle résultait plutôt
d'un calcul financier pragmatique de la part des poètes.
Toujours est-il qu'il s'agissait pour le poète d'une manière
particulièrement risquée et impopulaire de subvenir à ses
besoins car ce type de carrière implique un grand isolement à
la cour mais aussi la possibilité de représailles de la part
des puissants moqués64 comme le montre l'exemple du poète
Di‘bil, effectivement célèbre pour ses satires des califes de
Hārūn al-Rašīd jusqu'à al-Mutawakkil65 ainsi que de plusieurs
grands de la cour, ce qui lui valut des haines solides. Ainsi,
d'après le Kitāb al-Aġānī, Ibrāhīm b. al-Mahdī (m. 224 h/839),
voulut exciter le calife al-Ma'mūn contre le poète qui l'avait
insulté par vers en l'accusant d'avoir également insulté le63 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al-aġānī, t. XX, p. 137 d’après J. BERQUE,
Musiques sur le fleuve Les plus belles pages du Kitāb al-Aghāni, op cit., p. 266-267.64H. KILPATRICK, « The Medieval Arab Poet and the Limits of Freedom », Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), Londres 1979, Volume 6, p. 96-103. p. 99.65 L. ZOLONDEK, " Diʿbil", dans Encyclopédie de l’Islam, op. cit.
41
calife avec les vers suivants :
O masse des soldats, pas de scrupules ! Contentez-vous de ce
qui est. Pas de colère!/ Vous serez gratifiés des chants de
Hunayn [m. 728], dont se délectent l'imberbe et le grisonnant/
quant aux chants de Ma‘bad [m. 743], ils sont pour vous
généreux ! Ils n'entrent ni dans vos bourses ni dans vos
mouchoirs / et c'est ainsi que gagne ses généraux un calife qui
a pour Coran un luth persan !/
Cependant, al-Ma'mūn lui répond en riant : « Tu ne veux me
monter contre lui (…) qu'à cause des vers qu'il t'a décochés »
et que, pour sa part, il a pardonné au poète sa satire à son
égard66.
En effet, la comparaison du calife avec un musicien préférant
jouer de son instrument, le « luth persan » plutôt que de se
livrer à ses devoirs d'ordre politico-religieux, le « Coran »,
est particulièrement insultante. D'autant plus que le
satiriste a également évoqué les célèbres chanteurs Ḥunayn et
surtout Ma‘bad, l'un des plus grands chanteur et compositeur
de l'époque omeyyade et figure par excellence du musicien dans
la poésie arabe (chez Abū Tammām, al-Buhturī, etc...)67, dont
les chants seraient la récompense pour, respectivement, les
soldats et les généraux au lieu du butin tant attendu. Ainsi,
le calife est présenté dans cette satire comme quelqu'un
d'incapable de mener à bien sa mission sacrée de propagateur
de l'islam et qui préfère se consacrer aux futilités que sont
le chant et la musique.66 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al-aġānī, t. XX, p. 133 d’après J. BERQUE,
Musiques sur le fleuve Les plus belles pages du Kitāb al-Aghāni, op cit., p. 266.67 H. G. FARMER, E. NEUBAUER, " Maʿbad b. Wahb", dans Encyclopédie de l’Islam, op.
cit.
42
Cependant, les victimes des satires de Di‘bil n'ont pas
toutes la magnanimité d'al-Ma'mūn.
En plus des califes et d'Ibrāhīm b. al-Mahdī (m. 224 h/839),
prince abbasside fils du calife al-Mahdī connu pour avoir été
proclamé calife à Bagdad sous le règne d'al-Ma'mūn68, ce poète a
également fait la hiǧā' du vizir Ibn al-Zayyāt (m. 233/847), en
poste sous les califes al-Mu‘taṣim et al-Wāṯiq (règne de 227
h/842 à 232 h/847) jusqu'à sa disgrâce au tout début du règne
d'al-Mutawakkil69, pour se venger d'un panégyrique qu'il lui
avait dédié mais qui n'eût pas le succès escompté70 Il en va de
même pour Ḫālid b.Yazīd (m. 269/883), le Kātib, qu'il prend à
partie et reproche d'être un mauvais poète dont les longs
poèmes en l'honneur des victoires d'al-Mu‘taṣim sont mauvais
car l'exercice est trop difficile pour lui71. Même s'il est
sans doute le plus célèbre, d'autres poètes que Di‘bil se sont
illustrés dans le genre satirique comme Muḥammad b. Ḥāzim
b.‘Amr al-Bāhilī, poète satirique de la fin du IIe/VIIIe
siècle et du début du IIIe/IXesiècle connu pour son humour
grinçant et ses rancunes tenaces qui ont fait qu'il poursuivit
plusieurs personnages de la cour sans jamais accepter leurs
excuses72. Satiristes à leurs heures également, les poètes ‘Alī
b.Ǧabala al-‘Akkawak et ‘Alī b. al-Ǧahm (m. 249 h/863) qui se
déchaînent contre le vizir Ibn al-Zayyāt à l'instigation du
68 D. SOURDEL, " Ibrāhīm b. al-Mahdī", dans Encyclopédie de l’Islam, op. cit.69 D. SOURDEL, « Ibn al-Zayyāt », dans Encyclopédie de l’Islam, op. cit.70 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au II
e et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique , op. cit., p. 311.
71 Ibid.72 J. E. BENCHEIKH, « Muḥammad b.Ḥāzim b.‘Amr al-Bāhilī », dans Encyclopédie de
l’Islam, op. cit.
43
grand qāḍī Aḥmad b. Abī Du‘ād (m. 240 h/854), administrateur
générale de la justice de l'Empire et personnalité influente
de la cour abbasside sous le règne des califes al-Muʿtaṣim,
al-Wāṯiq et au début de celui d'al-Mutawakkil. La hiǧā' de ‘Alī
b. al-Ǧahm est d'ailleurs particulièrement violente et montre
bien la liberté de ton dont bénéficiaient les poètes à la
cour73. Enfin, et malgré cette relative liberté de ton dont
bénéficiaient les poètes à la cour abbasside, de nombreux
poèmes satiriques à propos politique sont restés anonymes afin
d'assurer la sécurité de leurs auteurs, il est cependant
certain qu'au moins une partie d'entre eux étaient l'œuvre de
poètes de cour de profession. Par exemple, concernant les
règles de succession très particulières qu'al-Rašīd avait
décidé pour ses deux fils al-Amīn et al-Ma'mūn, a été
conservée une petite pièce en vers dans laquelle le poète
exprime sa consternation devant ce que le calife avait fait :
He tried to prevent quarrels among his sons
And to produce love between them
Yet he has planted hostility without fail
And occasioned battle for their company
And caused violent conflict between them
And strung to their avoidance chains.
Woe to the subjects in a little while
For he has presented them with terrible grief.
Le poème tel qu'il est parvenu jusqu'à nous fut sans doute
rédigé plus tard avec le bénéfice du recul, mais pas besoin
73 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au II e et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique , op. cit., p. 279.
44
d'être un devin pour s'apercevoir que, malgré tous les efforts
d'Hārūn, un drame couvait74.
Autre satire anonyme, nettement plus féroce et grossière, à
l'heure de la guerre entre al-Amīn et al-Ma'mūn qui suivit la
mort d'al-Rašīd, et alors que les troupes de ce dernier,
dirigées par Ṭāhir, progressent vers Bagdad à travers l'Iran,
un poème satirique circule et semble refléter une opinion
largement répandue à Bagdad75 :
The caliphate has been ruined by the vizier's [Faḍl ibn Rabī's]
malice
The Imam's [Amīn's] dissoluteness and the counsellor's
ignorance
Faḍl is a vizier and Bakr a counsellor
Who desire what will be the death of the Caliph
This is nothing but a path of delusion
The worst of roads are the paths of delusion
The Caliph's sodomy is amazing
While the vizier's passive homosexuality is even more so.
One of them buggers, the other gets buggered
That is the only real difference between them.
If the two only made use of each other
They could manage to keep it quiet
But one of them [Amīn] plunged into the eunuch Kawthar
While being fucked by donkeys did not satisfy the other [Faḍl
ibn Rabī]
Lord, take them quickly to Thyself
Bring them to the punishment of hellfire
Make an example of Faḍl and his party
74 H. KENNEDY, The Court of the Caliphs : The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty, op. cit., p. 71.
75 Ibid., p. 96-97.45
And crucify them on the bridges over the Tigris76!
De telles allégations étaient probablement tout à fait
fantaisistes, il n'empêche qu'elles circulaient largement
parmi le peuple de Bagdad qui choisit de les croire.
Tout au long de ces trois parties, nous avons pu mesurer
l'importance des protecteurs dans la carrière des poètes
professionnels, nous nous pencherons maintenant sur les
relations que ces derniers peuvent entretenir avec leurs
protecteurs.
3) Les relations des poètes professionnels avec leurs
protecteurs
La carrière de poète de cour était largement ouverte aux gens
talentueux issus de toutes les classes sociales. Certains
poètes, tel Ibrāhīm b. al-Mahdī, fils du calife al-Mahdī,
venaient des plus hautes sphères du pouvoir, mais d'autres
étaient d'origine vraiment modeste. Bien sûr, pour se faire
connaître, un poète avait besoin d'un patronage ainsi que de
beaucoup de chance s'il en venait à se rendre aux audiences
califales et de nombreux poètes de talents sont sans doute
restés à jamais dans l'ombre. Malgré cela, le degré de
mobilité sociale atteint par les poètes de cour reste
impressionnant et leurs biographies nous donnent une vision
particulièrement précieuse de la façon par laquelle des
personnes extérieures pouvaient se faire une place en tant que
76 AL-ṬABARI, Annales, op. cit., p. 804-805, trad. abrégée avec des variations basées sur Fishbein trad., p. 58-59, le tout incorporant sa lecture du texte ; d'après H. KENNEDY, The Court of the Caliphs : The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty, op. cit., p. 96-97.
46
membres de la cour77.
Cependant, plus le gouvernement devient autocratique et
centralisé, moins le poète a la possibilité d'échapper aux
caprices de ses patrons. Cette vulnérabilité de la figure du
poète à la cour abbasside est clairement révélée dans des
anecdotes concernant les premiers califes, al-Manṣūr, al-
Mahdī, al-Rašīd , où ceux-ci interrogent les poètes sur des
vers suspects de leur composition et sur leurs opinions sous-
jacentes78.
Les poètes bédouins, cela concerne surtout les poètes de
l'époque omeyyade et beaucoup moins ceux de la période
abbasside, qui étaient occasionnellement de passage à la cour
y gagnaient un utile revenu supplémentaire mais restaient
indépendants de leurs patrons d'un point de vue financier.
Tout autre est la situation de la majorité des poètes « à
temps plein » qui vivent dans un environnement urbain, en
particulier les poètes de la cour abbasside qui résident soit
à Bagdad soit à Samarra, et qui dépendaient uniquement de leur
poésie pour vivre, à part s'ils étaient membres de
l'aristocratie comme Ibn al-Mu‘tazz, fils du calife al-Mu‘tazz
ou avaient d'autres talents comme Kušāǧim, la grande majorité
des poètes étaient dans l'obligation d'obtenir et de garder
les faveurs d'un mécène et, pour atteindre cet objectif, le
madīḥ était le seul moyen sûr. Cependant, même ainsi, la
situation du poète de cour à l'époque abbasside demeurait
précaire car, en plus des conflits de personnes, des intrigues
77 H. KENNEDY, The Court of the Caliphs : The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty, op. cit., p. 117-118.
78 H. KILPATRICK, « The Medieval Arab Poet and the Limits of Freedom », Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), op. cit., p. 96-103. p. 98.
47
des poètes rivaux et d'autres vicissitudes, le patron devait
toujours se trouver dans une situation où il était à même de
remplir son rôle de pourvoyeur, non seulement pour assurer le
minimum vital au poète qui lui est attaché, mais aussi de lui
payer le train de vie luxueux auquel il aspire généralement,
et dont les aléas de la vie le privait souvent.
En conséquence, très peu de poètes pouvaient se permettre de
proclamer publiquement leur loyauté à un protecteur en
disgrâce. C'est ce simple état de fait qui explique les
nombreuses anecdotes sur des poètes s'adaptant vite à une
nouvelle donne comme, par exemple, après la révolution
abbasside ou lors de la défaite d'al-Amīn. Ainsi, de temps à
autre, ceux-ci n'hésitaient pas à réécrire certains vieux
poèmes de leur composition ou à laisser de côté un vers
insultant ici et là.
Même une exception à cette attitude pour le moins versatile
des poètes comme Ḥusayn b.al-Ḍaḥḥāk (m. 250 h/864), le joyeux
convive d'al-Amīn qui s'exila à Baṣra durant le califat d'al-
Ma'mūn, illustre l'importance de l'argent dans la vie de ces
poètes. En effet, celui-ci ne put quitter la cour et subvenir
à ses besoins qu'en puisant dans la somme des présents reçus
du calife précédent79.
Souvent, les relations du poète avec son protecteur sont
cordiales voire chaleureuses à l'image de l'amitié entre le
poète Abū Tammām et son protecteur al-Ḥasan b. Wahb. En effet,
12 poèmes d'Abū Tammām sont dédiés à al-Ḥasan, du simple
billet au panégyrique d’apparat. De plus, à la mort du poète,
79 Ibid. p. 98-99.48
al-Ḥasan exprime sa douleur en vers80. Quant à al-Buḥturī,
l'élève d'Abū Tammām, celui-ci perpétue la tradition instaurée
par son maître en faisant à plusieurs reprises l'éloge d'al-
Ḥasan ainsi que celui de son fils Sulaymān et récite même un
thrène (élégie funèbre) à sa mort81.
Un autre grand de la cour entretient de très bonnes relations
avec ses protégés poètes. Il s'agit d'al-Fatḥ b. Ḫāqān qui
réunit autour de lui de nombreux poètes de qualité, en premier
lieu al-Buḥturi qui lui dédie 29 poèmes et sa Ḥamāsa, mais
aussi Abū ‘Alī al-Baṣīr, Aḥmad b. Abī Fanan qui se fait son
laudateur après avoir été celui de Muḥammad b.‘Abd Allāh b.
Ṭāhir, Ibn Abī Ḥakīm. ‘Alī b. al-Ǧahm prononce son éloge, et
glorifie le magnifique courage qu'il eut en protégeant al-
Mutawakkil de son propre corps contre les miliciens venus
l'assassiner82. Bien plus que de simples mécènes, certains
patrons étaient capables de « lancer » des nouveaux poètes à
la cour et pouvaient jouer un rôle considérable dans la
carrière de ses protégés, tels Alī b. Yaḥyā ibn al-Munaǧǧim
(201 h.-275 h.) dont Jamel Eddine Bencheikh dit que :
« Il s'intéressait particulièrement à leurs requêtes, les
introduisait auprès des califes et des princes, obtenait pour
eux des dons, offrait en leur nom des cadeaux pour leur
assurer la bienveillance protectrice des grands et, lorsque
ses démarches s'avéraient infructueuses, les consolait avec
son propre argent ». Il intervint ainsi en faveur d'Idrīs b.
Abī Ḥafṣa et Ibn Abī Fanan qu'il introduit auprès d'al-
80 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au II e et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique , op. cit., p. 287.81 Ibid, p. 288.82 Ibid, p. 300.49
Mutawakkil, d'al-Buḥturī qui, grâce à lui parvint jusqu'à al-
Fatḥ b. Ḫāqān et d'Ibn al-Rūmī qui lui dédie 35 pièces
réunissant un total de 1081 vers83.
De plus, les protecteurs sont souvent particulièrement
exigeants car ce sont de fins connaisseurs de poésie qui en
composent eux-mêmes (voir II, les poètes-kuttāb), ce qui fait
dire au poète Ibn al-Rūmī (m.v. 283 h/896):
Le malheur est que nous avons des mécènes lettrés et poètes
Si nous réussissons leur éloge, ils sont jaloux et nous privent
de la récompense.
Si nous échouons, ils nous réprimandent et critiquent nos vers
sans pitié,
Ils se sont érigés en rivaux et en égaux des panégyristes.84
Cet extrait rend bien compte de la difficulté d'être poète de
métier à la cour à cette époque. Face à des commanditaires
eux-mêmes poètes à leurs heures perdues, il se doit
d'exceller, quitte à attirer la jalousie car un mauvais
panégyrique sera jugé sans indulgence.
Pourtant, le facteur économique n'était pas toujours décisif.
L'obéissance servile aux caprices d'un patron afin de
s'enrichir n'empêchait pas nécessairement le poète d'exprimer
ses propres opinions, lesquelles étaient destinées à un
auditoire tout à fait différent.
Cependant, cela pouvait s'avérer dangereux : un poète qui
83 Ibid.84 J. E. BENCHEIKH, « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil (m. 247)
contribution à l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires », op. cit., p. 50.
50
exprimait en vers sa sympathie pour le parti alide pouvaient
se voir trahi par un rival qui pourrait réciter les vers en
question au calife abbasside en vue de l'éliminer. Ainsi, par
exemple, le poète mineur ‘Utabi apprend au calife al-Rašīd que
le poète Manṣūr al-Namarī (m. 190 h/805) louait les ‘Alides,
en représailles, ce dernier fut jeté en disgrâce, emprisonné,
torturé et exécuté85.Autre exemple, moins terrible : Le calife
al-Mahdī apprit que le poète Salm b. ʿAmr al-Ḫāsir loua
quelques ‘Alides et le menaça. Mais Salm implora son pardon
dans un long poème et l'obtint86.
Autre exemple, moins terrible : Le calife al-Mahdī apprit que
le poète Salm b. ʿAmr al-Ḫāsir loua quelques ‘Alides et le
menaça. Mais Salm implora son pardon dans un long poème et
l'obtint. P 22 Ibid.) Autre situation dangereuse pour le poète
professionnel, lorsque son auditoire s'en prend à son
panégyrique et le critique comme lorsque al-Buḥturi fait la
louange d'un calife en déclarant que nulle agressivité
n'entache la noblesse du calife, un membre de l'auditoire
rétorque : « Qu'est-ce qui entacherait la noblesse du calife ?
Ceci est plutôt un invective qu'une louange »87. C'est même le
patron lui-même, à fortiori s'il s'agit d'un calife, qui peut
mettre le poète dans une situation franchement inconfortable,
ainsi quand le calife al-Rašīd demande et reçoit des
85 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al-Aġāni, t. XIII, p. 149 cité dans la thèsede N. EL KHATIB, Etude historique de l’époque abbasside à travers le Kitâb al-Aghânî, op. cit., p. 21.
86 Ibid, p. 22.87 IBN RAŠĪQ (ABŪ ‘ALĪ AL-ḤASAN AL-QAYRAWÂNĪ), éd. MUḤAMMAD ‘ABD AL-QÂDIR
AḤMAD ‘ATÂ, al-‘Umda fī maḥāsin al-shi‘r wa-ādābih, 2 vols. en 1 (Beyrouth 1422 h/2001), p. 228-229 d'après J. SHARLET, Patronage and Poetry in the Islamic World : Social Mobility and Status in the Medieval Middle East and Central Asia, Londres New York 2011, p. 19.
51
invectives à propos de lui venant du poète Abū Nuwās, il
s'exclame : « Si je ne les avais pas moi-même expressément
demandées, j'aurais couvert le sol de ton sang »88. Enfin,
c'est le poète lui-même qui peut provoquer des situations à
risque si elles lui permettent de briller aux yeux de son
auditoire comme, une fois de plus, Le poète bachique et
érotique Abū Nuwās qui alla un jour voir le calife al-Amīn et
lui dit : « J'ai des vers pour toi mais je ne te les
déclamerais pas jusqu'à ce que tu dégages de ton trône et me
laisses m'y asseoir ». Le calife accepta, mais prévînt le
poète des conséquences s'il ne jugeait pas ses vers
satisfaisants et, heureusement pour Abū Nuwās, l'arrangement
finit bien89.
Après nous être plongés en détail dans la production poétique
des poètes professionnels, nous nous intéresserons maintenant
à un autre type de poètes, les poètes-secrétaires.
II) Les poètes kuttāb
A la cour abbasside, le terme arabe kātib (pluriel kuttāb) qui
se traduit généralement en français par le mot « secrétaire »
désigne toute personne dont le rôle ou la fonction consiste à
écrire ou à rédiger des lettres officielles ou des documents
administratifs. Il peut s'appliquer à un secrétaire
88 ABŪ HIFFĀN, ‘Abd Allāh b. Aḥmad b. Ḥarb al-Mihzamī, Akhbār Abī Nuwās, ed. ‘Abd al-Sattār Aḥmad Farrāj (Cairo, 1953), p.71 d'après J. SHARLET, Patronage and Poetry in the Islamic World : Social Mobility and Status in the Medieval Middle East and Central Asia, op. cit., p. 19.
89 ABŪ HIFFĀN, Akhbār Abī Nuwās, p. 70-71 d'après J. SHARLET, Patronage and Poetry in the Islamic World : Social Mobility and Status in the Medieval Middle East and Central Asia, op. cit., p. 31.
52
particulier aussi bien qu'au personnel d'un service
administratif. En fin de compte, il peut désigner un simple
« employé aux écritures » aussi bien qu'un chef de bureau, ou
un secrétaire d'Etat dépendant directement du souverain ou de
son vizir90. Dans cette partie, nous nous intéresseront à la
production poétique de ces kuttāb. En effet ils furent
particulièrement nombreux à la cour à cultiver les muses, ce
qui est à mettre en opposition avec la rareté de la production
poétique parmi les traditionnistes transmetteurs de ḥadīṯ ou
parmi les courtisans exerçant une activité d'ordre purement
intellectuel91.
1) La poésie comme une partie de l'adab – citations de vers
Le mot adab, dont le sens a beaucoup évolué au cours du temps,
a – à l'époque abbasside – le sens de bonne éducation,
d'urbanité et de courtoisie, et désigne plus particulièrement
la somme des connaissances qui rendent l'homme courtois et
urbain. C'est la culture profane (par opposition à ‘ilm : la
science, ou mieux science religieuse : Coran, ḥadīṯ et fiqh)
basée en premier lieu sur la poésie, l'art oratoire, les
traditions historiques et tribales des anciens arabes et aussi
sur les sciences relatives, rhétorique, grammaire,
lexicographie, métrique92.
Dans un premier temps, nous verrons en quoi les citations de
vers forment une partie de l'adab tel qu'il est pratiqué par
90 R. SELLHEIM, D. SOURDEL, « Kātib, Sous le Califat », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
91 KILPATRICK Hilary, « Abū l-Faraǧ's Profiles of Poets A 4th/10th Century Essay at the History and Sociology of Arabic Literature », Arabica 1997, t. 44, p. 94-128, p. 106-107.
92 F. GABRIELI, « Adab », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
53
les kuttāb.
Tout adīb, c'est-à-dire tout individu connaissant l'adab, terme
dont nous avons vu le sens plus haut, se doit d'avoir une
certaine connaissance de la poésie arabe, en particulier de la
poésie anté-islamique. Et la récitation de vers de poètes
célèbres lors du moment opportun fait partie de l'éloquence,
art cultivé par tous les membres de la cour abbasside.
Ainsi, lors du règne du premier calife de la dynastie, al-
Saffāḥ (règne de 132 h/749 à 136 h/754), celui-ci récite, pour
accompagner sa remarque faite à Dāwūd b.‘Alī « Qui aime la
vie, tombe dans l'humiliation », les vers suivants du poète
jahilite al-A‘šā :
Non, la mort, si je la subis sans faiblesse, n'est pas une
honte, alors que l'existence est en péril93.
Ces citations de vers peuvent se faire, non seulement à
l'oral, mais aussi à l'écrit lors d'un échange épistolaire.
Ainsi ‘Ubayd Allāh b. Sulaymān, vizir donc chef de
l'administration de l'empire sous le règne des califes al-
Mu‘tamid et al-Mu‘taḍid, écrit-il à ‘Ubayd Allāh b.‘Abd Allāh
b.Ṭāhir des vers de Ḥammād b. Muḥammad al-Kātib sur
« l'importance de l'amitié et de savoir saisir les
opportunités lorsque l'on a le pouvoir car qui sait quand les
choses changeront »94.
Un peu plus tard, sous le califat d'al-Rāḍī (règne de 322
h/934 à 329 h/940), lors d'un cercle bachique, Rāḍī :
93 MAS‘ŪDI, Les prairies d'or, op cit., Tome IV 1989, p 938-939, § 2311.94 HILĀL AL-ṢĀBI' (ṢĀBI', Hilāl ibn al-Muhassin), Rusūm Dār al-Khilāfah (The Rules
and Regulations of the ‘Abbāsid Court), op. cit., p 54.54
Invita son frère Hârûn aux pléiades (palais). Hârûn but et
souhaita que son frère lui tînt compagnie. Il se mit à boire du
nabîdh (alcool de dattes) avec lui au point qu’il en ressentit
quelque trouble. A cette époque, il lisait avec moi les poésies
d’Abû Nuwâs. Alors, faisant allusion à son état, je récitai un
vers d’Abû Dhu’aib (poète muḫaḍram m. v. 26 h/649): (tawîl)
« Elle me vit un jour en état d’ivresse, et je lui fis peur, à
[Wâdî] Qurrân ; car les buveurs ont les cheveux en désordre et
poudreux. »
Il comprit ce que je voulais dire et répliqua : « Pourquoi
m’avez-vous fait lire hier le vers d’Abû Nuwâs : (tawîl)
« Il n’y a de chagrin pour moi qu’à me laisser voir dégrisé et
de plaisir que quand l’ivresse me fait bégayer »
Alors , il s’arrêta de boire et s’en alla.95.
Pour les kuttāb, le but est de trouver des vers dont le sens
correspond le mieux à une situation donnée.
Ces vers cités peuvent ainsi éventuellement servir de
répliques cinglantes comme le montre cette citation de vers
d'Ḥasān b.Ṯābit (m. v. 40 h/660), le « poète du prophète » :
Votre père et votre mère sont tous deux de noble naissance,
mais parfois, des parents nobles donnent naissance à un vilain.
Qu’on ne s’étonne pas de vous voir si différent d’eux ! On
trouve bien naturelles les scories de l’argent96.
Toutes ces citations se veulent exactes, c'est-à-dire que les
vers cités sont strictement les mêmes que ceux composés par le95 AL-SŪLĪ Mohammed ben Yahyâ, Akhbar al-Radi Billah wa al-Muttaqi Lillah,histoire de la
dynastie abbaside de 322 à 333/934 à 944.Traduit de l'arabe par Marius Canard, 2 tomes: tome 1, Alger, 1946, p. 59-60.
96 Ibid, p. 66.55
poète.
Cependant dans certains cas, elles peuvent être modifiées
pour correspondre au mieux à la situation présente, surtout
lorsqu'elles se font devant un personnage important comme le
calife où le récitant a peur de faire preuve de maladresse et
de paraître insolent, ce qui pourrait lui attirer des ennuis
avec des peines allant de la bastonnade à la mise à mort en
passant par l'incarcération.
Ainsi, Muḥammad b. Yahyā al-Ṣūlī (m. 335 h/946-947) fait-il
preuve de prudence lorsqu'il récite certains vers devant le
calife al-Rāḍī :
Un jour, comme nous (al-Ṣūlī et al-Munaǧǧim) étions en train de
boire devant lui (al-Rāḍī), j’observai un trait de sa finesse
et de sa vivacité d’esprit, que je considère comme le plus
étonnant de tous. Il avait demandé de qui étaient certains
vers : Ahmed b.Yahyâ Munajjim dit qu’ils étaient de Di’bil.
Quant à moi, j’affirmai qu’ils avaient pour auteur Mohammed b.
al-Hajjâj Bagdadî, ce que contesta Munajjim. « Le dernier râwî,
lui dis-je, qui m’ait récité ces vers comme étant de Mohammed,
c’est votre père, sur la foi d’Abû Haffân, et il l’a consigné
dans ses ouvrages ». Ahmed b. Yahyâ se tut alors et Râdî se mit
à rire. Puis il me demanda de les lui réciter, ce que je fis,
tandis qu’il s’approchait de moi pour mieux entendre :
O ma fortune, longtemps tu as été abreuvée par Muttalib,
et tu n’étais que parterre et jardins (fleuris).
Vous avez par votre générosité rétabli ma situation, bien
plus vous m’avez gâté, et vous m’avez fait trouver
mesquin les bienfaits des autres.
56
Si d’autres ont été généreux avant vous, vous l’avez été
plus qu’eux ; je n’ai jamais été satisfait par qui que ce
fût, avant vous.
En réalité, le dernier vers n’est pas ainsi. Le poète avait
dit : « Si d’autres sont généreux après vous, vous l’avez été
plus qu’ils ne le seront ; je ne serai jamais satisfait par qui
que ce soit après vous ». Mais il ne me paraissait pas
convenable de le réciter avec les mots « après vous » dans le
premier comme dans le second hémistiche. C’est pourquoi je fis
ce changement. Ahmed b. Yahyâ dit alors : « Mohammed b.Yahyâ
Sûlî modifie les vers quand il les récite. Ce n’est pas ainsi
qu’a dit le poète ». « Comment a-t-il dit ? Demanda le calife.
« Si d’autres sont généreux après vous... ». Râdî comprît que
j’avais fait exprès de changer l’expression, en raison du sens
qu’elle peut comporter, chose que n’avait pas comprise Ahmed b.
Yahyâ, et il lui dit : « C’est la version de Sûlî, et l’autre
version est la vôtre. [...] Mais par Dieu, Sire, ce sont bien
là les mots du poète, répliqua Ahmed, et c’est ainsi que mon
père m’a récité ces vers. [...] Je sais comment votre père vous
a aussi récité ses propres vers : si vous êtes Quraich (la
tribu de Muḥammad, le prophète de l'islam), doucement ! » Ahmed
se tut et l’entretien se termina sur ces mots97.
Cependant, si la récitation de vers est effectivement une pratique
largement répandue dans le milieu des secrétaires, ceci n'empêche
nullement à ceci de composer également leurs propres vers qui font,
de plus, souvent office de moyen de communication.
2) Utilisation de la poésie comme un moyen de communication
97 Ibid, p. 105.57
- billets
A la cour abbasside, les secrétaires ont l'habitude de
s'échanger des billets en vers, c'est-à-dire de courtes pièces
excédant rarement une dizaine de lignes. On peut considérer
que ces pièces sont de la poésie épistolaire car il s'agit de
missives entre poètes et secrétaires et que billets et
réponses utilisent, de règle, le même mètre et la même rime.
De plus ces poèmes sont motivés par les circonstances les plus
diverses de la vie quotidienne, celles qui ne prennent pas, en
général, place dans la poésie d'apparat98.
Par exemple, le secrétaire et vizir Sulaymān b. Wahb (m. 272
h/885), qui se targue de poésie, se voit adresser des
suppliques et des placets le plus souvent versifiés.
L'obligation de répondre en utilisant la même rime et le même
mètre impose un véritable exercice de style et entraîne, chez
les secrétaires rompus à la pratique du saǧ‘, la prose rimée
et rythmée, l'usage des figures du badī‘ : c'est à dire les
innovations des poètes abbassides en matière de figures de
rhétorique99 . Les billets poétiques, par leur fréquence même
et la futilité des motivations qui les dictent, provoquent non
seulement la banalisation des thèmes (comme à propos d'al-
Ḥasan b. Wahb) mais aussi le maniérisme de l'expression (comme
à propos d'Ibrāhīm b. al-‘Abbās al-Ṣūlī (m. 243 h/857)).
En fait, ces billets versifiés sont la norme à la cour
abbasside, tous les courtisans les utilisent pour toutes
sortes de sujets, comme le montre l'exemple suivant :
Un jour où c’était le tour de « service » (service de
98 Ibid, p. 286.99 M. KHALAFALLAH, « Badī‘ », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
58
courtisan) de Sūlī auprès de Rādī alors encore prince, il tomba
malade. Il lui envoya un billet pour s’excuser de cette
indisposition qui l’empêchait d’accomplir ses devoirs, et il
écrivit au dos :
Un billet m’est parvenu qui m’a causé de la tristesse, parce
qu’il m’apportait la plainte d’un ami.
L’intimité a fait place à l’éloignement, et le jour de joie a
été changé en un jour de chagrin.
(A ces deux vers, Sūlī répond par une petite pièce dans
laquelle il remercie Rādī, dont la lettre a, dit-il, amené sa
guérison, et se glorifie de la place de choix qu’il occupe
auprès du prince, parmi ses commensaux)100.
L'échange de billets entre kuttāb ou avec un poète
« professionnel » peut créer une véritable correspondance
telle celle entre al-Ḥasan b. Wahb et le vizir Ibn al-Zayyāt
(dont al-Ḥasan fut le secrétaire et l'intime) avec qui il
échange des billets d'excuse et d'amitié. Il se désole d'aimer
la même femme que son ami basrien al-Ḥasan b. Ibrāhīm b.
Riyāḥ, et en profite pour soupirer d'amour. Il est aussi lié à
Abū Tammām par une fidèle et sincère affection, ils se
disputent un bel éphèbe, partage une agréable soirée, offre
des cadeaux. Il chante enfin sa passion pour une ǧāriya (qayna)
du nom de Banān101.
Certains secrétaires se sont même spécialisés dans ce type de
poésie. Comme al-Ḥasan b. Wahb dont le Dīwān, assez important
puisque de cent feuillets d'après Ibn al-Nadīm, serait
constitué de courtes pièces excédant rarement une dizaine de100 AL-SŪLĪ Mohammed ben Yahyâ, Akhbar al-Radi Billah wa al-Muttaqi Lillah, histoire de la
dynastie abbaside de 322 à 333/934 à 944. op. cit., t. I, p. 104.101 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au II
e et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique , op. cit., p. 286.
59
vers102. De même pour Ibn Bassām dont la renommée repose sur ses
épigrammes, très brèves mais percutantes. On rapporte de
nombreuses anecdotes sur ses relations avec les grands de son
temps qu’il ne ménageait guère, s’attaquant aussi bien aux
califes et à leurs ministres qu’à ses propres parents103.
- Poésie politique
Les secrétaire-poètes n'ont pas seulement une production
poétique d'agrément, qui atteste leur statut d'adīb, c'est-à-
dire de leur maîtrise de l'adab dans tous ses composants, ou
une production de simples billets inoffensifs concernant la
vie de la cour. La poésie peut être également une arme dans
les mains des kuttāb, un moyen d'attaquer leur adversaire ou au
contraire de faire la louange de leurs appuis. Pour cela, les
poètes-kuttāb vont utiliser les mêmes codes que les poètes
« professionnels », à savoir les différents genres poétiques
que nous avons vus plus haut et la forme phare de la poésie
arabe, à savoir la qasīda.
Souvent, les secrétaires n'hésitent pas à donner leur avis sur
les évènements marquants de la vie de la cour, tel, au tout
début de la dynastie, le meurtre d'Abū Salama (m. 132 h/750),
premier vizir du calife al-Saffāh, éliminé car suspecté de
sympathies ‘Alides potentiellement dangereuses pour la
nouvelle dynastie. Ce qui fait dire à Sulaymān b.al-Muhāǧir
al-Baǧalī :
Le crime inspire quelquefois de la joie, et souvent on devrait
102 Ibid, p. 285.103 C. PELLAT, « Ibn Bassām », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
60
se réjouir de ce qui inspire de la répugnance.
Le vizir, le ministre de la famille de Muhammad, vient de
périr, et tu fais ton vizir de celui qui te hait !104
Autre exemple de poésie de cour très politique, les poèmes de
Muḥammad b.‘Abd al-Malik Ibn al-Zayyāt, vizir sous al-
Mu‘tasim, al-Wāṯiq et al-Mutawakkil.
Le premier poème est une qaṣīda concernant Ibrāhīm b. al-Mahdī
et sa malheureuse aventure califale. D'après le Kitāb al-Aġāni, il
l'écrivit pour obliger Ibrāhīm (b. al-Mahdī) à rembourser
l'emprunt fait à son père, mais ne le remit pas à al-Ma'mūn,
ce qui paraît douteux. En fait, l'intérêt de cette qaṣīda
réside dans ses allusions à l'affaire d'al-Amīn (règne de 193
h/809 à 198 h/813) et à la désignation de l'imām chiite ‘Alī
al-Riḍā (m. 203 h/818) comme dauphin par al-Ma'mūn et par
l'accusation portée contre le « calife-chanteur » Ibrāhīm b.
al-Mahdī d'être le champion des nābita (c'est-à-dire des
hanbalites dans leur lutte contre les mu'tazilites soutenus,
eux, par al-Ma'mūn)105.
D'autre part, à la cour, la compétition pour avoir la faveur
des grands est féroce parmi les kuttāb, et ceux-ci n'hésitent pas
à s'accuser entre eux comme dans un autre poème politique de
Ibn al-Zayyāt, un pamphlet très violent contre deux chefs
turcs – Ašnās et Itāḫ – et leurs secrétaires respectifs Aḥmad
b. al-Ḫaṣīb (m. 265 h/879), futur vizir, et Sulaymān b. Wahb,
qu'il aurait présenté comme l'œuvre d'un chef militaire. Ceci
104 MAS‘ŪDI, Les Prairies d'or, op cit., Tome IV 1989, p. 953, § 2349.105 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au IIe et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique, op. cit., p. 287.61
hâta l'adoption par al-Wāṯiq de sévères mesures à l'encontre
des secrétaires car il y est accusé de laisser le califat aux
mains de deux d'entre eux, d'admettre leurs exactions et leurs
injustices et de leur permettre d'accumuler des richesses
innombrables. Le poème se termine par une exhortation à leur
faire le sort qui fut jadis celui des Barmécides, la mort106.
Autre exemple, l'accusation publique d'ignorance, d'incapacité
et de manque de sérieux faite à Ibrāhīm b. al-‘Abbās al-Ṣūlī
(m. 243 h/857) par Aḥmad b.al-Mudabbir en vers. D'ailleurs, en
réponse, Ibrāhīm compose deux vers dans lesquels il reconnaît
honnêtement que l'accusation était fondée107.
Ces accusations peuvent aussi donner lieu à des satires plus
ou moins grossières, telle celle d'Abū ‘Uṯmān Sa‘īd b. Ḥumayd
(m. v. 260/874) adressée à Ibrāhīm b. al-‘Abbās al-Ṣūlī qu'il
décrit comme prenant la parole « semblable à un âne mâchant
son mors »108.
En fait, les kuttāb peuvent également s'illustrer dans les mêmes
types de poésie que les poètes professionnels, à commencer par
le panégyrique. C'est ainsi que le secrétaire Ibrāhīm b. al-
Mudabbir (m. 279 h/892-893), d'après le Kitāb al-Aġanī, compose un
panégyrique à l'occasion d'une maladie d'al-Mutawakkil109.
Les vers, chez les kuttāb, peuvent également servir pour
adresser des suppliques, à l'exemple de celle d'Ibrāhīm b. al-
Mudabbir adressée à ‘Abd Allāh b. Ḥamdūn (m. 317 h/929) pour
qu'il intercède auprès du vizir al-Fatḥ b. Ḫaqān (m. 247/861)
et du calife al-Mutawakkil et à des remerciements comme ceux
envoyés par le même Ibrāhīm à Muḥammad b.‘Abd Allāh b. Ṭāhir
106 Ibid, p. 287.107 Ibid, p. 290.108 Ibid, p. 291.109 Ibid, p. 291.62
(m. 296 h/908-9) pour une intervention faite en sa faveur110.
De nombreux kuttāb sont célèbres pour leur production poétique,
un des plus fameux est sans conteste Muḥammad b. Yahyā al-Ṣūlī
(m. 335/947) dont la production rivalise avec celle des poètes
professionnels comme l'illustre l'anecdote suivante :
J’avais, ainsi que le calife me l’avait ordonné, transformé la
pièce que j’avais composée en dâd, sur la rime de Murtadi, en
une autre également en dâd sur la rime de Râdî. Quand nous fûmes
arrivés auprès de lui ce jour-là, Ahmed b. Yahyā et ‘Alī
b.Hârûn lui récitèrent deux poésies dans lesquelles ils le
félicitaient de son avènement au califat et décrivaient leur
bonheur et leur satisfaction. Il écouta attentivement leurs
vers et manifesta son admiration pour l’une et l’autre poésie.
Puis il m’invita à lui réciter ma pièce en dâd, ce que je fis.
Je vais la rapporter ici, car elle n’est pas de ces poésies que
repousse le cœur et que l’oreille refuse d’entendre. J’y fais
aussi l’éloge de Mohammed b. Yâqût et du vizir
(Sûlî commence sur le même thème que la pièce primitive
analysée plus haut ; puis il exalte le calife, dont il célèbre
la parfaite éducation, la science et la générosité. Il décrit
ensuite sa propre situation et ses chagrins pendant le temps où
il a été séparé du prince. Puis il fait l’éloge de Mohammed b.
Yaqût et loue son dévouement pour le calife. Il parle ensuite
du vizir Ibn Muqla, de son activité, de son habilité et de ses
aptitudes financières et termine en souhaitant au calife de
fêter le Naurûz [nouvel an perse] pendant de longues années).
Le calife, qui était un connaisseur et un critique en matière
de poésie, me dit qu’il ne connaissait rien de semblable à
cette pièce en dâd, chez les anciens et les modernes. « C’est110 Ibid, p. 291.63
votre dard que vous avez jeté, me dit-il, tel le dard avec
lequel frappait ‘Ajjâj, quand il disait : Dieu a restauré la
religion, et elle est maintenant restaurée... ». « Dieu vous
conserve, Sire, répondis-je. J’ai encore beaucoup d’autres
dards comme celui-là »111.
Cette comparaison faite par le calife al-Rāḍī du talent
poétique de Muḥammad b. Yahyā al-Ṣūlī avec le poète arabe de
la tribu de Tamīm al-ʿAǧǧāǧ (m. 97 h/115) est particulièrement
flatteuse. En effet, ce dernier est resté célèbre pour la
richesse de son vocabulaire et son grand respect des règles
classiques de la versification dans ses qaṣā'id112.
Autre exemple, encore plus explicite, de la reconnaissance par
ses contemporains du grand talent poétique de ce kātib, cet autre
passage de son Akhbar al-Radi Billah wa al-Muttaqi Lillah concernant la
victoire de l'émir turc Abulwafā' Tūzūn à la bataille du Nahr
Diyālā, affluent du Tigre situé au centre-est de l'Irak.
Des poètes récitèrent des vers vantant la résolution et le
jugement dont l'émir et Abū Ǧa‘far avaient fait preuve. Mais
ils n'obtinrent pas auprès des auditeurs un succès
satisfaisant. Tous me dirent : « Un événement aussi important
et une victoire aussi glorieuse ne trouveront-ils pas un
panégyriste qui les fasse connaître et les transmette à la
postérité ? ». Alors je composai, en dhul-hijja (25 juillet-23
août) les vers suivants : (kāmil)
Ainsi, al-Ṣūlī vante les mérites guerriers de Tūzūn, « bras du
califat et prince des émirs », à qui Dieu a donné la victoire.
Il décrit la frayeur qu'il inspire aux ennemis, la facilité
111 AL-SŪLĪ Mohammed ben Yahyâ, Akhbar al-Radi Billah wa al-Muttaqi Lillah,histoire de la dynastie abbaside de 322 à 333/934 à 944, op cit., tome I : Histoire d'al-Radi, p. 63-64.
112 C. PELLAT, " al-ʿAd̲j̲d̲j̲ād̲j̲", dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
64
avec laquelle il vient à bout d'eux. Les plus puissants
seigneurs s'inclinent devant lui, et l'émirat refuse de se
donner à un autre [271, v. 12]. Son succès lui vient non
seulement de sa force propre, mais aussi des conseils qu'il
reçoit du « prince des conseillers » Muḥammad b. Yaḥyā b.
Šīrzād. Suit l'éloge d'Ibn Šīrzād « ornement de l'art du
secrétaire », et fils d'un ancien chef de la chancellerie des
califes ; il le félicite d'avoir triomphé de la conspiration de
ses ennemis. Sūlī revient ensuite [272, v. 8] à l'éloge de
Tūzūn dont le sabre a achevé l'œuvre d'Ibn Šīrzād et coupé le
mal dans sa racine. Il le décrit encore une fois dans la
bataille, ferme et résolu, jetant l'effroi sur les ennemis. Il
le loue enfin [273, v.3] d'avoir rendu l'abondance à Bagdad
après la disette ; il rappelle qu'il s’est déjà distingué à
l'époque de Baǧkam et vante la puissance à laquelle il est
arrivé par ses mérites.
Cette poésie est suivie d'une autre, composée par Sūlī dans une
autre circonstance, à l'éloge de Tūzūn (273, v. 9-10 : Lorsque
l'émir Abulwafā' Tūzūn prit comme secrétaire Abū Ǧa‘far
Muḥammad b. Šīrzād et qu'il vint à Bagdad, je me rendis chez
lui et lui récitai les vers suivants...).
Cette pièce commence par un tašbīb, un prélude en poésie
amoureuse. Ṣūlī, faisant ensuite allusion à la robe d'honneur
conférée à Tūzūn par Muttaqī, félicite l'émir d'avoir obtenu
l'émirat qu'une fortune contraire et injuste avait jusque-là
donné à d'autres [274, v. 3]. Maintenant la promesse contenue
dans son nom, Abulwafā', a été accomplie (wafā : accomplir).
Cette distinction ajoute encore à la gloire des Turcs, dans la
personne de leur plus glorieux émir, entouré de tous les chefs
turcs éminents. Ṣūlī loue en lui le « Vivificateur de
l'Empire » (muḥyī al-dawla), titre qu'il lui demande de prendre
[275, v.1]. Il vante son audace et son courage au combat, et
65
son jugement. Il lui rappelle qu'il lui a prédit son succès et
a reçu à cette occasion la promesse d'une récompense. Il fait
ensuite l'éloge d'Ibn Šīrzād et de ses qualités d'intelligence
et de décision et termine par des vœux à l'adresse de l'émir113.
Ces poèmes traitant des sujets politiques brûlants à l'époque
peuvent même mettre en danger le secrétaire qui en est
l'auteur, dont le nom peut être, en conséquence, dissimulé.
Ainsi al-Ḥasan b.Wahb, ayant écrit un thrène à la mémoire
d'Ibn al-Zayyāt peu après son exécution dans lequel il attaque
vivement la dynastie régnante, peut être une telle amertume
est-elle dû à sa condition de chrétien, dissimula avec soin ce
poème et s'en défendit d'en être l'auteur. A sa mort aurait
été retrouvé un manuscrit de ce poème écrit de sa propre
main114.
- Poésie de demande
Il s'agit de poèmes dans lesquels le kātib formule une demande
concrète, en réclamant en général de l'argent sonnant et
trébuchant ou quelque objet précieux.
Ainsi, al-Ṣūlī compose un poème pour le calife al-Rāḍī qui lui
a promis une bague. Il la lui offre une fois que Ṣūlī a
composé son poème dont il est très satisfait.
Comme Rāḍī m'avait promis une bague dont j'avais admiré la
beauté, je lui adressai un poème dans lequel je lui demande de
me l'envoyer. Il me répondit : « La seule joie que j'éprouve113 Ibid, Tome II : Histoire d'Al-Muttaqī. p. 111.114 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au II
e et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique », op cit., p. 287.
66
est de recevoir quelque chose qui vient de vous. Faites-moi
donc parvenir des vers en sād sur la rime fass (chaton de
bague). » Je composai alors le poème suivant que je lui
envoyai: (ṭawīl)
Le prince me fit alors envoyer une bague au chaton de hyacinthe
couleur d'azur, et y joignit un cadeau. Il m'écrivit : « Je ne
connais aucun poète ayant composé une semblable pièce en sād, et
si je vous ai lésé [en réduisant] la valeur de mon présent,
c'est par nécessité et non de mon plein gré, en attendant, si
Dieu le veut, un redressement de la fortune115.
Après s'être intéressé à la production poétique des poètes
professionnels et des secrétaire-poètes, nous passons à celle des
qiyān.
III) Les qiyān
Une autre catégorie de praticiens, ou plutôt de praticiennes,
de la poésie à la cour abbasside est représenté par les qiyān
(esclaves-chanteuses, au singulier qayna). Ces femmes, formées
depuis l'enfance au chant et à la poésie, existaient déjà dans
l'Arabie préislamique mais leur activité connaît un grand
développement à partir du califat omeyyade où se créent dans
les villes saintes du Ḥijaz (la Mecque mais surtout Médine) au
Ier/VIIe siècle de véritables écoles de musiciens et de
chanteurs. Ces écoles forment de nombreuses qiyān qui suivent
une éducation musicale et poétique assez poussée. Les
meilleures élèves de l’école médinoise trouvent d'ailleurs
115 AL-SŪLĪ Mohammed ben Yahyâ, Akhbar al-Radi Billah wa al-Muttaqi Lillah,histoire de la dynastie abbaside de 322 à 333/934 à 944, op. cit., Tome I : Histoire d'al-Radi, p. 78-79.
67
aisément preneurs en Irak, tout particulièrement à Baṣra, où
ne tarda pas à prendre naissance une nouvelle école, rivale de
celle de Médine, qui forma quelques-unes des chanteuses les
plus renommées de la cour de Bag̲dad. Une fois à la cour, bien
des qiyān étaient capables d’écrire de brefs poèmes et
d’improviser des pièces de circonstance, concurrençant, sur ce
chapitre, les poètes avec qui elles rivalisaient de
virtuosité.
Parmi les esclaves-chanteuses présentes à la cour Abbasside,
on peut citer : Baḏl116, qayna d’al-Hādi et d’al-Amīn, Mutayyam
al-Hāšimiyya117, Šāriya118 adoptée par Ibrāhīm ibn al-Mahdī et
dont Ibn al-Muʿtazz ne jugea pas indigne d’écrire la
biographie.
Cependant, la plus célèbre esclave-chanteuse à avoir jamais
résidée à la cour de Bagdad était ‘Arib (m. 890), une femme
célèbre pour sa beauté, son sang-froid, et son talent de
joueuse de luth, poétesse et chanteuse. Celle-ci a vécu
jusqu'à l'âge de quatre-vingt-seize ans, après avoir servi à
la cour de cinq califes. Elle a commencé sa carrière sous le
calife al-Amīn (règne de 809 à 813) et si l'unique mention
dans le Kitāb al-Diyarat d'al-Šabušti (m. 998) est véridique, elle
a commencé sa carrière comme ġulamiyya, garçonne, c'est à dire
comme une femme travestie en garçon. Le passage qu'a connu
‘Arib en tant que ġulamiyya s'explique sans doute par les
préférences sexuelles d'al-Amīn pour les jeunes garçons. Pour
lui, une jeune fille habillée en garçon devait sûrement être
116 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al-Ag̲h̲ānī, éd. Beyrouth, t. XVII, p. 32-37 d'après C. PELLAT, " Ḳayna ", dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
117 Ibid, t. VII, p. 280-293.118 Ibid, t. XV, p. 320-328.68
particulièrement désirable. D'ailleurs, c'est sa mère,
Zubayda, qui la première, en vint à l'idée d'avoir des
esclaves-chanteuses travesties qui le divertiraient afin
d'inciter son fils à donner un héritier au califat119.
Dans la production poétique des qiyān sont largement célébrés
les reproches amoureux (ʿitāb), les lamentations sur les
séparations forcées y abondent aussi; on y rencontre cependant
également des éloges de personnages de haut rang, des élégies
sur la mort du maître, des pièces dans lesquelles des qiyān
éloignées de leur pays natal expriment leur nostalgie; le vin,
les descriptions y occupent aussi leur place, à côté des
épigrammes, fort en honneur dans ces milieux raffinés.
Ces femmes avaient reçu une éducation soignée ; elles
devaient faire preuve de talent et de connaissances étendues
en matière de langue et de poésie arabe puisqu’on nous dit
qu’al-Rašīd, avant de prendre une décision, chargea al-Aṣmaʿī
d’en interroger une, qui répondit à son examinateur avec une
telle assurance qu’elle «semblait lire les réponses dans un
livre»120 . En fait, l'apprentissage de la langue arabe par une
qayna était souvent aussi poussé que leur instruction musicale
car beaucoup de ces esclaves n'avaient pas l'Arabe comme
langue maternelle. De manière assez exceptionnelle, on trouve
des cas de qayna qui recevaient une éducation plus approfondie.
On peut ainsi lire dans les Mille et une nuits (Alf layla wa layla) que
Tawaddud, une qayna du calife Hārūn al-Rašīd, avait étudié la
grammaire, la poésie, le droit, la philosophie, le Coran, les119 K. RICHARDSON, « Singing Slave Girls (Qiyan) of the ‘Abbasid Court in
the Ninth and Tenth Centuries », dans Children in Slavery Through the Ages, éd. G.Campbell, S. Miers, J. C. Miller. Athens (Ohio) 2009, p. 114.
120 AL-ANBĀRĪ, Nuzha, éd. ‘A. ĀMIR, p. 72-73 dans C. PELLAT, " Ḳayna ", dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
69
mathématiques, le folklore arabe, la médecine, la musique, la
logique, la rhétorique et la composition. Même s'il s'agit
d'un recueil de contes dont le contenu peut s'avérer
discutable, ce n'est certes pas une coïncidence si Tawaddud
est décrite comme étant la propriété d'un calife car avec une
éducation de ce calibre, elle aurait été trop chère pour la
grande majorité des muqayyinun (propriétaires de qiyān)121.
Grâce à l’école fondée par Ibrāhīm al-Mawṣilī et développée
par son fils Isḥāq, lui-même formé en partie par une qayna du
nom de ʿAtīqa, Bagdad tendait, au début du IIIe/IXe siècle, à
ravir la prééminence à Baṣra, qui n’avait d’ailleurs pas
réussi à mettre totalement fin au monopole de la formation des
qiyān dont avait joui l’école médinoise.
Souvent, une ou plusieurs qiyān de cette catégorie étaient
offertes au calife, notamment Maḥbūba, don d’Ibn Ṭāhir à al-
Mutawakkil, sur laquelle nous reviendrons ; cependant, il
arrivait que le souverain fixât lui-même son choix: al-Wāṯiq,
après avoir entendu chanter Qalam al-Ṣāliḥiyya au cours d’une
séance privée, manifesta le désir de l’acheter.
Sur le plan littéraire, les qiyān ont contribué au
développement de la poésie dite moderniste tant par leurs
propres compositions, dont la valeur est, par la force des
choses, très variée, que par leur fonction d’inspiratrices des
poètes. A l’apogée de la civilisation abbasside, certaines
d’entre elles tenaient de véritables salons littéraires où,
tout en écoutant de la musique et des chants, les participants
121 K. RICHARDSON, « Singing Slave Girls (Qiyan) of the ‘Abbasid Court in the Ninth and Tenth Centuries », op. cit. p. 110.
70
faisaient assaut d’esprit et d’improvisation. Innombrables
sont les poètes qui, inspirés par des qiyān, ont célébré leur
séduction ou se sont plaints de leur cruauté; il faudrait
citer à ce propos presque tous les grands noms de la poésie
moderniste, quoi qu’en pense Ibn Qutayba qui, dans
l’introduction de l’Adab al-kātib, fulmine contre les scribes de
l’administration dont l’idéal est de réciter des «vers de
mirliton» à la louange d’une qayna122.
Le poète abbasside Ibn al-Rūmī (m. 896) décrit dans son poème
« Wahid l'esclave-chanteuse d'Amhamah » le pouvoir envoûtant
de séduction d'un qayna : « Ô mes deux amis, Wahid m'a
assservi... Les hommes libres sont asservis par elle ».
Pourtant, décrire sa beauté physique s'avère complexe, et
quand on le demande au poète, celui-ci réplique : « C'est aisé
et difficile en même temps. / Il est facile de dire qu'elle
est la plus belle des créatures, sans aucune exception, / mais
il est difficile de décrire sa beauté. » Ibn al-Rūmī fait
aussi le lien entre sa beauté et sa grâce lors de sa
performance musicale, son attrait apparaît ainsi comme
facilement reconnaissable, mais difficile à expliquer, et
semble constitué de nombreux éléments. En fait sa poésie, ses
talents de chanteuse et sa beauté forment un tout qui charme
son auditoire.123
Ainsi il apparaît clairement que la pratique de la poésie, et
tout particulièrement les joutes poétiques, n'étaient pas
l'apanage des hommes, les qiyān y participent également
122 G. LECOMTE, Mélanges Massignon, t. III, p. 51 dans C. PELLAT, " Ḳayna ", dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
123 K. RICHARDSON, « Singing Slave Girls (Qiyan) of the ‘Abbasid Court in the Ninth and Tenth Centuries », op. cit., p. 111.
71
activement. D'ailleurs la poétesse ‘Inān (m. 226/840), qui
connut une grande célébrité dans la deuxième moitié du
IIème/VIIIème siècle et considérée comme la première femme à
avoir connu la gloire littéraire sous les Abbassides a bâti sa
réputation sur sa capacité à improviser124. De même Faḍl, la
maîtresse de Sa‘īd b.Ḥumayd et servante d'al-Mutawakkil tenait
salon et s'engageait dans des joutes poétiques avec des poètes
reconnus comme Abū Dulaf al-Qāsim al-‘Iǧli (m. 226 h/840) ou
‘Alī b. al-Ǧahm (m. 249 h/863)125. En fait, les esclaves-
chanteuses sont l'un des pivots de la société de cour
abbasside126.
Un cas typique de parcours d'une esclave-chanteuse talentueuse
est illustré en la personne de Maḥbūba sur laquelle Mas‘ūdi
s'attarde longuement dans Les prairies d'or et au sujet de laquelle
il dit :
§ 2967. – ‘Alî b.al-Djahm raconte le fait suivant:
Lorsque le Commandeur des Croyants, Dja‘far al-Mutawakkil ‘alà
llâh fut élevé à la dignité de calife, il reçut des cadeaux
proportionnés au rang de ceux qui les lui offraient. Dans le
cadeau d'Ibn Tâhir (‘Abd Allāh b. Ṭāhir b. al-Ḥusayn)
figuraient deux cents esclaves des deux sexes et, parmi eux,
une jeune femme nommée Mahbûba (Maḥbūba) ; son premier maître,
un habitant de Taïf, avait soigné son éducation, cultivé son
intelligence et l'avait enrichie des connaissances les plus124 J. E. BENCHEIKH, « ‘Inan », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.125 K. ZAKHARIA, « Chapitre XXIII : La poésie solennelle », dans T. BIANQUIS,
P. GUICHARD, M. TILLIER (sous la direction de), Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, op. cit., p. 350.
126 EAD., « Chapitre XXII : Entre la taverne et la cour, les poètes de l'amour, de la nuit et du vin », p. 333, dans T. BIANQUIS, P. GUICHARD, M. TILLIER (sous la direction de), Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, op. cit.
72
variées ; elle faisait des vers qu'elle chantait en
s'accompagnant sur le luth, et réussissait, en un mot, dans
tout ce qui distingue les gens de mérite ; aussi fut-elle bien
accueillie d'al-Mutawakkil ; il lui donna une place importante
dans son [VII, 282] cœur et lui accorda toutes ses
préférences.127
Ainsi il apparaît clairement dans ce paragraphe que Maḥbūba,
malgré sa condition d'esclave offerte comme cadeau lors de
l'intronisation du calife al-Mutawakkil, a reçu une éducation
soignée dans la ville de Taïf, au Hijaz dans toutes les
disciplines constituant l'adab. C'est cette éducation qui lui
permet de briller à la cour et même de battre, lors d'une
improvisation en vers, le célèbre poète ‘Alī b. al-Ǧahm, comme
le racontent les deux paragraphes suivants :
§ 2968. – J'entrai un jour chez al-Mutawakkil, ajoute
‘Alî, pour boire en sa compagnie ; quand j'eus pris place, le
calife se leva et pénétra dans une des pièces réservées, puis
il revint en riant et me dit : « Mon cher ‘Alî, en entrant
[dans le harem], j'ai rencontré une esclave qui avait tracée
sur sa joue, en lettres de musc, le nom de Dja‘far ; je n'ai
rien vu d'aussi charmant. Trouve quelques vers sur ce sujet. –
Moi seul, Seigneur, lui demandai-je, ou Mahbûba avec moi ? –
Non, toi et Mahbûba ». Cette jeune esclave, se faisant apporter
une écritoire et du papier, alla plus vite que moi pour
composer des vers ; elle saisit ensuite son luth et chanta à
mi-voix ; après avoir préludé sur son instrument jusqu'à ce
qu'elle eût donné un corps à la mélodie, elle sourit pendant un
instant puis, avec la permission du calife, elle chanta ces
vers (attribués à la poétesse Faḍl ou à Maḥbūba) :127 MAS‘ŪDI, Les Prairies d'or, op. cit., tome V 1997, p. 1211, § 2967.73
Parfois une femme trace sur ses joues avec du musc le mot Dja‘far ; je
donnerais ma vie pour l'endroit charmant où le musc a laissé son empreinte.
[VII, 283] Si elle a confié à sa joue des lettres parfumées, elle a gravé
dans mon cœur de longues lignes d'amour.
Voyez cette esclave qui soumet à ses lois son propre maître, en secret
comme en public.
Voyez ces yeux qui ont contemplé un homme tel que Dja‘far ; que Dieu
répande sur Dja‘far la pluie de Ses bienfaits !
§ 2969. – ‘Alî poursuit ainsi son récit : Cependant mon
imagination flottait incohérente, et il me semblait que je ne
trouverais pas le premier mot d'un vers. « Eh bien, ‘Alî, me
demanda le calife, où en es-tu de ce que je t'ai commandé ? –
Pardon, Seigneur, répondis-je, je confesse que ma verve est
absente ». – Depuis lors et jusqu'à sa mort, al-Mutawakkil ne
cessa de me lancer ce souvenir à la tête et d'en prendre texte
pour me railler.128
Cependant malgré tous leurs talents, les qiyān restent des
êtres doublement inférieurs aux yeux des grands de la cour
qu'elles fréquentent, d'abord car ce sont des femmes dans une
société patriarcale, ensuite parce qu'elles sont des esclaves
propriétés de leurs maîtres. Ceci explique les moqueries d'al-
Mutawakkil décrites par Mas‘ūdi au paragraphe 2969 car
l'absence de réponse du poète professionnel ‘Alī b. al-Ǧahm à
la chanson de Maḥbūba, une inférieure, est vécue comme une
humiliation et donc l'objet légitime des railleries du calife.
Cette condition d'esclave de la qayna Maḥbūba est d'ailleurs
rappelée un peu plus loin dans Les Prairies d'Or au paragraphe
128 Ibid, tome V, p. 1211-1212, § 2968-2969.74
2972, où, après l'assassinat de son propriétaire, le calife
al-Mutawakkil, elle est revendue et connaît un triste destin:
§ 2972. – Après le meurtre du calife, rapporte ‘Alî (‘Alī
b. Yaḥya al-Munaǧǧim), Mahbûba fut, avec bien d'autres esclaves
de la cour, dévolue à la maison de Bughâ (en fait il s'agit de
Waṣif et non de Buġā, il s'agit là d'un lapsus de l'auteur)
l'aîné. Un jour que j'entrai chez ce dernier pour boire en sa
compagnie, il fit écarter le rideau et, sur son ordre, ses
esclaves s'avancèrent brillantes d'ornements et de parures ;
seule Mahbûba se montra sans bijoux ni vêtements de prix et
vêtue de blanc (en signe de deuil) ; elle s'assit rêveuse et la
tête baissée. [VII, 286] Wasîf l'invita à chanter, mais elle le
pria de l'excuser ; alors, il l'en adjura et fit apporter un
luth, qu'on posa sur les genoux de l'esclave. Se voyant dans la
nécessité d'obéir, elle garda le luth sur ses genoux et s'en
accompagna pour le morceau suivant, qu'elle improvisa :
Comment la vie pourrait-elle me plaire, si je ne rencontre plus Dja‘far,
Ce roi que j'ai vu souillé de poussière et de sang ?
Quiconque souffrait d'inquiétude et de maladie a retrouvé la santé,
Excepté Mahbûba qui, si elle savait que la mort s'achète,
L'achèterait de tout ce qu'elle possède, pour être portée au tombeau.
Wasîf, irrité de ce souvenir, envoya l'esclave en prison ; elle
y fut enfermée et, depuis, on n'a plus entendu parler d'elle.129
Ainsi, la condition de qayna, aussi douée soit-elle, reste
celle d'une esclave soumise à la volonté de son maître et
Maḥbūba, en refusant d'obéir à son nouveau maître car portant
le deuil de l'ancien, ce dernier fut-il calife, outrepasse sa129 Ibid, tome V, p. 1212-1213, § 2972.75
condition et se voit punie pour cela par l'emprisonnement.
Autre aspect peu reluisant inhérent à la condition de qayna,
l'exploitation sexuelle dont celles-ci peuvent faire l'objet.
En effet, les esclaves-chanteuses possédées par les nobles, à
l'inverse de celles possédées par les califes, étaient louées
à des clients en tant que chanteuses et, parfois, en tant que
prostituées130. Bien que le Coran interdise explicitement cette
pratique (verset 24:33 qui commande aux musulmans de « ne pas
contraindre vos femmes-esclaves à la prostitution »),
l'exploitation sexuelle des qiyān était suffisamment commune à
l'époque abbasside pour que ces chanteuses soient volontiers
identifiées avec la promiscuité et la licence. Le poète ‘Abbas
b. al-Ahnaf (m. après 808) a écrit un poème de 47 vers
décrivant une orgie en compagnie d'esclaves-chanteuses. Ibn
Qutayba (m. 889), un autre auteur abbasside remarquable, a
inclus le vers suivant dans son recueil littéraire ‘Uyun al-
akhbar : « Si celles-ci ne faisaient pas usage du rue [une herbe
contraceptive], les enfants des chanteuses-prostituées
[muġanniyat] couvriraient la Terre »131
Certes la pratique poétique que nous venons de décrire chez
les qiyān a une dimension publique, cependant c'est plutôt dans
les cercles privés, les cénacles, qu'on les rencontre le plus
souvent comme nous le verrons dans la deuxième grande partie.
Nous abordons maintenant un dernier type de praticien de la
poésie présent à la cour abbasside, se caractérisant par une
dimension intellectuelle plus marquée, il s'agit des rāwī ainsi130 K. RICHARDSON, « Singing Slave Girls (Qiyan) of the ‘Abbasid Court in
the Ninth and Tenth Centuries », op. cit., p. 109.131 Ibid., p. 111.76
que des philologues.
IV) La mise en forme de la poésie pré-islamique : des
rāwī aux philologues
La poésie pré-islamique, traditionnellement considérée par la
tradition comme un modèle insurpassable, a été véritablement
mis par écrit à l'époque abbasside seulement, et tout ce
processus de « canonisation » a impliqué de nombreuses
personnes ayant chacune des rôles différents. Pour
schématiser, cette poésie a d'abord été évidemment composé par
des poètes qui, à l'époque pré-islamique, évoluent dans un
cadre tribal, puis transmises à des transmetteurs, d'abord
tribaux puis hors du cadre tribal : les rāwī et enfin fut
consignée par écrit par des philologues spécialistes.
1) Rāwī
A l'époque de la ǧāhiliyya, chaque poète est accompagné de son
rāwī, qui est à la fois son élève, donc une sorte d'apprenti
poète, mais aussi un transmetteur de la poésie de son maître132.
Pour diffuser sa poésie, le poète avait un récitant, un
transmetteur (rāwī, pl. Ruwāt), le plus souvent poète lui-même.
Il est hautement probable que la relation du poète au rāwī (ou
aux ruwāt) était une relation de formation dans laquelle un
poète confirmé transmettait, par sa poésie, les règles de la
métrique et les secrets de la composition à celui qui était
132 K. ZAKHARIA, « Chapitre XXIII : La poésie solennelle », dans T. BIANQUIS, P. GUICHARD, M. TILLIER (sous la direction de), Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, op. cit., p. 343.
77
encore un apprenti133.
En effet, le rāwī mémorise les œuvres et les récite ensuite
oralement, servant ainsi d' « archive » vivante d'ancienne
poésie arabe. Ils forment ainsi une profession distincte des
poètes à proprement parler même s'il n'y a pas de limites
précises entre les deux. De nombreux transmetteurs étant eux-
mêmes des poètes, ou au moins tout à fait compétents pour
composer des poèmes. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à réviser,
compléter ou interpoler les poèmes de leur maître puisqu'ils
les mémorisent selon des méthodes mnémotechniques basées sur
le ma'āni, c'est-à-dire l'utilisation de topoi, d'idées ou
d'images métaphoriques et non pas en mémorisant des textes
entiers mot pour mot. A l'époque pré-islamique, le poème est
donc une entité en perpétuel changement sans contenu figé.
Ceci fait ainsi dire au célèbre transmetteur de la dernière
génération (rāwiya, terme défini plus loin) Ḫalaf al-Aḥmar (m.
v. 180 h/796) que « même pendant l'antiquité (la ǧāhiliyya), les
transmetteurs révisaient la poésie des poètes »134.Le lien entre
poète et rāwī est progressivement supplanté au début de la
période abbasside par celui entre maître (ustāḏ) et élève
(tilmīḏ). Abū l-Faraǧ reflète cette évolution dans les deux
vignettes d' al-‘Attābī (m. au début du IIIe/IXe siècle) et de
Manṣūr al-Namarī (m. v. 190/805) dans lesquelles ce dernier
est décrit en tant qu' « élève et transmetteur »135
d'al-‘Attābī. Par contre, Wāliba b. al-Ḥubāb (m. v. 180/796),133 H. TOELLE, K. ZAKHARIA, A la découverte de la littérature arabe, Paris 2003 (Champs
essais), p. 57.134 R. DRORY, « The Abbassid Construction of the Jahiliyya : Cultural
Authority in the making ».Studia Islamica, 83, 1996, p. 39.135 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al-aġānī, t. XIII, p. 109,140 cité dans
KILPATRICK Hilary, « Abū l-Faraǧ's Profiles of Poets A 4th/10th Century Essay at the History and Sociology of Arabic Literature », Arabica 1997, t. 44, p. 94-128, p. 110.
78
lui, est simplement décrit comme étant l'ustāḏ d'Abū Nuwās136.
Cependant, autour du milieu du huitième siècle, on assiste à
l'apparition d'une nouvelle génération de transmetteurs,
toujours impliqués dans la transmission de la poésie mais
d'une manière différente de celle des transmetteurs tribaux.
En fait, ils constituent une génération intermédiaire entre
les transmetteurs tribaux et les intellectuels137.
Ces transmetteurs sont appelés rāwiya, ce sont des grands
transmetteurs de poésie sans attache à un poète particulier138.
Les représentants le plus représentatifs et les plus célèbres
de ce groupe sont le kufien Ḥammād al-Rāwiya (m. v. 155-6
h/772-773) et le baṣrien Ḫalaf al-Aḥmar (m. v. 180 h/796).
Ils diffèrent des transmetteurs arabes tribaux car ils
viennent de milieux urbanisés, de la deuxième génération
d'Iraniens convertis à l'Islam (mawālī), et donc issus d'un
milieu culturel complétement différent par rapport aux
transmetteurs arabes tribaux.
En effet, Ḥammad est d'origine daylamite, une région d'Iran
située sur la côte méridionale de la mer Caspienne, dont les
parents ont été faits prisonnier et amenés à Kūfā139. Quant à
Ḫalaf al-Aḥmar, ses parents sont originaires du Farġāna, la
vallée du cours moyen du fleuve Syr-Daria en Asie Centrale,
également faits prisonniers et déportés à Baṣra. Et ceux-ci
furent finalement affranchis140.
Il apparaît donc clairement que la transmission de la poésie
136 Ibid, t. XVIII, p. 100, dans p. 110.137 R. DRORY, « The Abbassid Construction of the Jahiliyya : Cultural
Authority in the making », op. cit., p 40.138 K. ZAKHARIA, « Chapitre XXIII : La poésie solennelle », dans T. BIANQUIS,
P. GUICHARD, M. TILLIER (sous la direction de), Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, op. cit., p. 343.
139 J. W. FÜCK, " Ḥammād al-Rāwiya", dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.140 C. PELLAT, " K̲h̲alaf b. Ḥayyān al-Aḥmar", dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
79
de ces rāwiya n'était pas héritée de leurs familles mais qu'ils
ont sciemment choisi cette profession comme une façon de
s'intégrer à la société islamique naissante. C'est
effectivement une manière d'obtenir un certain statut et
d'être accepté à la cour des dirigeants, en particulier celle
du Calife, qui aimait à s'entourer d'experts dans différents
domaines du savoir. Considérant cela comme un divertissement à
la fois plaisant et édifiant141.
Ainsi, avec Ḥammad commence un nouveau type de transmetteurs
indépendant des paramètres tribaux, un transmetteur qui ignore
la répartition traditionnelle du savoir poétique selon les
tribus. Il est autonome, déclarant son autorité sur toute la
poésie Arabe et non pas celle d'une tribu spécifique. On peut
ainsi considérer qu'il opère comme un lettré. Il fait aussi la
distinction entre les ères poétiques préislamique et
islamique, avec pour la première fois l'idée d'une poésie
proprement jahilite.
Cependant, il s'attribue lui-même la liberté du transmetteur
tribal de modifier les poèmes à l'occasion et même d'attribuer
sa propre poésie à des poètes connus, ce qui causera
finalement sa perte, comme nous le verrons plus loin142.
2) Philologues
Dans son acceptation la plus générale, la philologie tend à se
ramener à l'interprétation textuelle des documents et sa
fonction consiste à maintenir les « monuments » d'une
141 R. DRORY, « The Abbassid Construction of the Jahiliyya : Cultural Authority in the making », op. cit.,p. 40142 Ibid, p. 41.
80
tradition dans le plus grand état de pureté, afin d'en
préserver le contenu, spécialement dans les domaines où
prédominent les valeurs imaginatives ou esthétiques comme la
littérature143.
On assiste ainsi à l'émergence, dans le dernier quart du
huitième siècle, d'un groupe de philologues qui déclarent
posséder une autorité professionnelle sur la poésie arabe
anté-islamique144.
Ceux-ci sont souvent, tout comme les «grands transmetteurs »,
des mawālī pour qui l'expertise en poésie est un moyen de
s'intégrer à la société arabo-islamique en formation. Ce sont
ces philologues qui ont rassemblés un corpus qui était
auparavant conservé dans un cadre tribal, l'ont réorganisé et
présenté comme « le corpus des connaissances autorisées sur le
passé des Arabes »145.
La poésie préislamique devient ainsi un corpus clos aux
limites précises, perçu comme le dīwān al-‘Arab, c'est à dire
l'archive de tout ce qui concerne le passé des Arabes et donc
comme un « patrimoine » à conserver absolument146. Cette volonté
de mise par écrit de la poésie de la ǧāhiliyya au début du califat
abbasside est bien illustrée par l'exemple suivant :
Une source médiévale nous informe que le calife al-Manṣūr
entendit son fils, le prince héritier al-Mahdī réciter une ode
du poète pré-islamique al-Musayyab devant son tuteur al-
Mufaḍḍal al-Ḍabbī (m. v. 168 h/784-5), un célèbre philologue
143 P. ZUMTHOR, « PHILOLOGIE », dans Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 15 décembre 2012. URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/philologie/
144 R. DRORY, « The Abbassid Construction of the Jahiliyya : Cultural Authority in the making », op. cit.,p. 42.
145 Ibid, p. 43.146 H. TOELLE, K. ZAKHARIA, A la découverte de la littérature arabe, op. cit., p. 58.81
et connaisseur de la poésie pré-islamique. Il s'est tenu là,
caché, jusqu'à ce que le prince finisse sa récitation, puis
les fit appeler dans une de ses chambres. Là, le calife al-
Manṣūr demanda à al-Mufaḍḍal son avis sur la récitation de
l'ode par le prince et ajouta : « Si vous sélectionniez pour
vos élèves les meilleurs œuvres de poètes dont la poésie est
rare (shā‘ir muqill), vous accompliriez un grand service ». Et
c'est, conclut notre source, exactement ce que al-Mufaḍḍal
fit147.
Ce récit nous donne ainsi une explication sur les origines de
la très réputée anthologie de poèmes anciens (principalement
pré-islamiques) appelée al-Mufaḍḍaliyyāt d'après le nom de son
compilateur. Cette anecdote nous montre donc clairement que la
poésie anté-islamique est tenue en haute estime dans le
répertoire culturel des Abbassides car elle fait partie de
l'éducation des courtisans et du futur calife lui-même148.
Ainsi, les califes abbassides ont généralement une formation
solide en poésie jahilite, tel le calife al-Ma'mūn qui en a
une connaissance approfondie et le prouve dans ses discussions
avec les érudits149.
De plus, ce corpus de production poétique pré-islamique va
jouer un rôle dans l'exégèse coranique vu que seule cette
poésie permettra de comprendre le sens des mots rares (ġarīb al-
lūġa) et des tournures grammaticales obscures du Coran étant
donné que celui-ci a été révélé dans la langue même de cette
147 R. DRORY, « The Abbassid Construction of the Jahiliyya : Cultural Authority in the making », op cit., p. 33.
148 Ibid, p. 34.149 J. E. BENCHEIKH, « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil (m.247)
contribution à l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires »,op cit., p. 36.
82
poésie150.
Ce fait est d'ailleurs souligné dans le Coran lui-même où il
est dit: « C'est une révélation en langue arabe pure (fuṣḥa) »151
et « nous n'avons envoyé que des prophètes qui s'expriment
dans la langue de leur peuple »152.
En fait, la poésie archaïque est conçue par les philologues
comme le conservatoire de la langue et de la culture arabe.
Pour toutes ces raisons, la profession de « savant en poésie »
(al-‘ilm bi'l-ši‘r) fut créée au début du IXème siècle en tant
qu'occupation autonome parmi les autres disciplines des
lettrés en « sciences arabes »153.
Il est important de noter que l' « expertise en poésie » fut
inventée comme un champ légitime de connaissance par
l'appropriation par les philologues de l'autorité
professionnelle sur la poésie ancienne des arabes, auparavant
aux mains des poètes et des transmetteurs.
Apparemment, les poètes n'étaient pas une menace sérieuse pour
les philologues à l'époque abbasside, car il n’avait plus
parmi leurs attributions celle de préserver l'ancienne poésie.
Ainsi, nous avons connaissance de poètes qui étaient
d'éminents experts en ancienne poésie arabe, tel Abū Nuwās,
mais dont la célébrité ne se fonde pas sur la préservation de
cette poésie.
En fait, la campagne de délégitimation menée par les
philologues était dirigée en priorité contre les
transmetteurs, en particulier ceux de la dernière génération
(les rāwiya), qui, nous l'avons vu, opèrent à la fois en tant150 H. TOELLE, K. ZAKHARIA, A la découverte de la littérature arabe, op. cit., p. 58.151 Coran, sourate XXVI, verset 195.152 Coran, sourate XIV, verset 4.153 DRORY Rina, « The Abbassid Construction of the Jahiliyya : Cultural
Authority in the making », op cit., p. 44.83
que « transmetteurs » (tribaux) et en « philologues ». Les
principales cibles de cette campagne furent Ḥammād al-Rāwiya
et Ḫalaf al-Aḥmar. En effet, ils furent accusés d'introduire
des vers à eux dans leurs anthologies de poètes jahilites, de
présenter leurs propres poèmes comme si ceux-ci avaient été
composés par de célèbres poètes de cette époque et de modifier
les vers de cette poésie. En fin de compte, ils furent
dénoncés comme n'étant pas des transmetteurs fiables.
La méthode flexible ordinairement utilisée par les
transmetteurs pour se souvenir de la poésie ancienne a ainsi
été supplantée par le principe des philologues de conserver
cette poésie comme des « archives » de textes aux contenus
fixés, dans lequel la tâche consistant à préserver la version
correcte est primordiale.
Fait intéressant, il est souvent dit que les philologues
manquaient de talent pour composer de la poésie. L'accent mis
sur ce fait n'est pas pour déprécier les philologues, mais
plutôt pour les défendre des potentielles accusations de
modification des poèmes. Ainsi, il s'agit donc véritablement
d'une défense de leur professionnalisme selon leurs propres
critères de philologues et non de poètes154.
Ce conflit entre transmetteurs et philologues pour
l'appropriation du champ de connaissance qu'est la production
poétique de la ǧāhiliyya se trouve clairement illustré par ce
passage tiré de la biographie d'Ḥammād al-Rāwiya dans le Kitāb
al-Aġānī :
Un groupe de transmetteurs et de philologues experts en
histoire des Arabes, leurs guerres, leurs poèmes et leur
154 Ibid, p 46.84
langue, sont rassemblés dans le palais du Calife al-Mahdī. Un
des chambellans apparut et appela al-Mufaḍḍal et Ḥammād pour
les faire entrer. Après quelques temps, le secrétaire réapparu
avec al-Mufaḍḍal et Ḥammād. Le visage d'Ḥammad était abattu et
lugubre alors que celui d'al-Mufaḍḍal était radieux et
débordant de joie. Le secrétaire déclara devant tous ceux qui
étaient assemblés : « Le Calife vous informe qu'il a accordé au
poète Ḥammād 20 000 dirhams comme récompense pour sa belle
poésie, et a annulé le statut d'Ḥammad en tant que transmetteur
puisqu'il a ajouté aux poèmes qu'il transmet des éléments qui
n'étaient pas dedans ; et le calife accorde à al-Mufaḍḍal 50
000 dirhams comme récompense pour la fidélité de sa
transmission. Celui qui désire entendre de la belle poésie doit
écouter Ḥammād, et celui qu'intéresse une transmission fidèle
doit l'obtenir d'al-Mufaḍḍal ! » Les personnes présentes
demandèrent des nouvelles à propos de la signification de tout
cela et on leur répondit : « Le calife al-Mahdi demanda à al-
Mufaḍḍal, « Pourquoi le poète jahilite Zuhayr Ibn Abī Sulmā,
ouvre-t-il un de ses poèmes au milieu d'un sujet [ce qui est
contraire à la norme poétique] ? Quelle est donc la cause de
cette négligence de la version exacte pour commencer ce
poème ? ». Al-Mufaḍḍal répondit, « Aucune information sur cela
ne m'a été transmise, mais j'atteste qu'il l'a faite de façon
délibérée, peut-être avait-il l'intention de déclamer quelque
autre poème, et a subitement changé d'avis et dit simplement
« Changeons de sujet... » Ce qui est la première ligne du poème
en question], c'est à dire qu'il a abandonné ce quoi il pensait
pour commencer à réciter des vers sur al-Harim [le personnage à
propos duquel le poème fut composé], et c'est ainsi que le
poème paraît abrupt dans son début ». Puis le calife appela
Ḥammād et lui posa la même question, lequel répondit, « Zuhayr
n'a pas dit ceci, mais plutôt cela », puis Ḥammad cita trois
85
lignes comme si elles étaient le début, supposé manquant, du
poème. [Le calife] al-Mahdī resta silencieux, considéra cette
réponse, puis contraignit Ḥammād de lui répondre sous serment
quelle était la vérité concernant ces lignes, et qui les avait
ajoutées à ce poème de Zuhayr. Ḥammād n'eut alors pas d'autre
choix que d'avouer qu'il avait composé ces lignes lui-même, et
ainsi al-Mahdī le paya comme il est dit plus haut »155.
Cette histoire illustre clairement qui est sorti vainqueur de
la lutte pour le monopole de la transmission de la poésie
anté-islamique. Pour le calife abbasside al-Mahdī, éduqué par
al-Mufaḍḍal au nouveau modèle d'expertise en poésie, le modèle
de transmission de la poésie d'Ḥammād, qui avait fait de lui
le transmetteur favori des califes Omeyyades, est désormais
obsolète. Pour al-Mahdī, les compétences professionnelles
d'Ḥammād sont principalement celles d'un poète, et en aucunes
façons celles d'un « transmetteur fidèle », c'est-à-dire d'un
philologue qui, contrairement aux transmetteurs tribaux
traditionnels, n'ose en aucun cas « bricoler » la version
originale d'un poème156.
En fait, il considère cela comme le texte final et définitif
dont les aspects inhabituels peuvent être rationalisés, mais
non changés, ce qui est précisément ce qu'a fait al-Mufaḍḍal.
Ainsi, l'on est passé d'une tradition vivante, en perpétuel
changement à la lumière des exigences du présent à des textes
de poésie pré-islamique devenus des véritables documents
d'archive, représentant un témoignage d'un passé devenu
lointain157.
155 Ibid, p. 47.156 Ibid, p. 47157 Ibid, p. 4786
Ainsi, cette poésie, conservée précieusement par les
philologues mais aussi dorénavant complètement figée deviendra
au cours des siècles un idéal quasiment insurpassable de
production poétique en langue arabe. En témoigne l'hommage du
philologue kufien Ṯa‘lab au secrétaire-poète Ibrāhīm al-Ṣūlī.
En effet, ce philologue, défenseur de la poésie archaïque, se
refusait à transmettre le moindre vers dû à un secrétaire.
Pourtant, celui-ci rend hommage, de façon inattendue, à
Ibrāhīm, jugeant que ce dernier était un des meilleurs poètes
modernes. Son jugement s'assortit, il est vrai, d'une
référence à la production classique : admirant trois vers où
sont décrites des chamelles, il les trouve dignes d'un poète
ancien158.
Parallèlement à la pratique publique de la poésie où les
différents types de praticiens ont des pratiques bien
distinctes, ceux-ci interagissent dans des cadres plus privés
comme celui du maǧlis et c'est sur les interactions de ces
différents types de praticiens que nous nous pencherons à
présent.
158 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au IIe et IIIe siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique », op cit., p. 284.
87
A partir du règne d'al-Mahdi, se développent des espaces plus
intimes pour la poésie et le chant dans lesquels une plus
grande variété de sujets sont être abordés. Il s'agit de
90
Figure 2 : Histoire de Bayâd et Riyâd (Hadîth Bayâd u Riyâd) : Bayâd chante en s'accompagnant sur le ‘oûd devant la noble dame et ses demoiselles d'honneur – Maghreb (Espagne ou Maroc), XIIIe siècle – (175 mm x 192 mm.).Vatican, Bibliothèque Apostolique, Ms. Ar. 368, folio 10 recto. (d'après R. ETTINGHAUSEN, La peinture arabe, Genève 1977, p. 65.)Cette miniature illustre une pratique de la poésie, qui était souventchantée, d'ordre privée dont les cénacles vont être le lieu d'expressionprivilégiée. Ceux-ci sont un lieu majeur d'interactions entre lesdifférentes catégories de praticiens de la poésie présents à la cour quenous avons vues plus haut.
réunions à caractère intime, ayant souvent lieu de nuit, où le
calife pouvait se détendre en compagnie de ses nadīm-s, ses
courtisans les plus proches, et toutes sortes de vers, même
ceux ayant un parfum de scandale, pouvaient être composés et
mis en musique. De plus, les vers considérés comme les
meilleurs étaient fréquemment publiés et circulaient dans le
public lettré159.
Ces maǧlis, comme nous nommeront désormais ces cercles, ont une
importance fondamentale pour ce qui concerne la pratique de la
poésie à la cour abbasside car ce sont des lieux d'échange et
de création privilégiés pour les différentes catégories de
praticiens que nous avons vu dans la première partie. Dans
cette ambiance relativement privée et informelle, les
différents praticiens de la poésie vont interagir et produire
une production poétique spécifique illustrée par de la poésie
bachique, amoureuse et élégiaque, d'agrément ou de joutes.
1) Poésie bachique (Ḫamriyya)
La poésie bachique est une poésie qui célèbre les plaisirs du
vin et de l'ivresse. Ce genre poétique connaît un grand
développement au début de la période abbasside, en particulier
dans la première partie du IIIème /IXème siècle. Son succès,
tantôt comme moyen de subversion et tantôt comme exaltation
des plaisirs de la vie, reflète l'oscillation de la société
musulmane naissante sur la signification et l'étendue qu'il
convient de donner à l'interdiction des boissons enivrantes.
En effet, si le Coran interdit explicitement la consommation
159 H. KENNEDY, The Court of the Caliphs : The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty, op. cit.,p. 116.
91
de vin, car il est dit : « Ô les croyants! Le vin, le jeu de
hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne
sont qu'une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous-en,
afin que vous réussissiez »160, ce précepte est cependant loin
d'être complétement respecté. Preuve de cette oscillation,
dont les sources témoignent par des centaines d'anecdotes, le
succès des cercles bachiques au cœur même du pouvoir. En
effet, à la cour de Bagdad, puis de Sāmarrā', les cercles
bachiques sont devenus une véritable institution161.
Le poème bachique dépeint un monde idéalisé où les commensaux
sont des jeunes gens accomplis ; les échansons beaux, subtils
et consentants ; les marchands de vin, serviables malgré leur
cupidité ; les ustensiles (aiguière, coupe...) raffinés et
précieux ; et la boisson elle-même un nectar qui transporte ou
endort. Décrire cet univers aussi irréel qu'idyllique sert au
poète à transgresser les principes de la morale ambiante, à
exprimer son rejet des valeurs inspirées du monde bédouin162.
Pour la tradition, le premier poète bachique de l'islam aurait
été al-Harth b. Badr al-Ghaznî (m. v. 64 h/684), quoi que l'on
ne sache pas grand-chose de sa production. Plus
vraisemblablement, l'inventeur de la ḫamriyya serait Abū l-Hindī
al-Riyāhī, dont on ne sait presque rien, sinon qu'il aurait
vécu dans la seconde moitié du II e / VIII e siècle et aurait
pu être en contact avec le groupe des libertins de Kūfa. Ces
derniers faisaient de l'ivresse un mode de contestation, voire
160 Coran, sourate V verset 90161 T. BIANQUIS, P. GUICHARD, M. TILLIER (sous la direction de),"Les débuts
du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes",op. cit.,p. 339.
162 Ibid, p. 341.92
de rejet, des valeurs islamiques163.
Mais le plus grand poète bachique reste Abū Nuwās (m. v. 200
h/815), célèbre pour avoir été le commensal d'al-Amīn164. En
effet, le bachisme, qui s'affirme déjà sous al-Rašīd à la cour
abbasside, trouve en al-Amīn, dauphin puis souverain, un
amateur fervent ; il connaît une fortune qu'il ne retrouvera
plus165. En effet, al-Amīn est considéré comme « un homme très
cultivé, sensible à la poésie et pourvu, en ce domaine, de
plus de goût et de finesse que son frère al-Ma'mūn. Type du
protecteur joyeux et familier avec ses commensaux, il aime les
soirées fines, l'amour, la musique »166. Ce goût du vin et de la
transgression atteint des sommets dans la poésie d'Abū Nuwās
qui, en bon poète bachique, n'hésite pas à faire l'éloge de
l'ivresse, comme l'illustrent les vers suivants :
1 Dis-moi : « Voilà du vin ! », en me versant à boire.…Mais surtout, que ce soit en public et notoire.2 Ce n'est qu'à jeun que je sens que j'ai tort. Je n'ai gagné qu'en étant ivre-mort.[…]167
En effet, le plus choquant dans ces vers est que d'une part le
poète déclare qu'il veuille que son ivrognerie soit connue
« en public » comme si c'était un motif légitime de fierté. De
plus, il y ajoute une critique implicite de la loi coranique,
163 Ibid, p. 340.164 Ibid, p. 341.165 BENCHEIKH Jamel Eddine, « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil
(m.247) contribution à l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires », op cit., p35.
166 Ibid p. 34.167 ABÛ-NUWÂS, (préf. et trad. Vincent-Mansour Monteil), Le vin, le vent, la vie,
Sindbad, coll. « La petite bibliothèque de Sindbad », Arles, 1998 (éd. Précédentes 1979, 1990), p. 70.
93
la charia, qui interdit la consommation de boissons
alcoolisées en disant au vers 2 qu'il ne sent « dans son
tort » que lorsqu'il n'est pas ivre au lieu du contraire.
D'autres vers bachiques d'Abū Nuwās sont plus spécifiquement
consacrés au vin lui-même qui est décrit de façon très imagée
avec un grand luxe de détails et un riche vocabulaire. Mais
laissons plutôt la parole à Mas‘ūdi qui, dans Les prairies d'or,
cite de nombreux vers du poète sur le vin et nous relate une
magnifique description de sa poésie.
L'auteur cité (« un des assistants »168) ajoute : Abû Nuwâs a
chanté le vin, sa saveur, son parfum, sa beauté, sa couleur,
son éclat, l'influence qu'il exerce sur l'âme. Il a décrit
l'appareil des banquets, des coupes et des amphores, les
convives, les libations du matin et celles du soir, en un mot
tout ce qui se rattache à ce sujet, et il l'a fait avec un
talent si grand qu'il aurait, pour ainsi dire, fermé les portes
de la poésie bachique, si le champ de celle-ci était moins
vaste, si son domaine avait des limites et s'il était possible
d'en atteindre les bornes. Voici en quels termes ce poète
décrit l'éclat du vin (voir le Dīwān d'Abū Nuwās, 681) :
5. – Dans la main de l'échanson [la coupe] brille comme le soleil, et cette main
a l'éclat de la lune.
Et ces vers :
10. – En se mêlant à l'eau, le vin perce les ténèbres de la caverne, comme
l'aurore les ténèbres de la nuit.
11. – Le buveur s'y dirige grâce à cette clarté, comme la caravane se guide
168 MAS‘ŪDI, Les Prairies d'or, Op cit., tome V, p. 1417, §3544.94
d'après les feux allumés sur les hauteurs.
Du même poète :
4. – Dix années [de cave] ont rendu cette boisson si pure et si brillante que si
elle était répandue sur la nuit, elle en chasserait les ténèbres.
Et encore :
4. – Lorsqu'un des convives boit à cette coupe, on dirait qu'il approche ses
lèvres d'une étoile dans la profondeur des nuits.
5. – Tout ce que la coupe [éclaire] dans la pièce est l'orient, tout ce qu'elle
laisse dans l'ombre est l'occident.
Du même :
5. – L'éclat que le vin répand sur la coupe (var. du Dīwān : « dans la nuit ») est
si vif qu'il semble que le buveur boive à la lueur d'un brasier.
Du même :
4. – Ménage-toi, lui disais-je, car je vois l'aurore briller à travers les fentes de la
maison.
5. – L'aurore ? Répondit-il d'un air étonné ; il n'y en a d'autres ici que la lueur
répandue par le vin.
6. – Et, se dirigeant vers l'outre (var. du Dīwān : « vers le vin »), il en ferma
l'orifice ; aussitôt revint la nuit aux voiles traînants.
Du même (les vers ne figurent pas dans le Dīwān) :
Rouge avant son mélange [avec l'eau], puis jaune, on dirait le soleil qui darde
95
sur toi ses rayons.
Du même :
Il semble qu'il y ait dans le vin une flamme ardente qui t'inspire tour à tour le
respect et la crainte.
Du même :
Sa couleur est d'un rouge si vif que, si l'eau ne venait l'éteindre, elle ravirait la
lumière du jour aux yeux qui la regardent en clignotant.
Du même :
Son mélange avec l'eau fait jaillir des rayons semblables aux étoiles [filantes]
qui fondent sur les génies indiscrets.
Du même :
4. – Ayant vieilli dans l'outre, le vin a profité de la chaleur du soleil et de la fraîcheur
de l'ombre.
Du même :
3. – Il me permet de boire ce vin, dont les rayons se prolongent sans
interruption jusqu'à l'empyrée
Du même :
7. – Il me demandait un flambeau : « Va doucement, lui ai-je répondu, l'éclat
du [vin] te suffira comme il me suffit ».
8. – Et je versai dans la coupe de verre cette boisson [délicieuse] qui remplaça pour lui
96
le jour jusqu'au lever du jour véritable.
L'auteur déjà cité ajoute : Les poésies d'Abû Nuwâs sont
remplies de descriptions du même genre : le vin y est comparé
au feu ; il est assimilé à la lumière, il dissipe les ténèbres,
transforme la nuit en jour et l'obscurité en clarté ; en un
mot, l'éloge est poussé dans ces vers jusqu'aux dernières
limites de l'hyperbole. Mais il est impossible de trouver pour
la couleur et l'éclat du vin un terme de comparaison plus
heureux que celui dont le poète s'est servi, puisque la lumière
est l'expression suprême de la beauté ». – Cette description
inspira à al-Mustakfî une joie si vive et une émotion si
grande, qu'il pria le narrateur de ne pas aller plus loin.
Celui-ci obéit aux ordres du calife.169
On assiste à cette époque à une codification du cercle
bachique qui, selon Abū Nuwās, inclut idéalement 5 membres, 3
buveurs, leur hôte et un musicien. Les buveurs et l'hôte
devaient être des personnes de bonne compagnie, lettrées,
spirituelles et raffinées, sachant bien boire et converser.
Dans la réalité, cependant, les cercles étaient généralement
plus larges170.
Sous al-Ma'mūn par contre, la ḫamriyya régresse au point de
disparaître, seul s'exprime le lyrisme officiel du
panégyrique171. Par contre, sous le califat d'al-Mutawakkil, on
assiste à une renaissance des cercles bachiques, l'exemple
étant donné par le calife lui-même. Ainsi il s'entoure de169 Ibid, p. 1418, 1419, 1420, § 3546 à 3549.170 BIANQUIS Thierry, GUICHARD Pierre, TILLIER Mathieu (sous la direction
de),"Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes", op cit., p. 339-340
171 BENCHEIKH Jamel Eddine, « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil (m. 247) contribution à l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires », op. cit., p. 36.
97
commensaux (nadīm), tels Abū ‘Abd Allāh Aḥmad b. Ibrāhīm ou
Ibrāhīm b. al-Mudabbir. Le commensal doit être prêt à obéir
aux moindres caprices du calife, il doit être capable de
réciter un poème, de débattre d'une question grammaticale, de
discuter d'un point d'histoire, de se prêter à une joute et
d'y faire preuve d'esprit172.
Ce même Ibrāhīm b. al-Mudabbir réunit également chez lui un
célèbre cercle bachique fréquenté par des chanteurs et des
musiciens comme ‘Arīb, Ǧaḥẓa (m. 324 h/936) le joueur de
ṭunbūr, un instrument à corde proche du ‘ūd (luth) et al-Qāsim
b. Zurzur ; des grammairiens tel al-Faḍl b. Muḥammad al-
Yazīdī, des secrétaires, en particulier Sa‘īd b. Ḥumayd et des
poètes comme al-Buḥturi, Ibn al-Rūmī (m. 283 h/896) ou Abū
‘Abd Allāh Muḥammad b. Ṣāliḥ b.‘Abd Allāh attaché à la famille
des Banū al-Mudabbir et qui fit leur panégyrique à plusieurs
reprises173.
La poésie bachique est, à l'époque abbasside, un genre nouveau
particulièrement prisé des muḥdathūn, c'est-à-dire les poètes
novateurs qui refusent l'imitation des anciens, en particulier
pour tout ce qui concerne le modèle classique de la qasīda
archaïque alors en train de se constituer sous l'égide d'Ibn
Qutayba (m. 276 h/889), le grand polygraphe du IIIe/IXe siècle
à la fois théologien, philologue et écrivain dont
l'introduction de l'ouvrage Kitāb al-Šiʿr wa-l-Šuʿarāʾ est souvent
considérée comme un manifeste du néo-classicisme174.
172 BENCHEIKH Jamel Eddine, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au II e et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique , op. cit., p. 297.
173 Ibid p. 293.174 G. LECOMTE, « Ibn Ḳutayba », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
98
D'autres poètes sont également appréciés pour leur ḫamriyya, il
s'agit de Muslim b. al-Walīd (m. 208 h/823), al-Husayn b. al-
Dahhāk (m.v. 250 h/864) et Ibn al-Mu‘tazz (296 h/908), le
« calife d'un jour », connu aussi pour ses ġazal-s175, c'est-à-
dire sa poésie amoureuse qui est liée inextricablement à la
poésie bachique.
2) Poésie amoureuse (ġazal)
- Le ġazal des poètes professionnels
A l'époque omeyyade, le ġazal apparaît dans la région du Ḥijaz,
à l'ouest de l'Arabie et dans laquelle se trouvent les villes
saintes de l'islam, la Mecque et Médine. Certains expliquent
son émergence par l'oisiveté des aristocrates mecquois et
médinois, ceux-ci s'étant en effet considérablement enrichis
grâce au butin acquis par les premières conquêtes qui a afflué
dans ces deux villes mais ont ensuite perdu tout pouvoir
politique au profit de la Syrie depuis la prise du pouvoir par
Mu‘āwiya (règne de 41 h/661 à 60 h/680) et l'avènement de la
dynastie des Omeyyades de Damas (41 h/661 à 132 h/750).
A cette époque, il existe deux types de ġazal. Le premier est
le ġazal urbain, dont le protagoniste principal multiplie les
aventures avec de nombreuses belles différentes et dont le
représentant le plus célèbre est le poète ‘Umar Ibn' Abī
Rabī‘a (m.v. 93 h/712) dont l'alter ego poétique est un véritable
Don Juan. Le deuxième type est le ġazal bédouin (ou ‘udhrite, du175 T. BIANQUIS, P. GUICHARD, M. TILLIER (sous la direction de),"Les débuts
du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes",op cit., p. 341.
99
nom de la tribu bédouine des Banū ‘Uḏrā dont les membres
seraient particulièrement doués pour cette poésie) où les
aventures ne sont que les péripéties douloureuses de
l'histoire unique d'un amour unique et impossible voué à une
femme unique. Amour impossible car le poète proclame, contre
l'usage tribal, le nom de sa bien-aimée et se voit donc, en
conséquence, privé de la possibilité de s'unir à elle. Le plus
connu des poètes ayant cultivé ce genre de ġazal est en fait
une figure imaginaire Qays ibn al-Mulawwaḥ, plus connu sous
son surnom de Maǧnūn Laylā (le fou de Laylā), représentant
extrême de l'amant passionné et inassouvi176. D'après la
légende, il finit par devenir vraiment fou et mourut dans le
désert entouré par les bêtes sauvages comme l'expliquent les
vers suivants :
Je baise cette terre où ton pied s'est posé,
Douce Laylâ. On crie : « Au fou ! Voyez-le faire ! »
Aimé-je donc la terre assez pour un baiser ?
Mais non ! C'est toi que j'aime et ton pas sur la terre !
De toi me voici fou, me voici, par amour,
Trouvant du charme au souvenir qui me maltraite,
Rivé, pour tout pays, au désert, et toujours
Goûtant plus de bonheur à vivre avec les bêtes.177
Même si la mise par écrit du cycle de Majnūn Laylā date
vraisemblablement de l'époque omeyyade, ces poèmes ont une
influence marquante sur le ġazal de l'époque abbasside et la
perception de la mise en poésie de la passion amoureuse à la176 ZAKHARIA Katia, TOELLE Heidi, A la découverte de la littérature arabe,op cit., p. 72.177 MAJNÛN (préf. et trad. André Miquel), L'amour poème, Actes Sud, coll. « La
petite bibliothèque de Sindbad », Arles, 1998 (éd. Précédente 1984), 107 p.
100
cour abbasside.
Cependant, à l'époque abbasside, Baššār ibn Burd apporte à ce
genre poétique une transformation déterminante. Il puise tant
dans les thèmes urbains que bédouins et mêle ġazal et
bachisme. Les plaisirs de l'amour s'associent désormais aux
cercles bachiques. Cependant, on remarque que la production de
ġazal se raréfie au début de la période abbasside même si elle
continue d'être illustrée par des poètes de talent comme
Baššar b. Burd, Abū l-‘Atāhiya ou Abū Nuwās178. De plus, à cette
époque, l'image de l'aimée connaît une importante
transformation, elle devient plus volontiers une qayna
(esclave-chanteuse) qu'une femme de condition libre comme
l'illustrent des poèmes de Muṭī‘ Ibn 'Iyās (m. 169 h/785).
Dans la poésie de cour abbasside, le sentiment amoureux est
canalisé et rendu approprié à cette société policée. Être
amoureux de femmes ou de garçons inaccessibles était considéré
comme tout à fait convenable pour les membres de la ḫāṣṣa ; même
les califes tombaient amoureux et écrivaient de la poésie sur
leurs désirs ardents, même si tout cela était sans doute
imaginaire.
Certains poètes, comme Abū Nuwās, développaient une attitude
d'hédonisme outré et transgressif. Mais la plupart étaient
plus raisonnables : l'amour malheureux était à la mode et
établissait l'amoureux comme un homme sensible et de goût,
capable d'apprécier la littérature raffinée et cherchant pour
lui-même la façon la plus élégante pour décrire la douleur
qu'il ressentait. Cette attitude de l'amant sophistiqué et
quelque peu éthéré permettait d'identifier celui qui était
épris comme un membre à part entière de la société de cour,178 Ibid p. 339101
capable de participer aux discussions raffinées du cercle
auquel il appartenait179.
Mais en fait, le tournant décisif a lieu avec Abū Nuwās dont
l'empreinte marque tout autant le ġazal que la poésie bachique
vue précédemment. Jouant sur l'ambiguïté des genres, il
célèbre les travestissements, fait coïncider l'aimé(e) et
l'échanson, et confère une place à part entière aux charmes
des éphèbes dans le ġazal ġilmānī, poésie amoureuse homosexuelle180
dont voici un extrait :
1 J'ai quitté les filles pour les garçons et, pour le vin vieux, j'ai laissé l'eau claire.2 Loin du droit chemin, j'ai pris sans façon celui du péché car je le préfère.3 J'ai coupé les rênes et sans remords j'ai enlevé la bride avec le mors.
4 Me voilà tombé amoureux d'un faon coquet, qui massacre la langue arabe.5 Brillant comme un clair de Lune, son front chasse les ténèbres de la nuit noire.[…]181
En effet, bien que cela soit réprouvé par l'islam, le grand
poète vante sans fards l'amour des garçons, généralement de
jeunes échansons imberbes d'origine persane (d'où le passage
de l'extrait où il est dit que le jeune homme dont le poète
179 H. KENNEDY, The Court of the Caliphs : The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty, p. 117.
180 H. TOELLE, K. ZAKHARIA, A la découverte de la littérature arabe, op. cit., p. 69-73.181 ABÛ-NUWÂS, (préf. et trad. Vincent-Mansour Monteil), Le vin, le vent, la vie, Op.
Cit.p.91102
est tombé amoureux « massacre la langue arabe »).
La cour abbasside est également le lieu où s'épanouit le ẓarf,
terme que l'on peut traduire par « élégance »,
« raffinement », ainsi le ẓarīf est-il l'« homme du monde », une
sorte de « dandy », ou, au pluriel, ẓurafā', les « gens
raffinés ». Ces ẓurafā' vont être à l'origine d'une vision
courtoise de l'amour.
On tient le poète al-‘Abbās b. al-Aḥnaf (m. 193/808) comme le
premier représentant du ẓarf en tant qu'individu combinant les
diktats littéraires et sociaux du raffinement182. Ce poète
présente la particularité de s'être consacré uniquement à la
poésie amoureuse érotico-élégiaque (ġazal, nasīb). Il est en
faveur auprès du calife Hārūn al-Rashīd qui l'utilise non
comme panégyriste mais plutôt pour charmer ses loisirs. Il est
aussi en rapport avec les Barmécides, en particulier Yaḥyā et
Ǧa‘far, et apparemment apprécié des dames du harem califien
comme Umm Ǧa‘far, plus connue sous son surnom de Zubayda (m.
216 h/831-2), épouse du calife Hārūn al-Rašīd et mère de son
successeur al-Amīn183, qui lui donna des présents184.
Autre poète ẓarīf célèbre, le poète Ibrāhīm b. al-Mudabbir (m.
279 h/892-893), commensal (nadīm) du calife al-Mutawakkil
(règne de 232 h/847 à 247 h/861)185, dont l'essentiel de la
production se compose de poèmes ayant pour thème principal la
passion. Il est l'amant attitré de ‘Arīb, une qayna. Les deux
amants échangent de nombreux billets en vers et le caractère
public de leur relation est primordial. De même son ami Sa‘īd
b.Ḥumayd (m. v. 260 h/874), le type même du ẓarīf qui anime les
182 J. E. MONTGOMERY, « ẓarīf », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.183 R. JACOBI, " Zubayda bt. Ḏj̲aʿfar" dans Encyclopédie de l’Islam, op. cit.184 R. BLACHERE, “al-‘Abbās b. al-Aḥnaf”, dans Encyclopédie de l’Islam, op. cit.185 " Ibn al-Mudabbir" dans Encyclopédie de l’Islam, op. cit.
103
soirées bagdadiennes, a également une liaison avec une qayna,
Faḍl, l'une des plus grandes poétesses de l'époque. En fait,
ces couples faits d'une chanteuse et d'un secrétaire
participent grandement à cette sociabilité des ẓurafā' décrite
par al-Waššā'186. En effet cet homme de lettres faisait autorité
pour ce qui concerne les bonnes manières et l'un de ses
ouvrages, le Kitāb al-Muwaššā, est un manuel des comportements,
des manières et des goûts particuliers propres aux ẓurafā comme
la politesse, la piété et la discrétion. Un autre de ses
ouvrages, le Tafrīǧ al-muhaǧ wa-sabab al-wuṣūl ilā al-faraǧ, est même un
guide pour écrire des lettres à l'intention de l'amoureux ẓarīf
dans lequel il présente des exemples de préambule et surtout
de la poésie à citer187.
Achevons cette partie sur la poésie amoureuse des poètes
professionnels par l'analyse d'un poème célèbre d'Abū al-
Atāhiya. Il s'agit d'un poème court, de 11 lignes seulement,
composée en un mètre léger : al-mutaqārib, dont l'utilisation
suggère que le poème soit un ġazal, un poème d'amour à l'image
des fameux poètes ‘udhrites de l'époque omeyyade sur un amour
chaste, unique et non-partagé, cependant cette œuvre est
également un panégyrique à la gloire du calife.
C'est à ce poème que le poète doit le début de sa célébrité,
comme le montre cette anecdote issue du Kitāb al-aghānī (le livre
des chansons) d'al-Iṣfahānī, où nous lisons qu'un jour où le
calife al-Maḥdī tenait une audience pour les poètes se
trouvait parmi eux Baššār ibn Burd ; Ašǧa‘ al-Sulamī, un élève
186 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au IIe et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique , op. cit., p. 291.
187 W. RAVEN, « al-Washshā' », dans Encyclopédie de l’Islam, op. cit.
104
et admirateur de Baššār ; et Abū al-Atāhiya. Et que comme le
raconte Ašǧa :
Quand Baššār entendit [Abū al-‘Atāhiya] parler, il [me] dit :
« O Aḫū Sulaym [Ašǧa‘], est-ce celui que l'on surnomme le
Kufien ? Oui, répondis-je. « Puisse Dieu ne pas le récompenser
par des bienfaits, lui qui nous a réunis ici avec lui ! »
répondit Baššār. Puis al-Mahdī dit à Abū al-‘Atāhiya,
« Récite ! » A la suite de quoi Baššār [me murmura], « Malheur
à toi ! Va-t-il commencer à réciter avant nous ? » « Il semble
bien », dis-je, et Abū al-‘Atāhīya récita les cinq premiers
vers de « Est-ce ma dame... » Puis... Baššār me dit, « Malheur
à toi, O Aḫū Sulaym ! Je ne sais ce qui m'émerveille le plus :
combien sa poésie est mauvaise, ou comme il [ose] réciter de la
poésie amoureuse à propos d'une esclave du calife pour que le
calife l'entende avec ses propres oreilles ! » Jusqu'à ce qu'il
atteigne « Vins à lui le califat... » et les cinq derniers
vers, à propos desquels Baššār, tremblant d'aise, me dit,
« Malheur à toi ! Je n'arrive pas à croire que le calife n'est
pas en train de sauter de joie de son trône !... »188
Abū al-‘Atāhiya « My Coy Mistress » (A-Lā Mā li-Sayyidatī)
1 What ails my lady ?
Is she coy ?
And I must bear her coyness ?
2 And if not, why does she accuse me ?
What crime did I commit ?
188 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHÂNĪ, Kitāb al-Aġānī, 4 :1247-48, d'après PINCKNEY STETKEVYCH Suzanne, The Poetics of Islamic Legitimacy : Myth, Gender, and Ceremony in the Classical Arabic Ode, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2002, p.146.
105
May God send rain upon her ruined abode !
3 A slave girl of the Imām –
has not love been lodged
beneath her shirt ?
4 Among maidens, dark-eyed, short-stepped,
she walked, as weighty buttocks
drew her back.
5 God has tried my soul with her,
and has tired her censurers
with blame.
6 As if before my eyes,
wherever I sojourn on earth,
I see her likeness.
7 [She was] the caliphate
[and] came to him, submissive,
training the train of her gown.
8 She was right only for him ;
he only for her.
9 Should anyone else desire her,
The very earth would quake.
10 Should the hearts' daughters fail to obey him,
God would not accept their deeds.
11 And the caliph, out of hatred for the word « no »,
106
hates whoever utters it.189
Avec une grande concision Abū al-‘Atāhiya évoque, sous la
forme d'un ġazal, toutes les conventions essentielles du
panégyrique sous sa forme abbasside bipartite.
Structurellement, ce poème est divisible en deux parties,
celle comprise entre les vers 1 à 6 et celle entre les vers 7
à 11, comme l'anecdote citée plus haut le confirme. En effet,
l'histoire racontée par Ašǧa‘ al-Sulamī nous indique bien que
la tradition voit dans la lecture de ce poème une surprise
dans laquelle le poète joue avec les attentes du public pour
produire, à la fin, un effet inattendu. Comme confirmé par
l'anecdote, les six premiers vers donnent l'impression d'une
description érotico-amoureuse conventionnelle (tašbīb), qui
devient choquante une fois que nous sommes informés que
l'objet de la passion du poète est la propriété du calife. En
effet, sachant que le tašbīb de la belle était considéré comme
équivalent à une liaison d'ordre charnelle, le début du poème
d'Abū al-‘Atāhiya peut être considéré comme un outrage au
calife dont la conséquence attendue et obligatoire devrait
être son exécution sur-le-champ même s'il est clair que la
belle du poète l'a frustré dans ses désirs et que donc cet
amour est non partagé. Mais soudain, au vers 7, on se rend
compte que la concubine du calife qui vient d'être décrite
s'avère être une métaphore du califat. Ainsi, c'est
symboliquement l'umma toute entière qui se soumet au calife
al-Mahdī dans une métaphore dont les origines tiennent sans
doute dans le rite du hieros gamos (mariage sacré) du Moyen-189 Fayṣal, Abū al-‘Atāhiyah, poème no. 197, pp. 609-13 d'après PINCKNEY
STETKEVYCH Suzanne, The Poetics of Islamic Legitimacy : Myth, Gender, and Ceremony in the Classical Arabic Ode, Op Cit., 2002, pp.146-147.
107
Orient antique.
Néanmoins, en conformité avec les attentes du public, la
deuxième partie de la qasida, celle du panégyrique proprement
dit (madīḥ), devrait remplacer l'amour malheureux du prélude
élégiaque par la dévotion pour le calife. Au lieu de cela,
plutôt qu'un changement radical dans le ton du poème qui
devrait passer du lyrisme « efféminé » du prélude élégiaque à
la « virilité » martiale du madīḥ, l'ensemble étant à l'origine
du phénomène de contraste entre les deux parties, l'atmosphère
érotique du prélude élégiaque prévaut jusqu'à la fin du poème.
Le pouvoir et la domination du calife, exprimés de manière
conventionnelle dans les termes et le ton de l'éthos héroïco-
martiale de l'aristocratie guerrière qui caractérise le madīḥ
est métaphoriquement transférée au domaine de l'intime et de
l'érotisme typiques du ġazal.
Cette métaphore sexuelle du calife et de sa concubine (aux
vers 7-8) exprime parfaitement d'un côté la relation de
soumission et de domination et de l'autre la complémentarité
parfaite qui définit la relation du souverain à ses sujets. Si
le désir du poète lors du prélude élégiaque (nasīb) se trouve
être frustré, il est évident que ce n'est pas le cas de celui
du calife dans le madīḥ. De plus, la relation de maître à
esclave évoquée par le poète ajoute aux dimensions mythiques
et sexuelles du hieros gamos celle de la propriété légitime ; une
relation de propriétaire envers sa propriété légitime. Dans un
tel contexte, la véhémence de la jalousie d'ordre sexuelle du
poète sert à exprimer à la fois la colère du calife outragé et
la fureur cosmique, le tremblement de terre, dont une autre
conception du califat serait la cause (vers 9).
Dans les deux derniers vers, le poème change la relation du108
calife au califat à celle des sujets au califat. D'abord, au
vers 10, l'obéissance et la soumission au calife devient une
partie de la foi islamique, sans laquelle les bonnes actions
de quelqu'un sont caduques aux yeux de Dieu. En effet, la
revendication d'obéissance politique exclusive au calife de
tous les musulmans est un élément central de la théorie du
pouvoir califal. Ici ce concept est représenté par une
métaphore sexuelle à travers la description de la loyauté
politique des musulmans comme des « filles de cœur » (banātu l-
qulūbi) : ils sont ainsi présentés comme des jeunes filles ou
des concubines qui doivent se soumettre aux exigences
sexuelles de leur maître. Cette métaphore étant comprise, elle
permet de comprendre le dernier vers (vers 11). Le « non »
doit se lire comme un refus aux droits et aux avances d'ordre
sexuel du calife, ce refus devient ainsi assimilé à une
négation d'allégeance politique, niant au calife l'obéissance
qui lui est due.
Le charme et l'efficacité de ce poème résident tous deux dans
son audace contrôlée : l'utilisation de ce qui est du point de
vue de la forme un ġazal pour remplir la fonction d'une qaṣīdat al-
madḥ (une ode panégyrique). En d'autres termes, utiliser un
genre poétique « léger » pour transmettre la gravité de la
monarchie absolue.190
- La poésie élégiaque chez les secrétaires
La poésie élégiaque est un genre très prisé par les kuttāb qui
vont ainsi s'approprier les codes de la poésie amoureuse
190 PINCKNEY STETKEVYCH Suzanne, The Poetics of Islamic Legitimacy : Myth, Gender, and Ceremony in the Classical Arabic Ode, Bloomington Indianapolis 2002, p. 147-150.
109
(ġazal) des poètes « professionnels » que nous venons de voir.
En fait, la poésie élégiaque est caractérisée par une langue,
un vocabulaire et des thèmes convenus, tout entier vouée à une
créature au demeurant parfaitement vague et anonyme, le poète
ne voit dans l'amour que l'impossibilité où il se trouve de le
réaliser. La passion est douleur, elle s'efface devant son
effet, elle ne révèle ni une âme ni un destin particuliers. Le
poème qui l'exprime se fixe en attitudes, et chacun peut les
reconnaître pour siennes. Œuvres nées d'une même inspiration,
fruits d'une même écriture, elles ne caractérisent pas leur
auteur, elles sont au-delà de sa personnalité ; elles ne
traduisent pas une conscience, elles se fondent dans leur
objet, et celui-ci ne saurait être réservé à un individu191.
Un exemple typique de kātib célèbre pour sa poésie élégiaque est
Ḫālid b. Yazīd (m.v. 269 h/883), c'est un poète de l'amour et
dans sa poésie, il dépeint les tourments sans fin de l'amant,
ses larmes, ses insomnies, la cruauté de sa solitude. Le
souvenir de l'aimée le hante et la fatalité de l'amour le
torture. Son cœur :
« chaque jour saigne d'une blessure d'amouret d'un tourment nouveau inventé chaque jour »192
Il faut noter que ses hommages ne s'adressaient pas uniquement
à des femmes, en effet, Ḫālid était très amateur d'éphèbes, et
leur consacra de nombreuses pièces193.
3) joutes poétiques et improvisation
191 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au IIe et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique , op. Cit., p. 307.
192 Ibid, p. 311193 Ibid, p. 312110
A côté des genres poétiques stéréotypés que nous avons étudiés
plus haut, les poètes se livraient régulièrement à des joutes
verbales, souvent pour le plus grand plaisir de leurs
protecteurs. La capacité à improviser des vers était donc une
qualité fondamentale pour les poètes.
A la cour abbasside, les poètes avaient l'habitude de se
mesurer à leurs contemporains en s'engageant dans des combats
de vers satiriques. Parfois ceux-ci étaient de même niveau ou
alors il n'y avait pas clairement de vainqueur. Mais prendre
un rival restait risqué car si l'un des participants était
totalement vaincu, sa carrière à la cour pouvait être brisée
nette, c'est d'ailleurs ce qui arriva au malheureux Wāliba b.
al-Ḥubāb qui se retira à Koufa après avoir été vaincu par les
poètes Baššār b. Burd et Abū l-‘Atāhiya194. Pire encore, le
poète vaincu pouvait perdre le soutien de son clan comme dans
le cas d'Abū Sa‘d al-Maḫzūmī (m.v. 230/845) qui fut carrément
radié de l'arbre généalogique de son clan après avoir perdu
une joute poétique face au redoutable Di‘bil195. La chose la
plus humiliante que pouvait faire un poète célèbre était de ne
même pas daigner répondre aux attaques d'un soi-disant
concurrent.
Quelle que soit l'issue de ces compétitions, elles jouaient un
rôle important une sorte d'ordre hiérarchique parmi une
génération donnée de poètes et influençaient le jugement de la
194 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al-Aġānī (XVIII, 100) d'après KILPATRICK Hilary, « Abū l-Faraǧ's Profiles of Poets A 4th/10th Century Essay at theHistory and Sociology of Arabic Literature », Arabica 1997, t. 44, p. 94-128, p. 112.
195 Ibid, (XX, 120).111
postérité sur chacun d'eux196.
Ainsi, sous le règne du calife al-Mutawakkil par exemple, on
observe que la cour est le lieu de joutes poétiques féroces,
d'autant plus que les récompenses sont somptueuses. Le calife
prend plaisir à exciter ses poètes-courtisans les uns contre
les autres. ‘Alī b. al-Ǧahm, en particulier, fut souvent
victime de ces assauts au cours desquels une certaine lenteur
de réaction le livrait à la verve féroce d'ennemis qui
finissent par le jeter dans la plus profonde disgrâce. En
fait, al-Mutawakkil aime organiser des joutes injurieuses
entre poètes, il les utilise pour se distraire et les réduit
souvent au rôle de bouffons de cour. Un des poètes qui tire le
plus de profit de ces affrontements est certainement Marwān b.
Abī al-Ǧanūb b. Abī Ḥafṣa197.
Peu de poètes échappèrent aux flèches de ce dernier mais ‘Alī
b. al-Ǧahm fut sa cible favorite. Il sait trouver pour lui les
injures les plus grossières, les moqueries les plus acérées.
Il ne recule devant aucun procédé pour ridiculiser son
adversaire dont la lenteur de réaction le sert à souhait. On
le voit ainsi s'adresser à lui comme à une femme, le traiter
de chien et de bâtard, suggérer qu'il est poète pour être né
des œuvres de son propre père, à lui Marwān, prendre à partie
sa généalogie. Lorsque ‘Alī b. al-Ǧahm, déjà emprisonné, écrit
une belle qaṣīda qui touche le souverain et l'incline à la
clémence, Marwān défend le cénacle dans une satire et obtient
le maintien du prisonnier dans sa geôle.
196 KILPATRICK Hilary, « Abū l-Faraǧ's Profiles of Poets A 4th/10th Century Essay at the History and Sociology of Arabic Literature », Arabica T.44, 1997, p. 112.
197 J. E. BENCHEIKH, « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil (m.247) contribution à l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires », op cit., p 38-39.
112
Cependant, tous les poètes du cénacle d'al-Mutawakkil n'ont
pas la lenteur et la pusillanimité de ‘Alī b. al-Ǧahm. ‘Alī b.
Yaḥya b. al-Munaǧǧim, injurié par Abī l-Ǧanūb, n'hésite pas un
instant : il le fustige, prenant à partie son honneur, sa
qualité de mawlā d'ennemis des Abbasides et du Prophète. Cette
réponse possède un grand nombre d'allitérations dues à
l'emploi de procédés stylistiques du badī‘. Il n'est donc pas
impossible, vu l'atmosphère de ce cénacle et les mœurs
agressives qui y régnaient, que les poètes se soient préparés
à ce genre de duel. Sachant qu'un jour ou l'autre ils
pouvaient être pris à partie, ils gardaient en réserve quelque
épigramme soigneusement affûtée et faisaient mine de
l'improviser sur le champ198.
4) La poésie d'agrément des secrétaires
Pour les secrétaires, la poésie n'est qu'un exercice de
lettrés, un aimable divertissement d'hommes cultivés. En
effet, ceux-ci ne sont pas et ne prétendent pas être des
créateurs. Comme nous l'avons déjà vu plus haut pour ce qui
concerne la poésie amoureuse, ils s'emparent d'un langage créé
par de « véritables poètes », c'est-à-dire les poètes que nous
avons qualifiés de « professionnels » et que nous avons
étudiés précédemment, ils en banalisent les thèmes et les
figures, ils multiplient l'emploi de ses clichés et de ses
poncifs199.
198 Ibid, p. 39-41.199 ID., « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au II e et III e
siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique , op. cit., p. 286.
113
Comme le déclare Ibn Rašīq (m.v. 456 h/1063-4), le célèbre
homme de lettres de l'Ifrīqiya (la Tunisie actuelle) dans son
œuvre, la ‘Umda200 :
« Le kātib ne s'attache pas à le disputer au poète pour la
maîtrise de l'art poétique. Ce qu'il recherche, c'est la
douceur des mots, leur légèreté, la rareté de l'artifice et
l'emploi, à cette fin, de tout ce qui peut en délivrer
l'esprit. D'autre part, la plus grande partie de sa production
relève exclusivement de l'exercice d'esprit, elle n'est due ni
au besoin ni à la crainte »201.
Avec une telle conception de la poésie, la production des kuttāb
est souvent assez différente de celle des poètes
professionnels dont ils s'inspirent comme le montre ce passage
du Kitāb al-Aġānī d'après Abū l-Faraǧ concernant la poésie
d'Ibrāhīm b. al-‘Abbās al-Ṣūlī (m. 243 h/857), le célèbre
secrétaire-poète et maître de prose ornée et de poésie de
style badīʿ, grand-oncle de Muḥammad b. Yaḥyā : « Il composait
puis soumettait son poème à un examen critique. Il éliminait
les vers les moins bons, puis ceux de qualité moyenne et enfin
ceux de facture courante. Il ne laissait ainsi d'une qaṣīda
que très peu de choses, parfois un ou deux vers seulement »202.
Cette volonté de concision s'applique chez lui à tous les
genres : panégyriques, thrène, satire, ġazal, billets. Elle est
notable à une époque où la tendance est au contraire de donner
aux compositions, surtout officielles, l'extension maximale.200 C. BOUYAHIA," Ibn Ras̲h̲īḳ" dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.201 Ibid, p. 267.202 ABŪ AL-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al-aghānī d'après J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au II e et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique , op. Cit., p 282.114
La raison première de ce fait est, nous l'avons vu, d'ordre
sociologique : le Secrétaire-poète n'est pas tenu de prononcer
de longues odes. Son goût va plutôt à d'élégantes mais brèves
réussites. Il cisèle avec soin une petite pièce, polit
l'expression d'un sentiment subtil, détache d'un thème un
motif, et brode autour de lui de savantes arabesques où le
maniérisme du langage exprime déjà par lui-même la recherche
de la pensée. La conséquence évidente de cette méthode de
production poétique est que son Dīwān regroupe de courtes
pièces n'excédant pas dix vers, ce qui ne l'empêche pas d'être
reconnu comme un homme de lettres de premier ordre qui
maîtrise tous les domaines de l'adab. Les célèbres poètes de
profession Abū Tammām et Di‘bil admettent même que si Ibrāhīm
avait fait de son métier la poésie, sa concurrence aurait été
des plus rudes203.
Autre particularité de la production poétique des secrétaires,
ceux-ci sont absolument libres de composer ce que bon leur
semble et ne sont donc pas astreints comme les poètes
professionnels à produire des panégyriques pour gagner leur
vie ou des satires pour se faire un nom. C'est cette liberté
qui fait dire au célèbre courtisan Kušāǧim : « Et si j'ai
composé des vers, je n'ai pratiqué ni la satire ni le
panégyrique, Car j'ai jugé que la poésie devait être
l'éloquente traduction de l'adab204»
En fait, tout membre de la cour ayant la maîtrise de l'adab
203 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au IIe et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique , op. Cit., p. 282.204 Ibid, p 268.115
sait tourner un poème et l'on attribue des essais aux
personnages les plus inattendus: pieux docteurs de la loi,
magistrats, érudits, etc...205. Même le calife n'hésite pas à
composer des vers, à l'image d'al-Manṣūr (règne de 95 h/ 754 à
158 h /775) qui déclare à propos de la mort d'Abū Muslim, le
principal artisan de la prise du pouvoir par les abbassides
assassiné sur ordre du calife car devenu trop puissant :
Tu prétendais que les dettes ne se réclament pas. Tiens, reçois le paiement de la
mienne à pleine mesure, ô Abū Mudjrim.
A la coupe que tu as souvent présentée aux autres, bois à ton tour [un breuvage] plus
amer au gosier que la coloquinte206.
C'est cette absence de contraintes d'ordre matériel qui
établit la distinction fondamentale entre les poètes-
secrétaires et les poètes professionnels, d'où cette
affirmation tirée également de la ‘Umda : « On ne doit pas
exiger des califes, des émirs, de tous les hommes de pouvoir
gâtés par la fortune, ce que l'on exige du grand poète dont la
poésie est le métier et le panégyrique la marchandise »207
Malgré le fait que le maǧlis soit un lieu privilégié d'échange
entre les différents types de praticiens de la poésie de la
cour, ceci n'exclue nullement l'existence de fractures parmi
ceux-ci comme nous allons le voir dans la partie suivante.
205 J. E. BENCHEIKH, « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil (m.247) contribution à l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires »,op cit., p.33.206 MAS‘ŪDI, Les Prairies d'or, op cit., Tome IV 1989, p 972, §2395.207 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au IIe et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique , op. cit., p. 267-268.116
II) Quelques clivages existant parmi les poètes
Parmi les poètes de la cour abbasside, des facteurs
politiques, doctrinaux et ethniques d'une grande complexité
agissent pour le regroupement des affinités et la constitution
de clans208.
On peut ainsi distinguer trois lignes de fractures majeures au
sein du groupe des poètes de la cour abbasside, la première
concerne le style, avec trois groupes différents de poètes
existant: les anciens, les modernes (muḥdathūn) et les
néoclassiques.
La deuxième ligne de fracture est religieuse ; en effet, on
distingue des poètes sunnites et chiites, au sein des sunnites
les mu'tazilites et les hanbalites et même les poètes
musulmans et ceux accusés de zandaqa, c'est-à-dire d'athéisme
ou de paganisme.
Enfin s'y ajoute un troisième clivage d'ordre ethnique avec la
rivalité entre Arabes du Nord et Arabes du Sud et la shu'ūbiyya,
la rivalité entre Arabes et Persans.
1) Concernant le style : Les anciens/les modernes
(muḥdaṯūn)/les néoclassiques
Une vue d'ensemble des œuvres en vers produites durant la
période étudiée dans le cadre de ce mémoire nous permet de
relever l'existence d'une opposition entre les artistes
frondeurs et volontiers irrévérencieux envers la tradition
208 ID., « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil (m. 247) contributionà l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires », op. cit., p 34.
117
poétique du Désert et une autre famille intellectuelle se
recrutant en majorité parmi les grammairiens et les
philologues nourris précisément de cette tradition. On doit
constater d'ailleurs que les tenants même du modernisme
poétique appelés muḥdaṯūn n'ont jamais pu aller jusqu'au bout
de leur théorie ; sous la pesée du conformisme et aussi du
fait qu'ils étaient contraints de satisfaire les goûts de
leurs mécènes, ils se plièrent en effet à certains impératifs
qui, bon gré mal gré, les placent dans le clan des
« classiques ». De ce compromis, se dégage peu à peu les
éléments d'une doctrine qui sera un néo-classicisme209.
Les muḥdaṯūn, en proposant de nouveaux critères d'évaluation du
poème et en rejetant l'imitation des anciens, contestent le
modèle classique de la qaṣīda archaïque en train de se
constituer210. Les chefs de file de ce mouvement sont les poètes
Abū Nuwās et Baššār ibn Burd. Ils se distinguent par leur
rejet du thème classique des ruines et des campements
abandonnés.
Les poètes que l'on nomme, les « anciens » sont d'abord ceux
de la ǧāhiliyya et tous ceux qui s'inspirent de la poésie de
cette période. Ils sont souvent d'origine bédouine, tel le
poète ‘Umāra b.‘Aqīl ou très attachés au classicisme comme Abū
l-‘Amayṯal (m. 240 h/854)211, très appréciés du calife al-Ma'mūn
dont les goûts sont clairement en faveur du traditionalisme
209 R. BLACHERE, « La poésie arabe au ‘Irāq et à Baġdād jusqu'à Ma‘rūf al-Ruṣāfī », Arabica T. 9, Volume spécial publié à l'occasion du mille deux centième anniversaire de la fondation de Baġdād, 1962, p. 424.
210 K. ZAKHARIA, « Chapitre XXII : Entre la taverne et la cour, les poètes del'amour, de la nuit et du vin », dans T. BIANQUIS, P. GUICHARD, M. TILLIER (sous la direction de), Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes,op. cit., p. 341.
211 " Abū l-ʿAmaythal ", dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
118
arabe212.
‘Umāra b.‘Aqīl, poète d'origine bédouine, formé dans la bādiya
de Baṣra, faṣīḥ, maître du langage pur est admiré par al-Ma'mūn
même s'il ne comprenait pas toujours ses œuvres tant il
accumulait de mots rares dans ses qaṣā'id bédouines. Il s'y plie
à la règle de l'articulation tripartite du panégyrique
introduit par l'élégie aux lieux désertés suivie du voyage à
travers le désert et se terminant par le panégyrique
proprement dit; il glorifie les vertus consacrées et se livre
à des invectives de type classique.
Cependant, le tripartisme de la qaṣīda n'établit plus vraiment à
cette époque l'influence de la bédouinité et, d'une manière
générale, celle d'un classicisme qui reste à définir. Les
poètes citadins et modernistes se plient eux aussi, pour la
plupart, à cette obligation (ex : Baššār b. Burd, Abū Nuwās),
en particulier lorsqu'ils composent des panégyriques pour le
Calife et les grands de la cour. En fin de compte, le
bédouinisme poétique doit se chercher essentiellement dans le
domaine lexical et celui des figures, images, comparaisons,
métaphores, etc...
En effet, à cette époque, la production bédouine est encore
déclarée insurpassable par les puristes, mais l'on ressent
également, comme Ibn Qutayba, « la répulsion du citadin
raffiné pour le mode de vie et d'expression des bédouins »213.
À la transition entre la période précédente et celle traitée
dans ce mémoire, se trouve une personnalité d'une rare
212 J. E. BENCHEIKH, « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil (m.247) contribution à l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires », op. cit., p. 36.
213 Ibid, p. 42-43119
vigueur :Baššār ibn Burd (m. 167 h/783-784). Né vers 95 h/714
d'une famille iranienne transférée à Baṣra, ce poète célébra
les derniers Omeyyades avant de chanter de hauts personnages
Abbassides ; il cultiva à la perfection à la fois les genres
traditionnels comme le panégyrique et l'élégie d'amour à la
manière des Hijaziens ; sa maîtrise de la langue arabe et son
aptitude à traiter de genres très différents dans leur
l'inspiration, sa verdeur satirique et sa sensibilité firent
de lui un des maîtres de l'art des vers à un moment où les
poètes recherchaient des voies nouvelles. En fait, son
influence fit déterminante et fit de lui un chef de file dont
l'originalité a été bouleversante214.
Pour H. Kennedy, ce sont ses innovations de style et d'images
qui ont conduit ultérieurement les critiques littéraires et
les orientalistes à voir en Baššār l'inspirateur du style
« moderne ». L'éclosion de ce nouveau style étant considérée
comme caractéristique de la cour abbasside par rapport à celle
de la ǧāhiliyya et de la période Omeyyade215.
Après Baššār, une génération montante s'engagea dans la voie
tracée par lui. On peut citer de célèbres poètes muḥdaṯūn comme
Muṭī‘ ibn Iyās (m. vers 170 h/787), al-Sayyid al-Himyarite (m.
171 h/787-8), al-‘Abbās ibn Aḥnaf (m. après 193 h/808-809) et
bien sûr les célèbres poètes Abū Nuwās (m. entre 197 et 200
h/813 et 816) et Abū al-‘Atāhiya (m. v. 213/828)216.
Face à cette querelle des anciens et des modernes, certains
poètes vont s'illustrer par leur volonté d'un retour aux
214 R. BLACHERE, « La poésie arabe au ‘Irāq et à Baġdād jusqu'à Ma‘rūf al-Ruṣāfī », op. cit.,p. 425.
215 H. KENNEDY, The Court of the Caliphs : The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty, Londres 2004, p. 120.
216 R. BLACHERE, « La poésie arabe au ‘Irāq et à Baġdād jusqu'à Ma‘rūf al-Ruṣāfī », op. Cit.,p. 425-426.
120
racines bédouines de la poésie arabe. Un des plus célèbres
représentants de cette mouvance est le poète Abū Tammām (m. v.
231-2 h/845) dont les innovations archaïsantes vont provoquer
d'âpres controverses entre admirateurs et réfractaires
auxquelles lui-même, creusant son propre sillon, est resté
parfaitement indifférent217. Ces poètes seront appelés
« néoclassiques » par les orientalistes218.
Pourtant, ce retour à la tradition n'est pas complet pour
autant. Ainsi, par exemple, l'ode la plus célèbre d'Abū
Tammām, celle sur la prise de la ville d'Ammorium
(al-‘Ammūriya) par le calife al-Mu‘taṣim en 838 aux Byzantins,
utilise le mètre basīt qu'affectionne le poète et par quoi il
tranche, en dépit de sa réputation de néoclassique, autant sur
les poètes bédouins que sur la plupart de ses émules
contemporains. On remarque cependant que si Abū Tammām a des
détracteurs, le Kitāb al-Aġāni contient une page « de grande
finesse critique » selon J. Berque et lui est donc très
favorable219. De même l'élève d'Abū Tammām, al-Buḥturi (m. 284
h/897) est également considéré par les orientalistes comme un
poète néoclassique220.
D'une veine très différente procède l'inspiration d'un autre
groupe de praticiens de la poésie qui comprends les
philologues mais aussi des poètes dont la production est
dominée par les thèmes laudatifs. Muslim ibn al-Walīd (m.
187 h/803) est l'un des premiers représentants de cette
tendance, appelée néo-classicisme. Son œuvre est constituée en217 H. KILPATRICK, « The Medieval Arab Poet and the Limits of Freedom »,
Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), op cit. p. 101.218 J. BERQUE, Musiques sur le fleuve Les plus belles pages du Kitāb al-Aghāni, op cit.,p. 26.219 Ibid220 C. PELLAT, « al-Buḥturi », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
121
majorité de pièces d'apparat écrites dans une langue très
savante. Pour la génération suivante Muslim demeurera le
modèle d'un nouveau style poétique où la recherche verbale et
l'emploi des figures de style sont la préoccupation
essentielle. Il en va de même pour Abū Tammām ; artiste
profondément imprégné de culture arabe car auteur d'une
anthologie fameuse : la Ḥamāsa, il fut un panégyriste itinérant
successivement au service de dignitaires égyptiens et syriens,
avant de s'attacher à des califes abbassides, notamment al-
Mu‘taṣim ; son œuvre est surtout constituée de qaṣā'id
tripartites dédiées à des protecteurs. Dans la même veine
s'inscrit le poète Di‘bil (m. 246 h/860) fameux notamment par
sa culture et son respect de certaines formes poétiques
archaïques. Autre grand poètes néoclassiques, Ibn al-Rūmī et
al-Buḥturī (m. 284 h/897), ce dernier, élève d'Abū Tammām, lui
ressemblait par sa culture arabe, car il est lui aussi auteur
d'une anthologie, et par l'usage qu'il fit de son talent ; en
effet il fut tour à tour panégyriste d'émirs syriens, puis de
hauts dignitaires de Bagdad et de Califes. À certains égards,
cette mouvance poétique s'achève avec un membre de la dynastie
abbasside, Ibn al-Mu‘tazz (m. 294 h/907), qui pourrait bien
avoir réussi une sorte de synthèse où la turbulence des
Modernes s'assagit, tandis que la recherche des néo-classiques
cède à la simplicité et à la spontanéité.
Dans l'histoire de la poésie arabe, la période illustrée par
les poètes dont on vient de parler a été sans nul doute celle
où toutes les virtualités ont été en présence. Reprenant les
cadres et les genres hérités de la tradition péninsulaire, les
poètes ont poussé aussi loin qu'il était possible de la faire122
cette tradition, en l'adaptant à un public qui n'était pas
celui du Désert ; le lyrisme qui les anime les conduits à
certaines mutations ; des genres triomphent pour un temps
comme l'élégie courtoise, la chanson bachique ou la poésie
ascétique.
Contre ces efforts pour un renouvellement profond, se dresse
le conservatisme littéraire des Anciens. Ceux-ci ont eu certes
le dernier mot sur les Modernes mais non sans eux-mêmes se
plier à certaines exigences. Ibn al-Rūmī en est la preuve
vivante, car ce représentant du néo-classicisme, et son
contemporain plus jeune Ibn al-Mu‘tazz, ont su vivifier
l'héritage poétique du passé en y incorporant ce que le
modernisme apportait d'essentiel221.
Après avoir vu le clivage purement littéraire concernant le
style, intéressons-nous à un autre clivage, celui concernant
les vues politico-religieuses de ces différents types de
praticiens de la poésie.
2) Clivages d'ordre politico-religieux : Les sunnites/ Les
chiites/ Les mu'tazilites/ Les hanbalites/ La Zandaqa
La révolution abbasside n'a pas seulement accentué les
différences idéologiques, elle a provoqué la mise en place
d'un gouvernement centralisé qui a cherché à éliminer les
opposants. Ainsi, les premiers abbassides, avec leurs
campagnes contre les partisans des Omeyyades, les
sympathisants des Alides et ceux qui furent décrits comme
zanadiqa évoque l'existence d'une censure impitoyable222.221 R. BLACHERE, « La poésie arabe au ‘Irāq et à Baġdād jusqu'à Ma‘rūf al-
Ruṣāfī », op. cit., p. 427-429.222 H. KILPATRICK, « The Medieval Arab Poet and the Limits of Freedom »,123
Cette censure, d'ordre idéologique, présentait la
caractéristique de s'appuyer sur des châtiments physiques
comme le passage à tabac, l'emprisonnement ou la mise à mort
comme moyen de contrôle. Cela était probablement inévitable
car dans une culture où la transmission orale continuait à
remplir un rôle fondamental la simple interdiction des textes,
en particulier de la poésie, n'aurait eu que peu d'effet223.
Les premiers califes abbassides peuvent être considérés comme
ayant amené la censure de la poésie à un point extrême et, par
la suite, les exemples de poètes ayant subi des
interrogatoires sur leurs compositions devient plus rares car
leur statut a changé. Ils sont en effet à cette époque de plus
en plus considérés comme de simples amuseurs.
Néanmoins, un poète qui dans son œuvre exprime de la sympathie
pour un groupe suspect continue de courir un risque
considérable. Comme le montre l'exemple du philologue expert
en poésie arabe Ibn al-Sikkīt (m. 244 h/858), piétiné à mort
par la garde turque pour avoir manifesté ses opinions chiites
pendant la persécution dirigée par le calife al-Mutawakil
contre les Alides et leurs partisans224.
Les poètes à la cour abbasside sont également divisés selon
leurs croyances. En effet, si certains poètes suivent
l'orthodoxie sunnite tels Abū Nuwās, ‘Alī b.al-Ǧahm ou Ibn al-
Mu‘tazz, ils sont nombreux à être d'obédience chiite et
certains n'hésitent pas à défendre la cause des Ahl al-Bayt (les
gens de la maison, c'est à dire pour les chiites les
descendants du prophète de l'islam par son gendre ‘Alī), dansBulletin (British Society for Middle Eastern Studies), Londres 1979, Volume 6, p. 99-100.
223 Ibid, p. 100.224 Ibid, p. 100.124
leurs poèmes. Un des poètes chiites les plus célèbres est
certainement le grand satiriste Di‘bil (m. 246 h/860), célèbre
pour sa marṯiya Madāris Ayat où il fait l'éloge de l'imam chiite
‘Alī al-Riḍā225.
Un exemple de poésie chiite typique d' Īsā b. ‘Abd Allāh b.
al-Qāsim b. Muḥammad b. Ǧa‘far est un thrène sur la mort des
imams chiites Ḥasan ( m.v. 49 h/669-70) et Ḥusayn (m. 61
h/680) dont voici quelques vers :
Je veux pleurer et gémir sur le sort d'al-Husayn et d'al-
Hasan ;
Sur le fils de ‘Âtika, qui fut inhumé sans linceul.
On les abandonna, le matin, dans la plaine de Fakhkh, loin de
leur foyer, loin de leur patrie226.
Le premier vers de cet extrait fait allusion au sort tragique
des deux fils de ‘Alī et Fāṭima, petit fils de Muḥammad, le
prophète de l'islam : Ḥasan, mort empoisonné selon les chiites
et Ḥusayn, qui trouva la mort lors de la bataille de Karbalāʾ
en combattant la troupe envoyée par le calife omeyyade Yazīd I
qui lui avait tendu une embuscade. De plus, l'évocation de la
plaine de Faḫḫ est une allusion au massacre d'une centaine de
‘Alides et de leur partisans qui s'étaient révoltés par les
forces loyales aux abbassides et qui eut lieu en 169 h/786
dans cette localité proche de la Mecque227.
On remarque que le chiisme de ces poètes a souvent une origine
familiale et que les familles de poètes assurent la
225 N. EL KHATIB, Etude historique de l'époque Abbaside à travers le Kitâb al-Aghânî, op. cit., p. 52.
226 MAS‘ŪDI, Les Prairies d'or, op. cit., tome IV, §2475.227 L. VECCIA VAGLIERI, " Fak̲h̲kh" dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
125
transmission d'un héritage, la persistance de tendances et la
continuité de certains courants. De génération en génération,
on fréquente les mêmes cénacles, on est introduit dans les
mêmes sphères de la société, on emprunte un même itinéraire
culturel. Il existe ainsi des cas fréquents de continuité
idéologique, surtout en ce qui concerne la doctrine chiite228.
Par exemple, les poètes issus du clan des Banū al-Munaǧǧim
sont des mu'tazilites et des alides convaincus229. De même ‘Alī
b. Muḥammad al-‘Abarta'i est chiite, tout comme son oncle Abū
‘Abd Allāh Aḥmad b. Ibrāhīm. ‘Alī est auteur de satires très
virulentes, brèves pour la plupart, et de thrènes à la mémoire
des Alides auxquelles il exprime son attachement230. Egalement
chiites sont les membres de l'illustre famille bagdadienne
d'origine iranienne des Banū Nawbakht. En effet, cette famille
fut très influente durant les deux premiers siècles de la
dynastie abbasside231. Ils furent les protecteurs d'Abū Nuwās à
la cour califale, ce qui n'empêcha pas ce dernier, sunnite, de
composer contre eux des épigrammes anti-chiites dont voici un
exemple ci-dessous :
1 Comment fréquenter des Shî‘ites
qui vous regardent de travers ?
2 Ils voudraient que je loue ‘Alî
et renonce à Abû-Bakr.
3 Mais je rejoins leurs adversaires
228 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au IIe et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique, op. cit., p. 308.229 Ibid, p 304.230 Ibid, p 298.231 L. MASSIGNON, " Nawbak̲h̲t" dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
126
et les accuse d'être impies,
4 et il faut que je remercie
ceux qui ont frappé leurs martyrs.232
Dans cette épigramme, Abū Nuwās fait preuve d'une grande
indépendance d'esprit car il n'hésite pas à attaquer ses
propres protecteurs, même s’ils ne sont pas explicitement
nommés. Ils sont qualifiés de chiites et, comme il est dit au
vers 2, souhaiteraient qu'Abū Nuwās embrasse leurs vues
religieuses en rejoignant le parti de ‘Alī (Šī‘at ‘Alī), le seul
des quatre premiers califes dits bien-guidés (Rāšidūn) qu'ils
reconnaissent, les trois autres : Abū Bakr (le seul mentionné
dans le vers 2), ‘Umar et Uṯmān étant considérés comme des
usurpateurs.
Enfin, à l'inverse, les Ibn Abī Ḥafsa sont par tradition
violemment anti-‘Alides et leur représentant le plus célèbre
Marwān b. Abī al-Ǧanūb b. Abī Ḥafṣa composa de cruelles
satires contre les chiites sous le califat d'al-Mutawakkil,
lui-même connu pour sa haine des ahl al-bayt. Ce sont d'ailleurs
ces satires qu'al-Mutawakkil affectionnaient tant qui
conduisirent Marwān à sa perte. En effet, à l'avènement du
nouveau calife al-Muntaṣir, plus favorable aux chiites, Marwān
se retrouve chassé de la cour à cause de son extrémisme et
reçoit l'ordre de retourner dans son Yamāma natal, en Arabie233.
Ces liens entre poètes qui trouvent leur fondement dans une232 ABÛ-NUWÂS, Le vin, le vent, la vie, trad. fr. V.-M. MONTEIL, Arles 1998 (La
petite bibliothèque de Sindbad), 190 p. (éd. Précédentes 1979, 1990), p. 141.
233 J. E. BENCHEIKH, « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil (m.247) contribution à l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires », op cit., p. 40.
127
croyance religieuse commune peuvent aussi concerner des poètes
n'ayant pas de liens familiaux entre eux, comme l'illustre
l'amitié entre Ibrāhīm b. al-‘Abbās al-Ṣūlī (176 h-243 h), Abū
Tammām et Di‘bil dont l'amitié se trouvait renforcée par leur
commune sympathie pour le parti ‘Alide234.
Si les poètes aux tendances chiites sont nombreux et
s'opposent aux sunnites, à l'intérieur même de ces derniers,
il existe un conflit entre deux écoles. En effet les partisans
de l'école mu‘tazilite, influencée par l'hellénisme et
souhaitant en conséquence faire une place à la raison dans le
dogme de l'islam, s'opposent aux Ḥanbalites, du nom du
fondateur de l'école Aḥmad b. Ḥanbal (m. 241 h/855) dont
l'interprétation des textes est beaucoup plus littérale. Si
les poètes de cour vivant de leur poésie se sont
majoritairement tenus à l'écart de ces querelles théologiques,
se contentant de faire allégeance au dogme tel qu'il a été
approuvé par le calife, c'est-à-dire une sorte de sunnisme
anti-mu‘tazilite en voie d'élaboration sous les premiers
abbassides (de 132 h/750 à 197 h/813), puis à partir du règne
d'al-Ma'mūn de l'instauration du mu‘tazilisme comme doctrine
officielle de l'Empire (de 197 h/813 à 234 h/848), puis à sa
révocation sous le règne du calife al-Mutawakkil à partir de
234 h/848. Quelques rares théologiens se sont illustrés par
leurs talents de poètes, notamment les mu‘tazilites Bišr al-
Mu‘tamir (m.v. 210-226/ 825-840) et Ṯumāma ibn Ašras (m.
213/828), ce dernier est resté célèbre car al-Ma'mūn voulut en
234 ID., « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au II e et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique,op. cit., p. 281.
128
faire son vizir, mais il déclina l'offre235.
Concernant Bišr al-Mu‘tamir, Hārūn al-Rašīd, qui était hostile
à la doctrine muʿtazilite, le fit jeter en prison. C’est alors
que celui-ci composa quelque quarante mille vers d’une
exceptionnelle éloquence sur «la justice» (al-ʿadl), «le
monothéisme» (al-tawḥīd) et «la menace» (al-waʿīd), trois principes
fondamentaux de l’école muʿtazilite. Ces vers traversèrent
bientôt l’enceinte de la prison; on se les répétait dans
toutes les réunions. al-Rašīd, ayant appris que les vers de
Bišr ainsi colportés avaient plus d’influence que
l’enseignement qu’il donnait avant d’être emprisonné, le fit
relâcher236.
Quant à Ṯumāma, fameux pour sa virulence, voire la grossièreté
de ses réparties face à ses adversaires doctrinaux, il acquit
la faveur de Hārūn lui-même ; et jouit ensuite d'un crédit
presque sans bornes auprès d'al-Ma'mūn. C'est en présence de
celui-ci, ainsi le veut l'une des multiples anecdotes le
concernant, qu'il aurait réduit au silence le poète Abū
al-‘Atāhiya qui critiquait les partisans du libre-arbitre,
c'est-à-dire les mu‘tazilites, et qui lui demandait par défi,
après avoir sorti une main de sa manche : « qui a déplacé
cette main ? ». Réponse de Ṭumāma : « Celui dont la mère a
forniqué ». Al-Ma'mūn de se tordre de rire sur son siège,
l'autre de se plaindre d'avoir été insulté, et Ṯumāma de
répliquer : « Ignorant, tu déplaces ta main et tu demandes qui
l'a fait ; si c'est toi, voilà l'opinion que je professe ; si
ce n'est pas toi, je ne t'ai pas insulté ». On saisit le ton
235 IBN AL-NADIM, The Fihrist of al-Nadīm, a tenth century survey of muslim culture, éd. et trad. B. DODGE, Londres New-York 1970, 2 vol.
236 A. N. NADER, " Bis̲h̲r b. al-Muʿtamir." dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
129
et la manière de ce genre de discussion237.
D'autres part certains poètes, souvent à cause d'un
comportement libertin ou excentrique, sont accusés d'être des
zindīq-s, c'est-à-dire accusés d'impiété.
Comme tous ceux qui ne se moulaient pas dans ces nouvelles
valeurs, ces libertins furent accusés de zandaqa. Le terme,
d'origine peut-être syriaque mais plus probablement perse,
aurait d'abord désigné – au sens strict – les adeptes du
manichéisme, particulièrement si, convertis à l'islam, ils
étaient soupçonnés d'être relaps. Peu à peu, la zandaqa acquit
une définition élastique, plus administrative que théologique.
Malgré ce flou, ou peut-être à cause de lui, l'accusation de
zandaqa permettait de sanctionner, dans leur diversité, tous
ceux qui, d'une manière ou d'une autre, paraissaient menacer
l'ordre ou le pouvoir califal et étaient donc zindīqs. Un
système inquisitorial, sous l'autorité du ‘ārif ou sāhib al-
zanādiqa, aboutit à l'emprisonnement, la torture et l'exécution
de nombreuses personnes, comme les poètes Baššār b. Burd et
Sāliḥ b. ‘Abd al-Quddūs (m. 167 h/783), coupables surtout
d'irrespect238. En effet Baššār s'était moqué ouvertement de
nombreux rites de la religion musulmane comme l'appel à la
prière et le pèlerinage. Quant à Sāliḥ b. ‘Abd al-Quddūs,
c’était un moraliste qui rendit publique ses idées sur la
religion par l’intermédiaire de dictons sapientiaux, la
237 R. BRUNSCHVIG, « Mu‘tazilisme et Aš‘arisme à Baġdād », Arabica T. 9, Volume spécial publié à l'occasion du mille deux centième anniversaire dela fondation de Baġdād, 1962, p. 345-356.
238 K. ZAKHARIA, « Chapitre XXII : Entre la taverne et la cour, les poètes del'amour, de la nuit et du vin », dans T. BIANQUIS, P. GUICHARD, M. TILLIER (sous la direction de), Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, Paris 2012 (Nouvelle Clio), p. 340.
130
considérant comme un enseignement moral et non comme un
système rationnel ou juridique. Ceci ayant été interprété
comme une incitation à l'athéisme, Goldziher suppose que c’est
la raison pour laquelle il fut compté parmi les zindīq-s et
exécuté239.
Ces accusations de zandaqa sont souvent de la calomnie pure et
simple. Comme dans le cas du poète Sa‘īd b. Ḥumayd dont
l'anti-chiisme était de notoriété publique au point d'obliger
son amante, la célèbre qayna Faḍl, à professer les mêmes
opinions que lui. En effet, celui-ci fut accusé d'hérésie par
un poète anonyme qui écrivit :
1 Nous ne connaissons pas à Sa‘īd b. Ḥumayd de pareil !
2 Pourquoi outrage-t-il l'Envoyé de Dieu en injuriant son
frère ?
3 C'est que le zindīq reste fidèle à la foi de son père.
Pour ce qui concerne le deuxième vers, le « frère » de
Muḥammad, l'Envoyé de Dieu, injurié par Sa‘īd b. Ḥumayd, n'est
autre que ‘Alī cousin et gendre du prophète de l'islam, figure
la plus révérée par les chiites mais qui jouit également d'un
très grand respect auprès des sunnites en raison de sa
proximité avec Muḥammad, d'où l'utilisation du qualificatif
« frère ». Ainsi, le poète anonyme feint de croire que Sa‘īd
cherche en fait à insulter Muḥammad, donc l'islam, à travers
‘Alī alors qu'il est bien plus probable que celui-ci n'injurie
la mémoire de ce dernier qu'en raison de son opposition aux
chiites (le parti de ‘Alī). Cette accusation d'hérésie de
239 M. ZAKERI, " Ṣāliḥ b. ʿAbd al-Ḳuddūs." dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
131
Sa‘īd par le poète se retrouve étayée par le vers suivant dans
lequel celui-ci est appelé zindīq, où il est fait allusion à
l'origine zoroastrienne de sa famille avant sa conversion à
l'islam, religion à laquelle il serait resté secrètement
fidèle240.
Autre calomnie, celle d'Abū Nuwās vis-à-vis de son rival, le
poète Abān b. ʿAbd al-Ḥamīd
al-Lāḥiqi (m.v. 200/815-16). Ce dernier étant le protégé des
Barmécides, il est fort probable que ce fait ait excité la
jalousie d'Abū Nuwās, lui qui ne s'estima jamais suffisamment
reconnu à la cour. Dans tous les cas, celui-ci écrivit une hiǧā'
(poème satirique) dans laquelle il accuse Abān,
vraisemblablement sans fondements, de manichéisme.
1 Je me trouvais un jour auprès d'Abân
(puisse le lait de ses troupeaux tarir !)
[…]
3 L'appel à la prière vint à retentir
4 et Abân se leva, comme un pieux Musulman,
5 pour donner, en priant, un exemple éloquent.
[…]
7 Il dit alors : « Vous portez témoignage
de Celui que vous n'avez jamais vu ?
8 En tout cas, moi, jamais je ne m'engage
sans être sûr que mes yeux ont bien vu. »
9 Je m'écriai : « Louange à Dieu mon maître ! »
240 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au IIe et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique », op. cit., p. 308-310.
132
Il répondit : « Que soit loué Mâni ! »
10 Je dis alors : « Jésus est un apôtre... »
Il répondit : « ...apôtre du Malin ! »
11 Je dis : « Moïse est l'interlocuteur
privilégié de Dieu le bienfaiteur. »
12 – « Ton dieu a donc des yeux et des oreilles ? »
13 fit-il : « Est-il son propre Créateur ?
Sinon, qui a créé cette merveille ? »
14 Je me levai et plantai là cet infidèle
qui ne croit pas en Dieu, Notre Seigneur.
[…]241
Il semble pourtant que dans certains milieux, surtout urbains,
une sorte d' « athéisme » se soit développé. Ces milieux, en
particulier ceux de Bagdad, exercèrent une forte influence sur
la cour abbasside. Ils sont appelés « dahriyya » et Ibn al-
Mu‘tazz nous précise que le poète bédouin ‘Umara b. ‘Aqīl
perdit la foi à force de les fréquenter et qu'il revint, une
fois fortune faite, parfaitement incroyant dans sa badiya
(steppe, habitat des bédouins)242.
À ces rivalités d'ordre stylistique ou politico-religieuse
s'ajoute enfin des rivalités d'ordre ethnique.
3) D'ordre ethnique : La rivalité Arabes du Sud/Arabes du Nord
et la šu‘ūbiyya
241 ABÛ-NUWÂS, Le vin, le vent, la vie, trad. fr. V.-M. MONTEIL, op. cit., p. 142-143.242 J. E. BENCHEIKH, « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil (m. 247)
contribution à l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires », op. cit., p. 44.
133
- La rivalité Arabes du Sud/Arabes du Nord
La rivalité d'ordre ethnique la plus ancienne dans l'empire
arabo-musulman est en fait entre Arabes mêmes. Il s'agit de la
rivalité entre les Arabes du Sud, c'est-à-dire les Arabes du
Yémen principalement et les Arabes du Nord, ceux du Najd et du
Hijaz. Cependant, suite à des migrations, certaines tribus, en
particulier d'Arabes du Sud, se sont retrouvés au nord de la
péninsule arabique et vice-versa.
Les Arabes du Nord et du Sud ont, en effet, des ancêtres
différents. Les Arabes du Nord se disent descendants de
‘Adnān243 et, pour la majorité, de Nizār244 alors que les Arabes
du Sud se réclament de Qaḥṭān245. Cette rivalité, d'origine pré-
islamique, perdure sous le califat des Omeyyades et est encore
suffisamment vivace au début du califat des abbassides pour
faire dire à Mas‘ūdi :
« Al-Saffāḥ aimait la causerie ; il se plaisait au récit des
compétitions de gloire entre les Arabes de Nizār et ceux du
Yémen. Les faits intéressants, concernant Khālid b. Ṣafwān et
d'autres Qahtānites, leurs joutes de jactance, leurs entretiens
dans les réunions du soir chez al-Saffāḥ [...] 246».
Ainsi, sous le règne d'al-Saffāḥ, des joutes poétiques ont
encore lieu prenant pour prétexte l'antique rivalité entre243 W. CASKEL, « ‘Adnān » dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.244 G. LEVI DELLA VIDA, « Nizār b. Ma‘add b. ‘Adnān » dans Encyclopédie de l'Islam,op. cit.245 A. FISCHER, A. K. IRVINE, « Ḳaḥṭān » dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.246 MAS'ŪDI, Les Prairies d'or, trad. fr. C. BARBIER DE MEYNARD et A. PAVET DE COURTEILLE revue et corrigée par C. PELLAT, Paris 1962-1997 t. IV 1989,(Société Asiatique collection d'ouvrages orientaux), p. 954, § 2350.134
Yéménites et Arabes du Nord. A cette rivalité d'ordre
ethnique, s'ajoute fréquemment une rivalité religieuse. Ainsi
le célèbre poète satiriste Di‘bil est chiite et partisan des
arabes du sud, il est donc ennemi lors des joutes poétiques
des partisans des arabes du nord tels Abū Tammām qui est, de
plus, sunnite247 et du poète al-Kumayt (m. 126 h/743) qui avait
attaqué les tribus yéménites et auquel il répondit de façon
mordante248.
Autre partisan des Arabes du Sud, Abū Nuwās, de son nom
complet Abū Nuwās al-Ḥasan b. Hāni' al-Ḥakamī, dont le père
était mawla d'un membre de la tribu sud-arabique des Banū Saʿd
b. ʿAšīra249. Ainsi, le poète se considérait comme yéménite et
n'hésitait pas à glorifier ces derniers et à dénigrer les
Nordiques, comme l'illustrent les vers suivants :
1 Qu'ai-je à faire d'une maison
que battent les vents et la pluie,
2 des campements à l'abandon,
des hyènes et de leurs petits ?
3 Je ne mesure pas mes pleurs
à la distance, au voyageur.
4 Nous sommes, nous, des Yéménites
et, de leurs hauts lieux, les seigneurs.250
[…]
Dans les 3 premiers vers de cette célèbre satire contre les
Arabes du Nord, Abū Nuwās fait allusion aux conditions de vie
247 L. ZOLONDEK, « Di‘bil », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.248 J. BERQUE, Musiques sur le fleuve Les plus belles pages du Kitâb al-Aghâni, op. cit.249 E. WAGNER, " Abū Nuwās", dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.250 ABÛ-NUWÂS, Le vin, le vent, la vie, trad. fr. V.-M. MONTEIL, op. cit., p. 144.135
frustres de ces derniers, considérés comme des bédouins vivant
sous la tente (vers 1) et cultivant une poésie du plus grand
classicisme consistant en qaṣīda-s tripartites commençant par un
prélude élégiaque (nasīb), où le poète se lamente sur les
traces du camp abandonné par les membres du clan de sa bien-
aimée, dont le poète se moque au vers 2, suivi du voyage dans
le désert (raḥīl) pour oublier celle-ci, avec lequel Abū Nuwās
prend résolument ses distances et ridiculise également au vers
3.
Autre célèbre charge anti-Arabes du Nord d'Abū Nuwās (m. v.
200 h/815), celle contre les Muḍarites (de Muḍar, l'ancêtre
dont se réclament la majorité des tribus nord-arabiques) et
les Bédouins qui ne font qu'un pour Abū Nuwās. Le poète prend
toujours le soin de bien le spécifier. Son insistance viserait
à chasser le moindre doute chez le lecteur. Dans une de ses
ouvertures anti-vestiges les plus célèbres, il le répète de la
façon la plus claire :
Vous avez mentionné les zones de mouvance de Asad, ont-ils
dit ! Puissiez-vous être poursuivis par l'insuccès, qui sont
les Banū Asad ?
Qui sont Tamīm et Qays et leurs contribules ? Les Bédouins ne sont pour Dieu
que quantité négligeable !
On le voit bien, pour lui, « Bédouins » équivaut à Asad, Tamīm, Qays et
leurs contribules, c'est à dire la confédération nordique.
Les Muḍarites, ces Bédouins, sont méprisables à cause de leur
façon de boire et de leur boisson : ils boivent du lait et
délaissent le vin.
136
Les goûts grossiers des bédouins sont également exprimés par
un autre symbole dans les ḫamriyyāt : l'opposition entre le goût
de ces Muḍarites pour la flore désertique et celui du poète et
des gens civilisés pour les plantes aromatiques du ‘Irāq251.
Toujours dans sa satire contre les Arabes du Nord, Abū Nuwās
va encore plus loin et n'hésite pas à vilipender, l'une après
l'autre, les tribus nord-arabiques, à commencer par la plus
noble et célèbre d'entre elle : les Qurayshites, tribu du
prophète de l'islam et de ses successeurs, les califes. En
effet, ceux-ci ne sont considérés par lui que comme de
vulgaires marchands. Ce rappel méprisant du statut de
marchands mecquois des Quraysh à l'époque de Muḥammad a
d'ailleurs provoqué l'ire du calife Harūn al-Rašīd qui jeta
Abū Nuwās en prison pour cette raison.
[…]31 Le seul titre de gloire des Quraishites, ce serait le négoce et ses beaux bénéfices...32 Si l'on mentionne leurs hauts faits, tout doux ! Qu' alors de commerce il s'agisse !252
[...]
Plus loin dans le poème les tribus bédouines de la
confédération nordique, celles-là même qui se réclament de
Nizār, sont insultés, souvent de façon grossière par le poète
qui se fait le champion du Yémen :
[...]
251 A. ARAZI, « Abū Nuwās fut-il šu‘ūbite ? », Arabica, t. 26, 1979, p. 21.252 ABÛ-NUWÂS, Le vin, le vent, la vie, trad. fr. V.-M. MONTEIL, op. cit., p. 145.137
33 Brocarde donc les nordiques Nizâr et mets en pièces cette race et le voile de leur disgrâce ![…]36 S'ils tiennent à tout prix à crier leurs exploits, que les Tamîm célèbrent Hajîb et son arc !37 Quelle misère d'être fier d'un bout de bois tout jauni, qui pendouille à leur ceinture ![…]40 Que dire des Banî-Asad, mangeurs de chiens, esclaves de chameaux secs comme un coup de trique ?41 Le clan des Bakr bin Wâ'il n'a pas d'autre titre que sa sotte Dugha et son prophète feint.42 Les Taghlib pleurent sur les traces et les ruines, mais ils n'ont même pas pu venger un seul mort.[…]47 Et l'avarice, chez Qâsit et ses frères, est telle qu'ils vont jusqu'à retenir...leurs pets !253
En effet, le héros de l'importante tribu des Tamīm n'est autre
que Ḥāǧib b. Zurāra (m.v. 620), célèbre pour son arc qu'il
aurait donné en gage au roi de Perse254 et dont la figure se
trouve ridiculisée par Abū Nuwās qui le qualifie, au vers 37,
de « bout de bois tout jauni, qui pendouille à leur
ceinture ». Pour ce qui concerne les Banū Asad, grande tribu
nomade d'Arabie du Nord, ils ne sont pour le poète que des
« mangeurs de chiens », aux « chameaux secs comme un coup de
trique » (vers 40), ce qui est sans doute une allusion à la
famine qui a atteint cette tribu lors de sa lutte contre
Muḥammad (vers l'an 9 h/630)255. Quant à la confédération253 Ibid, p. 145-146.254 M. J. KISTER"Ḥād̲j̲ib b. Zurāra" dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.255 H. KINDERMANN, " Âsad " dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
138
tribale des Bakr b. Wā'il, Abū Nuwās les réduit à la figure à
demi-mythique de Dugha al-‘Iljiyya, une femme d'une bêtise
proverbiale256 et au « faux prophète » Musaylima (m. 10 h/632)
mort lors d'une bataille de la ridda (« apostasie », série de
bataille opposant les musulmans aux tribus arabes ayant
apostasié l'islam à la mort de Muḥammad) qui l'opposa à Abū
Bakr257. Les Taghlib sont considérés comme des couards,
incapables de protéger l'honneur (‘irḍ) de la tribu, et enfin
les Qāsiṭ sont accusés en termes grossiers d'être avares, la
pire insulte pour un arabe, dont la qualité première est
d'être généreux258.
Plus tard dans l'Histoire du califat abbasside, alors que
l'arabisation de nombreuses régions de l'Empire et, en
particulier de l'Irak, est bien entamée, le poète Muḫallad ibn
Bakkār ose faire la satire du grand-cadi sous le règne d'al-
Mu‘taṣim : Aḥmad b. Abī Du'ād (m. 239 h/854), dont l'origine
Arabe s'avère plus que douteuse, dans les vers suivants :
With me thou art of Iyād, this is not mere talk.
An Arab art thou, an Arab in truth, not by coercion.
The hair of your legs and thigs is khuzāmā and thumām,
Your chest bones show with moles.
If you make a motion, there will not flee from you even an
ostrich,
Or prolific gazelles with large loins.
What fault of mine is it if people lie about thee ?
For verily they say that he is a Ḥām of the Banū Anbāṭ.256 ABÛ-NUWÂS, Le vin, le vent, la vie, trad. fr. V.-M. MONTEIL, op. cit., p. 187.257 W. M. WATT, " Musaylima " dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.258 ABÛ-NUWÂS, Le vin, le vent, la vie, trad. fr. V.-M. MONTEIL, op. cit., p. 188.139
Verily a true Arab art thou in lineage ; So farewell259.
En effet, on raconte que même si le grand-cadi déclare
appartenir à la tribu nord-arabique des Iyād, ce qui est
rappelé au premier vers, celui-ci aurait en fait été adopté
par ceux-ci et serait en fait d'origine nabatéenne d'Irak (« a
Ḥam of the Banū Anbāṭ »). Tout le long du poème, et en cela réside
l'effet comique, le poète feint visiblement de croire que les
déclarations de ses ennemis ne sont que calomnie (« What fault of
mine is it if people lie about thee ? ») et n'hésite pas à faire des
éloges tirés des topoi de la poésie bédouine sur les chasseurs
du désert que l'on imagine fort peu convenir à un grand-cadi.
Assurément, la description des mouvements d'Aḥmad comme
suffisamment furtifs pour lui permettre de ne pas faire fuir
l'autruche et la gazelle (« If you make a motion, there will not flee from
you even an ostrich,/ Or prolific gazelles with large loins. ») est d'un effet
tout à fait comique lorsque l'on pense au bureaucrate citadin
qu’il devait sans doute être.
Cependant, ces rivalités d'ordre ethnique ne sont pas
l'apanage des Arabes mêmes mais concernent également les
relations que les Arabes entretiennent avec les autres peuples
de l'Empire islamique, d'où la naissance et le développement
de la controverse de la šu‘ūbiyya.
- La šu‘ūbiyya
Il s'agit à l'origine d'un mouvement de contestation de la
primauté des Arabes au sein de l'empire arabo-musulman. Elle
259 IBN AL-NADIM, The Fihrist of al-Nadīm, a tenth century survey of muslim culture, éd. et trad. B. DODGE, Londres New-York 1970, 2 vol., p. 410.
140
s'inspire d'un passage du Coran où il est dit :
Hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et
Nous vous avons constitués en peuples (šu‘ūb) et en tribus
(qabāʾil) pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d’entre
vous aux yeux de Dieu est [néanmoins] le plus pieux260.
La Šu‘ūbiyya, terme dérivé du mot šu‘ūb, est à l’origine le
principe d’instauration de l’égalité entre šuʿūb et qabāʾil afin
qu’il englobe l’ensemble des Musulmans. Le mouvement šuʿūbite,
qui apparaît au IIe/VIIIe siècle et atteint son apogée au
IIIe/IXe, avait d’autres buts, plus divers. Ils allaient d’un
appel à l’égalité entre non-Arabes (ʿAǧam) et Arabes, dont les
avocats portaient aussi le nom d’ahl al-taswiya (les gens de
l'égalité), à l’exigence d’une suprématie des non-Arabes
déniant toute importance particulière aux Arabes dans le passé
comme dans le présent. Dans les faits, la plupart des
šu‘ūbites étaient Persans même si les sources font également
état d’Araméens, de Coptes et de Berbères261.
Cependant, c'est parmi les secrétaires où les Persans sont
très nombreux, voire majoritaires dans la deuxième partie de
la période que couvre le sujet de ce mémoire, que la šu'ūbiyya
atteint le maximum de sa virulence. En effet, si certains
šu‘ūbites restent modérés comme le secrétaire-poète Saʿīd b.
Ḥumayd (m. v. 257-260 h/871-874) dont la famille provenait de
la petite noblesse persane ; il était parfois appelé lui-même
al-Dihqān et revendiquait une ascendance royale. Son ouvrage,
260 Coran, sourate XLIX, verset 13.261 S. ENDERWITZ, « al-Shu'ūbiyya », dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
141
aujourd'hui perdu, le K. Intiṣāf al-ʿaǧam min al-ʿarab, «revendication de
la justice pour les Persans de la part des Arabes» est
également connu aussi sous le titre al-Taswiya «l’égalité». Le
choix des mots révèle ici un modéré, qui ne postule pas la
supériorité des Persans262.
Parmi les poètes de la cour, nombre d'entre eux sont d'origine
persane et s'illustrent en tant que šu‘ūbi, tel Baššār b. Burd
dont la sympathie pour la šu‘ūbiyya est manifeste dans certains
vers qui lui sont attribués : « Obscure est la terre, lumineux
est le feu ; le feu que l'on vénère depuis lors qu'il est
feu », aurait-il récité pour glorifier les rites religieux de
la Perse pré-islamique263.
Le penchant šu‘ūbi de Baššār transparaît également dans les
panégyriques destinés aux māwālī, c'est à dire des clients
non-arabes des tribus arabes, de la cour abbasside, par
exemple, il loue Ḫālid b. Barmak – un membre de la famille des
Barmécides – pour la simple raison qu'il n'est pas de souche
arabe264.
De plus, d'après l'Aġānī, le même poète :
Quand la Shu'ūbiyya atteignit l'apogée de sa gloire, [...] devenait si acerbe dans sa
critique qu'il n'épargnait pas le calife lui-même. Baššār attaquant al-Mahdi le critiqua
de traîner entre la coupe et le luth lui, qui était le calife de Dieu. Ce poème fut la
cause de son assassinat par al-Mahdī, alors que Ya‘qūb b. Dāwūd était son vizir265.
262 W. P. HEINRICHS, " Saʿīd b. Ḥumayd." dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.263 H. TOELLE, K. ZAKHARIA, A la découverte de la littérature arabe, Paris, Flammarion,
2003, p. 67.264 N. EL KHATIB, Etude historique de l'époque Abbaside à travers le Kitâb al-Aghânî, op. cit.,
p. 41.265 Ibid, p. 41.142
Par contre concernant le poète Abū Nuwās, de père arabe et de
mère persane, si certains de ses vers peuvent être considérés
comme pro-persans, celui-ci reste plus provocateur que šu'ūbi
comme on a pu l'affirmer un temps266car on constate que
l'inclination yéménite chez le poète l'emporte sur les
sympathies pro-sassanides. En effet, son admiration pour les
Persans n'a jamais atteint l'adhésion sans équivoque au ḥayy al-
yamānī (le clan des yéménites). D'ailleurs, si les Persans sont
appelés banū al-aḥrār (les descendants des seigneurs), les sud-
arabiques eurent droit au titre de banū al-mulūk (les descendants
des rois)267.
Une preuve de cette adhésion aux descendants de Qaḥṭān plus
forte même que son soutien à la cause des Persans peut être
trouvée dans sa célèbre satire contre les Arabes du nord, où
le célèbre poète n'hésite pas à déclarer :
[…] 6 Les bienfaits de nos rois antiques ont frappé les peuples poltrons. 7 Contre la Perse et ses satrapes, c'est Bahrâm qui fut notre élu.268
[…]
Le « nous » de ces vers signifie « Yéménites », groupe auquel
s'identifie totalement Abū Nuwās, alors que les Perses sont
des étrangers contre lesquels il faut se battre pour installer266 K. ZAKHARIA, « Chapitre XXIII : La poésie solennelle », dans
T. BIANQUIS, P. GUICHARD, M. TILLIER (sous la direction de), Les débuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, Paris 2012 (Nouvelle Clio), p. 341.
267 A. ARAZI, « Abū Nuwās fut-il šu‘ūbite ? », Arabica, t. 26, 1979, p. 20.268 ABÛ-NUWÂS, Le vin, le vent, la vie, trad. fr. V.-M. MONTEIL, op. cit. ., p 144.143
sur le trône Bahrām Gūr (l' « onagre »), l'héritier légitime
du trône de Perse élevé parmi les Arabes laḫmides de Ḥīra269, un
royaume arabe pré-islamique vassal des Sassanides dont la
capitale Ḥīra se trouve en Mésopotamie, sur l'Euphrate au sud
de Kūfa270 et dont la tribu dominante, les Banū Laḫm, est
d'origine qaḥṭānite.
Cependant, tous les šu'ūbites n'ont pas la modération de
Sa‘īd b. Ḥumayd et certains poètes comme Ismā'il b. Yassar
étalent la fierté des « ‘Aǧam » ; mot arabe signifiant à
l'origine étranger, celui qui ne parle pas l'arabe, analogue
dans son sens au mot grec barbaroi et a fini par désigner quasi-
exclusivement les Iraniens271 ; ces poètes n'hésitant pas à
déclarer leur supériorité sur les Arabes272.
Ainsi, l'un des poèmes les plus célèbres qui clame que les
Persans sont supérieurs aux Arabes est l'œuvre du célèbre
poète Baššār ibn Burd, shu'ubite notoire, dont voici quelques
extraits :
1 Is there a messenger, who will carry my message to all the
Arabs,
[…]
3 To say that I am a man of lineage, lofty above any other of
lineage :
4 the grandfather in whom I glory was Chosroes, and Sāsān was
my father,
269 C. HUART, H. MASSE," Bahrām " dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.270 A. F. L. BEESTON, I. SHAHID, " al-Ḥīra " dans Encyclopédie de l'Islam,
op. cit.271 F. GABRIELI," ʿAd̲j̲am " dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.272 N. EL KHATIB, Etude historique de l'époque Abbaside à travers le Kitâb al-Aghânî,Op Cit., p
42.144
[…]273
Ainsi, Baššār exalte ses origines persanes et se vante d'une
fausse ascendance royale qui le ferait remonter à Chosroès, le
célèbre empereur sassanide et même au fondateur éponyme de la
dynastie, Susan. Un peu plus loin, le poète se livre à une
violente diatribe contre les mœurs des arabes bédouins qu'il
considère comme barbares, comme le montre ce passage :
[…]
He (a forebear I have) was not given to drink the thin milk
of a goatskin, or to sup it in leather vessels,
12 never did my father sing a camel song, trailing along behind
a scabby camel,
nor approach the colocynth, to pierce it for very hunger ;
14 nor approach the mimosa, to beat down its fruit with a
stave ;
nor did we roast a skink, with it quivering tail ;
16 nor did I dig for and eat the lizard of the stony ground ;
nor did my father warm himself standing astraddle to the
flame ;
18 no, nor did my father use to ride the twin supports of a
camel saddle.
We are kings, who have always been so through long ages
past ;
[…]274
Tout le long de cet extrait, Baššār énumère les coutumes des
arabes bédouins de la péninsule arabique qu’ils trouvent
273 BASHSHÂR IBN BURD, Selections from the poetry of Baššār, trad. A. BEESTON Cambridge1977, p. 50.
274 Ibid, XXVI, p.50.145
répugnantes. Il s'agit tout d'abord de la consommation de lait
de chèvre mêlée à de l'eau et du lait fermenté en cas de
famine (vers 11), des traditions liées à l'élevage des
chameaux, en fait des dromadaires (vers 12 et vers 18), de la
consommation des fruits de la coloquinte (vers 13),
extrêmement amers, et du mimosa (vers 14). De la chasse et la
consommation de gerboises (vers 15) et de lézards (vers 16) et
même de la façon de se tenir, pour lui obscène, pour se
réchauffer à la flamme du feu de camp (vers 17).
Et le poète de conclure que lui est un roi descendant de toute
une dynastie perse (vers 19).
Malgré tout le dégoût que lui inspirent les coutumes
bédouines, on constate que Baššār les connaît parfaitement
puisqu'il a été capable de les énumérer sur de nombreux vers.
Ainsi, celui-ci est visiblement imprégné de culture arabe, non
seulement d'un point de vue strictement linguistique, mais
aussi d'un point de vue culturel au sens large.
D'ailleurs, une autre preuve de ce lien profond qui unit
Baššār à la culture arabe réside dans son attachement,
contraint ou non, à l'islam. En effet, un peu plus loin dans
le poème, il déclare :
[…]26 So that we restored the sovereignty into the family of the
Arabian Prophet.
Who is there that has fought against guidance and religion
without being stripped ?
28 Who, o who, has rebelled against it without being
plundered ?
For the sake of God and of Islam we are wrathful with a
146
most noble wrath :
30 We are the possessors of crowns and of disdainful stiff-
necked kingship.275
Ainsi, le poète considère les Iraniens comme les défenseurs du
véritable islam car ils ont appuyé la révolution abbasside,
les descendants de ‘Abbās étant considérés par lui comme la
véritable famille de Muḥammad le prophète de l'islam face aux
usurpateurs omeyyades dont les soutiens se trouvaient surtout
parmi les Arabes de Syrie (vers 26).
Les Arabes sont ainsi accusés d'avoir trahi leur prophète
(« the Arabian prophet » au vers 26) et l'islam (vers 28), ce qui
déclencha le courroux légitime et noble (« most noble wrath » au
vers 29) des Iraniens, considérés comme les détenteurs
naturels du pouvoir (vers 30).
On peut relier la šu'ūbiyya avec l'ascension culturelle brillante
de l'ethnie persane dans l'empire abbasside avec de grandes
familles de lettrés comme les Barmécides, ou les Munaǧǧim. Ces
derniers ayant eu aux IIIème et IVème siècles une activité
littéraire, artistique, ou scientifique de premier ordre276. On
pense aussi à des personnages aussi puissants que le vizir Ibn
al-Zayyāt dont l'activité poétique affirme la prépondérance
d'une génération de Secrétaires d'origine persane qui tout à
la fois occupent les plus hauts postes administratifs et
cultivent les muses277.275 Ibid, XXVI, p.51.276 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au
II e et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique », Op cit., p 303.
277 ID., « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil (m.247) contribution à l'analyse des instances de légitimation socio-littéraires », op cit., p 37-38.
147
Cette ascension des Persans n'a pas été sans soulever bien des
irritations. Abū al-Asad, poète tamīmite de pure « souche »
arabe, traduit, semble-t-il, un sentiment répandu, dans une
pièce de 21 vers toute entière consacrée à ‘Alī b. Yaḥyā ibn
al-Munaǧǧim (201h.-275h.) :
1 Bienfait de Dieu ! Je vous connaissais, avant l'opulence,
vêtus de caleçons courts.
2 A peine une année s'écoule et je vous voie marchant dans la
soie, les robes du Ḫuzistān, et l'aisance.
[…]
Pour souligner que leur richesse est bien récente, il décrit
la condition misérable de leur prétention à une haute
naissance :
[...]
6 Une fois riches, ils disent – mais ils mentent –
nous sommes nobles fils de Dihqān.
[...]
Les Dihqān étant les membres de la petite noblesse féodale de la
Perse Sassanide278, puis il se livre à une attaque véhémente des
Chosroës, du nom du plus célèbre des empereurs sassanide, et
des Nabatéens, mot désignant vraisemblablement les
Mésopotamiens279, qualifiés d'« enfants de Satan » (v.10).
[...]
278 A. K. S. LAMBTON, " Dihḳān " dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.279 " Nabaṭ " dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
148
14 Ils ont quitté les stalles de légumes
pour la demeure des rois et le seuil des souverains.
15 Leurs chaudrons bouillonnent de colère contre les Arabes
et d'hostilité contre l'Envoyé de Dieu et la religion.
[...]
Il dépeint le danger qu'ils représentent pour le calife
hachimide dont il fait l'éloge, et termine par une invocation
des Qaḥṭān et de leur mépris pour les Nabatéens à la
prononciation défectueuse280.
Cette attaque n'est pas la seule qu'eut à subir ‘Alī b. Yaḥyā.
A l'incitation d'al-Mutawakkil, qui aimait ce genre de joutes,
Marwān b. Abī al-Ǧanūb lui adresse une satire des plus
injurieuses (mentionnée par Yāqūt). Il l'y traite de Nabatéen,
de maquis (Perse zoroastrien), de misérable au discours grossier
et de raidi (hérétique).
Il existe d'autres réactions qui nous montrent que la gloire
des secrétaires et hommes de lettres d'origine persane était
durement ressentie par l'élément arabe ; mais elles furent
vaines, et l'emprise des kuttāb iraniens ne cessa de s'étendre
sur l'organisation et l'activité du milieu littéraire de la
cour281.
Cependant, il faut se garder d'exagérer l'importance de la
šu‘ūbiyya et de trop accentuer les différences entre Arabes et
non-Arabes car certains auteurs y sont complètement
280 J. E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au IIe et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique », op cit., p 304.281 Ibid, p 304.149
indifférent. Ainsi pour Abū l-Faraǧ al-Iṣfahānī, lui-même né à
Ispahan, en Perse, mais de pure « race » arabe et issu de
Quraych282, l'origine et les ancêtres des poètes et musiciens
cités n'a rien à voir avec des sentiments pro- ou anti-Arabe ;
Cela nous montre bien que dans le domaine de la poésie et de
la musique, la culture Arabo-islamique telle qu'Abū l-Faraǧ la
connaissait était ouverte aux personnes de tous horizons qui
pouvaient ainsi y contribuer, du moment qu'ils avaient une
maîtrise suffisante de la langue arabe ainsi que les talents
artistiques nécessaires283.
282 M. NALLINO " Abū l-Faradj̲ ʿAlī b. al-Husayn b. Muḥammad b. Aḥmad al-Ḳuras̲h̲ī al-Iṣbahānī." dans Encyclopédie de l'Islam, op. cit.
283 H. KILPATRICK, « Abū l-Faraǧ's Profiles of Poets A 4th/10th Century Essay at the History and Sociology of Arabic Literature », Arabica 1997, t. 44, p. 94-128., p. 99.
150
Conclusion
Après avoir établi une typologie des praticiens de la poésie à
la cour abbasside dans laquelle nous avons distingué les
poètes professionnels, les secrétaires-poètes, les qiyān ainsi
que les rāwī et philologues, nous avons étudié plusieurs
modalités d'interactions existantes entre ces différents types
de praticiens en mettant l'accent sur ce qui les réunit ou, au
contraire, ce qui les sépare.
Si les catégories que nous avons distinguées se sont avérées
essentielles pour les besoins de l'analyse, notre travail a
montré qu'elles étaient loin d'être étanches. C'est tout
d'abord le cas pour les groupes que forment les poètes-
secrétaires et les poètes professionnels. En effet, il est
tout à fait possible, par exemple, pour un poète, de se voir
attribuer un poste administratif à la cour. Nous en avons
rencontré des cas. L'inverse est cependant plus rare. Il y a
donc une circulation des individus entre ces différentes
catégories, ceux-ci ayant en conséquence une grande variété de
pratiques de la poésie. On observe en fait que toute la cour
abbasside est littéralement « imprégnée » de poésie, ses
membres sont ainsi tous susceptibles d'en produire. Cependant,
certains genres comme le panégyrique restent généralement le
« pré carré » des poètes « professionnels ».
On s'accorde en général pour parler d'une sorte d' « âge
d'or » de la poésie arabe sous les premiers califes
abbassides : d'al-Saffaḥ à al-Mutawakkil. On relève par la
151
suite ce que l'on peut être tenté de décrire comme un déclin
relatif de la production poétique. Ce phénomène est-il lié à
la montée en puissance de groupes comme les Turcs qui parlent
peu, voire pas du tout l'arabe ? C'est la thèse qu'avance
Hilary Kilpatrick dans un article intitulé « The Medieval Arab
Poet and the Limits of Freedom ». Elle y souligne que le poète
de cour s'exprimant en arabe voit son public décliner dans la
mesure où celui-ci n'est pas constitué d'arabophones. La
poésie est sans doute particulièrement difficile pour des
personnes n'ayant qu'une connaissance limitée de cette langue.
La poésie souffrit donc d'une diminution de son prestige et,
parallèlement, d'un formalisme de plus en plus grand pour ce
qui concerne ses thèmes et ses images284.
Au terme de ce mémoire, un vaste chantier s'ouvre devant moi.
S'interroger sur la poésie arabe à l'époque abbasside requiert
de se placer à la croisée de diverses disciplines. En effet,
s'il est nécessaire d'adopter une perspective historique, la
nature des sources exige de se pencher sur des travaux de
littérature poétique de langue arabe d'époque abbasside. De
fait, cette étude de la poésie s'avère une véritable mine pour
comprendre l'histoire des faits, mais surtout des mentalités
de cette période, étant donné que la poésie était le mode
d'expression artistique privilégié dans la culture islamique.
L'apport de la poésie à l'histoire de la cour abbasside
apparaît de plus comme un champ de recherche encore largement
ouvert. La majorité des travaux sur le sujet sont récents et
tentent d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche à ce
284 H. KILPATRICK, « The Medieval Arab Poet and the Limits of Freedom », Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies,op. cit. p. 102.
152
domaine relativement difficile d'accès puisqu'il exige de
l'historien une bonne connaissance de la langue arabe. En
effet, la langue poétique est souvent obscure et archaïsante,
en particulier pour ce qui concerne les poèmes panégyriques.
Pourtant, c'est la connaissance de cette langue et de cette
poésie qui est la véritable porte d'entrée pour comprendre
l'imaginaire et les mentalités de cette période.
153
ANNEXES
- Tableaux issus de ma base de données des poètes de la cour
abbasside (132 h/750 – 334 h/945).
Abbréviations Tableau 1:
EI : Encyclopédie de l’Islam
CHAL : The Cambridge History of Arabic Literature
Enc. Iranica : Encyclopedia Iranica
MPO : MAS‘UDĪ, Les prairies d’or
F : Fihrist
Aġ : Kitāb al-Aġānī
Tab: TABARĪ
KB: Kitāb al-Bayān
154
Tableau 1
nom usuel date de naissance
date de naissance calendrier grégorien
lieu de naissance
date de décès
date de décès calendrier grégorien
lieu de décès
sources
Abān al-Lāḥiqī Fasā (Fārs, Iran)
200 816 EI,CHAL
Abū al-ʿAtāhiya
130 748 Kūfa (ou ʿAyn al-Tamr)
211 826 Bagdad? EI
Abū al-Qanāfiḏ 8 EIAbū al-‘Amayṯal Rayy 240 854 EI, Enc.
IranicaAbū Dulāma 160 777 EIAbū Hiffān Baṣra 257 871 EIAbū Nuwās 130 747 al-Ahwāz 200 815 Bagdad EI,MPOAbū Tammām 188 804 Ǧasim 232 845 Mossoul EI,MPO,
CHALAbū Ya‘qūb Al-Ḫuraymī éduqué à
Bagdad214 829 Bagdad? EI, MPO
Abū ‘Alī al-Baṣīr Kūfa 279 892 EIAl-‘Abbās b. al-Ahnaf
133 750 Bagdad 193 808 Baṣra EI, CHAL
155
Al-Buḥturī 206 821 Manbiǧ 284 897 Manbiǧ EI,CHALAl-Fatḥ b. Ḫāqān
200 815 247 861 Sāmarrā' EI
Al-Sayyid al-Ḥimyarī
105 723 élévé à Baṣra
179 795 Bagdad EI
Al-‘Akawwak 160 776 Bagdad 213 828 Bagdad EIAšǧaʿ al-Sulamî
163 780 Raqqa,Yamamapuis éduqué à Baṣra
195 811 EI
Baššār b. Burd 95 Baṣra 167 783 Baṭiḥa EIDi‘bil b. ‘Ali 148 765 éduqué à
Kūfa246 860 Tīb (ville
d'Irak)EI
Faḍl al-Šāʿir Yamāma, élevée à Baṣr
260 873 EI
Ḫalaf al-Ahmar 115 733 Baṣra 180 796 EIHusayn b. al-Daḥḥak
150 Baṣra 250 864 EI,F
Ibn Abī ‘Uyayna le jeune
150 767 Baṣra EI
Ibn al-Dumayna EIIbn al Mu‘tazz 247 861 Sāmarrā’ 296 908 EI,MPO,
CHALIbn al-Rūmī 221 836 Bagdad 283 896 Bagdad EI, CHALIbn al-Zayyāt Bagdad
(Karḫ)233 847 EI
156
Ibn al-‘Allāf 218 833 318 930 EIIbn Bāna 278 891 Sāmarrā‘ EIIbn Bassām 303 915 Bagdad? EI, MPOIbn Da'b Médine 171 787 EIIbn Durayd 223 845 Baṣra 321 943 Bagdad EI, MPOIbn Harma 90 709 Médine 170 786 EI, FIbn Munāḍir ‘Adan puis
éduqué à Baṣra
198 813 La Mecque EI
Ibrāhīm al-Ṣūlī 243 857 EIIbrāhīm b. al-Mahdī
162 779 224 839 EI
Ibrāhīm b. Sayāba 193 EIIsḥaq b.Ḥassān al-Ḫurramī
200 CHAL
Kušāǧim Al-Ramla 350 961 EI, MPOManṣūr al-Namarī Ra's al-’Ayn
(Jazira)190 Bagdad EI, Aġ
Marwān al-Akbar b. Abī Ḥafṣa
Yamāma 181 797 EI
Marwān al-Aṣġar b. Abī al-Ǧanūb
Yamāma 248 862 Bagdad EI, Aġ, Ṭab
Muḥammad b. Ḥāzim b. ‘Amr al-Bāhilī
Baṣra Bagdad EI
Muḥammad b. Umayya
200 815 Bagdad EI
Muslim b. al- 130 747 Kūfa 208 823 Ǧurǧan EI, F
157
WalidMuṭī'b. Iyās Kūfa 169 785 Baṣra EI, CHALNubāta b. ʿAbd Allāh Dīnawar (Iran
occidental)8 EI
Nuṣayb al-Aṣġar Yamāma 175 791 EIRuʾba b. al-ʿAǧǧaǧ
65 685 Arabie 145 762 Baṣra EI
Ṣāliḥ b. ‘Abd al-Quddūs 167 783Salm b. ‘Amr al-Ḫāsir Baṣra 186 802Saʿīd b. Ḥumayd
260 874 EI
Yazīd b. Muḥammad al-Muhallabī
259 872 Aġ
Ya‘qūb al-Tammār 8‘Abdallah b. Ayyūb al-Taymī
Kūfa 8 Aġ
‘Alī b. al-Ǧahm
188 804 eduqué à Bagdad
249 863 Bagdad EI, F
‘Alī b. Yaḥya b. al-Munaǧǧim
275 889 Sāmarrā'
‘Inan Yamāma 226 841 Egypte EI‘Umāra b.ʿAqīl formé à
BaṣraAġ,F,KB
158
Tableau 2Nom usuel Calife(s) Protecteur(s) Religio
nTribu Profession Secréta
ireAbān al-Lāḥiqī
al-Rašīd al-Rašīd, Barmécides sunnite mawlā des Banū Rakāš poète non
Abū al-ʿAtāhiya
al-Hādī, al-Rašīd, al-Faḍl b. Rabīʿ, Zubayda
mawlā des ‘Anaza vendeur de poterie dans les rues puis poète
non
Abū al-Qanāfiḏ
B. Sulaym poète
Abū al-‘Amayṯal
al-Ma'mūn Ṭahirides: Ṭāhir b. al-Ḥusayn et son fils ʿAbd Allāh, fils de Sahl: al-Ḥasan et al-Faḍl
soi-disant mawlā des Banū Hāšim
poète, philologue, secrétaire, précepteur
oui
Abū Dulāma al-Saffaḥ, al-Manṣur, al-Mahdī
al-Saffaḥ, al-Manṣur, al-Mahdī
esclave noir client des Banū Asad de Kūfa
non
Abū Hiffān ʿAlī b. Yaḥyā al-Munaǧǧim, ʿUbayd Allāhb. Yaḥyā b. Ḫāqān
Banū Mihzam des ʿAbd al-Ḳays et se glorifiede son origine arabe
poète, collecteurd'aḫbār poétiques, rāwī mais à la fin de sa vie vend des vêtements pour senourrir
non
Abū Nuwās Harūn al-Rašīd, al-Amīn
Hārūn al-Rašīd,Barmécides,al-Amīn
sunnite poète non
Abū Tammām al-Ma‘mūn, al-Mu‘tasim al-Mu‘tasim, al-Wāṯiq,Al-Ḥasan b.Wahb
sunniteMuʿtazilī
al-Tayyi‘ tisserand, porteur d'eau, poète, anthologue
non
Abū Ya‘qūb Al-Ḫuraymī
Harūn al-Rashīd,al-Amīn, al-Ma'mūn
Barmakides: Yaḥya, al-Faḍl, Ǧa‘far.
mawlā de Khuraym.b ‘Amir et son fils
non
159
‘UthmanAbū ‘Alī al-Baṣīr
de al-Mu‘taṣim à al-Mu‘tamid
calife, al-Fatḥ b. Ḫāqān et son neveu ʿUbayd Allāh b. Yaḥyā
chiite origine persane poète et secrétaire
oui
Al-'Abbās b. al-Ahnaf
Hārūn al-Rashīd al-Rašīd, Barmécides: Yaḥya, Ǧa‘far.Umm Ǧa‘far (Zubayda)
poète non
Al-Buḥturī al-Mutawakkil, al-Muntasir...jusqu'à al-Mu‘tadid
Calife,al-Fath b.Khākān, wazīr Aḥmad b. al-Khaṣib
chiite al-Tayyi' poète, anthologue non
Al-Fatḥ b. Ḫāqān
al-Mutawakkil al-Mutawakkil secrétaire d'al-Mutawakkil, surintendant des travaux à Sāmarrā', gouverneur d'Egypte, lieutenant à Damas
oui
Al-Sayyid al-Ḥimyarī
al-Saffāḥ, al-Manṣūr, al-Mahdī, al-Rašīd
al-Saffāḥ, al-Manṣūr, al-Mahdī, al-Rašīd
chiite non
Al-‘Akawwak al-Ma'mun Abū Dulaf al-‘Iǧlī, Humayd b. ‘Abd al-Hamīd al-Ṭūsī, wazīr Ḥasan b. Sahl
Ḫurāsānien mawlā khurassanien
poète nonnon
Ašǧaʿ al-Sulamî
al-Rašīd Barmécides,al-Qāsim b.al-Rašīd, al-Amīn,al-Faḍl b. al-Rabī‘
adopté par les Qaysites
non
Baššār b. Burd
Califes Omeyyades puisal-Mansūr,al-Mahdi
Calife, notables de Baṣra
accusations dezandaqaet exécuté
famille originaire du Thukaristan mawlā des ‘Ukayl
poète oui
160
sur ordre d'al-Mahdi
Di‘bil b. ‘Ali
Harūn al-Rašīd chiite al-Khuzāʿî poète non
Faḍl al-Šāʿira
al-Mutawakkil admirateurs plutôt: lepoète Ṣa‘īd b.Ḥumayd et le musicien Bunān b.ʿAmr al-Ǧarrāḥ
esclave muwallada puisaffranchie
qayna non
Ḫalaf al-Ahmar
mawlā de Bilāl b. Abī Burda
rāwiya non
Husayn b. al-Daḥḥak
de al-Rašīd à al-Mutawakkil avec une interruption sous le règne de al-Ma'mūn
Calife (sauf al-Ma'mūn), Salih b.al-Rashīd, Muḥammad (futur al-Amin)
Ḫurāsānien mawlā des Bāhila
poète non
Ibn Abī ‘Uyayna le jeune
poète non
Ibn al-Dumayna
Khath‘am poète non
Ibn al Mu‘tazz
de al-Mu'tamid à lui-même
wazīr ‘Ubayd Allāh b.Sb.Wahb et son fils al-Ḳasim
sunnite prince abbasside non
Ibn al-Rūmī Banū Ṭāhir, Wahb, Djarrāh, l-Furāt, Nawbakht
chiite,mu‘tazilite
mawlā de ‘Ubayd Allāh b.‘Isa b.ǧa‘far
poète non
Ibn al-Zayyāt
al-Mu‘taṣim, al-Wāṯiq,al-Mutawakkil (quelques semaines)
al-Mu‘taṣim, al-Wāṭiq wazīr oui
Ibn al-‘Allāf
al-Mu'tadid al-Mu‘tadid, Ibn al-Mu‘tazz
poète non
Ibn Bāna Al-Mutawakkil, Ibrāhim mawlā des Ṯaqif poète non
161
b. al-MaḥdīIbn Bassām ouiIbn Da'b al-Mahdī, al-Hādī calife (surtout al-
Hādī)traditionniste, généalogiste, rāwī, poète
non
Ibn Durayd lexicographe, philologue, poète
non
Ibn Harma califes omeyyades (al-Walīd b. Yazīd), al-Manṣūr, peut-être al-Mahdī
chiite qurayš non
Ibn Munādhir
Al-Mahdi, al-Rašīd califes, Barmécides accusations dezandaqa
mawlā des Banu Ṣubayr b.Yarbū‘ (Tamīm)
poète non
Ibrāhīm al-ṢūlīIbrāhīm b. al-Mahdī
al-Ma'mūn sunnite prince abbasside prince abbasside non
Ibrāhīm b. Sayāba
al-Mahdī Yaḥya b. Ḫālid le Barmécide, al-Faḍl b.al-Rabī‘,
soupçons de zandaqa
mawlā des abbassides secrétaire d'al-Mahdī
oui
Isḥaq b.Ḥassān al-Ḫurramī
origine iranienne, participe à la šu'ūbiyya
poète non
Kušādjim famille originaire du Sind
secrétaire, astrologue, maître-queux
oui
Manṣūr al-Namarī
al-Rašīd Barmécides (al-Faḍl, Ǧa‘far), Ṭāhir, al-Faḍl b.al-Rabī‘ b.Yunūs
Ḫariǧite puis shi'iteet exécutésur
Namir b.Qāsiṭ, une destribus de Rabī‘a b.Nizār
poète non
162
ordre d'al-Rašīd pour cela
Marwān al-Akbar b. Abī Ḥafṣa
al-Manṣūr, al-Mahdī Abū al-Walīd Ma‘n b. Zā'ida
sunniteanti 'Alides
mawlā des Omeyyades non
Marwān al-Aṣġar b. Abī al-Ǧanūb
al-Mu‘tasim, al-Wāṯiq,al-Mutawakkil
al-Mu‘tasim, al-Mutawakkil, Aḥmad b. Abī Du'ād
sunniteanti ‘Alides
mawlā des Omeyyades poète non
Muḥammad b.Ḥāzim b.‘Amr al-Bāhilī
Ibrāhīm b. al-Mahdī, al-Ḥasan b. Sahl
mawlā des Bāhila poète non
Muḥammad b.Umayya
appartient à une famille de kuttāb
non
Muslim b. al Walid
Harūn al-Rashīd,al-Amin, Al-Ma'mun
Barmécides, al-Faḍl ibn Sahl
mawlā des Anṣar poète non
Muṭīʿ b. Iyās
al-Manṣūr al-Manṣūr tendances hétérodoxes (zandaqa)
poète non
Nubāta b. ʿAbd Allāh
Al-Mahdi al-Fayḍ b. Abī Ṣāliḥ Šīrawayh, vizir du calife al-Mahdī
poète non
Nuṣayb al-Aṣġar
de al-Manṣūr à al-Rašīd
al-Mahdī, al-Rašīd, Zubayda,Ṯumāma et Šayba b.al-Walīd al-‘Absī, Barmécides
mawlā d'al-Mahdī,esclave noir affranchi
non
163
(al-Faḍl en particulier)
Ruʾba b. al-ʿAǧǧaǧ
Califes omeyyades, al-Saffāḥ, al-Manṣūr
califes et fonctionnaires omeyyades, al-Saffāḥ, son oncle Sulaymān b. ʿAlī, al-Manṣūr
Banū Mālik b. Saʿd b. Zayd Manāt b. Taraîm
poète, informateur des philologues à Baṣra
non
Ṣāliḥ b. ‘Abd al-Quddūs
al-Manṣūr, al-Mahdi al-Manṣūr accusé de dualisme (zandaqa) et exécutésur odre d'al-Mahdi
mawlā des Azd ou des Asad
poète non
Salm b. ‘Amr al-Ḫāsir
al-Mahdī, al-Hādī, al-Rašīd
al-Mahdī, al-Hādī, Barmécides
mawlā rāwī de Baššār b.Burd, poète.
non
Saʿīd b. Ḥumayd
al-Muntasir, al-Mustaʿïn
Aḥmad al-Ḫaṣīb (ministre d’al-Muntasir), al-Mustaʿïn
persan, issu d'une famille de dihqān
secrétaire oui
Yazīd b. Muḥammad al-Muhallabī
al-Mutawakkil,al-Muhtadī
al-Muntaṣir, al-Mutawakkil, al-Fatḥ b.Ḫāqān
chiite appartient à l'illustre famille baṣrienne des Muhallabī
poète non
Ya‘qūb al-Tammār
non
‘Abdallah b. Ayyūb al-Taymī
Harūn al-Rashīd Barmécides, émir Yazīdb.Mazyad (m.801)
non
164
‘Alī b. al-Ǧahm
Al-Ma'mun, al-Wāṯiq,,al-Mu‘tasim,al-Mutawakkil
al-Mutawakkil sunnite, appuie ibn Ḥanbal contre les mu'tazilites
Banu Sāma b.Lu‘ayy, une tribu de Baḥrayn
poète non
‘Alī b. Yaḥya b. al-Munaǧǧim
al-Mutawakkil al-Mutawakkil secrétaire, savant
oui
‘Inan Harūn al-Rashīd al-Rašīd, esclave d'Abū Ḫālid al-Nāṭifī
esclave muwallada qayna non
‘Umāra b.ʿAqīl
Al-Ma'mūn, al-Waṯiq, al-Mutawakkil
‘Alī b.Hišām poète non
165
Tableau 3
nom usuel genres poétiques principaux
diwan
nom du diwan
elève maître particularités
Abān al-Lāḥiqī
oui Kalila wa dimna
Abū al-ʿAtāhiya
Wāliba b. al-Ḥubāb
poète novateur
Abū al-Qanāfiḏ
poète bédouin
Abū al-‘Amayṯal
panégyrique oui Dīwān perdu poète bédouin
Abū Dulāma poésie satirique,dédie une qasida à son âne
oui esclave noir, rôle de bouffon de cour
Abū Hiffān panégyrique, satire, ġazal, poésie bachique
Abū Nuwās
poète libertin mineur
Abū Nuwās panégyrique, poésie bachique, ġazal
oui Wāliba b.al-Ḥubāb, Khalaf al-Ahmar
poète novateur, partisan des Arabes du Sud
Abū Tammām panégyrique, oui Al-Buḥturī
poète néoclassique, partisan des Arabes du Nord
166
Abū Ya‘qūb Al-Ḫuraymi
panégyrique (qasida) non
Abū ‘Alī al-Baṣīr
panégyrique, satire oui Dīwān perdu
Al-'Abbās b. al-Ahnaf
ġazal et nasīb uniquement (pas de panégyrique)
oui neveu: Ibrāhīmal-Ṣuli
poète novateur
Al-Buḥturī panégyrique (qasida),élégie poète néo classique
oui Abū Tammām poète néoclassique
Al-Fatḥ b. Ḫāqān
oui mécène de nombreux poètes
Al-Sayyid al-Ḥimyarī
poésie chiite oui poète novateur
Al-‘Akawwak panégyrique oui Dīwān perdu panégyriste "sacrilège" dont al-Ma'mūn aurait fait arracher la langue et dont ilserait mort
Ašǧaʿ al-Sulamî
panégyrique
Baššār b. Burd
panégyrique, élégie, satire
oui poète novateur, šu‘ūbi
Di‘bil b. ‘Ali
satire (hiǧā'), panégyrique
oui Kitāb al-Šu‘arā'
Ibn Qutayba
Muslim b. al-Walīd
poète néoclassique
167
Faḍl al-ŠāʿiraḪalaf al-Ahmar
oui
Husayn b. al-Daḥḥak
panégyrique, poésie bachique, ġazal
non poète novateur, libertin, type achevé du poète de cour
Ibn Abī ‘Uyayna le jeune
ġazal, satire, poèmesdescriptifs de Baṣra
oui
Ibn al-Dumayna
ġazal, panégyrique oui
Ibn al Mu‘tazz
sharab, ġazal,fakhr, panégyrique
oui poète novateur
Ibn al-Rūmī panégyrique oui Dīwān ibn al-Rūmī
poète néo-classique
Ibn al-Zayyāt oui wazīr d'al-Mutaṣīm, d'al-Wāṯiq, d'al-Mutawakkil et misà mort par ce dernier
Ibn al-‘Allāf panégyrique ouiIbn Bāna Kitāb
Mudjarrad al-aghānī
168
(livre sur la musique)
Ibn Bassām épigrammes nonIbn Da'bIbn Durayd panégyrique ouiIbn Harma panégyriques (qaṣīda
de type bédouine), satire, ġazal, poésiebachique
oui
Ibn Munāḍir satire, panégyrique, thrène
Ibrāhīm al-ṢūlīIbrāhīm b. al-Mahdī
panégyrique non
Ibrāhīm b. SayābaIsḥaq b.Ḥassān al-Ḫurramī
poète šu‘ūbī
Kušādjim ouiManṣūr al-Namarī
Kulṯūm b.‘Amr al-‘Itābī
Marwān al-Akbar b. Abī
panégyrique,thrène oui dīwān perdu poète muqill (rare)
169
ḤafṣaMarwān al-Aṣġar b. Abī al-Ǧanūb
satire (hiǧā), panégyrique
appartient au cénacle d'al-Mutawakkil
Muḥammad b. Ḥāzim b. ‘Amral-Bāhilī
satire: muqaṭṭa'a (pièce brève)
non
Muḥammad b. UmayyaMuslim b. al Walid
non diwan perdu Di'bil poète néoclassique
Muṭīʿ b. Iyās panégyrique, ġazal, poésie bachique
non dīwān perdu poète novateur
Nubāta b. ʿAbd Allāh
compagnon du chanteur ‘Allawayh
poète bédouin
Nuṣayb al-Aṣġar
panégyrique, satire oui
Ruʾba b. al-ʿAǧǧaǧ
panégyrique (qaṣīda en mètre raǧaz)
oui poète bédouin
Ṣāliḥ b. ‘Abdal-Quddūs
poésie ascétique
Salm b. ‘Amr al-Ḫāsir
panégyrique, élégie oui Dīwān perdu Baššār b. Burd
poète libertin
170
Saʿīd b. Ḥumayd
non tendances šu‘ūbī (mais modéré)
Yazīd b. Muḥammad al-Muhallabī
panégyrique, thrène poète néoclassique
Ya‘qūb al-Tammār‘Abdallah b. Ayyūb al-Taymī‘Alī b. al-Ǧahm
panégyrique, thrène oui
‘Alī b. Yaḥyab. al-Munaǧǧim
non
‘Inan oui‘Umāra b. ʿAqīl
poète bédouin
171
INDEX
‘A‘Abbās, 12, 36, 39, 64, 71, 74, 79, 91‘Abbas b. al-Ahnaf, 47‘Abd Allāh b. Ḥamdūn, 39‘Abdallah al-Taymī, 19‘Adnān, 83‘Alī, 12, 27, 31, 34, 38, 39, 45, 46, 69, 70, 77, 78, 81, 92, 93‘Alī al-Riḍā, 77‘Alī b. al-Ǧahm, 27, 31, 70‘Alī b. Muḥammad al-‘Abarta'i, 78‘Alī b. Yaḥyā ibn al-Munaǧǧim, 92‘Alī b.Ǧabala al-‘Akkawak, 27‘Alides, 12, 32, 38, 77, 78‘Amr b. Ma‘dīkarib, 21‘Arib, 42‘Atīqa, 44
AAbū ‘Abd Allāh Aḥmad b. Ibrāhīm, 60, 78Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Ṣāliḥ b.‘Abd Allāh, 61Abū ‘Uṯmān Sa‘īd b. Ḥumayd, 39Abū al-‘Anbas, 24Abū al-‘Atāhiya, 11, 18, 22, 23, 65, 66, 67, 74, 80Abū al-Asad, 92Abū al-Ma‘ālī al-Kilābī, 13Abū Bakr, 78, 86Abū Dulaf al-Qāsim al-‘Iǧli, 45Abū l-Hindī al-Riyāhī, 57Abū Muḥtamad, 25Abū Muslim, 72Abū Nuwās, 5, 11, 15, 32, 49, 52, 57, 58, 60, 62, 63, 73, 74, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89
Abū Sa‘d al-Maḫzūmī, 69Abū Salama, 38Abū Tammām, 15, 16, 17, 27, 30, 37, 71, 74, 75, 79, 83Abū-l-Faraǧ al-Iṣfahānī, 5, 18Abulwafā' Tūzūn, 40, 41Aḥmad b. Abī Du‘ād, 27Aḥmad b. Abī Fanan, 31Aḥmad b. al-Ḫaṣīb, 38
172
Aḥmad b. Ḥanbal, 79Aḥmad b. Muḥammad al-Mudabbir, 23Aḥmad b.al-Mudabbir, 39al-A‘šā, 34al-ʿAǧǧāǧ, 40al-Amīn, 11, 21, 28, 30, 32, 38, 42, 57, 64al-Aṣmaʿī, 43al-Buḥturi, 16, 18, 23, 24, 31, 32, 61, 75al-Faḍl b. Muḥammad al-Yazīdī, 61al-Fatḥ b. Ḫāqān, 24, 31al-Ḥasan b. Ibrāhīm b. Riyāḥ, 37al-Ḥasan b. Sahl, 21al-Ḥasan b. Wahb, 30, 36, 37al-Husayn b. al-Dahhāk, 61al-Kumayt, 83al-Mahdī, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 26, 27, 29, 32, 38, 42, 51, 53, 65, 67, 88
al-Ma'mūn, 20, 26, 27, 28, 30, 38, 51, 57, 60, 73, 79, 80al-Manṣūr, 4, 19, 29, 51, 72al-Mu‘tadid, 18al-Mu‘tamid, 18, 34al-Mu‘tazz, 18, 30, 61, 75, 76, 77, 82al-Mufaḍḍal al-Ḍabbī, 51al-Muhtadī, 18al-Muntaṣir, 79al-Musayyab, 51al-Musta‘īn, 18al-Muʿtaṣim, 4, 27al-Mutawakkil, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 31, 38, 39, 44, 45, 46, 51, 57, 60, 64, 69, 70, 72, 73, 79, 82, 91, 93, 94
al-Muttaqi, 5, 34, 37, 40, 42al-Nābiġa, 17al-Naḍr b. Shumayl, 20al-Qāsim b. Zurzur, 61al-Rāḍī, 34, 35, 40, 41al-Rašīd, 12, 18, 25, 28, 29, 32, 43, 57, 79, 85al-Saffāḥ, 34, 83al-Walīd ibn Yazīd, 11al-Waššā', 64al-Wāṯiq, 27, 38, 44Ašǧa‘ al-Sulamī, 65, 66Ašǧa‘ b. ‘Amr al-Sullamī, 18Ašnās, 38
BBaḏl, 42Baǧkam, 41Bahrām Gūr, 89
173
Banān, 37Banū ‘Uḏrā, 62Banū al-Mudabbir, 61Banū Anbāṭ, 87Banū Asad, 84, 86Banū Laḫm, 89Banū Nawbakht, 78Banū Saʿd b. ʿAšīra, 83Barmécides, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 39, 64, 81, 88, 91Baššār b. Burd, 5, 11, 14, 22, 69, 74, 80, 88Bišr al-Mu‘tamir, 79
CChosroès, 90
DDi‘bil, 25, 26, 27, 69, 71, 75, 77, 79, 83Dugha al-‘Iljiyya, 86
FFaḍl, 14, 15, 19, 20, 21, 28, 29, 45, 46, 61, 64, 81
ĠĠassānides, 17
ǦǦa‘far, 15, 40, 41, 64, 77Ǧaḥẓa, 61
HHammād ‘Ajrad, 11Hārūn al-Rašīd, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 26, 43, 64, 79Hilāl al-Ṣābi', 5
ḤḤāǧib b. Zurāra, 86Ḥammād al-Rāwiya, 49, 52Ḥammād b. Muḥammad al-Kātib, 34Ḥasān b.Ṯābit, 35Ḥunayn, 27Ḥusayn b. al-Ḍaḥḥāk, 19, 20, 22
ḪḪalaf al-Aḥmar, 49, 52Ḫālid b. Barmak, 88
174
Ḫālid b. Yazīd, 68Ḫālid b.Yazīd, 27
I
Ibn Abī Fanan, 31Ibn Abī Ḥakīm, 31Ibn al-Nadīm, 5, 37Ibn al-Rūmī, 31, 44, 61, 75, 76Ibn al-Sikkīt, 77Ibn al-Zayyāt, 27, 37, 38, 41, 91Ibn Bassām, 37Ibn Manẓūr, 25Ibn Qutayba, 44, 47, 61, 74Ibrāhīm al-Mawṣilī, 43Ibrāhīm al-Ṣūlī, 54Ibrāhīm b. al-Mudabbir, 39, 60, 64Idrīs b. Abī Ḥafṣa, 31Imrū al-Qays, 3Itāḫ, 38
‘I‘Inān, 44
KKhālid b. Ṣafwān, 83Kušāǧim, 30, 71
MMa‘bad, 26, 27Ma‘n b. Zā'ida, 19Maǧnūn Laylā, 62Maḥbūba, 44, 45, 46, 47Majnūn, 5, 62Manṣūr al-Namarī, 32, 49Marwān b. ‘Abī al-Ǧanūb, 12Mas‘ūdi, 5, 19, 45, 46, 58, 83Mohammad b. ‘Abd Allâh, 19Muḍar, 84Muḫallad ibn Bakkār, 86Muḥammad, 5, 13, 21, 23, 27, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 61, 71,77, 81, 85, 86, 91, 93
Muḥammad b. Ḥāzim b.‘Amr al-Bāhilī, 27Muḥammad b. Yahyā al-Ṣūlī, 5, 35, 39, 40Muḥammad b. Yaḥyā b. Šīrzād, 40Muḥammad b.‘Abd al-Malik al-Zayyāt, 21Munaǧǧim, 31, 35, 46, 70, 78, 91, 92175
Musaylima, 86Muslim b. al-Walīd, 20, 61Mutayyam al-Hāšimiyya, 42Muṭī‘ Ibn 'Iyās, 62
NNaqfūr, 25Nizār, 83, 85Nuṣayb al-Aṣġar, 20
QQaḥṭān, 83, 89, 92Qalam al-Ṣāliḥiyya, 44Qāsiṭ, 86Qays ibn al-Mulawwaḥ, 62Qudāma b. Ǧa'far, 25Quraysh, 85
SSa‘īd b. Ḥumayd, 61, 81, 89Salm b. ʿAmr al-Ḫāsir, 32Sāsān, 90Sulaymān b. Wahb, 36, 38Sulaymān b.al-Muhāǧir al-Baǧalī, 38
ṢṢāliḥ b. ‘Abd al-Quddūs, 14
TTaghlib, 86Tamīm, 40, 84, 86Tawaddud, 43
ṬṬāhir, 28, 31, 34, 39, 44, 45
ṮṮa‘lab, 54 Ṯumāma ibn Ašras, 79
UUmm Ǧa‘far, 64Uṯmān, 39, 78
176
‘U
‘Ubayd Allāh b. Sulaymān, 34‘Umar, 62, 78‘Umar Ibn' Abī Rabī‘a, 62‘Umāra b.‘Aqīl, 73‘Utabi, 32‘Utba, 11, 22, 23
WWahid, 44Wāliba b. al-Ḥubāb, 49, 69
YYaḥya b. Ḫālid le Barmécide, 25Yazīd Ḥawrā, 22Yazīd I, 77
ZZubayda, 43, 64
177
BIBLIOGRAPHIE
- SOURCES
ABŪ L-FARAJ AL-IṢFAHĀNĪ, Kitāb al-aghānī, Beirut 2004, 25 vol.
ABÛ-NUWÂS, Le vin, le vent, la vie, trad. fr. V.-M. MONTEIL, Arles 1998(La petite bibliothèque de Sindbad), 190 p. (éd. précédentes 1979, 1990).
BASHSHÂR IBN BURD, Selections from the poetry of Baššār, trad. A. BEESTONCambridge 1977, 90 p.
IBN AL-NADĪM, The Fihrist of al-Nadīm, a tenth century survey of muslim culture, éd. et trad. B. DODGE, Londres New-York 1970, 2 vol.
MAJNÛN, L'amour poème, trad. fr. A. MIQUEL, Arles 1998 (La petite bibliothèque de Sindbad) ,107 p. (éd. Précédente 1984).
MAS'ŪDI, Les prairies d'or, trad. fr. C. BARBIER DE MEYNARD et A. PAVET DE COURTEILLE revue et corrigée par C. PELLAT, Paris 1962-1997 t. IV 1989 t. V 1997, (Société Asiatique collection d'ouvrages orientaux), 5 tomes.
HILÂL AL-ṢÂBI' (ṢÂBI',Hilāl ibn al-Muḥassin) Rusūm Dār al-Khilāfah (The Rules and Regulations of the ‘Abbāsid Court), trad. de l'arabe avec introduction et notes de E. A. SALEM, Beyrouth 1977 (UNESCO collection of representative works : Arabic series), 134 p.
Al-SŪLĪ Mohammed ben Yahyâ, Akhbar al-Radī Billāh wa al-Muttaqī Lillāh :histoire de la dynastie abbaside de 322 à 333/934 à 944, trad. de l'arabe par M. CANARD, 2 tomes:tome 1, Histoire d'ar-Radī, Alger 1946, 240 p. tome 2, Histoire d'al-Muttaqī, Alger 1950, 167 p.
- TRAVAUX
Ouvrages de référence :
178
‘Abbasid Belles-Lettres, ed. J. ASHTIANY, T.M. JOHNSTONE, J.D. LATHAM, R.B. SERJEANT, G.R. SMITH, Cambridge 1990 (The Cambridge History of Arabic Literature), 517 p.
T. BIANQUIS, P. GUICHARD, M. TILLIER (sous la direction de), Lesdébuts du monde musulman (VIIe-Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, Paris 2012 (Nouvelle Clio), 704 p.
N.-M. EL CHEIKH, «To be a Prince in the Fourth/Tenth-Century abbassid Court », dans Royal Courts in Dynastic States and Empires : a GlobalPerspective, éd. J. Duindam, T. Artan, M. Kunt, Brill, Leiden Boston, 2011.p 199-217,.
Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, comité de rédaction : H.A.R. GIBB, J.H. KRAMERS, E. LEVI-PROVENCAL, J. SCHACHT, Leyde Paris 1991, 13 tomes, suppléments et index.
D. SOURDEL, L'état impérial des califes Abbassides VIIIe-Xe siècle, Paris 1999 (Islamiques), 264 p.
H. TOELLE, K. ZAKHARIA, A la découverte de la littérature arabe, Paris 2003 (Champs essais), 388 p.
Ouvrages spécialisés et articles
A. ARAZI, « De la voix au calame et la naissance du classicisme en poésie », Arabica, t. 44, 1997, p. 377-406.
A. ARAZI, « Abū Nuwās fut-il šu‘ūbite ? », Arabica, t. 26, 1979,p. 1-61.
J.-E. BENCHEIKH, « Les secrétaires poètes et animateurs de cénacle au II e et III e siècles de l'hégire : contribution à l'analyse d'une production poétique », Journal asiatique, 263, Paris, 1975, p. 265-316.
J.-E. BENCHEIKH, « Le cénacle poétique du calife al-Mutawakkil(m.247) contribution à l'analyse des instances de légitimationsocio-littéraires », Bulletin d'études orientales, 29, Damas 1977, p. 33-52.
J. BERQUE, Musiques sur le fleuve : Les plus belles pages du Kitâb al-Aghâni, Paris 1995, 444 p.
179
R. BLACHERE, « La poésie arabe au ‘Irāq et à Baġdād jusqu'à Ma‘rūf al-Ruṣāfī », Arabica t. 9, Volume spécial publié à l'occasion du mille deux centième anniversaire de la fondationde Baġdād, 1962, p. 419-434.
R. BRUNSCHVIG, « Mu‘tazilisme et Aš‘arisme à Baġdād »,Arabica t. 9, Volume spécial publié à l'occasion du mille deux centième anniversaire de la fondation de Baġdād, 1962, p. 345-356.
DRORY Rina, « The Abbassid Construction of the Jahiliyya : Cultural Authority in the making ».Studia Islamica, 83,1996, p. 33-49.
N. EL KHATIB, Etude historique de l'époque Abbaside à travers le Kitâb al-Aghânî, thèse, Université Paris 4, 1975, 356 p. (dact.).
B. GRUENDLER, Medieval Arabic Praise Poetry, Ibn Al-Rūmī and the Patron's Redemption, Londres-New York 2003, 347 p.
H. KENNEDY, The Court of the Caliphs : The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty, Londres 2004, 326 p.
H. KILPATRICK, « Abū l-Faraǧ's Profiles of Poets A 4th/10th Century Essay at the History and Sociology of Arabic Literature », Arabica 1997, t. 44, p. 94-128.
H. KILPATRICK, « The Medieval Arab Poet and the Limits of Freedom », Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), Londres 1979,Volume 6, p. 96-103.
S. PINCKNEY STETKEVYCH, The Poetics of Islamic Legitimacy : Myth, Gender, and Ceremony in the Classical Arabic Ode, Bloomington Indianapolis 2002,385 p.
K. RICHARDSON, « Singing Slave Girls (Qiyan) of the ‘Abbasid Court in the Ninth and Tenth Centuries », dans Children in Slavery Through the Ages, éd. G. Campbell, S. Miers, J. C. Miller, Athens (Ohio) 2009, p. 105-118.
J. SHARLET, Patronage and Poetry in the Islamic World : Social Mobility and Status in the Medieval Middle East and Central Asia, Londres New York 2011, 326 p.
180
D. SOURDEL., Le vizirat 'abbāside de 749 à 936 (132 à 324 de l'Hégire),Damas 1960, 2 vol.
S. SPERL, « Islamic Kingship and Arabic Panegyric Poetry in the Early 9th Century », Journal of Arabic Literature, 8, 1977, p. 20-35.
181
Table des matières
Introduction p. 3
A)Différentes pratiques de la poésie – Différents
types de praticiens p. 8I) Les poètes professionnels p. 8
1) Le panégyrique et son cérémonial – Une pratique publique
de la poésie p. 10
- Le panégyrique p. 10
- Récompenses et châtiments p. 17
2) Le genre satirique p. 25
3) Les relations des poètes professionnels avec leurs
protecteurs p.29
II) Les poètes kuttāb p. 33
1) La poésie comme une partie de l’adab – citation de vers
p. 33
2) Utilisation de la poésie comme un moyen de communication
p. 36
- Billets p. 36
- Poésie politique p. 37
- Poésie de demande p. 41
III) Les qiyān p. 42
IV) La mise en forme de la poésie pré-islamique : des rāwī
aux philologues p. 48
1) Rāwī p. 48
2) Philologues p. 50
182
B)Différentes modalités d’interactions entre ces
différents types de praticiens p. 55I) Les cénacles de poésie (maǧlis) – Une pratique privée de
la poésie p. 55
1) Poésie bachique (ḫamriyya) p. 56
2) Poésie amoureuse (ġazal) p. 61
- Le ġazal des poètes professionnels p. 61
- La poésie élégiaque chez les secrétaires p. 68
3) Joutes poétiques et improvisation p. 69
4) La poésie d’agrément des secrétaires p. 70
II) Quelques clivages existant parmi les poètes p. 72
1) Clivages concernant le style : les anciens/ les modernes
(muhdaṯūn)/ les néoclassiques p. 73
2) Clivages d’ordre politico-religieux : les sunnites/ les
chiites/ les mu‘tazilites/ les hanbalites/ la zandaqa p.
76
3) D’ordre ethnique : la rivalité Arabes du Sud/ Arabes du
Nord et la šu‘ūbiyya p. 82
- La rivalité Arabes du Sud/ Arabes du Nord p. 82
- La šu‘ūbiyya p. 87
Conclusion p. 94
Annexes p. 96
Index p. 108
183