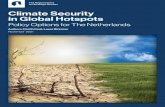Entre steppes et stèles, Territoires et identités au Bachkortostan
Archéologie, histoire et anthropologie de la presqu’île de La Hague (Manche). Etudes et travaux,...
Transcript of Archéologie, histoire et anthropologie de la presqu’île de La Hague (Manche). Etudes et travaux,...
Archéologie, Histoire etAnthropologie de la
presqu’île de la Hague(Manche)
Etudes et travaux
Volume n° 7
Ce volume recueille les travaux menéssur l’archéologie, l’histoire et l’anthropologie de la presqu’île de la Hague (Manche).
Directeurs de la publicationCyril Marcigny et Gérard Vilgrain
Ce numéro a été réalisé parCyril Damourette, Manoir du Tourp
Notice catalographiqueMarcigny C., Vilgrain G. et Damourette C., dir. Archéologie, histoire et anthropologie de la presqu’île de la Hague (Manche). Etudes et travaux. Volume n° 7, 2013. Beaumont-Hague : 2013. 56 p.
Mots clefsBasse-Normandie, Manche, la Hague, archéologie, histoire, anthropologie
ISSN : 1779-5575
Les avis exprimés dans les articles n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
Page de couvertureLa Gravelette limitée à l’est par la pointe de Courcoeur (photo N. Lecouvey).
Mise en pageCyril Damourette, Manoir du Tourp
DiffusionManoir du TourpCommunauté de communes de la Hague8, rue des TohaguesBP 21750442 Beaumont-Hague CedexMail : [email protected]
Avant-Propos
Comme chaque année, 2013 se clôture par la publication du septième volume des « Études et Travaux » concernant les recherches archéologiques, historiques et ethnographiques dans la Hague. Cette année, les
fouilles ont porté principalement sur trois zones : Urville-Nacqueville qui fait toujours l’objet d’un ambitieux projet de recherche interdisciplinaire conduit par A. Lefort sur une probable agglomération portuaire
replacée dans son contexte sitologique et environnemental ; le fort d’Omonville-la-Rogue dont l’étude des bâtiments a été achevée durant le deuxième semestre par G. Vilgrain ; et, pour finir, les sondages sur la
presqu’île de Jardeheu qui ont débuté cette année avec G. Fosse, G. Vilgrain et C. Marcigny.
Les résultats pour ces trois zones sont particulièrement représentatifs des problématiques de recherche développées dans la Hague ; ils nous permettent de suivre, sur le temps long, les occupations humaines
depuis la préhistoire et l’âge du bronze – à Jardeheu – jusqu’à l’actuel – à Omonville-la-Rogue – en passant par la protohistoire et l’Antiquité à Urville-Nacqueville. Sur ces chantiers, comme chaque année depuis
2005, des chercheurs issus de différentes institutions – archéologues bénévoles ou professionnels, spécialistes des environnements anciens et historiens – se sont côtoyés et ont travaillé de concert pour
aboutir à un projet commun : la compréhension et la restitution historique d’un site.
Cette ambition des chercheurs dans la Hague – toujours mêler les points de vue disciplinaires de manière à offrir un panel de lecture scientifique le plus large possible – reste un des objectifs majeurs du travail débuté
il y a maintenant huit ans. Ce sont ces regards croisés que l’on retrouve en partie dans ce volume qui, cette année, est principalement orienté vers les périodes moderne et contemporaine. Ainsi, nous aborderons
l’étude du cahier de Louis Levallois – agriculteur et maire de Saint-Germain-des-Vaux au début du XXe siècle – par G. Fosse, puis nous continuerons sur la présentation du projet avorté de jetée de la Gravelette, avant la Première Guerre mondiale, par N. Lecouvey. G. Vilgrain se fera ensuite le porte-parole d’un programme d’inventaire du patrimoine funéraire du canton de Beaumont-Hague : un exemple de ce travail est illustré
par le cimetière d’Omonville-la-Petite publié par J. Brionne. Puis, E. Marie continuera de nous faire découvrir le « petit patrimoine » de la Hague avec un élément emblématique : le frotteu. Enfin, ce volume s’achèvera
sur la présentation des vestiges de la Seconde Guerre Mondiale par R. Deroo.
En guise de conclusion de cet avant-propos, nous aimerions revenir sur ce qui fait une des forces du travail engagé dans la Hague : le souhait de restituer à tous, dans des délais rapides, le fruit des découvertes et des réflexions. Ce volume est le résultat de cette aspiration. Il doit beaucoup au partenariat engagé avec
la Communauté de communes de la Hague et, plus particulièrement, avec le Manoir du Tourp. Ils nous accompagnent et nous apportent un soutien infaillible depuis maintenant huit ans.
Qu’ils en soient remerciés.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et un bon voyage entre archéologie, histoire et anthropologie de la presqu’île de la Hague.
Cyril MARCIGNYInstitut national de recherches archéologiques préventives
UMR 6566-CReAAH du CNRS
Michel CANOVILLEPrésident
Communauté de communes de la Hague
Préh
isto
ire P
roto
hist
oire
His
toire
44
Préh
isto
ire P
roto
hist
oire
His
toire
Mésolithique
Néolithique
Âge du Bronze
Âge du Fer
Antiquité
Moyen Âge
- 5 000
- 2 000
- 800
0
476
1 492
1 789
- 9 000
- 250 000
ap. J.C.
av. J.C.
Époque moderne
Époque contemporaine
Paléolithique
Néolithique
1.indd 4 02/07/10 14:40
Sommaire
Cahier Louis Levallois, un cahier tenu par un agriculteur, maire de Saint-Germain-des-Vaux, pendant la 1ère moitié du XXème siécle, Gérard Fosse, Gérard Vilgrain-Bazin et collaborateurs 7
Projet d’une jetée à la Gravelette, Nicolas Lecouvey 27
Cimetière d’Omonville-la-Petite, un lieu ouvert vers l’absolu, Jacky Brionne 31
Inventaire et protection du patrimoine du funéraire dans le canton de Beaumont-Hague (Manche), Gérard Vilgrain-Bazin et collaborateurs 39
Les frotteux de la Hague, Eric Marie 45
Les sentiers de la mémoire, vers une valorisation du patrimoine de la Seconde Guerre Mondiale dans le Cap de la Hague, Rafaël Deroo 49
Préh
isto
ire P
roto
hist
oire
His
toire
44
Préh
isto
ire P
roto
hist
oire
His
toire
Mésolithique
Néolithique
Âge du Bronze
Âge du Fer
Antiquité
Moyen Âge
- 5 000
- 2 000
- 800
0
476
1 492
1 789
- 9 000
- 250 000
ap. J.C.
av. J.C.
Époque moderne
Époque contemporaine
Paléolithique
Néolithique
1.indd 4 02/07/10 14:40
6
La Gravelette limitée à l’est par la pointe de Courcoeur.
Plan de l’anse montrant l’emplacement de la jetée envisagée -1875.
7
Projet d’une jetée à la Gravelette (1874 - 1914)Nicolas Lecouvey
Il est toujours très agréable de descendre jusqu’à la paisible anse de la Gravelette. Faire une pause le long du chemin, assis sur de gros galets bien exposés. Pendant la belle saison, on peut apercevoir dans cette petite crique, les bateaux de quelques pêcheurs. Il y a une centaine d’années, les marins-pêcheurs de Jobourg ont voulu y faire construire une jetée.
L’état des lieux à la fin du XIXème siècle.
L’anse de la Gravelette est limitée au nord par la falaise, à l’ouest par les rochers de Sainvy et à l’est par la pointe de Courcoeur. Des apports de gros galets et de sable ont formé au fond de cette crique une petite grève.
En 1875, deux bateaux de pêche s’abritent à la Gravelette (voir tableau n°1).
Pendant les mortes-eaux, ces pêcheurs peuvent échouer leurs bateaux sur la grève. Mais en vives-eaux, la laisse de haute mer atteignant le pied de la falaise, tout échouage est alors impossible et les bateaux doivent être tenus à flot ou bien échoués dans la crique voisine de Moncaneval.
Homards, crabes et poissons constituent le lot quotidien de la pêche. Notons également que les pêcheurs de Jobourg ne se livrent pas exclusivement à cette activité : ils sont en même temps cultivateurs.
Une première demande en 1874
Par une pétition du 2 août 1874, le conseil municipal de Jobourg demande la création d’un petit port de pêche à l’anse de la Gravelette. Le 21 janvier 1875, un ingénieur des Ponts et Chaussés dresse un plan général de l’anse et un plan de la jetée demandée. Elle partirait des rochers que l’ingénieur nomme « Rochers de la Gravelette », mais appelé communément « Rochers de Sainvy ».
La jetée mesurerait environ 25 mètres de long, 7 mètres 20 de haut, 7 mètres 20 de large à la base et 3 mètres 60 de large au sommet. Le niveau bas de la jetée correspondrait aux basses mers de mortes-eaux et le niveau haut aux hautes mers de vives-eaux.
Dans un rapport daté du 15 mars 1875, ce même ingénieur des ponts et chaussées estime le coût de la jetée à 12000 francs, dépense démesurée au regard du petit nombre de marins inscrits sur la commune de Jobourg. De plus l’anse est inaccessible aux charettes. Les transports de varech et de poissons ne peuvent s’effectuer alors qu’à dos d’homme ou de cheval. En conclusion, l’ingénieur juge inutile toute amélioration du petit port naturel de la Gravelette tant que la commune de Jobourg n’en aura pas facilité l’accès.
La pétition de 1892
En 1892, le syndic des gens de mer d’Omonville-la-Rogue recense à la Gravelette trois bateaux de pêche. Ils jaugent 5 tonneaux 57 et embarquent douze hommes d’équipage. Ils se nomment la MARIE, la VIRGINIE et le VOYAGEUR (voir tableau n°2).
Le 6 novembre 1892, le maire de Jobourg M. Constant Lecostey, les conseillers municipaux et les marins-pêcheurs de Jobourg adressent une pétition au préfet et aux conseillers généraux de la Manche. 66 personnes la signent dont 34 de Jobourg, 20 d’Auderville et 12 de Saint-Germain-des-Vaux. Ils demandent la création d’un port à la Gravelette.
« Messieurs,
Les sousssignés, maire, conseillers municipaux, marins-pêcheurs et autres ont l’honneur de vous soumettre la présente pétition qui a pour but de solliciter votre bienveillance en vue de la construction d’une digue qui assurerait à plusieurs bateaux de pêche un abri qu’ils n’ont pas.
Nom du bateau Année et lieu de construction Tonnage Patron Hommes
d’équipageLa Marie-Joséphine 1853 à Cherbourg 1.31 Pierre Constant Lecostey, 47 ans 4Le Père et Fils 1865 à Cherbourg 1.47 Thomas Charles Antoine Mauger, 34 ans 4
Plan de coupe de la jetée demandée -1875.
Tableau n°1 : Description des bateaux s’abritant à la Gravelette en 1875.
Tableau n°2 : Description des bateaux recensés par le syndic des gens de la mer d’Omonville-la-Rogue en 1892.
Nom du bateau
Année et lieu de construction Tonnage Patron Hommes
d’équipageLa Marie 1883 à Omonville 1,76 Charles Auguste Sanson, 34 ans 4La Virginie 1888 à Barfleur 1,90 Thomas Charles Antoine Mauger, 51 ans 4Le Voyageur 1892 à Barfleur 1,91 Jules Léon Mauger1, 26 ans 4
1 Fils de Thomas Charles Antoine Mauger, précédemment cité.
8
De Goury à Diélette, sur toute la côte sud de la Hague, il n’y a pas un coin où un bateau de pêche puisse se mettre à l’abri contre les vents du large. Il y a cependant, à Jobourg et à Herqueville, 8 à 10 bateaux et il y en aurait sûrement bien davantage s’il y avait sur cette côte un petit port où les bateaux seraient en sûreté.
A l’heure actuelle, les pêcheurs sont exposés, tous les matins à trouver leurs bateaux au plein. Il fait beau le soir : les bateaux sont laissés à flot. Une tempête du large s’élève dans la nuit et, le lendemain matin, les bateaux jetés sur les rochers par la violence du vent, sont en miettes. La chose, du reste, est arrivée plusieurs fois.
Les bateaux de Goury, qui, à chaque instant, viennent tendre leurs filets dans l’anse de Vauville, seraient à certains moments très heureux de trouver, eux aussi, un abri sur nos côtes. Il arrive fréquemment qu’avec de grands vents d’ouest ou nord-ouest leurs filets restent tendus plusieurs jours, et souvent même, faute d’un refuge sur notre littoral, ces filets sont perdus. Voici comment avec les vents en question, les bateaux se rendraient facilement de Goury aux filets, mais ils ne pourraient retourner à Goury. Donc les filets restent là. Avec le petit port demandé les filets pourraient être ramassés et bateaux et filets seraient mis en sûreté dans le port en attendant le beau temps pour retourner à Goury.
D’après nous, Messieurs, on pourrait relativement à peu de frais, établir un abri pour tous ces bateaux. Nous avons sous Jobourg une petite baie nommée la Gravelette où avec une digue de 30 à 40 mètres on construirait un petit port de pêche admirable.
Presque à l’entrée de cette baie se trouvent les rochers les Brequets à l’abri desquels les bateaux pourraient mouiller en attendant l’heure de la marée pour entrer aux ports. »
Trop coûteux
Même si elle reconnaît la situation difficile dans laquelle se trouvent les pêcheurs de Jobourg, l’administration ne répond pas favorablement à cette pétition. Une lettre des Ponts et Chaussées datée du 17 janvier 1893 expose les raisons de ce refus.
Tout d’abord, la construction de l’ouvrage présenterait de grandes difficultés d’exécution et coûterait fort cher. En effet, l’anse de la Gravelette est située au pied d’une falaise de 90 mètres de hauteur et on ne peut y accéder que par des sentiers à peine tracés et praticables tout au plus à des piétons. Dans ces conditions, tous les matériaux nécessaires à l’exécution
du travail devraient être approvisionnés par mer au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La dépense qu’entraînerait l’exécution d’un pareil travail ne paraît pas en proportion des intérêts mis en jeu. Il n’y a en 1892 à la Gravelette que 3 bateaux de pêche.
Deuxièmement, les pétitionnaires semblent croire que le nombre de bateaux augmenterait si l’abri était plus convenable. L’administration en doute car, à Goury par exemple, où les marins ont toutes facultés pour exercer leur industrie, le nombre des pêcheurs et des bateaux diminue plutôt qu’il n’augmente.
Enfin, une cale d’échouage sera bientôt achevée dans la crique du Houguet à Herqueville, à moins de 3 km de la Gravelette. En cas de mauvais temps, les pêcheurs de Jobourg pourront s’y réfugier et y échouer leurs bateaux.
Trois nouvelles demandes du conseil municipal
En 1912, on recense à la Gravelette trois bateaux de pêche (voir tableau n°3).
Au début du XXème siècle, le conseil municipal de Jobourg sous la présidence de M. Constant Lecostey4, renouvelle à trois reprises sa demande de créer une jetée à la Gravelette : le 17 février 1901, le 5 avril 1908 et le 29 juin 1913. En 1913, le conseil municipal composé de Mrs Audoire, L. Heleine, Avoine, C. Lecostey, Lecarpentier, J. Lecostey, Alb. Heleine, J. Mauger, Th. Lecostey et A. Gosselin explique ainsi ses motivations :
“Les pêcheurs de la commune n’ont qu’une seule baie - La Gravelette – où ils puissent remiser leurs bateaux. Cette baie ouverte aux vents de sud n’offre aucun abri en cas de mauvais temps et les matelots sont obligés de tirer leurs bateaux à sec, ce qui leur fait perdre beaucoup de marées. Cette baie est la plus avantageuse qu’il existe le long de la côte ; il suffirait pour la rendre sûre de faire une petite jetée partant au-dessus du point vulgairement appelé ruet de Sainvy et se dirigeant vers le bec des Court Queuzes. Cette jetée, si elle avait seulement 20 mètres de longueur, donnerait une sécurité aux marins et leur permettrait même en mauvais temps de laisser leur bateaux à flot se trouvant alors abrités contre les vents de sud. L’ouest de la baie est naturellement protégé par une double ligne de rochers insubmersibles.
La cale du Houguet sur la commune d’Herqueville. Les Brequets.
9
Projet d’une jetée à la Gravelette
Le conseil en outre prend l’engagement, s’il est donné suite à ce voeu de rendre praticable dans la suite le chemin conduisant à la Gravelette.”
Le conseiller général du canton de Beaumont-Hague, Albert Le Moigne5, fait suivre tous ces voeux au conseil général de la Manche. La commission « Chemins de Fer et Ports » rédige à chaque fois un rapport dont les conclusions sont adoptées lors des séances du 20 août 1901, du 8 septembre 1908 et du 9 septembre 1913.
Le projet est définitivement abandonné
La jetée demandée étant moins longue (20 mètres au lieu de 30 mètres en 1892), le coût du projet se réduit. Mais, le 28 novembre 1913, l’ingénieur des Ponts et Chaussées émet encore beaucoup de réserves.
« L’abri que donnerait une jetée de 20 mètres de long procurerait-il bien le résultat qu’en attendent les pêcheurs ? Il est permis d’en douter. Par vents de sud-ouest, il se produirait un ressac très violent et vu la faible longueur de l’ouvrage on ne saurait affirmer que les bateaux seraient abrités suffisament. D’autre part, [...] le mètre courant de jetée en ce point ne reviendrait pas à moins de 1200 francs, c’est donc une dépense de 24000 francs qu’il faudrait faire. Elle est hors de proposition avec les résultats à obtenir.
Il convient de remarquer qu’actuellement les bateaux de Jobourg se mettent l’hiver à l’abri au Houguet où une petite cale avec cabestan a été établie : l’abri du Houguet est à 2 km de distance au sud de la Gravelette.
Nous sommes d’avis qu’il n’est pas possible pour les raisons ci-dessus énoncées d’émettre un avis favorable à la demande présentée.»
On vient de le voir, toutes les demandes successives de créer une digue à la Gravelette ont été rejetées. Les Ponts et Chaussées n’ont jamais manqué d’arguments pour se justifier. L’anse de la Gravelette demeurera donc telle qu’elle est aujourd’hui.
Sources
1. Archives départementales de la Manche à Saint-Lô.• Côte 4 S Cherbourg 319 : Port Racine, Herqueville, Jobourg
entretien, construction et réparation des sites.• Côte 4 S Cherbourg 434 : voeux divers tendant à
l’amélioration des ports de la partie du littoral située à l’ouest de Cherbourg.
• Procès-verbaux des délibérations du conseil général de la Manche. Années 1901, 1908 et 1913.
2. Service historique de la défense à Cherbourg.• Rôles des désarmements 1876 : numéros 162 et 268. • Rôles des désarmements 1893 : numéros 93, 229 et 279.• Rôles des désarmements 1912 : numéros 22, 172 et 229.
3. Registre des délibérations du conseil municipal de Jobourg de 1908 et 1913.
Nom du bateau
Année et lieu de construction Tonnage Patron Hommes
d’équipageLe Voyageur 1892 à Barfleur 1,91 Gustave Charles Mauger2, 43 ans. 3La Joséphine 1907 à Cherbourg 1,21 Hyacinthe Auguste Marie Sanson3, 27 ans. 2Le Saint-Louis 1907 à Cherbourg 1,12 Armand Auguste Cauvin, 29 ans. 2
Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil général de la Manche lors de sa séance du 8 septembre 1908.
Les rochers de Sainvy bordent la Gravelette à l’ouest.
2 M. Constant Lecostey fut maire de Jobourg de 1892 à 1929.3 Albert Le Moigne fut conseiller général du canton de Beaumont-Hague de 1886 à 1930 et il présida le conseil général de la Manche de 1922 à 1930. 4 Fils de Thomas Charles Antoine Mauger, précédemment cité.5 Fils de Charles Auguste Sanson, précédemment cité.
Tableau n°3 : Bateaux recensés 1912.
11
Cahier Louis LevalloisUn cahier tenu par un agricultueur , maire de Saint-Germain-des-Vaux-des-Vaux,
pendant la 1ère moitié du XXème siècle
Gérard FOSSE, Gérard VILGRAIN-BAZIN et Geneviève LEVALLOIS
Louis, François, Eugène Levallois (1905 - 1994), cultivateur à Saint-Germain-des-Vaux-des-Vaux, commune dont il a été longtemps le maire, a tenu un cahier sous forme d’annales, dans lequel il a noté les éléments les plus marquants de sa vie, des évènements et des manifestations, notamment religieuses, qui ont compté pour lui. Ce cahier, qui semble être resté inconnu de ses proches, sauf peut-être de ses parents, a été retrouvé récemment, parmi les archives et les documents qu’il avait conservés, par Bernadette et Geneviève Levallois, filles de son cousin germain, Joseph Levallois. Ces dernières nous l’ont confié pour lecture et, éventuellement, étude. En raison de l’originalité de la démarche, des choix faits par l’auteur quant aux informations retenues, de l’éclairage qu’il apporte sur une communauté rurale de bord de mer dans l’extrême pointe de la Hague pendant la 1ère moitié du XXème siècle, il nous a semblé intéressant d’en faire et d’en présenter une analyse thématique exhaustive, précédée d’une présentation de son cadre familial et géographique.
LE CADRE FAMILIAL ET GÉOGRAPHIQUE
L’ascendance de Louis Levallois
Les quatre grand-parents de Louis Levallois portent les patronymes suivants : Levallois (grand-père paternel), Lecouvey (grand-mère paternelle), Boissel (grand-père maternel), Renet (grand-mère maternelle). Ces quatre branches familiales ont fait l’objet de recherches généalogiques parvenues à des stades divers, mais inachevées.
Louis Levallois jouissait d’une certaine aisance économique ; vers le milieu du XXème siècle, il était le plus gros propriétaire foncier de Saint-Germain-des-Vaux-des-Vaux. De quelle branche familiale provenait cette aisance ?
Les Levallois
Les Levallois sont une vieille famille de Saint-Germain-des-Vaux, plus précisément de la Rue-de-Bas, qui est le plus populeux hameau de la commune et qui regroupe la grande majorité des Levallois.
• le plus ancien actuellement connu est Jacques au XVIIIème siécle.
• son fils, Jean-Baptiste (1779 - 1863), cultivateur, dont l’emplacement précis de la maison à la Rue-de-Bas est connu, grâce à l’ancien cadastre ; il a eu sept enfants (5 de sexe masculin), dont :
• Bazile, Baptiste (1819 - 1870), cultivateur. Marié deux
fois, il a eu huit enfants (sept garçons, deux filles). Les cinq garçons qui ont atteint l’âge adulte sont devenus domestique (à Paris), gendarme, douanier et cultivateurs ; parmi ces derniers :
• Eugène, Thomas, Elie (1851-1925) dit Pagène, cultivateur, a épousé Euphrosine Lecouvey ; ils ont eu deux enfants :
• Basile, Eugène (1874-1958), cultivateur, père de Louis, a laissé un très bon souvenir à Saint-Germain-des-Vaux (« C’était un bon bonhomme »). Il a épousé Marie, Louise, Virginie Boissel et portait, curieusement, l’« avernom », c’est à dire le surnom quasi-officiel, de « Bouessé », patronyme de son épouse en langage vernaculaire. Son fils Louis portera l’avernom de « Bouessé » comme son père, ou celui de « Basile », prénom de ce dernier.
• et Marie, Emélie, née en 1873, dite Marie Eugène, soeur de ce dernier, dont les enfants (cf. tableau généalogique) sont cités dans le cahier de Louis, actuellement possédé par ses petites filles.
Les Levallois ont vraisemblablement un niveau économique modeste. Jean-Baptiste, puis son fils Bazile, ont eu beaucoup d’enfants, dont certains sont obligés de choisir des professions de domestique, gendarme, douanier. Un autre indice est livré par la succession de Bazile, liquidée en 1882, qui porte sur une
Louis Levallois jeune adulte, en 1930 (collection privée).
1 Ancien conservateur Général du Patrimoine, membre du Groupe de Recherches Archéologiques du Cotentin.2 Président du Groupe de Recherches Archéologiques du Cotentin, Conseiller municipal de Saint-Germain-Vaux.3 Conseillère municipale de Saint-Germain-des-Vaux, cousine de Louis Levallois.
12
Jean Renet1580 -
Sieur de la Mare&Jeanne Lemaignen
Pierre Boissel&Jeanne Lecouvey
Jacques Boissel~1724 - 1801
cultivateur&Jeanne Catherine Grisel
Aimable François Lecouvey1790 -
cultivateur&Anne Euphrosine Lecouvey
Jacques Levallois&Marie Hubert
Jean Baptiste Levallois1779 - 1863
laboureur&Bonne Marguerite Revert
1784 - 1866
Bazile Baptiste Levallois1819 - 1870cultivateur
&Emilie Euphrosine Lecouvey1822 - 1859
Eugène Thomas Elise Levalloisdit « Pagine »1851 - 1925cultivateur
Marie Emilie Levalloisdie « Marie Eugène »
1873 - &Auguste Jean Baptiste
Arsène Levalloisdit « ???? »cultivateur
Euphrosine décédée en 1896Emilie décédée en 1898Louis décédé en 1902Joseph décédé en 1905
Louis François Eugène Levalloisdit « Louis Basile » ou
« Louis Bouessé »1904 - 1993cultivateur
sans descendance
Basile Eugène Levalloisdie « Bouessé »
1874 - 1958cultivateur
Aimable Thomas Lecouvey1828 -
cultivateur&Marie Elise Théodorine Groult
1829 - 1869
&Euphrosine Lecouvey1853 - 1916
Pierre François Boissel1765 - 1844
douanier&Marie Françoise Touzard
1774 -
Jean Pierre Boissel1812 - 1865
laboureur&Louise Soudain
1817 - 1877
Pierre François Boissel1849 - 1929cultivateur
Marie Louise Virginie Boissel1882 - 1979
&1900à Jobourg
Pierre Renet1620 -
Sieur de la Mare&Marguerite Aubrée
Guillaume Renett1656 - 1711
Sieur de la Mare - laboureur&Suzanne Marguerite De Mary
Michel Renett1711 -
&Marie Charlotte Vaultier1710 -
Jean-François Renet1743 - 1826
&Marie Françoise Fleury- 1800
Michel Renet1794 - 1866cultivateur
&Anne Marie Françoise Paris~1798 -
Pierre Basile Renet1825 - 1914cultivateur
&Marire Euphrosine Falaise1825 -
&Rose Augustine Mathilde Renet1859 -
L’ascendance de Louis Levallois (généalogie simplifiée en ligne directe).
13
Cahier Louis Levallois
maison avec jardin, une étable située à une centaine de mètres, et 5 parcelles de terre totalisant 2 ha 64 a 50 ca, soit un peu plus de 13 vergées. Eugène, grand-père de Louis, ne recueille pour sa part que 63 ares (un peu plus de 3 vergées), soit une partie d’une parcelle de 1 ha 4 a située au lieudit la Roquette. Or une superficie de 63 ares est insuffisante pour nourrir une seule vache.
Les Lecouvey
Euphrosine Lecouvey (1853 - 1916), grand-mère paternelle de Louis Levallois, était fille et petite-fille de cultivateurs. Les Lecouvey, qui sont également une vieille famille de Saint-Germain-des-Vaux (la Rue-de-Bas et le Bel-aux-Couvey), sont d’un niveau économique qui semble se situer dans la moyenne des cultivateurs de Saint-Germain-des-Vaux au XIXème siécle.
Les Boissel
Les Boissel sont une famille de Jobourg, dont il existe plusieurs branches. Celle à laquelle se rattache Louis Levallois a pu être remontée jusqu’à la fin du XVIIème siècle :
• Pierre.• Jacques (vers 1724-1801) a eu 4 enfants au moins, dont :• Pierre,François (1765-1844), douanier ; divers documents permettent de suivre sa carrière :- en 1806, lors de son mariage, il est dit « préposé aux douannes (sic) domicilié à Jobourg » ; - il est longtemps en fonction à Auderville (1809, 1812, 1814 : actes de naissance de ses enfants ; vers 1820 : ancien cadastre de Jobourg) ; - en 1835 (décès d’une de ses filles âgée de 21 ans, célibataire), il est dit laboureur, et en 1840 (décès de son autre fille, institutrice à Jobourg, âgée de 21 ans également, célibataire), il est dit « douane en retraite ».
Son frère Jean-Baptiste (1783-1864) et le fils de ce dernier, Bon, Augustin (1813-1882) étaient également douaniers. Jean-Baptiste était, vers 182O (ancien cadastre de Jobourg), « préposé à Saint-Germain-des-Vaux-des-Vaux ».
Le fait, à cette époque, de rentrer dans la fonction publique pour y occuper, de plus, des emplois plutôt subalternes, n’est pas un indice d’aisance, puisque l’honneur consiste dans le fait de reprendre l’exploitation familiale. Or Jean (1769-1807) était le seul des trois garçons à être laboureur; célibataire, il est mort sans descendance.
Pierre, François a eu trois enfants, deux filles, décédées jeunes et célibataires, et un seul garçon :
• Jean, Pierre (1812-1865), laboureur, a épousé Louise, Constance, Soudain (1817-1877) qui est décédée à Equeurdreville chez sa fille et son gendre, « charpentier au port militaire » de Cherbourg. Le couple a eu cinq enfants, dont un seul garçon atteindra l’âge adulte :
• Pierre, François (prénom usuel : François) (1849-1929), a épousé Rose, Augustine, Mathilde Renet (1858-1925). Le couple a eu, en 1880, une première fille, Marie, Louise, Virginie, qui n’a vécu que trois semaines. Une seconde fille, qui portait exactement les mêmes prénoms, ceux d’une tante qui devait être sa marraine,
est née en 1882 : c’était la mère de Louis Levallois, dont le prénom usuel était Louise et qui est décédée en 1979, à 98 ans. Il n’y a pas eu d’autres enfants.
Cette branche de l’ascendance de Louis Levallois a dû accéder à une certaine aisance, à partir de l’arrière grand-père de Louis, Jean-Pierre, fils de douanier, mais cultivateur, comme tous ses descendants de sexe masculin. Les décès en bas âge ou prématurés ont limité le nombre d’héritiers, ce qui a évité le morcellement de la propriété familiale. Ainsi, Jean-Pierre était héritier unique ; son fils, Pierre-François n’a eu que deux soeurs et la mère de Louis était fille unique. Mais, bien antérieurement, la famille Boissel a pu acquérir le manoir de la Boissellerie, ce qui n’est pas un indice de pauvreté.
Les Renet
La famille Renet est originaire d’Omonville-la-Petite, commune localement appelée Saint-Martin et limitrophe de Saint-Germain-des-Vaux-des-Vaux, où un hameau porte d’ailleurs son nom. Elle est mieux connue que les autres familles de l’ascendance de Louis Levallois, grâce aux recherches de Mme Hubert Agnès et grâce à des alliances avec des familles importantes, voire nobles. De lointains ancêtres ont même porté un nom de sieurie.
• Jean Renet, sieur de la Mare, né vers 1590.• Pierre, sieur de la Mare, né vers 1620. Selon Mme
Agnès, il rend aveu au roi, en 1668, dans son domaine royal de Valognes, pour des terres et des maisons sises au Hameau Renet.
• Guillaume, sieur de la Mare (1656-1711), laboureur, a épousé, en 1700, Suzanne Marguerite de Mary, fille de Pierre de Mary, écuyer, sieur de la Prairie, de la branche cadette des de Mary, famille de très ancienne noblesse qui possèdait la seigneurie de Jobourg depuis plus de 400 ans, et de Marguerite Simon de Lonprey (ou Longprey). Parmi les soeurs de cette dernière, on trouve la Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin et Suzanne, épouse de Louis Feuardent, écuyer, seigneur et patron d’Eculleville. La dot de Suzanne Marguerite de Mary était de 550 livres, auxquelles il faut ajouter des meubles, des vêtements et du linge estimés à 300 livres. Guillaume Renet a été inhumé dans l’église d’Omonville-la-Petite.
Françoise Renet, soeur de Guillaume, a épousé Jacques Falaize, sieur des Fontaines, tabellion, puis notaire royal à Omonville-la-Petite (Hameau des Guillemins-de-Haut).
Guillaume Renet et Suzanne de Mary ont eu cinq enfants, deux filles et trois garçons, dont :
• Michel, laboureur, né en 1711, qui a eu cinq fils, dont :• Jean, François (1743-1826), qui a eu au moins deux fils,
dont :• Michel (1794-1866), cultivateur, qui a eu au moins deux
fils, dont :• Pierre, Basile (1826-1914), cultivateur au Hameau
Renet, a épousé Marie, Euphrosine Falaize ; le couple a eu un garçon et trois filles, dont :
• Rose, Augustine, Mathilde (1859-1925) qui a épousé
14
Pierre François Boissel. Ils sont les parents d’une fille unique, Marie, Louise, Virginie Boissel, la mère de Louis Levallois.
Dans l’ascendance de Louis, la branche des Renet est sans doute celle dont le niveau économique est le plus élevé.
L’implantation géographique de la famille
Les parents de Louis Levallois ont deux implantations géographiques, deux maisons qu’ils ont héritées de leurs parents.
La Boissellerie
Du côté maternel (les Boissel), il s’agit de la Boissellerie, très belle propriété isolée à l’extrême nord de la commune de Jobourg, en fait un manoir. Son étude reste à faire. Une publication multigraphiée de la Société d’Archéologie de la Manche (« Architecture civile du canton de Beaumont-Hague. Récolement des édifices les plus intéressants », 1ère édition juillet 1978) indique laconiquement : « La Boissellerie (autrefois Le Haut Gallion : complexe ; murs é pais d’1 m ;
souches du 16è s.; aux Le Jouinel ; aux Boissel de 1701 à nos jours ». Dans son ouvrage d’architecture sur les « Trésors de la Hague » (Isoète, Cherbourg-Octeville, 2003, p. 168), Guillaume de Monfreid donne de la Boissellerie la description suivante : « manoir XIVè s. . Les deux ailes sont un rajout, l’aile nord étant la plus récente. La disposition des fenêtres dans chacune des façades respecte des ordonnances et des symétries partielles pas encore classiques, qui la rapprochent de l’architecture rurale Renaissance, ce qu’accentuent les fenêtres à meneau et traverse. Ici encore, des arcs de décharge soulagent des linteaux en plein cintre chanfreiné ». Dans sa thèse de l’Ecole des Chartes sur les noms de lieu du canton de Beaumont-Hague, Françoise Girard précise que les Boissel ont acquis la propriété en 1701.
Sur le cadastre napoléonien, La Boissellerie est le nom porté par une parcelle, un jardin (avec une boulangerie ?) (A1, 48), et par une maison avec cour (A1, 48bis). A l’exclusion de la parcelle, le propriétaire est Baptiste (en fait, Jean-Baptiste) Boissel, douanier. Ces bâtiments ne semblent plus exister.
Les autres bâtiments situés au même endroit portent curieusement le nom de la Haye. Il s’agit d’une masure avec cour (A1, 47) appartenant à Pierre Lenepveu, cultivateur à Saint-Germain-des-Vaux, qui ne semble plus exister non plus, d’une maison avec cour et masure (A1, 49) appartenant à Pierre Boissel, et d’une autre maison avec cour (A1, 50) appartenant à Baptiste Boissel. Les deux frères Boissel, Jean-Baptiste et Pierre, possèdent donc la maison que l’on voit aujourd’hui. L’appellation de la Haye est d’autant plus surprenante qu’un village très proche et totalement disparu porte ce nom. Il comportait, vers 1820, une boulangerie et trois maisons avec cour et dépendances appartenant à deux familles Boivin, cultivateurs à Vasteville, ce qui pourrait expliquer l’abandon et la ruine du hameau. La publication de la Société d’Archéologie de la Manche déjà citée signale des « ruines du manoir de la Haye (autrefois Hameau aux Jouinel) : aux Lucas de Bonval », famille noble mentionnée dans les recherches de noblesse (1666, p. 424 : sieur de la Noë). Le chemin d’accès à ce hameau est encore lisible dans le paysage et les quelques pans de murs ruinés encore visibles correspondent aux propriétés des familles Boivin, mais il n’y a plus, semble-t-il, aucune trace du manoir des Lucas de Bonval.
La Boissellerie, façade avant (cliché Martine Fosse). La Boissellerie, façade arrière (cliché Martine Fosse).
Les parents de Louis Levallois avec deux voisins : Bon Ladvenu et Jean-Baptiste Lecouvey (archives Louis Levallois, collection particulière).
15
Cahier Louis Levallois
On ignore comment la propriété de Jean-Baptiste Boissel est passée aux descendants de Pierre François Boissel, qui ont finalement possédé l’ensemble de la Boissellerie. Le fils unique de Jean-Baptiste, Bon Augustin (1813-1882), douanier comme son père et son oncle, est mort en 1882 à la Boissellerie. Il avait eu quatre filles dont aucune ne s’était apparemment fixée à Jobourg lors de son mariage. La propriété a pu être vendue à cette époque et ainsi réunifiée.
La maison de la Rue-de-Bas
Du côté paternel (les Levallois), la maison de la Rue-de-Bas à Saint-Germain-des-Vaux-des-Vaux a une apparence plus modeste. Il s’agit d’un vaste bâtiment comportant une grande maison, issue de la réunification de deux maisons, et
des dépendances, au milieu d’une cour fermée. L’ensemble, bien adapté à la fonction d’exploitation agricole, est typique du XIXème siècle. . Un bâtiment figure sur le cadastre napoléonien et même sur un plan de 1771, sans que l’on ne puisse savoir s’il s’agit d’un bâtiment antérieur qui n’existe plus ou du même bâtiment transformé ultérieurement. Il est certain qu’il ne s’agit pas de la maison natale d’Eugène Thomas Elie Levallois, le grand-père de Louis, qui est né en 1851, dans une autre maison, identifiée, de la Rue-de-Bas. Elle est donc sans doute arrivée dans le patrimoine des Levallois postérieurement à cette date, par mariage ou par acquisition. L’ensemble actuel est sans caractère particulier, mais il présente l’avantage, qui comptera beaucoup pour la mère de Louis Levallois, de se trouver au sein d’un village très populeux.
LE CAHIER DE LOUIS LEVALLOIS
Le document
Le document est un cahier de petit format (17 x 22 cm), avec une couverture légèrement cartonnée, de couleur bleutée, comportant une représentation du petit port de Saint-Germain-des-Vaux-des-Vaux (éd. Alex Becquemin), traditionnellement appelé « Le Pont » et plus récemment « Port-Racine », ce qui est déjà le cas ici. Au-dessus de cette représentation, figure la mention « Cherbourg et La Hague illustrés ». Ses 100 pages sont quadrillées en petits carreaux 5x5 (il ne s’agit donc pas de carreaux de type « écolier »), avec une marge blanche à gauche, isolée par un trait rouge de la partie quadrillée.
Le cahier a été tenu année par année. Il a été rédigé de manière « télégraphique », très brève, voire très sèche. Les phrases n’ont, en grande majorité, pas de verbe et les informations tiennent, pour la plupart, sur une ligne ou deux lignes au maximum. Les adjectifs sont rares, le style est strictement informatif et sa neutralité ne laisse en rien apparaître le sentiment du rédacteur. Quelques informations sont plus longues (trois ou quatre lignes), rédigées avec des verbes et des adjectifs ; ce sont le plus souvent celles qui ont trait à la religion et qui révèlent ainsi l’un des traits majeurs de la personnalité de Louis Levallois. Il n’y a pas un seul mot de langage vernaculaire, alors que Louis Levallois appartient à une génération qui, de manière courante, parlait le patois de la Hague (le normand). La langue française est bien maîtrisée, sans aucune faute d’orthographe. L’écriture est sûre, régulière, harmonieuse, mais sans pleins et déliés. Seule, la ponctuation et les majuscules sont parfois un peu aléatoires ou absentes, mais cela peut être lié au style « télégraphique ».
La première page porte le titre suivant : « Origine 1904 à 1909 ». Louis Levallois a donc, plus ou moins longtemps après, noté les évènements qui concernaient sa petite enfance. Le cahier est ensuite tenu annuellement, avec un nombre limité d’informations jusqu’en 1918 (entre deux et six par an, exceptionnellement, une fois neuf). A partir de 1919, les informations sont plus nombreuses (entre cinq et vingt-deux par an), mais elles tiennent presque toujours sur une page. On peut donc estimer que Louis Levallois a commencé à rédiger régulièrement son cahier à partir de 1919 - il avait alors 15 ans -, et qu’à cette date, il a noté, à l’année près, les évènements qui lui avaient paru les plus marquants entre 1910 et 1918 et
dont il se souvenait. Le cahier s’arrête en 1959, année d’élections municipales. Il ne comporte plus, après cette date, que les résultats des élections municipales de 1965, 1971 et 1977. Une cinquantaine de pages ont donc été utilisées.
Le contenu du cahier
Toutes les informations, sans exception, figurant dans le cahier ont été regroupées par thèmes qui sont développés dans la suite de cette étude. Ce choix de l’exhaustivité peut entraîner quelques énumérations un peu fastidieuses, mais, outre leur caractère très parcellaire qui rend une synthèse difficile à établir, il nous a semblé que le fait d’opérer des choix, nécessairement plus ou moins aléatoires, était susceptible d’altérer la nature du document, telle que son rédacteur l’a voulue.
La vie privée et familiale
Les étapes de l’enfance
Louis Levallois rentre à l’école de Jobourg à Pâques 1910, soit à 5 ans, ce qui est l’âge normal à l’époque, et « assiste » au catéchisme la même année, ce qui est très tôt. Le déménagement de la Boissellerie à la Rue-de-Bas entraîne la fréquentation de l’école de Saint-Germain-des-Vaux en 1911 et l’« entrée » au catéchisme dans la même commune l’année suivante, soit à 7 ans, ce qui est l’âge normal. Les noms, les maladies, parfois le décès des instituteurs et des curés sont indiqués. Louis prend l’habit d’enfant de choeur, selon sa propre formule, en 1914, qui est également l’année de sa « première communion privée ». Avec une certaine fierté, du reste légitime, il indique, pour l’année 1916, « premier de l’école et premier du catéchisme ». Cette même année, Louis fait sa communion solennelle le 11 juin, passe le certificat d’études primaires à Beaumont, le chef-lieu de canton, le 19 juin, et reçoit le sacrement de confirmation le même jour à Biville (s’agit-il d’une erreur de date ?). Cela achève la première étape de sa vie, l’enfance, et, après avoir satisfait à tous ces rites de passage, il peut indiquer « abandon de l’école et du catéchisme » et « apprentissage du métier de cultivateur ». Les premières pages du cahier ont été écrites longtemps après et il est normal que l’on y retrouve ce qui va être omniprésent dans la suite du cahier : la religion ; ainsi, l’absence de communion solennelle en 1915 est-elle indiquée, alors qu’elle ne le concerne pas.
16
Vers l’âge adulte : l’adolescence
Louis Levallois n’aborde pas ses débuts dans l’agriculture. L’initiation a dû se faire dès l’enfance, « sur le tas » dans la ferme familiale. L’immersion a dû être accélérée par l’absence du père pendant la Première Guerre Mondiale. Il est seulement indiqué, pour 1917, « première année de travail aux batteries ». Les batteries ont toujours eu une certaine importance dans le calendrier agricole. Faites au fléau vers le mois de septembre, elles réunissaient beaucoup de monde ; elles étaient donc des occasions de convivialité au sein du village et se terminaient par un repas copieux et bien arrosé. Il s’agit sans doute là du souvenir d’une époque où l’agriculture visait à produire du blé pour faire le pain qui était, avec les pommes de terre et les autres légumes du jardin, la base de l’alimentation, alors qu’en 1917, la Hague avait opté, depuis quelques décennies déjà, pour la production laitière de manière quasi-exclusive.
En 1921, à la Toussaint précisément, Louis note « 1ère barbe faite » en précisant même la marque du rasoir (« Le Barbec »), et, en 1925, « âge d’électeur - premier vote à l’occasion des élections municipales » : il est vraiment adulte.
Problèmes de santé
On apprend une paralysie du bras gauche qui survient en 1912. Cette paralysie explique sans doute la posture un peu particulière que Louis a eue toute sa vie. Ce handicap a dû le gêner dans l’exercice d’un métier manuel, mais il ne l’évoque plus une seule fois ensuite dans le cahier. Cette paralysie ne devait pas être totale, car Louis a trait des vaches, ce qui suppose l’usage des deux mains.
En 1927, Louis mentionne sobrement : « dentier ». La pose d’une prothèse dentaire à 22 ans n’était pas un fait rare dans la Hague où l’absence de soins dentaires rendait nécessaire le recours à cette solution radicale de manière prématurée. La mention, en 1948, « Dentelure Dentol Dentifrice par Delaunay » semble concerner cette prothèse dentaire.
Les domiciles familiaux
Le cahier montre les hésitations familiales entre le manoir de la Boissellerie à Jobourg et la maison de la Rue-de-Bas à Saint-Germain-des-Vaux-des-Vaux. Elle réside :
• de 1904 à 1911 à la Boissellerie, ce qui est vraisemblablement le cas depuis le mariage des parents de Louis en 1900 ; c’est donc à Jobourg que Louis est né et a commencé l’école et le catéchisme ;
• de 1911 à 1925, à la Rue-de-Bas ;• de 1925 à 1929, à nouveau à la Boissellerie ;• enfin, à partir de 1929 et de manière définitive, à
La Rue-de-Bas, où les parents de Louis et lui-même décèderont ; ils sont inhumés ensemble dans le cimetière de Saint-Germain-des-Vaux.
La Boissellerie est une belle et spacieuse demeure, avec des dépendances, dans une vaste cour. L’ensemble se prêtait bien, à l’époque, à une utilisation comme exploitation agricole. La Rue-de-Bas n’a pas, loin s’en faut, la même allure, le même cachet, et n’offre pas les mêmes potentialités pour pratiquer l’agriculture. Mais on sait que la mère de Louis n’aimait pas la solitude de la Boissellerie et appréciait au contraire la vie en village qu’offrait
la Rue-de-Bas. Mais le cahier est muet sur les raisons qui ont poussé la famille à retourner à la Boissellerie de 1925 à 1929. Après 1929, la famille a conservé la Boissellerie, pratiquement sans l’utiliser et sans la louer, ce qu’une relative aisance lui a permis.
Les évènements familiaux : décès, quelques parents et amis, guerres
Les décès des ascendants sont notés dans le cahier : Pierre Renet, arrière grand-père, en 1914, à 89 ans ; Mme Eugène Levallois, née Euphrosine Lecouvey, grand-mère paternelle et marraine, en 1916 ; Mme François Boissel, née Rose Renet, grand-mère maternelle, en 1925 ; Eugène Levallois, grand-père paternel, en 1925 également ; François Boissel, grand-père maternel et parrain en 1929. Il était assez rare à cette époque de connaître l’un de ses arrière grand-parents et ses quatre grand-parents. Traditionnellement, les parrain et marraine étaient choisis parmi ces derniers et donnaient souvent à l’enfant leur propre prénom (dans le cas de Louis, ses deuxième et troisième prénoms) ; leur rôle est en principe strictement religieux, ce qui devait revêtir une certaine importance pour Louis qui le précise dans le cahier.
Le décès du père en 1958 est plus détaillé puisque sont indiqués le jour de l’extrême onction, le jour du décès, le jour de l’inhumation et la pose, en 1959, d’un monument funéraire en granit poli de Vire. La mère de Louis et Louis lui-même reposeront dans la même sépulture.
En dehors des membres de la famille, peu de personnes sont citées dans le cahier. Quelques cousins, voisins et amis apparaissent au fil des pages à l’occasion d’achat de matériel agricole, de mariages et d’excursions ; ils seront mentionnés dans les parties consacrées à ces thèmes. On remarque cependant les mentions suivantes :
• en 1948, « du 21 au 30 août, séjour de Louis Morange et Alice après une absence au pays de 13 ans » ; Louis Morange tenait un commerce de grossiste en charbon et matériaux à Menton. Le choix du Midi de la France s’explique par la santé fragile d’Alice. Leur fils Louis venait en vacances à Saint-Germain-des-Vaux. Louis Levallois revoit Louis Morange le 6 juin 1957.
• en 1957 également, Louis indique la « visite du cousin Raymond Legendre de Bréhal ».
• en 1937, un voisin, Jean Ricard, se marie.• en 1925, Louis mentionne « l’assassinat de Madame
Isabelle Levallois » qui était réputée riche et qui habitait aussi le village de la Rue-de-Bas ; les auteurs de ce meurtre n’ont jamais été identifiés.
Les deux guerres mondiales ont concerné la famille de Louis. C’est la raison pour laquelle elles apparaissent dans le cahier qui, par ailleurs, fait une impasse totale sur les évènements politiques. En 1914, son père, âgé de 41 ans, part, pour ne revenir qu’en 1919. Ce retour donne lieu à deux mentions d’un genre très rare dans le cahier : « victoire et gloire des armées alliées » (1918) et « joie intense » pour le « retour du père au pays » (1919).
C’est Louis lui-même qui est concerné par le deuxième conflit mondial. Il passe, le 23 janvier 1940, devant la
17
Cahier Louis Levallois
commission de réforme et il est « classé service auxiliaire ». Il est appelé à Issoudun (Indre) le 17 avril et, réformé, revient à Saint-Germain-des-Vaux le 24 mai ; on ignore ce qui s’est passé entre ces deux dates, pendant un peu plus d’un mois. Les Allemands arrivent le 18 juin et Louis, pourtant conseiller municipal depuis 1935, ne mentionne pas la démission consécutive du maire, Eugène Digard. Un officier allemand occupe la salle à manger de la maison de la Rue-de-Bas, « transformée en chambre à coucher », d’avril 1941 à mai 1942. Les meubles de cette salle sont transportés en juin 1941 chez Eugène Morange, « chef de gendarmerie à Montebourg ». La Boissellerie est également occupée par les Allemands qui la quittent le 1er janvier 1943 et « n’y reviennent que pour la dévaster ». A la maison de la Rue-de-Bas, les dégâts sont limités et les « ruches à abeille sont en majeure partie détruites » : la guerre aurait pu être pire.
L’équipement personnel et familial, les moyens de locomotion.
Louis Levallois signale l’acquisition de certains équipements, dont certains apparaissent tôt dans le contexte de la Hague : une lampe électrique et un briquet à essence en 1917 ; un lit en fer chez Samson, rue des Carrières, Cherbourg, en 1923 ; un thermomètre en 1926 ; un appareil photographique Studio-Plait en 1933 ; un réveil Japy bleu, à Beaumont, chez Pierre Ecolivet, en 1946 ; un rasoir Gilette en métal en 1950 et, l’année suivante, un rasoir électrique Philishave.
Louis Levallois n’était pas chasseur et les armes achetées ont été utilisées par son père qui, lui, l’était : « une canardière à 2 coups - calibre 12 - long; 1m » en 1928 et « un fusil Verney Canon - prix 33.000 » en 1948.
Les moyens de locomotion successifs occupent une place certaine dans le cahier. En 1919, Louis mentionne l’ « apprentissage à bicyclette sous la conduite d’Eugène Morange ». La même année, une bicyclette est achetée à Cherbourg. En 1922, une autre bicyclette de marque Stella, dont le coût est de 500 francs, est achetée à Cherbourg. En 1927, une bicyclette Hirondelle est commandée à la Manufacture de Saint-Etienne. En 1933, le « vieux vélo » (lequel ?) bénéficie d’une « électrification ». En 1933, la bicyclette Hirondelle est peinte en « bleu français », remise à neuf et des pièces usagées sont remplacées. En 1951, elle est munie de l’éclairage « Soubitez ». Tous ces détails témoignent de l’importance, pour Louis Levallois, de ces bicyclettes qui constituent un équipement sans doute encore peu courant à cette époque. Cet équipement a permis à Louis, qui était incontestablement bon cycliste, de faire de nombreux déplacements, et même de véritables excursions, parfois lointaines. La bicyclette n’apparaît plus après 1951, car elle est remplacée en 1952 par un cyclomoteur de marque La Française-Diamant acheté chez Troude à Beaumont.
Mais la voiture arrive très vite, dès 1955, c’est à dire à une époque où cet équipement est encore loin d’être d’un usage courant. Le 22 février, c’est « la première leçon d’auto-école de M. Marc Margueritte de Cherbourg ». Dès le 21 avril, la voiture est achetée ; il s’agit d’une « Bréahe Renault : 475 000 francs, occasion livrée par Lesort, garagiste à Cherbourg, en provenance de chez Lucien Valognes à Digosville ». Elle arrive le 9 mai, elle est « à l’état absolument neuf ». Mais Louis Levallois n’a pas encore le permis de conduire, et il fait trois
déplacements à Valognes, le 19 août, le 23 septembre et 28 octobre, pour l’obtenir, ce qui tendrait à montrer que le fameux permis a nécessité trois tentatives. Louis Levallois était un des très rares hommes de sa génération à avoir une automobile, mais il n’a jamais été un bon conducteur. Contracté au volant, il roulait très lentement et ne faisait que des déplacements locaux. Paradoxalement, il est allé moins loin avec sa voiture qu’avec sa bicyclette. La voiture était essentiellement utilisée pour aller aux offices religieux, auxquels il emmenait quelques voisines âgées ou handicapées.
Livres, journaux et revues
Louis Levallois et, avant lui, ses parents ont acquis plusieurs ouvrages, notamment des dictionnaires : les sciences naturelles de A. Brémont (1916), le Petit Larousse illustré (1918), le Mémento Larousse et le Mémento Agricole Larousse (1923), le Larousse universel (1930), la « Sainte Bible » (1934). Avant la deuxième Guerre Mondiale, peu de maisons de Saint-Germain-des-Vaux avaient une telle « bibliothèque ». Louis Levallois avait un esprit curieux et avait une certaine culture.
Le cahier signale plusieurs abonnements : Le Chasseur Français (1924) ; l’Echo de Paris (1925), puis Ouest-Eclair (1927), puis Ouest-France (1947) ; la Victoire du Dimanche (1926), puis la Croix du Dimanche (1946), et l’on sait par la famille que l’Almanach de la Manche était acheté chaque année.
Outre les dictionnaires (dès 1918) et les quotidiens (dès 1925), les thèmes concernés sont les sciences naturelles, l’agriculture, la chasse, la religion.
L’aménagement des maisons et des dépendances
De nombreux travaux, qui concernent toutes les propriétés bâties de Louis Levallois, sont mentionnés dans le cahier.
La maison de la Rue-de-Bas.
Maison principale et siège de l’exploitation agricole (sauf de 1925 à 1929), c’est elle qui apparaît le plus.
En 1909, la maison est couverte en ardoises par Cosnefroy, artisan local. On n’a aucune indication sur le matériau que l’ardoise remplace : la pierre ou, plus vraisemblablement, le chaume ? En tout état de cause, l’ardoise est un matériau peu utilisé au début du XXème siècle. Les façades de la maison font l’objet de travaux en 1912 (joints), 1929 (« granitage », c’est à dire regrettable enduit de ciment, et pose de gouttières), 1930 (pose de persiennes), et 1932 (pose de gouttières côté jardin). Des travaux intérieurs ne sont mentionnés que deux fois (peinture en 1930 et peinture de la salle à manger en 1931). L’électricité est installée dès 1931 (« 15 octobre : l’électricité arrive à la maison ! »), un nouveau compteur à bloc est posé en 1942.
La cour fermée fait l’objet de plantations d’arbres (orme et frêne) en 1919. Une barrière en fer est installée en 1929, alors que les barrières de cour sont alors toutes en bois. Le mur de clôture est enduit en 1954. Un puits est foré et une pompe est installée en 1929, ce qui est d’avant-garde. Ce puits est approfondi en 1949 et, l’année suivante, la pompe est remise en route par E. Quoniam, mécanicien à Danneville, autre hameau de Saint-Germain-des-Vaux (« Désormais, on pompe de
18
dessous le hangar », c’est à dire à l’abri des intempéries).
De nouveaux bâtiments d’exploitation sont construits : une remise au pignon des étables et une écurie en face (1912), un hangar à porcs, lapins etc... (1929) dont la couverture en tôles est remplacée par une couverture en tuiles (1953), et la remise située dans le jardin est prolongée (1929). La couverture des étables, côté rue, est refaite par Louis Cauchon, maçon à Digulleville (1955).
De nombreux aménagements plus modestes sont mentionnés : un lavoir près de l’écurie (1913), ouverture d’une lucarne sur le grand fenil à fourrage (1921), une fosse à purin de 5320 litres, un pressoir, une auge à cidre, une aire en béton, une cloison en planches fermant l’atelier, une canalisation pour le purin et l’eau du lavoir, ouverture d’une porte au fond du cellier (1929), un mur de garniture en béton à la fosse à fumier, transformation de l’ancienne écurie en buanderie par la construction d’une cheminée et d’une aire en béton (1930), une auge en ciment (1936). En 1922, les « perches du grand fenil » ont été refaites ; parfois, l’étage des dépendances agricoles, sous la toiture, destiné à stocker le foin, ne comportait pas de véritable plancher, mais des « perches », c’est à dire branches et/ou des fragments de bois de récupération (bois d’épave souvent) qui constituaient une sorte de plancher, plus ou moins à claire voie. Ces informations témoignent d’une volonté de regrouper au même endroit toutes les activités de la ferme, alors que souvent maison d’habitation et bâtiments d’exploitation sont dispersés dans le hameau, et d’une volonté d’autarcie avec le lavoir, la buanderie, le puit qui dispensent d’utiliser les équipements collectifs (le lavoir, le puit ou la fontaine). De la même manière, le pressoir est privé, mais il est peut être utilisé par plusieurs familles. Certains équipements sont d’avant-garde (pompe en 1929). Il s’agit incontestablement, pour l’entre deux guerres, d’une exploitation d’une certaine importance. On constate également un goût très net pour le béton ; sont en effet successivement bétonnés : la façade de la maison d’habitation qui est « granitée », les étables à vaches et à porcs, le pressoir (1929), la buanderie installée dans l’ancienne écurie, l’étable aux veaux, le hangar aux lapins, la niche du chien (1930). A cette époque, toutes les maisons sont en pierres apparentes et les dépendances agricoles ont à peu près partout des aires en terre. On constate enfin que beaucoup de ces travaux ont été réalisés en 1929, année de la réinstallation, cette fois définitive, à La Rue-de-Bas, et en 1930.
« La maison à Adélaïde »
Cette maison est achetée en 1919 pour un prix de 4000 francs, « y compris je jardin de la Citadelle », situé dans la Rue Joignet, à environ 200 m de la maison de la Rue-de-Bas. Il s’agit de la maison contigüe à cette dernière, située dans la même cour. Un plancher est posé dans le fenil de la grange (1920), la « côtière avant (...) est refaite ; celles de la grange exhaussées, et le tout couvert en ardoises » (1925), ce qui permet d’homogénéiser la couverture des deux maisons contigües. En 1929, lors du retour définitif de la famille à la Rue-de-Bas, la maison à Adélaïde fait l’objet d’« une réfection intérieure complète » et des portes de communication entre les deux maisons, qui n’en forment désormais plus qu’une, sont pratiquées. « La maison à Adélaïde » devient la salle à manger
dont les meubles sont achetés en 1931. Précisons que cette Adélaïde n’a pu pour l’instant être identifiée.
La Boissellerie
Maison ancestrale de la mère de Louis Levallois, cette ferme, véritable petit manoir, ne nécessite pas les mêmes travaux que celle de la Rue-de-Bas, d’autant qu’elle n’est plus habitée à partir de 1929. Entre 1904 et 1909, la partie étable de la maison (c’est à dire le rez-de-chaussée accessible par la seule façade avant, le 1er étage se trouvant au niveau du sol sur la façade arrière) est transformée en cuisine. La cour est agrandie en 1934, la chasse (le chemin) d’accès est encaissée avec du « tuf alcalin » (en fait du « tu », terme vernaculaire qui désigne du granit altéré et décomposé), et deux arbres sont plantés en 1947. En 1951, le « versant ouest de l’étable du haut de la chasse » est recouvert. En 1955, les frères Malard, menuisiers à Saint-Germain-des-Vaux, entreprennent la remise en état de la maison consécutivement aux dégâts provoqués par son occupation par l’armée allemande. Au total, c’est peu comparativement à la Rue-de-Bas où il a fallu réunir deux anciennes maisons, celle des Levallois et celle d’Adélaïde, et aménager les dépendances et la cour, afin d’y installer, beaucoup plus à l’étroit qu’à la Boissellerie, une exploitation agricole.
La maison de Julie Digard.
En 1936, Louis Levallois note : « Achat de la maison à Julie Digard (Luce) ». Cette maison est également située dans le village de la Rue-de-Bas, presque en face de la ferme familiale. L’occupante était Charlotte Françoise Julie Digard dite Luce (1856-1942), fille de Joseph Philippe Digard dit Luce (1818-1887), célèbre fraudeur de Saint-Germain-des-Vaux ; elle était veuve de Constant Auguste Digard dit Pays, qui avait été employé à l’octroi de Cherbourg. A la page de l’année 1942, Louis Levallois signale le décès de Julie Digard-Luce, « usufruitière de ma maison ». Cette dernière a été alors louée à Alphonse Cauvin, ouvrier agricole qui a notamment travaillé chez Louis Levallois. Les seuls travaux indiqués sont l’ouverture d’une porte cochère « dans la vieille maison à Julie pour former garage auto » (1955).
La maison des Levallois et la maison à Adélaïde à la rue de Bas. (Cliché Jean-Marc Yvon).
19
Cahier Louis Levallois
L’« étable » du Jogard.
Enfin, Louis Levallois possédait également une étable au Jogard, à l’extrêmité ouest du village de la Rue-de-Bas, à moins de 100 m de la ferme. On ne sait comment ce petit bâtiment est arrivé dans le patrimoine des Levallois. Cette étable est recouverte en tuiles, entre 1904 et 1909, les tuiles remplaçant vraisemblablement du chaume, et une écurie y est installée en 1929.
Les champs
De nombreuses parcelles sont citées dans le cahier de 1904-1909 à 1949.
Le patrimoine foncier de la famille Levallois s’accroît très nettement durant cette période, puisque sont acquis : un passage à Grénéquet, un petit jardin à la Boissellerie, ce qui permet, vraisemblablement, une plus grande cohérence foncière et culturale, et, surtout, six parcelles entre 1922 et 1935, dont quatre pour cette seule dernière année : la Valette, le Champ-Fleuri, le Clos-Colette, la Petite-Vallée, le Val-au-Bec, les Capelles. Les noms des vendeurs sont parfois indiqués. Ces acquisitions témoignent d’une certaine aisance de la famille Levallois qui développe ainsi son exploitation. Aucune acquisition n’est mentionnée après 1935 ; Basile Levallois, le père de Louis, a alors 63 ans, Louis, 31 ans, semble se diriger
résolument vers le célibat, et l’exploitation doit être considérée comme d’une taille suffisante.
Dans le même but, des landes sont défrichées : le Valet, la Lande- Villeneuve, la Lande- Pointue, la Lande- aux- Petiots.
De nombreux travaux sont indiqués ; ils concernent :• les clôtures : construction de murs (Grénéquet,
le Jardin-à-Murs, le Clos-Colette, la Citadelle) ; plantation de haies (la Citadelle), de peupliers (la Vallée) ; démolition de talus (« au milieu de la vallée », Villeneuve).
• la maîtrise de l’eau : construction de fossés (les Champs- de-Bas), canalisation de ruisseau par busage (la Capelle).
• les abreuvoirs : des abreuvoirs sont construits à Gué-de-Poutre, aux Champs-de-Bas(entre 1904 et 1909, réfection en 1933), au Valet, à la Lande-aux-Petiots, à la Valette et au Clos-Colette ; dans ces deux dernières parcelles, il est précisé qu’il s’agit d’abreuvoirs en béton construits en 1932 et 1935.
• les barrières : construction de « potilles », également en béton, au Valet et à la Petite-Capelle en 1949. Les « potilles », qui étaient traditionnellement en pierre (granit), sont les deux éléments sur lesquels sont montées les barrières.
• les « frotteurs » (« frotteux » en langage vernaculaire) : six, en ciment armé », sont érigés en 1932 (parcelles non précisées). Les frotteux sont plantés au centre des herbages entourés de pierres sèches, pour permettre aux animaux (bovins) de se frotter en évitant de le faire sur les murs qui ainsi s’effondreraient.
Comme pour les travaux aux bâtiments de la ferme, on observe dans les aménagements réalisés dans les parcelles une utilisation du béton dès les années 1930. Après l’année 1949, aucune mention ne concerne les champs.
Le matériel
De nombreuses acquisitions de matériel, améliorations, réparations, révisions... figurent dans le cahier, de 1911 à 1957.
Matériel pour la fenaison
La récolte du foin, en juin-juillet, est une activité fondamentale du cycle agricole dans une région essentiellement vouée à l’élevage des vaches laitières, puisque le foin est la nourriture principale de ces animaux en hiver.
Une première faucheuse « Mac Cornike » est achetée chez Troude à Beaumont dès 1923, puis une autre faucheuse Royal Bamford en 1927. Elles sont vendues en 1932 et remplacées la même année par une faucheuse à moteur Massey-Hanis (moteur Bernard). C’est sans doute une grande première à Saint-Germain-des-Vaux, car Louis Levallois précise que « la mise au point est faite par l’ingénieur en chef de la société, l’agent général pour la vente en France, le chef de la maison de vente de Nantes ». La même faucheuse reçoit une nouvelle chaîne en 1948 et subit des réparations (porte-lame, moteur notamment) en 1949. La même faucheuse était utilisée pour la coupe du foin et pour celle des céréales.
L’étable du Jogard (la propriété de Louis Levallois ne comprenait que la partie droite, sans fenêtre et sans cheminée) (cliché Martine Fosse).
La maison de Julie Digard à la rue de Bas. (Cliché Jean-Marc Yvon).
20
Un rateau et une faneuse Deesing sont achetés en 1926, une botteleuse Dollé en 1954, chez Chauvin à Gréville (mise en route par Troude), une presse ramasseuse Rivierre-Casalis chez Troude en 1957. Pour le transport du foin, une voiture fourragère est acquise en 1926.
Ces acquisitions témoignent d’un esprit novateur et d’une volonté de mécaniser la récolte des foins qui constituent une importante corvée. Mais cela représente un investissement assez lourd pour une utilisation somme toute assez brève (quelques jours, tout au plus quelques semaines, par an et par exploitation), et le souci de rentabilisation conduit à des achats en commun : la première faucheuse avec Charles Digard-Hilaric, voisin de Louis Levallois, la botteleuse avec Michel Levallois, cousin, et la presse ramasseuse avec Joseph et Michel Levallois, cousins.
Matériel pour le lait
En 1949, le cahier indique la mise en service de deux bidons en almasilium de marque Maisonneuve. Ce nombre peu élevé de bidons est révélateur de l’importance moyenne de la ferme (cinq ou six vaches environ).
Matériel pour les labours
Une charrue Brabant Dollé est acquise en 1930. Le cahier ne mentionne pas l’achat d’une moissonneuse-batteuse, ce qui s’explique sans doute par la faible superficie consacrée aux céréales.
Matériel pour le cidre
Dans une région qui, jusqu’aux années 1960, vit en quasi-autarcie, on consomme quotidiennement une boisson fabriquée sur place, le cidre, et on en consomme parfois beaucoup. Mais la pointe de la Hague produit des pommes en quantité insuffisante et de qualité moyenne, d’où la nécessité de mélanger la production locale avec des pommes venues d’ailleurs, le bocage de Valognes-Bricquebec, à quelques dizaines de km. Parfois, c’est le cidre même qui est acheté dans cette région : ainsi en 1957 au Vrétot, mais le fait que cette mention ne figure qu’une fois dans le cahier pourrait indiquer le caractère exceptionnel de cet achat de cidre, et non de pommes. De toutes manières, on fait du cidre chez les Levallois : en 1925, un pressoir Garnier est acheté sans sa vis et le moulin à pommes est motorisé dès 1932.
Moyens de transport et de déplacement
Pour le transport des personnes et de denrées ou d’objets peu pondéreux et peu encombrants, on utilise la carriole et la voiture. Une carriole est acquise en 1912, elle est bachée en 1926, ce qui permet de s’abriter des intempéries. « Une voiture et un attelage approprié » sont achetés en 1925. Une carriole à roues caoutchoutées est achetée lors d’une vente publique à Nouainville en 1954.
Pour le transport des pondéreux, on utilise le tombereau ou le banneau. Un tombereau est acheté en 1911. Un corps de banneau neuf est construit par les frères Malard, artisans menuisiers établis dans le même village, en 1942 ; il est muni de roues neuves en 1944.
Enfin, pour les transports peu volumineux sur de coutes
distances, le cahier, qui s’attache parfois à de petits détails, signale l’achat d’une roue de brouette, de marque Increvable Baudou, chez Troude à Beaumont, pour 3 680 francs, et l’essai de la brouette neuve le 20 décembre 1948 !
Matériel pour les animaux
Une clôture électrique, de marque Clot Seul, est achetée chez Louis Fafin, le quincaillier local, en 1957, à une époque donc où ce type de matériel n’était pas encore d’usage courant.
Enfin, même avant les réglementations européennes, il fallait bien gérer les déjections animales, et, outre les aménagements, déjà mentionnés, destinés à stocker et évacuer le purin, le cahier signale la mise en service d’une pompe à purin neuve en 1946, et la mise sur roues du tonneau à purin en 1947.
Les animaux.
Les chevaux
Treize équidés sont nominalement cités dans le cahier : un cheval blanc nommé Poulo ; dix juments nommées Castille, Madeleine, La Petite (de couleur noire), Finette (noire), Caprice, Moussette (blanche), Bijou (blonde), Capiste, Roquette (gris pommelé), Perdrix ; un âne Octave ; un poney Pompon.
Les chevaux se succèdent à un rythme élevé et il ne semble pas y en avoir deux simultanément. Ils passent en effet entre un et six ans à la ferme, avec deux exceptions notables : Finette, achetée en 1926 et réquisitionnée en 1939 (13 ans), et le poney Pompon, acheté en 1929 et qui part en 1954 - on ne sait où-, après avoir passé 25 ans dans la ferme. Mais La Petite est achetée en 1925 et vendue en 1926, Bijou est achetée en 1945 et vendue en 1948. Cet état de fait est assez surprenant dans la mesure où un cheval peut travailler jusqu’à l’âge d’une vingtaine d’années et qu’un agriculteur s’attachait à un animal qui était en fait son compagnon de travail quotidien. Les chevaux ne sont pas nés à la ferme ; une seule jument y fait son poulain, Coquette en 1949, et Louis Levallois note alors : « C’est la première fois qu’un poulain naît à la maison », et Madeleine avait été achetée en 1913 avec son poulain. Les animaux sont donc achetés dans des fermes de Jobourg, Digulleville, Gréville, Vauville, Nacqueville, sans fournisseur privilégié, parfois âgés : ainsi Bijou qui a 19 ans lors de son achat à Georges Gosselin à Jobourg. Leur vente ou leur départ interviennent entre un et six ans plus tard ; on ne sait pas toujours où, ainsi le poney Pompon, malgré un âge très vénérable.Les prix d’achat et de vente sont presque systématiquement indiqués.
Les chevaux constituent l’un des indicateurs de l’importance des exploitations agricoles : les très petites fermes n’en ont pas, les fermes petites et moyennes en ont un, les fermes plus importantes en ont deux, et seules, les fermes les plus grosses peuvent en avoir trois. Avec un cheval, la ferme de Basile et Louis Levallois apparaît comme moyenne (5-6 vaches).
Les chiens
Neuf chiens apparaissent dans le cahier de 1910 à 1958. Ils portent les noms de Castor, Tom (deux animaux), Bergère (deux animaux), Bergère III, Moselle, Loulou, Bouboule ; cinq sont des mâles, quatre des femelles. La couleur est parfois
21
Cahier Louis Levallois
indiquée (l’un des deux Tom est blanc et noir, Moselle est blanche, Bouboule est marron), la taille également (l’une des deux Bergère et bouboule sont dits petits). Certains naissent à la maison, d’autres sont « acquis » (achetés ?) (Bouboule, âgé de 10 mois, à Sideville, en 1957 ; Castor en 1910), d’autres enfin sont « apportés » (Bergère III, par Fatosme de Gréville, en 1934 ; Bergère, âgée de 1 mois, par Théodore Ladvenu, du village de Danneville, en 1947). A l’inverse, certains sont donnés : Loulou, né en 1936, donné en 1939 à Jeanne Levallois née Lecouvey. Les décès à la ferme sont indiqués, avec le commentaire suivant pour Bergère III, morte en 1936 : « d’une maladie épidémique qui a fait périr 15 chiens dans la commune ».
Trois animaux sont des chiens de chasse. On sait que Basile Levallois, contrairement à son fils Louis, était passionné par la chasse. Castor (1910-1920) est le seul chien de trait ; on lui a construit une niche en 1916. Les chiens de trait, toujours attachés, étaient attelés, par un collier en cuir et une chaîne, sous un petit cabriolet léger, construit en tubes métalliques et compartimenté (trois ou quatre cases), destiné à transporter les bidons de lait quand l’herbage où se trouvaient les vaches en été, n’était pas très éloigné de la ferme. Dans le cas contraire, on avait recours au cheval attelé à la carriole, qui, en plus des bidons, pouvait transporter les personnes.
Enfin, le cahier indique la construction d’une niche en ciment (!) pour le chien en 1930.
Les chats
Neuf chats également sont cités dans le cahier entre 1910 et 1955. Ils portent les noms de Moumoune, Mimi, Fauchette, Moussette, Friquette, Vévette, Moumoutte, Miss et Mistinguette. Dans huit cas, il semble s’agir de chattes, qui sont beaucoup plus performantes à la chasse aux souris, mulots, taupes... que les mâles ; la seule exception est constituée par Mimi, « matou blanc » né en 1912. Deux chattes ont trois couleurs. Le record de longévité est atteint par Moussette (1921-1936, soit 15 ans). Contrairement à la plupart des chiens, les chats naissent tous à la ferme et le cahier permet de suivre les filiations, maternelles uniquement, sur sept générations : ainsi, Moumoune (1910-1921) est la quatre fois arrière grand-mère de Mistinguette, née en 1955.
Enfin, en 1950, naît la « chatte Titine Boivin », sans doute la chatte donnée à Augustine Boivin qui est une preque voisine. Le cahier ne mentionne pas de maladie, les causes de la mort des animaux, l’importance des portées... .
Les bovins
Vers la fin du XIXème siècle, la hague se tourne résolument vers l’élevage laitier qui a d’ailleurs apporté une certaine aisance. Les vaches laitières constituent donc le coeur du système agricole, mais elles sont curieusement à peu près absentes du cahier, qui ne comporte que quelques mentions se rapportant, parfois d’ailleurs indirectement, à elles.
En 1920, Basile Levallois adhère à la « Laiterie Coopérative de la Hague », c’est à dire à la laiterie de Gréville - auparavant chaque ferme vendait son lait et faisait son beurre-, et un camion à lait Renault est signalé dans le cahier en 1921.
Trois autres événements sont notés : la foudre responsable de la mort d’une génisse et de la « commotion » d’une autre dans les Champs-de-Bas (1922), une épidémie de fièvre aphteuse (1938), et une fugue des bêtes de l’Aubépine à Jardeheu, à 6 km environ (1946).
Le cahier ne comporte aucune information sur le nombre de vaches, l’origine des animaux, leur devenir (autre ferme ou boucherie), la naissance des veaux, le nombre de veaux et de génisses, indispensables pour renouveler le cheptel, la présence éventuelle d’un taureau...
Les espèces absentes
Tous les autres animaux généralement présents dans une ferme de la Hague à cette époque et qui ne sont pas des animaux de trait ou de compagnie, sont totalement absents du cahier. Il n’y a aucune indication sur la basse-cour (volailles), les moutons (race roussin avec la tête et les pattes noires, issue de croisements avec des races anglaises) qui font l’objet d’un élevage extensif et d’appoint dans la Hague, les chèvres appelées « biches » (une ou deux par ferme avec consommation familiale des petits dits « bichons »), les porcs (un animal par ferme, acheté petit, engraissé, tué et salé ; parfois une truie reproductrice, avec vente des petits pour engraissement). Les lapins apparaissent deux fois à la faveur de la construction de cabanes pour les abriter (1938) et du « bétonnage du hangar aux lapins » (1930). Au total, le cahier ne reflète en aucune manière la réalité économique d’une ferme d’une importance moyenne dans la Hague de cette époque.
La tortue et le serin
Dans ces conditions, la présence de la tortue et, à un moindre degré, du serin dans le cahier peut être considérée comme révélatrice de la personnalité de son auteur. Deux tortues sont achetées à Cherbourg le 16 août 1936. On ne connaît le devenir que de celle qui s’appelle Cocotte et qui est peut-être la seule à avoir survécu. Elle pond quatre oeufs le 1er juin 1944, puis, sept jours plus tard, sept oeufs « d’un seul coup ». Ces mentions peuvent surprendre tant la présence d’une tortue dans une exploitation agricole peut sembler anecdotique, mais on sait, par des membres de la famille, que Louis Levallois était très attaché à sa tortue Cocotte et qu’une petite partie du jardin potager était réservée à la production de légumes pour elle. On sait également que (l’abondante?) ponte de 1944 n’a pas abouti à des naissances. Un serin vert, offert à Basile Levallois le 16 août 1920, par sa nièce Euphrosine, meurt le 6 décembre 1933, à plus de 13 ans, ce qui doit représenter une longue vie pour un serin.
Le temps qu’il fait
La météorologie a une importance évidente pour un agriculteur, dans la mesure où elle détermine directement la pousse de l ‘ herbe, les récoltes, la réalisation des travaux agricoles..., et cependant, elle n’occupe pas une place très importante dans le cahier, puisque dix années seulement, de 1920 à 1957, comportent des informations sur ce thème.
L’été 1920 a été pluvieux (« mille peines à récolter le foin »), mais les printemps et les étés ont été secs en 1921 (« les foins
22
sont terminés en juin »), 1928 (« été très beau »), 1933 (« sécheresse permanente »), 1938 (« en raison de la sécheresse qui dure depuis l’hiver, du temps aride et froid, la récolte de foin a été nulle et terminée en juin »), 1949 (« 14 septembre : fin de la sécheresse qui a tout rôti et tari toutes les sources de par en bas et d’ailleurs »). Des grands froids et de la neige sont signalés en 1927 (« -9°, tous les dracaenas sont gelés »), 1929 (« -7°, les oiseaux et en particulier les grives meurent en grand nombre, les « pousses » des dracaenas périssent de nouveau ). Des dracaenas se trouvaient dans de nombreuses fermes, car leurs feuilles longues, étroites et pointues étaient utilisées pour fabriquer les liens des gerbes de céréales faites à la main lors des moissons.
En 1938 et en 1950, la récolte de pommes a été exceptionnelle. En 1950, le coucou est entendu pour la première fois de l’année le 13 avril, c’est à dire très tôt. Une aurore boréale est aperçue le 25 janvier 1938 et en février 1950, et une comète passe dans le ciel le 24 avril 1957.
Seuls, les phénomènes extrêmes ou exceptionnels ont été notés dans le cahier.
La vie municipale, les travaux publics et les grands événements
La vie municipale
Louis Levallois est élu pour la première fois au conseil municipal en 1935, à 30 ans. Il est certain que l’assemblée municipale élue cette année-là comprend de nombreux jeunes conseillers, mais la famille n’habite définitivement la commune que depuis six ans. En 1936, il est élu délégué pour les élections sénatoriales avec dix voix ; la journée de l’élection à Saint-Lô lui a laissé un excellent souvenir puisqu’il note : « temps splendide, repas grandiose, voyage et confort parfaits ».
L’arrivée des troupes allemandes en 1940 entraîne la démission du maire, Eugène Digard, et l’adjoint, Jean-Baptiste Lecouvey, assure l’intérim jusqu’en 1941. Louis Levallois n’évoque pas ces événements, mais détaille les élections de 1941 : « Le 22 juin, je suis élu maire à 3 tours de scrutin, 1er tour 4 voix, 2ème tour 6 voix (sur 11 votants, élu), 3ème tour 8 voix élu, je refuse », puis « le 6 juillet, Jean-Baptiste Lecouvey est élu maire avec 7 voix. Je suis élu adjoint avec 7 voix ». Il a donc fallu deux séances et au moins quatre tours pour élire un maire. Louis Levallois indique les faits sans les commenter, sans donner les raisons qui l’ont amané à ne pas accepter la fonction de maire (la guerre ? respect pour Jean-Baptiste Lecouvey qui était nettement plus âgé que lui ?), mais on sent une certaine fierté d’avoir été élu maire à 36 ans.
Le conseil municipal est dissout en 1945. Il indique simplement « élections municipales » à la date du 24 avril ; il en sera ainsi jusqu’en 1959. En 1945, le maire et l’adjoint sont réélus aux mêmes fonctions.
En 1947, Jean-Baptiste Lecouvey n’est pas réélu au conseil et Louis Levallois devient maire, à 42 ans. Il sera brillamment réélu au 1er tour avec un pourcentage écrasant, puis maire avec la quasi-totalité des voix, en 1953, 1959, 1965 et 1971. Le cahier s’arrête en 1959, mais comporte cependant les résultats nominatifs des élections de 1965, 1971 et 1977. En 1977, à 72 ans, il décide de ne pas se représenter. La liste issue du conseil
sortant n’obtient pas les résultats espérés et ses quelques élus composent avec l’autre liste conduite par Roger Lehuel qui devient le nouveau maire de Saint-Germain-des-Vaux-des-Vaux. Ce dernier tient l’hôtel-restaurant de l’Erguillière à Saint-Germain-des-Vaux. Pour la première fois, le maire n’est pas un cultivateur originaire de la commune. Une nouvelle époque commence, avec d’autres personnes et d’autres méthodes.
Louis Levallois a donc été élu 8 fois et a siégé, sans discontinuité, au conseil municipal de Saint-Germain-des-Vaux-des-Vaux de 1935 à 1977, soit pendant 42 ans : 6 ans conseiller, 6 ans adjoint, 30 ans maire.
En 1948, l’année qui suit sa première élection à la mairie, Louis Levallois note son « premier décès » (la mère du curé Calas), son « premier mariage », un voyage à Coutances pour l’élection de trois conseillers de la République (sénateurs), et, en 1955, la remise de la médaille communale à Beaumont, par le Préfet, à deux élus locaux.
Les travaux publics
D’assez nombreuses interventions sur le domaine public figurent dans le cahier ; la majorité d’entre elles se rapportent à la période durant laquelle Louis Levallois était maire :• les lavoirs et les fontaines : construction des lavoirs de la
Cavée et de Ruelland par Cosnefroy entre 1904 et 1909 ; construction de la Fontaine-Saint-Martin par « l’ouvrier Auguste Groult » (en fait artisan maçon à Saint-Germain-des-Vaux) en 1949.
• l’électricité : pose des poteaux électriques à haute tension en 1930 et pose des lignes électriques à basse tension en 1931.
• les routes : goudronnage de la Doucette et de la Rue-de-Bas en 1954 : « c’est un événement sensationnel ».
• l’eau : travaux d’adduction de l’eau courante en 1958-1959 et « arrivée de l’eau sous pression » le 2 mai 1959.
• les bâtiments communaux non religieux : « réparation des bâtiments communaux (mairie, école des garçons, presbytère) - peinture de tous les extérieurs - remplacement des boiseries détériorées » en 1949.
• l’église : pose d’une nouvelle croix au clocher en 1913 ; pose d’une nouvelle voûte en bois sur la nef par les frères Malard en 1953.
• la chapelle paroissiale : construction de la sacristie, couverture (par Mouchel, menuisier-couvreur à Saint-Germain-des-Vaux) et ouverture de la porte de communication avec la chapelle en 1931 ; une grande partie de ces travaux a été faite par les habitants eux-mêmes et Louis Levallois note : « tous les soirs, on travaille à enduire les parois de la sacristie ».
• le téléphone : le téléphone est installé à Auderville chez Pilastre en 1921, et à Saint-Germain-des-Vaux au Moulin à Vent en 1925 ; il s’agit là de cabines publiques.
Certains de ces équipements sont réalisés assez tôt pour une région rurale assez isolée : l’électricité en 1931, l’eau en 1959.
Les grands événements.
Les grands événements nationaux ou internationaux sont
23
Cahier Louis Levallois
presque totalement absents du cahier. Un seul président de la République est cité, Albert Lebrun, à l’occasion de sa venue à Cherbourg, en 1933, pour inaugurer la nouvelle gare maritime, mais les venues à Cherbourg, à plusieurs reprises, du Général de Gaulle ne sont pas évoquées.
La Première Guerre Mondiale n’est mentionnée qu’au travers de ses implications familiales ou personnelles : Basile Levallois, père de Louis, participe à cette guerre pendant toute sa durée, et Charles Duhoux, instituteur, est mobilisé et meurt en 1915. Il est vrai que la Hague n’est pas territorialement concernée par ce premier conflit mondial, mais le silence du cahier sur les autres morts de la commune et sur la construction du monument aux morts est à remarquer.
En revanche, la Hague est très directement concernée par le second conflit qui est davantage développé dans le cahier. L’implication militaire personnelle de Louis Levallois, la présence d’un officier allemand dans la maison de la Rue-de-Bas, l’occupation de la Boissellerie ont déjà été envisagées. En mai 1941, « la Hague est menacée d’évacuation » ; les bombardements sont détaillés, certains dommages matériels sont mentionnés, des victimes sont évoquées, mais pas nominalement. Les Américains arrivent à Saint-Germain-des-Vaux le 1er juillet 1944. « La lumière électrique disparue depuis le 21 mai » est rétablie le 26 octobre 1944. Le 7 mai 1945 , « capitulation de l’Allemagne - c’est la paix ». Mais auparavant a eu lieu un épisode curieux : « 11 avril et jours suivants, bombardement de Herqueville-Jobourg-Auderville par les batteries d’Aurigny toujours occupée par les Allemands ». En effet, les armées alliées ont libéré la Hague en oubliant Aurigny, à peu près totalement évacuée en 1940 et transformée par les Nazis en un immense camp de déportation. Les Allemands restés sur l’île ont bombardé la Hague, tuant même quelques vaches à Jobourg, avant de devoir se rendre.
Enfin, l’implantation d’une vaste usine nucléaire dans la Hague a été un événement d’une ampleur nationale, voire internationale, avec de très nombreuses et importantes implications régionales et locales. Louis Levallois a été inévitablement concerné en tant que maire. Les travaux de construction de l’usine ont commencé en 1959. Or, il n’y a aucune allusion à cet événement majeur dans le cahier, alors que la ponte de la tortue Cocotte est indiquée.
La vie religieuse
En revanche, la vie paroissiale est incontestablement le thème le plus abordé dans le cahier, parfois de manière détaillée, avec de fréquents commentaires personnels et enthousiastes. De toute évidence, la religion comptait énormément pour Louis Levallois.
Une chronique paroissiale.
Tous les départs de prêtres, toutes les installations de nouveaux prêtres sont indiqués, ce qui constitue une véritable chronique de la vie paroissiale :• 1920 : l’abbé Leclerc est remplacé par l’abbé Lefillâtre ; ce
dernier organise une séance de cinéma en 1921.• 1925 : l’abbé Lefillâtre est nommé à Réville et est remplacé
par l’abbé Enée.• 1929 : l’abbé Enée est nommé à Vauville et est remplacé
par l’abbé Gosselin ; ce dernier convoque, très rapidement semble-t-il, « les jeunes gens pour leur apprendre la note et le chant d’église ». C’est dans les années 1930 que Louis Levallois semble s’investir dans une forte pratique religieuse, peut-être sous l’impulsion de l’abbé Gosselin, qui avait la réputation d’être un « curé militant ».
• 1937 : l’abbé Gosselin est nommé curé-doyen de Bréhal et est remplacé par l’abbé Pierre Leroussel, précédemment vicaire à Octeville. Le 22 août 1937, « 400 Octevillais viennent passer la journée à Saint-Germain-des-Vaux pour revoir leur ancien vicaire M. l’abbé Leroussel. Le soir, ils parcourent les rues en chantant au clair de la lune et les habitants se joignent au cortège qui se termine au Moulin à Vent, où a lieu le départ ».
• 1944 : l’abbé Leroussel est nommé à Sauxemesnil. Louis Levallois participe au déménagement et à un voyage « dans le camion du laitier avec toute la jeunesse de Saint-Germain-des-Vaux pour porter un cadeau à M. l’abbé Leroussel ». Certains dimanches de mars-avril 1945, le service du culte est assuré par un prêtre qui vient de Montmartin-sur-Mer « administrer la Hague déshéritée ». Le 12 avril 1945, l’abbé Calas arrive dans ses nouvelles paroisses de Saint-Germain-des-Vaux-des-Vaux et d’Omonville-la-Petite (Saint-Martin) ; « à cette occasion les églises sont magnifiquement décorées du sanctuaire au portail avec des guirlandes de houx à Saint-Germain-des-Vaux, du sapin à Saint-Martin ». L’installation officielle a lieu le 15 avril ; « 6 prêtres sont présents à la messe, fait infiniment rare en ce temps présent » : Louis Levallois déplore le nombre de prêtres, que dirait-il maintenant avec un unique prêtre à Beaumont pour presque tout le canton ?
• 1950 : l’abbé Calas est nommé à Grosville (« une délégation de Saint-Germain-des-Vaux l’y accompagne ») et est remplacé par l’abbé Adam, précédemment vicaire à la basilique Sainte-Trinité de Cherbourg, qui « est installé en grande pompe ».
• 1953 : l’abbé Adam est nommé à Anneville-en-Saire et Louis Levallois assiste à son installation : « temps magnifique - Excursion à La Pernelle - Visite de l’église de Montfarville - Trajet en car par la nouvelle route touristique Cherbourg - Saint-Pierre-Eglise ». L’abbé
Groupe de filles et de jeunes filles de Saint-Germain-des-Vaux avec l’abbé Gosselin, curé de 1929 à 1937, et les parents de ce dernier. Sa mère, à sa gauche, porte une coiffe, son père est à l’extrême gauche (archives Louis Levallois, collection particulière).
24
Adam a été le dernier curé résident de Saint-Germain-des-Vaux qui, à partir de cette date et jusqu’en 1996, est administré par le curé d’Auderville et de Jobourg, mais Louis Levallois ne le mentionne pas dans son cahier.
Outre les curés successifs de Saint-Germain-des-Vaux, sont également indiqués : le décès, en 1936, de l’abbé Léon Malard (84 ans), qui avait fêté ses noces d’or sacerdotales en 1927, et qui « a vécu 50 ans dans la paroisse, dont il fut 20 ans le curé », puis où il a fait fonction de vicaire ; le décès de l’abbé Marie, curé d’Auderville, en 1947, après une maladie qui a contraint « ses paroissiens à [ venir] à la messe à Saint-Germain-des-Vaux », à l’inhumation duquel ont assisté 30 prêtres et le maire « Pierre Anquetil a fait un touchant discours » ; le mariage de l’organiste, Charles Lecouvey dit Octave, en 1938 (cérémonie détaillée) ; le décès du sacristain, Jean-Baptiste Groult en 1941, et son remplacement par Victor Lejuez en 1942.
La religion de Louis Levallois.
Plusieurs notations révèlent la piété de Louis Levallois : achat du livre de messe grégorien noté (1930), d’un paroissien « missel vespéral » (1947), d’un deuxième chapelet (1951).
L’implication de Louis Levallois dans la vie religieuse était très forte. Il s’investit dans le déroulement des offices en assurant le rôle de chantre ; à ce titre, il porte soutane noire, qu’il indique avoir inaugurée le dimanche 9 décembre 1945, surplis blanc et chape noire : cet « habit de choeur » disparaît avec la mise en place de la liturgie issue du concile Vatican II dans les années soixante. En 1932, il adhère à la Jeunesse Agricole Chrétienne, et, en 1933, le curé Gosselin acquiert une lanterne à projections lumineuses pour ce mouvement.
La famille est abonnée à des journaux catholiques (La Victoire du Dimanche à partir de 1926, la Croix du Dimanche à partir de 1946), et Louis Levallois devient correspondant de La Croix de la Manche en 1932. En 1930, il note « fondation du Cercle d’Etudes Bienheureux Thomas Hélye », nom d’un bienheureux, prêtre, enseignant et thaumaturge du XIIIème
siècles, originaire de Biville dans la Hague, où un culte, toujours très vivant, lui est voué ; Louis Levallois en faisait certainement partie. En 1944, il note, de manière laconique et quelque peu énigmatique « 30 janvier : j’affirme ma volonté de soutenir l’Eglise tout en respectant la tradition familiale ». La page consacrée à l’année 1935 comporte, après les rubriques habituelles, un texte du cardinal Eugenio Pacelli, qui sera bientôt le pape Pie XII, sur le thème « Au service de la famille paysanne ».
Les fêtes religieuses.
Les fêtes religieuses tiennent également une place importante ; elles sont détaillées dans des phrases rédigées, parfois de véritables petits paragraphes, avec de nombreux adjectifs admiratifs, dans un style presque lyrique qui contraste nettement avec la sobriété du style du cahier ; ces fêtes concernent :
• la chapelle paroissiale : en 1930, la paroisse fête son cinquantenaire avec bénédiction des nouveaux vitraux et de l’harmonium : « cérémonie splendide pleinement réussie » ; la sacristie nouvellement construite est bénie
en 1931 : « c’est une belle cérémonie à laquelle assiste un nombreux clergé » ; une statue de Sainte-Thérèse de-l’Enfant-Jésus est bénie en 1932 ; en 1947, la nouvelle cloche de la chapelle, Jeanne-Auguste-Jean, est bénie par le vicaire général, tous les prêtres présents sont cités, le parrain et la marraine de la cloche sont cités : « la chapelle était bien décorée et une nombreuse assistance la remplissait ».
• deux messes de minuit : en 1930, « elle est mémorable, chantée de façon parfaite » ; en 1932, les chants sont « nettement réussis ».
• les fêtes-Dieu ou fêtes du Saint-Sacrement : en 1938, « nous avons édifié un reposoir au Jogard ; pour la première fois, j’ai dirigé le travail. J’ai très bien réussi, parce que nous y avons mis le meilleur de nous-mêmes » ; en 1939, « édification d’un magnifique reposoir au Jogard ».
• la fête patronale Saint-Germain-des-Vaux de 1938 : les activités récréatives sont détaillées, mais avec la précision « après les vêpres ».
• la fête des moissons de 1945 : « l’église est décorée de guirlandes faites de blé et d’avoine du sanctuaire au portail. Des cannes en cuivre ornent les fenêtres. Un grand défilé de jacistes a lieu du presbytère à l’église ».
• les pélerinages à Biville, paroisse d’origine du Bienheureux Thomas Hélye, où se trouve son tombeau : en 1944, « magnifique fête (...). La messe est dite par les trappistes de Bricquebec (officiant, diacre et sous-diacre) ; en 1945, « arrivée à Biville de la statue de Notre-Dame-de-Boulogne. Nous allons à sa rencontre en habit de choeur sur la route de Vasteville. C’est une cérémonie impressionnante. Il y a messe à minuit et messe jaciste ensuite , elle est chantée de manière incomparable ».
• trois missions, symboles d’une église encore conquérante : celle de 1937 (12 jours), avec « de grandes fêtes le soir à l’église. magnifiques décorations. Ma bicyclette Rétro-Hirondelle participe au reposoir de la fête du travail » ; celle de 1951 (15 jours), « avec de grandes fêtes » et un prédicateur, le bon père Omer « qui a toujours exalté à l’amour du Christ », avec un « retour de mission » en 1952; enfin, celle de 1959, qui est juste mentionnée.
• les fêtes de la victoire en 1945 : le 13 mai 1945 : « fête officielle de la Victoire - Te Deum - Réjouissances - Journée pleine de gaieté et de joie » ; le 14 juillet de la même année, « pèlerinage à Biville à pied en exécution du voeu formé en 1941 pour implorer la protection du Bhrx Thomas contre les dangers de la guerre ».
• deux baptêmes de canot de sauvetage (l’« Edouard-Catenacci » et le « Victoire des Alliés ») à Goury, en 1928 et en 1948, par Mgr Louvard, évêque de Coutances, et la bénédiction du nouveau calvaire du Mont-Clin à Omonville-la-Petite en 1955 : « c’est une magnifique cérémonie ».
La religion et, notamment, l’appartenance à la JAC à partir de 1932 sont à l’origine d’un certain nombre de voyages : en 1930, voyage en car à Coutances pour une réunion catholique
25
Cahier Louis Levallois
(« magnifique journée ») ; en 1931, pèlerinage à Lourdes (à la ligne suivante, mention « les lumières spirituelles ») ; en 1932, « voyage à Coutances avec M. le curé, à l’occasion des noces d’or sacerdotales de Monseigneur Louvard, évêque » ; en 1933, réunion d’action catholique à Valognes ; en 1934, congrès eucharistique à Coutances (« c’était splendide ») ; en 1936, congrès de la JAC à Paris pendant 3 jours ; en 1938, congrès de la JAC à Coutances (« très belle journée dont je garde un excellent souvenir »). Louis levallois note également le pèlerinage de sa mère à Lourdes en 1952.
Jusqu’aux années 1960, la religion, outre son rôle spirituel, imprégnait la vie quotidienne, les loisirs de la grande majorité des gens de la Hague ; sans elle, Louis Levallois ne serait peut-être jamais allé à Paris. Mais ce dernier est profondément catholique et fervent pratiquant. Vers la fin de sa vie, il offre un harmonium à l’église et fait don de parcelles de terre à l’évêché.
Loisirs : fêtes et voyages
Les fêtes
Les fêtes citées dans le cahier qui n’intègrent pas d’une manière ou d’une autre la religion sont rares (même le cinéma est assuré par le curé).
Des manifestations non religieuses lors de fêtes patronales Saint-Germain-des-Vaux sont mentionnées : l’excursion de l’Etoile sportive », sans autre précision, en 1922 ; en 1938, la fête est « réalisée avec le concours des 50 musiciens du patronage d’Octeville. Après les vêpres jeux, concerts. Le soir défilé dans les rues (avec musique en tête) concert et feu d’artifice au Moulin-à-Vent ».
Deux fêtes de la Mi-Carême sont décrites dans le cahier : le 27 mars 1927, « fête exceptionnelle de la Mi-Carême. Je suis reine en char avec deux demoiselles d’honneur - 38 masques, cymbales, tambours et clairons ; le 27 mars 1928, « fête exceptionnelle de la Mi-Carême, je suis le roi Carnaval, 1 char avec cheval, 5 ânes travestis - dont Octave [ âne de la famille Levallois ]- 28 masques, temps splendide, succès complet ». C’est un aspect inattendu et méconnu de la personnalité de Louis Levallois, qui, il est vrai, avait alors environ 25 ans.
Les voyages et les excursions.
De 1913 à 1942, une quinzaine « d’excursions » sont mentionnées dans le cahier : Saint-Christophe-du-Foc, dans le canton des Pieux, en 1913 et 1922 (pèlerinage à Saint-Christophe ?) ; le Mont-Saint-Michel, qualifié de « cité merveilleuse » en 1928 ; Saint-Mère-Eglise - Carentan en 1929 ; le phare de Goury, l’île anglo-normande toute proche d’Aurigny, qualifiée de « charmant pays » et le phare de Gatteville en 1930 ; Saint-Pierre-Eglise - Quettehou - Saint-Vaast-la-Hougue - Réville... en 1931 ; Les Pieux - Flamanville - Diélette en 1933 ; Barneville-Carteret en 1934 ; Bricquebec en 1935 ; falaises et grottes de Jobourg (« ascension périlleuse du Nez de Jobourg ») en 1939 ; Montebourg - Quinéville - Saint-Germain-des-Vaux-de-Tournebut - Montebourg - Carentan - Isigny - Carentan - Montebourg en 1942.
Tous ces déplacements s’inscrivent dans le département de la Manche, sauf Isigny qui n’en est éloigné que de quelques
kilomètres, et Aurigny est la seule destination hors de France. Pour les plus éloignés, la durée est indiquée : une journée, à l’exception du dernier qui s’étale sur trois jours avec coucher à Montebourg et à Carentan. Trois excursions sont faites avec une ou deux autres personnes de Saint-Germain-des-Vaux. Le moyen de locomotion est (sauf pour Aurigny évidemment) la bicyclette, la fameuse « Rétro- Hirondelle », maintes fois citée, et on peut être étonné par les performances de Louis Levallois : cinq excursions, faites apparemment sur une seule journée, représentent entre 80 et 160 km. Le dernier voyage dure trois jours durant lesquels 200 à 250 km ont été effectués. Les motivations de ces petits voyages, évidentes pour le Mont-Saint-Michel, ne sont pas précisées, mais les églises, les phares, les sites remarquables semblent tenir une place importante ; la pêche aux coques sur la côte est du Cotentin lors du dernier voyage (3 jours) semble bien anecdotique.
La religion n’est pas absente de ces excursions : l’excursion à Bricquebec en 1935 comporte une visite de l’abbaye de la Trappe, et l’abbé Gosselin, curé de Saint-Germain-des-Vaux, accompagnait les valeureux cyclistes en voiture ; l’excursion dans les falaises et les grottes de Jobourg en 1939 se fait « sous la direction de M. le curé de Saint-Germain-des-Vaux » (l’abbé Leroussel).
Trois fêtes religieuses et familiales donnent lieu à des excursions en car : en 1934, la communion de Marcelle Ladvenu, petite cousine de Louis Levallois, à Saint-Pierre-Eglise où son père était gendarme, avec excursion à Saint-Vaast-la-Hougue ; en 1933, un mariage à Carentan avec excursion à Vierville-sur-Mer (Calvados) ; en 1938, le mariage de Charles Lecouvey dit Octave avec une « promenade à Barfleur ». Lors d’une communion solennelle ou d’un mariage, il était en effet fréquent à cette époque d’affréter un car pour faire une excursion, dans le double but de permettre aux convives de s’aérer et aux serveuses de préparer la table entre le déjeuner et le dîner, puisque ces fêtes comportaient systématiquement deux copieux repas.
Aucun déplacement n’est mentionné avec l’automobile acquise en 1955, sans doute pour les raisons déjà évoquées.
La mer
La mer est la grande absente du cahier qui est totalement silencieux sur la pêche, les tempêtes et les dégâts qu’elles entraînent dans les parcelles littorale et les activités liées à la mer (le ramassage des algues, la récolte du lichen, la récupération de tout ce que la mer apporte à la côte...). Louis Levallois était un terrien et, ce qui est beaucoup plus rare, un terrien qui ne pratiquait pas la pêche à pied, contrairement à son père Basile.
Le cahier mentionne deux baptêmes de canot de sauvetage, qui sont également des fêtes religieuses, par Mgr Louvard, évêque de Coutances et Avranches (1928 : l’« Edouard Catenacci » ; 1948 : le « Victoire des Alliés »), le premier allumage de la balise « La Plate » sous la Rue-de-Bas le 3 novembre 1949, et la mise en place d’une nouvelle lanterne au phare de Goury en 1951.
26
Les échouages sont cependant mentionnés :• le 4 mars 1948, le bananier « Guinée » (3076 tonnes)
s’échoue à Grénéquet. Le quotidien local, la Presse de la Manche relate l’échouage dans ses colonnes du 5 mars. Le bateau allait de Dieppe à Douala en Afrique Occidentale Française (Cameroun), sur l’est. Le temps était beau, mais brumeux et le navire a été victime d’une voie d’eau pénétrant dans les ballasts. Trois remorqueurs de type « Abeille » n’ont pas réussi à renflouer le navire, qui part enfin le 6 mars « tiré par cinq remorqueurs. Un nombre considérable de curieux a regardé le navire ».
• dans la nuit du 15 au 16 novembre 1950, par mauvais temps, « un grand cargo liberty américain, le « Tini » se met à la côte à Houffet ». Il transportait une cargaison de matériel militaire destiné aux bases de Cherbourg (4 000 tonnes), Anvers, Rotterdam, Brême . Le sauvetage difficile du bâtiment et de sa cargaison a lieu le 17 novembre « par cinq puissants remorqueurs » (2 remorqueurs « Cherbourg 3 » et « Cherbourg 4 », 2 « Abeilles » et le remorqueur britannique « le Turrail »).
• le 21 mai 1959, vers 4 h du matin, le vieux caboteur anglais « Channel Trader » (500 tonnes) s’échoue à proximité du Nez-Quilas, alors que l’équipage de six hommes croyait être dans l’île anglo-nomande d’Aurigny qui était sa destination. Le brouillard explique sans doute cette erreur, car le bateau naviguait régulièrement entre l’Angleterre, les îles anglo-normandes et Cherbourg, où il avait chargé de la viande congelée. L’équipage a réussi à gagner la terre ferme toute proche, et est arrivé au café-épicerie Guerrand à la Rue-de-Haut, à près de 2 km du lieu de l’échouage. Le navire reste échoué jusqu’au 15 octobre, date à laquelle il « est finalement remorqué à Cherbourg où il sera démoli », mais il est resté à Saint-Germain-des-Vaux, sur l’estran, accessible à pied sec à marée basse, pendant près de cinq mois. Louis Levallois indique dans son cahier que « de nombreux touristes viennent le visiter », mais ne mentionne pas le fait que de nombreux habitants de Saint-Germain-des-Vaux et des environs ont récupéré sur le bateau tout ce qui pouvait l’être !
• le 5 novembre 1959, le yacht anglais de 62 tonneaux et de 25 m de longueur, le « Sans Pareil » se fracasse par « fort vent de nord, presque tempête », sur les rochers de la Pointe de la Loge. A bord se trouvaient quatre personnes (le propriétaire canadien, son épouse, sa secrétaire et un marin anglais, navigateur expérimenté), qui parviennent à gagner la terre ferme en nageant « et arrivent chez Bonin à 5 h du matin, où ils sont réconfortés ». Il s’agit de Bon Ladvenu dit « Bonin » ou « Bounin », gendarme retraité, qui habite à l’extrémité de la Rue-de-Bas, au Jogard, à environ 1,5 km du lieu du naufrage, et qui est donc presque voisin de Louis Levallois. Là aussi, les habitants de Saint-Germain-des-Vaux ont récupéré ce qui pouvait l’être : ainsi, un mât a été réutilisé comme solive dans une dépendance agricole de Danneville.
Le caboteur « Channel Trader » échoué à Saint-Germain-des-Vaux entre « la Noë » et le « Nez-Quilas » en 1959 (cliché Auguste Digard, 1899-1962, collection particulière).
Le bananier « Guinée » échoué à Saint-Germain-des-Vaux, lieu-dit « Grénéquet », en 1948 (cliché Auguste Digard, 1899-1962 ; collection particulière).
27
Cahier Louis Levallois
Le Naufrage du voilier britannique « Sans Pareil » en 1959 relaté dans « La presse de la Manche ». La photographie montre ceux qui ont accueilli et réconforté les naufragés : Bon Ladvenu et son épouse Euphrosine Levallois, cousine germaine de Louis Levallois (reproduction, Martine Fosse).
Le Naufrage du voilier britannique « Sans Pareil » en 1959 relaté dans « La presse de la Manche » (reproduction, Martine Fosse).
29
Cimetière d’Omonville-la-Petite Un lieu ouvert vers l’absolu
Jacky Brionne
L’église Saint-Martin et le cimetière se nichent dans un cadre bocager, et très discrètement, au hameau Fleury et forment un ensemble très harmonieux rythmé de monuments funéraires en verticalité donnant de l’élan à l’ensemble du site et qu’il est indispensable de préserver face à la standardisation horizontale des stèles, malgré qu’il y ait ici quelques exemples artistiques de stèles très appréciables. L’église a la particularité d’être dotée d’un campagnier, à l’ouest, dans les ouvertures duquel sont suspendues deux cloches. Le cimetière est entièrement clos de mur à l’arrière au nord, nord-ouest et de muret au sud, sud-est et sud-ouest. La croix, dite du cimetière, de section carrée se dresse au midi. Le cimetière est presqu’entièrement loti et bon nombre de tombeaux sont serrés et rendent difficile la circulation entre tombes. Mur columbarium au nord, en applique contre le mur de clôture (10 cases dont 2 occupées). Il ne semble pas y avoir d’ossuaire (s’il existe, il n’est pas identifié comme tel).
La notoriété du cimetière et la fréquentation assidue par les touristes de passage, sont dues à la présence des sépultures de Jacques Prévert (décédé le11 avril 1977), Janine Prévert (le 20 mars 1993) et Michelle leur fille (1986) ainsi que celles d’Alexandre Trauner (13 décembre 1993) et Nane sa veuve (2011). Parmi ces décédés notons aussi Félix Mesnil, biologiste, membre de l’Institut Pasteur (1868-1938). Ces tombes remarquables apportent une forte contribution à l’intérêt général du cimetière.
Le site, certes comparé à des clichés plus anciens, a perdu deux palmiers au sud, en parallèle avec l’église (57 Fi 1138, photographie André Gain) mais l’abondance arbustive et végétale rendent ce lieu paisible. C’est un critère très appréciable et il serait préjudiciable de supprimer, sous un prétexte quelconque de gestion des espaces concédés, tous ces arbustes fleuris et odorants, même s’ils prennent sur le terrain public.
Des tombeaux aux hautes croix de marbre, de ciment armé, de calcaire tendre, de pierre reconstituée, quelques hautes stèles de ciment armé « art décoratif » sont tout à fait représentatifs
de cet art funéraire en voie de disparition, auquel s’ajoutent quelques très rares croix de fonte, au nombre si réduit, qu’il devient impossible de s’en séparer. Les accès au site nécessitent au midi le franchissement d’escaliers. Les allées sont étroites et contribuent à une déambulation adaptée sur l’ensemble du site dont le lotissement se réparti en trois parcelles, une au sud, une au nord, nord-ouest, et la dernière au nord, nord-est. Il faut y ajouter quelques tombeaux isolés dans l’angle nord-ouest de l’église et l’occupation dans l’angle nord-est par le monument aux morts et des fragments de stèles et épitaphes fixées au mur de la chapelle nord, flanc est.
• Croix bleue : pierre• Croix noire: ciment armé• Croix rouge : croix de fonte• Rectangle bleu : tombeau pierre• Rectangle noir : tombeau
ciment
• Rectangle vert : végétal ou encadrement bois
• Tiret bleu : stèle de pierre• Tiret noir : stèle de ciment
30
Etat des sépultures :
Année : Nombre : Année : Nombre :2007 20102008 20112009 2012Moyenne annuelle de sépultures :
Contrats de concession :
Les récolements d’archives font état de la conservation de contrats de concession en mairie qui ne sont pas antérieurs à 1948. Une rapide attention aux actes civils publics permet de dire que le régime des concessions fut adopté bien antérieurement, pour exemple le maire d’Omonville-la-Petite accorde une concession perpétuelle de 2 m², à Auguste Alard, le 16 septembre 1931, moyennant la somme de 400 francs (compte 549 du volume 113). Les autres transcriptions de contrats peuvent être consultés dans les actes civils publics de Beaumont-Hague1834-1900, 1900-1934, 1934-à ce jour = Cherbourg-Octeville, (3 Q 1079-1157 et suivant jusqu’à maintenant).
Règlement du cimetière :
Un règlement du cimetière a été défini le 26 décembre 2011.
Opération de reprises de sépultures :
Application d’un arrêté du maire concernant les reprises en terre commune daté du 2 mai 2013.
Etat d’abandon de la tombe d’un mort pour la France. Sépulture, croix de bois, entourage façon briques, Emile Morel, MPLF (mort pour la France) (Emile, Casimir, Hyacinthe, 4 juin 1917, matricule 1138 (1907), Cherbourg).Est-il utile de faire mourir deux fois ?
31
Le cimetière d’Omonville-la-Petite
Les monuments funéraires qu’il serait souhaitable de préserver au titre de l’art et de la mémoire
Angle nord-est de l’église :
Monument aux morts.Stèle calcaire tendre et plaque de marbre blanc, monsieur l’abbé Legendre, décédé curé, le 2 décembre 1859, 65 ans.Stèle néogothique trilobée (fragment), calcaire tendre, monsieur l’abbé Maurice, Alexandre Roulland, décédé le 28 septembre 1878, curé.Stèle néogothique, étroite, bâtière pointue, amortissements, épitaphe à peine distincte, mais exploitable.Plaque Charles François Lemière, 1805, curé de ce lieu, scellée.Plaque JB Lemière, curé de ce lieu, 1786, scellée.
Carré sud (à partir du sud-est) :
Sépulture Henry Pelerbe, croix de bois, clôture de tuiles de terre cuite.Tombeau ciment armé, courte stèle, Louis Henry, mort pour la France, 1909-1948.Tombeau, haute croix de marbre, ailerons à volutes, Auguste Cédra, 1860-1940, Honorée Lechevalier, 1870-1919.Hautes croix de marbre, la première droite, la deuxième, aux extrémités arrondies, arbustes.Dalle tombale contemporaine, granit poli, famille Cédra, dont Albert, 1922-1939, Alphonse, mort pour la France, 1917-1940.Tombeau art décoratif, étroite stèle, croix sommitale, illustrée d’une croix peinte or, enfant Simone Cédra.Haute croix, calcaire tendre, brisée, Emile Henry, décédé le 9 septembre 1891.Croix de fonte enfant, peinte en blanc, clôture de dalles de ciment, enfant Jullien, 1925 (7).Haute croix de ciment armé, Jean-Baptiste Jullien, 1929.Tombeau, grande dalle tombale, granit poli, haie de lavande bordant sur trois côtés, Fernand Mostade 1964, Madeleine Gosset 1977.Tombeau, dalle tombale avec plaque « en souvenir de notre ami, UNOR, Cherbourg, 13 décembre 1986 ».Tombeau, sépulture enfant, cippe portant statuette, Thérèse Delacourt, 1955.Monumentale sépulture constituée d’une grande clôture de plots de granit, chaîne, deux stèles aux frontons à bâtières et amortissements, une croix en élévation, de granit, famille
32
Damourette-Martin-Richer, plantations. Deux sépultures distinctes avec deux croix de fonte rondes, arbres de vie, illustrées de chrysanthèmes, volubilis, plantations, dont Caroline Aimée Jean, épouse d’Henri Dufour, 1923.Deux croix de marbre sur sépultures plantées, Louise Lejemmetel née Perrotte, Marie, Madeleine Lejemmetel, née Damourette, Louis Damourette, Fernand Lejemmetel (1944).Tombeau, haute croix de ciment armé (endommagée), épitaphe sur plaque de marbre, Auguste Gautier, prisonnier, mort pour la France, Trosly-sur-Loire, 1940.Sépulture enfant, croix de ciment armé, brisée, Victor Gautier, 1921.Sépulture enfant, cippe portant statuette faïence, Marie, Cécile Hervieu, 1937, bon état.Tombeau, haute croix, ciment armé, Julia Henry, femme Renet, 1956, bon état.Tombeau, haute croix de marbre, Emile Renet, 1942.Monument funéraire, trois sarcophages, haute croix à ailerons de granit bouchardé, illustrée de motifs floraux, couronne de tanaisies centrale, épitaphe sur stèle : Célestine Damourette (1906), Célestin Damourette, juge de paix honoraire, chevalier du Mérite agricole (1916, JB Damourette (1953), docteur Edouard Damourette, ancien interne des hôpitaux de Paris (1862-1901) et autres. Un Jean Damourette fut maire d’Omonville-la-Petite (signature de vitrail en 1922). Tombeau, haute croix à pointe, ciment armé ou pierre reconstituée, René Legrand, 1966.Idem, sépulture de madame Legrand, 1962.
Tombeau à très belle croix, calcaire tendre, ailerons, déclarée abandonnée, Louis Quoniam, 1855-1916, à la mémoire de Joseph Quoniam, mort pour la France, 25 avril 1917, 21e année. Tombeau à très belle croix, calcaire tendre, ailerons, déclarée abandonnée madame Louis Quoniam, née Stéphanie Henry, 1935. Stèle pierre naturelle, MA Fleury, épouse JM Boccassini, 1880-1944.Tombeau haute croix de marbre, à la mémoire de madame veuve Dohet, née Fleury, 28 février 1942.Tombeau, haute croix de marbre à pointes, Jean Morel (1933), Marie Fleury (1945).Stèle art décoratif, ciment armé ou pierre reconstituée, croix en relief, décor au fil en creux.Tombeau, haute croix fleuronnée, marbre, couronne de tanaisies au centre, sépulture R Mesnil, sarcophage tectiforme, Requiescant in pace. Tombeau, haute croix à pointes, pierre reconstituée façon granit de Fermanville, décor en filet en creux, plaque de marbre blanc « sépulture Dufour-Renet ». De profundis.
Croix de la tombe de l’abbé Robin. Epitaphes à l’avers et au revers.
33
Le cimetière d’Omonville-la-Petite
Sépulture, croix de bois, entourage façon briques, Emile Morel, MPLF (mort pour la France) (Emile, Casimir, Hyacinthe, 4 juin 1917, matricule 1138 (1907), Cherbourg). Sépulture Francine Morel (1939) endommagée.Sépulture végétalisée, croix de calcaire tendre, ailerons, madame Renet, née Constance Levallois, décédée le 5 juin 1927. Tombeau, croix de marbre, Charles Renet, 1857-1894, Maria Renet 1886-1911.Sépulture, croix de fonte ronde, végétalisée.Croix pédiculée, marbre, ici reposent les restes mortels de M. l’abbé Robin, curé d’Omonville-la-Petite de 1860 à 1873, décédé le 7 Xbre, âgé de 59 ans, calice et ciboire en faisceau, « souvenir d’une nièce », longue épitaphe en français et en latin à l’avers le concernant. Au revers « ici reposent les restes mortels de Victor Desheulles, né à (Houbesville) décédé à l’âge de 37 ans, amis pendant leur vie, la mort ne les a pas séparés, souvenir d’une bonne épouse. »Croix de la tombe de l’abbé Robin. Epitaphes à l’avers et au revers. Tombeau de marbre, sarcophage coffre, membres de la famille Henry (dont Edmond Henry, 1899, Reine Henry-Cussy (1808-1887), Jean Henry, 1885). Belle couronne en faïence en mobilier. Croix de fonte ajourée, brisée.Croix de fonte ajourée, pavots aux extrémités, faisceaux lumineux, anges en prière, Marie Guillemin née Lefèvre.Fragment de croix en calcaire, Auguste, Alexandre Fleury, agent voyer d’(…).Fragment de dalle « à la mémoire de (…) Boul (…), le 12 (…) 1888 sa 18e année.Fragment de stèle en marbre « Marie, Louise Lemarinel, épouse J. Bigot, 1900-1924.
Carré nord, nord-ouest, nord-est :
Stèle, pierre naturelle, épitaphe peinte en vert, Jacques Prévert, 4 février 1900, 11 avril 1977, sépulture végétalisée.Stèle de même nature, Janine Prévert, 20 mars 1993, sépulture végétalisée.Stèle de même nature, Michele Prévert, 16 novembre 1946, sépulture végétalisée.Tombeau, haute stèle, granit poli, « in te domine speravit » familles Boulay-Fleury-Pietra, dont Ernest Boulay, chevalier de la Légion d’honneur, 1866-1943, Jean-Louis Pietra, chevalier de la Légion d’honneur, 1883-1972. Ce patronyme apparait parmi les donateurs des vitraux de 1937. Tombeaux (deux), courtes stèles pierre naturelle, Pierre Trauner, (…-…), Nane Trauner, 1926-2011.Tombeau, contemporain, pierre naturelle, stèle en forme d’arbre, Geneviève Legrand, 1939-2002, Henri Legrand, 1935-2008.Tombeau contemporain, stèle, oiseau en vol sur le côté, Claude Corbin, 1933-1990, Officier de l’Ordre national du mérite, Laurent Corbin, 1926-2004. Mobilier : plaque des personnels civils et militaires du SEA de la Courneuve.Croix pédiculée de marbre enfouie au pied du mur nord-ouest (pignon de bâtiment).Deux tombeaux enfants avec portiques de ciment (?) peints en blanc.
Tombeau contemporain, granit poli, Lefrançois-Deshayes « nous nous sommes bien aimés tous les deux ».Tombeau, dalle tombale, granit bouchardé, Félix Mesnil, 1868-1938, membre de l’Institut, Commandeur de la légion d’honneur, Adrienne Mesnil née Gaullery, 1871-1963, Chevalier de la légion d’honneur.Tombeau avec stèle « art décoratif » renversée au sol. Tombeau, haute croix à pointes, marbre, sculptures en filet, M le docteur Mesnil, chevalier de la légion d’honneur, estimé et regretté de tous, décédé à Cherbourg le 8 février 1894. Sarcophage en granit bouchardé, Maurice Mesnil, 1896-1987, ancien élève de l’Ecole polytechnique, chevalier de la légion d’honneur, Yvette mesnil née Pimbert, 1907-1998.Tombeau, sarcophage, granit bouchardé, vasque sur l’avant, Durel-Duval (†1951, 1954).
Répartition générale des sépultures : vert : tombe naturelle, bleu : tombeau de pierre, gris : tombeau en ciment armé, croix : en élévation.
35
Le cimetière d’Omonville-la-Petite
Croix pédiculée, calcaire tendre, Elie, Jean-Baptiste Lemière, du Vivier, 25 août 1884. Tombeau, stèle art décoratif, ciment armé ou pierre reconstituée, tombe végétalisée.Tombeau, courte stèle « René Lemière, mort pour la France, 1906-1939, madame Lemière (…).Tombeau, haute croix, Léon Gautier, †1952.Tombeau, haute croix, deux plaques, dont Flavie Leportois, 1929, tombe végétalisée.
Angle nord-ouest de l’église :
Tombeau, dalle tombale, granit bouchardé, docteur JP Mesnil, 1838-1894, Pierre Mesnil, 1893-1972.Tombeau, sarcophage coffre, marbre, croix gravée en filet, madame Eléonore Lepesqueur, 1833-1919, Emma Mesnil, sa fille, 1855-1867.Tombeau, stèle, Auguste Richer, †1877, Marie Paris, †1904.Dernière stèle néogothique en calcaire, à double épitaphe à l’avers et au revers.
Carré nord-est :
Croix de fonte, plate, arums, iris sur tiges, brélée cordon, couronne de leurs variées, sur stèle calcaire, Suzanne Aubrais, †1917. Tombe végétalisée.Tombeau, haute croix fleurdelisée, illustration de lierre, MM Aubrais, 1861-1937, 1893-1958. Pater Ave.Stèle, calcaire, enfant Paul Aubrais, †1928.Stèle néogothique, ogivale, calcaire tendre, revers : à la mémoire de (…) Aubrais, décédé le 19 février (…) 66 ans. Avers, couronne de tanaisies en relief, épitaphe sur plaque de marbre blanc : à la mémoire de notre cher enfant, Guillemin Aubrais, décédé le 2 juillet 1892, âgé de 9 ans. Tombe végétalisée.Croix ronde marbre sur stèle, Marguerite Aubrais, 26 novembre 1925.
Haute croix à pointes, ciment armé, Georges Aubrais, †1931.Haute croix pédiculée, marbre, Auguste Levallois, †1898. Tombe végétalisée.Croix pédiculée renversée, calcaire tendre, Mon(ique) Bri(e), 26 mars 1889.Haute croix à pointes sur stèle renversée, marbre, madame veuve Deslongchamps-Leneveu, née Anne mesnil, †1897.Sépulture, haute croix pédiculée, marbre, clôture de fonte (la seule), Emélie (…)Tombeau, haute croix, calcaire ou marbre, madame Aubrais née Delépine (1885-1948), Louis Aubrais (1888-1951).Tombeau, courte stèle pierre naturelle, Pierre Gallis, 1919-1989.
Parmi d’autres personnes décédées :
Jean Damourette, ancien maire (famille dont le nom apparait souvent comme donateurs des vitraux de Jean Barillet en 1937). Robert Simenot, ancien maire, décédé en 1989Jehan Fleury décédé en 1551, fondateur de la chapelle sud, pour servir de sépulture à ses trois neveux : Denis, décédé en 1536, François, décédé en 1552, Robert, décédé en 1553.L’abbé Albert Aulagner, chanoine (1891-1968), et d’autres sans doute non remarqués... Dernière clôture de fonte à volutes et haute croix renverséeCroix de fonte plate, brélée d’un cordon, illustrée d’iris et d’arums, d’une couronne de fleurs variées, sur stèle calcaire, Suzanne Aubrais, 1917.
Dernière clôture de fonte à volutes et haute croix renversée. Croix de fonte plate, brélée d’un cordon, illustrée d’iris et d’arums, d’une couronne de fleurs variées, sur stèle calcaire, Suzanne Aubrais, 1917.
36
Fig. 1 : Eglise et cimetière de Saint-Germain-des-Vaux (© Gérard Vilgrain-Bazin).
Fig. 2 : Accès sud avec un échalier constitué d’une dalle de schiste dans sa partie inférieure (© Gérard Vilgrain-Bazin).
37
Inventaire et protection du patrimoine funéraire dans le canton de Beaumont-Hague (Manche)
Gérard Vilgrain-Bazin et collaborateurs
Madame Francine Aguiton a été depuis de nombreuses années sensibilisée à la perte du patrimoine funéraire en particulier dans le sud du département et notamment par la disparition des croix de fonte dont un inventaire fut réalisé ainsi qu’une sauvegarde. Jacky Brionne en fondant l’association pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine en Val de Sienne (Gavray-Percy-Villedieu) a effectué avec ses coéquipiers un inventaire dans le centre Manche et Jean Barros en Côte-des-Isle. Une commission pour la sauvegarde du patrimoine funéraire de la Manche a été créée en 2003 et depuis cette époque la sauvegarde des cimetières dans le département est considérée comme sensible.
Compte tenu de ces éléments le GRAC a pris conscience qu’il y avait un intérêt certain à étendre cette démarche au canton de Beaumont-Hague.
Cette opération consiste à effectuer l’inventaire et la protection des monuments funéraires remarquables dans les cimetières du canton selon une typologie bien précise établie par M. Jacky Brionne, membre de la Fondation du Patrimoine, délégation Basse-Normandie – Fédération Patrimoine environnement – Fédération des Moulins de France – Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France – Commission départementale pour la sauvegarde du patrimoine funéraire de la Manche – Groupe de travail national « cimetière, mémoire des lieux » de la SPPEF.
D’autre part, cette opération s’inscrit dans le cadre du programme « Archéologie, histoire et anthropologie de la presqu’île de la Hague » qui a rejoint la programmation de l’Unité Mixte de Recherche (UMR 6566-CreAAH) « Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire » du CNRS (ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche), rattaché aux universités de Rennes I, Rennes II et Nantes et au ministère de la Culture (DRAC Pays-de-Loire, Bretagne et Basse-Normandie). Le travail conduit par les équipes de recherche de la Hague vient abonder les thèmes de l’UMR, en particulier « L’Homme et la Mer : occupation du littoral » et « Paysages, environnements et sociétés » qui forment deux axes d’études importants de cette Unité de Recherches à vocation interrégionale (Bretagne, Pays-de-Loire, Basse et Haute Normandie). Ce programme est placé sous la direction de Cyril Marcigny membre de l’Institut National de Recherches Archéologiques préventives et UMR 6566-CRe-AAH du CNRS.
Les résultats seront chaque année publiés dans l’ouvrage Archéologie, Histoire et Anthropologie de la presqu’île de la Hague.
Ce projet actuellement en cours à pour objet, également, de sensibiliser les conseils municipaux des communes du canton
à la vigilance lors de reprises de concessions échues afin de protéger les monuments les plus remarquables au point de vue architectural et au point de vue de la notoriété des défunts inhumés.
Pour accomplir la démarche il convient de se procurer le plan du cimetière quand cela est possible, sinon il faut en effectuer le relevé. Ensuite il faut effectuer un repérage des tombes qui peuvent présenter un intérêt comme mentionné ci-dessus.
MÉTHODOLOGIE
L’enregistrement de chaque monument funéraire s’effectue à partir d’un document établi par le service de conservation des antiquités et objets d’art de la Manche : vocabulaire typologique du patrimoine funéraire (Version 2 : juin 2004). La première partie est consacrée aux définitions du vocabulaire typologique avec un exemplaire de fiche recto verso destiné à l’enregistrement de chaque tombe et une fiche complémentaire pour les croix de fonte. Ensuite, des illustrations avec des commentaires des divers monuments, susceptibles de faire partie de l’inventaire, permettent de renseigner correctement les fiches. Sont également pris en compte : les croix de cimetières, les monuments aux morts ainsi que les ossuaires et les caveaux provisoires.
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET QUELQUES DEFINITIONS
L’église et le cimetière constituent le périmètre consacré. A Saint-Germain-des-Vaux (fig 1), ce périmètre est délimité par un muret mais souvent il peut être délimité par des haies d’épines blanches ou de hêtres. Lorsque le périmètre est curviligne celui-ci atteste d’une réelle ancienneté. L’accès s’effectue par trois grilles : l’une côté ouest avec un échalier adjacent, la seconde côté sud et la troisième côté sud aussi avec un échalier constitué, dans sa partie inférieure, par une dalle de schiste (fig 2) provenant probablement d’un puits compte tenu de l’encoche aménagée pour le passage de la corde afin de remonter les seaux. Dans la partie nord-est du mur on distingue les traces d’une ancienne entrée. Le marquage des tombes est attesté au XVIème siècle. Un édit de Louis XVI limite les inhumations dans les églises (rappel de la cour d’appel de Rouen pour la région normande). Au XIXème siècle, l’art funéraire est lié au calcaire, le bois révèle un savoir faire local, le ciment était pratiqué par beaucoup d’Italiens émigrés. On distingue les carrés des enfants qui parfois pouvaient être inhumés dans les
1 Président du Groupe de Recherches Archéologiques du Cotentin
38
allées sauf refus. Les tombes des soldats morts pour la France sont des tombes militaires et imprescriptibles. Dans certains cimetières des carrés militaires sont aménagés. Sur des tombes anciennes on peut observer des lettres gravées : CAP concession à perpétuité, CP concession perpétuelle, CC concession centenaire et CT concession trentenaire.
LE CIMETIÈRE DE SAINT-GERMAIN-DES-VAUX
La première séance a eu lieu sous la houlette de Jacky Brionne afin d’initier les membres de l’association à la procédure à appliquer pour renseigner les fiches d’inventaire ainsi qu’au vocabulaire typologique qui est très fourni, en particulier pour les croix de fonte. C’est la partie nord du cimetière qui a été déterminée pour effectuer cette opération. Notre attention a été attirée par plusieurs monuments remarquables : croix de fonte, stèles néogothiques en calcaire, tombeau avec grille entourant la sépulture, sépulture d’enfant, tombeau avec croix en marbre de Carrare, ossuaire et caveau provisoire, tombe d’un ancien maire de la commune, d’un militaire, tombe d’un prêtre sans monument, monument aux morts… L’enregistrement va parfois jusqu’à relever la plaque d’identification du marbrier : matière, ancienneté… En ce qui concerne le côté sud plusieurs tombeaux remarquables, de même nature, ont également fait l’objet d’enregistrements.
QUELQUES TOMBES REMARQUABLES
Dans la partie nord, la partie ancienne, vingt six monuments en place ont fait l’objet d’un enregistrement ainsi que trois monuments déplacés.
Concession n° 33 (fig 3) : croix funéraire en calcaire blanc ; illisible/Isaac DIGARD/curé de cette/ paroisse décédé/le 10 août1850 à/l’âge de 66 ans/In memoriam/illisible. Croix à la partie supérieure, étoile à 5 branches dans un petit fronton triangulaire ; épitaphe dans la partie centrale et ovale de la croix ; sablier ailé.
Concession n° 46 (fig 4) : croix funéraire en fonte sur socle en calcaire blanc, tombeau avec entourage en briques, le tout sur socle en béton. Amélie GROULT/née LADVENU/1864-1920/priez pour elle. Croix cylindrique avec Christ crucifié rajouté ; à la base de la croix : chrysanthèmes ? feuilles d’acanthe et lierre.
Concession n° 112 (fig 5) : tombeau avec cippe, sépulture d’enfant en ciment. A/notre enfant chéri/illisible/LEVALLOIS/décédé/dans sa 8è année/le 1er mai 1933/Ses parents inconsolables. Statue en porcelaine : enfant aux cheveux bouclés, mains croisées, tunique à plis, à genoux sur un coussin à pompons (attitude de prière, orant), d’après/A Godard ; estampille porcelaine 14.28. Croix funéraire perlée posée sans porte-croix.
Concession n° 104 (fig 6) : croix funéraire sur stèle et socle en marbre de Carrare avec tombeau en granite et dalle de marbre, le tout sur semelle en béton. A/la mémoire/de Marie Louise/LECOUVEY/décédée le 1er décembre/1932/dans sa 24ème année/Regrets éternels dans un phylactère sur le socle.
Concession n° 141 (fig 7) : tombeau sarcophage tectiforme en granite. A/la mémoire de Bon Pierre GROUT/instituteur/et de/Constance MOSQUERON/son épouse/1887/requiescant in pace avec croix en relief au-dessus. Concession/à/perpétuité (au pied est du tombeau). Grille sans portillon avec fleurs de lys stylisées et feuilles d’acanthe aux quatre angles Croix en calcaire blanc déplacée et posée à la verticale au pied du tombeau. Ci-gît/Bon Pierre GROUT/instituteur/décédé le/4 (?) xbre 1880. Au verso, figurent de la gauche vers la droite : une ancre de marine, une croix et un cœur surmonté d’une croix qui signifient : foi, espérance, charité (vertus théologales) ; au centre et légèrement en dessous l’inscription De profondis.
Dans la partie sud, la partie la plus récente, vingt quatre monuments ont été référencés.
Concession n° 177 (fig 8) : tombeau militaire avec stèle en pierre reconstituée. LOUIS/LEVALLOIS/1902-1941/MORT POUR LA FRANCE. Tombeau avec entourage et jardinière. Sur la stèle, palme d’hommage avec casque et croix de guerre.
Concession n° 186 (fig 9) : tombeau en calcaire avec stèle en grès, en trois parties ; à la base un décor géométrique constituant le socle, la partie centrale avec deux décors apposées et la partie supérieure comporte un vase. L’épitaphe est gravée sur une tablette en marbre : Ici repose/Pierre/MICHEL/décédé le/27 février 1917/à l’âge de 70 ans/Regretté/de sa veuve/ et de ses enfants/ E. Herbet.
Fig. 3 : Concession n° 33 (© Martine Fosse).
39
Inventaire du patrimoine funéraire dans le canton de Beaumont-Hague
Fig. 4 : Concession n° 46 (© Martine Fosse). Fig. 5 : Concession n° 112 (© Martine Fosse).
Fig. 6 : Concession n° 104 (© Martine Fosse).
Fig. 7 : Concession n° 141 (© Martine Fosse).
40
Fig. 8 : Concession n° 177 (© Martine Savary). Fig. 9 : Concession n° 186 (© Martine Savary).
Fig. 11 : Concession n° 296 (© Martine Savary).Fig. 10 : Concession n° 266 (© Martine Savary).
41
Inventaire du patrimoine funéraire dans le canton de Beaumont-Hague
Concession n° 266 (fig 10) : stèle en calcaire jaune avec une demi rosace transformée en tombeau. La société centrale/de sauvetage des naufragés/à SAUVÉ Auguste/canotier de sauvetage/de la station de Barfleur/mort glorieusement/en se portant au secours/d’une chaloupe en détresse/20Xbre 1893/Recuiescat in pace.
Concession n° 296 (fig 11) : tombeau avec stèle en granit gris avec croix mortuaire. L’intérieur est rempli de galets. JE N’AI JAMAIS CRAINT/LES VENTS D’OUEST. Au pied du tombeau : François NÉRAULT/1920-1993.
La concession n° 186, a fait l’objet, selon la loi d’une réparation pour cause de péril. Elle a été prise en charge par la municipalité faute de descendants identifiés.
La concession n° 266 est dédiée à la mémoire d’un des canotiers ayant péri en mer au cours d’une intervention dans
la nuit du 19 au 20 décembre 1893. Le canot à avirons « Sophie Jeanne de Saint-Faron » de Barfleur s’est retourné en portant secours au sloop de pêche local « Maria ». Le corps d’Auguste Sauvé s’est échoué le 5 janvier suivant à proximité du port Racine. Le corps de Louis Crestey ne fut jamais retrouvé. En leur hommage, le canot de sauvetage de Barfleur en service de 1955 à 1994 fut baptisé « Crestey et Sauvé ».
L’association a obtenu, de la part de la PBO, un prix d’un montant de 1 500 € afin de participer à la préservation des monuments les plus remarquables. Ce fut le cas, cette année, à Saint-Germain-des-Vaux où les lettres du nom « Louis Levallois » qui a siégé pendant 42 ans à la mairie dont 30 ans en tant que premier magistrat, ont été repeintes par une société spécialisée.
42
La «grosse pierre» à Saint-Germain-des-Vaux. LA GROSSE PIERRE
Sur la commune de Saint-Germain-des-Vaux trois mégalithes sont encore visibles. Tout d’abord, «La Grosse Pierre», menhir qui a déjà fait l’objet de plusieurs publications depuis la fin du siècle dernier. Il s’agit d’un bloc parallélépipédique en granite local, d’une largeur de 1,10 mètre pour une épaisseur de 0,50 mètre. Sa hauteur hors sol est de 1,80 mètre. Les dimensions de ce mégalithe tendent à montrer qu’il ne puisse pas s’agir d’une «pierre à vache» ou «frottoir», bien que ceux-ci soient fort nombreux dans la Hague. Un autre monolithe de dimensions très proches est visible à quelques centaines de mètres, à proximité du «Joggard», le monument le plus douteux de Saint-Germain. Situé au niveau d’un muret surmontant un abreuvoir, celui-ci se compose essentiellement d’une dalle en granite local mesurant 2,50 mètres de long; 1,50 mètre de large et 0,50 mètre de hauteur. Outre ce bloc, plusieurs autres plus petits sont également visibles dans le mur. La présence de ces pierres dans une maçonnerie en pierres sèches composée de moellons est en fait des plus problématique. S’il semble peu probable qu’il s’agisse d’un dolmen en place, il pourrait être question d’une récupération d’éléments mégalithiques sur un monument qui aurait existé à proximité immédiate de la clôture. Pour tenter de résoudre ce problème, un sondage aurait du être effectué à I’arrière de la dalle principale, dans l’espoir de repérer les traces d’un éventuel dolmen.
Bibliographie : Coutil L. 1896b, pp. 123-124 ; Voisin A- 1908, pp. 77-78.Biblio : E. Ghesquière, H. Lepaumier, C, Marcigny et AU, Un nouvel inventaire des mégalithes de la Manche, in Bulletin du GRAC, N° 7, avril 1996, pp. 33 -53
43
Les frotteux de la HagueEric Marie
Ne pas confondre les « frotteux » avec des mégalithes ou de pseudo menhirs dédiés uniquement au confort des vaches.
Il y a quelques années, je devrais dire plutôt, pour être exact, quelques décennies, un passionné de mégalithes s’était enthousiasmé après avoir constaté la présence d’un menhir dans presque chaque champ de la Hague : d’où une remarquable densité de ces mégalithes dans cette zone géographique. Il fit part de sa découverte au travers de publications et diverses communications, tout exalté qu’il était de transmettre son incroyable trouvaille.
Malheureusement pour notre intrépide archéologue, si les menhirs ne sont pas totalement absents de notre région – les Haguais ne les appellent pas d’ailleurs comme les Bretons «pierres longues» (men : pierre ; hir : longue) mais «pierre butaées» (pierres bloquées, stoppées, arrêtées) – ils sont plutôt rares.
En fait, ses mégalithes se révélaient n’être que des «frotteux» dont la présence au milieu des champs se justifiait par la présence également de vaches venant en brouter l’herbe.
De l’usage des « frotteux »
On appelle « frotteux » des sortes de poteaux de pierre, généralement en granit ou grés, fichés en terre au milieu des herbages, d’une hauteur de 1,40m. en moyenne à 90cm pour les plus petits (le niveau du sol ayant pu changer), destinés aux bovins que l’on met en pâture dans ces espaces enclos de murs en pierres sèches. Car la Hague est bien connue pour ses
« clos » circonscrits de cette sorte. Les murs de pierres sèches sont d’ailleurs vraisemblablement à l’origine de ces «frotteux». Les murs dressés au moyen de simples cailloux sans mortier, tout au plus un peu d’argile, sont fragiles et les éleveurs savent bien (doit-on dire savaient bien ?) – que l’on doit sans cesse remettre en place les pierres qui glissent où se désolidarisent de l’ouvrage. Or, les bovins sont sujets aux attaques incessantes, surtout en période chaude voire orageuse, des insectes et divers parasites qui sont attirés par leur présence. Leur seul et unique mode de défense consiste à se gratter, à se frotter le long des parois, branchages, haies vives, troncs se trouvant dans les parages. Mais dans un enclos où seuls les murs de pierres sèches s’offrent à leurs flancs, il faut bien être conscient des dommages que peuvent causer les démangeaisons de ces bestiaux dont le poids est loin d’être négligeable. Les frottements répétés, associés à une poussée de plusieurs dizaines voire centaines de kilogrammes ont tôt fait d’avoir raison de ces murs de pierres sèches qui en viennent à s’ébouler. C’est ainsi que les éleveurs imaginèrent d’offrir à leurs troupeaux des grattoirs adéquats. Il n’est qu’à observer des bovins dans un champ où se trouvent des arbustes du genre épine, pour constater que les troncs de ceux-ci sont très souvent sollicités par ces animaux afin de soulager l’inconfort que leur procurent les démangeaisons diverses et variées de leurs flancs. Dans un enclos n’offrant aucune végétation de ce genre, le recours à un poteau, à une pierre dressée verticalement à hauteur d’animal se trouvait être la solution.
44
Pour un inventaire
Le nombre et la localisation, et donc la densité de ces «frotteux», s’avère aujourd’hui très aléatoire car les conditions d’élevage se sont énormément modifiées au cours de ces dernières décennies. Il est toutefois possible d’affirmer que la présence des « frotteux » dans les champs entourés de murs de pierres sèches, voire de fossés1 de terre avec ou sans parements de pierre, était encore la règle il y a une cinquantaine d’années. L’augmentation des troupeaux, l’usage du fil de fer barbelé, voire de clôtures électriques, la modification des surfaces par suppression de murs en partie ou totalité sont quelques-uns des facteurs qui ont pu précipiter leur disparition. L’attention moindre prêtées au confort des bestiaux pourrait-on peut-être ajouter ?
Autre facteur d’importance, la remise en labour de nombreuses surfaces a nécessité la suppression de ces obstacles à la charrue et aux moissonneuses.
Dans quelques cas il s’agit plutôt de vénalité à l’origine de l’arrachage de ces piliers de granit propres à entrer dans
1 Fossés. Ce terme dans la Hague désigne la levée de terre, le talus servant de clôture et non le creux formé à sa base. Cette dernière partie est d’ailleurs appe-lée le « creus du fossaé ». (Dictionnaire normand français, d’après un inventaire des usages en Cotentin E. Marie, O.R.E.P. 2012).
la construction, voire la restauration de bâtiments. Souvent d’ailleurs la belle pierre qui servait de « frotteux » a été remplacée par un poteau électrique en ciment tronçonné ou une traverse de chemin de fer en bois. Qu’importe l’esthétique si l’utilité en est préservée.
Il est vrai que la qualité et la beauté de certaines des pierres utilisées pour faire des « frotteux » peut laisser rêveur de nos jours quand on sait le prix de tels matériaux. Nous ne sommes plus dans cette civilisation où la pierre faisait partie des matières premières usuelles et où le temps de façonnage n’avait guère d’importance.
C’est ainsi que certains, très attachés à préserver l’usage de ces moyens traditionnels, ont imaginé des ersatz afin de ne pas avoir à recourir à la pierre. C’était le cas d’un ancien maire de Saint-Germain-des-Vaux, Louis Levallois – dit Louis Basile – qui, promoteur en son temps, avait conçu en 1932 six « frotteux » en ciment armé. Celui-ci m’avait d’ailleurs confié, un jour que je l’interrogeais sur les « pierres percées » de nos barrières, vouloir en fabriquer en ciment en se servant de boîtes de conserves en fer blanc en guise de gabarit pour le trou.
Curieusement certains frotteux encore visibles n’ont une hauteur que de 90 cm.
Quelques exemples représentatifs de frotteux.
45
Les frotteux
Historique
Si la disparition de bon nombre de ces «frotteux» est liée aujourd’hui à la mise en labour, leur apparition par contre est très vraisemblablement associée au couchage en herbe dès le XVIIIe et surtout au XIXe siècle, voire un peu antérieure (fin XVIIe ?). Avec l’abandon des labours, même sur de très petites parcelles parfois, au profit de l’élevage et de la production laitière, l’apparition des pâturages dans ces pièces de terre encloses de murets de pierres sèches a sans doute suscité l’érection de ces « frotteux ».
Leur usage, même sporadique, était-il connu auparavant et s’est-il alors développé ? Cela n’est pas exclu mais en l’absence de documents rien ne permet de l’affirmer. De là à penser que nous sommes en présence d’un héritage celtique lié au culte des vaches…
Frotteus en ciment à proximité de Beaumont-Hague.
Frotteus en ciment à Saint-Germain-des-Vaux.
Exemple de poteau électrique tronçonné servant de frotteus.
Le fil barbelé vient renforcer le muret de pierres sèches.
46
Fig. 2 : Carte de la Küstenverteitigungsabschnitt-Untergruppe Jobourg avec toutes les fortifications jusqu’au 1er janvier 1944. On remarque également une densité de fortifications qui est même plus grande que celle des plages du Débarquement (source : A. Chazette).
47
Les sentiers de la mémoire
Vers une valorisation du patrimoine de la Seconde Guerre Mondiale au cap de la Hague
Rafaël Deroo
« C’est une fortification qui barre toute la Hague […], la transformant en très vaste camp retranché. La fortification [est] incorporée dans le paysage bocager. » Si on lit ce texte, à quels bunkers allemands doit-on penser ? A aucun, car il s’agit du panneau du Hague-Dike, fortification autrefois attribuée aux Normands mais datant de l’âge du bronze et non de fortifications de la Seconde Guerre Mondiale dans le Cap.
La Hague a toujours joué les mêmes rôles dans l’histoire, celui de camp fortifié ou de poste d’observation et de transmission.
La Hague possède bien une continuité d’atouts de l’histoire de guerre et de la radio communication depuis les Normands du Hague-Dike, les Romains à Jobourg, les essais de radio du Français Edouard Branly en 1902 près du sémaphore d’Auderville, les défenses de l’armée française de l’entre-guerre, les fortifications et postes de radar allemands, le CROSS de Jobourg et l’usine AREVA.
Nous nous sommes basés sur la liste des vestiges de l’œuvre d’Alain Chazette, mais en visitant les lieux, nous avons tenté de retrouver toutes les fortifications. Nous avons constaté que, bien qu’une grande partie des fortifications existe encore aujourd’hui, aucune n’a été mise en valeur ou reçu quelconque traitement de sauvegarde (sauf des abris pour chauves-souris) ; au contraire, elles sont livrées aux intempéries et aux vandalismes.
Seules trois endroits dans la Hague permettent de voir, un peu par hasard, une série de vestiges « publics » de la guerre : la première série va de la pointe de Jardeheu à la plage de l’anse Saint-Martin jusqu’à la Pointe du Nez, la deuxième se trouve autour du sémaphore et du port de Goury et la troisième sur le sentier allant de la plage de la Crecque à Vauville à celle de Biville. Et n’oublions pas le très accessible tunnel de Laye.
Dans le livre, les fortifications sont reprises selon une logique « de promenade » et le livre termine avec une proposition concrète de balades visitant la plus grande partie des vestiges.
Fig. 1 : La Seconde Guerre Mondiale n’a pas épargné la Hague, comme l’atteste cette photo d’un Heinkel 111 P4 en vol à basse altitude devant le nez de Voidries, prise entre juin 1940 et avril 1941. On remarque également le sémaphore de Jobourg, détruit par les Alliés en 1944. Le 9 avril, cet avion nommé ‘G1+LS’ de la Kampfgeschwader 55 s’écrasait lors d’un raid de nuit en Angleterre après y avoir été abattu à 2h30 par un Boulton Paul Defiant (source : INFocus)
48
TRAVAIL D’INVENTAIRE
Le patrimoine
Y a-t-il lieu d’incorporer dans une sauvegarde du patrimoine les vestiges de guerres récentes ? On dirait que oui en ce qui concerne les fortifications de Vauban, qui, dans un temps antérieur, étaient souvent soumises à une grande pression pour les détruire. Aujourd’hui, il y a consensus pour les sauvegarder dans un patrimoine militaire.
Mais quel est l’usage potentiel des lieux militaires de la Seconde Guerre Mondiale ? Est-ce que ce sont déjà des ouvrages du patrimoine ? Quel imaginaire les accompagne ? Quelles instances se préoccupent des vestiges du Mur ? On voit que, autour de Beaumont-Hague, le Hague-Dike, la digue de défense construite à l’âge du bronze pour protéger la petite péninsule de la Hague contre les attaques de l’intérieur du pays, est l’objet d’attention d’historiens et de quelques touristes. Peut-on tirer une ligne directe du Dike haguais – premier « bunker » de la région – aux vestiges de la Seconde Guerre Mondiale dans la Hague ? Rien n’est encore entrepris pour les répertorier, les valoriser et les sauvegarder.
Les témoignages
Des témoignages historiques de personnes qui ont vécu les années 1939-45 nous donnent une vue sur la capacité de mémoire et d’oubli de cette période. On remarque ainsi que certaines personnes préfèrent oublier, mais que d’autres ont très tôt déjà entamé un travail de mémoire et parlent dans des ouvrages d’anthropologie locale, décrivant leur vécu personnel de la guerre. Une personne raconte dans l’exposition « Cap Liberté » (2004) que sa famille avait hébergé un prisonnier de guerre allemand pendant deux ans après la guerre (des prisonniers allemands était renvoyés aux zones côtières pour déblayer les plages et landes de mines et autres restants encombrants de la guerre) et qu’ils ont noué un lien d’amitié. Maintes autres familles utiliseront de plein gré les restes des combats et des fortifications et on voit encore aujourd’hui
partout les poteaux de barbelés, piquets « queue de cochon », tôles ondulées et obstacles de plage tripodes coupés en trois qui servent de barrière de champ.
Le mur de l’Atlantique ne fait-il pas partie de notre héritage guerrier comme témoin historique et lieu de mémoire, même dans notre logique de paix (ou surtout dans notre logique de paix) ? Il appartient au patrimoine militaire en particulier et plus largement au patrimoine et à la mémoire collective.
Comment s’effectue la transmission de ce patrimoine guerrier ? Il faut tenir compte du sentiment du public, de la population locale et plus particulièrement de cette partie de la population locale ayant vécu la guerre avec parfois des traumatismes. A cette partie de la population s’ajoutent les personnes n’ayant pas personnellement vécu la guerre et pour lesquelles les « bunkers » sont des témoins d’un autre temps, des témoins qui restent immuables, un lieu de mystère et d’aventure.
Dans les œuvres de référence sur la sauvegarde du patrimoine guerrier, il y a souvent référence aux donjons, châteaux forts ou citadelles. Nous faisons référence à la discussion en été 2013 sur Saint-Sauveur-le-Vicomte et son aspiration à devenir un lieu de mémoire (pour la guerre de Cent Ans). La Hague possède bien un patrimoine de transmissions (sémaphores, radar CROSS) ou de guerre (de tout temps : le Hague-Dike, les fort d’Omonville-la-Rogue, Vauville, Saint-Germain-des-Vaux et son port Racine, le Vendémiaire et les épaves autour du Cap, le champ de tir de Biville et ses carcasses de chars, et les fortifications importantes des années 30 de Castel Vendon). Mais ce patrimoine se trouve presque complètement soit dans un domaine militaire, soit sur terrain privé, soit sous la mer. Il est alors assez inaccessible pour le visiter régulièrement. Or la mise en état des vestiges de la Seconde Guerre Mondiale relierait, sur le territoire de la Hague, son patrimoine du XXème siècle, de transmissions et de fortifications.
Fig. 3 : La batterie Stahl (acier) de la Roche semble être tolérée et connue comme seul vestige guerrier de la région. Sait-on que cette batterie est jointe à une station de radar historique nommée Ammer ?
49
Les sentiers de la mémoire
Pour les vestiges de la Seconde Guerre Mondiale, faut-il qu’il y ait un lien avec une bataille de la Libération ? Ceci n’est pas nécessaire. Par exemple, sur la côte flamande en Belgique, le domaine historique du mur de l’Atlantique de Raversijde à Oostende remplit bien une fonction de patrimoine du Mur, bien qu’il n’ait fait partie d’aucune grande action d’hostilités pendant la Première et Seconde Guerre Mondiale. Mais, outre son rôle dans maintes guerres dans l’histoire et la bataille du Débarquement (les bombardements avant le Jour J, les batailles de Cherbourg et de Normandie), la Hague a aussi joué un rôle (comme la ville de Douvres-la-Délivrande près de Bayeux) comme poste de transmissions et de radar dans la guerre.
La disparition des vestiges
La mer, les intempéries finiront par balayer les vestiges. On le constate à la plage d’Ecalgrain ou à Biville. En France, le Conservatoire du Littoral a constitué certains bunkers en objet d’étude, d’autres ont été inscrits sur l’Inventaire supplémentaire des Monuments. Peu de moyens sont nécessaires pour sauvegarder les constructions car elles sont bâties pour perdurer, pour autant qu’elles soient entretenues au minimum. Une signalétique esthétique et fréquent permettrait de valoriser les vestiges.
Sans vision globale au niveau régional, et encore plus, sans volonté de voir dans la sauvegarde une importance locale, la construction de nouvelles routes et de lotissements continuera également. On voit ainsi des deux côtés d’Auderville (au nord et au sud), une chaîne de lotissements qui font partie d’une évolution qui entrera en conflit avec la future préservation du patrimoine de la Seconde Guerre Mondiale.
Fig. 4 : Une des photos les plus importantes que nous trouvons au musée de Douvres, est la photo prise par un avion de reconnaissance anglais des installations de radars Freya à Auderville (les Mirandas) à la future station Ammer le 22 février 1941. Ce site historique a été partiellement détruit il y a quelques années (source : Alain Millet et Imperial War Museum).
Fig. 5 : Photo d’un radar Freya (A. Chazette).
50
N’oublions pas non plus l’élargissement des routes et la propagation de ronds-points (des fortifications étaient souvent érigées à côté des routes et des carrefours, tous plus petits dans les années 40), qui ont déjà fait disparaître plus d’un petit vestige.
Quand tous les vestiges auront disparu, assisterons-nous dans quelques dizaines d’années à la construction de bunkers de la Seconde Guerre Mondiale taille 1:1 dans nos musées, comme on le fait avec d’autres constructions historiques, aujourd’hui disparues ?
Outre l’importance, à long terme, de préserver cette région de grande valeur environnementale de la construction continue (surtout dans les collines dans l’arrière-pays du Cap – qui sont également les lieux des bunkers, construits souvent sur les hauteurs), le travail de mémoire classique peut avoir un lien avec la sauvegarde de ces monuments comme le font les Journées du Patrimoine, le musée de la Ligne Maginot, le Mémorial de Caen, la station radar de Douvres, le musée du Débarquement d’Arromanches, celui d’Ouistreham, celui du Mémorial du Pegasus Bridge et surtout ceux des batteries des plages du Débarquement (Pointe du Hoc, Longues-sur-Mer, Gatteville, Merville, Crisbecq,…).
Le temps européen
Le mur de l’Atlantique est considéré comme un travail de l’occupant et depuis longtemps on a voulu le détruire. Maintenant que l’Allemagne est depuis longtemps dans l’Union européenne avec la France, le temps de l’effacement de l’Atlantikwall et de ses constructions « ennemies » serait-il révolu ? Beaucoup des fortifications ne sont pas connues par la population ou le public, surtout dans les régions, bien que stratégiques comme la Hague où aucune grande bataille n’a eu lieu. Les bunkers sont souvent la seule preuve tangible de la période 39-45. Et qu’en est-il de l’intérêt des populations, des touristes français, allemands ou autres ?
Y a-t-il une opportunité pour un mémorial moderne de la Seconde Guerre Mondiale au cap de la Hague ? Quels en seront les éléments ? On se repose sur le travail de Christelle Neveux. Un tel mémorial comporterait :
• un élément mémoriel mettant en exergue l’Occupation, la lutte contre l’occupant, le travail forcé (de personnes de toute l’Europe), le STO (service de travail obligatoire vers l’Allemagne) mais aussi le travail aux chantiers de la Hague ;
• un élément fonctionnel et touristique présentant une collection de vestiges ;
• un élément éducatif portant à la connaissance des adultes et des jeunes de tous âges et tous pays une période difficile de l’histoire de la France et de l’Europe.
On peut alors penser à des expositions sur les plus grands emplacements historiques du Mur, sur la photographie aérienne dans la Hague lors de la dernière guerre, ou d’un musée du radar et de la radio navigation.
Fig. 6 : Le secteur de la Hague a été l’objet de convoitises aériennes alliées lors de la dernière guerre : outre la photo des radars Freya à Auderville, les batteries de la Hague ont été photographiées plusieurs fois (source : U.S. National Archives et « Cap Liberté », 2004). Sur la photo, on voit Goury, La Roche et les batteries sur les « Monts ».
Fig. 8 : Un exemple de radar Mammut, implanté à Digulleville, faisant partie de la douzaine de radars implantés pendant la guerre dans la Hague. (source : A. Chazette).
51
Les sentiers de la mémoire
Fig 7 : A Douvres-la-Délivrande (Calvados), le musée radar montre l’importance de la « guerre des ondes ». Or, on y mentionne à plusieurs reprises le rôle important qu’a joué la Hague lors de la Seconde Guerre Mondiale.
Fig. 9 : Cette carte a été établie par les services de renseignement britanniques ; elle montre la couverture des radars allemands et comment la Hague était un important centre de détection radar. L’aviation alliée évitait de s’en approcher, sauf si elle devait bombarder ces installations.
52
Regardons par exemple la réconciliation franco-allemande avec ses lieux de recueillement mutuel. Weimar qui devient Capitale culturelle de l’Europe. Cette ville est un lieu d’enseignement, d’information, de recueil. Il ne faut pas vivre intégralement sous l’histoire, mais il faut lui donner un lieu pour la commémorer en pensant au futur. La préservation de l’Atlantikwall n’est souvent pas une raison suffisante pour restaurer les bunkers. Il faut avoir un raisonnement éducatif, un lien avec la Libération, avec l’Europe unifiée, avec une fonction spéciale (l’histoire du radar, l’histoire des fortifications, des douaniers, de la Seconde Guerre Mondiale, …).
De « zones interdites » à zones accessibles ?
Il semble que le sort de ces vestiges, ces constructions « condamnées », n’ait pas changé depuis le début de la guerre dans la Hague : elles restent dans leurs zones interdites, elles ont été détruites, sont introuvables, inaccessibles, méprisées, vandalisées ou au mieux, ignorées. Sauf par les chauves-souris, qui y trouvent, avec l’aide ou non d’associations, un hébergement garanti tranquille – comme par exemple dans la grotte du château de Beaumont (le parc dans lequel la grotte se trouve faisant partie du programme européen Natura 2000).
Par ces moyens, on pourrait fournir un nouvel attrait touristique et économique pour cette belle région historique et naturelle qu’est la Hague, à côté de son Hague-Dike, son Prévert et son Vendémiaire, son phare et ses ports, ses falaises et ses plages, ses landes et ses contrebandiers, ses églises et son usine, ses radars et ses randonnées, ses vaches et ses moutons.
Une situation intéressante existe déjà sur la Pointe du Nez à Saint-Germain-des-Vaux où la sécurisation du sentier pédestre a fait installer des passages piétons à travers une partie des vestiges de l’ancien fort qui s’y trouve encore aujourd’hui, caché sous les ronces. A d’autres endroits, l’accessibilité est déjà assurée ou facile à assurer via les sentiers du littoral : les vestiges à la pointe du Nez, à Goury, à Ecalgrain et à la Crecque via Vauville et Biville. D’autres endroits se trouvent dans des lieux à utilisation privée, mais sont souvent visibles de la voie publique (comme la batterie Stahl à Auderville).
Autres attraits pour rendre publics les vestiges de la Seconde Guerre Mondiale : l’assainissement environnemental, la propreté publique et ce dernier via le contrôle social : presque tous les bunkers, petits ou grands, posent actuellement un danger pour le bétail, ont un intérieur très sale et où se trouvent des déchets non-identifiés car ils ne sont pas contrôlés et sont souvent ouverts à tout public.
Fig. 10 : « La Saline » à la rade de Cherbourg : bunkers réaffectés au tourisme
53
Les sentiers de la mémoire
COMMENT VALORISER LE PATRIMOINE DU MUR DANS LE CAP DE LA HAGUE ?
Une valorisation institutionnelle
Il faut une politique concrète et surtout générale vis-à-vis des blockhaus, accompagnée par des historiens et archéologues. Pour la direction de l’Architecture et du Patrimoine qui gère le patrimoine national français et supervise les différents projets, il y a un travail d’études archéologiques dans la Hague (qui fait partie du projet du Groupe de recherches archéologique du Cotentin - GRAC) ou par le biais de la DRAC à Saint-Lô. Le projet de recherches du GRAC n’ouvre-t-il pas une opportunité pour une recherche archéologique sur la Seconde Guerre Mondiale dans la Hague ?
Il y a également souvent des passages du pouvoir central vers les autorités locales, ce qui peut générer un éparpillement des responsabilités face aux défis, surtout face à ceux du développement immobilier. Bien que la plupart des vestiges de la Seconde Guerre Mondiale se trouvent dans les zones de compétence du Conservatoire du Littoral, le simple fait d’avoir des territoires soumis à la loi sur le Littoral ne garantit pas une sécurité contre leur délabrement ou une décision de leur destruction.
Un sentier du littoral fléché et informatif
Un circuit de mémoire dans la Hague pourrait bien se connecter aux autres lieux de mémoire dans le Cotentin, par exemple ceux des lancements V1 et/ou V2 autour de Cherbourg et de Brix, ou les plages du Débarquement qui sont à une heure de route. Si on investit depuis des dizaines d’années déjà dans les différents stades de la bataille de Normandie (« Cobra », « Objectif un Port »,… de la bataille de Normandie), pourquoi pas une sorte de « circuit de la mémoire » à la Hague, dont la bataille en 1944 faisait bien partie d’ « Objectif un Port », le dernier faisant partie d’un circuit balisé et soutenu par les administrations de l’Etat et du Département et de la communauté de communes de la Hague, de son Office de Tourisme et des passionnés locaux.
On pourrait imaginer une extension « thématique » du sentier du littoral existant. Un exemple existe déjà sur le sentier entre Landemer et Gréville, où des plaques d’information et un fléchage accru sur Gréville et Millet ornent le sentier pour le plaisir des randonneurs.
En ce qui concerne les vestiges de la guerre, les touristes intéressés pourraient, via des accès réglementés dans le temps et restreints dans l’espace, avoir accès à des petites parties de propriété privée ou publique (comme le fait déjà en quelque sorte le sentier du littoral) pour visiter les vestiges existants de la Seconde Guerre Mondiale sur le territoire local. Souvent on découvre, en accédant aux anciennes fortifications, de magnifiques vues sur la région ou simplement la nature environnante. Les atouts touristiques de la région s’en renforceraient. On peut même imaginer un jumelage « fortifications de la Seconde Guerre Mondiale » ou bien « vestiges de guerre de tous les temps » avec Aurigny, île fortifiée à plusieurs reprises par différentes armées européennes.
Il serait également concevable d’organiser l’attention sur le rôle historique que la Hague a joué dans l’utilisation des nouveaux radars et postes de radioguidage allemands et de concevoir une visite guidée des postes de radar et de radioguidage dans la Hague.
Une partie de ces témoins de cette ère de guerre dans les ondes aériennes a été détruite après la construction du radar CROSS, de l’usine AREVA et plus récemment des quartiers d’habitation à Beaumont. Mais les postes de Digulleville (nord et sud) et un poste de radioguidage au bourg de Beaumont subsistent encore. Il y en a aussi à Auderville et à la Roche. « Le radar en temps de guerre et de paix » ? Un bon exemple d’un tel musée radar se trouve à Douvres-la-Délivrande (Calvados).
Un aménagement à moindre coût
Assisterons-nous à une défiguration du paysage en déblayant la plupart des vestiges ? Et qu’en est-il des autres besoins d’espace privé et public ? Il est difficile d’affecter les blockhaus à d’autres fonctions. Il y a des dangers d’instabilité, des restes de munitions, souvent des difficultés d’accès mais surtout des problèmes de propriété privée ou publique.
Après reconnaissance de l’importance de ce nouveau patrimoine, et sans faire appel à un grand aménagement, comme celui à la rade près de Cherbourg (où un ensemble de bunkers entier a été transformé en parc public, avec tables de pique-nique dans les cuvées des positions Flak), il est possible, avec un minimum de budget, de garantir un minimum de déblaiement et de protection des lieux avec des barrières, une construction de petits passages, des simples bornes d’information, entretenues annuellement par des volontaires ou ouvriers.
Des publications accessibles
Il ne faut pas seulement rendre accessibles les bunkers, mais aussi la connaissance sur ces vestiges. La médiathèque Côtis-Capel et la médiathèque de Jobourg possèdent une petite collection. Il serait intéressant de réunir à un endroit une consultation publique des ouvrages et récits existants sur le mur de l’Atlantique, la Seconde Guerre Mondiale dans la Hague et les sujets connectés, mentionnés plus haut (Hague-Dike, radars et CROSS, lien avec Cherbourg, …), montrant les liens entre les différentes parties de l’histoire riche de la Hague. Le livre « Les sentiers de la mémoire » a essayé de répertorier les ouvrages qui traitent de ces sujets.
Une exposition permanente
Les éléments de l’histoire haguaise susmentionnés méritent peut-être une nouvelle exposition lors des futurs anniversaires du Débarquement au Manoir du Tourp, mais certainement un élargissement d’une nouvelle exposition permanente sur l’histoire de la Hague. Finalement, cet espace culturel, en ce qui concerne les vestiges du Mur, pourrait instiguer un véritable travail archéologique à coordonner sur les vestiges de la Seconde Guerre Mondiale dans la région.
54
Un intérêt accru pour le tourisme de mémoire
Un calcul un peu rudimentaire nous mènerait à dire que l’équivalent de la surface d’un hameau haguais de bonne taille existerait sur le territoire de la Hague en bunkers, blockhaus et autres constructions de la Seconde Guerre Mondiale. Quand on regarde le village de Goury (Auderville) qui, pendant la guerre était totalement situé dans la zone interdite, ses quartiers nord et sud-ouest sont encore aujourd’hui très marqués par les vestiges de la guerre. Dans la Hague, on compte un grand nombre de vestiges d’envergure, comme les batteries de Laye, la Roche, le baraquement d’Auderville, les casemates de l’anse, du fort Saint-Martin et de la Pointe du Nez, les postes de radar ou radioguidage de Digulleville et de Beaumont, les bunkers de Vauville et de Biville, les batteries de la lande du Thot et de Sainte-Croix-Hague. En s’approchant du 70e anniversaire du Débarquement, il sera intéressant d’impliquer un tel patrimoine dans le futur développement de la région.
CONCLUSION
Jusqu’à aujourd’hui, rien n’a été entrepris de façon permanente pour montrer aux Haguais et aux visiteurs de la Hague quel rôle important cette région a joué dans l’histoire récente. Même le Manoir du Tourp ne mentionne pas (encore) le rôle historique de cette région pendant la Seconde Guerre Mondiale dans ses expositions et activités.
Nous trouvons qu’il y a là un champ d’action intéressant pour prendre des initiatives afin de sauvegarder pour les futures générations un patrimoine du XXème siècle. Ceci permettra de reconnecter la Hague avec un patrimoine historique plus large et d’y ajouter, à un moindre coût, un attrait qui est à la fois touristique, environnemental et économique.
SOURCES PRINCIPALES
Chazette Alain e.a., « Atlantikwall – Mythe ou réalité », Editions Histoire et Fortifications, 2008, 480 p.
Neveux Christelle, « Le Mur de l’Atlantique – vers une valorisation patrimoniale », L’Harmattan, Patrimoines et Sociétés, juin 2003, 315 p.
Deroo Rafaël, «Les sentiers de la mémoire – vers une valorisation des vestiges de la Seconde Guerre Mondiale au cap de la Hague », octobre 2013, 200 p.
Desquesnes Rémy, « Le mur de l’Atlantique », Editions Ouest-France, Rennes, 143 p.
Dowding Taylor, « Spies in the Sky: The Secret Battle for Aerial Intelligence during World War II », 2011, Little-Brown, 383 p.
Tassel Marie et Boucey Virginie, « Cap Liberté – La Hague pendant la Seconde Guerre Mondiale », Editions Office de Tourisme de la Hague, 2004 (brochure, expo, visites)
« Archéologie Historie Anthropologie de la presqu’île de la Hague », Etudes et travaux, volumes n° 5 et n° 6, resp. 2011 et 2012, Manoir du Tourp
Imperial War Museum, G.B. © IWM (C 5474) http://www.iwm.org.uk.
Fig. 11 : La seule valorisation de fortification de la Seconde Guerre Mondiale à la Hague : la restauration privée à Sainte Croix-Les Delles.
Fig. 12 : Beaucoup d’autres importants vestiges attendent une telle attention : ici la batterie de la lande du Thot à Vauville.