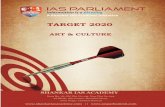Application of IAS 36 standard
Transcript of Application of IAS 36 standard
1
RESUME
Dans un contexte de globalisation et d’internationalisation, la mise en pratique d’une
normalisation comptable unique, quel que soit le pays ou l’entreprise en question, s’avère
prometteuse puisque cette adoption des normes internationales viendrait satisfaire les besoins en
information financière des différents partenaires. Portant essentiellement sur la dépréciation des
actifs, la norme IAS 36, touche grandement à cette information du moment qu’elle est en relation
directe avec le patrimoine des entreprises.
De ce fait, ce projet de fin d’étude, dont l’objectif ultime est non seulement d’appliquer la
norme IAS 36 au sein de l’OCP S.A, mais aussi d’étudier l’impact financier de cette application sur
cette dernière, a démontré que l’éventuel application de ladite norme nécessitera la collaboration
de plusieurs intervenants au sein de l’entreprise, et aura une incidence palpable sur trois niveaux
d’information financière, à savoir : la rentabilité, la valorisation des actifs, et l’endettement.
Mots clés : globalisation, normalisation comptable, normes internationales, partenaires, IAS 36,
dépréciation, actifs, information, financière, impact financier, rentabilité, valorisation, endettement.
ABSTRACT
In a context of globalization and internationalization, the implementation of a single
accounting standard, is promising, regardless of the country or the company in question, since the
adoption of international standards would fill the needs of the different partners in the financial
information. Focusing on the impairment of assets, IAS 36, affects this information greatly because
of its direct relation to the assets of the companies.
Therefore, this end of studies project, whose ultimate goal is not only to apply IAS 36 in the
OCP S.A, but also to study the financial impact of this application, showed that the future
application of this standard will require the collaboration of several stakeholders within the
company, and will have a palpable impact on three levels of financial information, namely:
profitability, asset valuation, and debt.
Key Words : globalization, accounting standard, international standards, partners, IAS 36, impairment,
assets, financial information, financier impact, profitability, valuation, debt.
2
DEDICACES
A mes chers parents qui ont toujours été là pour moi, en
reconnaissance à tous les sacrifices qu’ils ont consentis pour m’offrir ce
qu’il y a de meilleur.
J'espère qu'ils trouveront dans ce travail la preuve de l’amour et du
respect que je leur porte.
3
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail, mes plus vifs remerciements vont tout d’abord à l’ENCG d’El Jadida
qui m’a accueilli durant mes cinq années d’études supérieures. Ensuite mes remerciements
s’adressent a à la société OCP S.A qui m’a offert l’occasion de passer mon stage, et de réaliser
mon projet de fin d’étude dans les meilleures conditions.
Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à mon
encadrant pédagogique, Monsieur Salah OULFARSI, pour le temps qu’il m’a consacré, ses
directives précieuses, et pour la qualité de son suivi durant l’élaboration de mon projet.
Je profite de cette occasion pour adresser mes remerciements à Madame Meryame
LAHLOU, mon maitre de stage pour sa coopération, ses conseils et l’amabilité dont elle a fait
preuve, tout au long de la période de stage.
Je suis également redevable envers, M. MANSOUR, M. MZILI, et M. OUAD, responsables
contrôle de gestion, pour leurs conseils et leurs directives précieuses ainsi que leur disponibilité à
mon égard malgré leurs multiples occupations.
Je souhaite adresser mes chaleureux remerciements, à mes collègues de bureau, M. Nabil
DINARI, M. Mohamed, BOUSSAOUD, M. Mustapha BARAKAT, et M. Khalid GUOURICHY, pour les
services qu’ils m’ont rendus et leur sympathie.
Je n’oublierais pas non plus de remercier très sincèrement tout le cadre professoral et
administratif de l’ENCG El Jadida.
Enfin, Je remercie toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l’élaboration
de ce travail.
4
LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS
ANC: Actif Net Comptable
AP: Account Payables
ARC: Accounting Regulatory Committee
BFR: Besoin en fond de roulement
BMP: Bunge Maroc Phosphore
BO: Business Object
CA: Chiffre d’Affaires
CAF: Capacité d’autofinancement
CERPHOS: Centre d’Études et de Recherches des Phosphates minéraux
CMPC: Coût moyen pondéré du capital
DA: Dotations aux amortissements
DAP: Di Ammonium de Phosphate
DCF: Discount cash flow
EBE: Excédent brut d’exploitation
EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG),
EMAPHOS: Euro Maroc Phosphore
FA: Fixed Assets
FCF: Free cash flow
GL: General Ledger
HCROI: Human Capital Return on Investment
IAS: International Accounting Standards
IASB: International Accounting Standard Board
IASCF: International Accounting Standards Commitee Foundation
IFRIC: International Financial Reporting Interpretations Committee
IFRS: International Financial Reporting Standards
5
IMACID: Indo Maroc Phosphore
IS: Impôt sur les Societés
JESA: Jacobs Engineering SA
MAP: Mono Ammonium Phosphate
KDh: Milliers de dirham
MEDAF: Modèle d’évaluation des actifs financiers
MW: Mégawatt
N m3/h: Normaux mètres cubes
NPK: Azote, phosphore et potassium
OCP: Office Chérifien des Phosphates
P2O5 : Pentoxyde de phosphore
PMP: Pakistan Maroc phosphore
PO: Purchase Order
RE: Résultat d’exploitation
RI: Résultat Imposable
RN: Résultat net
ROA: Return On Asset
S.A: Société Anonyme
SIC: Standing Interpretation Committee
Smesi: Société d’Ingénierie et de Maîtrise d’œuvre des grands projets d’Investissements
SOTREG : Société de transport et exploitation des gravières
TSP : Phosphate trisodique en poudre
UGT : Unité Génératrice de Trésorerie
VNC : Valeur Nette Comptable
VT: Valeur terminale
6
LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Structure opérationnelle de l'IASB ........................................................................................ 15
Figure 2 : Schéma récapitulatif de la procédure de dépréciation ......................................................... 48
Figure 3 : Ecriture comptable de la dépréciation .................................................................................. 49
Figure 4 : Ecriture comptable de la reprise de perte de valeur............................................................. 50
Figure 5 : Chaîne de l'activité phosphatière .......................................................................................... 56
Figure 6 : Organigramme de l'OCP S.A .................................................................................................. 57
Figure 7 : Filiales du Groupe OCP .......................................................................................................... 58
Figure 8 : Organigramme du département comptabilité chimie .......................................................... 64
Figure 9 : Capture d'écran du progiciel Oracle ...................................................................................... 65
Figure 10 : Processus du choix du thème .............................................................................................. 66
Figure 11 : Méthodologie de travail ...................................................................................................... 68
Figure 12 : Processus de gestion des immobilisations .......................................................................... 72
Figure 13 : Processus de dépréciation au sein de l’OCP S.A (Comptabilité marocaine) ....................... 73
Figure 14 : Axes stratégiques fixés par le Groupe OCP ......................................................................... 75
Figure 15 : Processus des retraitements de passage aux IFRS .............................................................. 78
Figure 16 : Capture d'écran du progiciel BO Finance ............................................................................ 78
Figure 17 : Evolution de la production .................................................................................................. 85
Figure 18 : Evolution des ventes ........................................................................................................... 86
Figure 19 : Régression de la production réelle ...................................................................................... 88
Figure 20 : Evolution des prix de vente ................................................................................................. 89
Figure 21 : Variation des ventes en fonction des prix de vente ............................................................ 90
Figure 22 : Variation des charges en fonction de la production ........................................................... 92
Figure 23 : Circuit des flux d'informations relatives au processus de dépréciation............................ 115
7
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Historique de l'application des normes IAS/IFRS ................................................................ 16
Tableau 2 : Différences entre les normes marocaines et les IAS/IFRS .................................................. 34
Tableau 3 : Informations à fournir pour la norme IAS 36 ..................................................................... 39
Tableau 4 : Sources des indices de dépréciation................................................................................... 46
Tableau 5 : Récapitulatif de la démarche de dépréciation ................................................................... 51
Tableau 6 : Fiche technique d'OCP S.A .................................................................................................. 54
Tableau 7 : Historique du Groupe OCP ................................................................................................. 55
Tableau 8 : Modules du progiciel Oracle ............................................................................................... 65
Tableau 9 : Méthodologie de recherche ............................................................................................... 67
Tableau 10 : Comparaison des normes exigées et des retraitements effectués .................................. 82
Tableau 11 : Ecart entre la production espérée te la production réelle ............................................... 84
Tableau 12 : Ecart entre les ventes prévisionnelles et les ventes réelles ............................................. 85
Tableau 13 : Prévision de la production ................................................................................................ 88
Tableau 14 : Evolution des prix de vente .............................................................................................. 89
Tableau 15 : Prévision des prix de vente unitaires ................................................................................ 90
Tableau 16 : Evolution des ventes par rapport au prix ......................................................................... 90
Tableau 17 : Prévision des ventes en tonnes ........................................................................................ 91
Tableau 18 : Evolutions de la production et des charges décaissables ................................................. 91
Tableau 19 : Prévision des charges décaissables en KDh ...................................................................... 92
Tableau 20 : Prévision du Chiffre d'affaires en KDh .............................................................................. 93
Tableau 21 : Dotations aux amortissements en Dh .............................................................................. 93
Tableau 22 : Prévision des Résultats d'exploitation en KDh ................................................................. 94
Tableau 23 : Résultat Imposable en Dh ................................................................................................. 94
Tableau 24 : Cotisation minimale en KDh ............................................................................................. 94
8
Tableau 25 : Impôt prévisionnel sur les sociétés en KDh ...................................................................... 95
Tableau 26 : Prévision du BFR et de sa variation en KDh ...................................................................... 95
Tableau 27 : Prévision des flux de trésorerie de la nouvelle ligne DAP ................................................ 97
Tableau 28 : Plan d'amortissement de 590741RV-DEMARREU Avant dépréciation ............................ 99
Tableau 29 : Plan d'amortissement de 590741RV-DEMARREU Après dépréciation ............................. 99
Tableau 30 : Comparaison des principaux comptes du Bilan et du CPC avant et après dépréciation 100
Tableau 31 : Tableau comparatif des indicateurs financiers avant et après application de la norme IAS
36 ......................................................................................................................................................... 107
Tableau 32 : Bases de la conception du guide pratique ...................................................................... 113
Tableau 33 : Recensement des informations relatives à l'application de la norme IAS 36 ................ 114
Tableau 34 : Intervenants dans le processus de dépréciation ............................................................ 114
9
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE ............................................................................................. 10
Partie I : Présentation des normes IAS/IFRS .............................................................. 13
Chapitre 1 : Gnéralités sur les normes IAS/IFRS .................................................................. 14
Section1 : Définition et contexte historique des normes IAS/IFRS ............................... 14
Section 2 : Enjeux, objectifs, et cadre conceptuel des normes IAS/IFRS ...................... 17
Section 3 : Adoptions des normes IAS/IFRS au Maroc .................................................. 29
Chapitre 2 : Contenu de la norme IAS 36 ............................................................................ 36
Section 1 : Survol de l’IAS 36 ......................................................................................... 36
Section 2 : Notion de la valeur ...................................................................................... 39
Section 3 : Dépréciation de la valeur ............................................................................ 45
Partie II : Application de la norme IAS 36 au sein d’OCP S.A ................................. 53
Chapitre 1 : Environnement et contexte du stage .............................................................. 54
Section 1 : Présentation générale du Groupe OCP ....................................................... 54
Section 2 : Présentation du pôle chimie et du département d’accueil ......................... 60
Section 3 : Choix du thème et méthodologie................................................................ 66
Chapitre 2 : Application de la norme IAS 36 au sein du pôle chimie .................................. 71
Section 1 : Analyse des procédures IFRS de gestion des immobilisations au sein du pôle
Chimie .......................................................................................................................... 71
Section 2 : Mise en œuvre de la norme IAS 36 ............................................................. 82
Section 3 : Conception d’un guide pratique pour l’application de la norme IAS 36 ... 112
CONCLUSION GENERALE ................................................................................................ 119
REFERENCES ..................................................................................................................... 121
10
INTRODUCTION GENERALE
La comptabilité est généralement définie comme étant un système permettant
l’organisation de l’information patrimoniale, destiné à informer les tiers détenteurs de droits
réels sur l'entreprise, notamment les actionnaires, les créanciers, et l’Etat, et ce à travers la
fourniture d’états synthétisant la situation économique et financière de la société. Cette
vision patrimoniale de la comptabilité a montré ses limites dans une économie en
mouvement, qui devient plus financière qu’industrielle.
L’une des mutations les plus notables ayant caractérisé l’environnement comptable
international, ces dernières années, est l’adoption des normes comptables internationales
IAS/IFRS par un nombre important et croissant de nations. Pour la plupart de ces pays,
l’application des IAS/IFRS est un acheminement vers une nouvelle philosophie comptable
fondée essentiellement sur la communication d’une information financière de qualité et
utile à la prise de décision. En effet, les IAS/IFRS, sont un assortiment de recommandations
visant l’harmonisation internationale de l’information financière dans tous ses aspects, et ce,
pour obtenir une meilleure comparabilité, et plus de transparence des états financiers
publiés par les entreprises et les groupes.
Les normes comptables internationales se fondent sur une philosophie nouvelle. Elles
apportent un véritable changement d’esprit par rapport à la tradition comptable, en
adoptant de nouveaux concepts _tel que la prééminence de la substance sur la forme, ou
encore la juste valeur_ ainsi qu’en soulignant la primauté des investisseurs comme
destinataires de la l’information financière, et en privilégiant le bilan sur le compte des
produits et charges.
L’adoption des IFRS présente donc des enjeux majeurs pour les entreprises et les
investisseurs. En effet, dans le cadre de la mondialisation, les grandes entreprises, toujours
en quête de nouvelles parts de marché ont actuellement tendances à s’externaliser de plus
en plus et à rechercher des investisseurs et des partenaires provenant des quatre coins du
globe. Le Maroc est également concerné par cette mutation dans la mesure où l’économie
marocaine est très touchée par les effets de la mondialisation. Les normes comptables en
vigueur au Maroc sont basées sur la loi comptable 9-88 et le code générale de normalisation
11
comptable (CGNC) qui ont eu pour modèle de référence la quatrième directive de l’union
européenne. Avec l’évolution des pratiques comptables au niveau international, le
dispositif comptable marocain se trouve devancé par les efforts continus des autres pays en
matière de modernisation de leurs systèmes comptables. Dans ce contexte, les entreprises
marocaines se trouvent dans l’obligation de suivre ces mutations révolutionnaires en se
rapprochant des normes comptables internationales. Dans cette optique, en tant que
société marocaine cherchant à devenir leader sur le marché internationale, le Groupe OCP
présente depuis 2008 ses états financiers consolidés en norme IFRS.
Ce Groupe industriel, opérant dans la production des phosphates et ses produis
dérivés, est l’un des pionniers sur le plan international. Sa vocation ainsi lui a permis d’assoir
une position confortable sur le marché international des superphosphates. Cependant cette
position est plus que jamais sous une pression concurrentielle de plus en plus poussée.
Conscients de l’enjeu, les dirigeants de la firme ont fixé des objectifs stratégiques parmi
lesquels nous citons la relance de l’investissement industriel, et la normalisation financière à
travers le passage aux IAS/IFRS.
Si la question de mobilisation de capitaux pour investir dans des immobilisations est
un impératif majeur pour cette entreprise, il en est de même pour la gestion de ses actifs. La
détection d’une perte de valeur d’un actif présente deux atouts majeurs pour l’entreprise.
Elle lui permet d’une part la comptabilisation de ses actifs avec leurs vraies valeurs et
d’autre part de contrôler d’une manière plus efficace leurs performances.
Il en résulte donc que pour pouvoir mieux gérer ses immobilisations, et pour être en
adéquation avec les normes comptables internationales, le Groupe OCP est tenu de
pratiquer la norme IAS 36 traitant la dépréciation des actifs. Toutefois, suite à notre analyse,
OCP S.A n’inclut pas un traitement permettant son alignement avec ladite norme.
De ce fait, se pose logiquement la problématique suivante :
Comment pouvons-nous appliquer la norme IAS 36, qui traite la dépréciation des
actifs, au sein d’OCP S.A ? Et quel est l’impact de cette application sur l’information
financière de l’entreprise ?
12
Pour répondre à notre problématique, et mener à bien notre étude, nous avons
décidé de présenter ce rapport sous forme de deux parties. La première qui se veut
purement théorique, sera consacrée au cadre global de l’étude, à travers lequel, nous
exposerons les concepts et les objectifs des IAS/IFRS, et spécialement la norme IAS 36
relative à la dépréciation des actifs, et sujet de notre projet de fin d’étude. Tandis que la
deuxième partie sera empirique, et exposera le volet pratique de notre projet au sein du
pôle chimie d’OCP S.A, avec tout d’abord une présentation de ce dernier et de la
méthodologie de travail, pour ensuite enchaîner avec une analyse des procédures actuelles
de gestion des immobilisations, et un exposé de notre essai d’application de la norme IAS 36.
Le travail que nous avons effectué, se base sur une démarche scientifique, allant du
choix du thème, à l’analyse des résultats et à la généralisation de l’application de la norme
IAS 36, en passant par la revue de la littérature, la collecte des données, ainsi que leurs
traitements. Il faut noter que ce traitement, consiste en une détection de la dépréciation et
en un calcul d’un ensemble d’indicateurs financiers suite à la perte de valeur constatée, et
ce, afin de déceler l’écart existant entre l’information financière obtenue, avant et après
application de la norme IAS 36.
13
Partie I : Pre sentation des normes IAS/IFRS
Introduction
L’évolution des marchés financiers a extériorisé et souligné les limites de
l'individualisation des référentiels comptables nationaux, notamment, l’inexistence formelle
d'un système de normes unifiées pour les entreprises qui lèvent des capitaux sur les marchés
internationaux; l’absence d'homogénéité de l'information financière fournie aux investisseurs
; et l’investissement important en temps pour les directeurs financiers de sociétés afin de
présenter l'information financière selon les différents référentiels. Dans ce cadre, visant
l’amélioration de la comparabilité et la transparence de l’information financière en Europe, la
Commission européenne a émis le Règlement n° 1606/2002 rendant ainsi, obligatoire
l’application des normes internationales IAS/IFRS par les sociétés communautaires dont les
titres sont admis à la négociation sur les marchés réglementés d’un Etat membre, dans leurs
états financiers consolidés à partir de 2005. Cependant, l’adoption d’un référentiel comptable
de qualité ne représente qu’une étape intermédiaire dans le processus du reporting financier.
Une fois les normes IFRS sont entrées en vigueur, il s’est avéré nécessaire de s’assurer que
celles-ci soient bien respectées.
Dans ce contexte, il faut mettre le point sur une norme particulièrement complexe, et
difficile à respecter, à savoir, la norme IAS 36 qui traite la dépréciation des actifs.
Nous allons donc dans cette partie, mettre la lumière dans un premier temps sur
l’évolution historique des normes IAS/IFRS, ainsi que sur leurs enjeux et principaux objectifs
(Chapitre 1). L’analyse portera par la suite, sur un aperçu de la norme IAS 36, et de la
démarche de dépréciation (Chapitre 2).
14
Chapitre 1 : Généralités sur les normes IAS/IFRS
Suite aux scandales financiers qui ont marqué le début des années 2000 en Europe et
aux Etats Unis notamment le scandale Enron et Worldcom, la qualité de l’information
financière fournie par les groupes et leurs filiales a été renforcée par l’application des normes
internationales IAS devenues IFRS en 2001. Au titre de ce chapitre nous présenterons un
aperçu de l’historique des normes IAS/IFRS et ce dans la section 1, l’analyse se penche ensuite
dans la section 2 sur les enjeux et le cadre conceptuel des normes comptables
internationales, la section 3 quant à elle abordera la question de l’adoption de ces normes au
Maroc.
Section1 : Définition et contexte historique des normes IAS/IFRS
1-1 Définition des normes IAS/IFRS
Les normes IAS/IFRS sont un ensemble de recommandations qui comprennent trois
types de textes1, notamment :
les normes internationales d’information financière, dites IFRS ;
les normes comptables internationales, dites IAS ;
les interprétations des normes internationales d’information financière, dites
SIC.
Malgré les dénominations différentes des deux premiers types de textes, il n’existe
pas une différence notable. En effet, la seule différence réside dans l’époque de publication
de la norme. D’une part, les IAS sont les normes ayant été publiées avant 2001. D’autres
parts, les IFRS sont celles dont la publication est postérieure à cette date. 2 Ces normes ont
pour finalité l’harmonisation de l'information financière dans ses différents aspects au
niveau international, y compris son aspect comptable, et ce afin d’atteindre une meilleure
comparabilité, ainsi qu’une meilleure transparence des états financiers publiés par les
groupes et les entreprises.3 Elles apportent un véritable changement d’esprit par rapport à la
tradition comptable, et ce en privilégiant les investisseurs comme destinataires de la
1 Norme IAS 1 ; Paragraphe 7 2 http://www.differencebetween.net/business/difference-between-ias-and-ifrs/
3 Steve COLLINGS ; Frequently Asked Questions in IFRS ; 2013 ; Page 22
15
comptabilité, en adoptant des concepts nouveaux tel que « La juste valeur », ainsi qu’en
soulignant la primauté du bilan sur les comptes des produits et charges.
1-2 Organisation de la normalisation comptable
Créé en 1973 par les instituts comptables de 9 pays, l’IASC avait pour objectif
l’élaboration et la publication des normes internationales d'information financière pour la
présentation des états financiers, ainsi que la promotion de leur utilisation et leur
généralisation à l'échelle mondiale. Suite à une réforme en 2001, l’IASC a été substitué par
l’IASB qui est un organisme indépendant chargé d’élaborer les normes IAS/IFRS. Il est
chapoté par la fondation Trustees qui a la responsabilité de nommer les quatorze
personnes formant l’IASB.
Les Trustees gèrent un autre organisme dénommé IFRIC. Le rôle de ce dernier est
d’expliquer le traitement comptable à effectuer pour une opération si des explications
concernant la dite opération manquent dans le texte des normes.4
La figure suivante représente la structure opérationnelle actuelle de l’IASB5 :
Figure 1 : Structure opérationnelle de l'IASB
4 Robert OBERT ; Pratiques des normes IFRS : Normes IFRS et US GAAP ; Dunod ; 2013 ; Page 14
5 Eric TORT ; L’essentiel des normes IFRS ; Gualino ; 2012 ; Page 18
16
Il faut tout de même noter que d’autres organismes interviennent dans Le processus
de normalisation comptable, notamment l’EFRAG qui étudie l’applicabilité d’une nouvelle
norme à l’union européenne, et l’ARC qui décide du calendrier d’application si l’étude
aboutit à un résultat positif.6
1-3 Historique
Le tableau ci-dessous résume le processus historique de l’évolution et de l’application
des normes IAS/IFRS :
Années Evènements
1973 Création de l’IASC à Londres par les instituts comptables de 9 pays.
1975 Publication des deux premières normes IAS 1 et IAS 2.
1982 Dévolution officielle du rôle de normalisateur comptable à l’IASC.
1987-1993 Processus d’amélioration des normes afin d’assurer une meilleure comparabilité des états financiers.
1989 Publication du cadre conceptuel pour la préparation et la présentation des états financiers.
1995 Recommandation d’acceptation des états financiers présentés selon les normes internationales pour les cotations effectuées sur les marchés internationaux.
2001 Réforme de l’IASC : création de l’IASCF, de l’IASB, et de l’IFRIC.
2002 Règlement européen pour l’application des normes comptables internationales.
2003 Publication de la version révisée des 13 normes existantes.
2005 _Diffusion de nouvelles normes : de IFRS 1 à IFRS 8. _Application des normes IAS/IFRS.
2006 Élaboration d’une norme spécifique applicable aux PME.7
Tableau 1 : Historique de l'application des normes IAS/IFRS
6 Eric TORT ; L’essentiel des normes IFRS ; Gualino ; 2012 ; Page 20
7 Bernard CHAUVEAU ; Les normes internationales de l’IASB ; Editions e-theque ; 2003 ; page 6-7
17
Section 2 : Enjeux, objectifs, et cadre conceptuel des normes IAS/IFRS
2-1 Les enjeux des normes IAS/IFRS
Divers sont les enjeux de l’application normes IAS/IFRS pour les entreprises. D’une
part, après les scandales des manipulations comptables qui ont faussé les résultats de
sociétés aussi emblématiques qu’Enron ou Worldcom, l’économie internationale a remis en
cause la qualité de l’information financière. D’autres parts, un projet de passage aux normes
IAS/IFRS implique de lourdes conséquences opérationnelles :8
a) le passage aux normes IAS/IFRS au service de la sécurisation, et la restauration de la
crédibilité de l’information financière
La reproduction des scandales financiers a mené à la restauration de la crédibilité de
l’information financière via la transparence et la sécurisation accrue des états financiers.
Pour assurer la pérennité économique et financière des entreprises, il est nécessaire
d’éliminer le doute profond et durablement nocif concernant la fiabilité des chiffres
annoncés. Cette crédibilité ne pourra s’installer sans la contribution des normes comptables
internationales IAS/IFRS qui ont une connotation plus économique que juridique.
En effet, le passage aux normes IAS/IFRS ne constitue pas un nouveau style mais il
s’agit bel et bien d’un système qui tend à améliorer la qualité de l’information financière et à
la rendre plus fiable pour ses utilisateurs. On cherche également via ces normes à sécuriser
les services, les prestations et les productions de l’entreprise. La communication des états
financiers peut être assimilée à la commercialisation des produits courants de l’entreprise
dans la mesure où la pérennité et la rentabilité de l’entreprise dépendent largement de la
qualité des états de financiers élaborés.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’amélioration de l’image fidèle de l’entreprise, les
changements des durées d’amortissement nous semblent un exemple pertinent de l’apport
des normes IAS/IFRS : Aujourd’hui, plusieurs entreprises procèdent pour des fins
d’optimisation fiscale, à amortir leurs immobilisations corporelles (matériel, machines,
outillages…) sur des durées courtes suite à la tolérance de l’administration fiscale en ce sens.
8 www.xavierpaper.com/documents/art/p.Magsecurs.18.12.03.ias1.doc
18
Par ailleurs, les normes IAS/IFRS imposent d’appliquer des durées d’amortissement
équivalentes aux durées d’usage effectif des immobilisations. L’adoption de ce nouveau
système d’amortissement a pour objectif de réduire les charges d’amortissement de
l’entreprise, d’améliorer ses résultats et de fournir une image fidèle que devraient présenter
les états financiers de l’entité.
b) le passage aux normes IAS/IFRS relève de la gestion de projet
Pour pouvoir contribuer à la réussite du projet de passage aux normes IAS/IFRS il est
nécessaire de bien gérer et maitriser la phase amont de la définition et d’expression des
besoins des utilisateurs et d’élaboration des cahiers des charges. La gestion de ce projet va
faire intervenir différentes directions opérationnelles (commercial, achats, production…) et
fonctionnelles (administration, gestion, trésorerie, financement…). Cependant, le problème
qui se pose est celui de vulgariser les changements dus à l’application des nouvelles normes
comptables, ayant une dimension conceptuelle, pour les traduire sous forme de
spécifications techniques détaillées et exploitables immédiatement par les informaticiens.
c) le passage aux normes IAS/IFRS a des conséquences opérationnelles et
administratives lourdes
Le passage aux normes IAS/IFRS aura des impacts majeurs sur les techniques
quotidiennes de traitement et d’établissement des états financiers. Parmi ces impacts, nous
évoquons d’une part, l’adaptation des outils comptables à la spécificité des nouvelles
normes, et d’autre part l’obligation du personnel à les adopter, ce qui constitue un
investissement important dans la formation des cadres chargés de la comptabilisation en
IFRS. Par ailleurs9, les entreprises qui adoptent les normes IAS/IFRS se trouvent dans
l’obligation de modifier leurs systèmes d’informations en intégrant de nouveaux modules de
gestion, ou bien, faisant l’acquisition de progiciels performants, adaptés aux normes
IAS/IFRS, et assurant les fonctions de reporting pour les filiales. Cette modification
représente souvent un lourd investissement pour les entreprises.
9 Hervé PUTEAUX ; Norme IAS/IFRS : Une simple affaire de présentation ; Sage ; 2004 ; Page 17
19
2-2 Le cadre conceptuel des normes IAS/IFRS Le cadre conceptuel de l'IASB n'est pas une norme comptable internationale. Il ne
comporte donc pas de disposition normative en matière d'évaluation ou d'information à
fournir. Publié par l'IASC en juillet 1989 et adopté par l’IASB en avril 2001, il fait
actuellement l'objet d'un réexamen par ce dernier. En effet, le 6 Février 201310, les
normalisateurs comptables nationaux français, allemand, italien et britannique ont publié
leurs propositions sur la révision du cadre conceptuel des IFRS, et ce, afin de participer au
débat critique pour l’avenir des IFRS, et d’assurer finalement que le cadre conceptuel révisé
qui sera adoptée en 2015, reflètera un modèle comptable sous-jacent, favorable à des
normes d’information financière robustes et efficaces.
a) Objectif du cadre conceptuel
Le cadre conceptuel11 définit les concepts qui sont à la base de la préparation et de la
présentation des états financiers à l'usage des utilisateurs externes. L'objectif de ce cadre est
notamment :
d'aider l'IASB à développer les futures normes comptables internationales et à réviser
celles qui existent déjà ;
d'aider les préparateurs des états financiers à appliquer les IAS et IFRS et à traiter des
sujets qui doivent encore faire l'objet d'une norme ;
d'aider les auditeurs à se faire une opinion sur la conformité des états financiers avec
les normes comptables internationales ;
d'aider les utilisateurs des états financiers à interpréter l'information contenue dans
les états financiers préparés en conformité avec les normes comptables
internationales.
b) Champ d'application
Le cadre conceptuel traite des questions suivantes :
l'objectif des états financiers ;
10 http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/efrag_et_autres_normalisateurs_strategie_sur_la_revision_du_cadre_conceptuel_des_ifrs 11http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/que_sont_les_ias_ifrs/cadre_conceptuel
20
les caractéristiques qualitatives qui déterminent l'utilité de l'information contenue
dans les états financiers ;
la définition, la comptabilisation et l'évaluation des éléments à partir desquels les
états financiers sont construits ;
les concepts de capital et de maintien de capital.
Le cadre conceptuel s'intéresse aux états financiers à usage général, y compris aux
états financiers consolidés. Ces états financiers sont préparés et présentés au moins une fois
par an et visent à satisfaire les besoins d'informations communs à un nombre important
d'utilisateurs. Un jeu complet d'états financiers comprend un bilan, un compte de résultat,
un tableau des flux de trésorerie, et un état indiquant l'ensemble des variations des capitaux
propres. 12
Le cadre conceptuel s'applique aux états financiers de toutes les entreprises
commerciales, industrielles ou autres, qu'elles appartiennent au secteur public ou au secteur
privé.
c) Les utilisateurs et leurs besoins d'information
Les utilisateurs des états financiers comprennent les investisseurs actuels et
potentiels, les membres du personnel, les prêteurs, les fournisseurs et autres créanciers, les
clients, les Etats et leurs organismes publics et le public. Ils utilisent les états financiers afin
de satisfaire certains de leurs besoins différents d'informations. Comme
les investisseurs sont les apporteurs de capitaux à risque de l'entreprise, la fourniture d'états
financiers qui répondent à leurs besoins répondra également à la plupart des besoins des
autres utilisateurs susceptibles d'être satisfaits par des états financiers. C'est d'abord sur la
direction de l'entreprise que repose la responsabilité de la préparation et de la présentation
des états financiers.
d) l'objectif des états financiers
L'objectif des états financiers est de fournir une information sur la situation
financière, la performance et les variations de la situation financière d'une entreprise, qui
soit utile à un large éventail d'utilisateurs pour prendre des décisions économiques.
12
Eric TORT ; L’essentiel des normes IFRS ; Gualino ; 2012 ; Page 23
21
e) Hypothèses de base
Le cadre conceptuel se base sur deux hypothèses principales :13
Comptabilité d'engagement : les états financiers sont préparés sur la base de la
comptabilité d'engagement. Selon cette base, les effets des transactions et autres
événements sont comptabilisés quand ces transactions ou événements se produisent
(et non pas lorsque le versement ou la réception de trésorerie interviennent) et ils
sont enregistrés dans les livres comptables et présentés dans les états financiers des
exercices auxquels ils se rattachent ;
Continuité d'exploitation : les états financiers sont normalement préparés selon
l'hypothèse qu'une entreprise est en situation de continuité d'exploitation et
poursuivra ses activités dans un avenir prévisible. Ainsi il est supposé que l'entreprise
n'a ni l'intention, ni la nécessité de mettre fin à ses activités, ni de réduire de façon
importante la taille de ses activités. S'il existe une telle intention ou une telle
nécessité, les états financiers peuvent être préparés sur une base différente, et, s'il en
est ainsi, la base utilisée doit être indiquée.
f) Caractéristiques qualitatives des états financiers
Afin de rendre utile l'information pour les utilisateurs, quatre caractéristiques
qualitatives principales des états financiers sont exigées, à savoir: l'intelligibilité, la
pertinence, la fiabilité, et la comparabilité.14
intelligibilité : l’information fournie dans les états financiers doit être
compréhensible immédiatement par les utilisateurs supposés diligents et dotés d’une
connaissance raisonnable des affaires et des activités économiques ainsi que de la
comptabilité. En effet, l’information relative à des sujets complexes, qui doit être
incluse dans les états financiers du fait de sa pertinence par rapport aux besoins de
13
Michel MEAU ; Cours : Le cadre conceptuel comptable de l’IASB ; Centre de Ressource Comptabilité et Finance 14
Eric TORT ; L’essentiel des normes IFRS ; Gualino ; 2012 ; Page 24
22
prises de décisions économiques des utilisateurs, n’est pas à écarter au seul motif
qu’elle serait difficile à assimiler par certains utilisateurs.15
pertinence : l’utilité de l’information est dépendante de sa pertinence pour les besoins
de prises de décisions des utilisateurs. L'information possède la qualité de pertinence
lorsqu'elle influence les décisions économiques des utilisateurs en les aidant à évaluer
des événements passés, présents ou futurs, ou en confirmant ou corrigeant leurs
évaluations passées. La pertinence de l'information est influencée par sa nature et son
importance relative.
Dans certains cas, la nature de l’information est suffisante, à elle seule, à lui conférer
cette qualité de pertinente. A titre d’exemple, la conquête d’un nouveau secteur peut
affecter l’appréciation des menaces et des opportunités auxquels fait face l’entreprise,
quelle que soit l’importance relative des résultats réalisés par le nouveau secteur au
cours de l’exercice.
Par ailleurs, dans d’autres cas, la nature et l‘importance relative jouissent du même
degré d’importance, à titre d’exemple, le montant des stocks détenus dans chacune
des principales catégories qui sont appropriées à l’activité. L’information est
significative si son omission ou son inexactitude peut influencer les décisions
économiques que les utilisateurs prennent sur la base des états financiers.
L'importance relative dépend de la taille de l'élément ou de l'erreur, jugée dans les
circonstances particulières de son omission ou de son inexactitude. En conséquence,
l'importance relative fournit un seuil ou un critère de séparation plus qu'une
caractéristique qualitative principale que l'information doit posséder pour être utile.
fiabilité : l'information est qualifiée de fiable quand elle ne contient ni erreurs, ni biais
significatifs, et que les utilisateurs peuvent lui faire confiance pour présenter une
image fidèle de ce qu'elle est censée présenter ou de ce qu'on pourrait s'attendre
raisonnablement à voir présenter.
Trois caractéristiques sont nécessaires pour garantir la fiabilité de
l’information16:
15
Mohammed MOKHLIS ; Zakaria ROUIJA ; PFE : Application de la norme IAS 16 au sein de la DEPJL ; Université Chouaib Doukkali ; ENCG El Jadida ; 2012 ; Page 30
23
Présentation d’une image fidèle : pour être fiable, l'information doit présenter
une image fidèle des transactions et autres événements qu'elle vise à présenter ou
dont on s'attend raisonnablement à ce qu'elle les présente. Ainsi, à titre exemple, un
bilan doit être une photographie de la situation de l’entreprise à une date donnée,
qui traduit une image fidèle des transactions et autres événements qui génèrent des
actifs, des passifs et des capitaux propres et qui satisfont aux critères de
comptabilisation.
Si l'information doit présenter une image fidèle, il est nécessaire d’appliquer le
principe de la prééminence de la substance sur la forme afin que les transactions et
autres événements soient comptabilisés et présentés conformément à leur substance
et à leur réalité économique et non pas seulement selon leur forme juridique. En
effet, la substance n’est pas toujours cohérente avec ce qui ressort du montage
juridique apparent. L’exemple suivant nous paraît adapté pour illustrer ces propos :
En cas de cession des actifs d’un tiers, les actes visent en général à attribuer la
propriété juridique à ce tiers. Cependant, des accords peuvent exister, qui font en
sorte que l’entreprise continue à percevoir des avantages économiques futurs liés à
cet actif. Dans de telles situations, la comptabilisation d’une vente ne présenterait
pas une image fidèle de la transaction qui a été conclue ;
neutralité : pour qu’elle soit fiable, l'information contenue dans les états
financiers doit être neutre aussi, c'est-à-dire sans parti pris. Les états financiers ne
sont pas neutres si, par la sélection ou la présentation de l'information, ils influencent
les prises de décisions ou le jugement afin d'obtenir un résultat ou une issue
prédéterminée. Cependant, les préparateurs d’états financiers sont confrontés aux
doutes qui entourent inévitablement un nombre élevé de circonstances et
d’événements, comme le recouvrement des créances douteuses, la durée d’utilité
probable des immobilisations corporelles et le nombre de demandes en garantie qui
peuvent survenir. De telles incertitudes sont reconnues à travers l’exercice de la
prudence dans la préparation des états financiers. Cette dernière est la prise en
compte d'un certain degré de précaution dans l'exercice des jugements nécessaires
pour préparer les estimations dans des conditions d'incertitude, pour faire en sorte
16
Eric TORT ; L’essentiel des normes IFRS ; Gualino ; 2012 ; Page 25
24
que les actifs ou les produits ne soient pas surévalués et que les passifs ou les charges
ne soient pas sous-évalués. Cependant l'exercice de la prudence ne permet pas, par
exemple, la création de réserves occultes ou de provisions excessives, la sous-
évaluation délibérée des actifs ou des produits, ou la surévaluation délibérée des
passifs ou des charges, parce que les états financiers ne seraient pas neutres, et, en
conséquence, ne possèderaient pas la qualité de fiabilité ;
exhaustivité : pour être fiable, l'information contenue dans les états financiers
doit être exhaustive, autant que le permettent le souci de l'importance relative et
celui du coût. Une omission peut rendre l'information fausse ou trompeuse et, en
conséquence, non fiable et insuffisamment pertinente17 ;
comparabilité : l'évaluation et la présentation de l'effet financier de transactions et
d'événements semblables doivent être effectués de façon cohérente et permanente,
et ce sur deux plans :
plan chronologique : les utilisateurs doivent être en mesure de comparer les
états financiers d’une entreprise dans le temps afin d’identifier les tendances de
sa situation financière et de sa performance ;
comparabilité entre entreprises : Les utilisateurs doivent être en mesure de
comparer les états financiers d’entreprises différentes afin d’évaluer, de façon
relative, leurs situations financières, leurs performances et les variations de leurs
situations financières. 18
g) contraintes à respecter pour que l'information soit pertinente et fiable
Les caractéristiques qualitatives de l’information doivent être appliquées en tenant
compte de trois contraintes ou limites 19:
célérité : l'information peut perdre sa pertinence si elle est fournie avec un retard
indu, il est donc nécessaire pour l’utilisateur de l’obtenir au moment opportun ;
17
Mohammed MOKHLIS ; Zakaria ROUIJA ; PFE : Application de la norme IAS 16 au sein de la DEPJL ; Université Chouaib Doukkali ; ENCG El Jadida ; 2012 ; Page 31 18
Robert OBERT ; Pratiques des normes IFRS : Normes IFRS et US GAAP ; Dunod ; 2013 ; Page 63 19
http://www.procomptable.com/iasb/comparaison/ccc.htm
25
rapport coût/avantage : le rapport coût/avantage est une contrainte générale plutôt
qu'une caractéristique qualitative. Les avantages obtenus de l'information doivent
être supérieurs au coût qu'il a fallu consentir pour la produire ;
équilibre entre les caractéristiques qualitatives : en pratique, la recherche d'un
équilibre ou d'un arbitrage entre les caractéristiques qualitatives est souvent
nécessaire, puisque l’accent sur une qualité se fera généralement au détriment d‘une
autre. Pour assurer cet équilibre, il faut prendre en considération le fait que le cadre
conceptuel fait la distinction entre des caractéristiques qualitatives fondamentales, à
savoir : la pertinence et la fiabilité, et les caractéristiques qualitatives auxiliaires qui
sont l’intelligibilité et la comparabilité20.
En effet, l'importance relative des caractéristiques dans les divers cas est une affaire
de jugement professionnel21.
h) image fidèle/présentation fidèle
L'application des principales caractéristiques qualitatives et des dispositions
normatives comptables appropriées a normalement pour effet que les états financiers
donnent ce qui généralement s'entend par image fidèle ou présentation fidèle de la situation
financière, de la performance et des variations de la situation financière d'une entreprise.
i) éléments des états financiers
Le cadre conceptuel identifie dans les états présentant la situation financière et la
performance de l'entité un certain nombre d'éléments essentiels. Il faut noter que dans la
logique des IAS/IFRS, qui stipule que l'information financière est destinée prioritairement
aux investisseurs, l'IASB privilégie dans ses normes, les informations fournies par le bilan,
qualifié d'état de de la situation financière, à celles données par le compte de résultat.
Font l'objet d'une définition et de commentaires approfondis les 5 notions suivantes:
actifs, passifs et capitaux propres pour le bilan, produits et charges pour le compte de
résultat. 22
20
Robert OBERT ; Pratiques des normes IFRS : Normes IFRS et US GAAP ; Dunod ; 2013 ; Page 61 21
Omar BENGELLOUN ; L’impact des nouvelles normes IFRS sur la qualité de l’information financière ; Université Montesquieu Bordeaux 4
26
actifs : un actif est une ressource contrôlée par l'entreprise du fait d'événements
passés et dont des avantages économiques futurs sont attendus par cette dernière.
L'avantage économique futur représentatif d'un actif est le potentiel dont ce dernier
dispose pour contribuer, directement ou indirectement, à des flux de trésorerie et
d'équivalents de trésorerie au bénéfice de l'entreprise ;
passifs : un passif est une obligation actuelle de l'entreprise résultant d'événements
passés et dont l'extinction devrait se traduire pour l'entreprise par une sortie de
ressources représentatives d'avantages économiques ;
capitaux propres : les capitaux propres sont l'intérêt résiduel dans les actifs de
l'entreprise après déduction de tous ses passifs ;
produits : les produits sont les accroissements d'avantages économiques au cours de
l'exercice, sous forme d'entrées ou d'accroissements d'actifs, ou de diminutions de
passifs qui ont pour résultat l'augmentation des capitaux propres autres que les
augmentations provenant des apports des participants aux capitaux propres ;
charges : les charges sont des diminutions d'avantages économiques au cours de
l'exercice sous forme de sorties ou de diminutions d'actifs, ou de survenance de
passifs qui ont pour résultat de diminuer les capitaux propres autrement que par des
distributions aux participants aux capitaux propres.
j) comptabilisation des éléments des états financiers
Un article qui satisfait à la définition d'un élément doit être comptabilisé si :
il est probable que tout avantage économique futur qui lui est lié ira à l'entreprise ou
en proviendra ;
l'article a un coût ou une valeur qui peut être évalué de façon fiable.
Un article qui possède les caractéristiques essentielles d'un élément mais qui ne
satisfait pas aux critères de comptabilisation peut néanmoins mériter une information dans
les notes annexes, textes explicatifs ou tableaux supplémentaires.
22
Robert OBERT ; Pratiques des normes IFRS : Normes IFRS et US GAAP ; Dunod ; 2013 ; Page 68
27
k) évaluation des éléments des états financiers
L'évaluation est le processus consistant à déterminer les montants monétaires
auxquels les éléments des états financiers vont être comptabilisés et inscrits au bilan et au
compte de résultat. Ceci implique le choix de la convention appropriée d'évaluation, qui
peut être23 :
le coût historique ;
le coût actuel ;
la valeur de réalisation ou de règlement ;
la valeur actuelle (c'est-à-dire la valeur actualisée des entrées ou des sorties nettes
futures de trésorerie).
l) concepts de capital et de maintien du capital
Un concept financier de capital est adopté par la plupart des entreprises pour
préparer leurs états financiers. Deux concepts sont à distinguer :
Selon un concept financier de capital, tel que celui de l'argent investi ou du pouvoir
d'achat investi, le capital est synonyme d'actif net ou de capitaux propres de
l'entreprise ;
Selon un concept physique de capital, tel que la capacité opérationnelle, le capital est
considéré comme la capacité productive de l'entreprise, fondée, par exemple, sur les
unités produites par jour.
Le choix du concept de capital approprié pour une entreprise doit être fondé sur les
besoins des utilisateurs de ses états financiers. En termes généraux, une entreprise
maintient son capital si elle a autant de capital à la clôture de l'exercice qu'elle en avait à
l'ouverture de l'exercice. Le choix des conventions d'évaluation et du concept de maintien de
capital détermine le modèle comptable utilisé pour la préparation des états financiers.
23http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/que_sont_les_ias_ifrs/cadre_conceptuel
28
2-3 Principaux objectifs des normes IAS/IFRS
La vocation ultime des normes comptables internationales IAS/IFRS est de procurer
une information financière utile pour les utilisateurs (dirigeants, investisseurs, membres du
personnel, fournisseurs, clients, État…). En effet, dans un contexte où les états financiers
sont établis selon les usages appliqués en vigueur dans un pays donné, l’information
financière communiquée est jugée difficilement compréhensible par les investisseurs
étrangers donc les normes comptables internationales viennent résoudre cette
problématique en veillant à ce qu’une comparabilité (dans le temps et dans l’espace) entre
les états financiers soit possible.24 Il s’agit de favoriser l’émergence d’une information
financière à jour, de qualité, reconnue au niveau international et susceptible de donner une
image plus fidèle sur la réalité économique d’une entreprise, indépendamment du système
juridique et fiscal de son pays d’origine.
Ce sont généralement les sociétés cotées en bourse qui sont tenues de présenter leurs
états financiers selon les normes IAS/IFRS. D’une part, elles doivent être capables de fournir
une information transparente, de qualité, et globale, destinée aux investisseurs afin de les
attirer, les sécuriser et les aider dans leur prise de décisions. comme elles doivent
également respecter les contraintes imposées par le marché en matière de politique
d’information, l’application des IAS/IFRS répond aux attentes des investisseurs en matière
d’informations et par conséquent aident les entreprises à obtenir des conditions de
financement plus avantageuses.
Trois objectifs principaux des normes IAS/IFRS à citer :
l’exhaustivité : il s'agit d'intégrer dans les comptes tout ce qui fait l'économie de
l'entreprise. Avec une conséquence : la disparition quasi totale du hors-bilan ;
les annexes : si le rapport annuel version IAS/IFRS est en lui-même peu épais, les
normes exigent des annexes très détaillées. C'est ce que réclamait la communauté des
analystes financiers. Ils vont avoir en main des documents normés, identiques pour
toutes les entreprises, qui vont leur permettre de prendre leurs décisions de
recommandation d'achat et de vente de manière rationnelle ;
24
http://www.argusdelassurance.com/institutions/origines-principes-et-enjeux-des-normes-ias-ifrs.30656
29
la substance prédomine la forme : Peu importe le statut juridique d'une opération
comptable et son nom. Ce qui compte, c'est sa finalité pratique comptable. Un achat,
une vente, un emprunt, un prêt... L'objectif recherché par l'entreprise dans ces
opérations n'entre pas en ligne de compte, pas plus que leur statut juridique au regard
du système législatif dans lequel ladite entreprise opère.
D’autres objectifs généraux existent à savoir :
répondre à la croissance rapide de l’internalisation des échanges ;
élaborer dans l’intérêt général un jeu unique de normes comptables de haute qualité ;
satisfaire les besoins des marchés financiers et donner à leurs états financiers une
meilleure visibilité internationale et une meilleure crédibilité ;
assurer une meilleure comparabilité des états financiers au sein des entreprises cotées
en bourse ;
satisfaire les besoins des investisseurs en matière d’information.
Section 3 : Adoptions des normes IAS/IFRS au Maroc
L’adoption internationale des IFRS présente des enjeux majeurs pour les entreprises
et les investisseurs. Le Maroc est également concerné par cette mutation dans la mesure où
l’économie marocaine est très touchée par les effets de la mondialisation et se trouve de ce
fait dans l’obligation de suivre ce changement révolutionnaire.
L'année 2005 a constitué pour les professionnels de la comptabilité un
bouleversement majeur dans les référentiels comptables applicables. En effet, dans le cadre
de l'harmonisation comptable internationale, les groupes cotés devaient, à compter du 1er
janvier 2005, publier leurs comptes suivant les normes IFRS qui constituent la nouvelle
référence internationale en matière de normalisation comptable. Maroc Telecom a été le
premier à franchir le pas. Sa cotation à la Bourse de Paris en a été la principale raison.
Holcim Maroc l'a fait, entre autres, pour se conformer aux normes de sa maison-mère en
matière de reporting.25
25
http://www.lavieeco.com/news/votre-argent/normes-ifrs-quel-impact-sur-la-valeur-des-societes-cotees--6002.html
30
Sur le plan macro-économique, l’implémentation des normes IFRS au Maroc
rencontre certaines difficultés, notamment d’ordre : conceptuel, organisationnel, et
réglementaire comme présentée ci-dessous26 :
difficultés d’ordre conceptuel :
_un décalage remarquable existe entre les normes comptables nationales et les normes
IAS/IFRS dans la mesure où ces dernières se fondent sur la prééminence de la réalité
économique sur la réalité juridique et sur la notion de la juste valeur, tandis que le CGNC
donne la suprématie à la réalité juridique. L’exemple du traitement comptable des
immobilisations acquises par voie de crédit-bail nous paraît approprié pour illustrer ces
propos. D’une part, selon les normes marocaines, les immobilisations acquises en crédit-
bail ne doivent pas figurer au bilan de l’acquéreuse puisque leur propriété juridique n’est
pas en possession de cette dernière. D’autre part, selon les normes IAS/IFRS, en cas
d’acquisition d’actif via crédit-bail, il faut le comptabiliser comme étant une
immobilisation, puisque les avantages économiques générés par cet actif iront à
l’entreprise acquéreuse.
difficultés d’ordre organisationnel:
_la majorité des universités et des écoles marocaines ne procurent pas une formation en
normes comptables internationales. Il en résulte un manque de compétences en la matière,
qui se traduit par un choc lors de la mise en place des normes IAS/IFRS au sein de
l’entreprise, et qui génère un lourd investissement dans la formation des cadres, que ça soit
sur le plan de l’initiation aux normes IAS/IFRS ou sur le plan informatique.
_contenant plusieurs complexités, les normes IAS/IFRS s’avèrent difficiles à appliquer, et
nécessitent la création de nouvelles tâches, l’élargissement du système d’information, ainsi
qu’une veille permanente.
26
http://www.lavieeco.com/news/debat-et-chroniques/les-ifrs-au-maroc-ou-le-permis-de-conduire-a-gauche-5216.html
31
difficultés d’ordre réglementaire:
_la législation fiscale a plus de pouvoir par rapport à la législation comptable au Maroc ce qui
bloque l’évolution vers un référentiel comptable international.
L’information financière jusqu’à nos jours à une tendance plus fiscale que comptable, qui
participe à la consolidation du rôle que les pouvoirs publics font jouer à l’impôt. En effet, en
plus de sa finalité première qui est celle de mobiliser les ressources budgétaires, l’impôt en
tant que composante essentielle du budget est un instrument d’intervention du
gouvernement dans la mise en place de sa politique économique et sociale27.
_les instances de réglementation comptable doivent être en mesure de revoir la
comptabilité en tant qu’outil d’information de l’investisseur et d’adapter les normes selon la
taille de chaque entreprise. En effet, cette dernière est un élément déterminant du
périmètre des métiers de la fonction financière et comptable. D’une part, dans les PME et les
TPE, les frontières entre les métiers s’estompent, et la fonction comptable ne comprend
généralement qu’un seul cadre prenant en charge la totalité de la comptabilité. D’autre part,
dans les grands groupes, les métiers sont plus nombreux, et n’existent pas au sein
d’entreprises plus petites : c’est le cas du consolideur, du responsable communication
financière, du responsable des normes comptables…28
_ Difficulté d’instaurer une culture de transparence financière dans le tissu économique
marocain avec l’existence de l’informel, y compris dans les structures dites organisées. Les
opérateurs économiques doivent tout d’abord à souscrire aux réformes entreprises sur le
plan national avant de s’orienter vers un référentiel international.
Plusieurs normes IAS/IFRS laissent anticiper une plus forte volatilité des bilans et des
résultats en normes IAS/IFRS qu’en normes marocaines:
- la valorisation des actifs financiers et des immobilisations à leur juste valeur ;
- les conditions sévères pour la passation des provisions (IAS 37) ;
27
Kawtar EL MENGAD ; Exposé : Le système fiscal marocain ; Université Sidi Mohammed Ben Abdellah ; Faculté de sciences juridiques, économiques et sociales ; 2009-2010 28
Les référentiels des métiers cadres ; Les métiers des fonctions finance d’entreprise et comptabilité ; Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC) ; 22-04-2012 ; Page : 8
32
- la définition stricte de la notion d’élément extraordinaire (IAS 8).
La difficulté se présente surtout aux PME quant à l’application des IAS/IFRS
puisqu’elles ne disposent pas des moyens financiers et humains nécessaires à la réussite de
l’orientation vers les IAS/IFRS.
Les différences d’impact selon la taille des entreprises nous mènent aux deux
remarques suivantes:
_ l’option pour le référentiel des IFRS a coûté cher aux sociétés cotées en bourse,
notamment pour l’ONA et pour Maroc Telecom.
L’introduction de nouvelles normes et la modification des procédures anciennes dans
toutes les fonctions empêche les plus petites entreprises non cotées de disposer des mêmes
conditions financières et des mêmes ressources internes pour piloter dans les meilleures
conditions la mise en place de cet ambitieux projet d’entreprise.
Les PME n’éprouvent pas d’intérêt à l’égard des normes IAS/IFRS en les comparants aux
investisseurs dans des grandes structures.
_l’application des normes IAS/IFRS implique une volatilité des comptes évalués en juste
valeur ce qui engendre la volatilité des marchés financiers. Même les entreprises non cotées
ne peuvent pas échapper à cette exigence car parfois ce sont leurs partenaires qui leur
imposent de communiquer des informations financières conformes aux exigences des
IAS/IFRS.
Dans la pratique, certaines normes sont plus difficiles à appliquer :
- l’utilisation de l’approche par composants et la révision des durées d’utilité pour les
immobilisations (IAS 16) ;
- l’application des normes IAS 32/39 et IFRS 7 relatives aux instruments financiers ;
- la détermination des engagements à l’égard du personnel ne peut se faire qu’à travers des
études actuarielles.
D’autres difficultés se présentent :
complexité du référentiel de normes ;
33
détection des différences existantes entre les normes IAS/IFRS et les règles
appliquées ;
difficulté de collecte des informations financières nécessaires auprès des groupes
ayant énormément des filiales et notamment celles situées à l’étranger ;
les responsables financiers craignent ne pas pouvoir assumer ce projet ou ne pas
être à la hauteur des attentes des parties prenantes, ils craignent en fait une
surcharge des agendas et la lourdeur informatique ;
les responsables financiers sont tenus de travailler avec un nouveau système sans
être en mesure de le maitriser en intégralité et sans avoir à connaitre des impacts ;
la conversion vers des normes internationales exige des coûts importants de la part
de l’entreprise pour pouvoir bénéficier des services de conseil et d’assistance auprès
des cabinets externes, pour adapter ses systèmes d’information, pour former ses
salariés et pour former ses filiales à l’étranger.
L’adoption des IAS/IFRS doit être conçue comme un projet d’entreprise dans lequel
toutes les fonctions doivent être impliquées et non pas une simple affaire de comptable.
Cet objectif peut être atteint en utilisant une méthodologie bien établie qui se
composent de trois étapes à savoir :
-premièrement il s’agit d’observer l’état des lieux dans le but de déterminer les
changements à opérer, cela se fait bien évidemment avec l’intervention d’un expert-
comptable ;
- une deuxième phase consacrée à l’organisation qu’exige d’ailleurs tout type de projet
complexe ;
- la dernière phase doit être consacrée à la mise en œuvre des plans d’action et donc à la
réalisation concrète du projet.
Toutes ces différences entre les normes marocaines et les normes internationales se
reflètent sur le traitement comptable que nous pouvons résumer dans le tableau suivant29 :
29
Bouchra ELABBADI ; Cours : Principes comptables, normes internationales, comparaison ; Université Abdelmalek Essaadi ; ENCGT ; 2013-2014
34
Normes Marocaines
IAS/IFRS
Présentation des
états financiers
Le CGNC se base sur un schéma
comptable (plan comptable)
IAS 1 : Les IFRS ne prévoient
aucun canevas prédéfini.
Immobilisations
incorporelles
_Amortissement obligatoire
_ Réévaluation interdite
_Comptabilisation des frais
d’établissement à l’actif
IAS38 : _Amortissement de
certaines immobilisations
_Possibilité de réévaluation
_Interdiction de la
comptabilisation des frais
d’établissement parmi les
actifs.
Immobilisations
corporelles
_ Réévaluation l’ensemble
immobilisations
_ Durée d’amortissement =
Durée fiscale
IAS16 : _ Intégration des
droits d'enregistrement
capitalisés, des honoraires
d’ingénieur consultant dans le
coût d’acquisition.
_ Réévaluation de certaines
immobilisations de façon
régulière
_ Durée d’amortissement =
Durée d’utilité
Stocks _ Enregistrement à la date du
transfert de propriété
_ Evaluation des biens fongibles
soit au FIFO soit au CMUP
IAS2 : _Enregistrement à la
date du transfert des risques
et avantages économiques.
_Possibilité de recourir au LIFO
Impôt différés Comptabilisation de l’impôt
courant seulement IAS12 : Comptabilisation des
impôts différés dans les
comptes sociaux et
consolidés
Produits des activités
ordinaires
Distinction entre les « produits
d'exploitation », les « produits
financiers » et ceux « courant »
IAS18 : Pas de distinction
Provisions _ Actualisation non obligatoire
_Evaluation approximative IAS37 : _ Actualisation
obligatoire
_Précision grâce à
l’actualisation des flux et aux
informations à fournir
Tableau 2 : Différences entre les normes marocaines et les IAS/IFRS
35
Pour conclure ce chapitre, nous pouvons dire que la mondialisation accrue des
échanges a rendu l’application des IAS/IFRS indispensable, ce qui a entrainé des
changements remarquables dans les méthodes comptables appliquées jusque-là. Elle a
impacté également la présentation des états financiers dont le but ultime est de fournir une
information financière transparente, crédible et qui reflète la réalité économique de
l’entreprise.
36
Chapitre 2 : Contenu de la norme IAS 36
L’IAS 36 présente la manière pour une entreprise de procéder à la dépréciation de ses
actifs. La première Section de ce chapitre sera consacrée à la présentation générale de cette
norme, en précisant ses objectifs, son champ d’application, les conditions de
comptabilisations, l’analyse mettra ensuite l’accent sur la notion de la valeur dans la Section
2, et sa dépréciation dans la Section 3.
Section 1 : Survol de l’IAS 36
1-1 Objectif, origine, et définitions
L’IAS 36 prescrit les procédures qu’une entité applique pour s’assurer que ses actifs
sont comptabilisés pour une valeur qui n’excède le montant qui pourrait être recouvré de
leur utilisation ou de leur vente. La norme indique à quel moment les pertes de valeur
doivent être comptabilisées et les conditions dans lesquelles il doit y avoir reprise des pertes
de valeur. L’IAS 36 fournit également des lignes directrices sur les obligations
d’information.30
La création de cette norme est liée à l'écart grandissant entre la valeur comptable et la
valeur boursière des sociétés cotées au cours des 25 dernières années, dû en partie à
l'importance croissante des actifs incorporels dans la valeur de ces entreprises. Cet écart a
levé le voile sur certaines limites des conventions comptables, accusées de ne pas refléter
convenablement la perception des marchés financiers et la réalité économique. Dans ce
cadre, les normes comptables ont intégré graduellement de nouvelles dispositions, ayant
pour objectif d'ajuster à la baisse les valeurs comptables de certains actifs déterminées sur la
base des coûts historiques engagés pour les créer ou les acquérir, en les rapprochant de leur
juste valeur.31
30
Brian FRIEDRICH ; le reper ; Norme comptable internationale 36 : IAS 36 dépréciation d’actifs ; CGA-Canada ; 2009 31
Sabrina BAZIRE ; Marie-Noel MAFFON ; Impacts de la mise en place des normes IFRS sur les capitaux propres ; CNAM Paris ; 2005 ; Page : 22
37
Dans la norme IAS 36, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après32 :
La valeur comptable est le montant auquel un actif est comptabilisé après déduction
du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur y afférents.
Une unité génératrice de trésorerie, dite UGT, est le plus petit groupe identifiable
d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées
de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs.
La juste valeur est le montant qui peut être obtenu de la vente d’un actif ou d’une
unité génératrice de trésorerie lors d’une transaction dans des conditions de
concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des
coûts et frais de sortie33 représentés par les salaires et les commissions des
vendeurs, les frais de manutention, et d’emballage, ainsi que les frais de transport à
la charge du vendeur34.
Une perte de valeur est le montant par lequel la valeur comptable d’un actif ou
d’une unité génératrice de trésorerie excède sa valeur recouvrable.
La valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie est la valeur
la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur
d’utilité.
La valeur d’utilité ou valeur d’usage est la valeur actuelle des flux de trésorerie
futurs susceptibles de découler d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie,
jusqu’à sa sortie du bilan, ou la fin de son usage.
1-2 Champ d’application
L’IAS 36 s’applique à la comptabilisation de tous les actifs autres que ceux pour
lesquels des lignes directrices relativement à la perte de valeur sont données dans d’autres
normes.
Ainsi, la norme ne s’applique pas aux actifs suivants :
stocks (IAS 2);
actifs générés par des contrats de construction (IAS 11);
32
Norme Comptable Internationale 36 : Dépréciation d’actifs ; Page 2 33
Eric TORT ; L’essentiel des normes IFRS ; Gualino ; 2012 ; Page 104 34
Emanuelle AUBERT ; Pedro MATLAS ; TD : Le coût et le prix de vente ; Académie de Nancy-Metz
38
actifs d’impôt différé (IAS 12);
actifs générés par des avantages du personnel (IAS 19);
actifs financiers compris dans le champ d’application de l’IAS 39;
immeubles de placement évalués à la juste valeur (IAS 40);
certains actifs biologiques (IAS 41);
certains actifs relatifs à des contrats d’assurance (IFRS 4);
actifs non courants (ou groupes destinés à être sortis) classés comme étant
détenus en vue de la vente selon l’IFRS 5.
L’IAS 36 s’applique, notamment, aux actifs suivants35 :
terrains;
immeubles;
matériel et outillage;
immobilisations incorporelles y compris le goodwill;
immeubles de placement comptabilisés au coût;
participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises.
1-3 Informations à fournir
Comme bien d’autres normes, l’IAS 36 présente une liste d’informations à joindre en
annexe des états financiers :36
35
Brian FRIEDRICH ; le reper ; Norme comptable internationale 36 : IAS 36 dépréciation d’actifs ; CGA-Canada ; 2009 36
Robert OBERT ; Le petit IFRS, DUNOD, 2006/2007 ; Page 34
39
Pour chaque catégorie d’actif Pour chaque perte de valeur significative comptabilisée ou reprise pour un actif pris
individuellement ou une UGT
Montants des pertes de valeur et
reprises de pertes de valeur
comptabilisées dans le compte de
résultat au cours de la période, et
postes du compte de résultat dans
lesquels ces pertes sont incluses.
Montants des pertes de valeur et
reprises de perte de valeur sur des
actifs réévalués comptabilisées
directement en capitaux propres au
cours de la période.
Evènements et circonstances qui ont
conduit à comptabiliser ou à
reprendre une perte de valeur.
Montant de la perte comptabilisée
ou reprise
Pour un actif isolé : nature de l’actif
et secteur d’information sectorielle
de premier niveau.
Pour une UGT : description de l’unité,
montant de la perte de valeur
comptabilisée ou reprise par
catégorie d’actif.
Nature de la valeur recouvrable.
Si la valeur recouvrable est la juste
valeur diminuée des coûts de la
vente, base utilisée.
Si la valeur recouvrable est la valeur
d’utilité, taux d’actualisation utilisée.
Tableau 3 : Informations à fournir pour la norme IAS 36
Section 2 : Notion de la valeur
La valeur se situe au cœur des différences de perception des principes comptables
propres à chaque pays. En raison de leur histoire sociale, économique et culturelle, les pays
anglo-saxons ont toujours privilégié une vision financière de l’entreprise, alors que les pays
d’Europe continentale mettent davantage l’accent sur une orientation économique et
sociale de l’entreprise, ce qui explique la divergence d’interprétation du mot « valeur ».37
37
Pascal BARNETO ; Pierre GRUSON, Instruments Financiers et IFRS : Evaluation et comptabilisation ; Dunod ; 2007 ; Page : 29
40
2-1 Notion de juste valeur
La juste valeur n’est pas un nouveau concept émanant des normes IAS/IFRS. Elle
existait bien avant dans d’autres référentiels, notamment français et anglo-saxons.38
Elle peut être définit _ comme a été vu auparavant_ comme étant le montant pour
lequel un actif peut être échangé entre des parties avisées et consentantes, dans le cadre
d’une transaction effectuée dans des conditions normales supposant que les intervenants du
marché sont indépendants, et agissent dans leurs meilleurs intérêts économiques et dans un
contexte de pleine concurrence.39
A l’origine, la juste valeur avait pour but de valoriser les produits financiers. En effet,
les IAS/IFRS ont été initiées, développées et rédigées dans un contexte ou l’environnement
économique international a connu d’importantes innovations financières au cœur
desquelles on trouve le développement par des opérations d’ingénierie financière, et la
croissance de l’industrie financière avec l’apparition d’instruments de plus en plus
complexes, dont les produits dérivés40. Ce n’est que plus tard que la notion de juste valeur a
été généralisée aux autres catégories d’actifs.
Cette notion peut être justifiée par plusieurs points :
la juste valeur répond aux attentes des investisseurs, et leur permet d’avoir
une vision plus économique de la réalité de l’entreprise par rapport à
l’adoption du coût historique ;
elle est un moyen efficace pour suivre l’évaluation des actifs. C’est une
traduction plus financière de l’entreprise ;
elle se prête bien au reporting pour créer des états prévisionnels à partir des
flux de trésorerie estimés.
38
Benoît LEBRUN ; La norme IFRS 13 sur la juste valeur ; Revue française de comptabilité ; 2011 ; Rubrique : Synthèse 39
Norme internationale d’information financière 13 ; Evaluation de la juste valeur ; Page : 4 40
Salah SALHI ; Said BOUHRAOUA ; Colloque : Produits et applications de l’innovation et l’ingénierie financiers entre l’industrie financière conventionnelle et l’industrie financière islamique ; Université Ferhat Abbas ; 05-06 Mai 2014
41
Si la généralisation de la juste valeur paraît louable dans son intention pour répondre
à des besoins de clarté et de fiabilité de l’information financière auprès de la communauté
des investisseurs, il n’est pas certain que son application généralisée fait l’unanimité.41
En effet, plusieurs critiques peuvent être adressées à ce concept :
l’abandon du coût historique peut rendre difficile le suivi et l’évolution des
actifs et des passifs, en particulier à long terme ;
la généralisation de la juste valeur introduit une profonde subjectivité dans les
états financiers, surtout ceux ne pouvant être évalués en valeur de marché ;
l’information à la juste valeur a un caractère volatile. Elle n’est donc
rapidement obsolète, pas très pertinente, et susceptible à des manipulations ;
le choix par l’entreprise du taux pour actualiser les flux est plus ou moins
libre, ce qui peut faire varier les résultats qui se reportent directement dans
les états financiers.
2-2 Méthodes d’évaluation de la valeur
On distingue entre deux modèles de valorisation de la juste valeur qui peuvent être
utilisées selon l’environnement :
a) Modèle Mark-to-market
Le mark-to-market consiste à évaluer régulièrement, voire en permanence, une position
sur la base de sa valeur observée sur le marché au moment de l'évaluation42.
En effet, la valeur de marché représente le prix constaté pour un élément d’actif qui résulte
de la confrontation offre-demande sur un marché organisé ou de gré à gré. Ce modèle est
considéré comme étant le procédé qui fournit la meilleure estimation de la juste valeur. En
41
Pascal BARNETO ; Pierre GRUSON, Instruments Financiers et IFRS : Evaluation et comptabilisation ; Dunod ; 2007 ; Page : 31 42
VERNIMMMEN.NET / lesechos.fr
42
effet, le paragraphe 25 de l’IAS 36 énonce que la meilleure indication de la juste valeur d’un
actif diminuée des coûts de la vente est un prix figurant dans un accord de vente irrévocable
signé à l’occasion d’une transaction dans des conditions de concurrence normale, ajusté
pour prendre en compte les coûts marginaux directement attribuables à la sortie de l’actif.
En l’absence d’un accord de vente irrévocable, si l’actif est négocié sur un marché actif, la
juste valeur diminuée des coûts de la vente correspond au prix de marché de l’actif diminué
des coûts de sortie. S’il n’existe pas de marché actif, l’entité utilise la meilleure information
disponible, par exemple en se reportant à des transactions semblables récentes dans le
même secteur d’activité.43
b) Modèle Mark-to-model
Le mark-to-model consiste à valoriser une position sur la base d'un modèle financier et
donc d'hypothèses formulées par l'évaluateur. Il est donc soumis au risque que le modèle
utilisé ou les hypothèses retenues soient erronés. Il est utilisé le plus souvent pour des
positions complexes et pour lesquels il n'y a pas de marché liquide ce qui empêche d'avoir
recours au mark-to-market. 44
Cette méthode consiste à mettre en place un processus d’évaluation qui permet
d’estimer de manière fiable la valeur des flux financiers futurs, attendu de cet actif,
actualisés. C’est la méthode des Discounted Cash Flows.
Les flux de trésorerie concernent des estimations d’avantages économiques réalisés sur
des entrées et des sorties de trésorerie, relatives à l’actif.
Les projections des flux de trésorerie sont établies grâce à des indicateurs externes basés
sur des hypothèses raisonnables quant à l’évolution de l’environnement économique ou sur
la base d’indicateurs internes comme des calculs de coûts effectués sur une période donnée.
Ces flux sont par la suite actualisés en fonction d’un taux calculé ou donné, qui est
généralement le Coût Moyen Pondéré du Capital dit CMPC, mais il faut noter que la norme
IAS 36 n’exige pas le CMPC, mais recommande son utilisation. En effet, la norme stipule que
43
Brian FRIEDRICH ; Le reper ; Norme comptable internationale 36 : IAS 36 dépréciation d’actifs ; CGA-Canada ; 2009 ; Page 4 44
VERNIMMMEN.NET / lesechos.fr
43
les taux d’actualisation utilisés pour déterminer la valeur d’utilité doivent correspondre aux
taux avant impôt qui reflètent à la fois la valeur temps de l’argent et les risques spécifiques à
l’actif pour lequel les estimations de flux de trésorerie futurs n’ont pas été ajustées.
Calcul des cash-flows :
Les cash-flows disponibles, sont la différence entre les flux d’exploitation qui sont égaux
au résultat d'exploitation net d’impôt et avant frais financiers, augmenté des charges non
décaissables à savoir les dotations aux amortissements, et les flux d’investissement composé
de l’addition de la variation des besoins en fonds de roulement et des investissements.
Généralement, on estime qu’une durée prévisionnelle de 5 ans est un horizon
raisonnable des prévisions, mais en pratique la durée du plan d’affaire dépend de la
visibilité de l’entreprise et de la durée d’utilité de l’actif. La durée doit donc correspondre au
temps durant lequel l’entreprise compte utiliser l’actif.
Donc l’horizon de prévisions dépend de la nature de l’actif. Si l’actif a une durée
d’utilité limitée, l’horizon de prévision doit être borné à cette durée. Mais si la durée d’utilité
est infinie, ou très longue, il faut prévoir une valeur terminale. Cette dernière est la valeur du
cash-flow attendu de l’actif au-delà de la période de prévision explicite. Deux approches
peuvent être adoptées pour déterminer cette valeur.
En effet, soit on se réfère à la valeur de sortie choisie explicitement, soit on détermine
une valeur implicite grâce à la méthode de Gordon Shapiro par actualisation à l’infini d’un
flux de trésorerie normatif croissant à un taux g.
Résultat d’exploitation
- Impôt + Amortissement
-Investissements
-Variation du BFR = Free Cash-Flow
44
La formule se présente comme suit :
Avec : Flux normatif :
Flux normatif : correspond au flux qui pourrait être généré au-delà de l'horizon explicite.45
k : taux d’actualisation CMPC
g : taux de croissance
Calcul du taux d'actualisation CMPC:
Le coût moyen pondéré du capital (CMPC) correspond à la rentabilité exigée par
l’ensemble des pourvoyeurs de fonds de l’entreprise, notamment les actionnaires, et les
créanciers. Le coût du capital se constitue donc de deux coûts différents, à savoir : le coût
des capitaux propres, et le coût de la dette. La formule suivante permet de calculer le CMPC
à partir de ces deux coûts :
Où :
kcp : coût des fonds propres
Kd : coût de la dette avant impôts
Vcp : valeur des fonds propres
Vd : valeur de marché de la dette
45
Généralement, le flux normatif est basé sur le dernier flux du plan d’affaires : FN= FCFn (1+g)
Valeur Terminale = Flux normatif / k – g
CMPC = kcp x Vcp / (Vcp+Vd) + kd x (1-IS) x Vd / (Vcp+Vd)
45
Le coût des fonds propres est calculé de la manière suivante à travers le MEDAF
qui fournit une estimation du taux de rentabilité exigée par les investisseurs pour un actif
financier en fonction de son risque systématique ou non diversifiable46:
Avec
rf : Taux de l’actif sans risque
rm : Rentabilité du marché
(rm - rf) : Prime de risque
β : Coefficient de volatilité
Il faut noter que le calcul du Beta, se fait de deux manières en fonction de la
situation de l’entreprise. En effet, si l’entreprise est cotée, le Beta est calculé à partir du la
covariance de la rentabilité implicite du portefeuille avec celle du marché et de la variance
de la rentabilité implicite du marché. Mais si l’entreprise n’est pas cotée, il faut procéder au
calcul de Bêtas d’entreprises comparables, pour en tirer un Bêta désendetté, qui sera
ensuite endetté à nouveau en fonction du levier financier de l’entreprise concernée.
Section 3 : Dépréciation de la valeur
La norme IAS 36 exige qu’un actif doit être déprécié lorsque sa valeur comptable est
devenue supérieure à sa valeur recouvrable.
3-1 Indices de dépréciation
A chaque date de clôture, une entreprise doit évaluer s’il existe une indication objective
de perte de valeur en passant en revue tous les actifs susceptibles d’être déprécié ou toutes
les UGT.
46
VERNIMMMEN.NET / lesechos.fr
kcp = rf + β(rm - rf)
46
IAS 36 fournit des indications sur les sources d’informations externes et internes qui
peuvent fournir des indices qu’un actif s’est déprécié. C’est là une question qui fait
largement appel au jugement.
Le tableau suivant, dresse une liste non exhaustive des indices à prendre en
considération pour déterminer si un actif a perdu de la valeur47 :
Sources internes
Sources externes
Obsolescence ou dégradation
physique de l’actif
Changements importants, ayant un
effet négatif sur le mode d’utilisation
de l’actif tel qu’il est ou qu’on
s’attend à l’utiliser
Elément probant provenant du
système d’information interne
démontrant que la performance
économique est inférieure à celle
attendue
Flux de trésorerie ou résultats
d’exploitation réels qui diffèrent
sensiblement de ceux qui avaient été
budgétés à l’origine
Diminution importante ou anormale
de la valeur de marché de l’actif
Changements dans l’environnement
technologique, économique,
juridique ou du marché dans lequel
opère l’entité, avec effet négatif sur
cette dernière
Certaines augmentations des taux
d’intérêt ou autres taux de
rendement du marché susceptibles
d’affecter le taux d’actualisation
utilisé pour le calcul de la valeur
d’utilité
Capitalisation boursière inférieure à
la valeur de l’actif net de l’entité
Tableau 4 : Sources des indices de dépréciation
3-2 Tests de dépréciation (impairment tests)
La norme IAS 36 stipule que les actifs doivent être dépréciés soit indépendamment, soit
de manière regroupée au niveau des UGT. En effet, il est très difficile d’effectuer des tests de
manière séparée, car un actif pris isolément, ne génère pas de flux de trésorerie
indépendamment des autres actifs de l’unité.
47
Eric TORT ; L’essentiel des normes IFRS ; Gualino ; 2012 ; Page 104
47
C’est donc sur le plan des UGT qu’il convient d’estimer les pertes de valeurs éventuelles.
Cependant, il faut noter que même si un découpage assez fin des UGT peut faciliter la
détection des actifs susceptibles d’être déprécié, il peut aussi divulguer des informations
plus ou moins confidentielles.
En ce qui concerne la perte de valeur, la difficulté consiste principalement en
l’appréciation de son importance. La norme IAS 36 exige que si la valeur recouvrable devient
inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation doit être constatée de manière à ce
que la valeur comptable s’ajuste sur le montant de cette valeur recouvrable de l’actif.
Donc on peut déduire à travers ceci que la procédure d’identification des dépréciations
suit la démarche suivante:
Recherche d’indices de dépréciation laissant supposer que la valeur
recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de l’immobilisation.
Si tel est le cas, il faudra déterminer la valeur recouvrable de l’actif, en
comparant et en choisissant la plus grande entre la valeur de cession du bien
sur le marché, et celle de son usage.
Lorsque la valeur recouvrable est supérieure à la valeur nette comptable,
l’entreprise gardera comme valeur de l’immobilisation sa valeur nette
comptable.
Au contraire, si elle lui est inférieure, elle retiendra comme valeur de
l’immobilisation la valeur recouvrable.
Le schéma suivant récapitule la procédure d’identification 48:
48
A. Brassely ; Méthodologie de dépréciation des actifs selon IAS 36 ; Pansard & Associés
48
Figure 2 : Schéma récapitulatif de la procédure de dépréciation
3-3 Comptabilisation des dépréciations
La perte de valeur est comptabilisée immédiatement en résultat 49 . En effet, La
dépréciation d'une immobilisation incorporelle ou corporelle représente à la fois : une
charge d'exploitation calculée, non décaissable, qui ne vient pas amoindrir la trésorerie,
enregistrée au débit du compte "Dotations aux dépréciations des immobilisations
49
Pascal BARNETO ; Normes IFRS : Application aux états financiers ; DUNOD ; 2ème édition ; 2006
49
incorporelles et corporelles". Une diminution de la valeur du bien concerné enregistrée au
crédit d'une subdivision du compte "Dépréciations des immobilisations"50.
L’écriture comptable à passer donc en cas de dépréciation, ou d’augmentation de la
dépréciation se présente comme suit :
Figure 3 : Ecriture comptable de la dépréciation
Il faut noter que si la perte de valeur concerne une UGT, la dépréciation devrait venir en
réduction de la valeur nette comptable des actifs dans l’ordre suivant :
Réduire la valeur comptable du goodwill affecté à l’UGT
Réduire la valeur des autres actifs de l’unité au prorata de la valeur comptable de
chaque actif, sans que celle-ci puisse descendre sous la valeur d’utilité d’un actif
pris individuellement.
La perte de valeur entraine donc une modification du plan d’amortissement. En effet,
après la comptabilisation d'une perte de valeur, la dotation aux amortissements de l'actif
doit être ajustée pour les périodes futures, afin que la valeur comptable révisée de l'actif,
diminuée de sa valeur résiduelle puisse être répartie de façon systématique sur sa durée
d'utilité restant à courir. Il s’agit donc d’un changement prospectif qui conduit à modifier le
plan d’amortissement initial uniquement pour sa partie future, et non pour l’historique.
En outre, un indice qui révèle qu’un actif a perdu de la valeur peut signifier que la durée
d’utilité, le mode d’amortissement, ou la valeur résiduelle doivent être revus ou ajustés.51
50
Marie MUSARD ; Comptabilité : Cours et TD ; IG3 ; Poly’tech Montpelier : Université de Montpelier 2 ; 2007-2008
50
3-4 Reprise de dépréciation
A la date de clôture suivant une perte de valeur, il faut apprécier si cette perte peut être
reprise. Pour ceci, on se réfère à des indices comme dans le cas d’une perte de valeur. Les
exemples d’informations externes pouvant indiquer une reprise d’une perte de valeur
comprennent une augmentation importante de la valeur de marché des actifs ou des
changements importants ayant un effet favorable sur l’entité, par exemple des changements
favorables dans l’environnement de marché.
S’il s’avère qu’on peut reprendre une dépréciation, il faut augmenter la valeur comptable
de l’actif à hauteur de sa valeur recouvrable et réajuster le plan d’amortissement. Dans tous
les cas, le montant de la reprise ne peut pas conduire à une valeur nette comptable
supérieure à celle qui qui aurait été obtenue si aucune dépréciation n’avait été
comptabilisée. On parle alors d’annulation de la dépréciation.
Il faut tout de même noter que les pertes de valeur ne se reprennent pas sur le goodwill.
En ce qui concerne la comptabilisation de la reprise, le montant de l'ajustement est
porté au débit du compte Dépréciations des immobilisations par le crédit du compte
Reprises sur dépréciations des immobilisations.
L’écriture comptable se présente comme suit 52:
Figure 4 : Ecriture comptable de la reprise de perte de valeur
51
Ahmed KARIM ; Le Meilleur des IAS ; 2010 ; Page 179 52
Marie MUSARD ; Comptabilité : Cours et TD ; IG3 ; Poly’tech Montpelier : Université de Montpelier 2 ; 2007-2008
51
Comme récapitulatif, le tableau suivant résume la démarche de la dépréciation de
valeur 53:
Valeur comptable Prix de vente net Valeur d’utilité (usage)
Flux de trésorerie actualisés Valeur recouvrable
= Maximum [Prix de vente net ; Valeur d’utilité]
Si la valeur comptable < valeur recouvrable Pas de dépréciation
Si la valeur comptable > valeur recouvrable Dépréciation constatée
Perte de valeur comptabilisée en charges dans le compte de résultat
Perte de valeur traitée comme une réévaluation négative dans le bilan
Tableau 5 : Récapitulatif de la démarche de dépréciation
Dans ce chapitre, nous avons dans un premier temps, survolé la norme IAS 36, en
précisant son objectif, son champs d’application, et en définissant quelques concepts cités
dans cette norme. Nous avons par la suite approfondi l’un de ces concepts, à savoir, la notion
de la valeur, en mettant l’accent sur les méthodes de son évaluation.
Finalement, nous avons présenté la globalité de la démarche de dépréciation de la
valeur, allant des tests de dépréciation, jusqu’à la comptabilisation de la perte de valeur, en
passant par l’identification de la dépréciation.
Pour conclure le chapitre, nous pouvons dire que la mise en œuvre de la norme IAS 36
s’avère une opération délicate, qui nécessite la prise en considération de plusieurs
informations, ainsi qu’une veille perpétuelle pour la détermination de la valeur des actifs.
53
Pascal BARNETO ; Normes IFRS : Application aux états financiers ; DUNOD ; 2ème édition ; 2006
52
Conclusion
Apparue dès l’antiquité, formalisée depuis le 15ème siècle, la comptabilité est
devenue la source la plus sûre de l’information économique et financière. Base du système
d’information de gestion de l’entreprise, elle a connu plusieurs évolutions au fil de l’histoire,
et elle est aujourd’hui le langage commun de celle-ci avec tous ses partenaires.
L’application des normes comptables internationales a rendu cette pratique
comptable aussi rigoureuse que précise. En effet, peu d’options sont prévues, et de
nombreuses informations détaillées doivent être fournies dans les états financiers.
L’application des normes comptables internationales a aussi modifié l’analyse qui pourra être
effectuée à partir des états financiers sous forme d’indicateurs ou de ratios.
La norme IAS 36 fait partie des normes qui nécessitent plus de rigueur, et qui peuvent
avoir un impact notable sur l’information financière de l’entreprise, car la dépréciation a une
incidence directe sur le résultat, qui est l’un des éléments les plus importants de cette
information, vue sa présence dans le bilan, et dans le compte de résultat.
De ce fait, la deuxième partie du présent rapport sera dédiée à l’application de ladite
norme au sein d’OCP S.A, ainsi qu’à l’étude de son impact sur l’information financière de
l’entreprise.
53
Partie II : Application de la norme IAS 36 au sein d’OCP S.A
Introduction
La familiarisation avec l’environnement du stage et la bonne adaptation à ce dernier,
est l’une des étapes nécessaires pour la réussite, et pour l’atteinte des objectifs fixés par le
stagiaire. De ce fait, nous allons présenter dans un premier lieu le Groupe OCP, en décrivant
ses métiers et ses filiales, pour finalement enchainer avec une présentation de la filiale du
pôle chimie qui est notre direction d’accueil.
Notre travail consistera dans cette partie à établir un essai d’application de la norme
IAS 36 au sein de l’entité, et ce en suivant tout un processus, allant de l’analyse des
traitements IFRS adoptés par l’entreprise, jusqu’à la conception d’un guide pratique, en
passant par la détection de la dépréciation, et l’analyse de son impact sur l’information
financière.
Mais avant d’en arriver à ce point, nous jugeons indispensable de décrire notre
méthodologie de travail dans le premier chapitre de cette partie. En effet, Tout travail
scientifique doit suivre une certaine démarche, une certaine voie désignée sous le terme de
méthode afin d'arriver à l'acquisition de nouvelles connaissances.
54
Chapitre 1 : Environnement et contexte du stage
L’exploitation des mines était toujours présente dans les traditions du Maroc, dans ce
cadre, nous pouvons citer le phosphate qui constitue une véritable richesse pour notre pays.
Cette richesse est recherchée, exploitée et commercialisée par l’Office Chérifien des Phosphates
qui a été créé par le Dahir du 27 janvier 1920, et qui s’est transformé en groupe OCP en 1975. Le
Groupe est spécialisé dans la recherche, l’extraction, la valorisation et la commercialisation des
phosphates et de ses produits dérivés. Nous allons dans ce présent chapitre présenter le groupe
OCP.SA (Section 1), la description portera par la suite sur le site industriel Jorf Lasfar et le pôle
chimie (Section 2), et nous allons clôturer le chapitre avec une présentation de la méthodologie de
travail que nous avons adopté pour mener à bien notre mission (Section 3).
Section 1 : Présentation générale du Groupe OCP
1-1 Fiche technique d’OCP S.A
Raison sociale OCP S.A
Siège social 2, Rue Al Abtal Hay Erraha, Casablanca Statut juridique Société anonyme Capital social 8 287 500 000 Dh Activité Extraction, traitement, transformation et
commercialisation des phosphates et leurs dérivés
Effectif Environ 20 000 collaborateurs Représentant légal M. Mostapha TERRAB (Président Directeur
Général)
Tableau 6 : Fiche technique d'OCP S.A
1-2 Historique
Les phosphates marocains sont exploités dans le cadre d’un monopole d’État confié à un
établissement public créé en août 1920, l’Office Chérifien des Phosphates, devenu Groupe OCP
en 1975. Mais c’est le 1er Mars 1921 que l’activité d’extraction et de traitement a démarré à
Boujniba, dans la région de Khouribga.
55
Le tableau suivant présente les dates clés de l’évolution du groupe :
Dates Evènements
1920 Création, le 7 août, de l’Office Chérifien des Phosphates
1921 Début de l’exploitation en souterrain sur le gisement d’Oulad Abdoun, le 1er mars
1965 Création de la société Maroc Chimie
1975 Création du Groupe OCP (décision de création en juillet 1974 et mise en place en janvier 1975).
1996 -Regroupement des activités des deux sociétés Maroc Chimie et Maroc Phosphore au sein de Maroc Phosphore
-Création de la société Euro-Maroc Phosphore
1998 Démarrage de la production d’acide phosphorique purifié
2008 -Transformation de l’Office Chérifien de Phosphates en société anonyme OCP SA le 28 février
-Démarrage de Pakistan Maroc Phosphore à Jorf Lasfar
2009 Démarrage de Bunge Maroc Phosphore à Jorf Lasfar
2010 - Création d’une joint-venture avec Jacobs engineering (JESA)
- Ouverture de bureaux de représentation au Brésil et en Argentine
2012 Fusion-Absorption de Maroc phosphore par OCP S.A
Tableau 7 : Historique du Groupe OCP
1-3 Activités du Groupe
Le Groupe OCP monopolise toute la chaîne liée à l’activité phosphatière, allant de la
recherche, jusqu’ à la commercialisation des phosphates et de produits dérivés, en passant par
l’extraction et la valorisation.
Le schéma suivant décrit l’ensemble du processus :
56
Figure 5 : Chaîne de l'activité phosphatière
Il faut noter que d’une part, la production d’acide phosphorique et d’engrais du Groupe
OCP est répartie entre deux sites : Safi et Jorf Lasfar. D’autre part, l’exportation se fait via les
ports de Casablanca, Jorf Lasfar, Safi et Laâyoune.
Commercialisation
le phosphate est vendu selon la demande des clients aux cinq continents de la planète soit brut soit après traitement
Valorisation
le Groupe OCP a concentré ses efforts sur la transformation sur place des phosphates en produit semi-fini, notamment l'acide phosphorique, ou des produits finis, à savoir es engrais.
Traitement
le phosphate extrait subit un enrichissement de façon à éliminer la gangue et réduire la teneur de certaines impuretés.
Extraction
elle s'effectue de deux manières qui dépendent du site, puisque le phosphate se présente sous forme de couches quasi-horizontales séparés par des intercalaires stériles ou peu phosphatés, l'extraction s'effectue soit à ciel ouvert (le cas des couches faibles) soit par voie souterraine.
Recherche
elle consiste à faire le forage pour délimiter le gisement, s'informer sur l'épaisseur des couches et leur teneur.
57
1-4 Organigramme d’OCP S.A
L’organigramme fonctionnel d’OCP S.A se présente comme suit au 30 Juin 201154 :
Figure 6 : Organigramme de l'OCP S.A
Il faut noter qu’en début Mai 2014, OCP S.A a procédé à une restructuration interne,
divisant l’entreprise en 4 axes principales, à savoir : l’axe nord, l’axe sud, l’axe ouest, et l’axe est.
54
Note d’information : Emission d’un emprunt obligataire ; OCP S.A ; 2011 ; Page : 60
58
1-5 Filiales et participations du Groupe OCP
Figure 7 : Filiales du Groupe OCP55
Le Groupe OCP opère dans le domaine de l’industrie du phosphate et ses produits
dérivés. Son activité d’extraction et de traitement du phosphate est réalisée au niveau des sites
miniers de Khouribga, Benguérir, Youssoufia et Boucraâ-Laâyoune. L’activité Chimie est assurée
par son ancienne filiale Maroc Phosphore fusionnée maintenant avec OCP SA ainsi que par les
Joint-Ventures que le Groupe OCP a réalisés avec ses partenaires étrangers.
Les principales participations du Groupe OCP, comme indiqué dans l’organigramme ci-
dessus sont structurées en quatre groupes de familles :
55
Ancien organigramme datant de 2011. L’organigramme actualisé est indisponible
59
Filiales d’exploitation
-Maroc Phosphore : Actuellement nommée Pôle Chimie après avoir fait l’objet d’une fusion-
absorption en 2012 par OCP S.A. L’activité principale de la société consiste en la production et
l’exportation de l’acide phosphorique et des engrais phosphatés à travers les sites de Jorf Lasfar.
Après la transmission universelle de son patrimoine à OCP S.A., Maroc Phosphore S.A. se trouve
dissoute de plein droit par le seul fait de la réalisation définitive de la fusion, et l’ensemble de ses
droits et obligations ont été transmis à OCP S.A.
-Phosboucraa : spécialisé dans l’extraction, le traitement, le transport et la commercialisation du
minerai de phosphate du site de boucrâa ;
Filiales Support
-Sotreg : créée en 1973 avec pour unique objet le transport du personnel du Groupe OCP.
-Smesi : est une société d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre des grands projets d’investissements
du Groupe OCP.
-Cerphos : est un centre de recherche scientifique spécialisé dans les processus d’extraction, de
traitement et de valorisation des phosphates en acide phosphorique et engrais phosphatés.
-Imsa : créée en 1970 pour gérer le cinéma et l’hôtel Atlantide à Safi. A travers cette filiale, le
Groupe OCP assure une prestation sociale en hôtellerie et restauration pour l’ensemble de son
personnel et leur famille
- Lejonc : est propriétaire et exploite les bureaux de OCP SA à Paris.
-Star : spécialisée dans le transport et l’affrètement maritime. La société est en cours de
liquidation suite au transfert de l’activité d’affrètement maritime à Casablanca.
Joint-Ventures
-Pakistan Maroc Phosphore : a pour activité la production et la commercialisation de l’acide
phosphorique marchand.
-Imacid : Indo Maroc phosphore a pour activité la Production et la commercialisation d’Acide
Phosphorique
-Emaphos : Euro Maroc Phosphore a pour activité la Fabrication et la commercialisation d’acide
phosphorique purifié
60
-Bunge Maroc Phosphore : Fabrication et commercialisation d’acide phosphorique marchand,
d’engrais phosphatés et azotés d’autres produits dérivés
-Prayon : Fabrication et commercialisation d’une large gamme de produits principalement
phosphatés et fluorés, ainsi que des spécialités de la chimie minérale (oxyde de zinc,
hydrosulfite de soude, sels fluorés et pigments anti-corrosion, etc).
Par ailleurs, OCP SA détient d’autres entités réalisant des prestations commerciales et
socioculturelles dont notamment :
-Une société d’intermédiation commerciale : OCP Do Brazil56, avec un capital social est de 450
000 BPL, soit 2,1 millions de Dh. Cette société procède à la prospection du marché brésilien, à la
mise en contact avec de nouveaux clients et à l’amélioration des services rendus aux clients
actuels ;
-La Fondation OCP : C’est une association à but non lucratif, créée en 2007, pour porter
l’engagement social et sociétal du Groupe OCP. Elle a pour vocation de définir et de mettre en
œuvre des actions concrètes et efficaces dans les communautés où le Groupe OCP est présent à
travers le Monde. Elle a également pour mission de développer l’implication du Groupe OCP
dans les problématiques et tendances globales qui influencent son rôle.
Section 2 : Présentation du pôle chimie et du département d’accueil
2-1 Présentation du pôle chimie
Anciennement appelé Maroc Phosphore, le pôle chimie est l’une des deux unités
constituants OCP S.A après la fusion-absorption de 2012. Il faut noter que suite à cette
dernière, certains actifs de l’entreprise ont été sujets à des réévaluations alignant leurs
valeurs comptables à la valeur de marché et d’utilité des biens.
Le pôle chimie du complexe industriel Jorf Lasfar est une unité industrielle
intégrée, caractérisée par de grandes infrastructures et d’un port d’une capacité d’accueil
de navires de 100.000 tonnes, la chose qui crée une valeur ajoutée permettant de séduire
les investisseurs.
56Le décret autorisant OCP SA et Maroc Phosphore à créer OCP Do Brazil a été signé par le premier Ministre le 13 octobre 2009
61
L’unité pôle chimie dispose d’une capacité de production annuelle de 1,7 million
de tonnes d’acide phosphorique et 1,625 million de tonnes équivalent DAP.
L’atelier de production d’acide sulfurique comprend 6 lignes de production d’acide
sulfurique monohydrate d’une capacité de 2.650 tonnes par jour chacune. Le procédé
utilisé est celui à double absorption. Comparé à la simple absorption, ce procédé permet
une meilleure récupération énergétique, un meilleur rendement de conversion et une
bonne protection de l’environnement.
En effet, Les 6 unités de production du pôle chimie sont dotées d’un système
numérique de contrôle et de commande, qui permet de faciliter le travail du personnel et
l’exploitation en permettant l’enregistrement et l’archivage des opérations.
En ce qui concerne la mission du pôle chimie, cette dernière consiste
essentiellement en l’assistance, l’animation, l’harmonisation et la consolidation auprès de
diverse entités qui la composent.
Il se charge également du suivi et du contrôle des performances et des réalisations
concernant la sécurité, environnement et d’actions sociétales. Cette unité repose sur
quatre départements principaux à savoir: « consolidation économique », « consolidation
technique », « Audit et amélioration processus » et « consolidation et pilotage de
l’activité externalisation et sous-traitance ».
Cette plateforme est considérée comme la plus grande de son genre sur le plan
mondial et a pour objectif d’attirer encore plus d’investisseurs, et plus particulièrement
des partenariats avec des pays de très grande notoriété et reconnus à l’échelle mondiale.
2-2 Présentation du Jorf Lasfar
Situé sur le littoral atlantique, à 20 km au sud-ouest d’El Jadida, le complexe industriel de
Jorf Lasfar a démarré sa production en 1986. Cette unité a permis au groupe OCP de doubler sa
capacité de valorisation des phosphates. L’endroit a été choisi pour ses multiples avantages :
proximité des zones minières, existence d’un port profond, et disponibilité de grandes réserves
d’eau. Le site permet de produire chaque année 2 millions de tonnes de phosphate P2O5 sous
62
forme d’acide phosphorique, nécessitant la transformation de 7.7 millions de tonnes de
phosphate extraite des gisements de Khouribga, 2 millions de tonnes de soufre et 0.5 million de
tonnes d’ammoniac. Les besoins en énergie du complexe sont satisfaits une centrale de 111 MW
utilisant la chaleur de récupération.
Dans le cadre des actions menées en faveur des économies d’énergie et d’eau, le
site de Jorf Lasfar mène actuellement plusieurs projets de développement.
D’ailleurs, la division production d’acide phosphorique produit de l’acide
phosphorique de différentes qualités destiné à l’exportation ou à la fabrication de
fertilisants.
Le site comprend toutes les unités alimentant les ateliers de production en énergie
et fluides. Il est composé d’une centrale électrique, d’une station de pompage d’eau de
mer, d’une station de reprise d’eau de mer, d’une station de réception et de distribution
de l’eau douce et d’une station d’air comprimé.
Une partie de la production est transformée localement en engrais DAP, MAP, et NPK,
ainsi qu’en acide phosphorique purifié. L’autre partie est exportée sous forme d’acide
phosphorique marchand via les installations portuaires locales.
Les procédés utilisés pour la production d’acide phosphorique et des engrais sont munis
de système à double lavage des gaz avec recyclage du liquide dans la boucle de production. Il
en résulte des émissions gazeuses fortement atténuées et une absence de rejet liquide. En
effet, en matière de contrôle, un suivi permanent des émissions et rejets est assuré par le
laboratoire du site et des analyseurs en continue, et ce dans le cadre, de la certification ISO
14001, et de la responsabilité sociale du Groupe OCP.
2-3 Présentation de département d’accueil : « département comptable »
La fonction comptable est en relation avec l’ensemble des autres fonctions de
l’entreprise.
63
Elle est le point d’arrivée de données plus ou moins brutes et fournit des informations aux
autres fonctions mais aussi à ses partenaires extérieurs. Cette fonction fait largement appel à des
postes de travail informatisés. Elle est rattachée à la direction administrative et financière.
a) Missions du département
Les missions du département comptabilité se résument comme suit :
La fonction comptable a pour mission de recueillir les données utiles, puis de produire,
analyser et communiquer diverses informations financières. Ces informations doivent
être conformes aux règles en vigueur, compréhensibles, fiables, pertinentes et aptes à
éclairer les décisions des partenaires internes et externes de l’entreprise
Produire dans les délais et en respect de la législation en vigueur, les états de synthèse
et les déclarations fiscales prévus par la réglementation.
Veiller à l’optimisation de la gestion de la trésorerie de l’entité
Gérer et optimiser le portefeuille de l'endettement de l'entité
Assurer la coordination et la gestion de tous les financements bilatéraux et
multilatéraux de l'entité
Appliquer la politique définie par la Direction Générale dans les domaines financiers,
comptables, budgétaires et fiscaux ;
Assurer le contrôle du bon fonctionnement et l’exactitude du système d’information
comptable, financier, et budgétaire ;
Mettre en œuvre la politique de recouvrement poursuivie par la Direction Général ;
Mettre en œuvre la politique définie par la Direction Générale en matière comptable,
financière, fiscale et budgétaire.
Veiller sur le respect des procédures, des normes et des règles de gestion définies par
la direction générale dans les domaines précités ;
Assurer le bon fonctionnement du système d’information financière et comptable et
veiller sur la fiabilité et sincérité des informations produites ;
Assister les autres départements dans les domaines financiers et budgétaires.
64
b) Organisation du département
Sur le site Jorf Lasfar, le département comptable se divise en quatre services.
L’organigramme du département peut se présenter comme suit :
Figure 8 : Organigramme du département comptabilité chimie
Le système comptable, mis en place_ non seulement dans ce département mais au sein
du Groupe OCP en entier_ a une vocation essentiellement financière, juridique et fiscale : son rôle
consiste à enregistrer et à synthétiser les transactions opérées entre l’entreprise et ses tiers.
L’architecture de ce système est articulée autour d’un système de gestion intégré - Oracle E-
Business Suite - dont le déploiement a démarré en 2003 et qui couvre aujourd’hui les domaines
fonctionnels relatifs à la finance d’entreprise.
L’installation du progiciel Oracle permet de répondre aux objectifs fixés par le groupe, en
plus de la disponibilité de l’information en temps réel avec le maximum de renseignements et
efficacité. En effet, il s’agit d’un système d’information qui permet de mettre en liaison l’ensemble
d’informations ayant rapport avec la fonction comptabilité. Il rend également disponibles
instantanément toutes les données saisies, pour tous les utilisateurs ayant accès à la base de
donnée Oracle. Il regroupe quatre modules, chacun correspondant à l’un des services du
département :
Responsable Comptabilité
Chimie
Comptabilité Fournisseur
Comptabilité Client
Comptabilité Immobilisations
/ IFRS Centralisation
Responsable Comptabilité Jorf
65
AP Account Payables Comptabilité Fournisseur permet de gérer les clients, comptabiliser les opérations de ventes ainsi que les encaissements.
PO Purchase Order Comptabilité Client permet de gérer les fournisseurs, comptabiliser les opérations d’achat et de règlements.
FA Fixed Assets Gestion des Immobilisation permet de gérer les immobilisations, et de centraliser sur GL.
GL General Ledger Centralisation Comptable permet de centraliser les écritures comptables, analytiques et budgétaires. Il constitue le réceptacle qui reçoit des écritures synthétiques des autres modules dits auxiliaires, qui eux contiennent le détail des opérations.
Tableau 8 : Modules du progiciel Oracle
Ci- dessous, une capture d’écran du progiciel Oracle :
Figure 9 : Capture d'écran du progiciel Oracle
66
Section 3 : Choix du thème et méthodologie
3-1 Choix du thème de stage
Au début de notre stage, nous avons effectué une tournée dans le département
Comptabilité Chimie. Cette tournée nous a permis de nous familiariser avec les missions
effectuées dans le département.
Notre attention a porté particulièrement sur la comptabilité en normes IAS/IFRS. En
effet, cette dernière s’inscrit parfaitement dans la logique de notre formation. En outre, les
normes IAS/IFRS sont devenues actuellement un enjeu crucial pour les entreprises, et leur
maîtrise est une compétence requise pour tout bon gestionnaire.
En comparant le contenu du manuel des procédures IFRS, avec les retraitements
réellement effectués pour générer la comptabilité de ces normes, nous avons détecté
l’absence d’un retraitement concernant la dépréciation d’actifs. Il est mentionné dans le
manuel IFRS interne à l’OCP que le suivi du caractère recouvrable de la valeur comptable des
immobilisations est effectué conformément aux dispositions de la norme IAS 36
« dépréciations d’actifs » mais aucune application effective n’a été entamée jusque-là.
Nous avons donc décidé, après entretien avec le responsable du service gestion des
immobilisations Mme LAHLOU, d’initier l’application de la norme IAS 36, et d’étudier si
possible l’impact financier de cette éventuelle application.
La figure suivante, résume la logique qui nous a poussés à choisir ce thème :
Figure 10 : Processus du choix du thème
Analyse des procédures de gestion des
immobilisations
Analyses des procédures de gestion IFRS
Comparaison entre les procédures et les
retraitements effectués pour detecter les
défaillances
67
Le choix de ce thème de stage se révèle pour nous très judicieux, puisqu’il représente
une combinaison de la comptabilité et de la finance.
3-2 Méthodologie de recherche
Notre travail de recherche a été mené dans l’objectif de mettre en pratique une norme
comptable internationale.
Notre méthodologie consiste en fait à travailler sur deux axes majeurs à savoir : la
recherche documentaire et la collecte de données, comme présenté dans le tableau ci-
dessous :
Recherche documentaire Collecte de données
Elle a été effectuée non seulement pour
construire la partie théorique de notre
rapport mais aussi pour qu’on puisse
approfondir nos connaissances concernant
les normes IAS/IFRS en général, et la norme
IAS 36 spécialement.
Nous avons ciblé à travers cette recherche,
différentes sources d’informations :
Ouvrages
Sites web
Articles
Rapports de stage
Dans notre étude nous avons opté pour
deux approches :
Approche quantitative
l’objectif principal était de recueillir des
données chiffrables et quantifiables qui vont
permettre de fournir de nouvelles
informations chiffrées se présentant sous
forme d’analyses descriptives, de tableaux,
de graphiques et d’analyses statistiques de
recherche de lien entre les variables, pour
pouvoir décrire le phénomène étudié
,l’expliquer et le prédire.
Approche qualitative
basée sur la conduite des entretiens avec
différents responsables (comptabilité
immobilisations et contrôle de gestion),
inversement à l’approche quantitative qui
fournit des données chiffrées, l’approche
qualitative fournit des données de contenu.
Ces deux approches se complètent pour
aboutir à des résultats pertinents.
Tableau 9 : Méthodologie de recherche
68
3-3 Méthodologie de travail
Comme nous l’avons précisé dans la première partie de ce présent rapport, l’application
de la norme IAS 36 nécessite tout un processus, se basant sur la détermination de plusieurs
valeurs.
La méthodologie de travail adoptée pour la réalisation de ce projet se présente comme
suit :
Figure 11 : Méthodologie de travail
c) Détermination d’une UGT
La détermination de l’UGT qui sera sujette de notre test de dépréciation est une étape
très importante car l’enchainement du processus en dépend. En outre, elle peut être
qualifiée de délicate, car les données nécessaires au découpage des actifs en des unités
génératrices de trésorerie sont teintées de confidentialité au sein de l’OCP.
Nous avons opté pour un découpage en projet, et ce pour deux raisons principales:
Un projet combine plusieurs actifs qui génèrent la trésorerie dépendamment
d’autres actifs.
La possibilité de comparaison entre les réalisations et les prévisions du projet.
Détermination d'une UGT
Détermination des indices de dépréciation
Tests de dépréciation
Retraitements
Analyse des résultats
Généralisation de l'application de la norme
69
d) Détermination des indices de dépréciation
Comme nous avons vu dans la partie théorique, les indices de dépréciations peuvent être
soit de sources internes à l’entreprise, soit de sources externes.
Vu que nous avons choisi d’étudier la dépréciation d’une UGT, et plus précisément d’un
projet, il semblerait logique que les indices pertinents ne peuvent être générés qu’à partir de
l’entreprise.
e) Tests de dépréciation
Pour pouvoir juger et dire qu’une UGT a subi une dépréciation il faut juste après
l’apparition de l’indice tester l’existence d’une éventuelle perte de valeur et cela se fait à
travers la détermination de la valeur recouvrable pour la comparer par la suite avec la VNC.
On parle de dépréciation lorsque la VNC est supérieure à la valeur recouvrable.
f) Retraitements
Si l’UGT a subi une perte de valeur, il convient de procéder à des retraitements de la
base amortissable qu’on doit remettre à la valeur recouvrable.
Il faut également comptabiliser la dépréciation constatée dans la comptabilité IFRS, et ce
à travers un retraitement à effectuer sur la base de la comptabilité sociale.
g) Analyse des résultats
Si l’UGT révèle une dépréciation significative nous serons amenés à mesurer l’impact
financier des changements et des retraitements effectués. La modification de la base
imposable aura un impact sur les dotations d’amortissement et donc influencera bien
évidemment le résultat.
L’analyse a surtout consisté en une interprétation de ratios, basée sur la comparaison de
l’information financière avant l’application de la norme IAS 36, et celle postérieure à cette
application, pour enchaîner enfin avec une interprétation globale des résultats obtenus.
70
h) Généralisation de l’application de la norme
Pour généraliser l’application de la norme IAS 36 sur l’ensemble des actifs de
l’entreprise, il faut rédiger une procédure claire, adaptée à l’entreprise, prenant en
considération sa structure, la nature de ses actifs, ainsi que son système d’information.
Ayant effectué une opération de fusion-absorption, et basant sa comptabilité sur un
système d’information performant et à la pointe de la technologie, le Groupe OCP est considéré
comme un Groupe innovant et moderne.
La première section du présent chapitre a été consacrée essentiellement à la présentation
dudit Groupe, notamment son histoire, son activité, ainsi que les principaux événements qui ont
marqué son existence depuis 1920. , tandis que la deuxième section a été réservée à la
présentation du pôle chimie, et spécialement du site Jorf Lasfar, du département comptable dans
lequel nous avons effectué les quatre mois du stage de fin d’étude. La troisième section a été
dédiée à expliciter la méthodologie de travail suivie tout au long de l’élaboration du projet.
71
Chapitre 2 : Application de la norme IAS 36 au sein du pôle
chimie
Afin de réussir à implanter la norme IAS 36 au sein du pôle chimie d’OCP S.A, il est
indispensable d’analyser, dans un premier temps, les procédures de gestion des
immobilisations selon les normes comptables marocaines, pour ensuite étudier les
procédures IFRS adoptées au sein de l’entité, et détecter les failles causant la non alignement
avec ladite norme. Mais avant d’effectuer cette étude, nous jugeons nécessaire de décrire
dans le projet de la mise en place des normes IAS/IFRS au sein d’OCP S.A, en présenter les
raisons d’adoption, ainsi que impacts sur l’organisation de l’entreprise (Section 1).
Le travail portera par la suite, sur un essai d’une application effective de la norme IAS
36 au sein du pôle chimie, et sur l’analyse de cette application sur l’information financière de
l’entité (Section 2).
La section 3 quant à elle, abordera les étapes de la conception d’un guide pratique
permettant de faciliter l’application de la norme IAS 36 au sein de l’entreprise.
Section 1 : Analyse des procédures IFRS de gestion des immobilisations au sein du pôle
chimie
1-1 Présentation des processus de gestion des immobilisations en normes marocaines
La gestion et le traitement comptable des immobilisations au sein d’OCP S.A sont
décrits dans le Manuel des Processus Comptable _ Processus Immobilisations. Ce manuel
détaille chacune des étapes du Processus Comptable Immobilisations et met en évidence les
activités, les tâches, les rôles, les responsabilités et les contrôles à mettre en œuvre dans le
cadre de la gestion des immobilisations. Il a pour finalité la normalisation et
l’homogénéisation du Processus Comptable Immobilisations au sein du Groupe OCP et la
maîtrise de la qualité des opérations comptables, et ce en définissant les principes, les
activités et les tâches relatives au traitement comptable des immobilisations à la fois dans
l’activité transactionnelle courante et lors des travaux de clôture, en clarifiant et formalisant
72
les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes du Processus Comptable des
Immobilisations, ainsi qu’en contribuant au renforcement du dispositif de contrôle interne.
Il couvre les immobilisations en non-valeur (comptes 21), les immobilisations
incorporelles (comptes 22), et les immobilisations corporelles (comptes 23), mais ne traite
pas des immobilisations financières. Ces dernières sont traitées dans le cadre du Manuel de
Processus des Comptes Financiers.
Le processus de gestion des immobilisations est organisé selon une logique de
hiérarchie à 5 niveaux :
Figure 12 : Processus de gestion des immobilisations
Dans notre étude nous n’allons-nous intéresser qu’à la partie traitant les transferts, les
cessions et les dépréciations, puisque c’est elle qui présente la procédure adoptée par le
pôle chimie dans le traitement des dépréciations des immobilisations selon la comptabilité
marocaine.
Les principaux acteurs intervenant dans cette étape traitant les dépréciations sont les
suivants :
comptabilité immobilisations ;
contrôle de gestion ;
entité de contrôle matériel.
La procédure d’application de la dépréciation selon le manuel se présente ainsi :
du besoin à la commande
réception enregistrement de
la fiche immobilisation
transferts,cessions et dépreciations
opérations de clôture
73
Figure 13 : Processus de dépréciation au sein de l’OCP S.A (Comptabilité marocaine)
Le manuel de procédures précise comment les entités de contrôle matériel peuvent
déterminer des indices de dépréciation. En effet, il fournit deux exemples d’indices :
Indice de dégradation des actifs : un moteur prévu pour fonctionner dans l’eau douce
qui se déprécie plus vite car utilisé dans l’eau de mer
indice de sous-utilisation des actifs : une chaîne de production utilisée à 50% de ses
capacités
Cependant, le manuel néglige un point essentiel, notamment, la procédure de
l’évaluation de la perte de valeur par le contrôle de gestion. Par ailleurs, il faut signaler que
comptabilisation de la dépréciation éventuelle
le contrôle technique et le contrôle de gestion transmettent leurs résultats à l'entité contrôle materiel ainsi qu'à la comptabilité immobilisations qui se chargera de comptabiliser la dépréciation.
valorisation de la dépréciation (contrôle de gestion)
le contrôle de gestion procéde à l'évaluation des immobilisations en sous-utilisation.
valorisationde la dépréciation(entité controle technique)
à la demande de l'entité contrôle matériel,l'entité contrôle technique procède à une évaluation de l'immobilisation concernée par la perte/détérioration de la valeur.
demande d'étude écrite
les entités contrôle matériel doivent vérifier lors des inventaires que les immobilisations sont utilisées dans des conditions normales et que leur valeur ou leur durée de vie est bien en phase avec ce qui avait été préalablement envisagée pour ce bien. Dans le cas où un indice de perte de valeur est constatée, le contrôle matériel doit effectuer une demande écrite d'étude de dépreciation auprès des entités contrôle technique .
74
la dépréciation est restée une procédure écrite qui est négligée, et qui n’a jamais été opérée
au sein d’OCP S.A, et ce à cause de son caractère exceptionnelle dans la comptabilité
marocaine.
1-2 Adoption des normes IAS/IFRS au sein du Groupe OCP
Le Groupe OCP a certes, commencé à appliquer les normes comptables internationales
IFRS pour la tenue de ses comptes consolidés à partir de 2008, date qui semble coïncider
avec la publication de la loi n° 38-05 relative aux comptes consolidés des établissements
publics qui stipule que les établissements publics possédants ou contrôlant des filiales
doivent établir et présenter des comptes annuels consolidés selon la législation en vigueur,
ou à défaut, selon les normes internationales en vigueur57.
Cependant, suite à nos entretiens avec le personnel chargé de la comptabilité IFRS,
nous avons découvert qu’il y a une méconnaissance de l’obligation juridique du passage du
Groupe aux normes IAS/IFRS.
En effet, les raisons avancés par l’OCP sont purement stratégiques. En effet, depuis
2006, le Groupe OCP s’est doté d’une nouvelle stratégie ambitieuse qui vise à conforter sa
position dans le secteur du phosphate. La normalisation financière est l’un des grands axes
stratégiques fixés par le Groupe :
57
Dahir n° 1-06-11 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 38-05 relative aux comptes consolidés des établissements et entreprises publics (B.O n° 5404 du 16 mars 2006)
75
Figure 14 : Axes stratégiques fixés par le Groupe OCP58
La stratégie de l’OCP, vise à atteindre une meilleure transparence et ce pour des
raisons aussi stratégiques que financière. En effet, d’une part, la mise en place des normes
IAS/IFRS rentrait dans le cadre de l’émission d’obligations cotées sur la bourse de
Casablanca. D’autres parts, le groupe cherche à attirer de nouveaux partenaires étrangers,
et de ce fait, la transparence et la normalisation de son information financière seront un
atout considérable facilitant la réalisation de cet objectif.
L’année 2008 a connu la première adoption des IFRS qui s’est concrétisée par un
retraitement du bilan d’ouverture du 1er janvier conformément aux dispositions de la norme
IFRS 1. Le groupe OCP a également établi ses comptes consolidés semestriels du 30 juin 2008
et ceux annuels du 31 décembre 2008 conformément au référentiel IAS/IFRS.
La réalisation de ce projet a permis à l’OCP de se doter d’un outil de gestion jugé
indispensable pour une aussi grande structure. En effet, le passage aux normes IAS/IFRS
confère à l’entreprise la capacité de fournir une information financière claire, pertinente et
58
OCP S.A ; Note d’information : Emission d’un emprunt obligataire ; 2011
76
fiable, ainsi que d’établir des états financiers comparables dans le temps et dans l’espace. En
outre, ça lui permettra une éventuelle ouverture sur les places financières internationales.
L’adoption du référentiel IFRS a engendré la constatation de plusieurs impacts sur la
gestion de l’OCP SA dont on peut citer :
a) impacts sur la répartition des responsabilités :
Les opérationnels, notamment les ingénieurs et les chefs de chantiers, interviennent
actuellement dans des décisions qui relevaient auparavant des responsabilités des
comptables et des fiscalistes. En effet, ils peuvent:
valider les frais à attribuer dans le coût global d’une immobilisation.
valider la durée et le mode d’amortissement d’une immobilisation ou des
composantes d’une immobilisation.
voir si des dépenses doivent être immobilisées.
vérifier d’une manière régulière les durées, et les modes d’amortissement.
b) impacts sur le système d’information :
Le passage aux normes IFRS a impliqué des changements assez importants dans les
systèmes d’information de l’entité. Les changements opérés sur le système d’information lié
aux immobilisations corporelles portent essentiellement sur les applications informatiques
de suivi et de reporting des immobilisations.
D’une part, Il a fallu intégrer dans un premier temps acquérir un nouveau progiciel de
reporting, à savoir BO Finance. Ce dernier, étant alimenté par une liasse provenant d’Oracle,
permet de s’aligner sur la comptabilité IFRS et ce grâce à des écritures de retraitement et de
reclassement.
D’autres parts, la revue du système d’information a concerné essentiellement le
paramétrage des données et la mise à jour des catégories d’immobilisations, en y intégrant
77
de nouveaux sous-groupes d’immobilisations. Le système d’information dédié aux
immobilisations permet donc :
de décomposer les immobilisations par respect à l’approche par composants
et de comptabiliser chaque composant selon sa durée d’amortissement. (IAS
16)
d’imputer les immobilisations et les charges d’amortissement au secteur qui
les concerne par respect aux dispositions de l’IAS 14 : informations sectorielles.
Par ailleurs, l’impact sur le système d’information se manifeste par une utilisation
intensive du livre IFRS du module ORACLE FA.
c) impacts financier :
Afin de préparer un bilan d’ouverture aux normes IFRS (1er janvier 2008), et selon la
norme IFRS1, l’OCP a réévalué sélectivement certaines immobilisations corporelles en
fonction de leurs valeur actuelles à la date de réévaluation, et ce sur la base de l’utilité du
bien pour l’entreprise ou de la valeur du marché.
Il faut noter que la majorité des actifs réévalué ont connu une réévaluation à la hausse,
qui a généré une plus-value comptable de réévaluation. Cette dernière étant égale à la
valeur réévaluée diminuée de la valeur nette comptable avant la réévaluation. Elle a un
impact direct sur les dotations aux amortissements.
1-3 Présentation des procédures IFRS de gestion des immobilisations
Suite à notre étude du manuel IFRS des immobilisations corporelles propre à l’OCP, nous
avons découvert que ce dernier ne précise pas des procédures exactes à suivre, mais fait
plutôt une référence directe à plusieurs normes qui sont à appliquer au sein du département
comptabilité, notamment :
IAS 1 : Présentation des états financiers ;
IAS 2 : Stocks ;
IAS 16 : Immobilisations corporelles ;
IAS 17 : Contrats de location ;
78
IAS 36 : Dépréciations d’actifs ;
IFRS 1 : Première utilisation des normes d’information financière internationales ;
IFRS 6 : Prospection et évaluation des ressources minérales.
Dans l’objectif de s’aligner avec ces normes, la comptabilité chimie de Jorf Lasfar procède
à des retraitements d’un certain nombre d’applications comptables provenant de la
comptabilité nationale, et ce pour faciliter la gestion du double référentiel.
Comme nous l’avons déjà précisé, les retraitements sont effectués à l’aide du progiciel
BO Finance, et ce en procédant à des écritures manuelles (pouvant être enregistrées),
basées sur des données provenant du progiciel Oracle, comme schématisé ci-dessous :
Figure 15 : Processus des retraitements de passage aux IFRS
Ci-dessous, un aperçu du menu du progiciel BO Finance :
Figure 16 : Capture d'écran du progiciel BO Finance
79
Les retraitements effectués au sein du service Gestion des Immobilisations sont
présente comme suit :
a) Retraitement des dotations aux amortissements
La durée d’amortissement aux normes IFRS est une durée économique, et d’utilité, qui
est en général, supérieure à celle fiscale, adoptée dans la comptabilité nationale. Cette
différence génère automatiquement un écart aux dotations d’amortissements. Ce qui
implique une écriture de retraitement.
A base d’un extrait de journal de comptabilité national, et des durées d’utilité provenant
de l’annexe du Manuel de procédures IFRS des immobilisations corporelles, il y a lieu de
passer l’écriture de retraitement qui consiste à débiter le poste 283 du montant de
différence et à créditer le compte 6193 du même montant.
NB : Le matériel informatique fait l’exception de ce retraitement à cause de sa durée
d’utilité fiscale qui est supérieure à celle économique. Dans ce cas, le retraitement consiste à
débiter le compte 61935 du montant de différence et créditer le compte 2835 du même
montant.
b) Correction des amortissements sur cession
Généralement, les dotations aux amortissements dans la comptabilité nationale sont
supérieures à leurs homologues IFRS.
Après comparaison des deux _pour chaque compte d’immobilisation_ il y a lieu de passer
une écriture de retraitement en débitant le compte 6513 du montant de différence et en
créditant le poste 283 du même montant.
c) Reclassement du stock stratégique
Un stock est l’ensemble des achats non encore consommés ou vendus, et qui sont
encore présents dans les entrepôts de l’entreprise. Il est classé parmi les éléments de l’actif
80
circulant de l’entreprise, et destiné à ne pas y rester durablement, c’est-à-dire, pendant
moins d’un cycle d’activité.
Cependant, il y a une partie du stock qui reste plus d’une année dans les entrepôts de
l’entreprise qui nous appelons stock stratégique et qui nécessite un reclassement vers les
immobilisations corporelles dans les IAS/IFRS. Ledit reclassement consiste à débiter le
compte 2380 (autres immobilisations corporelles) du montant total_ diminué de la valeur
de la décote59_, et le compte 3912 (provisions pour dépréciation des matières et fournitures)
du montant total des décotes, et à créditer le compte 3122 (stocks de matières et
fournitures consommables) du montant total des stocks.
d) Reclassement des immobilisations en stock
Certaines immobilisations doivent être reclassées en stock dans la comptabilité IFRS,
notamment les groupements de bâtiments et d’appartements destinées à la vente. OCP S.A
construit fréquemment ces immeubles puisque ça rentre dans sa politique d’amélioration du
cadre social de ses ressources humaines.
Le reclassement se fait en débitant le compte 315 des produits finis, ou le compte 313
des produits en cours, et en créditant le compte 232 des constructions.
e) Retraitement du crédit-bail
Suivant le principe de prééminence de la substance sur la forme, il y a lieu de
comptabiliser les biens loués en crédit-bail en débitant un compte d’immobilisation et en
créditant le compte 1486 (fournisseur d’immobilisations), et ce en prenant en considération
la juste valeur.
Il faut noter que dans les années à suivre, il faut procéder à un amortissement du capital,
ainsi qu’au payement des charges d’intérêt.
59
Donnée relevée à partir de l’état annuel des stocks communiqué par le service contrôle de gestion
81
f) Retraitement des gros travaux à caractère immobilisable
Si les travaux de réparation et d’entretien, dépassent l’objectif de maintenance, pour
aller jusqu’à prolonger la durée de vie d’une immobilisation _ce qui induit des avantages
économiques futur_ à ce moment-là, on parle d’investissement.
A partir de la liste annuelle des gros travaux comptabilisés en charges d’entretien et
communiqués par le service contrôle de gestion, il y a lieu d’effectuer une analyse et
sélection des charges qui ont un caractère immobilisable. Par la suite, un e-mail est envoyé
au chef de projet via le contrôle de gestion pour confirmer la sélection qui a été faite en lui
demandant de compléter les informations suivantes : la date de fin du projet, et la nouvelle
durée d’utilité. A la réception de l’ensemble de ces informations, les impacts devant être
calculés sont les suivants:
L’annulation de la charge constatée sur la période concernée.
La reconnaissance de l’immobilisation.
Le calcul des amortissements à partir de la date de fin des travaux.
Le retraitement se fait à travers les écritures de retraitement suivantes :
débit du compte 2338 (autres installations techniques) du montant global des
charges de l’année à caractère immobilisable, et crédit le compte 61330 (entretien et
réparation) du même montant.
débit du compte 619338 (dotations aux amortissements) du montant globale des
amortissements, et crédit du compte 28338 (amortissement des installations
techniques) du même montant.
1-4 Comparaison des exigences du manuel de procédures IFRS et des
retraitements effectués
Le tableau suivant présente un recensement des normes exigées par le manuel de
procédures IFRS, ainsi que les retraitements effectués pour être en adéquation avec chacune
d’elle :
82
Normes exigées par le manuel
Retraitements effectués
IAS 1 Retraitement effectué au niveau du siège
IAS 2 _ Retraitement du stock stratégique
_ Retraitement des immobilisations en stock
IAS 16 _ Amortissement par composants
_ Retraitement des dotations aux amortissements
_Correction des amortissements sur cession _Retraitement des gros travaux à caractère immobilisable
IAS 17 Retraitement du crédit-bail
IAS 36 Pas de retraitement effectué
IFRS 1 _Réévaluation effectué en 2008
IFRS 6 _Retraitement effectué au niveau du pôle Mine
Tableau 10 : Comparaison des normes exigées et des retraitements effectués
Le tableau nous montre clairement qu’aucun retraitement n’est effectué pour
s’aligner avec la norme IAS 36 traitant la dépréciation des actifs. Il en résulte que la
comptabilité IFRS pôle chimie n’est pas en adéquation ni avec le manuel de procédure IFRS
du groupe, ni avec les normes IAS/IFRS. En effet, le passage aux normes comptables
internationales est un engagement d’application de l’ensemble des normes, ce qui n’est pas
le cas d’OCP S.A. Ceci nous a amené à pousser notre réflexion dans ce sens, et à faire un
essai d’application de la norme IAS 36 au sein du pôle chimie de l’OCP.
Section 2 : Mise en œuvre de la norme IAS 36
2-1 Détermination d’une UGT
Le manuel des procédures IFRS définit une UGT comme étant l’ensemble des actifs et
non pas un seul bien, regroupés par nature homogène, et bénéficiant des avantages
économiques futurs. Comme nous l’avons déjà précisé dans notre méthodologie, nous
avons opté pour un découpage en mode projet.
Vu la contrainte du temps, et la difficulté d’accès aux informations qui sont pour la
plupart teintées de confidentialité, notre échantillon d’étude n’a pu contenir qu’un seul
projet, et donc qu’une seule UGT qui sera sujette du test de dépréciation, et à travers
83
laquelle nous pourrons construire un modèle standard qui sera généralisé pour toute les
UGT d’OCP S.A
Un entretien avec M. MANSOUR, Responsable du Service Contrôle de Gestion, nous
a poussés à choisir comme UGT, la nouvelle ligne DAP. La date de démarrage de cette
dernière en fait le candidat idéal pour notre étude. En effet, ayant démarré en 2008, la ligne
a pu connaitre une perte de valeur. En outre, nous avons pu avoir accès à l’historique des
charges, production, et prix de vente des produits de ce projet.
Description du projet :
La nouvelle ligne DAP, est une ligne de production d’engrais destiné entièrement à
l’export. C’est un projet qui a démarré en 2008 pour une durée de vie de 15 ans, et qui a
nécessité un investissement de 1 Milliards de Dh, et ce dans le cadre d’un vaste programme
destiné à renforcer la position stratégique de l’OCP au niveau international.
Il faut noter que la capacité de production de la nouvelle ligne DAP s’élève à 280
Tonnes par heure.
Le projet se constitue en totalité d’environ 1600 immobilisations 60 , mais ses
composantes les plus importantes se résument en ce qui suit :
une unité de fabrication de DAP qui peut fabriquer également du MAP granulé et du
NPK ;
trois bacs de stockage de fuel de 500 m3;
un bac de stockage d’eau de procédé et d’eau d’incendie;
une station d’air d service et d ‘air instruments composée de 2 compresseurs de 1600
N m3/h chacun;
un bac de stockage et de recyclage des effluents avec pomperie;
un hangar de stockage;
une installation de stockage et de reprise de phosphate pour ballast ;
un circuit de convoyeurs de mise en stock d’engrais dans les hangars;
un bâtiment de contrôle et de commande ;
un poste de transformation et de distribution électrique ;
60
Voir Annexe n°1
84
des pipes racks et tuyauteries de jonction y compris une conduite d’eau de mer ;
un magasin de stockage des additifs ;
un local abrité pour le stockage des toiles métalliques pour cribles et outils divers et
le stationnement des engins ;
un secteur d’entretien et de bureaux ;
une unité de stockage d’ammoniac a -33C°;
une installation pilote d’une capacité de 1T/h d’engrais qui peut être utilisée pour
toute formule d’engrais.
2-2 Indices de dépréciation
Vu l’impossibilité de déterminer des indices de dépréciation externes, nous nous
sommes orientés vers des données provenant de l’intérieur de l’entreprise.
Nous avons dans un premier temps essayé de faire une tournée dans les ateliers de
production des engrais, pour vérifier la présence d’une dégradation physique des actifs,
cependant, l’emploi du temps chargé du personnel qualifié pour nous accompagner dans
notre mission, a empêché la réalisation de cette tournée.
Nous avons alors décidé de nous baser sur des données provenant du département
de contrôle de gestion, notamment, la production, et la vente de la ligne DAP.
a) Comparaison entre la production espérée et la production réelle :
Le tableau suivant présente la quantité d’engrais qu’on espérait produire grâce à la
nouvelle ligne DAP, ainsi que la quantité d’engrais réellement produite, et ce durant la
période allant de 2008 à 2013.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Production Espérée en Tonnes 367000,00 207000,00 711900,00 797788,11 999600,00 1385611,73
Production Réelle en Tonnes 264045,00 574900,00 813975,00 949375,00 833550,00 1025625,00
Ecart 102955,00 -367900,00 -102075,00 -151586,89 166050,00 359986,73
Tableau 11 : Ecart entre la production espérée te la production réelle
85
A partir de ce tableau nous avons pu dresser le graphique d’évolution des deux
productions.
Figure 17 : Evolution de la production
Le graphique montre clairement qu’à partir de l’année 2012, la production réalisée
est devenue inférieure à son homologue espérée. Ceci peut être expliqué par une
détérioration des machines de production, ce qui nous pousse à supposer qu’il existe une
certaine dépréciation des actifs de la nouvelle ligne DAP.
b) Comparaison entre les ventes prévisionnelles et les ventes réelles:
La quantité d’engrais produite joue naturellement le rôle de vente prévisionnelle. Le
tableau ci-dessous présente l’évolution de cette dernière, ainsi que celle des ventes réelles.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vente Prévisionnelle en Tonnes 264045,00 574900,00 813975,00 949375,00 833550,00 1025625,00
Quantité Vendue en Tonnes 263674,4 538713,12 474731,4 505613,24 454752,32 327240,025
Ecart 370,60 36186,88 339243,60 443761,76 378797,68 698384,97
Tableau 12 : Ecart entre les ventes prévisionnelles et les ventes réelles
A partir de ce tableau le graphique d’évolution des quantités de vente a été dressé
comme suit :
0,00
200000,00
400000,00
600000,00
800000,00
1000000,00
1200000,00
1400000,00
1600000,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pro
du
ctio
n e
n T
on
ne
s Evolution de la production
Production Espérée
Production Réèlle
86
Figure 18 : Evolution des ventes
Le graphique montre que durant les deux premières années du projet, les prévisions
et les ventes étaient similaires, tandis qu’à partir de 2010, la différence entre les prévisions
et les ventes réelles est devenue tellement flagrante qu’elle atteigne 698384,97 Tonnes. Cet
écart est dû à la non prise en compte de la crise financière internationale_ qui a démarré en
2008, et qui a influencé le marché des produits phosphatiers après 2009_ lors de
l’établissement des prévisions.
Ceci constitue un indice de dépréciation qui reflète une perte de valeur de la
nouvelle ligne DAP.
2-3 Test de dépréciation
a) Valeur recouvrable
Comme nous avons vu dans la partie théorique, la valeur recouvrable est le maximum
entre la valeur de marché, et la valeur d’utilité.
Vu que nous ne pouvons pas calculer ou estimer une valeur de marché pour la ligne
DAP, la valeur d’utilité sera automatiquement considérée comme étant la valeur recouvrable
de l’UGT.
0,00
200000,00
400000,00
600000,00
800000,00
1000000,00
1200000,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ve
nte
s e
n T
on
ne
s
Années
Evolution des ventes
Vente Prévisionnelle
Quantité Vendue parNlle DAP
87
b) Valeur d’utilité
Avant de dresser un tableau de cash-flows nous permettant de calculer la valeur
d’utilité, nous avons d’abord consulté le service contrôle de gestion pour vérifier l’existence
de cash-flows prévisionnels pour la ligne DAP, mais il s’est avéré que le service n’assure pas
ces prévisions.
Nous avons par la suite consulté encore une fois le département de contrôle de
gestion, et précisément la cellule étude et tableau de bords, pour avoir un tableau de bord,
comparant les prévisions initiales du projet avec les réalisations, mais il s’est avéré que le
service n’établit pas cette comparaison. Nous avons donc substitué ces derniers par
l’historique fournit par la section prix de revient, concernant le coût de revient des engrais,
la production, les ventes et les prix de ventes.
Nous avons pour chacun de ces quatre, modélisé une courbe de tendance61 qui nous
a permis de faire une projection vers le futur, et ainsi établir des prévisions. En effet, les
courbes de tendances nous montrent comment les variations de la mesure d’un X peuvent
expliquer les variations d’une variable Y. Nous avons testé plusieurs types de régression, et
dressé plusieurs courbes de tendances pour enfin déterminer celles qui expliquent le mieux
nos quatre variables, et ce grâce au coefficient R-square. Ce dernier, autrement appelé, R
carré, est une mesure de la précision de l'ajustement de la courbe de tendance. Il s'agit du
rapport entre la variation de la variable dépendante (mesurée par sa variance) expliquée par
le modèle de régression et sa variation totale (mesurée par sa variance). La formule se
présente donc comme suit :
Cet indicateur varie entre 0 et 1. Plus sa valeur approche de 1, plus la corrélation est
forte entre les cours et la courbe de régression.62
Prévision de la Production
A partir du Tableau 11, nous avons dressé la courbe de la production réelle en
fonction des années, ainsi que la courbe de tendance qui l’explique :
61
Les courbes de tendances ont été tracées grâce à l’utilitaire Excel. 62
http://www.axialfinance.com/manuel/pagesindicateurs/pageRSQ.html
88
Figure 19 : Régression de la production réelle
La courbe de tendance a été générée grâce à une régression linéaire. L’équation se
présente comme suit :
y = 134836x + 271653
Le coefficient de corrélation R² est égal à 0,8088, ce qui implique que 80% de la
production peut être expliquée par cette régression linéaire.
En remplaçant X par le facteur temporel des années 2014 à 2022, nous obtenons les
quantités produites prévisionnelles suivantes :
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Production 1215505 1350341 1485177 1620013 1754849 1889685 2024521 2159357 2294193
Tableau 13 : Prévision de la production
Nous avons pris en compte la capacité de production de la nouvelle ligne DAP dans
nos prévisions. En effet, comme nous l’avons précisé dans la présentation du projet, la
capacité de production de la ligne s’élève à 280 Tonnes/Heure. Il en résulte que le plafond
de production est de 2419200 Tonnes/An.
Prévision des Prix de vente
Le tableau ci-dessous présente l’historique des prix de vente de l’engrais produit par
la ligne DAP :
0,00
200000,00
400000,00
600000,00
800000,00
1000000,00
1200000,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pro
du
ctio
n e
n T
on
ne
s
Années
Production Réelle
Production Réèlle
Linéaire (ProductionRéèlle)
89
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prix de vente en DH 7205,31 2688,88 3983,15 5099,12 4894,57 3888,33
Tableau 14 : Evolution des prix de vente
A partir de ce tableau, nous avons dressé la courbe d’évolution temporelle des prix
de vente, ainsi que la courbe de tendance l’expliquant. Il faut noter que cette dernière est
une régression de puissance dont l’équation est y = 3011,9 X0,2994, et qui explique l’évolution
des prix à 56,1%.
Figure 20 : Evolution des prix de vente
Notons que nous n’avons pris en considération que les données concernant la
période après l’année 2009, et ce pour avoir une certaine logique dans la prévision des prix
de vente. En effet, il est difficile de prévoir le prix de vente des engrais. D’une part, le
marché international des engrais obéit à la loi de l’offre et de la demande. Ainsi les cours des
produits phosphatés peuvent, dans le cas d’un marché tendu, connaître une forte volatilité.
D’autres parts, le prix de vente est lié à un autre facteur qui est la fluctuation des taux de
change, ce qui accentue volatilité.
En remplaçant dans l’équation, nous obtenons les prix de ventes unitaires, en Dh,
prévisionnels suivants63 :
63
Les chiffres ont été arrondis pour assurer une lecture aisée du tableau.
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2009 2010 2011 2012 2013
Pri
x d
e v
en
te u
nit
aire
en
Dh
Années
Prix de vente
Série1
Puissance (Série1)
90
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PVU 5 393,4 5 613,4 5 814,9 6 001,2 6 175 6 337,9 6 491,7 6 637,3 6 775,8
Tableau 15 : Prévision des prix de vente unitaires
Nous avons choisi de suivre une régression exponentielle, car nous estimons que
l’effet de la crise financière causant la chute de prix, est en train de se dissiper
graduellement, et donc les prix connaîtront une augmentation progressive à partir de 2013.
Prévision des Ventes
N’adoptant pas une politique de production sur commande, et vu que l’écart entre
les ventes et la production s’est agrandie durant les dernières années à cause de la crise
financière, nous nous sommes tournés vers le prix de vente pour élaborer nos prévisions.
Le tableau suivant présente les prix de ventes, et les quantités d’engrais vendues par
la ligne DAP64, et ce durant les années entre 2008 et 2014.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Prix de vente en DH 7205,31 2688,88 3983,15 5099,12 4894,57 3888,33
Quantité Vendue par Nlle DAP 263674,4 538713,12 474731,4 505613,24 454752,32 327240,025
Tableau 16 : Evolution des ventes par rapport au prix
Le but de cette présentation est de dresser une courbe de tendance, expliquant la
variation de la quantité d’engrais vendue, en fonction du prix de vente :
Figure 21 : Variation des ventes en fonction des prix de vente
64
Les engrais de la ligne DAP sont destinés à l’étranger. C’est une activité d’export.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
0 2000 4000 6000 8000
Ve
nte
s e
n T
on
ne
s
Prix de vente en Dh
Quantité Vendue par Nlle DAP
Quantité Vendue par NlleDAP
Poly. (Quantité Venduepar Nlle DAP)
91
La courbe de tendance que nous avons tracée est une courbe polynomiale de
troisième degré, et dont l’équation se présente comme suit :
y = -0,00003x3 + 0,44423x2 - 2 023,53585x + 3 368 940,85449
Le coefficient de corrélation R² est égal à 0,81208. Donc, la variation de la quantité
d’engrais vendue est expliquée à 81% par la variation du prix.
En remplaçant dans l’équation les X avec les prix de vente prévisionnels qu’on a déjà
obtenue précédemment, nous obtenons les quantités prévisionnelles de vente d’engrais
suivantes65 :
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ventes 670684 701436 724469 740088 748674 750628 746341 736185 720506
Tableau 17 : Prévision des ventes en tonnes
Prévision des Charges décaissables
OCP SA doit s’approvisionner en ammoniac et en soufre pour la production de
dérivés du phosphate. Les prix de ces matières premières peuvent fluctuer et leur
disponibilité varier. Cependant, OCP SA dispose d’un portefeuille fournisseurs de qualité
avec lequel le Groupe OCP entretient des relations privilégiées susceptibles de lui assurer un
accès direct aux matières premières et à des prix contrôlés.
Le tableau suivant présente les quantités d’engrais produites par la ligne DAP durant
les années entre 2008 et 2014, ainsi que les montants des charges ayants été mobilisées
pour cette production.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Production 264045 574900 813975 949375 833550 1025625
Charges en Dh 1675167976 203166237 2619101197 4103544543 3750290103 3855231727
Tableau 18 : Evolutions de la production et des charges décaissables
A partir de ce tableau, nous avons dressé la courbe ci-dessous, reflétant la relation
entre les charges et la production.
65
Les chiffres ont été arrondis pour assurer une lecture aisée du tableau.
92
Figure 22 : Variation des charges en fonction de la production
Cette courbe de tendance est une courbe logarithmique dont l’équation est :
y = 1 981 948 124,37ln(x) - 24420883570,1, et le R² est 0,43.
En remplaçant dans l’équation les X avec les quantités produites prévisionnels qu’on
a déjà calculées précédemment, nous obtenons les montants des charges prévisionnels en
Milliers de Dh66 :
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Charges 3347538 3556034 3744669 3916901 4075355 4222073 4358675 4486466 4606514
Tableau 19 : Prévision des charges décaissables en KDh
Prévision du Chiffre d’Affaires
Pour établir les prévisions concernant le chiffre d’affaires, nous n’avons pas eu à
modéliser une courbe de tendance. En effet, il suffit simplement de multiplier les quantités
vendues prévisionnelles, par les prix de ventes unitaires.
Le tableau ci-dessous présente les chiffres d’affaires prévisionnels en milliers de Dh
de la nouvelle ligne DAP, et ce entre 2014 et 2022 :
66
Les chiffres ont été arrondis pour assurer une lecture aisée du tableau.
0,00
500 000 000,00
1 000 000 000,00
1 500 000 000,00
2 000 000 000,00
2 500 000 000,00
3 000 000 000,00
3 500 000 000,00
4 000 000 000,00
4 500 000 000,00
0,00 400000,00 800000,00 1200000,00
Ch
arge
s d
éca
issa
ble
s e
n D
h
Production en Tonnes
Total charges
Total charges
Log. (Total charges)
93
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CA 3617271 3937438 4212703 4441444 4623029 4757430 4844990 4886283 4882024
Tableau 20 : Prévision du Chiffre d'affaires en KDh
Dotations aux amortissements
Pour calculer les dotations aux amortissements futurs de la nouvelle ligne DAP, nous
nous sommes basés sur la liste des immobilisations de la nouvelle ligne DAP67, contenant
notamment les informations suivantes à propos de chaque immobilisation :
Description
Date mise en service
Méthode d'amortissement68
Durée de vie
Valeur d’origine
Amortissement mensuel
Dotation annuelle
Amortissement cumulé
Valeur nette comptable
Le tableau suivant fournit les totaux69 des dotations aux amortissements annuels
entre 2014 et 2022 :
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DA 34301749 34251222 34161455 34081202 33569855 33556448 33545887 33476725 31233965
Tableau 21 : Dotations aux amortissements en Dh
Résultat d’exploitation
En déduisant les charges décaissables et les dotations aux amortissements du Chiffre
d’affaires, nous obtenons le Résultat d’exploitation70 :
67
Voir Annexe n°1 68
La méthode d’amortissement est toujours linéaire à l’OCP. 69
Voir Annexe n°2 pour les dotations individuelles.
94
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
RE 235432 347153 433872 490462 514105 501800 452769 366340 244277
Tableau 22 : Prévision des Résultats d'exploitation en KDh
Impôt sur les sociétés
Exerçant une activité d’export, la nouvelle ligne DAP bénéficie d’un taux d’IS réduit.
En effet, les entreprises exerçant une activité d’export sont imposées à hauteur de 17,5%71.
Il faut noter qu’en cas de résultat négatif, l’entreprise est tenue de payer une
cotisation minimale de 0,5% du Chiffres d’affaires, mais tout en intégrant le prorata de
l’exonération pour l’activité d’export72.
Pour calculer l’IS prévisionnel, nous avons en premier lieu déterminé le résultat
imposable73 en éliminant les charges non imposables qui constituent en moyenne 27% des
charges décaissables :
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
RI 1139267 1307283 1444933 1548025 1614451 1641760 1629611 1577686 1488035
Tableau 23 : Résultat Imposable en Dh
Nous avons par la suite calculé la cotisation minimale en fonction des chiffres
d’affaires prévisionnels:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cotisation en KDh
9043 9843 10532 11104 11557 11893 12112 12216 12205
Tableau 24 : Cotisation minimale en KDh
En prenant le maximum entre l’impôt calculé à partir du Résultat Imposable et les
Cotisation Minimale, nous avons déterminé l’Impôt prévisionnel à payer :
70
Le Résultat d’exploitation est présenté en Milliers de Dh 71
Article 19 du Code Général des Impôts 72
Article 144 du Code Général des Impôts 73
Les montants sont en milliers de Dh. Ils ont été arrondis pour une lecture aisée du tableau
95
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
IS en KDh
199371 228774 252863 270904 282529 287308 285182 276095 260406
Tableau 25 : Impôt prévisionnel sur les sociétés en KDh
Besoin en fonds de roulement
Le BFR matérialise le besoin en trésorerie que l'activité. En effet, il sert à financer le
cycle d'exploitation de l'entreprise. Il est calculé en fonction des délais de dettes et de
créances par rapport aux jours du chiffre d'affaires.
En ce qui concerne la nouvelle ligne DAP, le délai des créances est de 4 mois. Tandis
que le délai des dettes est de 1 mois :
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
BFR en KDh
957481 1048740 1126505 1189978 1238754 1272673 1291728 1296015 1285692
∆ BFR en KDh
247413 91259 77764 63473 48776 33919 19055 4286 -10323
Tableau 26 : Prévision du BFR et de sa variation en KDh
Il faut noter que pour le calcul de la variation du BFR en 2014, nous avons en premier
lieu calculé la valeur du BFR en 2013, et qui était de 710 068 755,54 Dh.
Investissement et valeur résiduel
Le projet de la nouvelle ligne DAP n’a nécessité aucun investissement après l’année
2012, et selon le programme d’investissement en vigueur actuellement au sein du pôle
chimie, il n’en nécessitera pas au-delà de 2014.
Par ailleurs, vu que nous avons mené les prévisions jusqu’à la date de fin du projet,
nous n’avons pas eu à incorporer une valeur terminal ou résiduel dans le calcul de la valeur
d’utilité.
Cash-Flow
Après avoir déterminé toutes les valeurs nécessaires pour le calcul des flux de
trésorerie, il ne reste plus qu’à appliquer la formule de déduire les flux d’investissement des
flux d’exploitation, pour obtenir les cash-flows.
96
Dans notre cas, cette opération consistera à appliquer la formule suivante :
Cash-Flow = Résultat d’exploitation – IS + Dotations aux amortissements - ∆ BFR
Pour déterminer la valeur d’utilité, il faut additionner l’ensemble des cash-flows
actualisés.
Le taux ayant servi à actualiser les flux de trésorerie est égal à 12%. Cette valeur est
une donnée fournie par la Direction Financière du Pôle Chimie, et qui correspond au Coût
Moyen Pondéré du Capital d’OCP S.A.
Le tableau suivant récapitule toutes les valeurs que nous avons déjà déterminées, et
présente les Cash-Flows, ainsi que les Cash-Flows actualisés74 :
74
Les chiffres ont été arrondis pour assurer une lecture aisée du tableau.
97
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Production 1215505 1350341 1485177 1620013 1754849 1889685 2024521 2159357 2294193
Ventes 670 684 701 436 724 470 740 089 748 675 750 628 746 342 736 186 720 506
Prix 5 393 5 613 5 815 6 001 6 175 6 338 6 492 6 637 6 776
CA 3 617 271 614 3 937 438 646 4 212 703 519 4 441 444 449 4 623 029 787 4 757 430 512 4 844 990 107 4 886 282 960 4 882 024 783
Charges 3 347 537 927 3 556 033 964 3 744 669 452 3 916 901 174 4 075 355 230 4 222 073 568 4 358 675 340 4 486 466 129 4 606 514 026
Dotations 34 301 749 34 251 222 34 161 455 34 081 202 33 569 855 33 556 448 33 545 887 33 476 725 31 233 965
RE 235 431 939 347 153 460 433 872 613 490 462 073 514 104 703 501 800 496 452 768 880 366 340 106 244 276 792
Cotisation
Minimale
9 043 179 9 843 597 10 531 759 11 103 611 11 557 574 11 893 576 12 112 475 12 215 707 12 205 062
IS 199 371 756 228 774 460 252 863 339 270 904 443 282 528 858 287 308 063 285 181 964 276 095 043 260 406 226
BFR 957 481 475 1 048 740 363 1 126 504 855 1 189 977 979 1 238 754 416 1 272 673 048 1 291 728 281 1 296 014 749 1 285 691 804
∆ BFR 247 412 720 91 258 888 77 764 492 63 473 124 48 776 437 33 918 631 19 055 234 4 286 467 -10 322 945
CF -177 050 789 61 371 334 137 406 236 190 165 708 216 369 263 214 130 250 182 077 570 119 435 321 25 427 475
Actualisation 12%
DCF -158 081 061 48 924 852 97 803 045 120 853 746 122 773 731 108 485 049 82 362 646 48 237 923 9 169 403
Tableau 27 : Prévision des flux de trésorerie de la nouvelle ligne DAP
NB : Seules les valeurs de concernant la production et les ventes sont en Tonnes. Toutes les autres valeurs sont en Dh.
98
En additionnant les Cash-Flows actualisés des périodes allant du 1er Janvier
2014, jusqu’au 31 Décembre 2022, on obtient la valeur d’utilité de la nouvelle ligne
DAP au 31 Décembre 2013 :
Valeur d’utilité = ∑ Cash-Flows actualisés = 480 529 332 Dh
La Valeur Nette Comptable des immobilisations du projet est égal à 660
330 679 Dh75. Cette dernière a été calculée après un traitement de l’ensemble des
immobilisations du projet.
On remarque donc qu’il y a une dépréciation chiffrée à :
Dépréciation = VNC – Valeur d’utilité = 660 330 679 Dh - 480 529 332 Dh = 179
801 348 Dh
2-4 Comptabilisation de la dépréciation
Pour assurer le passage de la comptabilité marocaine vers les normes
IAS/IFRS, nous devons comptabiliser la dépréciation de l’UGT, et ce en mettant au
point retraitement. Ce dernier se présente sous forme de l’écriture comptable
suivante:
Suite à la comptabilisation de l’écriture comptable de la dépréciation, il faut
ajuster les plans d’amortissement de l’ensemble des immobilisations faisant partie
de la nouvelle ligne DAP.
75
Voir Annexe n°1
99
La distribution de la perte de valeur sur les immobilisations de l’UGT, se fera
en fonction du prorata de la valeur comptable de chaque actif.
Nous allons donner un exemple de l’ajustement du plan d’amortissement
d’une immobilisation appartenant à la nouvelle ligne DAP76 :
L’immobilisation 590741RV-DEMARREU est l’une des immobilisations ayant
été réévaluées après la fusion de 2012. Sa valeur d’origine est de 67 468,89 Dh lors
de la nouvelle mise en service du 1er Janvier 2012, et sa durée de vie est de 8 ans.
Son plan d’amortissement initial, après réévaluation, et avant dépréciation se
présente comme suit :
Date Valeur d’origine Amortissement VNC
31/12/2012 67 468,89 8433,61 59 035,28 31/12/2013 59 035,28 8433,61 50 601,67 31/12/2014 50 601,67 8433,61 42 168,06 31/12/2015 42 168,06 8433,61 33 734,45 31/12/2016 33 734,45 8433,61 25 300,84 31/12/2017 25 300,84 8433,61 16 867,23 31/12/2018 16 867,23 8433,61 8 433,61 31/12/2019 8 433,61 8433,61 0
Tableau 28 : Plan d'amortissement de 590741RV-DEMARREU Avant dépréciation
Après constatation de la perte de valeur, les dotations aux amortissements
survenant après le 31/12/2013 seront réduites, suite à la réduction de la VNC à cette
date de 13778,32168 Dh. Le plan d’amortissement se présentera donc comme suit :
Date Valeur d’origine Amortissement VNC
31/12/2012 67 468,89 8433,61 59 035,28 31/12/2013 59 035,28 8433,61 36 823,35 31/12/2014 36 823,35 6137,225 30 686,12 31/12/2015 30 686,12 6137,225 24 548,90 31/12/2016 24 548,90 6137,225 18 411,67 31/12/2017 18 411,67 6137,225 12 274,45 31/12/2018 12 274,45 6137,225 6137,225 31/12/2019 6137,225 6137,225 0
Tableau 29 : Plan d'amortissement de 590741RV-DEMARREU Après dépréciation
76
Consulter l’Annexe n°4 pour la distribution de valeur sur l’ensemble des immobilisations
100
La VNC de 590741RV-DEMARREU au 31/12/2013 est de 36 823,35. Cette
valeur correspond la VNC diminuée du montant de la perte de valeur :
50 601,67 - 13778,32168 = 36 823,35 Dh.
En ce qui concerne la dotation aux amortissements des années suivant le
31/12/2013, elle a été obtenue comme suit :
Valeur d’origine / Nombre d’années restantes = 36823,35 /6 = 6137,225
2-5 Impact sur l’information financière
a) Indicateurs financiers
Afin de quantifier l’impact de la norme IAS 36 sur l’information financière du
Pôle Chimie d’OCP S.A, nous allons calculer des indicateurs financiers à partir des
documents comptables suivant le CGNC, que nous allons par la suite modifier pour
obtenir une information prenant en considération la perte de valeur induite par
l’application de la norme IAS 36. Nous n’intégrerons pas dans cette étude, les autres
normes IAS/IFRS et ce pour une raisons principale. Nous ne voulons étudier que
l’impact financier qu’apporterait l’application de la norme IAS 36.
Nous allons nous baser sur le Bilans et le CPC du 31/12/201377pour effectuer
nos calcul, mais, avant même de calculer les indicateurs financiers principaux, nous
pouvons déjà constater les prémices de l’impact à travers la simple lecture des
Bilans et des CPC :
Avant application Après application
Total Actif 66 618 583 KDh 66 438 782 KDh
Total Passif (Hors Résultat) 56 199 464 KDh 56 019 663 KDh
Total Immobilisations 35 812 642 KDh 35 632 841 KDh
Résultat Net 10 419 119 KDh 10 239 318 KDh
Tableau 30 : Comparaison des principaux comptes du Bilan et du CPC avant et après dépréciation
77
Voir Annexe n°5 « Bilan », et Annexe n°6 « CPC »
101
Indicateurs financiers selon les normes marocaines :
Ratio d’endettement :
Ce ratio mesure la part que représentent toutes les dettes par rapport au
total des actifs de l’entreprise, autrement dit au total de ses ressources puisque
l’actif est égal au passif.
Donc : Ratio d’endettement = 5 594 760/ 66 618 583 = 0,083
Plus le ratio d’endettement est élevé, plus l’entreprise étudiée est endettée.
Il est généralement admis qu’un ratio supérieur à 80 % signifie que l’entreprise est
trop endettée. Dans notre cas, nous pouvons dire que le pôle chimie d’OCP S.A est
faiblement endetté. Ce qui reflète l’indépendance de l’entreprise.
Capacité d’autofinancement :
La CAF est une ressource interne dégagée par l’activité de l’entreprise au
cours d’une période donnée et restant à la disposition de l’entreprise lorsque tous
les produits auront été encaissés et les charges décaissées.
CAF = 10419119 – 657704 – 37159 – 47408 – 17914 + 2495590 + 16626 +
82823 + 68635 = 12 322 608 KDh
La capacité d’autofinancement du pôle chimie est très forte. Elle reflète
l’indépendance de l’entreprise malgré l’absence de capitaux propres, et lui
permettra de de poursuivre les programmes d’investissement nécessaires au
maintien ou au développement de son activité.
RATIO D’ENDETTEMENT = TOTAL DETTES / TOTAL ACTIF
CAF = RESULTAT NET - AUTRES PRODUITS NON ENCAISSABLES – PRODUITS DE CESSION
D’ELEMENTS D’ACTIF + AUTRES CHARGES NON DECESSABLES + VNC D’ELEMENTS
CEDES – QUOTE PART DES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
102
Ratio de remboursement des dettes :
Ce ratio permet de mesurer le nombre d’années nécessaires à l’entreprise
pour rembourser ses dettes à long terme.
Ratio de remboursement de dettes = 269770/12322608 = 0,022
Ce ratio montre qu’en cas de problème, le pôle chimie d’OCP S.A serait dans
la mesure de rembourser ses dettes financières dans un délai de 8 jours, et ce grâce
à sa capacité d’autofinancement.
Le Besoin en Fonds de Roulement :
Le besoin en fonds de roulement correspond à la différence entre les besoins
et les ressources engendrées par le cycle d’exploitation.
Donc : BFR = 14887829 – 5309441 = 9 578 388 KDh
Le BFR étant positif, nous déduisons que les emplois d'exploitation de
l'entreprise sont supérieurs à ses ressources d'exploitation. L'entreprise doit donc
financer ses besoins à court terme soit à l'aide d’un excédent de ressources à long
terme, soit à l'aide de ressources financières complémentaires à court terme,
comme les concours bancaires.
Rentabilité économique :
Ce ratio correspond à ce que la comptabilité anglo-saxonne appelle le
« Return on Assets » ou encore « ROA ». Il représente l’efficacité avec laquelle
l’entreprise utilise les capitaux mis à sa disposition.
BFR = CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT - DETTES DU PASSIF CIRCULANT
RATIO DE REMBOURSEMENT = DETTES A LONG TERME/ CAF
103
Donc ROA= 7789973,4 / 45391030 = 0,17
Le pôle jouit donc d’une rentabilité économique forte.
Rentabilité commerciale:
Elle mesure la capacité de la société à générer du chiffre d’affaire en fonction
des volumes de ventes qu’elle réalise.
Concrètement, ce ratio donne le taux de marge nette qui mesure la
rentabilité de l’entreprise en fonction de son chiffre d’affaires. En d’autres termes, il
permet de calculer la profitabilité de l’entreprise.
Donc : Rentabilité commerciale = 10419119 / 27588982 = 0,38
Donc, pour chaque 100 Dhs de chiffre d’affaires, le pôle chimie d’OCP S.A
génère 38 Dhs de bénéfice net.
Retour sur investissement du capital humain :
Le retour sur investissement du capital humain, ou Human Capital Return on
Investment en anglais, est un ratio financier, qui sert dans les reporting et pilotage
des données sociales.
Donc : HCROI = (27588982 – 18687268 + 2367402) / 2367402 = 4.76 KDH
RENTABILITE ECONOMIQUE = RESULTAT ECONOMIQUE / ACTIF ECONOMIQUE =
RE APRES IMPOT/ (IMMOBILISATIONS NETTES + BFR)
RENTABILITE COMMERCIALE = RESULTAT NET / CHIFFRE D’AFFAIRES
HCROI = (CA - CHARGES + REMUNERATIONS) / REMUNERATIONS
104
Il est apparent selon ce ratio que l’investissement du pôle chimie d’OCP S .A
en ressources humaines est un investissement très profitable.
Obsolescence des immobilisations :
C’est le taux d’amortissement moyen des immobilisations. Il Renseigne sur la
politique d’investissement de l'entreprise.
Donc : Obsolescence = 3617593 / 39429722 = 0,09
A travers ce ratio, on constate que les immobilisations du pôle chimie sont
amorties à un taux moyen de 9%.
Actif Net Comptable:
Le calcul de l’actif net comptable est l’une des méthodes patrimoniales de la
valorisation de l’entreprise. En effet, l'actif net comptable est la part de l'actif d'une
entreprise qui appartient en propres aux actionnaires. Il permet de donner
une évaluation brute d'une entreprise à partir de son bilan comptable.
Donc : ANC = 66616803 – 5577598 = 61 039 205 KDH
C’est la valeur patrimoniale du pôle chimie d’OCP S.A
Indicateurs financiers après application de la norme IAS 36 :
En suivant les mêmes formules que nous avons déjà appliquées ci-dessus
pour obtenir les indicateurs financiers selon les normes marocaines, nous allons
ANC = ACTIF REEL - DETTES REELLES
OBSOLESCENCE = TOTAL DES AMORTISSEMENTS / IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES BRUTES
105
procéder aux calculs des indicateurs financiers mais en prenant en considération
l’application de la norme IAS 36 sur le projet de la nouvelle ligne DAP :
Ratio d’endettement :
Ratio d’endettement = 5 594 760/ 66 438 782 = 0,084
Il apparaît que l’entreprise est peu endettée et jouit donc d’une grande
indépendance financière.
Capacité d’autofinancement :
CAF = 10239318 – 657704 – 37159 – 47408 – 17914 + 2495590 + 16626
+179801+ 82823 + 68635 = 12 322 608 KDh
On constate que le pôle chimie possède une excellente capacité
d’autofinancement qui lui permet de jouir d’une indépendance financière.
Ratio de remboursement des dettes :
Ratio de remboursement de dettes = 269770/12322608 = 0,022
D’après ce ratio, le pôle chimie d’OCP S.A serait dans la capacité de
rembourser ses dettes financières dans un délai de 8 jours, et ce grâce à sa capacité
d’autofinancement.
Besoin en Fonds de Roulement :
BFR = 14887829 – 5309441 = 9 578 388 KDh
Ayant un BFR positif, l’entreprise doit lever des fonds pour combler le flux
négatif généré par le cycle d’exploitation.
Rentabilité économique :
ROA= 7 641 636 / 45 211 229 = 0,16
106
L’entreprise jouit donc d’une rentabilité économique de 16%.
Rentabilité commerciale:
Rentabilité commerciale = 10 239 318 / 27 588 982 = 0,37
Donc, pour chaque 100 Dhs de chiffre d’affaires, le pôle chimie d’OCP S.A
génère 37 Dhs de bénéfice net.
Retour sur investissement du capital humain :
HCROI = (27588982 – 18867069 + 2367402) / 2367402 = 4.68 KDH
Il apparaît donc clairement que l’investissement du pôle chimie d’OCP S.A est
très rentable.
Obsolescence des immobilisations :
Obsolescence = 3797394/ 39429722 = 0,096
A travers ce ratio, on constate que les immobilisations du pôle chimie sont
amorties à un taux moyen de 8%.
Actif Net Comptable:
ANC = 66437002 – 5577598 = 60 859 404 KDH
Donc la valeur de l’entreprise est de 60 859 404 KDH.
b) Comparaison entre les indicateurs
Grâce à la comparaison entre les indicateurs financiers, nous ne pourrons
certes pas déterminer l’ampleur de l’impact de l’application de la norme IAS 36 sur
l’information financière du pôle chimie d’OCP S.A, mais nous allons néanmoins
107
détecter l’information susceptible d’être modifiée suite à la généralisation de
l’application de la norme.
Tableau comparatif :
Indicateur Avant application de
la Norme IAS 3
Après application de
la Norme IAS 36
Ecart78
1 Résultat Net 10 419 119 10 239 318 179 801 KDH
2 Endettement 8,3% 8,4% -0,1%
3 CAF 12 322 608 12 322 608 0 KDH
4 Remboursement
des dettes
8 Jours 8 Jours 0 Jour
5 BFR 9 578 388 9 578 388 0 KDH
6 ROA 17% 16% 1%
7 Rentabilité
Commerciale
38% 37% 1%
8 HCROI 4.76 4.68 0,08 KDH
9 Obsolescence 9% 9,6% 0,6%
10 ANC 61 039 205 60 859 404 179 801 KDH
Tableau 31 : Tableau comparatif des indicateurs financiers avant et après application de la norme IAS 36
Interprétations et analyses :
1) L’écart qui existe entre le Résultat Net avant et après la constatation de la
dépréciation de la nouvelle ligne DAP est similaire à la perte de valeur
constatée, qui est de 179 801 KDH. Ce montant n’est certes pas significatif
pour une entité aussi grande qu’OCP S.A, cependant, cette constatation nous
pousse à supposer qu’en cas d’une généralisation de l’application de la
norme IAS 36, le Résultat Net sera impacté sensiblement.
La mise en place des normes IAS 36 au sein d’OCP S.A a donc un grand impact
sur la vision qu’on a du bénéfice de l’entreprise.
2) Les deux ratios que nous avons obtenus en ce qui concerne l’endettement
du pôle chimie montrent que ce dernier est très peu endetté.
78
Ecart = Indicateur avant application de la norme IAS 36 – Indicateur après application de la norme IAS 36
108
L’écart apporté par l’application de la norme IAS 36 entre les deux ratios est
de 1%. Nous pouvons donc dire que la mise en place de la norme IAS 36 au
sein d’OCP S.A influencera significativement l’information concernant
l’endettement de l’entreprise.
3) Aucun écart n’a été constaté sur la CAF. Cependant, ceci ne veut pas
forcément dire que la mise en place de la norme IAS 36 n’a aucun impact sur
l’information financière d’OCP S.A. En effet, la similarité entre les deux
indicateurs est due à l’absence d’un impôt propre au pôle chimie. Ceci est
donc un cas d’exception qui ne peut être généralisé.
4) Aucun écart n’a été détecté dans le nombre de jours nécessaires pour le
remboursement des dettes du pôle chimie. Mais vu la liaison de cet
indicateurs à la CAF, nous ne pouvons affirmer la non existence d’un impact
sur le délai de remboursement des dettes après application de la norme IAS
36.
5) Les deux BFR étant égaux, on déduit que la mise en place de la norme IAS 36
au sein d’OCP S.A n’a pas d’incidence sur le BFR. En effet, le BFR est calculé à
la base du bas du bilan, tandis que l’incidence apportée par la mise en œuvre
de la norme IAS 36 est constatable en haut du bilan.
6) La rentabilité économique est un indicateur très important pour le contrôle
de gestion, et pour toute analyse financière, puisqu’il mesure l'efficacité de
l'activité de l'entreprise d'un point de vue financier.
Donc, suivant ce principe, si un analyste financier calcule la rentabilité
économique avant l’application de la norme IAS 36, il se retrouvera avec une
rentabilité financière de 17%, tandis qu’un autre qui prend en considération
la dépréciation, trouvera une rentabilité économique de 16%. Certes, ce
n’est pas très éloigné de la première rentabilité. Néanmoins, en termes de
rentabilité économique, le moindre écart a une grande significativité.
109
Dans notre cas, l’écart est de 1% après l’application de la norme IAS 36 sur
un seul projet du pôle chimie. Nous pouvons donc dire que la mise en place
de la norme de dépréciation d’actifs au sein d’OCP S.A entrainera
probablement une grande incidence sur sa rentabilité économique.
7) L’information que nous pouvons tirer du bilan avant l’application de l’IAS 36,
concernant la rentabilité commerciale est telle que pour chaque 100 Dhs de
chiffre d’affaires, le pôle chimie génère 38 Dh de bénéfice net, alors que celle
tirée après l’application de la norme est telle que pour chaque 100 Dh de
chiffre d’affaires, le pôle chimie génère 37 Dh de bénéfice net.
Donc, même si l’écart entre les deux ratios est juste 1%, la différence entre
les gains que peuvent générer deux entreprises avec les taux de rentabilité
nette de 37% et 38% est très grande.
Nous pouvons donc dire que la mise en place de la norme IAS 36 au sein
d’OCP S.A changera la vision que nous avons de la rentabilité commerciale
de l’entreprise.
8) L’écart entre les deux indices du Retour sur Investissement en Capital
Humain est de de 0,08 KDH. Cette valeur semble insignifiante mais le cumul
des dépréciations entrainera certainement un plus grand impact.
Nous déduisons que la mise en place de la norme IAS 36 influence
l’information financière concernant le retour sur investissement du capital
humain.
9) Suite à l’écriture passée pour constater la perte de valeur de la nouvelle ligne
DAP, l’amortissement des immobilisations corporelles de l’année 2013 a
augmenté de la valeur de la dépréciation. Ceci est la source de l’écart de
0,6% dans le ratio d’obsolescence des immobilisations.
Nous déduisons donc que l’application de la norme IAS 36 a un impact sur le
degré d’obsolescence de l’actif immobilisé de l’entreprise.
110
10) Le calcul de l’Actif Net Comptable fait partie des méthodes patrimoniales de
l’évaluation de l’entreprise.
L’écart constaté dans l’ANC est de 179 801 KDH. C’est un montant équivalent
à celui de la dépréciation de la nouvelle ligne DAP. Donc, la mise en place de
la norme IAS 36 au sein d’OCP S.A entrainera une influence sur l’évaluation
du patrimoine de l’entreprise, reflétée par une diminution de l’Actif Net
Comptable d’une valeur égale à la somme des pertes des valeurs constatées
dans l’entreprise.
c) Synthèse
Suite aux interprétations des indicateurs financiers que nous avons déjà
présentés, nous remarquons que l’incidence de la mise en place des normes IAS/IFRS
sur l’information financière peut être perçue sur 3 types d’informations,
notamment : informations concernant la rentabilité, informations concernant
l’évaluation des actifs, et informations concernant l’endettement de l’entreprise
Informations concernant la rentabilité :
Dans notre étude, la rentabilité a été représentée par quatre principaux
indicateurs à savoir : le résultat net, la rentabilité économique, la rentabilité
commerciale, le retour sur investissement du capital humain.
Toutes ces informations ont subi un changement suite à l’application de la
norme IAS 36. En effet, les quatre indicateurs ont connu une baisse qui semble à
première vue minime, mais qui ne doit pas être négligée, puisque l’application de la
norme sur l’ensemble des projets de l’entreprise entraînera surement une baisse
très importante.
Donc, la mise en place de la norme IAS 36 au sein d’OCP S.A aura un impact
réel qui se ressent très clairement, et de façon négative au niveau de la rentabilité de
l’entreprise, ce qui peut pousser les dirigeants à revoir le management de
l’entreprise.
111
Informations concernant la valorisation des actifs :
Plusieurs sont les acteurs intéressés par les informations liées à la valorisation
des actifs. En effet, cette dernière peut avoir plusieurs connotations stratégiques,
allant de l’investissement, aux opérations de restructuration, en passant par le
redéploiement stratégique.
Dans notre analyse, nous avons traité deux indicateurs ayant une relation
avec la valorisation des actifs, à savoir : l’Actif Net Comptable, et l’obsolescence des
immobilisations.
Lors de l’application de la norme IAS 36 sur les immobilisations de la nouvelle
ligne DAP, nous avons constaté une réduction de l’Actif Net Comptable. Donc, le
passage à la norme IAS 36 exerce un impact négatif sur la valeur de l’entreprise.
Cependant, il faut noter que plusieurs méthodes d’évaluation des entreprises,
considérées comme étant les plus efficaces _ Telles que la méthodes des DCF_ ne se
basent pas sur le patrimoine, et donc, nous ne pouvons parler de grande influence
en ce qui concerne la valorisation de l’entreprise lors de l’application de la norme IAS
36, sauf dans le cas des méthodes patrimoniales.
Par ailleurs, nous avons aussi constaté l’augmentation du degré
d’obsolescence des immobilisations, ce qui traduit une diminution de la valeur des
actifs immobilisés à un rythme supérieur après application de la norme IAS 36.
Nous pouvons donc déduire que la mise en œuvre de la norme IAS 36 au sein
d’OCP S.A influence négativement la valeur des actifs de l’entreprise.
Informations concernant l’endettement de l’entreprise:
Dans notre étude, l’information liée aux dettes de l’entreprise n’est
représentée que par deux ratios, qui sont respectivement : celui d’endettement, et
celui de remboursement des dettes.
Lors du passage à la norme IAS 36, le ratio d’endettement a connu une
hausse de 1%, due à la réduction de la valeur de l’actif, et la stagnation des dettes de
l’entreprise.
112
Par ailleurs, le délai de remboursement des dettes, n’a connu aucun
changement. Cependant, nous ne pouvons affirmer que la mise en œuvre de la
dépréciation d’actif n’a aucune incidence sur le délai de remboursement des dettes.
En effet, le calcul de cet indice repose sur la CAF, et cette dernière n’a pas été
impactée, du a l’absence d’imposition au niveau du pôle chimie qui ne jouit pas
d’une personnalité juridique depuis la fusion qui a eu lieu en 2012. En cas de calcul
du ratio pour OCP S.A, la CAF connaitra surement un changement, qui induira
automatiquement un impact sur le délai de remboursement des dettes.
Nous déduisons donc, qu’en cas d’application réelle de la norme IAS 36 au
sein d’OCP S.A, il y aura un impact palpable sur l’information financière relevant de
l’endettement de l’entreprise.
Section 3 : Conception d’un guide pratique79 pour l’application de la norme IAS 36
Pour faciliter l’application de la norme IAS 36 au sein du pôle chimie, nous
avons décidé de concevoir un manuel pratique décrivant la manière la plus adéquate
de procéder à la mise en œuvre de ladite norme au sein de l’entité.
Pour la conception de ce manuel, nous nous sommes basé sur plusieurs
éléments, qui peuvent être séparé en trois catégories : éléments externes à
l’entreprise ; éléments internes à l’entreprise ; éléments personnels.
Le tableau suivant présente lesdits éléments :
79
Voir Annexe n°7 pour consulter le guide
113
Eléments internes Eléments externes Eléments personnels
_ La procédure de dépréciation
décrite dans le manuel des
procédures suivant les normes
marocaines
_ Manuel des procédures IFRS
_ Le suivi des flux d’informations
au sein de l’entité
_ Normes IAS 36
_ L’expérience acquise lors de
l’application de la norme IAS 36 sur
la nouvelle ligne DAP
_ Entretiens informels avec le
personnel
Tableau 32 : Bases de la conception du guide pratique
Vu que la plupart de ces éléments contenus dans ce tableau ont été déjà
présenté auparavant dans notre rapport, nous allons nous allons dans un premier
temps nous concentrer sur le suivi des flux d’informations relatifs à l’application de
la norme IAS 36 au sein de l’entité, pour ensuite dégager une conclusion concernant
les différents intervenants dans le processus.
3-1 Suivi des flux d’informations au sein de l’entité
a) Recensement des informations nécessaires à l’application de la norme
L’application de la norme IAS 36 repose sur deux catégories d’informations
essentielles, à savoir : les informations relatives aux indices de dépréciation ; les
informations relatives à la valeur recouvrable. Pour adapter ceci au cas de l’OCP,
nous avons dressé le tableau suivant :
114
Informations relatives aux indices de dépréciation Informations relatives à la valeur recouvrable
Indices internes Indices externes Valeur de marché Valeur d’utilité
_dégradation physique
_sous-utilisation des
actifs
_Performance
économique inférieure à
celle attendue
_promulgation d’une
nouvelle loi écologique
interdisant l’utilisation
d’une certaine matière
dans la production
_Entrée d’un nouveau
concurrent puissant dans
le marché
_Valeur de marché
des terrains non
exploités
_Chiffres d’affaires
prévisionnels
_Charges d’exploitation
prévisionnelles (Hors
amortissement)
_Dotations aux
amortissements futures
_Plan d’investissement
_ Délais fournisseurs et
délais clients
_ Taux d’actualisation
Tableau 33 : Recensement des informations relatives à l'application de la norme IAS 36
b) Détermination des sources d’informations
Grâce aux éléments en début de section, nous avons pu localiser les sources
de chaque information nécessaire à l’application de la norme IAS 36 au sein du pôle
chime d’OCP S.A
Le tableau suivant présente ces différentes sources, et donc les différents
intervenants dans le processus de dépréciation :
Informations Sources
Dégradation physique
Sous-utilisation des actifs
Service contrôle matériel ; Chefs de
projet
Performance économique Cellule étude et tableaux de bord
Indices externes Cellule étude et tableaux de bord
Valeur de marché Cellule étude et tableaux de bord
Prévisions Service Business Plan ( siège d’OCP S.A)
Taux d’actualisation Service contrôle de gestion
Dotations aux amortissements Service comptabilité des immobilisations
Tableau 34 : Intervenants dans le processus de dépréciation
115
c) Schématisation des flux d’informations
Suite à la détermination des informations nécessaires, ainsi que de leurs
sources, nous avons dressé une schématisation logique représentant le circuit des
flux d’informations dans le cas de l’application de la norme IAS 36 au sein du pôle
chimie d’OCP S.A :
Figure 23 : Circuit des flux d'informations relatives au processus de dépréciation
3-2 Informatisation du processus80
Vu que le pôle chimie gère de nombreux projets, il est inconcevable de de
garder une procédure manuelle. De ce fait, nous avons décidé d’informatiser le
processus de dépréciation/reprise, et ce, grâce à des tableurs Excel.
80
Consulter l’Annexe n°8
116
a) Tableur de calcul de la Valeur Nette Comptable :
L’objectif de ce tableur est de calculer la VNC d’une UGT donnée, et ce à partir
de la liste des immobilisations qui la composent.
b) Tableur de calcul des dotations futures:
Ce tableur sert à calculer les dotations aux amortissements des immobilisations
formants l’UGT, et ce en fonction de la valeur d’origine de l’actif, sa date
d’acquisition, sa durée d’amortissement économique, ainsi que sa VNC à la date du
test.
c) Tableur de calcul de la valeur d’utilité et de la dépréciation/Reprise :
Ce tableur a pour finalité de calculer la dépréciation/reprise, et ce, en menant le
test à travers la détermination des cash-flows dont le calcul est basé sur les
prévisions fournies par le service Business Plan. Il faut noter aussi, que ce tableur
utilise les données produites par les deux premiers tableurs.
D’une part, les dotations futures sont incorporées pour l’obtention des flux
d’exploitation. D’autre part, la VNC est comparée à la valeur d’utilité obtenue par la
somme des Cash-Flows actualisés.
Par ailleurs, le tableur prend en compte l’activité réalisée au sein du Maroc, ainsi
que l’export. En effet, le type d’activité peut impacter le calcul de l’impôt sur les
sociétés. Ce dernier doit aussi prendre en considération la cotisation minimale.
117
d) Tableur de distribution de la dépréciation/Reprise :
Après obtention du montant de la dépréciation/Reprise, ce tableur se charge de
distribuer ce montant sur l’ensemble des immobilisations formant l’UGT, et ce en
fonction du prorata de leur VNC par rapport à la VNC totale de l’UGT.
Le présent chapitre a porté sur l’analyse procédures IFRS de gestion des
immobilisations au sein du pôle chimie d’OCP S.A. Cette analyse a montré l’absence
d’un retraitement permettant l’alignement avec la norme IAS 36, d’où la nécessité
d’une mise en œuvre de cette dernière. Nous avons effectivement fait un essai de la
norme qui s’est révélé complexe et nécessitant une adaptation à l’entreprise, ainsi
qu’ayant un impact sur l’information financière de l’entreprise.
118
Conclusion
Cette deuxième partie a été consacrée dans un premier temps, à la
présentation de l’environnement et du contexte du stage.
Le deuxième chapitre de cette partie empirique est une étude essayant
d’analyser la mise en place des normes IAS/IFRS au sein du Groupe OCP, ainsi qu’une
application de la norme IAS 36 au sein l’entreprise d’accueil OCP S.A, et une analyse
de son impact sur l’information financière.
Nous avons pu, grâce à notre étude, montrer qu’il y a bel et bien une
incidence sur l’information financière, lors de la mise en œuvre de la norme IAS 36 au
sein de l’entreprise, surtout en ce qui concerne la valorisation des actifs de
l’entreprise, de sa rentabilité, et de son endettement.
Par ailleurs, la création du guide pratique nous a permis de faciliter la
démarche de dépréciation, et de créer un processus adapté aux spécificités de
l’entreprise.
119
CONCLUSION GENERALE
Le développement des marchés financiers, la recherche de transparence, et
la nécessité de faciliter l’accès des partenaires potentiels à des données fiables,
compréhensibles, interprétables, et surtout homogènes et comparables, ont
contribué à la mise en place des normes comptables internationales IAS/IFRS Au sein
de l’OCP S.A. Cependant, cette mise en place connaît certaines défaillances, dont la
plus importante est l’absence d’un alignement avec la norme IAS 36. Cette dernière
étant caractérisée par sa complexité, nous avons limité notre essai de son
application sur un seul projet, qui en fin de compte a subi une dépréciation qui a été
enregistrée dans la comptabilité de l’entreprise.
Dans ce contexte, notre étude a porté également sur l’impact de la mise en
place de ladite norme au sein du pôle chimie d’OCP S.A, et a montré qu’il y a en effet
une incidence sur l’information financière, surtout celle liée à la rentabilité de
l’entreprise, à la valorisation de ses actifs, et à son endettement.
Par ailleurs, notre travail s’est prolongé par la conception d’un guide pratique
permettant de faciliter l’application de la norme IAS 36 au sein du pôle chimie.
Toutefois, comme toute autre étude, notre travail présente certaines limites, comme
listées ci-dessous :
L’étude porte comme titre « Projet d’application de la norme IAS 36 au sein
d’OCP S.A», mais la mise en œuvre de la norme, l’étude de l’impact sur
l’information financière, ainsi que le guide pratique, ne concerne que le pôle
chimie de l’entreprise. Mais il faut tout de même noter que l’utilisation du
guide peut être étendue au pôle mine ;
La norme IAS 36 n’a été appliquée que sur un seul projet, et donc l’étude
financière n’a pas dégagé des chiffres importants, permettant de visualiser
clairement l’impact de l’application de la norme IAS 36 sur l’information
financière ;
120
Le goodwill qui est normalement un élément compris dans la dépréciation
des actifs, n’a pas été inclus lors de notre mise en œuvre. Ceci est dû à
l’absence de l’application de la norme IFRS 3 au sein de l’entreprise. En effet,
cette norme prévoit l’allocation du goodwill aux différents actifs ou UGT ;
La non intégration de certains éléments stratégiques dans les prévisions _ tels
que la politique de prix, ou l’entrée d’un nouveau concurrent dans le marché_
et ce à cause de la confidentialité de ces informations ;
Les tableurs destinés à simplifier l’application de la norme IAS 36 n’ont pas
été reliés avec le progiciel Oracle.
Par ailleurs, nous recommandons à l’entreprise, en premier lieu d’utiliser
notre guide et nos tableurs pour une meilleure application de la norme IAS 36. Nous
recommandons aussi une application de la norme IFRS 3, et une amélioration de la
communication et la transmission d’informations entre les services. En effet, d’après
nos constatations, l’entreprise souffre d’une mauvaise circulation horizontale de
l’information. Et finalement, OCP S.A devrait revoir sa comptabilité IFRS en général,
car la pratique de cette dernière à travers le retraitement et le reclassement de la
comptabilité nationale n’assure pas une aliénation parfaite avec les normes
internationales. Nous recommandons donc, la création d’un « Service Comptabilité
IFRS », chargé de l’application effective de l’ensemble des normes indépendamment
de la comptabilité marocaine.
Finalement, nous pouvons dire que ce projet de fin d’étude était aussi
bénéfique pour l’OCP, que pour nous même. D’une part, ce projet de quatre mois,
ne nous a pas seulement permis d’approfondir nos connaissances en matière des
normes IAS/IFRS, mais aussi d’acquérir des nouvelles compétences, non seulement
financières mais aussi relationnelles à travers le contact humain au sein de
l’entreprise et la familiarisation avec le monde professionnel. D’autre part, notre
projet ouvre voie à des travaux futures qui peuvent être menées au sein de
l’OCP S.A, tels que : l’étude de l’incidence de l’application de la norme IAS 36 sur
l’information financière du Groupe OCP en entier, l’application de la norme IFRS 3,
ou le perfectionnement du système d’information comptable grâce à la liaison des
tableurs avec le progiciel Oracle.
121
REFERENCES
Ouvrages
Bernard CHAUVEAU ; Les normes internationales de l’IASB ; Editions e-
theque ; 2003
Eric TORT ; L’essentiel des normes IFRS ; Gualino ; 2012
Hervé PUTEAUX ; Norme IAS/IFRS : Une simple affaire de présentation ; Sage ;
2004
Pascal BARNETO ; Normes IFRS : Application aux états financiers ; DUNOD ;
2ème édition ; 2006
Pascal BARNETO ; Pierre GRUSON, Instruments Financiers et IFRS : Evaluation
et comptabilisation ; Dunod ; 2007
Robert OBERT ; Le petit IFRS, DUNOD, 2006/2007
Robert OBERT ; Pratiques des normes IFRS : Normes IFRS et US GAAP ;
Dunod ; 2013
Steve COLLINGS; Frequently Asked Questions in IFRS; 2013
Sites web
http://www.argusdelassurance.com/institutions/origines-principes-et-enjeux-des-
normes-ias-ifrs.30656
http://www.differencebetween.net/business/difference-between-ias-and-ifrs/
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/actualites_phare/efrag/efrag_et_autres_normalisateurs_strategie_sur_la_revision_du_cadre_conceptuel_des_ifrs
http://www.focusifrs.com/menu_gauche/normes_et_interpretations/que_sont_les
_ias_ifrs/cadre_conceptuel
http://www.ifrs.com
122
http://www.lavieeco.com/news/debat-et-chroniques/les-ifrs-au-maroc-ou-le-
permis-de-conduire-a-gauche-5216.html
http://www.lavieeco.com/news/votre-argent/normes-ifrs-quel-impact-sur-la-
valeur-des-societes-cotees--6002.html
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/
http://www.procomptable.com/iasb/comparaison/ccc.htm
www.xavierpaper.com/documents/art/p.Magsecurs.18.12.03.ias1.doc
Documents internes à l’entreprise
Manuel des procédures IFRS ; Immobilisations corporelles ; OCP S.A ; Pôle
Finance et support de gestion ; Septembre 2009
Manuel des processus comptable ; Processus immobilisations ; Groupe OCP ;
Filière Finance ; 2010
Note d’information : Emission d’un emprunt obligataire ; OCP S.A ; 2011
Note justificative : Projet de la Nouvelle ligne DAP ; Groupe OCP ; Direction
stratégie et développement ; 21/03/03
Mémoires, rapports, cours, et autres
A.Brassely ; Méthodologie de dépréciation des actifs selon IAS 36 ; Pansard &
Associés
Ahmed KARIM ; Le Meilleur des IAS ; 2010
Benoît LEBRUN ; La norme IFRS 13 sur la juste valeur ; Revue française de
comptabilité ; 2011
Bouchra ELABBADI ; Cours : Principes comptables, normes internationales,
comparaison ; Université Abdelmalek Essaadi ; ENCGT ; 2013-2014
Brian FRIEDRICH ; Le reper ; Norme comptable internationale 36 : IAS 36
dépréciation d’actifs ; CGA-Canada ; 2009
123
Emanuelle AUBERT ; Pedro MATLAS ; TD : Le coût et le prix de vente ;
Académie de Nancy-Metz
Kawtar EL MENGAD ; Exposé : Le système fiscal marocain ; Université Sidi
Mohammed Ben Abdellah ; Faculté de sciences juridiques, économiques et
sociales ; 2009-2010
Les référentiels des métiers cadres ; Les métiers des fonctions finance
d’entreprise et comptabilité ; Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC) ;
22-04-2012
Marie MUSARD ; Comptabilité : Cours et TD ; IG3 ; Poly’tech Montpelier :
Université de Montpelier 2 ; 2007-2008
Michel MEAU ; Cours : Le cadre conceptuel comptable de l’IASB ; Centre de
Ressource Comptabilité et Finance
Mohammed MOKHLIS ; Zakaria ROUIJA ; PFE : Application de la norme IAS 16
au sein de la DEPJL ; Université Chouaib Doukkali ; ENCG El Jadida ; 2012
Norme comptable internationale IAS 1 ; Présentation des états financiers
Norme Comptable Internationale IAS 36 ; Dépréciation d’actifs
Norme internationale d’information financière IFRS 13 ; Evaluation de la juste
valeur
Omar BENGELLOUN ; L’impact des nouvelles normes IFRS sur la qualité de
l’information financière ; Université Montesquieu Bordeaux 4
Sabrina BAZIRE ; Marie-Noel MAFFON ; Impacts de la mise en place des
normes IFRS sur les capitaux propres ; CNAM Paris ; 2005 ; Page : 22
Salah SALHI ; Said BOUHRAOUA ; Colloque : Produits et applications de
l’innovation et l’ingénierie financiers entre l’industrie financière
conventionnelle et l’industrie financière islamique ; Université Ferhat Abbas ;
05-06 Mai 2014
124
ANNEXES
1. Liste des immobilisations de la nouvelle ligne DAP, jointe sur CD ;
2. Projection des dotations aux amortissements futures de chaque
immobilisation de la nouvelle ligne DAP, jointe sur CD ;
3. Coûts de revient et analyses des charges de la nouvelle ligne DAP ;
4. Distribution de la dépréciation sur l’ensemble des immobilisations
de la nouvelle ligne DAP, jointe sur CD ;
5. Bilan du pôle chimie de l’année 2013;
6. CPC du pôle chimie de l’année 2013;
7. Guide pour l’application de la norme IAS 36 au sein du pôle
chimie ;
8. Application informatique pour le calcul de la dépréciation, jointe
sur CD.
125
Table des matières
RESUME ................................................................................................................................... 1
DEDICACES ............................................................................................................................. 2
REMERCIEMENTS.................................................................................................................. 3
LISTE DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS .................................................................. 4
LISTE DES FIGURES .............................................................................................................. 6
LISTE DES TABLEAUX .......................................................................................................... 7
SOMMAIRE .............................................................................................................................. 9
INTRODUCTION GENERALE .............................................................................................10
Partie I : Présentation des normes IAS/IFRS ..............................................................13
Chapitre 1 : Généralités sur les normes IAS/IFRS ............................................................... 14
Section1 : Définition et contexte historique des normes IAS/IFRS……………………………….…14
1-1 Définition des normes IAS/IFRS ........................................................................... 14
1-2 Organisation de la normalisation comptable ...................................................... 15
1-3 Historique ............................................................................................................ 16
Section 2 : Enjeux, objectifs, et cadre conceptuel des normes IAS/IFRS………………………….17
2-1 Les enjeux des normes IAS/IFRS .......................................................................... 17
2-2 Le cadre conceptuel des normes IAS/IFRS .......................................................... 19
2-3 Principaux objectifs des normes IAS/IFRS ........................................................... 28
Section 3 : Adoptions des normes IAS/IFRS au Maroc…………………………………………………….29
Chapitre 2 : Contenu de la norme IAS 36 ............................................................................ 36
Section 1 : Survol de l’IAS 36………………………………………………………………………………………....36
1-1 Objectif, origine, et définitions ............................................................................ 36
1-2 Champ d’application ............................................................................................ 37
1-3 Informations à fournir ......................................................................................... 38
Section 2 : Notion de la valeur…………………………………………………………………………………..…..39
2-1 Notion de juste valeur ......................................................................................... 40
126
2-2 Méthodes d’évaluation de la valeur .................................................................... 41
Section 3 : Dépréciation de la valeur………………………………………………………………………..…….45
3-1 Indices de dépréciation ....................................................................................... 45
3-2 Tests de dépréciation (impairment tests) ........................................................... 46
3-3 Comptabilisation des dépréciations .................................................................... 48
3-4 Reprise de dépréciation....................................................................................... 50
Partie II : Application de la norme IAS 36 au sein d’OCP S.A .................................53
Chapitre 1 : Environnement et contexte du stage .............................................................. 54
Section 1 : Présentation générale du Groupe OCP………………………………………………………….54
1-1 Fiche technique d’OCP S.A .................................................................................. 54
1-2 Historique ............................................................................................................ 54
1-3 Activités du Groupe ............................................................................................. 55
1-4 Organigramme d’OCP S.A .................................................................................... 57
1-5 Filiales et participations du Groupe OCP ............................................................. 58
Section 2 : Présentation du pôle chimie et du département d’accueil……………………………60
2-1 Présentation du pôle chimie ............................................................................... 60
2-2 Présentation du Jorf Lasfar .................................................................................. 61
2-3 Présentation de département d’accueil : « département comptable » ............. 62
Section 3 : Choix du thème et méthodologie………………………………………………………………….66
3-1 Choix du thème de stage ..................................................................................... 66
3-2 Méthodologie de recherche ................................................................................ 67
3-3 Méthodologie de travail ...................................................................................... 68
Chapitre 2 : Application de la norme IAS 36 au sein du pôle chimie .................................. 71
Section 1 : Analyse des procédures IFRS de gestion des immobilisations au sein du pôle
chimie……………………………………………………………………………………………………………………………71
1-1 Présentation des processus de gestion des immobilisations en normes
marocaines ...................................................................................................................... 71
1-2 Adoption des normes IAS/IFRS au sein du Groupe OCP...................................... 74
127
1-3 Présentation des procédures IFRS de gestion des immobilisations .................... 77
1-4 Comparaison des exigences du manuel de procédures IFRS et des retraitements
effectués .......................................................................................................................... 81
Section 2 : Mise en œuvre de la norme IAS 36……………………………………………………………….82
2-1 Détermination d’une UGT ................................................................................... 82
2-2 Indices de dépréciation ....................................................................................... 84
2-3 Test de dépréciation ............................................................................................ 86
2-4 Comptabilisation de la dépréciation ................................................................... 98
2-5 Impact sur l’information financière ................................................................... 100
Section 3 : Conception d’un guide pratique pour l’application de la norme IAS 36…….…112
3-1 Suivi des flux d’informations au sein de l’entité ............................................... 113
3-2 Informatisation du processus ............................................................................ 115
CONCLUSION GENERALE ................................................................................................ 119
REFERENCES ..................................................................................................................... 121
ANNEXES ............................................................................................................................ 124
Table des matières.......................................................................................................... 124