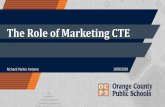"Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville, biographe de Louis Dorigny", 'Verona Illustrata', 19, 2007,...
-
Upload
epheacademia -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of "Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville, biographe de Louis Dorigny", 'Verona Illustrata', 19, 2007,...
67
Stéphane Loire
ubliée pour la première fois en 1752, la biographie consacrée par Antoi-ne-Joseph Dezallier d’Argenville à Louis Dorigny (Paris, 1654-Vérone, 1742)dans l’Abrégé de la vie des plus fameux peintres est un document exceptionnel pourla connaissance de l’artiste.1 D’une ambition comparable à celle publiée en1718 par Bartolomeo Dal Pozzo (1637-1722) dans ses Vies des peintres, sculp-teurs et architectes véronais,2 elle oπre l’avantage de prendre en compte l’en-semble de sa carrière. Elle donne en outre une liste beaucoup plus détailléede ses œuvres, qui complète également celle figurant dans un manuscrit ano-nyme conservé à la Biblioteca Civica d’Udine.3 Mais si cette biographie a étésouvent citée par les historiens de Dorigny, aucun ne semble avoir tenté d’exa-miner la totalité des informations qu’elle comporte, ni d’en donner une éva-luation d’ensemble. Certaines de ses données, comme le contexte de sa publi-cation, méritent pourtant d’être éclaircis. Il convient d’autre part d’encomparer les deux versions publiées à dix ans d’intervalle (1752, 1762) et, dansla mesure du possible, d’identifier les œuvres que l’on y trouve mentionnéesou de préciser leur sort.
Louis Dorigny, dont Dal Pozzo avait déjà italianisé le prénom en Lodovico,a été bien davantage étudié par les historiens de la peinture véronaise quepar ceux de la peinture française; c’est d’ailleurs dans sa ville d’adoptionque lui a été consacrée, en 2003, une exposition monographique accompa-gnée d’un important catalogue où l’on trouve la synthèse des nombreusespublications récentes le concernant.4 Mais pour Dezallier d’Argenville, il ne
1. A.-J. Dezallier D’Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux peintres, 3, Paris 1752, pp. 232-239; 2nde éd., Paris 1762, 4, pp. 271-280.
2. B. Dal Pozzo, Le vite de’ pittori, degli scultori, et architetti veronesi raccolte da vari autori stampatie manuscritti, e da altre particolari memorie, Vérone 1718, pp. 176-179.
3. M. Frank, Zu einer kaum bekannten Vita des Ludovico Dorigny, «Wiener Jahrbuch für Kunstge-schichte», 40, 1987, pp. 103-106.
4.Louis Dorigny 1654-1742. Un pittore della corte francese a Verona, éd. G. Marini et P. Marini, cataloguede l’exposition (Vérone, Museo di Castelvecchio, 28 juin-2 novembre 2003), Venise 2003.Voir aussiM. Favilla, R. Rugolo, Un pittore “reale”. Riflessioni su Louis Dorigny, «Studi Veneziani», 50, 2005,pp. 137-171.
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, biographe de Louis Dorigny
P
stéphane loire
68
faisait aucun doute qu’il devait être compté parmi les peintres de l’écolefrançaise. Les artistes sont classés dans son Abrégé selon leurs dates de nais-sance et dans la première édition de l’ouvrage, la biographie de Louis Do-rigny figure dans le troisième tome publié en 1752, entre celle de NicolasColombel, né en 1644, et celle de Jean-Baptiste Blain de Fontenay, dont ilsituait la naissance une année trop tard, en 1654. Quant à la seconde édi-tion parue en 1762, elle donne ce texte complété dans le quatrième volumequi est intégralement consacré aux peintres français, entre celle de Louis deBoullogne, né en 1654, et celle de Blain de Fontenay.
Né en 1680 à Paris, où il est mort en 1765, Antoine-Joseph Dezallier d’Ar -genville eut l’activité multiple d’un homme du siècle des Lumières: juriste etfamilier de la Cour, il était à la fois musicien, dessinateur et graveur, collec-tionneur et historien d’art, voyageur et auteur d’études scientifiques, curieuxde tous les domaines de la connaissance et avide de les enrichir.1 Fils d’An-toine Dezallier, un libraire parisien qui avait acquis la terre d’Argenville, ilavait pour oncle maternel Pierre Mariette le fils (1634-1716).2 Des études à lafaculté de Droit de Paris lui permirent de devenir avocat au Parlement de Pa-ris, sa principale fonction o√cielle qui lui acquit très rapidement un statutsocial de premier plan. En 1716, il acheta la charge largement honorifique deSecrétaire du Roi, avant celles de Maître des comptes (1733) puis de Conseillerdu Roi (1748). Parallèlement, il avait étudié le dessin et la gravure avec Ber-nard Picart, Jean Le Blond et Roger de Piles; mais bien davantage que pourses estampes, il devait passer à la postérité grâce à son activité de collection-neur et à ses écrits. Ses premiers travaux portaient tout particulièrement surles sciences naturelles et sur le jardinage: outre des études sur des fossiles oudes coquillage, il s’agit en particulier de La théorie et la pratique du jardinage (Pa-ris 1709), un ouvrage fréquemment réédité tout au long du XVIIIe siècle etqui joua un rôle essentiel pour la codification du «jardin à la française». Trèstôt membre de nombreuses sociétés savantes, collaborant à l’Encyclopédie deDiderot et d’Alembert pour des articles sur le jardinage et l’hydraulique, De-zallier d’Argenville traduisit de l’italien un traité de Filippo Buonanni sur les
1. Son patronyme complet est «Dezallier d’Argenville»: il ne doit donc pas être nommé «D’Ar-genville», ni «Dézaillier d’Argenville». Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville est parfois confon-du avec son fils Antoine-Nicolas (1723-1796), lui aussi amateur d’art, qui est notamment l’auteurdes ouvrages suivants: Voyage pittoresque de Paris, ou indication de tout ce qu’il y a de plus beau dans cettegrande ville en peinture, sculpture et architecture, Paris, 1749; Voyage pittoresque des environs de Paris, Paris,1755; Description sommaire des ouvrages de peinture, sculpture et gravure exposés dans les salles de l’Académieroyale, Paris, 1781; Vies des fameux architectes et vies des fameux sculpteurs depuis la Renaissance des arts, Pa-ris, 1787. Sur la vie d’Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, voir J. Labbé, L. Bicart-Sée, Es-quisse biographique, in La collection de dessins d’Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, Paris 1996, pp. 16-37.
2. Pierre II Mariette était aussi le père de Jean Mariette (1660-1742), qui eut à son tour pourfils Pierre-Jean Mariette (1694-1774); ce dernier était donc le cousin de Dezallier d’Argenville.
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, biographe de Louis Dorigny
69
vernis;1 quant à la «Lettre sur le choix et l’arrangement d’un Cabinet curieux»publiée en 1727 sous forme d’article dans le Mercure de France,2 il s’agit de sapremière publication en rapport avec les arts. Mais elle traite aussi d’objetsnaturels intéressant la curiosité et sa méthode de classification est issue de sesactivités liées aux sciences naturelles. En 1714, Dezallier d’Argenville s’étaitrendu en Italie pour un long séjour au cours duquel il exécuta des gravures depaysages3 et copia divers tableaux de maîtres anciens. D’autres voyages, auxPays-Bas, en Angleterre et en Allemagne, favorisèrent ses relations avec lesplus notables amateurs d’art de son temps, tandis qu’il rassemblait une im-portante collection de peintures et de dessins; elle devait être dispersée lorsde deux ventes publiques qui eurent lieu à Paris, l’une peu de temps après samort et l’autre après celle de son épouse, en 1779.4
Entre 1745 et 1752, Dezallier d’Argenville publia les trois volumes de la pre-mière édition de son Abrégé de la vie des peintres, un recueil de vies d’artistes quiétait comme la somme de toutes ses activités et de toutes ses connaissancesd’historien de l’art. Organisé sur le modèle de celui de Vasari, son ouvragepossède une ampleur encyclopédique et un souci d’exhaustivité qui n’ont pasde précédent dans la littérature artistique de la France de l’Ancien Régime.Avant lui, seuls André Félibien et Roger de Piles s’étaient fixés un objectifcomparable, le premier avec les Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellentspeintres anciens et modernes (Paris 1666-1688), le second avec l’Abrégé de la vie despeintres avec des réflexions sur leurs ouvrages (Paris 1699). Mais ces deux auteursn’étaient pas dépourvus d’intentions polémiques: pour Félibien, il s’agissaitnotamment d’a√rmer que l’école française n’avait rien à envier à celle de l’Ita-lie et qu’avec l’œuvre de Nicolas Poussin (1594-1665), elle était parvenue ausommet de la création artistique en accédant à son tour au rang de modèle in-surpassable. Sans doute profondément marqué par l’esprit universaliste desLumières, l’Abrégé de Dezallier d’Argenville a des intentions à la fois plus pra-tiques et plus didactiques que les ouvrages de ses deux prédécesseurs. Enten-dant fournir une histoire de la peinture depuis la Renaissance jusqu’à sescontemporains, il accordait une importance à peu près équivalente aux ar-tistes des diπérents foyers de l’Italie et à ceux des autres écoles, du nord (PaysBas, Allemagne) et de la France.5 Allant jusqu’à ses contemporains les plus
1. F. Buonanni, Traité des vernis, où l’on donne la manière d’en composer un qui ressemble parfaitement à ce-lui de la Chine, et plusieurs autres qui concernent la peinture, la dorure, la gravure à l’eau-forte, etc., Paris 1723.
2. Lettre sur le choix et l’arrangement d’un Cabinet curieux, écrite par M. Des-Allier d’Argenville, Secre-taire du Roy en la Grande Chancellerie, à M. de Fougeroux, Tresorier-Payeur des Rentes de l’Hôtel de Ville, «LeMercure de France», juin 1727, pp. 1295-1330.
3. M. Roux, Bibliothèque nationale. Département des estampes. Inventaire du fonds français. Graveurs duXVIIIe siècle. 6. Deny (Mlle Jeanne)-Du Duy-Delage, Paris 1951, pp. 274-275, nºs 1-12.
4. Paris, vente Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, 3 mars 1766; vente de sa veuve, 18-28janvier 1779.
5. Dans la seconde édition de l’Abrégé, deux volumes sont consacrés aux diverses écoles de l’Ita-
stéphane loire
70
remarquables, il prenait en compte, pour la péninsule, les plus illustrespeintres anciens depuis Raphaël pour les peintres romains, Léonard de Vinciet Michel Ange pour les Florentins, Corrège pour les Lombards, Giorgioneet Titien pour les Vénitiens. Destiné aux amateurs, cet ouvrage entendait leurfournir un outil concis et maniable afin de les aider à reconnaître les styles,les écoles, les époques et les artistes, ou encore pour distinguer les originauxdes copies, ou les œuvres des grands maîtres de celles de leurs disciples. L’ap-proche de Dezallier d’Argenville est avant tout biographique et les peintres,au nombre de deux cent cinquante-cinq dans la seconde édition de l’Abrégé,sont classés par écoles. Donnant les noms des principaux graveurs interprètesde leurs œuvres, il localisait les églises, palais et galeries princières où l’onpouvait voir leurs peintures. Dezallier d’Argenville attachait également uneattention particulière à analyser la technique de chaque peintre et à définirleur style, notamment dans ses dessins. Il possédait d’ailleurs lui-même un en-semble d’œuvres graphiques, estampes et dessins, d’une abondance et d’unequalité exceptionnelles, en grande partie issu de celle de son père.1
L’une des premières indications de la biographie de Dorigny rédigée par De-zallier d’Argenville se rapporte à sa présence au sein de l’Académie royale dePeinture et de Sculpture de Paris où il remporta, le 28 mars 1671, le second prixpour le concours du prix de Rome.2 La première place lui aurait permis de par-tir en Italie comme pensionnaire du roi mais au concours suivant, le 11 juin1672, il n’obtint de nouveau que la seconde.3 Dezallier d’Argenville préciseque «ce contre-tems ne fit qu’augmenter l’envie qu’il avoit de voir l’Italie», etqu’il s’y rendit en compagnie de l’orfèvre et médailler Nicolas de Launay(1646-1727). Louis Dorigny pourrait donc être arrivé à Rome dès la fin de l’an-
lie (Romains, Florentins et Vénitiens pour le tome 1; Lombards, Napolitains et Espagnols, Génoispour le tome 2), le troisième à l’«Ecole de Flandres» (Allemands et Suisses; Hollandais; Flamands;Anglais) et le quatrième à l’«Ecole de France».
1. Dezallier d’Argenville semble les avoir classées en les numérotant selon l’ordre retenu dansl’Abrégé; quelques quatre mille de ses dessins ont été répertoriés, grâce à leurs numéros d’ordre,dans l’ouvrage de Labbé et Bicart-Sée (1996). Ils figuraient au nombre de trois mille trois centcinquante, répartis en cinq cent cinquante-cinq lots, dans la vente de janvier 1779; quant aux ta-bleaux, il y en avait soixante-dix dans le catalogue de la même vente.
2. A. de Montaiglon, Procès-Verbaux de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture (1648-1793), 1,Paris 1875, p. 358. Le concours dont le sujet était un tableau montrant Le Roi donnant la paix à l’Europefut remporté par Alexandre Ubeleski (1649/1651-1692). Le titre de Peintre du Roy qui figurait dans lesregistres de l’église Saint-Thomas du Louvre, à Paris, à la date du 7 juin 1672 (A. Jal, Dictionnaire cri-tique de biographie et d’histoire, Paris 1867, p. 501), est indépendant de l’appartenance de Dorigny à l’Aca-démie royale de Peinture et de Sculpture où il n’était qu’élève. Les titulaires d’une telle qualificationétait nombreux alors parmi les peintres parisiens et elle ne supposait pas nécessairement une activi-té continue au service du roi (A. Schnapper, Le métier de peintre au Grand Siècle, Paris 2004, pp. 31-45).En l’absence de documents attestant celle de Dorigny sur les chantiers royaux, il était donc abusif dele qualifier de «peintre de la cour de France» lors de l’exposition de Vérone en 2003.
3. Ibidem, p. 388. Le sujet était un Divertissement donné au Roi par la ville de Dunkerque et le premierprix alla cette fois à François Verdier (1652-1730).
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, biographe de Louis Dorigny
71
née 1672,1 et le biographe ajoute qu’avec de Launay, ils vécurent ensemble«plusieurs années». Fils de Louis de Launay, lui-même orfèvre, cet artiste futreçu maître orfèvre, à Paris, en 1672. Il serait revenu en fait assez rapidementdans la capitale puisqu’il devait s’y marier le 25 mai 1676.2 Mais son nom figu-re dans une liste d’élèves de l’Académie de Saint-Luc à Rome, le 12 mai 1675,ce qui confirme sa présence dans la Ville éternelle.3 Quant à Dorigny, il ne pou-vait prétendre au titre de pensionnaire du roi en raison de son double échec auconcours du prix de Rome et les documents relatifs à son séjour romain sontrares:4 il s’agit d’une gravure représentant La bataille d’Ostie d’après Raphaël,datée de 1673,5 et d’un dessin représentant Apelle et Campaspe (Rome, Acadé-mie de Saint-Luc)6 qui lui valut un quatrième prix lors du concours annuel or-ganisé la même année par l’institution romaine.7
Le texte de Dezallier d’Argenville fournit des précisions importantes sur leséjour de Dorigny en Ombrie, un épisode insu√samment pris en compte parles historiens de son œuvre. Il mentionne en eπet sa présence à Gubbio età Foligno,8 une ville où il aurait peint un Saint Bernard aux pieds de la Viergeau maître-autel de l’église des Feuillants, pour être substitué à une œuvrede même sujet exécutée par un peintre français dont l’identité reste incon-nue. La réussite de cette entreprise lui valut la commande, par les moinesde l’église du couvent des augustiniens, d’une série de décors à fresque com-prenant vingt-quatre scènes de la vie de saint Augustin: avec les portraitsdes saints de leur ordre accompagnés de putti, elles ornaient les lunettes etles pendentifs du cloître. Mais le tableau cité par Dezallier d’Argenville
1. Il était alors âgé de dix-huit ans selon Dal Pozzo (Le vite cit., p. 177), qui précise aussi quece séjour à Rome dura quatre années.
2. Travaillant pour la Couronne dès 1678, Nicolas de Launay occupait un logement au Louvreen 1682. En 1696, il devint directeur du balancier des médailles au Louvre et directeur de la Mon-naie. S’il a collaboré à l’exécution du mobilier d’argent de Louis XIV avant de réaliser, de 1724 à1727, celui de Louis XV, il ne reste pratiquement rien de son œuvre (D. Alcouffe, Note sur unportrait de Tournières: Nicolas de Launay et sa famille, «La Revue du Louvre et des Musées de Fran-ce», 1979, 5/6, pp. 444-448).
3. A. Cipriani, E. Valeriani (éd.), I disegni di figura nell’Archivio Storico dell’Accademia di SanLuca, Rome 1988, p. 189 («Nicolo Launay»).
4. Louis Dorigny est mentionné à tort comme pensionnaire du roi par J. Guiffrey, J. Bar-
thélémy, Liste des pensionnaires de l’Académie de France à Rome donnant les noms de tous les pensionnairesrécompensés dans les concours des prix de Rome de 1663 à 1907, Paris 1908, p. 50. On ne trouve d’ailleursaucune mention le concernant dans les lettres publiées par A. de Montaiglon, J. Guiffrey, Cor-respondance des directeurs de l’Académie de France à Rome avec les Surintendants des Bâtiments, Paris, 1, 1887.
5. A. Corubolo, Le incisioni di Louis Dorigny, «Verona Illustrata», 10, 1997, pp. 43, 47, pl. 38.6. G. Marini, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp. 134-135, nº 33, repr.7. Cipriani, Valeriani, I disegni di figura cit., p. 63. Dorigny précédait cette fois son rival
Alexandre Ubeleski, le lauréat du concours du Prix de Rome en 1671, qui ne devait être priméqu’en 1677.
8. Le passage de Dorigny dans ces deux villes est évoqué également par Dal Pozzo (Le vite cit.,p. 177). Il ne fournit toutefois aucune indication sur son activité mais mentionne aussi son passa-ge «in diverse Città di Romagna».
stéphane loire
59, 60
61, 62
72
semble avoir disparu et l’ensemble de fresques, sous lesquelles se lisait la da-te de 1678, a été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale;1 seule une mé-diocre photographie de l’une des lunettes en conserve le souvenir.2Quelques-unes des œuvres peintes par Dorigny en Ombrie subsistent toute-fois: outre un important tableau d’autel montrant Saint Trophime implorant laVierge et l’Enfant pour obtenir la guérison du podagre (Gubbio, Santa Croce dellaFoce) qui lui a été attribué récemment,3 il s’agit des fresques de l’église San-ta Maria del Prato de Gubbio. Cet édifice a été construit sur le modèle bor-rominien de San Carlo alle Quattro Fontane de Rome et sa première pier-re avait été posée en 1662 par Alessandro Sperelli (1589-1672), évêque deGubbio à partir de 1644.4 L’artiste parisien y a peint une lunette montrantSaint Ubalde imposant la paix à ses concitoyens sur le côté droit, L’Espérance surl’un des pendentifs de la coupole et un Baptême du Christ au-dessus de l’en-trée.5 Quant à la coupole et aux trois autres autres pendentifs, ils ont étédécorés par Francesco Allegrini (vers 1614-après 1679). Pour la même égli-se, celui-ci exécuta d’autres fresques et plusieurs tableaux d’autels que di-vers documents permettent de situer en 1677-1678.6 Vraisemblablement ori-ginaire de Gubbio, Allegrini y était revenu après un long séjour à Rome.Dorigny aurait pu l’y rencontrer, peut-être au sein de l’Académie de Saint-Luc; son aîné en était membre depuis 1655 et il pourrait bien être à l’origi-ne de sa présence à Gubbio. Toujours en Ombrie, Dorigny peignit pour l’au-tel-majeur de l’église San Martino de Vescia (Foligno) un tableau montrantLe Christ en croix avec la Vierge, saint Jean et la Madeleine qui n’y figure plus etsur les parois de la chapelle du chœur, des fresques montrant des Scènes de lavie de saint Martin.7 Outre La Charité de saint Martin et un Miracle de saint Mar-tin représentés sur des tapisseries feintes, il s’agit de pendentifs montrantdes Anges musiciens, des compositions peintes que leur état de conservationrend peu lisibles; quant au tableau qui ornait l’autel de l’édifice, il se
1. V. Casale, G. Falcidia, F. Pansecchi, Pittura del ’600 e ’700. Ricerche in Umbria. II, Trévi-se 1980, pp. 80, 82, 100, note 87.
2. L. Coggiola Pittoni, Luigi Dorigny e i suoi freschi veneziani, «Rivista di Venezia», 14, 1935,6-7, p. 15, fig. 2a.
3. E. Storelli, Louis Dorigny in Santa Croce della Foce a Gubbio, «Verona Illustrata», 18, 2005, pp.65-67, fig. 64.
4. J. Connors, A copy of Borromini’s S. Carlo alle Quattro Fontane in Gubbio, «The Burlington Ma-gazine», 137, 1995, pp. 588-599; M.V. Ambrogi, G. Belardi (éd.), Gubbio nel Seicento. FrancescoBorromini e la chiesa della Madonna del Prato, Città di Castello-Gubbio 2005.
5. O. Lucarelli, Memorie e guida storica di Gubbio, Città di Castello 1888, p. 576. Une vue in-térieure de l’église montrant les deux premières compositions figure dans Connors, A copy cit.,p. 593, fig. 9. Pour des reproductions couleurs des compositions peintes par Dorigny, voir Ambro-
gi, Belardi, Gubbio nel Seicento cit., pp. 131, 143, 250.6. P. Ciufferi, Una scheda su Francesco Allegrini, «Ricerche di Storia dell’Arte», 6, 1977, pp.
121-125.7. Ces peintures sont mentionnées sous le nom de «Monsù d’Oregny» dans un manuscrit daté
de 1732 (Casale, Falcidia, Pansecchi, Pittura del ’600 e ’700 cit., pp. 100-101, note 88).
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, biographe de Louis Dorigny
73
confond peut-être avec une toile à présent dans l’église San Niccolò deBelfiore (Foligno) dont il faut là aussi souhaiter la restauration prochaine.1
Après avoir évoqué l’installation de Dorigny en Vénétie, Dezallier d’Argen-ville mentionne le séjour d’un an qu’il fit à Paris en 1704 «pour revoir sa famil-le», un motif déjà avancé par Dal Pozzo pour ce voyage.2 Il évoque tout d’abordla commande d’un plafond peint pour un escalier dont deux esquisses auraientété fort critiquées, notamment par Nicolas de Largillierre (1656-1746) et Hya-cinthe Rigaud (1659-1743) qui en auraient empêché l’exécution. Ces deuxpeintres étaient alors parmi les plus en vue du moment à Paris et l’anecdoten’a rien d’impossible; mais ils étaient avant tout des portraitistes et il est sur-prenant que Dezallier d’Argenville ait jugé utile de les mentionner: les nomsd’autres peintres décorateurs auraient pu être avancés. Le biographe donneensuite un récit détaillé de la tentative infructueuse de Dorigny pour être ad-mis à l’Académie royale de Peinture et de Sculpture. Il reprend pour l’essen-tiel celui qu’en avait déjà fait Dal Pozzo3 mais curieusement, les procès-ver-baux des séances de l’institution parisienne ne comportent aucune mention desa candidature qui aurait dû pourtant y figurer le jour de sa présentation.4D’autre part, dans les raisons supposées du refus qui lui aurait été opposé, lebiographe mêle des éléments vraisemblables à d’autres qui le sont moins et surlesquels il convient de revenir.
Comme Dal Pozzo avant lui, Dezallier d’Argenville précise tout d’abord queDorigny aurait rencontré l’hostilité de certains membres de l’Académie: «mé-contens de ce qu’il avoit abandonné sa patrie», ils auraient indisposé contrelui Jules Hardouin-Mansart (1646-1708). L’un des principaux architectesfrançais du règne de Louis XIV, celui-ci eut également, de 1699 à sa mort,la charge de Surintendant des Bâtiments. Cette fonction administrative degrand prestige faisait de lui le protecteur de l’Académie royale de Peintureet de Sculpture et il aurait eπectivement eu le pouvoir d’empêcher Dorignyd’y être reçu. Il faut toutefois souligner que l’institution était alors particu-
1. P. Caretta, C. Metelli, Pittura del Seicento e del Settecento. Ricerche in Umbria, 3: la Teverinaumbra e laziale, Rome 2000, pp. 121, 157, fig. 352-355.
2. Dal Pozzo, Le vite cit., p. 178.3. «Nel 1704 fece un viaggio a Parigi per rivedere i Parenti dopo tanto tempo che n’era assen-
te, dove si trattene un anno & essendo ben noti i suoi avvanzamenti in Italia, fu persuaso da’ Si-gnori della Regia Accademia a decorarsi dell’honore, che godettero il proprio Padre, e gli altrisuoi Maggiori col farsi aggregare al numero loro, tanto più che n’era fin dal principio meritevole,mentre dalla prima sua gioventù havea riportato il premio per due volte in Parigi, & una volta inRoma nel publico certame de gli altri Giovini Studenti. Tutto il corpo dell’Accademia era dispo-sto a rendergli questa giustitia; ma non poteva aggregarlo senza il previo consenso del Signor diMansarò Protettore dell’Accademia. Però preoccupato da Malevoli, che mal toleravano un emoloFrancese Italianato, non volle ammetterlo con suo torto manifesto, e dispiacere de’ Principali del-l’Accademia, che non lasciarono di testificarlo a lui stesso in propria Casa» (ibidem, p. 178).
4. Voir de Montaiglon, Procès-Verbaux cit., 3, Paris 1880.
stéphane loire
74
lièrement accueillante, avec huit nouveaux peintres admis en 1704.1 Avantcette date, l’Académie avait accepté à plusieurs reprises des artistes étran-gers déjà fameux dans leur pays d’origine, où ils retournèrent après leur ad-mission, voire même sans qu’ils se soient présentés devant elle:2 le surcroîtde prestige qu’ils lui apporteraient paraissait sans doute plus important queleur éloignement ultérieur. Enfin, l’Académie fut souvent bienveillante pourles fils d’anciens membres, au point de faire preuve d’indulgence pour faci-liter leurs admissions: lorsque Nicolas Dorigny (1658-1746), le frère cadet deLouis, se présenta devant elle le 28 septembre 1709, il fut immédiatementautorisé à siéger «comme fils d’o√cier». Encore en Angleterre, il écrivait enjanvier 1714 pour annoncer la remise de son morceau de réception après sonretour en France; mais déjà bien âgé, il fut définitivement reçu le 28 sep-tembre 1725 sans l’avoir réalisé: en considération «des fatigues de ses longsvoyages» et du «défaut de sa vue», on se contenta de recevoir trois volumesde ses estampes.3
Dezallier d’Argenville fait ensuite référence à la publication, en 1651 à Pa-ris, d’un pamphlet publié sous la forme d’un placard imprimé dirigé contreFrançois Mansart (1598-1666), le plus fameux architecte français de la pre-mière moitié du siècle. Réputé pour son âpreté au gain, celui-ci était par-venu à se faire attribuer un privilège qui contraignait à soumettre à son ap-probation toute nouvelle publication d’estampe à Paris, lui donnant ainsi lahaute main sur le commerce de la gravure parisienne. Cet octroi avait sus-cité des réactions très hostiles des graveurs, peintres-marchands et impri-meurs, qui se groupèrent pour lui faire échec et en obtenir l’annulation.4 Entête de leur pamphlet imprimé figure une gravure dont le dessin pré -paratoire correspond précisément à la description donnée par Dezallierd’Argenville. Reconnaissable à son grand nez, François Mansart, est juchésur un âne et chemine vers le gibet de Montfaucon, le lieu traditionnel desexécutions publiques à Paris depuis le Moyen Age, et les moulins de Mont-martre: le texte d’accompagnement le disait fils d’une meunière. Il tient une
1. L. Dussieux, Liste chronologique des membres de l’Académie de peinture et de sculpture depuis son origi-ne, le 1er février 1648, jusqu’au 8 août 1793, jour de sa suppression, «Archives de l’Art français», 1, 1851-1852, pp. 375-376.
2. En particulier Le Bernin et Abraham Genoels en 1665, Bertholet Flémalle en 1670, Dome-nico Guidi en 1676, Niccolò Codazzi en 1681, ou encore Giovanni Pietro Bellori en 1689, commeconseiller-amateur. Par la suite, l’Académie admit Sebastiano Ricci en 1719, Rosalba Carriera en1720, Giovanni Paolo Pannini en 1732 ou encore Gianantonio Pellegrini en 1733.
3. Voir de Montaiglon, Procès-Verbaux cit., 4, Paris 1881, pp. 92, 176, 401. Sur le contexte desa réception, voir W. Mac Allister Johnson, Les morceaux de réception gravés de l’Académie Royalede Peinture et de Sculpture: 1672-1789, Kingston 1982, pp. 101-103.
4. A. de Montaiglon, La Mansarade. Satire contre François Mansart suivie d’un arrêt de Louis XIVen faveur de la gravure, «Archives de l’Art Français», 2, 1862, pp. 242-266; M. Grivel, Le commer-ce de l’estampe à Paris au XVIIème siècle, Genève 1986, pp. 94-96, 403-405, pl. 34.
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, biographe de Louis Dorigny
63
75
clochette et la marotte des fous, il a autour du cou l’échelle qui le mènerasur l’échafaud et traîne derrière lui les instruments des arts. Porté par unsinge, le parasol est un écho burlesque des cavalcades o√cielles, rappelantà la fois la folie des grandeurs de l’architecte et le soin ridicule avec lequelil tâchait de «conserver son tein frais et [de] faire le damoiseau».1 Mansartétait l’oncle de Jules Hardouin-Mansart et Dezallier d’Argenville attribuela caricature à Michel Dorigny. On peine à croire, pourtant, que la rancu-ne de l’architecte envers celui-ci ait été, un demi-siècle plus tard, la raisonprincipale de l’obstruction opposée par le neveu du premier envers le fils dusecond.2 Le biographe voyait l’origine de cette caricature dans un diπérentqui aurait opposé les deux hommes sur le chantier du château de Vincennes;mais Michel Dorigny n’y travailla qu’à partir de 1660,3 de sorte qu’il estexclut qu’un diπérent avec François Mansart ait pu l’inciter à donner le des-sin de l’estampe de 1651.4 Il y a donc plusieurs motifs sérieux pour douterdu récit de l’échec de l’admission de Louis Dorigny par l’Académie royalede Peinture et de Sculpture: il se pourrait qu’il s’agisse d’une légende diπu-sée par l’artiste lui-même, en particulier auprès de Dal Pozzo, avant que De-zallier d’Argenville ne la reprenne à son tour sans la vérifier.5 Est-il possiblequ’il ait songé à revenir s’installer définitivement en France, comme SimonVouet (1590-1649), son grand-père, l’avait fait en 1627 après une brillantecarrière italienne? Dorigny était bien établi en Vénétie, notamment depuisson mariage à Venise en 1683 et les naissances de plusieurs enfants, mais ilestimait peut-être que ses brillantes réalisations dans le domaine du granddécor pouvaient lui ouvrir une carrière comparable à Paris. Il se pourrait,dans ce cas, qu’il ait rencontré l’hostilité des peintres d’histoire qui étaientplus nombreux dans la capitale que lors du retour de Vouet, quand les cir-constances étaient bien plus propices; il est probable, surtout, qu’il n’eûtpas comme celui-ci le privilège de recevoir l’ordre de revenir en France afind’y contribuer à la gloire du roi.
1. J.-C. Boyer, Dessins français du XVIIe siècle dans les collections publiques françaises, catalogue del’exposition, Paris 1993, pp. 186-187, nº 91, repr.
2. Pierre Marcel (La peinture française au début du dix-huitième siècle. 1690-1721, Paris 1906, p. 37)a√rmait que l’attitude hostile de Hardouin-Mansart envers Dorigny était à l’origine de son expa-triation; mais celle-ci avait commencé avec son départ pour Rome en 1672, soit bien avant l’ac-cession de Jules Hardouin-Mansart aux fonctions de Surintendant, en 1699.
3. V. Théveniaud, Michel Dorigny (1617-1665). Approches biographiques, «Bulletin de la Sociétéde l’Histoire de l’Art français», 1982 (1984), pp. 63-67.
4. En dernier lieu, le dessin préparatoire à l’estampe de 1651 a été attribué à Gilbert Francart,un peintre et dessinateur fort mal connu (J.-C. Boyer, La Mansarade et autres estampes satiriques, inMansart et compagnie, Actes du colloque, novembre 1998, «Les Cahiers de Maisons», 27-28, 1999,pp. 24-31, fig. 2).
5. En l’absence de documents sur la venue à Paris de Dorigny en 1704 autres que les textes deDal Pozzo et de Dezallier d’Argenville, on pourrait aussi mettre en doute l’ensemble de l’épisodeparisien.
stéphane loire
64
76
Comme toutes les vies de peintres rédigées par Dezallier d’Argenville, celle deDorigny fournit des observations sensibles sur la technique de l’artiste, qu’ils’agisse de ses grands décors ou de ses dessins. En dehors de celles relatives àses tableaux de chevalet dont Pierre-Jean Mariette devait écrire qu’ils «ne luifont pas le même honneur que ce qu’il a peint à fresque sur des murailles»,1 ontrouve ici quelques indications sur d’autres aspects de son activité qui ne figu-raient pas chez Dal Pozzo. Ainsi, l’anecdote du plafond commandé lors de sonséjour à Paris apprend que Dorigny l’avait préparé par deux esquisses, sansdoute peintes sur toile, qui restèrent en possession de ses sœurs après son re-tour vers l’Italie. Quant à la mention des «quelques portraits» exécutés à cet-te occasion, elle confirme qu’il dut en exécuter à divers moments de sa carriè-re.2 Des découvertes significatives ont été faites récemment sur son activitédestinée à des collectionneurs et elles peuvent en laisser espérer d’autres: il res-te en particulier à retrouver le prototype peint d’un Songe de Jacob actuellementdocumenté par deux estampes. Publiée à Venise en 1732, par Pietro Monacodans sa fameuse Raccolta di cento dodici stampe di pittura della storia sacra, la premiè-re disait cette peinture «di Ludovico Dorigny Francese» et en possession de lafamille Zucconi;3 quant à la seconde, elle figure dans un recueil de cent-tren-te illu strations gravées d’après les principaux épisodes de la Bible, qui fut im-primé par Philipp Andreas Kilian (1714-1759) à Augsbourg, en 1758.4 En-cadré dans un cadre rocaille, chacune des scènes reprend, vraisemblablementpar l’intermédiaire d’une gravure antérieure, la composition d’un tableau pou-vant parfois revenir à un artiste ancien,5 le plus souvent à un peintre moder-
1. P.-J. Mariette, Abécédario et autres notes inédites de cet amateur sur l’art et les artistes, éd. P. deChennevières et A. de Montaiglon, Paris, 2, 1853-1854, p. 115.
2. Deux e√gies peintes du pape Alexandre VIII qu’il aurait exécutées avant la mort du souve-rain pontife, en 1691, lui ont été récemment attribuées (M. Favilla, R. Rugolo, Colpo d’occhio suDorigny, «Verona Illustrata», 17, 2004, pp. 98-99, pl. 63-64). Les traits de Louis Dorigny ne sontactuellement connus que par la gravure de Michel-Guillaume Aubert (?, vers 1704-Paris, 1757)qui figure en tête de la biographie de Dezallier D’Argenville (éd. 1752, p. 232; éd. 1762, p. 270;R. Pancheri, Per Louis Dorigny: un elogio e un nuovo rapimento d’amore, «Verona Illustrata», 15, 2002,pp. 90-91, pl. 42). Cette gravure ne comporte pas de nom d’«inventeur» et l’on ne peut exclurequ’elle conserve le souvenir d’un Autoportrait disparu.
3. D. Apolloni, Pietro Monaco e la raccolta di cento dodici stampe di pittura della storia sacra, Gorizia2000, pp. 228-229, nº 56. Cette oeuvre est la seule de l’artiste qui ait été reproduite dans le re-cueil de Monaco, et l’unique qui soit signalée en possession de cette famille.
4. P.A. Kilian, Index picturarum chalcographicarum historiam veteris et novi Testamenti celeberrimorumartificium manu CXXX tabulis delineantium / aere expressum, et venum expositarum a Philippo Andrea Kilia-no…, Augsbourg 1758, pl. 15. On connaît au moins un autre tableau de Dorigny sur ce sujet (S.Marinelli, Intorno a Dorigny e Brentana, «Verona Illustrata», 10, 1997, pp. 71-72, pl. 93).
5. En particulier Véronèse, Laurent de La Hyre, Charles Le Brun, Nicolas Poussin ou Pierre-Paul Rubens.
6. Notamment Antonio Balestra, Pompeo Batoni, Antonio Bellucci, Carlo Cignani, BenedettoLuti, Carlo Maratta, Alessandro Marchesini, Giambattista Piazzetta, Francesco Solimena, Fran-cesco Trevisani ou Giuseppe Zocchi; ou encore Nicolas Bertin, François Boucher, Louis de Boul-logne, Pierre-Jacque Cazes, Jean Jouvenet, Charles de La Fosse, François Lemoyne, Jean Restout,Carle Van Loo ou Nicolas Vleughels.
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, biographe de Louis Dorigny
77
ne;6 il est probable, ainsi, que Kilian a copié en l’inversant la planche de Mo-naco. Mais surtout, il est remarquable qu’il ait fait figurer Louis Dorigny dansce recueil qui constitue une sorte de Panthéon des plus illustres peintres d’his-toire de son temps.
On connaît peu les circonstances dans lesquelles Dezallier d’Argenville a pré-paré son ouvrage. Lors du séjour italien entrepris en 1714, il avait pu voir cer-taines des réalisations de Louis Dorigny, qu’il aurait éventuellement pu ren-contrer en Vénétie. La précision de son texte sur les créations postérieures àcette date laisse toutefois supposer d’autres sources d’information. Avant lui,seul Dal Pozzo avait consacré à l’artiste une Vie détaillée et l’on peut suppo-ser que le biographe français, généralement bien informé des publicationscontemporaines relatives aux arts, pouvait connaître cet ouvrage. Pourtant,l’historien de l’Ecole véronaise ne figure pas parmi les auteurs cités par De-zallier d’Argenville dans l’«Avertissement» de son Abrégé;1 d’autre part, si cefoyer était déjà représenté dans son ouvrage par la biographie d’AlessandroTurchi,2 celle-ci ne se fondait pas nécessairement sur une connaissance préa-lable de l’ouvrage de Dal Pozzo car elle apportait peu d’éléments nouveauxen regard de celle qu’avait déjà donnée Félibien.3 Une confrontation des deuxbiographies de Dorigny met en évidence leurs indéniables parentés: Dal Poz-zo et Dezallier d’Argenville mêlent tous deux un récit biographique à peu prèschronologique de la vie de Dorigny à une énumération de ses principales réa-lisations. Chez le premier, la liste de ses œuvres réalisées en Vénétie précèdela mention du voyage à Paris, qui est suivie à son tour du signalement des der-niers décors que Dal Pozzo pouvait connaître, à Udine et à Vienne; chez le se-cond, le détail de ses œuvres ne vient qu’après la biographie, où figuraienttoutefois des indications précises sur son activité en Ombrie, puis à Vienne,les deux parties du texte étant séparées par un bref appendice portant sur Ni-colas Dorigny, le frère cadet de Louis.
Le texte de Dezallier d’Argenville ne saurait pourtant être considéré com-me une simple reprise de celui de son prédécesseur, qu’il aurait mis à jouret complété. Les séquences les plus détaillées de la biographie concernentla formation parisienne de Dorigny et son voyage dans sa ville natale en1704, deux épisodes que le biographe parisien aurait très bien pu connaîtresans le recours au livre de Dal Pozzo. On relève en outre à plusieurs en-droits dans son texte des erreurs de dénominations dans les noms propres
1. Dezallier D’Argenville, Abrégé cit., 1752, 1, pp. vi, vii.2. Ibidem, pp. 199-201.3. A. Félibien, Entretiens sur les vies et les ouvrages des plus excellents peintres anciens et modernes, 5, Pa-
ris 1688, pp. 15-16.
stéphane loire
78
qui seraient incompréhensible s’il y avait eu un accès direct.1 Enfin, si De-zallier d’Argenville a donné une liste d’ouvrages plus détaillée que son pré-décesseur, en particulier pour Vérone, il en a passé sous silence plusieursparmi les plus considérables citées par celui-ci, notamment à Bergame, Pa-doue ou Vicence.2 Faudrait-il admettre que ces absences résultent d’un choixdélibéré de Dezallier d’Argenville? Que celui-ci avait décidé de ne mention-ner que les ouvrages les plus considérables de la carrière de Dorigny, ouceux sur lesquels il était le mieux informé? A y regarder de près, le recourssystématique au texte de son prédécesseur paraît possible mais il ne sauraitsu√re pour expliquer la genèse de sa biographie.
Absente de la première édition de l’Abrégé publiée en 1745, la biographie deDorigny fut ajoutée au supplément paru en 1752: elle fut certainement ré-digée entre ces deux dates, alors que Louis Dorigny était disparu. Quant àla deuxième version figurant dans l’édition de 1762, elle complète la pre-mière par des corrections mineures sans en altérer la structure générale, nile jugement du biographe sur l’artiste.3 Elle s’en distingue surtout par unusage plus raisonné de la ponctuation et des majuscules; sa lecture plus flui-de l’a fait préférer ici, même s’il paraissait indispensable d’en indiquer lesvariantes avec la première version. Pour l’annotation de la biographie, ontrouvera ici des indications sommaires sur les œuvres mentionnées par De-zallier d’Argenville. Certaines ont disparu, d’autres n’ont pas encore été lo-calisées, ni documentées plus précisément: il reste sans doute beaucoup àfaire pour apprécier à sa juste mesure la richesse et l’intérêt de sa biogra-phie de Louis Dorigny.
1. Ainsi, la «Capella del Collegio de’ Notai» chez Dal Pozzo devient «l’Eglise du collége DeiSig. Hottai» chez Dezallier d’Argenville, «Spolverini» devient «Spolvarini»; en revanche, la «CasaZanobria» du premier est correctement désignée «Zenobio» chez le second. Souvent attentif auxnoms des commanditaires, d’autre part, le biographe français ne mentionne pas la famille Maninà propos du décor du Duomo d’Udine, alors que cette précision figurait chez Dal Pozzo.
2. Les décors cités par Dal Pozzo (1718) mais non par Dezallier d’Argenville (1762) sont lessuivants: p. 177. «In Uderzo nel palazzo del Procurator Contarini Imperiale una sala, e quattroCamere. A S. Anna Morosini [à Venise?] al Procurator Morosini diverse opere»; p. 178. «In Pado-va al Signor Fedrigo Cavalli la sala del suo palazzo. A Bagnolo la sala del Signor Abbate Vidma-ni. A Cittadella la Chiesa del Sig. Bernardo Nave. A S. Biagio in Cà da Leze il so√tto della sala.In Trevigi la Sala del Signor Orsetti, e tutto questo a fresco. In Vicenza diverse opere a fresco, &ad olio nelle Case Montanari, del Mar, Capra, del Co: Scrofa, & il so√tto della Scala del Mar.Scipion Repetta. In Bergamo al Colonnello Suppioni il so√tto d’una Camera».
3. A propos du décor de la galerie du palais d’Eugène de Savoie à Vienne, la seconde éditionsupprime une remarque sur les défauts de Dorigny dus au «déclin de l’âge» (p. 274); en revanche,elle déplore que «ses grandes machines» n’aient pas «plus de graces & un plus grand caractère»(p. 275).
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, biographe de Louis Dorigny
79
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux peintres, Paris 1762, 4,pp. 271-280.
LOUIS DORIGNY
271/ Si les excellens ouvrages de peinture1 éternisent leurs auteurs, Louis Dorigny a un droit acquis à l’im-mortalité. Son pere Michel, Professeur de l’académie de Paris, avoit épousé la fille du fameux Voüet,2 &de ce mariage Louis naquit à Paris en 1654. Michel est connu par ses ouvrages dans le château de Vin-cennes, à l’hôtel de Hollande à Paris, & dans d’autres maisons, ainsi que par ses gravures d’après Voüet,qui sont faites avec beaucoup de goût.
Le jeune Dorigny sçut tirer un grand profit des instructions de son père; il le perdit à l’âge de dix ans,& crut ne pouvoir mieux réparer cette perte qu’en entrant dans l’école de le Brun.3 Son génie, nourri dansl’allégorie, dans la composition des sujets de la fable, & dans l’ordonnance des grands traits de l’histoire,le fit paroître des mieux instruits à l’âge de dix-sept ans. Il travailla alors pour les prix de l’académie; &,piqué de n’avoir que le second, croyant avoir mérité le premier,4 il refusa la médaille d’or, se retira de l’aca-démie, & ne fut point nommé pour aller à Rome. Ce contre-tems ne fit qu’augmenter l’envie qu’il avoitde voir l’Italie; il partit avec le sieur de Launay, orfévre, qui depuis a été Directeur du Balancier des mé-dailles. Ces deux amis, qui vécurent ensemble plusieurs années, n’eurent d’autre occupation que de dessinerce qui pouvoit contribuer à /272/ leur avancement. Dorigny fut quatre ans à Rome5 à imiter les plus grandsmodéles, dont il sçut très-bien apprécier les diπérentes beautés. Son génie se développa, & l’aπranchit del’esclavage de copiste; alors il s’eπorça d’égaler les maîtres les plus parfaits.
Il donna bientôt des preuves de ses progrès rapides, dans un voyage de Rome à Gubbio & à Foligno;il y trouva un peintre François peignant au maître-autel des Feuillans de cette derniere ville, saint Ber-nard aux pieds de la Vierge. Ce tableau, qui n’étoit nullement de son goût, l’engagea à demander au peintrela permission de traiter le même sujet; il l’obtint. Les Religieux en sentirent la diπérence, & prirent sontableau. Cette préférence lui procura de peindre le cloître entier des Augustins, où il exposa la vie de leurSaint en vingt-quatre tableaux, qui par leur mérite étendirent beaucoup sa réputation.
Dorigny passa à Livourne en 1677,6 & vint se rendre à Venise, où il se maria à la fille d’un Or-f èvre.7 Plus de dix ans s’écoulerent à visiter les chefs-d’œuvres de cette ville, & à se distinguer par de
1. Éd. 1752: «…ouvrages de Poësie, ainsi que de Peinture, éternisent…».2. Michel Dorigny (Saint-Quentin, 1617-Paris, 1665) avait épousé en 1648 Jeanne-Angélique
Vouet, l’une des filles de Simon Vouet. Admis à l’Académie royale de Peinture et de Sculpture deParis en 1663, il y avait été nommé professeur en 1664.
3. Dominant la scène artistique parisienne au cours de la première moitié du règne de LouisXIV, Charles Le Brun (1619-1690) cumulait depuis 1663 la direction de l’Académie royale de Pein-ture et de Sculpture avec celle de la manufacture des Gobelins. Nommé premier peintre du roi en1662, il avait été confirmé dans ces fonctions en 1664. Il n’existe aucune autre mention du passa-ge de Dorigny auprès de Le Brun mais en raison du prestige qu’avait alors celui-ci, un tel appren-tissage paraît assez vraisemblable.
4. Éd. 1752: «…le second, il crut mériter le premier, refusa…».5. De la fin de l’année 1672 à 1676. Une durée identique pour son séjour était donnée par Dal
Pozzo (Le vite cit., p. 177).6. La date de 1678 figurait sous l’une des fresques des augustiniens de Foligno, ce qui condui-
rait à retarder d’une année au moins l’arrivée de Dorigny à Livourne ainsi que dans les états deVenise, où l’auteur de la biographie anonyme de la Biblioteca Civica d’Udine le disait être parve-nu à l’âge de vingt-deux ans (Frank, Zu einer kaum bekannten Vita cit., p. 103).
7. Son mariage eu sans doute lieu peu après le 10 février 1683, quand le peintre demandait la«libertà di matrimonio» pour épouser Andriana Grandi (M. Favilla, R. Rugolo, Regesto biografi-co, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., p. 182). Dorigny devait déjà être en relation avec le milieu desorfèvres parisiens grâce à Nicolas de Launay; il est possible, d’autre part, que ses contacts avec
stéphane loire
80
grands ouvrages qui seront détaillés à la fin de cette vie.1 Son frere cadet, Nicolas Dorigny,2 qui a de-meuré long-tems à Rome, le vint voir à Venise, & ils visiterent souvent ensemble M. de Piles, qui étoitpour lors Secrétaire d’ambassade chez M. Amelot, Ministre de France.3 Quoique Venise lui fournit lesmoyens de s’enrichir, Dorigny ne put s’accoutumer à flatter sans cesse les nobles Vénitiens, ce qui le déter-mina à s’établir à Vérone, où il fixa sa demeure.4 Cette ville est enrichie de beaucoup de tableaux de samain, & il y en a /273/ peu dans l’Italie qui n’oπrent aux curieux des preuves de son rare génie. Lesgrands ouvrages ausquels il étoit appellé, l’obligeoient à des courses continuelles d’une ville à une autre.
Dorigny vint faire un voyage à Paris, en 1704, pour revoir sa famille.5 Il y fit, pendant un an de sé-jour, quelques portraits,6 & deux esquisses pour le plafond de l’escalier d’une maison qui appartenoit au
cette profession, à Venise, soient à l’origine de son intervention en tant que peintre de miniatu-re, sans doute entre 1698 et 1706, sur un Baiser de Paix (Venise, basilique Saint-Marc, Trésor ; M.Favilla, R. Rugolo, Dorigny e Venezia. Da Ca’ Tron a Ca’ Zenobio e ritorno, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp. 53, 54, fig. 31) oπert par le pape Grégoire XIV à la République de Venise en 1591.
1. Le séjour de Dorigny à Venise aurait duré dix ans selon Dal Pozzo (Le vite cit., p. 177). Le6 mai 1680, Louis Dorigny faisait rédiger par le notaire ducal de Venise, Gianfranco Bonamini,une procuration en latin au nom de sa sœur Jeanne-Angélique Dorigny, pour le représenter dansl’aπaire passablement compliquée du règlement de la succession de Simon Vouet. Ce documentétait authentifié le lendemain par un sceau de l’ambassadeur de France à Venise et le 7 août sui-vant, sa sœur le portait chez le notaire parisien Levasseur; elle renonçait alors à cette sucessionen son nom et en celui de son frère (Paris, Archives Nationales, Minutier Central, XLV, 248, ci-té par J. Rivet, Comment s’entendre? ou la succession de Simon Vouet, in S. Loire (éd.), Simon Vouet,Actes du colloque international, Galeries nationales du Grand Palais, 5-7 février 1991, Paris 1992,p. 375, note 57).
2. Nicolas Dorigny (1658-1746) était à Rome entre 1687-1688 et 1709. Le texte de Dezallierd’Argenville fournit une indication précieuse sur son passage à Venise: la fin de la phrase permetde le situer entre 1682 et 1685.
3. Roger de Piles (1635-1709) devint en 1662 le tuteur de Michel-Jean Amelot de Gournay(1655-1724), qu’il accompagna en 1673 lors d’un voyage en Italie; ce dernier personnage fut am-bassadeur du roi Louis XIV à Venise, de 1682 à 1685. A cette occasion, Dorigny donna le dessind’une estampe montrant la gondole utilisée par l’ambassadeur pour son entrée à Venise, dont ilavait sans doute aussi projeté la décoration (Corubolo, Le incisioni cit., pp. 45, 56, pl. 78).
4. L’installation de Dorigny à Vérone aurait eu lieu vers 1690 (A. Pasian, Per un catalogo di LouisDorigny, «Arte in Friuli. Arte a Trieste», 18-19, 1999, p. 14). Dal Pozzo (Le vite cit., p. 177) l’ex-pliquait déjà de manière comparable: «Di là trasferì in Venetia, ove fermatosi per lo spatio di die-ci anni, ha maggiormente con l’opere dilatato il suo nome. Ma perché nelle Città dominanti peravvanzarsi co’ Grandi, ci vuole pronto servire, e continuo adulare, e la libertà Francese non sa ac-comodarsi alla soggettione, quindi ritirossi in Verona, come Città più confancente al suo genio,dove stabilì la propria Casa, e da trenta, e più anni in quà vi continua la permanenza con Moglie,e numerosa Figliuolanza».
5. Le séjour parisien de Dorigny et l’échec de sa tentative d’admission à l’Académie étaientdéjà mentionnés par Dal Pozzo (Le vite cit., p. 178): «Nel 1704 fece un viaggio a Parigi per rive-dere i Parenti dopo tanto tempo che n’era assente, dove si trattene un anno & essendo ben noti isuoi avvanzamenti in Italia, fu persuaso da’ Signori della Regia Accademia a decorarsi dell’hono-re, che godettero il proprio Padre, e gli altri suoi Maggiori col farsi aggregare al numero loro, tan-to più che n’era fin dal principio meritevole, mentre dalla prima sua gioventù havea riportato ilpremio per due volte in Parigi, & una volta in Roma nel publico certame de gli altri Giovini Stu-denti. Tutto il corpo dell’Accademia era disposto a rendergli questa giustitia; ma non poteva ag-gregarlo senza il previo consenso del Signor di Mansarò Protettore dell’Accademia. Però preoccu-pato da Malevoli, che mal toleravano un emolo Francese Italianato, non volle ammetterlo con suotorto manifesto, e dispiacere de’ Principali dell’Accademia, che non lasciarono di testificarlo a luistesso in propria Casa».
6. Éd. 1752: «…pour revoir sa famille, & il y resta un an entier. Il y fit quelques portraits &deux esquisses…».
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, biographe de Louis Dorigny
81
fils d’un Maréchal ferrant; son sujet fut1 la chûte de Phaëton, où ses chevaux renversés montroient tous lesfers de leurs pieds:2 cette aπectation ne fut pas exempte de critique, & le maître de la maison, à qui on lafit remarquer, lui demanda une autre esquisse qui ne le contenta pas mieux. Les plus habiles peintres furentconsultés, entr’autres, Largilliere3 & Rigaud;4 tous désapprouverent les deux esquisses, & en empêcherentl’exécution. Quelques amis lui persuaderent de se présenter à l’académie, dont son père avoit été membre. Ily avoit aussi remporté des prix, ainsi qu’à celle de Rome. On l’auroit sûrement admis dans ce corps,5 siquelques-uns, mécontens de ce qu’il avoit abandonné sa patrie, n’eussent indisposé6 contre lui Jules-Har-douin Mansard, Surintendant des bâtimens, & protecteur de l’académie, en lui disant qu’il étoit fils deMichel Dorigny, qui avoit gravé, en 1651, une estampe contre son oncle, appellée la Mansarade; piécedes plus satyrique:7 il n’en fallut pas davantage pour être refusé.
Il est vrai que Michel Dorigny son pere, pour se venger de ce que François Mansard avoit proposé d’éta-blir un impôt sur les Arts, l’avoit représenté monté sur un mulet,8 avec un singe en croupe /274/ qui luiporte un parasol, & le tire avec une échelle passée dans le col, pour le conduire à Montfaucon,9 avec unécrit très-satyrique au bas de l’estampe.
Louis voyant que sa réception à l’académie étoit très-incertaine, & ne pouvant exécuter son plafond, enremit les équisses à ses sœurs,10 & partit pour Vérone; mais avant que d’y arriver, il passa par Naples, en1706, & y visita Solimene,11 qui lui donna deux de ses disciples pour le conduire dans la ville. Sitôt que Do-rigny eut vû des fresques de ce grand homme, qu’il crut de Lanfranc,12 il ne cessa de les admirer, & se ren-dit ensuite à Vérone, où il fut accueilli de tout le monde, & reçu avec distinction parmi les peintres Véronois.
Le Prince Eugène de Savoye13 le manda à Vienne en 1711,14 & il y passa environ treize mois à décorer
1. Éd. 1752: «…d’un Maréchal ferrant; il prit pour son sujet la chute de Phaëton, …».2. Pour les diπérentes versions de ce sujet par Dorigny, voir S. Pierguidi, Louis Dorigny e il te-
ma della Caduta di Fetonte, «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 45, 2001,pp. 338-341.
3. Nicolas de Largillierre (1656-1746) avait été admis à l’Académie Royale de Peinture et deSculpture en 1686 comme peintre de portrait. Il devait en être le directeur de 1734 à 1735, puisde 1738 à 1742.
4. Hyacinthe Rigaud (1659-1743) avait été admis à l’Académie Royale de Peinture et de Sculp-ture en 1700 comme peintre d’histoire. Il devait en devenir le directeur en 1733.
5. Éd. 1752: «…de Rome. On l’y auroit sûrement admis, si quelques-uns…».6. Éd. 1752: «…sa patrie, & jaloux de ce qu’il s’étoit rendu habile sur les grands modéles d’Ita-
lie n’eussent aigri contre lui…».7. Éd. 1752: «…en 1651 une Estampe satyrique contre lui appelée la Mansarade; il n’en fallut…».8. Éd. 1752: «…son père, ayant reçu pendant qu’il peignoit dans le Château de Vincennes
quelque mécontentement de ce Sur-Intendant qui vouloit dominer sur tous les peintres employéschez le Roi, le représenta monté sur un mulet, avec un singe…».
9. Éd. 1752: «…dans le col pour se rendre à Montfaucon, avec un écrit…».10. Éd. 1752: «…en remis les esquisses à ses sœurs…».11. Dominant le milieu des peintres napolitains, Francesco Solimena (1657-1747) était alors dans
sa pleine maturité. Au retour d’un séjour au service de la cour d’Espagne (1692-1702), il éxécu-tait alors de grands tableaux d’autel pour le Duomo de Sarzana (1706) et pour l’église San PietroMartire de Naples (1707).
12. Séjournant à Naples de 1634 à 1646, Giovanni Lanfranco (1582-1647) y avait peint notam-ment la coupole et les pendentifs du Gesù Nuovo, divers décors dans l’église de la chartreuse deSan Martino et dans celle des Santi Apostoli, ainsi que la coupole de la chapelle du Trésor auDuomo.
13. Eugène de Savoie (1663-1736). Ses victoires militaires firent de lui l’un des plus fameuxcondottiere de l’histoire européenne. A partir de 1694, à Vienne, il avait fait édifier le Stadtpa-lais, sur des projets de Johann Bernhard Fischer von Erlach.
14. Selon Roberto Pancheri (in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp. 60-61), le peintre pourraitl’avoir rencontré dès 1706.
stéphane loire
82
dans son palais un grand escalier,1 dont l’architecture est peinte par des Bolonois:2 on y voit trois comparti-mens de sujets d’histoire, dont une est celle d’Icare;3 dans les deux chambres suivantes, il a peint de l’archi-tecture & des ornemens: le plafond de la galerie représente l’enlèvement d’Orithye4 par Borée,5 accompagnéde plusieurs Vents.6 Dorigny a encore représenté, dans la salle de la Chancellerie de Bohême, le conseil desDieux, d’une maniere & d’une exécution des plus parfaites.7 On voit dans la ville de Prague, un plafondovale, où Junon paroît dans son char, suivie de quatre Nymphes, avec des animaux & diπérens8 attributs.9
Cet artiste composoit facilement: les grandes machines ne l’étonnoient point, & il sçavoit très-bien l’artdes raccourcis;10 le génie, la correction, la couleur & beaucoup de vivacité dans le pinceau, /275/ se trou-vent réunis dans ses ouvrages: on y remarque un goût ferme & prononcé, un style héroïque & sublime; ony souhaiteroit quelquefois plus de graces & un plus grand caractère.11
Les diπérentes occasions qu’il eut de se signaler dans plusieurs villes, l’avoient rendu un grand praticienpour les ouvrages à fresque. Son plus fameux morceau est à Trente, où il a peint de cette manière la coupo-le de la grande Eglise:12 les saints Protecteurs de cette Ville y sont placés sur des nuages; & dans les lu-nettes qui regnent autour de la croisée de l’Eglise, ce sont les martyres des mêmes saints, en clair-obscur:ceux de l’ancien & du nouveau Testament, accompagnés d’un grand nombre de figures, se voient dans lavoûte de l’Eglise, avec des ornemens en clair-obscur. L’ordonnance & l’exécution de ce grand morceau,sont autant d’honneur à sa piété qu’à son esprit.
Il est mort à Vérone en 1742, âgé de quatre-vingt-huit ans, laissant une nombreuse famille, dont au-
1. Ces décors sont évoqués brièvement par Dal Pozzo (Le vite cit., p. 179). Sur le séjour de Do-rigny à Vienne, voir H. Schwarz, Louis Dorigny in Wien, «Mitteilungen der Österreichischen Ga-lerie», 10, 1966, pp. 69-80; M. Frank, Louis Dorigny a Vienna, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp.63-71.
2. Dezallier d’Argenville est le seul des anciens biographes de Dorigny à lui attribuer le décorde cet escalier. Selon Frank (ibidem, p. 63), toutefois, des photographies anciennes permettent d’ex-clure qu’il en soit l’auteur.
3. Schwarz, Louis Dorigny in Wien cit., p. 72, fig. 44 (Apollon sur le char du soleil), 45 (La chuted’Icare), 46 (Allégorie de l’Aurore).
4. Éd. 1752: «…des ornemens, & dans le plafond de la galerie l’enlevement d’Orithie par Bo-rée, …».
5. Ce décor n’est plus visible en raison de la pose ultérieure d’un faux-plafond (pour divers dé-tails, voir Schwarz, Louis Dorigny in Wien cit., fig. 47-48; G. Menato, Contributi a Luigi Dorigny,«Arte Veneta», xxi, 1967, pp. 167, fig. 197-198). La composition du Borée enlevant d’Orithye est do-cumentée par deux dessins conservés dans une collection particulière et au Museo di Castelvec-chio de Vérone (B. Aikema, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp. 159-160, nº 68, repr.; G. Mari-
ni, ibidem, pp. 159-160, nº 69, repr.).6. Éd. 1752: «…plusieurs Vents. Ces ouvrages se ressentent un peu du déclin de l’âge. Dori-
gny a encore…». Toujours en place, le plafond de la Salle Bleue représente Les noces d’Hercule etHébé (Frank, Louis Dorigny a Vienna cit., pp. 62, 65, figg. 1-2).
7. Éd. 1752: «…d’une manière & d’une exécution plus parfaites. On voit…». Le palais de laChancellerie de Bohême a été édifiée entre 1710 et 1714. Ce décor à présent disparu est égalementmentionné dans la biographie anonyme de Dorigny, qui cite d’autres décors peints à Vienne(Frank, Zu einer kaum bekannten Vita cit., p. 104). Il a été remplacé au début du XIXe siècle par unplafond d’inspiration néo-classique (Eadem, Louis Dorigny a Vienna cit., p. 63).
8. Éd. 1752: «…dans son char avec quatre Nymphes accompagnées d’animaux & de diπé-rens…».
9. Il n’existe aucune autre mention d’une activité de Dorigny à Prague.10. Éd. 1752: «…l’art du raccourci; le génie…».11. «On y souhaiteroit […] plus grand caractère»: ne figure pas dans l’édition de 1752.12. Achevé en 1732, ce décor dont Dezallier d’Argenville donne une description particulière-
ment détaillée a été détruit à la fin du XIXe siècle (voir Pancheri, Per Louis Dorigny cit., pp.79-91).
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, biographe de Louis Dorigny
83
cun n’a suivi sa profession. On ne connoît point ses élèves, la multitude de ses ouvrages ne lui a pas donnéle tems d’en former.
Ses desseins sont faits à toutes sortes de crayons: il y en a d’arrêtés d’un seul trait de plume au bistre,ou lavés à l’encre de la Chine, relevés de blanc; d’autres sont entiérement maniés à la plume, sur-tout lespetits desseins qu’il vouloit graver: ses hachures sont toujours de droit à gauche, & peu croisées. On y trou-ve de l’esprit, du feu, un génie abondant, & une expression qui le distinguent assez des autres maîtres.Quoiqu’il ait excellé à traiter des sujets en grand, il s’est attaché a mettre plus de perfection dans les petits:le goût du fa/276/meux Sébastien le Clerc1 paroît l’avoir un peu guidé dans ces derniers.
NICOLAS DORIGNY
Son frere cadet, Nicolas Dorigny, né à Paris en 1657,2 après plusieurs voyages, s’établit à Paris. Il a faitpeu de chose en peinture;3 mais la gravure, à laquelle il s’est plus attaché, a procuré aux amateurs d’excel-lens morceaux.4 Vingt-huit années de séjour en Italie5 lui ont à peine su√ pour publier les plus beaux ta-bleaux des grands maîtres, & les angles du Dominiquin à saint André della valle.6 Il ne s’est pas moinsexercé pendant quinze autres années en Angleterre,7 à graver les fameux cartons de Raphaël que l’on conser-ve à Hamptoncourt:8 ces derniers morceaux lui acquirent les bonnes graces de Georges I,9 qui le combla debiens & le fit chevalier.10 Il fut reçu à l’académie de peinture en 1725, & mourut à Paris en 1746, âgéde quatre-vingt-neuf ans & demi, sans laisser de postérité.
LOUIS DORIGNY
Les ouvrages de Louis Dorigny à Vérone sont, quatre tableaux à l’huile, dans l’Eglise du collége Dei Sig.Hottai:11 les deux premiers représentent deux miracles de saint Zenon, Evêque & protecteur de la ville;12 onvoit dans le troisiéme, Daniel qui justifie Susanne;1 & une annonciation fait le sujet du quatriéme:2 dans
1. Sébastien Le Clerc (1637-1714).2. Nicolas Dorigny est né en fait en 1658 (B. Gady, in Saur Allgemeines Künstler Lexikon. Die Bil-
denden Künstler aller Zeiten und Völker, 29, Munich-Leipzig 2001, p. 72).3. Éd. 1752: «…à Paris. Son application à la peinture a fourni peu d’ouvrages; mais la gravu-
re…».4. Un catalogue des gravures de Nicolas Dorigny comportant cent quarante-et-un numéros a
été publié par R.-A. Weigert, Bibliothèque nationale. Département des estampes. Inventaire du fonds fran-çais. Graveurs du XVIIème siècle, 3, Paris 1954, pp. 490-507.
5. Il était de retour à Paris en 1709, ce qui situerait son arrivée en Italie en 1681. Il n’est do-cumenté à Rome qu’à partir de 1687/1688 mais un passage antérieur du texte fait état de sa pré-sence à Venise entre 1682 et 1685 (voir note 2, p. 80).
6. Éd. 1752: «…les angles du dominicain & de Lanfranc. Il ne s’est pas moins…». Il s’agitdes reproductions des pendentifs de la coupole de l’église San Andrea della Valle de Rome peintspar Dominiquin en 1623-1626 (Weigert, Bibliothèque nationale cit., p. 500, nºs 90-93).
7. Nicolas Dorigny était à Londres entre 1711 et 1724.8. Il s’agit des Actes des Apôtres d’après les cartons de tapisseries de Raphaël (Londres, Victoria
and Albert Museum) : Weigert, Bibliothèque nationale cit., pp. 502-503, nºs 100-107.9. Éd. 1752: «…bonnes grâces de Charles II qui le combla…». Georges Ier, roi de Grande-
Bretagne et d’Irlande de 1714 à 1727. L’édition de 1752 nommait à cet endroit Charles II qui futroi d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande de 1660 à 1685.
10. Le 11 juin 1720.11. Tableaux peints en 1696-1697, cités brièvement par Dal Pozzo (Le vite cit., p. 178). Il s’agit
en fait de la chapelle des Notaires (en italien Notari, ou Notai) de Vérone.12. Saint Zénon ordonnant au diable de transporter la coupe de porphyre, Saint Zénon arrêtant le char tiré
par des bœufs possédés du démon (S. Marinelli, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp. 101-105, nºs 6-7,repr.).
stéphane loire
84
l’Eglise de saint Sébastien, est le songe3 de Machabée, qui croit voir l’épée d’or du Prophète Zacharie;4 plu-sieurs clairs-obscurs représentant la vie de saint Louis de Gonzague & de saint Stanislas de Kostka.5 La man-ne est peinte au maître-autel de l’Eglise de saint Luc;6 & dans celle de sainte Euphemie, un saint Christophequi porte Jesus-Christ sur ses épaules, avec une gloire d’anges au-dessus;7 à saint Marc, la /277/ conceptionde la Vierge, & au bas de ce tableau d’autel, sont placés saint Grégoire & saint François de Paule; on8 voitdans le palais Giusti, un grand tableau de l’enlèvement des Sabines,9 & le combat des Horaces & des Cu-riaces;10 dans le palais Pelegrini, au plafond de l’escalier, ce sont11 les Vertus Théologales & les Cardinales,assises sur des nuages; dans la maison Lombardi, plusieurs tableaux à l’huile sont12 placés dans une salle; sçavoir, le repas de Cleopâtre, Enée abordant sur les côtes d’Italie, Orphée aux portes des enfers, pour ramenerEurydice; Herminie sur les bords du Jourdain, avec un vieux berger & trois enfans qui chantent.13 La mai-son des Piccoli possede de grands tableaux à l’huile, représentant le déluge, le sacrifice de Noé, la constructionde la Tour de Babel; dans la vigne du Comte Allegri à Cuzzano,14 dans le plafond de la salle, paroît leConseil des Dieux; dans une embrasure, Persée tient la tête de Méduse, qui change en pierre plusieurs soldats;15& vis-à-vis le combat des Centaures & des Lapithes:16 au-dessous de ces tableaux, il a peint, à fresque, deuxluttes d’hommes en clair-obscur17 & tout autour de la salle, les douze signes du Zodiaque personnifiés. Dansle palais du même Seigneur à Vérone,18 la salle & plusieurs chambres sont ornées de plafonds,19 où sont représentés Borée qui enleve Orithye, accompagné de plusieurs Vents;20 dans une autre c’est une fête de Bac-chus;21 on voit dans le même palais, les quatre Parties du Monde,22 la Renommée & les Vertus Cardinales,Vénus suivie1 des Graces, Junon dans son char tiré par des Paons, la Déesse Flore, & la Nuit environnée des
1. Daniel innocentant Suzanne, Vérone, Palazzo del Comune, Cappella dei Notai (ibidem, pp. 100-102, nº 5, repr.).
2.L’Annonciation, L’ange de l’Annonciation, Une gloire d’anges, 1697 (ibidem, pp. 105-107, nºs 8-10, repr.).3. Éd. 1752: «…l’Eglise de Saint Sébastien, le songe de Machabée…».4. Le songe de Maccabée, disparu. Voir A. Pasian, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., p. 131.5. Scènes de la vie de saint Stanislas Kostka, probablement exécutées après 1726, Vérone, Museo di
Castelvecchio (Pasian, Per un catalogo cit., p. 27; Idem, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp. 129-131, nºs 26-32, repr.).
6. La récolte de la manne, 1704, Vérone, San Luca (F. Pietropoli, in Louis Dorigny 1654-1742 cit.,pp. 174-176, nº 89, repr.).
7. Saint Christophe, 1694, Vérone, Sant’Eufemia (ibidem, pp. 172-175, nº 88, repr.).8. Éd. 1752: «…tableau d’Autel saint Grégoire & Saint François de Paule. On voit…».9. G. Knox, The collection of Ercole Giusti at Verona, «Verona Illustrata», 10, 1997, pp. 24-25. La
composition de ce tableau, qui mesurait dix-huit mètres de long, est documentée par un dessinconservé au Museo di Castelvecchio de Vérone (G. Marini, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp.156-157, nº 64, repr.).
10. Seul le premier de ces deux tableaux est cité par Dal Pozzo (Le vite cit., p. 178).11. Éd. 1752: «…au plafond de l’escalier, les Vertus Theologales…».12. Éd. 1752: «…plusieurs tableaux à l’huile placés dans une salle ; …».13. Ces tableaux sont cités brièvement par Dal Pozzo (Le vite cit., p. 178 : «diverse opere a olio»).14. Décors de l’oratoire et du salon, vers 1718-1720, Cuzzano di Grezzana (Vérone), Villa Allegri-
Arvedi. Voir A. Pasian, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp. 178-179, nº 91, repr.15. Persée tenant la tête de Méduse (P. Marini, Louis Dorigny frescante a Verona e nel Veneto, in Louis
Dorigny 1654-1742 cit., pp. 24-25, fig. 1).16.Le combat des centaures et des lapithes (Menato, Contributi a Luigi Dorigny cit., pp. 167-168, 171, fig. 205).17. Hommes luttant (Marini, Louis Dorigny frescante cit., pp. 24-25, fig. 1).18. Éd. 1752: «…personnifiés. Dans son Palais à Vérone la Salle…».19. Ces décors disparus lors de la Seconde Guerre mondiale sont cités de manière générale par
Dal Pozzo (Le vite cit., p. 178).20. Borée enlevant Orithye (composition documentée par un dessin conservé au Museo di Castel-
vecchio de Vérone : G. Marini, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp. 161-162, nº 72, repr.).21. Bacchus et sa suite (ibidem, pp. 168-169, nº 85, repr.).22. Les quatre parties du monde (ibidem, pp. 153-154, nº 59, repr.).
Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville, biographe de Louis Dorigny
85
Songes personnifiés:2 dans le palais du /278/ marquis Spolvarini, il a peint, à fresque, le plafond d’une sal-le, partagé en trois;3 on voit dans le milieu un chœur de Bergers;4 à un des bouts une Bacchanale,5 & dansl’autre une chasse de Diane; dans une autre chambre, le plafond représente la chûte de Phaeton que Jupiter pré-cipite:6 le palais Murelli a de lui trois plafonds à fresque;7 on voit dans celui de la salle, le char du soleil avecles signes du Zodiaque; le triomphe d’Hercule, avec les Arts libéraux & autres sujets, ornent les deux autreschambres: dans la maison Nuvoloni, il y a une grande piéce toute remplie de morceaux à l’huile, dont les prin-cipaux sont, Salomon visité par la Reine de Saba,8 sa piété envers Dieu,9 ensuite son idolâtrie.10
La ville de Venise expose, dans l’Eglise de saint Silvestre, au milieu du plafond, un ciel ouvert, où l’on voitla Trinité avec la Vierge, & plusieurs anges en adoration; vers la porte, il a peint d’autres anges qui portentla croix; & du côté du maître-autel, c’est l’apothéose de saint Silvestre, le tout peint à fresque: on voit autourdu plafond, les saints de l’ancien & du nouveau Testament, sur des nuages;11 l’Eglise des Jésuites représen-te12 deux plafonds à fresque, celui du maître-autel est composé d’un concert d’anges;13 l’autre, qui est au mi-lieu de la croisée, fait voir le Ciel, la Terre & l’Enfer, qui adorent le nom de Jesus:14 le plafond d’une cha-pelle latérale, dans l’Eglise des Carmes déchaussés, expose un grouppe d’anges peint à fresque;15 dans le palais16del Sig. Tron, il a exécuté de même dans une salle le triomphe d’Hercule, où sont rassemblés tous les Dieux;17& les signes du Zodiaque personnifiés se voient dans les ornemens du pour/279/tour: au palais Zenobio, il apeint deux salles & une chambre;18 dans la première, est l’Aurore qui devance le char du Soleil, accompagnéedes Vents qui écartent les phantômes de la nuit;19 on voit dans l’autre salle, trois niches; le Mérite accompa-gné de la Vertu & de la Renommée, grouppées de petits enfans, est dans la premiere;1 la seconde est la Vertu
1. Éd. 1752: « Vénus accompagnée des Graces, Junon…».2. Allégorie de la Nuit (composition documentée par un dessin conservé au Museo di Castelvec-
chio de Vérone : ibidem, pp. 168-169, nº 86, repr.).3. Les décors du palais Spolverini Orti Manara de Vérone sont cités brièvement par Dal Pozzo
(Le vite cit., p. 178).4. Un chœur de bergers (P. Marini, Louis Dorigny frescante cit., pp. 29-35, fig. 11).5. Bacchanale (ibidem, fig. 12).6. La chute de Phaeton (ibidem, fig. 14 : détail).7. Dal Pozzo (Le vite cit., p. 178) ne mentionne que «due so√tti» dans la «Casa Muselli».8. La rencontre de Salomon et de la reine de Saba, disparu. Composition documentée par un dessin
conservé au Castello del Buonconsiglio de Trente (G. Marini, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp.154-156, nº 63, repr.).
9. Un roi d’Israël oπfrant un sacrifice, disparu. Composition documentée par un dessin conservé auCastello del Buonconsiglio de Trente (ibidem, pp. 154-156, nº 61, repr.).
10. Salomon adorant les idoles, disparu. Composition documentée par un dessin conservé au Cas-tello del Buonconsiglio de Trente (ibidem, pp. 154-156, nº 60, repr.). Le même musée conserve unautre dessin montrant Une scène de banquet (Esther et Assuérus?) (ibidem, pp. 154-156, nº 62, repr.).
11. 1682-1683. Détruit. Ce décor est cité plus brièvement par Dal Pozzo (Le vite cit., p. 177).12. Éd. 1752: «…les Saints du Vieux & du Nouveau Testament sur des nuages. L’Eglise des
Jésuites présente deux plafonds…». Sur ces décors peints vers 1718-1720, voir L. Olivato, Nuo-vi ordini e nuovi ricchi. La chiesa dei Gesuiti a Venezia, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp. 78-85.
13. Anges musiciens (ibidem, p. 83, fig. 2).14. Allégorie religieuse: le triomphe du nom de Jésus (ibidem, p. 78, fig. 1).15. Gloire d’anges, 1716, Venise, Scalzi, voûte de la chapelle Manin (Menato, Contributi a Luigi
Dorigny cit., p. 168, fig. 199). L’ensemble du décor a été reproduit dans une gravure de JohannAndreas Pfeπel et Martin Engelbrecht (Frank, Louis Dorigny a Vienna cit., p. 68, fig. 5).
16. Éd. 1752: «…expose un gouppe d’Anges peints à fresques. Dans la maison del Sig. Tron il a exé-cuté…».
17. Le triomphe d’Hercule, 1701-1702, autrefois à Venise, Ca’ Tron, détruit en 1842-1847. Décor citébrièvement par Dal Pozzo (Le vite cit., p. 177). Voir Favilla, Rugolo, Dorigny e Venezia cit., pp. 36-44 (étudient d’autres œuvres de Dorigny inspirées par la Genèse et toujours conservées à la Ca’ Tron).
18. Décor cité brièvement par Dal Pozzo (Le vite cit., p. 177).19. L’Aurore précédant le char du soleil, vers 1698, Venise, Ca’ Zenobio (Pasian, Per un catalogo cit.,
p. 17; Favilla, Rugolo, Dorigny e Venezia cit., pp. 44-50, fig. 18).
stéphane loire
86
récompensée par la Justice;2 & la troisiéme est remplie de plusieurs Vices personnifiés, vaincus & foudroyés:3il y a une chambre à deux plafonds; l’un est un Mercure avec plusieurs symboles de la Vertu; dans l’autre, cesont les trois Déesses qui se disputent la pomme d’or.
A Mantoue, il a peint à fresque la chûte de Phaëton, dans le plafond de la salle du palais du ComteBeltrame.4
A Trévise, on voit dans l’Eglise des Religieuses de saint Paul, une gloire d’anges au plafond; & sur lesmur de côté, les actions les plus intéressantes de saint Paul sont peintes5 en clair-obscur doré sur un fond blanc.6
Dans la grande Eglise d’Udine, on voit au plafond du maître-autel, une gloire d’anges, à fresque;7& sur les murs, est peinte d’un côté la résurrection du Sauveur qui triomphe de la Mort, de l’Enfer, duPéché & de l’Hérésie;8 de l’autre est son ascension, & la Gloire humaine accompagnée des Honneurs &des Richesses de ce monde, y paroît prosternée:9 on voit dans les plafonds de la croisée de l’Eglise les Peresde l’Ancien & du Nouveau Testament,10 peints à fresque sur des nuages.
Il auroit été trop long de décrire tous les ouvr/280/ages que Dorigny a faits dans les autres villes d’Ita-lie, on s’est attaché aux principaux.
Il a gravé de sa main cinq emblêmes d’Horace,11 une vûe en grand de l’amphithéâtre de Vérone,12 sixsujets de métamorphose;13 une suite de trente-un petits morceaux, & le titre historié pour une traductionItalienne des Pensées Chrétiennes pour tous les jours du mois, par le Pere Bouhours, imprimées in-16, à Ve-nise en 1684.14 Desbois a gravé d’après lui des titres de Livre;15 son frere Dorigny a fait une piéce pourles Eloges de la famille Barbarigo.16
1. L’Honneur, accompagné par la Force et la Prudence, est célébré par la Renommée, vers 1700, Venise,Ca’ Zenobio (ibidem, pp. 49, 51, 58, note 82, fig. 25).
2. L’Aπabilité-Amabilité et la Richesse, avec la Noblesse et la Justice, conduisent à la Renommée et à la Ver-tu, vers 1700, Venise, Ca’ Zenobio (ibidem, pp. 49, 51, 58, note 83, fig. 26).
3. La Superbe, l’Ignorance et l’Obstination (?) sont vaincues et chassées, vers 1700, Venise, Ca’ Zeno-bio (ibidem, pp. 49, 51, 58, note 84, fig. 24).
4. Il n’existe aucune autre mention d’une activité de Dorigny à Mantoue.5. Éd. 1752: «…les plus intéressantes de S. Paul sont peintes en clair-obscur doré…».6. Décors peints en 1711-1715; disparus.7. Les décors du Duomo d’Udine sont cités plus brièvement par Dal Pozzo (Le vite cit., p. 179). Ils
ont été réalisés entre 1709 et 1714. Pour une vue d’ensemble, voir Menato, Contributi a Luigi Dorignycit., p. 166, fig. 196. Sur l’activité de Dorigny à Udine, voir aussi M. Favilla, R. Rugolo, In Arca-dia e in firmamento: Louis Dorigny in Friuli, in M. P. Frattolin (éd), Artisti in viaggio, 1600-1750. Presenzeforeste in Friuli Venezia Giulia, Venise 2005, pp. 117-142.
8. La descente du Christ aux enfers (Frank, Louis Dorigny a Vienna cit., p. 67, fig. 3).9. Allégorie sacrée (ibidem, p. 67, fig. 4).10. Éd. 1752: «…croisée de l’Eglise les Pères du Vieux & du Nouveau Testament peints à
fresque…».11. Six emblèmes ont été catalogués par Corubolo, Le incisioni cit., pp. 47-48-55, nºs 2-7, fig.
39-41; Idem, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp. 139-140, nºs 38-43, repr. Des dessins préparatoirespour ces estampes sont conservés à Paris, au musée du Louvre (P. Marini, in Louis Dorigny 1654-1742 cit., pp. 137-140, nºs 35-37, repr.).
12. Les arênes de Vérone, 1696 (Corubolo, Le incisioni cit., pp. 53-55, nº 40, pl. 45; Idem, in LouisDorigny 1654-1742 cit., pp. 148-152, nº 56, repr.).
13. Corubolo, Le incisioni cit., p. 55, nºs 41-46 (non retrouvés).14. Gravures pour l’ouvrage de Dominique Bohours, Pensieri christiani per tutti li giorni del mese.
Opera francese di un padre della Compagnia di Giesù, Venise 1684 (Corubolo, Le incisioni cit., pp. 50-53, nºs 8-39, pl. 46-77).
15. Ibidem, pp. 57-58, nºs 2-4, fig. 79, 82, 83.16. Ibidem, p. 60, nº 10 (non retrouvée).