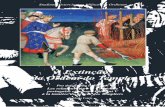Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs
-
Upload
univ-paris5 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.1
Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs
Marianne Doury
CNRS, Laboratoire Communication et politique
Si les approches visant essentiellement à l’élaboration d’un modèle théorique de
l’argumentation adoptent bien souvent une perspective normative, visant, au-
delà de l’identification des mécanismes argumentatifs, à en proposer une
évaluation, les approches empiriques, cherchant avant tout à rendre compte de
l’inscription langagière de l’argumentation et de la dynamique des échanges
argumentatifs, ne peuvent pas non plus faire l’économie de la question des
normes en argumentation. Une part importante de l’activité argumentative
déployée par des locuteurs engagés dans des contextes de confrontation
d’opinions vise précisément à rapporter l’argumentation de leur adversaire à leur
conception, plus ou moins systématique, plus ou moins élaborée, de ce qu’est
une argumentation recevable – ou, plutôt, irrecevable : il s’agit le plus souvent
de disqualifier le discours de l’adversaire en lui opposant quelque chose
comme : « ce n’est pas un (bon) argument » - ou toute autre objection
constituant une des multiples déclinaisons de cette disqualification générique. La
question des normes est donc au cœur de toute approche de l’argumentation,
qu’elle adopte elle-même une perspective normative ou descriptive.
La présente contribution vise à illustrer ce qu’une approche descriptive de
l’argumentation peut avoir à dire de la question des normes argumentatives. Elle
s’inspire très largement de la proposition faite par Plantin (1995) de « voir dans
l’accusation de paralogisme non pas une sentence transcendant le débat dans
lequel se situe l’argumentation ainsi rejetée, mais comme un moment de ce
débat » (p.254), et de considérer que « le verdict ‘Argumentation invalide !’
n’est ni plus ni moins qu’un argument à reverser au dossier de la polémique »
(p.245). Prêtant attention aux procédés de réfutation observables dans les
interactions argumentatives, ainsi qu’au lexique ordinaire de l’argumentation (et
en particulier, aux termes désignant des procédés argumentatifs disqualifiés), je
proposerai quelques pistes pour mettre au jour les formes que peut prendre ce
qu’on peut appeler « la critique ordinaire de l’argumentation ».
Après avoir précisé la conception de l’argumentation qui sera développée ici, je
me permettrai un retour sur mon itinéraire de recherche pour suggérer comment
certaines données, associées à des questionnements de recherche, peuvent, dans
une certaine mesure, imposer une perspective descriptive sur la question des
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.2
normes argumentatives. Je proposerai enfin quelques études de cas illustrant
l’intérêt d’un tel programme de recherche1.
1. Préalables théoriques et méthodologiques
1.1. Définition de l’argumentation.
On considérera qu’au cœur même du fait argumentatif, il y a un mode
d’articulation bien particulier entre un discours et un contre-discours, chacun
traçant les contours de positions antagonistes ; on définira donc l'argumentation
comme un mode de construction du discours visant à le rendre plus résistant à
la contestation (Doury 2003 : 13).
L’existence d’un désaccord, d’une divergence d’opinions, plausible dans
l’univers de discours ou manifeste dans la situation de communication, constitue
une condition pour l’émergence d’une argumentation2 ; mais, si nécessaire
qu’elle soit, cette condition n’est pas suffisante. Il ne suffit donc pas qu’il y ait
confrontation d’opinions (“ moi, j’aime le music hall ” / “ moi, j’ai horreur de
ça ”) pour qu’il y ait argumentation ; encore faut-il qu’il y ait une
“ cristallisation du désaccord ”, pour reprendre les termes de Traverso (1999 :
76), cristallisation qui conduise les locuteurs à construire leurs positions et à les
soutenir par des propositions-arguments dont la relation à la conclusion
détermine des modes de réfutation spécifiques. L’argumentation suppose donc
un double mouvement de positionnement, et de justification (Micheli 2011).
L’avantage de cette définition, de mon point de vue, est double.
D’une part, elle permet de situer l’argumentation en dehors du paradigme de la
persuasion, paradigme massivement dominant dans les approches de
l’argumentation d’inspiration rhétorique, et fortement présent dans les
définitions de l’argumentation comme acte de langage3.
D’autre part, d’un point de vue méthodologique, cette définition fait la part belle
aux sciences du langage : elle invite à aborder le discours argumentatif avant
tout à partir de la façon dont s’y inscrit l’articulation du discours et du contre-
discours qui le fonde, et de mobiliser ainsi tant les outils forgés dans le cadre de
l’analyse du discours (notamment pour aborder les manifestations de
l’hétérogénéité énonciative) que les catégories de l’analyse des interactions. 1 On trouvera une version détaillée de ces études de cas dans Doury 2008, 2003 et 2009. 2 Qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas pour nous de nier que l’argumentation se déploie parfois dans une
situation de consensus, entre des interlocuteurs qui se réclament d’une position commune sur un sujet ; mais
c’est alors l’évocation d’une possible opposition, au-delà du cercle des interactants rassemblés par la discussion,
qui justifie l’entrée en argumentation (voir notamment la séquence analysée dans Doury 2011). 3 Pour une discussion de la relation entre argumentation et persuasion, et des propositions pour une définition
non persuasive de l’argumentation, voir le numéro 26-1 de la revue Argumentation (G. Roque, éd.).
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.3
Enfin, l’introduction du contre-discours (par le biais de la contestation) dans la
définition même de l’argumentation est en parfaite adéquation avec la
perspective qu’on va développer ici sur la question des normes en
argumentation.
1.2. La position du chercheur en argumentation
Quelques mots à présent sur le choix qui s’offre au chercheur en argumentation
entre une perspective normative et une perspective descriptive.
1.2.1. Approches normatives / approches descriptives
En forçant un peu le trait, on peut dire que les approches normatives de
l’argumentation cherchent centralement à répondre à la question : « qu’est-ce
qu’une bonne argumentation ? ». Elles cherchent ainsi à construire des modèles
explicitant les critères et les procédures qui seront mobilisés pour évaluer ainsi
les argumentations effectives. Ces critères peuvent être de nature logique,
éthique, interactionnels, et les modèles peuvent intégrer des normes
« hybrides », la cohérence étant assurée par l’objectif prêté à l’activité
argumentative. Ainsi, dans le modèle pragma-dialectique (Eemeren &
Grootendorst, 2004), c’est parce qu’elles concourent au succès d’une discussion
critique que les normes définies par le modèle sont cohérentes d’un point de vue
théorique, et acceptables du point de vue des interactants.
Les approches descriptives, quant à elles, visent, à la façon des sciences du
langage au sein desquelles elles s’inscrivent souvent, à rendre compte des
procédés discursifs et interactionnels mobilisés par des locuteurs amenés à gérer
de façon langagière des divergences d’opinions.
L’adoption d’une perspective plutôt que d’une autre peut être liée à des
trajectoires intellectuelles, institutionnelles, disciplinaires spécifiques ; elle peut
être aussi, dans une certaine mesure, dictée par les données argumentatives dont
on se propose de rendre compte, et par les objectifs de recherche que l’on se
donne. C’est ce que cherche à illustrer le développement qui suit, qui évoque
l’évolution de mon propre positionnement, d’une perspective a priori évaluative
sur l’argumentation, à une approche descriptive. J’espère ainsi montrer que le
choix entre approche normative et approche descriptive est une décision
radicale, qui entraîne avec elle quantité de conséquences en termes de
constitution du corpus, choix des outils d’analyse et détermination des questions
de recherche.
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.4
1.2.2. De « l’image de la science dans le discours des pseudo-sciences » à
« l’analyse du débat autour des ‘parasciences’ » : d’une approche
évaluative à une approche descriptive
Je vais donc évoquer brièvement les divers avatars de ce qui a constitué mon
travail de doctorat4, au cours duquel s’est esquissée une position que je travaille
toujours à affiner : l’analyse de l’argumentation autour des « parasciences » (les
parasciences étant un conglomérat de disciplines et pratiques au statut
problématique, parmi lesquelles, l’astrologie, la parapsychologie, l’ufologie, les
médecines dites parallèles, etc.).
Le projet de recherche initial était de rendre compte de la façon dont la science
était utilisée comme caution par un certain nombre de disciplines que j’appelais
alors « pseudo-sciences » ; j’ai ainsi élaboré un mémoire de recherche intitulé
« l’image de la science dans le discours des pseudo-sciences », prenant pour
objet « le discours des pseudo-sciences », et mobilisant ce que je qualifierais
aujourd’hui d’analyse critique sauvage – c’est-à-dire d’analyse cherchant à
évaluer les arguments présents dans le corpus étudié sans pour autant disposer
de critères d’évaluation explicites et « faisant système ».
Dans ce cadre, j’ai été amenée à lire différents ouvrages, et en particulier, des
livres écrits par des rationalistes militant contre les pseudo-sciences, et qui, dans
le cadre de leur démarche de dénonciation, se livraient à une forme de critique
de l’argumentation des partisans de ces disciplines – critique souvent
extrêmement élaborée, et qui témoignait d’une certaine culture des théories de
l’argumentation.
Dans une large mesure, les analyses que j’avais moi-même produites entraient
en résonance avec leurs travaux. Or, une telle convergence a commencé à poser
problème quand je me suis aperçue que ces discours rationalistes, loin de
constituer un « extérieur » par rapport au discours parascientifique, participaient
en fait d’un même objet – qu’on pourrait appeler le débat sur les para- ou
pseudo-sciences -, et que le discours parascientifique, pas plus que le discours
rationaliste, ne pouvaient être étudiés isolément, autrement que comme des
discours polémiques entrant dans un débat contradictoire.
Les travaux des auteurs rationalistes, que j’avais dans un premier temps
considérés comme des béquilles de l’analyse, étaient en réalité à verser dans
l’objet même de l’analyse argumentative, qui devenait du coup non plus « le
discours des parasciences », mais « le débat sur les parasciences », intégrant
discours « pour » et discours « contre ».
Pour éviter d’être entraînée moi-même dans cet élargissement de l’objet, il me
fallait, du coup, redéfinir ma propre position – et, d’une certaine façon, cette
redéfinition du « terrain » a entraîné du même coup, et quasi automatiquement,
4 Recherche menée au sein du GRIC (Groupe de Recherches sur les Interactions Communicatives, CNRS /
Université Lumière-Lyon 2, sous la direction de Christian Plantin, et soutenue en 1994.
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.5
une redéfinition de la démarche d’analyse : je suis passée d’une démarche
d’analyse critique et évaluative de l’argumentation, proche de celle des
rationalistes que je viens d’évoquer, à une démarche essentiellement descriptive,
visant à décrire les mécanismes de l’affrontement du discours et du contre-
discours dans une controverse particulière : celle autour des pseudosciences, en
essayant de ne jamais me prononcer en tant qu’analyste sur la question de savoir
qui, sur le fond, avait tort ou avait raison.
Ce que je voudrais retenir de ce petit récit autobiographique, c’est
que l’adoption d’une perspective normative en argumentation fait courir le
risque de rabattre la position de l’analyste sur celles des acteurs du débat.
L’analyste en vient à tenir un discours « de même nature » (quoiqu’un peu plus
systématique et plus savant) que l’un des camps en présence. Que l’analyse
savante d’un débat puisse toujours, au bout du compte, être considérée comme
un élément à ajouter au débat, pourquoi pas ; mais rien n’exige que l’analyste
constitue un acteur du débat au même titre que les autres acteurs.
1.2.3. Une perspective descriptive sur la question des normes
argumentatives
Cette prise de position pour une approche résolument descriptive de
l’argumentation n’implique pas, on l’a dit en introduction, de considérer que
l’activité d’évaluation des arguments – et la notion de norme argumentative qui
la sous-tend – est hors du champ d’investigation d’une étude de l’argumentation
ainsi conçue. En effet, l’observation de discours argumentés fait apparaître que
cette activité de critique de l’argumentation – associée le plus souvent à des
mouvements de réfutation du contre-discours – est essentielle pour les locuteurs
engagés dans la défense d’une thèse. Sans arrêt, les locuteurs qui argumentent
produisent des commentaires du type « ton argument ne tient pas », « c’est un
argument facile », voire « ce n’est pas un argument », ou des commentaires plus
spécifiques, associant catégorisation et évaluation, comme :
- « ça, c’est un amalgame » (énoncé qui permet de contester un rapprochement
comme abusif),
- « il ne faut pas généraliser » (énoncé qui permet de rejeter une argumentation
inductive), ou
- « il n’y a pas de rapport » (énoncé qui permet de rejeter une argumentation
pour cause de « non pertinence »).
Force est de constater que l’évaluation de l’argumentation, avant d’être prise en
charge par un éventuel analyste adepte d’une approche normative de
l’argumentation, est assurée par les argumentateurs eux-mêmes. La question
« cette argumentation est-elle acceptable / bonne / logique / valide ? » se pose en
premier lieu aux locuteurs engagés dans une interaction argumentative, et
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.6
confrontés à des arguments qu’ils doivent comprendre, évaluer, et
éventuellement accepter ou rejeter sur la base de cette évaluation.
Il s’agit alors, pour un analyste descriptif, prêt à abandonner aux locuteurs
l’examen critique des arguments, de chercher à dégager les normes qui sous-
tendent les argumentations « en action ». Ce qui amène à la deuxième partie de
cet article, au cours duquel on montrera, à partir de différentes études de cas,
comment on peut dégager quelques normes argumentatives qui sous-tendent les
argumentations ordinaires à travers l’observation des stratégies de
réfutation menées par les locuteurs ordinaires engagés dans la défense d’un
point de vue et la critique d’un point de vue adverse, et, en particulier, à travers
l’observation des commentaires méta-argumentatifs qui sont souvent produits en
contexte réfutatif.
Il s’agit, dans une certaine mesure, de faire la place, dans le champ de
l’argumentation, à un équivalent de la folk-linguistique, ou linguistique
populaire, définie comme un « ensemble de pratiques linguistiques profanes
reposant sur une conception perceptive de la norme, et produisant trois types de
discours sur la langue (…) :
- des descriptions et (pré)théorisations linguistiques des règles de
fonctionnement de la langue (…) ;
- des prescriptions concernant les usages (…)
- des interventions spontanées sur la langue, le plus souvent régularisantes
(émotionner, aller au coiffeur, malgré que, etc.) (…).
Pour récapituler, la linguistique populaire se constituerait de trois types de
pratiques profanes à dimension perceptive : descriptions, prescriptions,
interventions. » (Paveau 2008 : 100)
Si l’intérêt pour les représentations ordinaires de l’argumentation est clairement
marginal dans l’ensemble des travaux sur l’argumentation, qu’ils soient en
langue anglaise ou en langue française, il est cependant sensible chez certains
auteurs. Ainsi, Plantin affirme vigoureusement, depuis ses premiers travaux, la
nécessité de prendre en compte les représentations ordinaires de l’argumentation
dans l’élaboration des conceptualisations savantes du domaine :
« On en vient toujours à l’argumentation avec un savoir substantiel de “ce
qu’est” l’argumentation. Ce savoir commun doit être mis en question et
problématisé. Ce n’est qu’à cette condition qu’il sera possible de construire des
éléments de connaissance sur certaines formes d’argumentation. » (Plantin,
1996 : 16).
Dans le champ anglo-saxon, des auteurs comme Craig (1996, 1999, 2011, Craig
& Tracy 2005) ou Goodwin (2007) invitent eux aussi l’analyste à faire dialoguer
les théories « savantes » de l’argumentation avec les théories décelables dans les
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.7
pratiques argumentatives elles-mêmes ; le rapprochement avec la perspective
développée par Plantin est frappante, même si Craig et Goodwin maintiennent
une perspective normative (puisqu’il s’agit pour eux, au bout du compte, de
travailler à « améliorer » les pratiques argumentatives ordinaires).
L’intérêt pour les conceptualisations ordinaires de l’argumentation peut passer
par une investigation lexicale : il s’agit alors d’étudier les mots de
l’argumentation – ce que Plantin appelle « le discours de la preuve », et qu’il
parcourt systématiquement, des substantifs (argument, preuve, raison) aux
verbes (démontrer, argumenter, prouver, raisonner) (2005 : 80-86 ; voir aussi
Plantin, 2010). Des études similaires ont été menées sur le champ lexical de
l’argumentation en anglais (voir notamment les travaux de Billig 1987, ou la
distinction désormais classique entre argument_1 et argument_2 chez O’Keefe
1977, 1982 sur le sens de argument en anglais).
On a montré ailleurs (Doury 2008) qu’en dehors de ces considérations
lexicologiques sur le sens de ces termes « en langue », l’observation, dans des
discours ordinaires, de négociations portant sur le sens du mot argument donne
un accès particulièrement riche aux représentations que les locuteurs se font de
cette activité5.
2. Définitions négatives de l’argumentation : « Ce n’est pas un argument ! »
Afin d’illustrer la proposition d’une approche descriptive de la question des
normes argumentatives, la première entrée dans l’univers de ce qu’on peut
appeler la « police argumentative ordinaire » qui sera proposée ici est
l’expression « ce n’est pas un argument », et sa variante, « ça n’a pas valeur
d’argument ».
Le jugement « ce n’est pas un argument », qui n’a rien d’exceptionnel (en
particulier en contexte polémique) est d’autant plus intriguant, pour le chercheur
en argumentation, qu’il vise le plus souvent un énoncé qui constitue, pour lui,
justement, un argument – bon ou mauvais, mais un argument quand même.
Pourtant, pris littéralement, il prétend tracer la ligne entre ce qui relève du
champ de l’argumentation et ce qui en est exclu – et esquisse donc les contours
du champ de l’argumentation pour le locuteur qui l’énonce.
En observant les occurrences de « ce n’est pas un argument » en contexte, on a
cherché à élucider en particulier deux questions :
- Qu’est-ce qui est ainsi exclu du champ de l’argumentation ? (à quoi
renvoie le « ce » de « ce n’est pas un argument » ?
5 Voir aussi, sur des données en anglais, les travaux menés par Goodwin (2007), mobilisant les outils de la
linguistique de corpus pour dégager le sens du mot « argument », de ses dérivés et de ses comparables sur un
large corpus de débats portant sur la position des Etats-Unis lors de la première guerre du Golfe.
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.8
- Quelles sont les justifications données de cette exclusion ? (sur quelles
bases est-ce que le locuteur décide qu’un énoncé constitue, ou non, un
argument ?)
La profération de jugements de ce type témoigne du degré maximal de
normativité que peuvent atteindre les conceptions spontanées de
l’argumentation ; ils ont un fonctionnement similaires à « ça, c’est pas
français » ou « ça, ça ne se dit pas », énoncés pointés par des travaux sur la
linguistique populaire, et qui renvoient ce qui vient d’être proféré non plus
simplement hors du champ de l’argumentation, mais hors du champ du langage
même (entendez, « du langage correct »).
2.1. Les paralogismes ne sont « pas des arguments »
On accède aux représentations que se font les locuteurs de ce qu’est
l’argumentation (ou, plus précisément, de ce qu’est la bonne argumentation)
lorsque l’expression « c’est pas un argument » introduit une réfutation « méta »,
qui porte sur le schème argumentatif qui vient d’être utilisé.
Dans la plupart des cas, le schème argumentatif ainsi rejeté appartient à la liste
des types d’arguments critiqués par les logiciens, épistémologues, ou théoriciens
normatifs de l’argumentation.
Argument du nombre
C’est ainsi le cas de l’argument du nombre dans cette interview de Nicolas
Hulot, au cours de laquelle il déplore que les politiques assouplissent la
législation sur les cultures OGM sous l’influence des positions dominantes dans
le monde sur le sujet :
« Tout le monde le fait » n'est pas un argument, l'erreur commune n'est pas
une vérité. »
Argument d’autorité
C’est aussi le cas de l’argument d’autorité : le fait d’invoquer un tiers comme
garant d’une proposition est opposé à l’invocation de données factuelles, qui
seules seraient dignes du statut d’argument67
:
Et pour info, citer sarkozy a chacune de tes interventions se n'est pas un
argument... un argument c'est répondre a une chose par des faits concrets qui
se sont passé !
6 7 http://www.dailymotion.com/video/x5jzig_segolene-royal-dimanche-25-mai-2008_news, message de
jeremove, fin mai 2008.
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.9
Argument par l’ignorance
Est encore ainsi rejeté hors du champ de l’argumentation un autre paralogisme
« classique », l’argumentum ad ignorantiam, qui, de l’incapacité de l’adversaire
à prouver la vérité de p, conclut à la vérité de non-p. L’exemple est tiré d’un
forum consacré à l’astrophysique, Benoit.d réagit au propos d’un internaute, qui,
du fait que selon lui, « Il n’y a aucune raison pour que la masse fasse exception
au changement de signe », conclut que « la masse ne fait pas exception au
changement de signe », par le commentaire méta-argumentatif suivant8 :
AMHA, l'absence d'argument contre une idée n'est pas un argument
significatif pour valoriser l'idée ;)
Pétition de principe
Certains commentaires méta-argumentatifs reflètent également ce que Plantin
(2002) pointe dans de nombreuses approches normatives de l’argumentation :
une défiance systématique vis-à-vis du langage naturel, en raison notamment de
son manque d’univocité, de sa subjectivité. Cette défiance se traduit notamment
par des mises en garde contre l’emploi de certains mots « chargés » en raison de
leur incapacité à fonctionner de façon neutre dans le débat. Ainsi, dans une
discussion sur l’euthanasie, ben_ouah demande à son interlocuteur d’éviter de
défendre le droit à l’euthanasie au nom de la dignité humaine :
Ce sujet sera certes encore débattu dans le futur, et d'ailleurs cette
commission le préconisait. Mais de grâce ne prenons pas des mots pour
des arguments, et n'essayons pas de monopoliser ce mot de dignité. Tout
le monde est pour la dignité.
Arguments ad hominem
Autre schème argumentatif dont la légitimité est contestée par les locuteurs
ordinaires : les procédés relevant de la réfutation ad hominem, dans ses variantes
offensante, circonstantielle ou tu quoque, sont parfois disqualifiés. Ainsi, dans le
forum satirique consacré à Nicolas Sarkozy, une discussion se développe autour
de l’assertion « la taille de Nicolas Sarkozy n’est pas un argument ». Utiliser la
petite taille de Nicolas Sarkozy comme moyen de le discréditer comme homme
politique relève de l’argument ad hominem offensant, et est rejeté comme
indigne du débat politique.
Chacun aura reconnu, dans les extraits proposés, des illustrations de schèmes
argumentatifs identifiés comme des paralogismes (c’est-à-dire des arguments
fallacieux) par les théoriciens normatifs de l’argumentation.
8 Fr.sci.astrophysique, message de Benoit.d, 4 mai 2008.
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.10
2.2. Certains genres ne sont pas argumentatifs
Plus rarement, c’est l’appartenance de l’énoncé à un genre présenté comme
distinct du registre de l’argumentation qui est invoquée pour justifier son
exclusion. C’est ce qu’on observe dans l’exemple qui suit. Le message reproduit
fait suite à une prise de position de Bosco, selon laquelle faire des enfants est
une manifestation d’égoïsme, et qui s’appuie sur une chanson de Henri Tachan.
La réaction de Declairvaux33 est immédiate :
"ouehhhh cette chanson, elle fait passer un message !"
il n'empêche qu'une chanson n'est pas un argument. C'est comme les
"putain", les insultes, ou les répétitions d'une même formule incantatoire,
cela ne permet pas de persuader.
Après avoir caricaturé le raisonnement prêté à Bosco (« ouehhh cette
chanson… »), il associe le recours à une chanson comme argument à d’autres
procédés discursifs faisant, eux, l’objet d’un ostracisme clair (« putain »,
insultes, « répétitions d’une même formule incantatoire »), afin d’opérer un
discrédit par contagion. Enfin, le recours à une chanson ayant été dénoncé en
tant que tel, Declairvaux se livre à une critique de l’invocation de cette chanson
en particulier, sous l’angle de sa qualité littéraire (« rien que sur le plan
poétique, cette strophe est assez minable ») aussi bien que du contenu qu’elle
véhicule.
De façon similaire, l’inscription dans un registre religieux est vue comme
antagoniste avec une argumentation rationnelle, comme le suggère la réaction de
Nicolas George à la réflexion d’un intervenant suggérant, à propos du mot
« libre » dans l’expression « logiciel libre », qu’ « il faut s’efforcer de la [la
liberté] minimiser »9 :
« Il faut » tout court ne veut rien dire. « Il faut » toujours en vue d'un
objectif. Une phrase qui contient « il faut » sans le mot « pour » un peu plus
loin, comme la tienne, est une phrase de nature religieuse, pas un argument
rationnel.
2.3. « Ça n’a pas valeur d’argument »
Passons maintenant à l’examen d’une variante de « c’est pas un argument » :
« ça n’a pas valeur d’argument ».
9 Fr.comp.os.linux.debats, message de Nicolas George, 5 mai 2008.
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.11
Les procédés discursifs dont la valeur probante se trouve mise en cause par
l’expression « ça n’a pas valeur d’argument » sont (en dehors de ceux que l’on
vient d’identifier grâce à l’expression « c’est pas un argument ») :
Le recours à la force :
Chez eux la sympathie se mérite et le coup de trique n'a pas valeur
d'argument.
Les réactions émotionnelles ayant valeur évaluative :
Au soir du premier tour, un journaliste demande à marine Lepen si le FN est
mort, ce a quoi, elle répond bien évidemment: "pas du tout, en tout cas, ses
idées ont gagnées..." Perso, ça me glace le sang... mais j'en convient, ça
n'a pas valeur d'argument.
Des énoncés relevant de régimes discursifs non démonstratifs :
Une description littéraire n'ayant pas valeur d'argument, je laisse de côté
le récit, dû à la plume du petit poétaillon-branleur Mehdi Belhaj Kacem, de
l'assassinat d'une « connasse », paru dans le n° 5, décembre 1992, p. 37-38.
http://www.teleologie.org/OT/textes/txtmando2.html
Mais les procédés qui se voient le plus souvent déniés toute valeur
d’argument sont les procédés inductifs, catégorisés comme « exemples »,
« anecdotes » ou « expérience (personnelle ») :
Ce ne sont que deux exemples. Ils n'ont pas valeur d'argument.
http://unsibeaubordel.blogspot.com/2006/01/pedro-pauleta.html
Un tel rejet peut faire l’objet d’une élaboration méta-argumentative, qui spécifie
les normes au regard desquelles la valeur probante de l’énoncé est contestée.
Ainsi, dans l’énoncé suivant,
Le vécu, et l'expérience personnelle n'ont pas valeur d'arguments car ils ne
sont pas universels et ne permettent donc pas de faire avancer le débat.
http://www.digital-broadcast-
channel.com/forums/index.php?showtopic=2118&st=36
(fil de discussion « qu’est-ce qu’un artiste »)
c’est bien l’impossibilité de tirer des conclusions générales à partir d’énoncés
particuliers qui est pointée du doigt : pour le locuteur à l’origine de cette
assertion, l’argumentation ne peut avoir de valeur purement locale.
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.12
Ces quelques observations, très partielles, à partir des entrées « ce n’est pas un
argument » et « ça n’a pas valeur d’argument », suggèrent une forte proximité
entre les représentations ordinaires et certaines conceptions expertes de
l’argumentation – en particulier, les approches normatives. L’argumentation y
apparaît comme une activité rationnelle (supposant une forme de suspension des
émotions), alternative au recours à la force. Elle est vue comme impliquant un
minimum de généralité : tout procédé d’étayage jugé trop spécifique (induction),
ou trop étroitement associé à la personne, court le risque de se voir renvoyé hors
du champ de l’argumentation.
Cette proximité n’invalide en aucune façon les approches normatives de
l’argumentation ; elle constitue en revanche un argument fort en faveur de
l’introduction d’une importante composante descriptive dans ces perspectives à
visée prescriptive, afin de systématiser un dialogue entre les pratiques effectives
et les représentations de l’argumentation qui les sous-tendent, et l’élaboration
d’un modèle idéal de la discussion argumentée. Seul un tel dialogue peut
permettre d’éviter d’écraser la position de l’analyste normatif sur celle des
argumenteurs ordinaires.
Après cet aperçu des traits prêtés à l’argumentation de façon générale, et de la
dimension normative de la compétence argumentative qu’il met au jour, on
s’arrêtera sur la façon dont certains procédés argumentatifs spécifiques sont
catégorisés et évalués par les locuteurs ordinaires. On se focalisera sur deux
procédés qui mettent en jeu des mécanismes dont on vient de voir qu’ils étaient
souvent considérés comme problématiques et, partant, sont dénoncés comme des
« scandales argumentatifs » par les locuteurs ordinaires : l’amalgame, qui
renvoie souvent une argumentation mobilisant un lien analogique, et le procès
d’intention, qui conteste la légitimité d’une argumentation établissant un lien
entre l’acte et la personne.
3. Le cas de l’accusation d’amalgame.
On a procédé, pour le cas de l’accusation d’amalgame, de la même façon que
pour l’expression « c’est pas un argument » : on s’est intéressé aux moments où,
dans des séquences argumentatives10
, un locuteur identifie l’argument de son
adversaire comme un amalgame, l’objectif étant, une fois encore, de montrer
10
Ces séquences sont tirées de matériaux divers : conversations quotidiennes, presse écrite,
débats télévisés, forums de discussion sur Internet...
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.13
comment on peut étudier les normes argumentatives “ à l’ouvrage ” dans des
discours argumentés, et d’ouvrir la voie d’un questionnement sur l’articulation
entre normes spontanées et normes savantes en argumentation.
3.1. L’amalgame comme catégorie d’analyse savante
Le terme amalgame, comme catégorie d’analyse savante, ne fait pas partie des
termes pivots du lexique de l’argumentation. Lorsqu’il apparaît dans les travaux
du champ, amalgame est le plus souvent défini comme un rapprochement
illégitime. C’est le cas notamment chez J.-J. Robrieux (1993) qui, dans un
chapitre consacré aux “limites de l’argumentation”, en propose la définition
suivante : « vice de raisonnement, volontaire ou non, qui cause de l’embarras à
ceux qui se laissent priver d’un choix sous prétexte qu’on leur impose un
ensemble pré-constitué à prendre ou à laisser » (p.125).
Dans le même ordre d’idée, P. Oléron (1987) oppose aux rapprochements
effectués sur des bases rationnelles (ex. : liaison acte/personne), les
rapprochements de type associatif, qui jouent davantage sur les charges
affectives que sur les liens logiques – rapprochements au nombre desquels il
compte l’amalgame, qui « présente comme lié, participant d’une même nature,
ce qui peut ne comporter qu’une ressemblance ou des liens superficiels ou
accidentels » (p.101).
E. Koren (1995), quant à elle, restreint l’amalgame à un type particulier de
rapprochement : l’analogie – et, plus précisément, à sa forme « pervertie ». Elle
considère qu’il y a amalgame dès lors qu’une analogie fait fi des différences
distinguant le phore du thème au point de poser une équivalence entre eux : de A
est à B ce que C est à D, on passe à A, c’est C (1995 : 544).
3.2. Le mot amalgame dans les argumentations ordinaires
Dès que l’on s’intéresse au mot amalgame11
comme catégorie spontanée des
locuteurs-argumentateurs, on ne peut manquer d’être frappé par sa fréquence
dans des contextes argumentatifs variés, et le rôle pivot qu’il y joue.
La dimension axiologique associée au mot amalgame, quand il renvoie à des
faits de discours, apparaît dès l’examen des qualifications dont il fait l’objet
(adjectifs dépréciatifs en position d’épithète ou d’attribut). Un amalgame peut
ainsi être :
- épistémiquement critiquable : sans fondement, douteux, mauvais
11 On ne s’intéressera ici qu’aux cas où amalgame renvoie à du discours, et on ne tiendra donc pas compte de
l’« amalgame dentaire », ou de l’amalgame au sens de « synthèse réussie entre différentes composantes » (ainsi,
la femme des années quatre-vingts qui, selon le chanteur français Michel Sardou, aurait « réussi l’amalgame de
l’autorité et du charme »).
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.14
- éthiquement critiquable : pas juste / injuste, scandaleux, intolérable /
pas tolérable
- excessivement simplificateur : grossier, réducteur, super-gros,
manichéen, facile
- critiquable au regard de ses conséquences : dangereux, fâcheux.
Les constructions verbales autour d’amalgame témoignent d’une même
orientation négative, puisqu’il s’agit de récuser tout amalgame, éviter
l’amalgame, empêcher un amalgame, condamner les amalgames, craindre
l’amalgame, accuser d’amalgame, hurler à l’amalgame, refuser un amalgame,
dénoncer un amalgame. En revanche, on ne trouve jamais d’expressions comme
« se réclamer d’un amalgame », « revendiquer un amalgame »…
Le mot « amalgame » entre souvent dans des énoncés déontiques, qui édictent
les règles de la bonne conduite argumentative :
Il faut, par ailleurs, se garder des amalgames
Il faut se retenir de faire l'amalgame.
Il faut éviter les amalgames
Ne pas faire d'amalgame !
Je ne crois pas qu’il faille faire l’amalgame.
On peut pas faire l’amalgame
Surtout, il ne faut pas faire d'amalgame entre...
je voudrais pas que vous fassiez l'amalgame
il faut pas amalgamer...
Faut pas non plus faire un amalgame
Non à l’amalgame
Pas d’amalgame !
De tels énoncés, en contexte polémique, peuvent être vus aussi bien comme de
simples mises en garde – c’est ainsi qu’ils se présentent – que comme des
anticipations sur de possibles accusations d’amalgame ou comme des
accusations d’amalgame adoucies ; ils tiennent alors parfois de la dénégation.
D’autres énoncés (non déontiques) réalisent des accusations d’amalgames,
comme dans les exemples suivants :
Belilan tu fais encore des amalgames douteux. [Forum Libération, “ Israël
va-t-il perdre la guerre ? ”, 16 mai 2002]
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.15
Vous faites-là un amalgame scandaleux que je ne peux laisser passer.
[Forum Libération, “ Vaincre le terrorisme ”, 12 novembre 2002]
3.3. A quoi renvoie l’accusation d’amalgame ?
L’observation des occurrences de l’accusation d’amalgame suggère qu’elle peut
s’appliquer à des mécanismes discursifs très divers.
L’examen des séquences qui constituent nos données met au jour deux grandes
familles de procédés argumentatifs qui sont qualifiés d’amalgames en contexte
polémique.
3.3.1. Association de deux objets X et Y sur la base de propriétés présentées comme communes et significatives
L’accusation d’amalgame peut être déclenchée par :
- un parallèle ou une comparaison entre deux objets X et Y :
L’exemple suivant est tiré d’un débat télévisé sur l’astrologie. L’astrologue, ET,
est opposée à DB, astronome, qui rejette le principe même de l’influence astrale,
et conclut à l’inanité de l’astrologie :
ET: Vous savez qui vous me rappelez?
DB: Peu m'importe, peu m'importe.
ET: Lord Kelvin qui au début du XXe siècle disait “l'aviation n'existe pas,
on ne pourra jamais voler parce que le métal est plus lourd que l'air ;
voilà ce que vous me rappelez.
DB: Nous sommes au XXe siècle, non non non non, rien à voir, c'est un
amalgame. C'est un amalgame, vous faites des amalgames
extrêmement savants et ces amalgames, je veux les dénoncer parce
que ça c'est scandaleux.
ET: Mais si ! et Galilée, alors ? et Galilée ? alors…[“ Duel sur la Cinq ”
sur l’astrologie, La Cinq, 6 juin 1988]
Ici, l’astrologue argumente par le précédent. Elle établit un parallèle entre la
position de Lord Kelvin sur l’aviation au début du siècle, et la position de DB
sur l’astrologie aujourd’hui. Ce parallèle repose sur certaines caractéristiques
partagées par les deux situations, caractéristiques laissées implicites.
L’astrologue cherche à transférer le jugement relatif à la situation de référence à
la situation actuelle, à savoir : Lord Kelvin a manqué de clairvoyance, Lord
Kelvin a eu tort – et il en est de même pour DB. Ce parallèle est rejeté par
l’astronome comme un “amalgame scandaleux”. L’accusation d’amalgame est
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.16
étayée par l’explicitation d’une différence présentée comme décisive : “nous
sommes au vingtième siècle”12
. L’astrologue persiste dans sa stratégie et
propose une comparaison avec une nouvelle figure de référence : Galilée. Le
second parallèle établit un lien entre l’Inquisition et l’héliocentrisme d’un côté,
et DB et l’astrologie de l’autre.
L’accusation d’amalgame peut être encore portée contre :
- une proposition généralisante rejetée comme généralisation abusive :
C’est du moins ainsi que F1 comprend l’accusation d’amalgame portée contre
elle par C dans la séquence ci-dessous. F1 est une cliente d’un magasin de
presse ; elle discute avec C, le commerçant, et défend la thèse que “ le
gouvernement a peur des noirs ” et qu’“ on leur donne tout ”. F2 est une cliente,
témoin de l’échange :
F1 : Mais eux ils leur filent tout…
F2 : C’est pas vrai, on leur file pas tout.
F1 : Vous savez pas ce que m’a dit mon amie ? mon amie, vous m’avez
déjà vue avec elle, non ?
C : Oui
F1 : Elle, elle habite Aulnay-sous-bois, et y a des… y a des tours là-bas
c’est très populaire ; et bien euh y a une dame qui avait beaucoup
d’enfants et qui habitait un HLM, et comme maintenant elle reste
avec un seul fils dedans et ben vous savez pas ce qu’ils font ? i v- ils
lui ont dit “ madame on va vous donner un appartement plus petit
maintenant que vous avez plus qu’un enfant ”
C : Ben oui !
F1 : “ Parce que maintenant on va loger, il faut qu’on loge des émigrés des
familles nombreuses ”
C : C’est logique
F1 : C’est sûr que là, la révolte gronde, hein.
C : Non mais attendez, non mais attendez attendez, là y a une amalgame
là, je comprends pas ; si si si elle a qu’un enfant elle va pas garder un
F5 ou un F6 pour UN enfant ! Faut pas non plus faire un amalgame
F1 : Non elle a peut-être pas… elle a peut-être pas… non mais écoute
arrête, me fais pas la morale
C : Je te fais PAS de la morale
F1 : Parce que je généralise pas ! mais… non mais ça devient inquiéTANT !
Dans cet exemple, la locutrice F1 étaye la thèse “ le gouvernement a peur des
noirs, on leur donne tout ” par une argumentation par l’exemple. Elle considère
12 Si l’on comprend ainsi l’intervention de DB (et c’est la seule interprétation plausible à notre disposition), il
faut entendre : “ nous sommes à la fin du XXème siècle ”, afin de rétablir le contraste avec la mention “ au début
du XXème siècle ” produite par ET.
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.17
donc que l’anecdote qu’elle raconte est un cas particulier susceptible de fonder
la loi générale. Lorsque C l’accuse de pratiquer l’amalgame, c’est le lien entre le
cas particulier et la règle générale qu’il conteste ; pour lui, le cas évoqué est
“ normal ”, et n’illustre pas la lâcheté supposée des autorités face aux immigrés.
F1, elle, prend l’accusation d’amalgame portée contre elle comme une
contestation de la généralisation à laquelle elle se livre (“ parce que je généralise
pas ! ”) ; se confrontent donc deux acceptions distinctes du terme amalgame, qui
désigne, pour C, le choix d’un cas particulier qui échoue à illustrer le principe
général qui fait l’objet de l’argumentation ; pour F1, une généralisation abusive
à partir d’un cas particulier.
On soulignera enfin l’échange “ me fais pas la morale ” / “ je te fais pas la
morale ”, qui témoigne que pour ces locuteurs, l’accusation d’amalgame a aussi
une dimension éthique : c’est pourquoi on a considéré que l’accusation
d’amalgame entrait dans les dénonciations des « scandales argumentatifs »
menées par les locuteurs ordinaires en contexte polémique.
La deuxième famille de procédés identifiés comme des amalgames repose sur :
3.3.2. L’établissement d’un lien entre deux objets X et Y sur la base d’une relation de dépendance entre X et Y.
Le plus souvent, l’accusation d’amalgame concerne une relation causale
dénoncée comme erronée. Dans l’exemple qui suit, le mot amalgame est dirigé
contre l’affirmation selon laquelle il existe une relation de cause à effet entre le
piratage musical sur Internet et la baisse des ventes de CD. L’interviewée étaye
cette accusation d’amalgame en proposant des causes alternatives (“ A mon avis
[...] l'arrivée de nouveaux acteurs ”).
mercredi 5 décembre 2001, 16h45 (Dépêche AFP):
01net.: A combien évaluez-vous les pertes financières causées par le
piratage de la musique?
Catherine Kerr-Vignale (Sacem): Nous ne pouvons chiffrer précisément les
pertes de l'industrie du disque imputables au piratage. Cependant, l'Ifpi
(l'industrie phonographique) donne des chiffres que l'on peut analyser
comme une tendance. Surtout, il ne faut pas faire d'amalgame entre
l'utilisation d'Internet et la baisse des ventes de CD dans le monde. Ce n'est
pas parce qu'un internaute va télécharger illégalement de la musique qu'il
n'achètera pas le CD du chanteur ensuite. En fait, on ne sait pas réellement
à quoi cette baisse est due. A mon avis, c'est un ensemble de facteurs
comme le piratage, peut-être la mauvaise qualité des directeurs artistiques
ou la concentration des majors qui ne favorise pas l'arrivée de nouveaux
acteurs.
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.18
L’exemple suivant, relevé sur le vif lors d’une conversation portant sur une
femme en cours de divorce et suspectée de négliger ses enfants, entre encore
dans cette catégorie :
Attention, c’est pas parce qu’elle leur fait manger des chips et du poisson
pané que c’est une mauvaise mère, il faut pas amalgamer...
Ici, c’est une relation non plus causale, mais indicielle, qui est contestée par
l’accusation d’amalgame (une alimentation à base de chips et de poisson pané ne
constitue pas un indice suffisant pour conclure au manquement au devoir
maternel).
3.3.3. Le “vidage sémantique” de l’accusation d’amalgame
Par ailleurs, il arrive que l’analyste se révèle incapable d’identifier un
événement de discours précis susceptible de déclencher l’accusation
d’amalgame, et qui correspondrait à une des catégories repérées précédemment.
Dans de tels cas, l’accusation d’amalgame semble se réduire à “je n’accepte pas
votre argument”, quel que soit ledit argument.
C’est ce que suggère l’extrait suivant, issu du même débat télévisé que
précédemment. Selon l’astrologue ET, au cours d’un dîner, l’astrophysicien
Hubert Reeves aurait admis ne pas exclure l’hypothèse astrologique.
L’astronome DB conteste cette affirmation :
(23) DB: Il n'a jamais dit ça
ET: Mais vous étiez là? vous étiez dans ce déjeuner?
DB: Mais lui il me l'a dit, il me l'a confirmé; voilà le genre d'amalgame
que je dénonce. C'est scandaleux de dire des choses comme ça.
Ici, l’identification de ce qui déclenche l’accusation d’amalgame ne fait guère de
doute : c’est la négociation de la position d’Hubert Reeves sur l’astrologie.
Pourtant, la signification de amalgame, dans cette séquence, est obscure – sinon
une évaluation morale du type : “ce que vous dites là est scandaleux”.
En bref, l’examen de diverses occurrences d’accusation d’amalgame dans des
discours argumentatifs montre que l’on a affaire ici à une réfutation méta-
argumentative “à spectre large ”, dont la définition serait :
A affirme que B a établi un rapprochement indu entre X et Y.
B l’a fait sur la base d’une ressemblance, ou d’une relation causale, ou d’une
généralisation, que l’accusation d’amalgame rejette comme fallacieuse,
erronée ou trompeuse.
L’argument de B est rejeté au nom d’une norme implicite, mais dont on
suppose qu’elle n’est pas propre à A (son caractère implicite contribuant à la
présenter comme communément admise) – d’où la possibilité d’exploiter des
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.19
formulations elliptiques de l’accusation d’amalgame, hors de toute
justification, chacun étant présenté comme à même de comprendre ce qui est
en jeu.
La fonction réfutative de l’accusation d’amalgame peut même supplanter son
sens propre (qui est pourtant, on l’a vu, déjà assez flou) ; l’accusation
d’amalgame est alors mobilisée presque indépendamment de l’argument
adverse : sa seule fonction est de disqualifier le discours adverse comme
coupable d’atteinte aux règles universellement admises d’une saine discussion
argumentative.
Le cas de l’accusation d’amalgame est particulièrement intéressant, du fait qu’il
re-modèle la catégorie savante de l’amalgame (ou sans doute faudrait-il voir, à
l’inverse, la catégorie savante comme une spécification de la constellation de
sens que peut actualiser le mot amalgame dans le discours ordinaire) à des fins
stratégiques. Par ailleurs, l’accusation d’amalgame, dans sa fonction de rejet
d’un large éventail de procédés argumentatifs, semble propre à la langue
française (les équivalents proposés par d’autres langues semblent en effet soit
trop larges, comme hotch-potch, soit trop spécifiques, comme hasty
generalization) : elle invite donc à explorer la piste du lien entre critique
argumentative et système linguistique.
On peut mener le même type d’investigation à partir d’autres expressions
relevant du vocabulaire critique de l’argumentation ordinaire ; et c’est, au-delà
de l’accusation d’amalgame, ce que propose la dernière partie de cet article, à
partir de l’expression « procès d’intention ».
4. Acte et personne dans l'argumentation: le cas du procès d’intention
On s’efforcera une fois encore d’établir un parallèle entre les voies savantes de
la critique de l’argumentation et ses réalisations ordinaires, en s’interrogeant sur
le pendant académique de l’accusation de procès d’intention.
On partira de quelques rappels et considérations générales sur les
argumentations ad hominem et, plus largement, sur les liens entre acte et
personne dans l’argumentation. On verra comment l’accusation d’intention
s’article avec cette problématique. Enfin, on s’attachera à décrire la forme
linguistique des occurrences de l’accusation de « procès d’intention » et on
cherchera à mettre au jour la dynamique argumentative dans laquelle elle
s’inscrit.
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.20
4.1. Argumentation sur l’acte, argumentation sur la personne et argumentum ad hominem
Du point de vue des théoriciens normatifs de l’argumentation, l’argument ad
hominem (comme d’ailleurs l’argument d’autorité) a longtemps été disqualifié
par la logique, en raison de l’exigence qu’elle imposait à toute argumentation de
faire abstraction de ses conditions d’énonciation (Plantin 1990 : 208). Mais les
évolutions plus récentes de la logique non formelle prônent une évaluation
contextuelle des arguments ; ainsi, le ad hominem est désormais plus souvent
considéré comme une forme de critique de l’argumentation acceptable sous
conditions, en particulier lorsqu’il participe à l’évaluation d’un appel à
l’expertise ou d’un témoignage.
Perelman (1989), dans une perspective rhétorique, offre un cadre dans lequel
penser, en deçà de toute approche critique, la notion de procès d’intention, en
reconnaissant le rôle majeur joué par l’interaction entre l’acte et la personne
dans l’argumentation. Perelman envisage la relation de coexistence entre acte et
personne comme un des mécanismes fondamentaux par lesquels les individus
cherchent à faire sens du monde social qui les entoure. Il part de l’affirmation
que la personne, le sujet, n’est accessible aux autres qu’au travers de ses actes –
que ceux-ci soient verbaux, ou de toute autre nature. C’est donc par
l’interprétation et l’évaluation des actes que l’on peut faire des hypothèses sur la
personne qui en est à l’origine. A l’inverse, l’idée que l’on se fait préalablement
d’un individu influe sur la façon dont on perçoit ses actes, par l’effet de
préventions positives ou négatives. La personne constitue l’élément supposé
stable, les actes étant davantage soumis à la contingence.
C’est pourquoi l’imputation d’intentions à la personne est un ressort majeur de
l’interprétation des actions humaines.
Et les hypothèses que l’on peut faire sur ces motifs de l’action sont
déterminantes dans la compréhension et l’évaluation que l’on porte sur elle.
Comme le souligne Perelman (1989), « Le même acte accompli par quelqu’un,
sera considéré comme différent et autrement apprécié parce qu’on le croira
accompli dans une intention différente » (p.272). Ce mécanisme interprétatif fait
prévaloir la morale de l’agent sur celle de l’acte. Dans la plupart des situations,
l’interprétation du monde social met en œuvre les deux logiques, entre lesquelles
s’établit un compromis : certes, participer à de grands shows caritatifs peut
contribuer à rétablir la popularité d’artistes sur le déclin ; mais leur participation
permet quand même de renflouer les caisses d’organisations défendant de
grandes causes.
4.2. Accusation de procès d’intention
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.21
L’expression « procès d’intention » est propre au répertoire critique spontané de
l’argumentation, et n’apparaît pas dans les nomenclatures savantes identifiant
classiquement les paralogismes. On peut considérer que le procédé qu’il désigne
entre dans une sous-catégorie de l’argument ad hominem circonstanciel, qui
consiste à rejeter une thèse ou une ligne d’action par le dévoilement des
intentions mauvaises qui présideraient à sa défense.
Si l’on en revient aux réflexions de Perelman évoquées précédemment,
l’accusation de procès d’intention vise à bloquer le mécanisme d’interaction acte
/ personne, qui consiste ici à faire des hypothèses sur les intentions de x,
intentions supposées peu avouables, et à en conclure à l’irrecevabilité de sa
position. L’accusation de procès d’intention présente l’imputation d’intention
comme un processus purement spéculatif et hasardeux, ne reposant sur aucune
preuve rationnelle, et ne prouvant rien d’autre que la prévention de celui qui en
est à l’origine à l’encontre de celui qui en est victime.
Pourtant, comme le rappelle Perelman, une imputation d’intention peut être
fondée par l’observation d’actes antérieurs répétés et concordants, ayant permis
de construire une image de la personne supposée stable, et donc susceptible à
son tour de servir de prémisses à un calcul intentionnel (1989 : 272) : elle n’est
pas nécessairement arbitraire, et peut, on l’a dit, être centrale dans la
compréhension d’un acte.
4.3. L’accusation de procès d’intention en discours
Comme « amalgame », l’appellation « procès d’intention », lorsqu’elle désigne
l’argumentation de l’adversaire, est nécessairement disqualifiante. En effet, on
ne la trouve que dans des énoncés à orientation négative, qui axiologisent en
retour le syntagme « procès d’intention » 13
:
« Pas de procès d’intention ! »
« On me fait un procès d’intention ».
« je me refuse à faire des procès d’intention »
« je ne veux pas entrer dans un procès d’intention »
« arrêtons de faire un procès d’intention à… »
« X dénonce un procès d’intention »
« victime d’un procès d’intention »
« … vire au procès d’intention »
« ras le bol des procès d’intention »
« … abuse des procès d’intention »
13
Les exemples sont tirés de divers sites Internet et forums de discussion, à partir d’une recherche autour de
l’expression « procès d’intention ».
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.22
Dans le même esprit, les qualificatifs associés à « procès d’intention » sont
clairement disqualifiants, un procès d’intention étant nécessairement « odieux »,
« injuste », « mauvais », « sinistre ».
Si l’on s’intéresse aux termes méta-argumentatifs associés, dans les
argumentations ordinaires, au terme « procès d’intention », on peut élaborer un
paradigme des procédés argumentatifs délictueux, qui constitue un inventaire à
la Prévert des comportements communicatifs délinquants :
« après le procès d'intention, voici le délit d'opinion. »
« les rumeurs et les procès d’intention »
« écarter tout anathème et autres procès d’intention. ... »
« dégager la pépite du désaccord de la gangue du malentendu et du
procès d’intention »
« un tel déchaînement d’agressivité, d’injures, de procès d’intention, un
tel abus des qualificatifs les plus insultants »
« restent le délire et les procès d’intention »
« Anathème et procès d'intention »
« la stratégie du discrédit, qui passe par les faux procès d’intention et
par les mensonges »
« Il s’agit de dépasser les incompréhensions et les procès d’intention »
« selon des critères qui relèvent à la fois du procès d’intention et de la
calomnie, et de la soumission à la loi du plus fort »
« champion des procès d'intention et des mauvaises foi ! ... »
"Je ne suis pas dans le procès d'intention, je ne suis pas dans l'opprobre
lancée sans savoir et je ne suis pas dans les bagarres de personnes"
« Ils ont donné dans tous les genres. Le mépris, l'insulte, le coupage de
parole, les commentaires à haute voix, les procès d'intention, la
mauvaise foi, la haine... »
« Le procés d'intention ne constitue pas un argument. La dérision n'est
pas un palliatif à l'ignorance. Encore moins le début d'une réflexion. »
De tels paradigmes frappent par deux caractéristiques :
- d’une part, ils exhibent une dimension émotionnelle très présente (à
travers notamment un lexique émotionnel associé : « haine, mépris,
agressivité… »…)
- d’autre part, ils tracent un portrait de victime. En effet, certaines formes
d’arguments classiquement envisagés comme des sophismes ou des
paralogismes, et en particulier, les stratégies relevant du ad hominem sont
caractérisées par le fait qu’elles mettent en relation un locuteur en position
de « bourreau », et un locuteur en position de « victime ». On n’est pas
« victime » d’une pétition de principe ou d’un argument d’autorité ; en
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.23
revanche, on est victime d’un procès d’intention, qualifié en retour
d’« injuste », ou d’« odieux »14
.
De ce fait, accuser l’adversaire de faire un procès d’intention a une double
répercussion sur l’ethos de celui qui porte l’accusation :
- c’est une façon d’exhiber une compétence méta-argumentative qui permet
de catégoriser les procédés argumentatifs en circulation et de leur attacher
une étiquette valorisante ou, ici, disqualifiante (cette conséquence sur
l’ethos vaut pour tous les commentaires méta-argumentatifs, et
notamment pour l’accusation d’amalgame abordée ci-dessus) ;
- c’est aussi une façon d’assigner aux partenaires de l’échange argumenté
des rôles spécifiques, dans un rapport duel de « bourreau » (ou du moins,
d’agresseur) à « victime », ou dans un rapport ternaire de bourreau,
victime et défenseur de la veuve et de l’orphelin, lorsque l’accusation de
procès d’intention est portée par un tiers, non visé directement.
Enfin, l’observation des termes méta-argumentatifs en co-occurrence avec
« procès d’intention » permet, à l’inverse, de dresser un inventaire des
antonymes – ou, plus largement, des comportements argumentatifs valorisés :
« Encore une fois, pas de procès d’intention, jugeons sur pièces »
« aborder les problèmes franchement et ne plus se faire de procès
d'intention »
« sur des bases sereines, sans amalgame ni procès d’intention. ... »
Le procès d’intention s’opposerait donc à une argumentation ad rem (portant sur
la thèse elle-même), et se développant dans un contexte dépassionné.
En guise de conclusion
Dans cet article, et à travers les recherches dont il rend compte, on a cherché à
illustrer les voies que pourrait emprunter une approche descriptive des normes
argumentatives, fondée sur l’observation du fonctionnement du jugement « ce
n’est pas un argument » et des accusations d’amalgame et de procès d’intention.
Ces études de cas nous amènent, en conclusion, à insister sur l’intérêt qu’il peut
y avoir à prendre au sérieux la matérialité langagière de l’argumentation – et les
14
Une recherche sur Internet via le moteur de recherche Google suggère qu’on peut aussi être
« victime d’amalgame », comme dans l’exemple suivant, tiré du
site http://soutien.hicheur.pagesperso-
orange.fr/Revue%20de%20Presse/la%20voix%20de%20l%20oranie_10_2009.pdf (consulté
le 17/02/2012): « En fait, le cas de Adlane Hicheur, qui assume son appartenance religieuse,
rappelle curieusement celui de plusieurs autres Algériens, notamment le pilote Halim Raissi,
victime d’amalgame et de bavure des services policiers occidentaux qui l’ont accusé de
terrorisme pour se débarrasser de lui. »
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.24
ressources linguistiques que chaque langue offre à ses locuteurs pour mettre en
mots leurs stratégies15
. Cet intérêt – particulièrement central pour l’auteur en
raison de sa formation linguistique – a été mis en évidence de façon inaugurale
par les travaux de Ducrot et de son école autour des connecteurs et opérateurs
argumentatifs (Ducrot et al. 1980), puis étendu à l’ensemble du lexique
(Anscombre & Ducrot 1983). Il est actuellement repris et appliqué à la plus
large catégorie des « indicateurs d’argumentation » [argumentative indicators]
par l’école d’Amsterdam (Eemeren, Houtlosser, Snoeck Henkemans 2007,
2010) ; et on peut considérer que l’attention prêtée à des désignations comme
« procès d’intention » ou « amalgame » – voire à des unités plus larges, comme
des aphorismes du type « c’est l’Hôpital qui se fout de la Charité » (et qui
dénoncent des argumentations ad hominem tu quoque) participent du même
souci pour la matérialisation discursive de l’argumentation.
La proximité qui émerge des études précédentes entre théories spontanées de
l’argumentation et approches « savantes » (en particulier, approches normatives)
ne devraient pas surprendre, les liens entre contre-argumentation, évaluation
“ savante ” et évaluation “ spontanée ” des arguments ayant été évoqués par
plusieurs théoriciens de l’argumentation, parmi lesquels :
Frans van Eemeren, et, autour de lui, les tenants de l’école d’Amsterdam, qui
cherchent à établir les points de convergence et les points de rupture entre les
critères d’évaluation des arguments définis par le modèle pragma-dialectique
et les évaluations spontanées produites par des locuteurs ordinaires en
situation expérimentale. Une des méthodes employées pour mettre au jour
ces évaluations spontanées est de demander à des informateurs, confrontés à
des saynètes argumentatives, de produire des contre-arguments (voir par
exemple les études de Garssen, 2002 et Eemeren & Meuffels, 2002 sur la
perception de l’argument ad hominem).
Trudy Govier, qui, dans son manuel de référence A practical study of
argument (2001), propose à l’analyste qui se donne pour tâche d’évaluer une
argumentation de prendre en compte ce qu’elle appelle le contexte
dialectique [dialectical context], d’étudier les objections formulées dans les
données, de chercher à en formuler lui-même d’originales, et de “ peser ”
ainsi le pour et le contre. Ainsi, l’analyste de l’argumentation qui cherche à
évaluer un argument ne fait que reprendre et systématiser la façon dont s’y
prennent les locuteurs ordinaires engagés dans des interactions
argumentatives (Govier 1987 : 129).
Robert Craig, qui rappelle que les praticiens de l’argumentation théorisent
toujours, peu ou prou, leur activité (1996 : 463), et qu’il n’y a pas rupture,
mais continuité, entre les théorisations « savantes » et les théorisations
« ordinaires » (Craig 1996 : 472, 1999 : 21) ;
15
Sur l’inscription langagière de l’argumentation, voir notamment le numéro de la revue Verbum (XXXII-1,
2010) qui y est consacré.
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.25
Christian Plantin enfin, dont on a rappelé combien la position sur la question
de l’évaluation de l’argumentation est décisive pour notre démarche, et qui
propose de considérer toute évaluation d’un argument comme l’élément d’un
contre-discours, que la norme sous-jacente à l’évaluation soit explicite ou
implicite, qu’elle soit “ savante ” ou “ spontanée ” (Plantin 1995, 2002).
Affirmons une fois encore que le constat de cette proximité entre théorisations
savantes et théorisations ordinaires de l’argumentation, évaluation technique et
jugements « sauvages » sur l’acceptabilité des arguments, ne vise en aucun cas à
discréditer les approches normatives ; il montre en revanche combien est
indispensable la description minutieuse des normes argumentatives
« ordinaires », afin de permettre aux approches normatives de se construire en
explicitant leur position par rapport à ces répertoires critiques spontanés.
ANSCOMBRE, J.-C., DUCROT, O., 1983. L’argumentation dans la langue, Liège : Mardaga.
BILLIG, M., 1987. Arguing and thinking. A rhetorical approach to social psychology, Cambridge :
CUP / Paris : Editions de la maison des sciences de l’homme.
CRAIG, R. T., 1999. “Metadiscourse, Theory, and Practice”, Research on Language and Social Interaction, 32, 1&2, 21-29.
—, 1996. “Practical-Theoretical Argumentation”, Argumentation 10, 461-474.
— , 2011. “The uses of "argument" in practical metadiscourse”. In R. C. Rowland (Ed.), Reasoned argument and social change, Washington, DC: National Communication Association, 78-86.
CRAIG, R. T., TRACY, K., 2005. “‘The issue’ in argumentation practice and theory”, in F. H. van
Eemeren & P. Houtlosser (éds), argumentation in practice, Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 11-28
DOURY, M., 2003. « L’évaluation des arguments dans les discours ordinaires : le cas de l’accusation
d’amalgame », Langage et société 105, 9-37.
— , 2012. “Preaching to the converted. Why argue when everyone agrees?”, Argumentation 26-1, 99-114.
— , 2008. « “Ce n’est pas un argument ! ” Sur quelques aspects des théorisations spontanées de
l’argumentation », Pratiques 139 (« Les Linguistiques populaires, M.-A. Paveau & G. Achard-Bayle, éds), 111-128.
DUCROT, O. et al., 1980. Les mots du discours, Paris : Minuit.
EEMEREN, F. H. Van, GROOTENDORST, R., 2004. A systematic theory of argumentation. The pragma-
dialectical approach, Cambridge University Press.
EEMEREN, F. H. Van, HOUTLOSSER, P., SNOECK HENKEMANS, F., 2007. Argumentative Indicators in Discourse. A Pragma-Dialectical Study, Springer.
—, 2010. « Profils dialectiques et indicateurs de ‘coups’ argumentatifs », Verbum XXXII-1.
EEMEREN, F. H. Van, MEUFFELS, B., 2002. “Ordinary arguers’ judgments on ad hominem fallacies”, in F. H. Van Eemeren (ed.), Advances in Pragma-Dialectics, Amsterdam : SicSat, Newport News,
Virginia : Vale Press, 45-64.
GARSSEN, B., 2002. “Understanding argument schemes”, in F. H. Van Eemeren (ed.), Advances in
Pragma-Dialectics, Amsterdam : SicSat, Newport News, Virginia : Vale Press, 93-104.
M. Doury, Amalgames, procès d’intention et autres scandales argumentatifs. Conférence faite
au colloque international Communication et Argumentation dans la Sphère Publique,
Université « Dunarea de Jos », Galati, ROUMANIE, 13-15 mai 2010, p.26
GOODWIN, J., 2007. “What, in practice, is an argument ?”, In H.V. Hansen, et. al. (Eds.), Dissensus
and the Search for Common Ground, CD-ROM (pp. 1-44). Windsor, ON: OSSA.
GOVIER, T., 1987. Problems in Argument Analysis and Evaluation, Dordrecht/Providence, Foris Publications.
—, 2001. A practical study of argument (5th edition), Belmont, Wadsworth.
KOREN, R., 1995. “Concerning an ‘argumentative monster’ : The perverted analogy in French journalistic discourse”, In van Eemeren (Frans H.), Grootendorst (Rob), Blair (J. Anthony), Willard
(Charles A.) (eds), Reconstruction and application. Proceedings of the third ISSA Conference on
Argumentation (University of Amsterdam, June 21-24, 1994), Vol. III. Amsterdam, Sic Sat, 543-552.
MICHELI, R., 2012. “Arguing Without Trying to Persuade? Elements for a Non-Persuasive Definition
of Argumentation”, Argumentation 26 (1), 115-126.
O’KEEFE, D., 1977. “Two concepts of argument”. Journal of the American Forensic Association, 13, 121-128.
—, 1982. “The concepts of argument and arguing”. In J.R. Cox & C. A. Willard (eds), Advances in
argumentation theory and research, Carbondale, IL : Southern Illinois University Press, 3-23.
OLERON, P., 1987. L’argumentation, Paris, PUF (2e éd.) (1ère éd. : 1983).
PAVEAU, M.-A., 2008. « Les non-linguistes font-ils de la linguistique ? Une approche anti-
éliminativiste des théories folk », Pratiques 139-140, 93-110.
PERELMAN, C., 1989. « Acte et personne dans l’argumentation », Rhétoriques, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 257-293.
PLANTIN, C. , 1990. Essais sur l’argumentation. Introduction linguistique à l’étude de la parole
argumentative. Paris : Kimé.
—, 1995. « L’argument du paralogisme », Hermès 15, 245-262.
—, 1996. L’argumentation, Paris : Seuil (coll. Mémo).
—, 2002. « Analyse et critique du discours argumentative », in Koren, R. & Amossy, R., Après Perelman : quelles politiques pour les nouvelles rhétoriques ?, Paris : l’Harmattan, 229-263.
—, 2005. L’argumentation, Paris : PUF (QSJ)
—, 2010. « Les instruments de structuration des séquences argumentatives », Verbum XXXII-1.
ROBRIEUX, J.-J., 1993. Éléments de rhétorique et d’argumentation, Paris : Dunod.
TRAVERSO, V., 1999. L’analyse des conversations, Paris : Nathan (coll. 128).