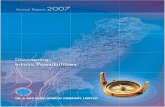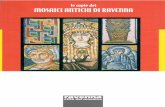Adv pdf léger - copie
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Adv pdf léger - copie
PROLOGUE
2 UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
Reproduction de la Une del’hebdomadaire Le Combat du 29 mai
1946. La restitution de l’histoire passepar la production des documentscontemporains des faits. S’ils ne
garantissent pas l’exactitude scientifiquedes événements, ils rendent au moins
compte de la façon dont lescontemporains les ont perçus.
(1 PER88/1 Archives départementales)
PROLOGUE
«J’arrive à La Réunionen 1991, Le Journalde l’Ile de LaRéunion est installérue Alexis deVilleneuve. Et cenom est à ce point
passé dans la langue que le JIR est régulièrementdénommé comme « le quotidien de la rue Alexisde Villeneuve… ». Curieux, je demande qui estce Monsieur. On me répond qu’il s’agit d’unhomme politique qui a été assassiné. C’est partide-là. Au fil de mes recherches sur la person-nalité de M. De Villeneuve, je perçois une gênecroissante, et même de la peur, chez mes inter-locuteurs lorsque je demande qui l’a tué… A cetteépoque Gilbert Annette est installé député-mairede Saint-Denis, Sous le prétexte de travaux de
VI SOUVIENSDevoir de mémoire
peinture du mur, il fait déposer la plaque qui ho-norait la mémoire de M. De Villeneuve sur le lieude son trépas. Et on oublie de l’y remettre, le der-nier coup de pinceau donné. Je trouve que c’estun peu trop. D’autant que régulièrement, dansTémoignages les camarades style Rousse,Biedinger, Jean Saint Marc, ChantalLauvernier... tous inféodés, tous alimentairesdu PCR, s’en donnent à cœur joie et compissentallègrement la mémoire d’Alexis de Villeneuve.Non seulement il a été assassiné, mais lesCommunistes, dont il était l’adversaire, crachentsur sa tombe ! De plus, dans la mémoire collec-tive des Réunionnais, on a si bien effacé les faitsqu’on en est presque à se demander si Alexis deVilleneuve n’est pas mort dans un accident devélo ? Un peu plus tard, une fois Gilbert Annetteexpédié en taule, fait aux pattes par la brigade
financière section pandores, avec le procureurBernard Legras comme chef d’orchestre, jem’emploie à rétablir publiquement les faits : où,qui, quand, comment ? les matrones avinées ,enrhumées (ivrognes pays), tapant sur leurs cas-seroles pour étouffer le discours de Villeneuve etles coups de calibre… Paul condamné pour avoirtiré sur De Villeneuve « sans intention de don-ner la mort » puis amnistié, qui cause de « lamain noire », Raymond et les autres… Je créel’association Vi Souviens, demande aux lecteursde se manifester, ce qu’ils font en nombre, ils noussoutiennent financièrement, et nous réalisons uneplaque commémorative laquelle est posée faceà la cathédrale, sur le mur d’où elle n’aurait ja-mais dû bouger. Nous la posons assez haut, defaçon à éviter que des mécréants ne viennent labriser… Depuis, tous les ans, le 25 mai, date anniversairede sa mort, je salue la mémoire d’Alexis deVilleneuve. Et dès qu’un alimentaire du clanVergès s’emploie à salir la mémoire d’Alexis deVilleneuve, dans un article, ou un livre, ne se-rait-ce qu’en éludant la vérité historique, je le re-mets dans l’axe par édito interposé et Alexis deVilleneuve à sa place, de victime, d’homme po-litique assassiné. La maison familiale de M. de Villeneuve, celleoù son corps a été déposé, puis veillé, là où il vi-vait au moment des faits, cette demeure ayant étérachetée par la Région Réunion, la mémoire col-lective était à ce point occultée, qu’on l’avait re-baptisée « case du général ». Un généralforcément de passage, forcément métropolitainet donc pas réunionnais pour deux sous ! Ironiedu destin, cette case là a été rachetée par la col-lectivité régionale quand Paul Vergès en était lePrésident. Or si le Président a des trous de mé-moire, ou des souvenirs sélectifs, ce n’est pas notrecas. Donc, quand il s’est agi d’inaugurer la casefraîchement restaurée, en présence de PaulVergès, de fifille, de maman Vergès, de toute lasmallah, du clan et même de M. Vauthier, dontle père a tenu Alevis de Villeneuve mourant dansses bras, pas question de dire amen, et d’appe-
ler cette case « la maison du général » ! Ces gens-là, n’ont vraiment aucune pudeur. Vi Souviens seréveille, d’où l’idée du buste… Les lecteurs sou-tiennent l’initiative, et l’association dont j’ai aban-donné la présidence du fait de mon prochaindépart, m’annonce qu’elle prépare une publica-tion destinée à rétablir la réalité des faits qui sesont déroulés ce 25 mai 1946, de les situer dansleur contexte historique, de façon à renvoyer toutun chacun à ses responsabilités devant l’histoire.De même que l’assassinat d’Alexis de villeneuvea été un sujet proposé au bac grace à notre tra-vail de mémoire, j’espère que cet engagement seperpétuera, parce qu’Alexis de Villeneuve a étéassassiné es qualité d’homme politique et parcequ’il faisait de l’ombre à ses adversaires. C’estgrave ! Et la motivation politique est une circons-tance aggravante. D’ailleurs, je vais m’employer à faire décorerAlexis de Villeneuve de la Légion d’honneur àtitre posthume… » �
Il y a presque 10 ans, le 9 octobre 1998, Jacques Tillier déclaraiten Préfecture la création de l’association « Vi Souviens », dontla vocation était clairement établie par l’article 2 de ses statuts :« Cette association a pour but l’apposition d’une plaquecommémorative de l’homicide de Monsieur Alexis de Villeneuve,sur les lieux de l’événement, Place de la Cathédrale, à Saint-Denis et, plus généralement, l’organisation de toute célébrationou manifestation liée à cet événement, dans le respect des loiset règlements en vigueur… »
De ce jour Vi Souviens n’a cessé d’œuvrer au rétablissement,dans la mémoire collective des Réunionnais, des faitsdramatiques qui ont marqué pour longtemps la vie politiquelocale. Des faits que le Parti Communiste Réunionnais et seshiérarques n’ont cessé de nier et d’occulter.
Jacques Tillier, à la veille de son départ pour d’autres latitudeset de nouvelles aventures, explique les motivations qui l’ontpoussé à s’opposer à l’oblitération du destin d’Alexis deVilleneuve.
3UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
Jacques Tillier, Directeur Général du Journal de l’Ile de La Réunion et fondateur de l’association Vi Souviens.
4 UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
ACTE I
Le bi hebdomadaire Le Cri du Peuple nes’embarrasse pas de circonlocutions et
d’euphémisme. Pour ce journal acquis àla cause gaulliste (MRP), les communistes
sont responsables de la mort d’Alexis deVilleneuve, raison pour laquelle on a
arrêté Paul Vergès, Roger Bourdageau etOrré… Les communistes, pour leur part,
contestent les faits et dénoncent « lesprovocations de la réaction ».
(1 PER86/1 Archives départementales)
ACTE I
L’homicided’Alexis de Villeneuve
En 1946, La Réunion vient d’accéder austatut départemental, sur le papier,mais elle baigne - comme le reste dela France - dans un climat putride deviolence, de frustration, de peur et devengeance qui découle de la décompo-sition de la société française. A cette
époque, la population confrontée à la défaiteet à la collaboration, aux dénonciations, à la ter-reur instaurée par la milice, puis aux excès dela libération, perdit toute retenue et toute no-tion de justice. Sous prétexte de chasse aux col-labos, on régla des comptes qui n’avaient souventrien à voir avec la guerre, on lyncha des malheu-reux, on tondit des femmes. Selon les résultatsdu Comité d’Histoire de la Deuxième Guerremondiale, de 8 000 à 9 000 exécutions extra-ju-diciaires eurent lieu dont un petit nombre aprèsdes jugements rendus soit par des Cours mar-tiales improvisées soit par des Tribunaux mili-taires d’urgence ; les magistrats qui avaient prêtéserment à Pétain et condamné à mort tous ceuxqui, résistants ou pas, déplaisaient au régimede Vichy et aux Nazis, continuèrent de condam-ner ceux-là mêmes qu’ils avaient servis, sauf un,le seul et unique qui refusa de prêter sermentau Maréchal. Même remarque pour la policeet à la gendarmerie qui, au-delà d’exceptions no-tables, étaient restées fidèles à Pétain. De fait,si les mœurs politiques s’étaient policées sousla férule du gouverneur Capagorry, celui-làmême qui avait rallié la Réunion à la Francelibre, les élections municipales, cantonales puislégislatives (constituante) de 1945 se déroulantdans le calme, la campagne électorale pour leslégislatives réunionnaises de juin 1946 s’inscritdans des conditions inquiétantes, renouant avecles violences des années 30 et de la IIIeRépublique. Sur la première circonscription, celle de Saint-Denis, les deux leaders politiques du moments’opposent : Raymond Vergès, maire de Saint-Denis, membre du Parti communiste françaisà la Réunion, et candidat sous l’étiquette péidu Comité républicain d’action démocratique etsociale, et Alexis de Villeneuve, maire et conseil-ler général de Saint-Benoît, gaulliste, candidatsous les couleurs du Mouvement républicain po-pulaire.En fait, deux personnalités politiques de pre-
mier plan qui se disputent un même électorat,sans négliger aucun des moyens d’ordinaire em-ployés en temps de guerre électorale. Pressions,menaces, dénonciations, intimidations, bataillesrangées entre nervis, militants et partisans fana-tisés… Le 24 mai 1946, en présence d’Alexisde Villeneuve, l’un de ses alliés, M.Vauthier,échappe de peu à une tentative d’attentat per-pétrée par un ancien gendarme. Mais l’armes’était enrayée. De son côté, Raymond Vergèscraint une action homicide contre son fils Paul
revenu de métropole le 13 mai et contre d’au-tres «camarades». Chantal Lauvernier, dans sonouvrage consacré à Raymond Vergès, soulignecette inquiétude fondée « de sources sûres »selon le Dr.Vergès. De fait le gouverneurCapagorry convoque incontinent les divers can-didats en lice à une réunion de pacification.Elle se tient dans les locaux du gouvernorat, le25 mai en début d’après-midi. Les parties enprésence s’engagent à ne plus troubler les ras-semblements concurrents.Ce traité de non-belligérance n’aura pas le tempsd’entrer en vigueur. Alexis de Villeneuve a prévuun rassemblement à 16h30, place de laCathédrale, à Saint-Denis. En octobre 1945, M.de Villeneuve organisant la même manifestation,au même endroit, avait subi de la part de ses ad-versaires politiques ce que l’adjudant-chefPascal, commandant de la section et commis-
saire central de police qualifiait un an plus tard,« d’obstruction tapageuse ». Le climat politi-que s’étant rudement dégradé depuis, les au-torités craignaient que de tels événements sereproduisent et un fort parti de policiers et degendarmes avait été positionné à proximité dela place de la Cathédrale.On avait même envisagé recourir à l’emploi dela troupe.Pour reconstituer les événements qui se sont dé-roulés ce jour-là, entre 16h30 et 17h, nous pu-blions ici des fragments de récit rédigés par lestémoins de la scène, et qui sont restés consignésdans les dossiers poussiéreux d’une justicemuette. Amnistie oblige.Paulo Lallemand, sous-brigadier de police au 2earrondissement de Saint-Denis, décrit avec pré-cision le premier acte du drame : « Nous noustenions à 16h30 auprès du jet d’eau, place de laCathédrale, quand MM. Alexis de Villeneuve,Vauthier, Chatel (père et fils), Sauger et WallonHoareau sont sortis de l’étude de ce dernier… »Il était en fait 16h45. L’adjudant-chef Pascal,commissaire de police, évaluait «à cinq centspersonnes environ la foule très disséminée qui setrouvait sur la place de la Cathédrale, aux abordsde celle-ci et dans les rues adjacentes… ». C’està ce moment précis que le chauffeur munici-pal Vlody utilisa une trompette pour émettredeux ou trois sons. A ce signal sortit du jardin dela Maternité coloniale une colonne comprenantprincipalement des femmes, qui tapaient sur desbidons vides en fer blanc, ainsi que plusieurshommes et, en particulier Vergès Paul, fils dumédecin directeur du service de Santé,Bourdageau Roger, directeur du journalTémoignages et Quessoi Emile, conseiller mu-nicipal de Saint-Denis (1).Paulo Lallemand précise : « Ils étaient porteursde vieux fers-blancs, de caisses et de bâtons etdescendaient la rue de la Victoire en toute hâte,jusqu’à proximité de la rue Edouard, où les at-tendait M. Roufli, qui était porteur d’un appa-reil photographique. Là, ce fut un véritabletintamarre… »Alexis de Villeneuve tente alors d’obtenir de lapolice qu’elle fasse dégager le parti d’opposantsqui entend l’empêcher de parler.Le brigadier Barne Joseph décrit la façon dontAlexis de Villeneuve s’engage dans la mêlée qui
«Nous sommes libres de lutter contre le sommeil de la mémoire et du cœur et de vaincre en nous la puissance formidable de l’oubli. Il nous appartient de ressusciter les morts et de rendre la vie à cette cendre età cette poussière qui furent un sang brûlant et une chair aimée…» François Mauriac «Cinquante ans» - Octobre 1939
« (…) soudain un bruit strident, semblable à celui d’une détonation est parvenu jusqu’à moi… ».
5
Alexis De Villeneuve.
Raymond Vergès.
Paul Vergès.
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
L’ASSASSINAT D’ALEXIS DE VILLENEUVE
lui sera fatale : « S’adressant alors aux sieurDeville Joseph il a dit ceci : “Marmaille amèneles hommes, nous allons les baiser !” Et de fait,selon le maréchal des logis-chef Delis, « Le sieurAlexis de Villeneuve avait l’attitude d’un hommedécidé, les bras quelque peu levés et semblaitdonner un ordre de marche. Aussitôt le contactune bagarre s’en est suivie… »L’inspecteur principal Belon Alix était au plusprès de l’échauffourée : « Je suis parvenu à maî-triser quelques femmes, mais des coups conti-
nuaient à être échangés entre MM. de Villeneuve,Forest et les femmes. Tout à coup j’ai reçu uncoup de poing au flanc droit de la part de M.de Villeneuve (…) je suis resté un moment quel-que peu ahuri (…) soudain un bruit strident,semblable à celui d’une détonation est parvenujusqu’à moi… ».Selon l’agent Tranquillin Simon : « J’ai entendudeux détonations. Des gens disaient Bourdageauet le fils Vergès ont tiré les coups de revolver ».Un autre de ses collègues, le maréchal des logis-chef de gendarmerie Gelis Jules déclare : «MM.Ludovic Revest et Dominique Sauger préten-daient que les coups de feu avaient été tirés parle fils du docteur Vergès. En ce qui me concerneje n’ai pas remarqué sa présence. Seul le nomméBourdageau, déjà nommé avait été remarqué parle groupe des femmes… ».Le maréchal des logis-chef Payet prend la suite :« J’ai entendu parmi le bruit, deux coups de feu.Quelques secondes à peine, après ces coups defeu, le gendarme Cros, qui me suivait m’a sou-dain prévenu qu’il venait de voir un homme sor-tir de la foule, et en essayant de dissimuler unrevolver dans sa poche. Nous l’avons appréhendéet fouillé. Un pistolet automatique se trouvaitdans la poche de son pantalon… ».Le sieur Bourdageau n’était autre que le rédac-teur en chef de Témoignages, connu pour agiren chef nervi. Il avait déjà été remarqué un an plus tôt pouravoir sérieusement perturbé le meeting du MRP,au même endroit. C’est encore lui qui avait or-ganisé la contre-manifestation des femmes cejour-là, se faisant livrer à domicile les bidonsen fer-blanc du bureau des approvisionementsde la commune.
Quant au fugitif arrêté en possession de l’arme,Emile Orre, il était dans la soirée déféré de-vant le procureur de la République.Selon l’adjudant-chef Pascal les autres suspectssont interpellés dans la soirée : « Au cours dela nuit j’étais chargé par M. le juge d’instruc-tion de la recherche du fils Vergès et deBourdageau désignés par la rumeur publiquecomme étant les auteurs des coups de feu… ».Au cours de l’enquête, il devait apparaître queles douilles des projectiles tirés lors de l’agres-sion provenaient bien de l’arme saisie sur Orre.Et que cette arme était dûment enregistrée au-près des autorités comme appartenant auDr Raymond Vergès, qui l’avait reçue au titre dela fonction qu’il exerçait. Quant à Alexis deVilleneuve, le maréchal des logis-chef Durandle décrit ainsi : «Assis le dos sur l’arête du trot-toir, la face tournée vers l’Est. Les personness’empressaient autour de lui, le relevaient et l’em-portaient vers l’étude de Maître VallonHoareau »(2). Il était mort, comme devait leconstater le commissaire Gelis cité par l’adju-dant-chef Pascal : « Je voyais le commissaireGelis de face, sortant de cette foule, très pâle etl’entendais dire : C’est fini. »Dès le début de l’échauffourée, Alexis deVilleneuve est donc tombé à terre, mortellementblessé, pendant que ses voisins, Marsan et MorelLuçay étaient également atteints. �
«Nous l’avonsappréhendé et fouillé.Un pistoletautomatique setrouvait dans la poche de sonpantalon… »
« Dès le tintamarre et les coups de feu, je sui-vais le maréchal des logis chef Payet (…)
lorsque j’ai remarqué parmi la foule, un individuqui battait en retraite, se retournant à plusieurs re-prises, tenant un pistolet qu’il essayait de placerdans sa poche. J’ai attiré l’attention de mon chefsur cet individu, qui s’enfuyait rue de la Victoire.Poursuivi, nous l’avons rejoint dans les jardins dusecrétariat général, près du monument Mac-Auliffe.Fouillé aussitôt, je lui ai retiré le pistolet qu’il por-tait dans la poche revolver de son pantalon (3). J’aiconstaté que cette arme, avait le canon encorechaud, et des traces bleuâtres de poudre à l’inté-rieur et à l’extrémité… » Conduit immédiatementau commissariat de police du 1er arrondissementOrré est interrogé. « Un instant après, l’adjudant-chef Meunier nous rejoignait au commissariat depolice, commençait l’interrogatoire de cet individu,qui, en présence du maréchal des logis chef Payet,
Compte rendu du gendarme CROS EMILE
�������������������������
La place de la cathédrale a servi de théâtre aux protagonistes de la fin tragique d’Alexis de Villeneuve. Un acte qui a marquédu sceau de la violence la vie politique réunionnaise pendant de longues années…
6 UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
de l’agent de police Dejean et moi-même déclaraitspontanément qu’il n’avait tiré qu’un seul coup…». Le compte rendu du maréchal des logis chefPayet permet d’apprendre qui est l’homme au pis-tolet : « Cet individu qui m’a été désigné par le gen-darme Cros, montait la rue en direction dumonument aux morts. Il allongeait le pas et regar-dait de temps à autre derrière lui. Nous l’avonssuivi. Arrivés à la hauteur de la petite porte du jar-din du Secrétariat, il l’a franchie et, est allé se pos-ter près du monument Mac-Auliffe. C’est alors quenous nous sommes avancés vers lui, alors qu’il re-gardait en direction de la place de la cathédrale,et que nous l’avons appréhendé et fouillé. Un pis-tolet automatique se trouvait dans la poche de sonpantalon. Nous lui avons retiré l’arme (…) J’aiconduit l’homme qui avait déclaré se nommerORRE au commissariat… » (Voir documents pagessuivantes). �
2
1
3
La munition de calibre 6,35mm ou 25 ACP pourles anglo-saxons est traditionnellement utilisée pardans des pistolets automatiques de très faible en-combrement. Malgré une vitesse initiale élevée,l’effet de choc produit demeure faible (en parti-culier en raison de son ogive blindée). Son éner-gie cinétique (entre 70 et 90 joules) est d’environ30% inférieure à celle du 22 Long Rifle, mais sasurface d’impact est légèrement supérieure.C’est le pistolet automatique Browning modèle1906 qui a rendu cette cartouche assez popu-laire au cours de la première moitié du XXe siè-cle. Cette arme a été copiée dans le mondeentier, diffusant ainsi la munition qui lui cor-respondait. De dimension très réduite, leBrowning modèle 1906 et ses nombreux avatarsLe Français y compris, sont des pistolets « depoche » ou « de dame » car facilement dissimu-lables ; plus exactement il s’agit d’armes dites dedéfense », voire de dissuasion, car leur faiblepuissance d’arrêt ne garantit pas un impact suf-fisant pour stopper net une agression. Par ail-leurs, les armes qui utilisent d’ordinaire lecalibre 6.35mm sont très compactes, peu ergo-nomiques et donc peu précises quand bienmême sur un Browning, le tir reste précisjusqu’à 25 mètres. Avec un Le Français, on peutespérer atteindre sa cible sans difficulté pourpeu qu’elle se situe à 10 ou 15 mètres du ti-reur. Dans l’affaire Alexisde Villeneuve, le coupayant été porté quasiment à bout portant, n’alaissé aucune chance à la victime touchée enplein cœur. �
Une BALLEde 6.35 mm
6.35 Le Français une armetrès appréciée de la Résistance
L’acte d’accusation du procureur général prèsla cour d’appel de Lyon du le 18 avril 1947nous permet de suivre les détails de l’enquêtemenée par les experts de l’époque : « Aprèsla disparition de la foule, deux douilles furenttrouvées sur les lieux par les témoins Gence etLefoulon. D’après le rapport du lieutenantcontrôleur d’armes Vaures de la Direction del’artillerie de Tananarive, commis en qualitéd’expert, elles avaient été toutes deux percutéespar le revolver N° 77 488. Cette arme avait étécédée le 9 octobre 1939 au service de Santé, puisattribuée à l’agent Rubègue, qui, en cessant sesfonctions en 1942, la restitua, d’après ses dires,au Secrétaire du Service de Santé Sida et,d’après ce dernier, directement au Dr. VergèsLe Docteur Ricquebourg, commis pour procé-der à l’autopsie, retrouva dans le corps de laseptième vertèbre dorsale une balle de 6.35 mm,
qui avait atteint la victime à 1,43 m du sol, àla hauteur du revers du veston, et avait suiviune trajectoire horizontale, d’avant en arrière,légèrement de droite à gauche. Il attribua ledécès à une hémorragie foudroyante, consécu-tive à une plaie à l’oreillette droite et constataque le tireur se trouvait à une distance supé-rieure à 30 cm, faute de brûlure du veston oude dépôt de fumée au point d’impact. Le mêmeexpert examina le blessé Marsan et releva, au-dessus de l’extrémité inférieure du péroné droit,une plaie à bords irréguliers provoquée par uneballe et de nature à entraîner une incapacité detravail supérieure à 20 jours. Enfin, le Dr Ycardreleva sur le front de Morel Luçay une croûterecouvrant une plaie en voie de cicatrisationproduite par un corps contondant, de forme trèsrégulière, telle que la balle d’une arme à feu…»�
En plein cœur
vait être introduite directement dans le canonbasculé. D’où à un moment donné, la créationd’une bague sous le chargeur, pour conservercette première balle à portée de main. Unedeuxième caractéristique étonnante est l’ab-sence totale d’extracteur. La face de culasse estcomplètement plate, sans cuvette, ne laissant ap-paraître que le trou du percuteur. Enfin, le pis-tolet fonctionne uniquement en “double action.C’est a dire que l’appui sur la détente engen-dre systématiquement un armement et un dé-crochage du percuteur comme pour un revolver.Le 6,35 Le Français, pistolet de sac ou de car-table, discret et léger, fut très apprécié du faitmême de ses qualités de discrétion par laRésistance. Il fut en vente dans sa version stan-dard jusqu’en 1965. Un second modèle dit “al-légé” vit le jour en 1939 le canon et la culassequi portaient des cannelures longitudinalesétaient réalisés en alliage léger, d’où un poids de245gr. Sa fabrication fut interrompue par laguerre. Le Français type « policeman »,construit sur la même base que le modèle « depoche », mais à canon long, fut créé en 1922.Il restera au catalogue Manufrance jusqu’en1968. Ce modèle sera notamment employé parl’Office National des Forêts. �
Le pistolet « Le Français » avec lequel Alexis deVilleneuve a été abattu est une production de lacélèbre Manufacture d’armes et de cycles deSaint-Etienne, fondée en 1885, par PierreBlachon et Etienne Mimard. En 1912, EtienneMimard entreprit des travaux concernant laconception d’un petit pistolet automatique mai-son. Il déposa un brevet le 6 août 1913 (no472.505). Le pistolet figurera pour la premièrefois au catalogue de 1914. Dans sa configuration originale, dite « de poche»,le Pistolet “Le Français” est un 6.35 mm auto-matique à canon court. Capacité de chargeur 7coups, dimension hors-tout 135 mm, canon de60 mm, poids 320 grammes. Il se distingue parun certain nombre de caractéristiques origina-les. Tout d’abord, le canon basculant. Pour lelibérer, il suffit de descendre le levier sur le côtédroit de l’arme ou descendre le chargeur. Dansl’esprit du concepteur, la première cartouche de-
L’ASSASSINAT D’ALEXIS DE VILLENEUVE
�������������������������
7UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
9
AU NOM DU PÈRE
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
Le Communiste du 3 juin 1946. L’hebdomadaire« marxiste-léniniste » de Léon de Lépervanche : « PaulVergès ne peut pas être le meutrier de M. deVilleneuve. On l’accuse pour atteindre le père àtravers lui… » (1 PER87/1 Archives dépardementales)
L’homicide d’Alexis de Villeneuve a étésuivi d’une série d’arrestations, à com-mencer par celle du porteur de flin-gue, Raymond Orre, suivie dans lasoirée par celles de Paul Vergès, RogerBourdageau et Emile Quessoi. Le juged’instruction avait ordonné la recher-
che et l’interpellation de ceux qui étaient dési-gnés par des témoins directs comme étant lesauteurs et complices des coups et blessures por-tés à l’endroit d’Alexis de Villeneuve, Marsan etMorel Luçay… Robert Chaudenson, dans son ouvrage intitulé« Vergès Père, frères & fils – Une saga réunion-naise », explique qu’en 1946 Raymond Vergèsqui craint pour la sécurité et même la vie de sonfils, souhaite que le procès n’ait pas lieu à LaRéunion mais en métropole : « …grâce à depuissants appuis (celui, avéré, du PCF et celui,probable, du Grand Orient de France), en jan-vier 1947, le procès est « dépaysé » à Lyon, oùil se déroule, plus d’un an après les faits, en juil-let-août 1947… »Chantal Lauvernier est plus affirmative queRobert Chaudenson s’agissant du rôle du GOF :« Le Grand Orient intervint auprès du ministrede la France de l’Outre-mer pour le rappel deAndré Capagorry. L’obédience blâmait par ail-leurs les magistrats de Saint-Denis pour la pro-cédure engagée dans l’arrestation des inculpésaprès l’assassinat… » Mme Lauvernier préciseen outre que Raymond Vergès intervint direc-tement auprès du ministre socialiste AugusteLaurent, lequel organisa le renvoi du procès de-vant une cour de cassation pour cause de sûretépublique ; initiative suivie par le Conseil des mi-nistres qui ordonna au gouverneur Capagorryd’en dessaisir le Procureur général de LaRéunion. En conséquence, l’acte d’accusationde l’affaire débutait ainsi : « Le procureur géné-ral près la Cour d’Appel de Lyon expose que pararrêt de la Cour de Cassation du 5 janvier 1947,rendu pour cause de suspicion légitime et de sû-reté publique » les accusés Raymond Orre, PaulVergès, Roger Bourdageau et Emile Quessoi se-ront jugés par la Cour d’Assises du départementdu Rhône. La prise en compte de cette notionde suspicion légitime montre que le docteurVergès a été entendu lorsqu’il mettait en causela justice réunionnaise de son temps, en l’ac-
propagande communiste contemporaine de la tra-gédie et du procès. Raymond Vergès accusait sansvergogne les amis d’Alexis de Villeneuve d’avoirorganisé sa mort. Le sage docteur usait alors d’undiscours peu amène, bien loin de l’image de saintlaïque qu’on lui a collé depuis, stigmatisant le« complot cagoulard tramé par l’administration,le clergé, les puissances de l’argent… »L’Humanité écrivait à sa suite, en date du 28 mai1947 : « Les facistes ne reculent devant rien. Ily a des exemples. Qui n’a encore présent à la mé-moire l’assassinat de Doumer (par le russe blancGorgulov, entre les tours de scrutin de 1938) ?Qui ne se rappelle l’incendie du Reichstag, pro-vocation montée de toutes pièces par Goering ?Le 2 juin, la réaction craint la défaite. Elle ne re-culera, comme ses maîtres hitlériens, devant au-cune provocation anticommuniste… »Le 29 mai, le même journal titrait à sa Une : « Laréaction est responsable de l’attentat de LaRéunion ». Un jugement qui était loin d’être partagé par leplus grand nombre, à La Réunion surtout, carenfin, le gouverneur Capagorry était un gaul-liste de bon aloi, de fait adversaire des fascistes,quant à Raymond Vergès, il était de notoriétépublique qu’il avait collaboré, comme beaucoupd’autres alors. Gilles Gauvin rapporte les propos qui suivent,tirés du greffe de l’Assemblée nationale, séancedu 27 août 1946 : « Le Palais Bourbon est alorsle théâtre de joutes oratoires où l’argument dela Résistance et de la Collaboration est utilisédans un débat sur la fraude électorale. Le 27août (J.O. Assemblée nationale, 1e séance du 27août 1946), les députés, après avoir évoqué l’as-sassinat d’Alexis de Villeneuve, se focalisent surle comportement de Raymond Vergès durantla guerre. Un député métropolitain du MRP ac-cuse en effet le Réunionnais de collaborationen rappelant que l’une de ses conférences de1941 commençait par une citation du MaréchalPétain. Une voix du banc communiste lui ré-torque : « M. Vergès a envoyé ses deux filscomme volontaires dans l’armée ! » S’adressantalors à l’Assemblée, le député MRP demande àses collègues la validation de Marcel Vauthierélu en juin 1946 contre Raymond Vergès : « Vousvaliderez Marcel Vauthier parce que lui aussireprésente sur les bancs un patriote assassiné ».
« L’Histoire qui s’écrit Outre-mer se soumet encore trop à la logique de l’histoire exemplaire, celle qui tend à construire un récit édifiant… » Françoise Vergès
ACTE II
Au nom DU PÈRE « Kriegel-Valrimont
reconnaît quel’attitude de Vergèsn’était pas sansreproche…»
Prenant la défense de Vergès, le résistant com-muniste Maurice Kriegel-Valrimont expliqueque les lettres compromettantes pour son col-lègue réunionnais « lui ont été dictées dansl’exercice de ses fonctions ». Un député s’indi-gne alors : « C’est cela de la Résistance ! Eh bien! C’est joli ! » Finalement, Kriegel-Valrimont re-connaît que l’attitude de Vergès n’était pas sansreproches : « Je déclare en mon nom et en celuides députés qui siègent sur ces bancs, que, pla-cés dans une situation semblable, nous avonsjugé qu’il ne fallait pas agir ainsi». Dans la bou-che d’un Kriegel-Valrimont, qui s’était illustrédans une lutte sans compromission contre le na-zisme, une telle déclaration fait mal. Il est enoutre difficile de remettre en cause l’honnêtetéd’un homme qui après avoir dénoncé la pestefasciste, puis lutté contre le nazisme, eut la res-source alors qu’il était l’un des dirigeants duPCF, de dénoncer le stalinisme avant d’être ren-voyé à la « base » en 1961 et de quitter le Particommuniste.Le «Il ne fallait pas agir ainsi » de Kriegel-Valrimont, que l’on prendrait facilement au-jourd’hui pour une douce réprimande adresséeà un mauvais élève, recouvrait en un compor-tement de notable pétainiste, fort répandu à LaRéunion, sous le régime de Vichy.On a du mal à y croire, avec le recul, tant la propa-gande du PCR a fait de cet homme une icône. �
cusant d’être excessivement soumise à un gou-verneur gaulliste. Effet induit de ce dépayse-ment, « le procès devient pour une bonne part,celui de Raymond Vergès… » précise RobertChaudenson. Ironie de l’histoire, aujourd’hui Paul Vergès etle PCR font de la victime du 25 mai 1946 un hor-rible et violent réactionnaire, grâce à la plumed’Eugène Rousse dans Témoignages : « Certainsopposants à la transformation de la colonie de LaRéunion en département français en voulaient àmort à Raymond Vergès et à ses amis. Ils ont com-mis les pires crimes contre la démocratie et contreles Réunionnais pour tenter de s’opposer à cetteévolution statutaire et à l’application du prin-cipe d’égalité. C’est le cas notamment d’Alexis deVilleneuve, maire de Saint-Benoît… » qui « n’hé-site pas à organiser un grand rassemblement placede la Cathédrale à Saint-Denis le 25 mai 1946.Cette manifestation illégale, qui se déroule devantle domicile de Raymond Vergès, en présence deplusieurs dizaines de gendarmes et de policiers,se termine par un drame affreux : Alexis deVilleneuve est tué par balle au cours d’une échauf-fourée qu’il a lui-même provoquée… ». Ce faisant ils s’inscrivent en droite ligne dans la
Richement documenté,mais un tantinethagiographique, le livrede Chantal Lauverniercomporte un chapitreédifiant sur les enfancesdu héros.
11UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
AU NOM DU PÈRE
Q ui était donc le fameux RaymondVergès avant cette triste affaire Alexisde Villeneuve ? Témoignages, a pondu
des pages et des pages de littérature chantantles merveilleuses qualités morales du fondateurde la dynastie, sacrifiant ainsi à un culte de lapersonnalité très stalinien, toutefois mâtiné d’hé-roïsme épique. La magnification de la personnedu Père participe des « enfances du héros » com-munes à toutes les gestes, depuis le romand’Alexandre. N’y manquent que les signes etprodiges, peu recevables il est vrai dans un cor-pus d’inspiration marxiste. Et encore, ChantalLauvernier y a pourvu en parallèle, exhumant le
profil astrologique du grand homme. Extraits :« L’étude du thème astral du nouveau né signi-fiait que par la conjonction des positions duSoleil, de la Lune, de Mercure et de Vénus, lanaissance de l’enfant était intervenue sous l’in-fluence du lion, signe de feu. Par ce signe de nais-sance (lion) et celui de son ascendant (lion), lapersonnalité de l’individu devait, au cours del’existence, s’imposer avec force et audace, en in-citant à la confiance. Par ambition et vanité, ilaccepterait généreusement soucis et fardeauxd’autrui et sa domination sur le milieu le por-terait vers un rôle de conseiller, de protecteur.Doté d’une puissante volonté de travail, d’un es-prit lucide et logique, d’un sens rapide de l’ana-lyse, il posséderait les atouts d’un être richementdoué, promis à une réussite élevée, à une situa-tion de commandement… » Moralité son des-tin était écrit dans les astres et si par la suite,marxisme oblige, l’Histoire s’est substituée à laProvidence, rien d’étonnant à ce que les disci-ples de Paul, Pierre et les autres, offrent uneapothéose au fondateur de la lignée. Paul et sesfils peuvent ainsi attester d’une hérédité héroï-sée, un peu comme César, qui se prétendait filsde Vénus en passant par Iule, le fils de Romulus(fondateur légendaire de Rome). Témoignagesn’a rien négligé pour affiner l’image et la légendede l’ancêtre, ainsi qu’en attestent les 1 100 ré-férences en ligne de www.temoignages.re (Ndlr :lorsqu’on tape en Recherche « RaymondVergès »), archives numériques qui ne prennentévidemment pas en compte les milliers d’occur-rences de la très historique version papierconservée aux Archives départementales. Pourêtre fidèle aux sources biographiques, nous nousréférerons de loin en loin à la série biographi-que développée par Eugène Rousse, à partirdu 2 juillet 2007, à l’occasion du 50e anniver-saire de la disparition du fondateur du quotidiend’opinion communiste.« Marie, Louis, Adolphe Raymond Vergès est
né à Saint-Denis le 15 août 1882. Peu après lanaissance de Raymond, son père, un Dionysiende 26 ans, s’installe avec sa famille à Tamatave,où il exerce la profession de pharmacien. La mortprématurée de son épouse conduit le pharma-cien, aux revenus plus que modestes, à confierson fils unique à ses parents résidant à LaRéunion. Entouré de l’affection de sa grand-mèreHermelinde, et de sa tante Marie, l’enfance puisl’adolescence de Raymond se sont écoulées dansun climat propice à son épanouissement sur tousles plans… » S’agissant des enfances du héros,Eugène Rousse qui semble ne point priser lesrecherches généalogiques, se limite à la mentionde « grand-mère Hermelinde » et de « tanteMarie ». Pourtant le père de Marie, Louis,Adolphe Raymond Vergès, s’il a connu quelquesrevers de fortune à Madagascar, descend lui-même d’une famille qui disposait en 1848, annéede l’abolition, de biens notables. Ainsi, « grand-mère Hermelinde » est l’une des six enfants deCharles Henry Romain Million Desmarquets,aristocrate terrien plutôt aisé, lieutenant des dra-gons et chevalier de Saint-Louis, qui faisait tri-mer sur ses propriétés agricoles une populationesclave précisément détaillée dans le recense-ment annuel obligatoire. Figurent sur ce docu-ment les biens immeubles de l’habitant MillionDesmarquets et ses 121 esclaves, cités par leurnom, et répartis en fonction de leur âge, sexe,caste, couleur, cheveux, taille et profession.Grand-mère Hermelinde a donc vécu dans unepropriété, où l’on comptait « 15 noirs au-des-sous de 14 ans », « 56 noirs de 14 à 60 ans »,« 2 noirs au dessus de 60 ans », « 19 négressesau-dessous de 14 ans » et « 29 négresses au-des-sus de 60 ans ». Cette population servile étaitencore répartie par caste : « 66 Créoles », « 12Malgaches », « 59 Mozambiques (cafres), « 4Indiens ou Malais ».Hermelinde épouse le 22 mars 1855, à Saint-Denis, Adolphe François Joseph Vergès ; ils don-neront naissance à Charles Joseph Vergès, pèrede Raymond Vergès.Nous passerons sur la prime enfance du futurchef, sur sa scolarité, notamment au LycéeLeconte de Lisle où, toujours selon ChantalLauvernier, utile complément à la prose deRousse, « Raymond Vergès fut l’élève le plus bril-lant de sa génération. Il suscitait l’admirationde ses camarades qui succombaient à son talentd’orateur, attirés par la tenue de ses discours… »Le fait est que boursier car peu « friqué », ondirait ainsi de nos jours, le jeune homme rêvaitde faire fortune, comme tout le monde. A notertout de même cette anecdote significative rele-vée par la narratrice, dans son inimitable stylecandide : « De toutes les disciplines enseignées(dans lesquelles Raymond Vergès excella avec uneégale aptitude), l’histoire reçut les faveurs dujeune homme marquant son esprit sur le planmoral et philosophique : les héros français de lapériode révolutionnaire (1789) devinrent selonsa propre définition l’incarnation frémissante dela Révolution dans ce qu’elle eût des plus profon-dément désintéressé (sic). Il n’acceptait pas l’idéeque Robespierre fut jugé comme un monstre. « Legrand Conventionnel lui apparaissait comme unevictime, « calomniée , puis assassinée (sic)… »Bref, d’une chose à l’autre, le brillant lycéen de-
vint par la suite, ingénieur en agronomie tropi-cale, après avoir fait une licence de sciences etfaute, selon Robert Chaudenson, d’avoir pu bé-néficier de la bourse qui aurait pu lui permet-tre d’accéder à une classe préparatoire auxgrandes écoles. Puis, il travaillera en Chine dansune société qui construisait des chemins de fer,reviendra en France, où il sera mobilisé en 1914après avoir débuté deux ans plus tôt un cur-sus en médecine. Blessé au combat et à plu-sieurs reprises, comme tant d’autres, il finira sesétudes de toubib en 1919 à l’âge de 38 ans. En1920 il repart en Chine où il enseigne à Shangaï,avant de décrocher un job de médecin-chefdans le bas-Laos. En 1925 il devient responsa-ble du dispensaire d’Oubône au Siam(Thailande), et Consul de France par la mêmeoccasion. Il y fera preuve d’un véritable zèle ad-ministratif, pistant communistes et bolchévi-ques dont il démonçait fidèlement les menéesauprès de la légation de France au Siam. Il vajusqu’à dénoncer un trafic de vin de messe, viala valise diplomatique, orchestré par un certainPère Chatenet… Nous passerons sur les hautset les bas de sa vie privée, la mort de sa pre-mière femme, Jeanne, mère de ses deux pre-miers enfants, son concubinage avec KhangPham-Thi, qui lui donne deux fils, JacquesCamille Raymond et Paul Emile Marie Just.
Son mariage en 1928, trois ou quatre ans aprèsla naissance de ses derniers fils. Le trépas dela mère de Jacques et Paul à La Réunion le 24novembre 1928, à La Réunion, lors d’un congéadministratif. Chassé à courre en Indochine parceux-là même qu’il avait inquiétés, victime decalomnies, il ne rejoindra pas son poste deconsul en Thailande, mais sera nommé en 1930médecin-chef de la province de Quang-Tri enAnnam… après avoir été blanchi des accusa-tions portées contre lui par son remplaçant etle fameux père Chatelet. Mais son état de santénécessite un rapatriement d’urgence sur la mé-tropole. Il quittera la colonie indochinoise avecune médaille de première classe décernée parle roi d’Annam sur incitation du gouvernementgénéral d’Indochine. Il ralliera La Réunion fin1931, suite à sa nomination de médecin-chef dela station d’Hell-Bourg et sera bombardé chefdu service de Santé en 1934.En 1935 il est élumaire de Salazie. Franc-maçon (Grand Orientde France), membre éminent de la Ligue desdroits de l’homme, il devient, en 1938, secré-taire général de la Fédération des syndicats defonctionnaires de La Réunion, qui revendiqueson apolitisme. Il soutiendra néanmoins le FrontPopulaire en mai 1937, avant de quitter LaRéunion, la même année, avec Jacques et Paulpour un long congé administratif. �
Les enfances de Raymond
Chassé à courre en Indochine par ceux-là même qu’il avait inquiétés
De retour à La Réunion, Raymond Vergèsconnaîtra de loin l’effondrement de la
France consécutif au début de la seconde guerremondiale et à l’occupation du sol national par lesforces nazies. L’armistice signé le 22 juin 1940par Pétain consacre la défaite et installe les for-ces allemandes dans la vie quotidienne desFrançais.
Le gouverneur Aubert, arrivé dans l’île le 27 fé-vrier 1940, réunit à Saint-Denis une « commis-sion consultative de défense » composée denotables de la colonie, dont le Docteur Vergès.Il s’agit d’opter pour la fidélité à Pétain ou pourla poursuite de la lutte aux côtés des anglais…Consulté, le Docteur Vergès déclare au chef dela colonie : « En tant que fonctionnaire, je vousobéirai…», tout en agrémentant son allégeanceadministratives de considérations patriotiquesfleurant bon la rhétorique : « En tant qu’homme,il m’est extrêmement pénible de voir la Francefoulée aux pieds ; et je crois qu’il est du devoirde chacun de nous d’envisager de lutter aux côtésde n’importe qui pour le salut de la France… »Le fait est qu’après discussion, la décision estprise de servir le maréchal Pétain qui avait ins-tallé son gouvernement à Vichy. Et Témoignages de commenter :« Fonctionnaire discipliné, le Docteur Vergèsle sera pendant les 27 mois du régime de Vichy.La guerre terminée, son obéissance au représen-tant local du maréchal Pétain sera le grief ma-jeur que lui feront inlassablement ses adversairespolitiques. » Il est vrai que le franc-maçon-li-gueur-syndicaliste, bénéficie d’extraordinairesfacilités sous le régime de Vichy. En août 1940,la loi contre les « sociétés secrètes », maçonne-rie en premier lieu, est étendue à La Réunion.Raymond Vergès passe à travers et conserve sesfonctions administratives, quand instituteurs etpetits fonctionnaires sont destitués et privés deleurs droits à la retraite. Or pour Pétain et le ré-gime de Vichy, l’appartenance maçonnique est
L’ombre de Vichy et la collaboration molle
�������������������������
12 UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
AU NOM DU PÈRE
L’administration tenaitun compte exact dupatrimoine despropriétaires de LaRéunion : “Les feuillesde recensement fourniespar les propriétairesd’esclaves devront (…)mentionner lesnaissances, les décès ettoutes les mutationssurvenues parmi les ditsesclaves…”
13UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
AU NOM DU PÈRE
En 1848, année de l’abolition,
la famille Millon Desmarquets,
celle de la grand-mèrede Raymond Vergès,
Hermelinde, possède 121 esclaves.
14 UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
AU NOM DU PÈRE
La Légion française des combattants, créée le 29août 1940, est le mouvement populaire du régimede Vichy, chambre d’écho d’où le régime sondel’opinion mais aussi et instrument pédagogique dela Révolution nationale. Elle a pour insigne « l’éculégionnaire » composé d’un écusson tricolore por-tant le casque gaulois et une épée.Sa première mission sera de pratiquer une épu-ration municipale en révoquant tous ceux quipourraient ne pas être fidèles à Pétain. La res-ponsabilité de l’exportation du pétainisme outre-mer incombe au Ministère des Colonies, plusprécisément à l’Amiral Charles-René Platon, quis’impliqua beaucoup pour que la Légion fran-çaise des combattants et la législation anti-juivede Vichy, soient exportées aux colonies.Rapidement, querelles de pouvoir et oppositionsentre tenants de Pétain et de l’amiral Darlanaffaiblissent la Légion dont l’essentiel de l’acti-vité, les « journée légionnaires » et autres « jour-
nées du Secours national » tournent à des cé-rémonies de culte au maréchal Pétain. Un phé-nomène qui s’accentue encore avec la créationdu Service d’ordre légionnaire (SOL), en juin1942, initiative des ultras qui noyautent laLégion. Un Service d’ordre légionnaire qui semétamorphosera en Milice - de triste mémoire- courant janvier 1943. A titre d’exemple, PaulTouvier a adhéré à la Légion française des com-battants le 30 octobre 1940. En avril 1942 il estnommé secrétaire du SOL à Chambéry. En jan-vier 1943 il rejoint la Milice. Pour illustrer la phi-losophie de ces mouvements, de la Légion à laMilice, un rappel des mots d’ordre de SOL estéloquent : chaque participant ou communiantdoit s’engager « contre l’Egoïsme bourgeois, leScepticisme, l’Individualisme, l’Egalitarisme, leCapitalisme international, la Franc-maçonneriepaïenne, la Dissidence gaulliste, le Bolchevismeet la Lèpre juive »(Sic). �
un crime pire que la judéité. (Ndlr : voir Pétainet la maçonnerie).Donc, le fait que Raymond Vergès, maçon no-toire, puisse adhérer à Légion française des com-battants, pilier du régime de Pétain (Ndlr : lirenotre encadré De la Légion à la milice), est éton-nant. Il est à noter que nombre d’autres ancienscombattants réunionnais s’y refusent. Le 5 octobre 1940 Raymond Vergès écrit au gou-verneur Aubert : « Je m’engage donc personnel-lement à suivre, avec un entier loyalisme, legouvernement français, ainsi que son chef, le ma-réchal Pétain… » ; ce qui lui vaut de la part dugouverneur ce commentaire : Raymond Vergèsa adopté « l’attitude d’un très net loyalisme ».Ayant démissionné de son mandat de maire deSalazie en 1940, le gouverneur Aubert le rétablitdans ses fonctions électives dès février 1941.En novembre 1941, suite à la lettre du gouver-neur Aubert appelant les fonctionnaires réunion-nais à se montrer loyaux vis-à-vis du MaréchalPétain, Raymond Vergès en tant que chef du ser-vice de Santé transmet ses ordres à ses subor-donnés : « J’attire votre attention sur la disciplinedont vous avez l’obligation impérieuse de donnerl’exemple. Il n’est pas possible de concilier lesavantages qu’on retire d’une fonction publiqueavec un comportement hostile, voire rétif enversle gouvernement qui rétribue cette fonction etsi on entend agir autrement, l’honnêteté la plusélémentaire consiste à se démettre. Je sais quela grande majorité d’entre-vous sinon tous voussuivez les directives de fidélité et de loyauté qu’onvous a données… »Le 31 mai 1942, il prend part à la cérémonie deprestation de serment des légionnaires sur laplace du Gouvernement, autour de la statue deRoland Garros : discours nationalistes enflam-més, serment d’allégeance collectif, brassard tri-colore, bras tendu, selon le salut mis à la modeen ce temps là par Mussolini et Hitler…Cette appartenance à la Légion des combattantsest incriminante, car Raymond Vergès ne secontentera pas d’y figurer profil bas. Ce qui luivaudra un jugement peu amène du Feuillet, or-gane de presse gaulliste, publié le 29 juillet1943. Le Feuillet décrit Raymond Vergèscomme «un personnage en mal de situation etde prébende, qui fut, sous tous les gouverne-ments depuis plus de 10 ans – jusque et y com-pris Aubert Pillet dont il assiégeait les bureaux– en mal d’amélioration de situation, de prében-des ; lui qui se lance dans des couplets sur labourgeoise, alors qu’il fit tant de démarches au-près de nombre de bourgeois, dont l’un prési-dent du Conseil Général, toujours pouraugmentation de situation (…) Lui qui parle del’argent comme corruption de la part de celuiqui donne et de celui qui reçoit, alors que partous ses avantages il a une situation créée spé-cialement pour lui, de plus de 100 000, soit uncapital de 2 millions à 5% ; alors que dans sasuite, la situation de certains touche à la mi-sère ! (…) Lui qui exposait sa majestueuse suf-fisance dans toutes les clowneries vichystes,notamment à la fameuse cérémonie des sachetsde terre de Gergovie. Et lui qui faisait de mul-tiples serments aux Vichystes avec la ferme in-tention de ne pas les tenir… comme il les auraitfaits, les ferait à n’importe quel gouvernement.M. le gouverneur Capagorry a un exemple dela valeur de tels serments… de ralliement beef-teak et prébendes… » �
En 1940 le régime de Vichy s’installe à LaRéunion, dans un climat assez défavorable
tout de même. Pourtant au fil des mois, il va s’im-planter, se renforcer jusqu’à retourner complè-tement l’opinion. Pour ce faire il va utiliser tousles moyens dont il dispose : la confiance dansle Maréchal Pétain, l’homme de Verdun, l’exploi-tation des agressions anglaises afin de battre enbrèche la popularité britannique, l’instaurationd’un système autoritaire et une propagande soi-gneusement orchestrée dans laquelle chacun,jeune et moins jeune, aura un rôle à jouer.Le 29 juin 1940, au cours d’une réunion au som-met où il a réunit les personnalités les plus im-portantes de l’île, le gouverneur Aubert a réussià renverser la vapeur. Tous, malgré leur désirde poursuivre la lutte avec les alliés, ont renou-velé leur confiance en le gouverneur et dans lerégime qu’il représente. Pierre Aubert peut setranquilliser. Le soir même, il reçoit confirma-tion de la justesse de sa décision. Les instructionstant attendues du ministre des colonies sont enfinarrivées et sont pour le moins précises : le gou-vernement, après le chaos qui a accompagné etsuivi la signature de l’armistice, est sur le pointde quitter Bordeaux pour s’installer à Vichy. Ilreprend par ailleurs le pays et l’Empire en main.Toute une série de lois suivra et ces lois serontapplicables à La Réunion aussi. Si la colonie nesubit pas les excès de la métropole avec l’occu-pation, les déportations, la milice, le service detravail obligatoire (STO), les Français livrantd’autres Français aux Allemands, elle connaîtraquand même les rigueurs d’un état policier oùla liberté d’expression ne sera plus de mise. Lepremier objectif du gouvernement est de bri-ser tout élan qui porte les Réunionnais vers
Maurice et les Anglais. On retrouve les fermentsde l’anglophobie : vieilles rancœurs contreMaurice datant de La Bourdonnais renforcéespar le perpétuel contraste entre la prospéritémauricienne et la pauvreté réunionnaise ; répu-gnance et méfiance envers l’Anglais héritées desguerres des XVIIIe et XIXe siècles. Mais le désirde poursuivre le combat - à l’image du Généralde Gaulle - est plus fort que les anciennes que-relles et personne n’hésiterait à filer vers Mauricepour rejoindre les rangs des anglais. « L’actiondu Général de Gaulle est unanimement approu-vée et on le considère comme la seule porte desortie dans la situation actuelle », peut-on liredans un rapport des renseignements généraux,daté du 2 juillet 1940. Paradoxalement ce sontles Anglais eux-mêmes qui vont fournir au gou-vernement l’occasion d’atteindre son objectif. Le3 juillet 1940, à Mers-el-Kébir, la flotte anglaisetire sur des navires français à l’ancre, tue des ma-rins français. Cette manœuvre aura pour effet defaire remonter dans le piège de Toulon une flottequi restait relativement libre en Afrique du Nord; surtout elle détournera une partie de l’opinionde la cause anglaise. Inutile de préciser que lapropagande de Vichy s’empare de l’événement.Cependant, à La Réunion, son écho n’est pas suf-fisant pour que les habitants abandonnent tota-lement les idées d’hier. Il en faudra plus. Le 22juillet 1940, les relations avec la Grande-Bretagne sont rompues. Mais dans l’océanIndien, on tente de maintenir le contact. Il estvrai que Maurice, Madagascar et La Réunion ontintérêt à maintenir leurs relations sous les meil-leurs auspices : il y a chez l’un des marchandi-ses dont l’autre aurait besoin ; à la réunion setrouvent des démobilisés mauriciens en attente
De la Légion à la Milice
Vichy et La Réunion la drôle d’histoire
���������������������������������������
de leur rapatriement, et à Maurice des soldatsréunionnais capturés par la marine anglaise surle « ville de Majunga ». Le blocus britannique,décrété le 30 juillet, n’a donc pas de répercus-sion immédiate sur le plan local. Cependant le6 août, les colonies sont incitées à « s’opposerpar la force à toute attaque ou violation du ter-ritoire et à tout coup de main anglais ».
Blocus anglais. Et le 23 du même mois,le blocus anglais devient effectif dans l’océanIndien. Seules les relations télégraphiques serontmaintenues pendant toute la durée de la guerre,relations contrôlées bien sûr. Voilà donc la prin-cipale conséquence de la mise en place du ré-gime de Vichy. A l’intérieur du pays, la premièregrande réforme touchera les institutions. 10 juil-let 1940. Le Maréchal Pétain obtient les pleinspouvoirs. Dès le lendemain il publie ses actesconstitutionnels numéros 1, 2, 3 ; suit un rema-niement ministériel. Aux colonies, Lémery rem-place Rivière. Sur le papier à en-tête « Etatfrançais » prendra la place du mot «République»et la devise de ce nouvel état sera « Travail,Famille, Patrie ». La réforme des institutions lo-cales suit immédiatement celle des institutionsnationales. Son principe : remplacer le systèmeélectoral par la désignation gouvernementale.
Seules les relationstélégraphiques seront maintenuespendant toute la durée de la guerre
15UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
AU NOM DU PÈRE
La loi du 13 août 1940 qui dissout les sociétés se-crètes est motivée par la référence à des risques
de sabotage de « l’oeuvre de redressement na-tional » imputables à des fonctionnaires apparte-nant à la franc-maçonnerie : « Leur activité tendtrop souvent à fausser les rouages de l’Etat et à pa-ralyser l’action du gouvernement. »La publication de la loi au Journal officiel du 14août s’accompagne donc de deux formulaires àremplir par tous les fonctionnaires de métropoleet des colonies… Dans le premier, le signatairedéclare n’avoir jamais appartenu à la franc-ma-çonnerie et prend l’engagement de ne jamais yappartenir. Dans le second, le fonctionnaire avoueavoir été membre d’une société secrète, préciseà quelle date il a rompu toute attache avec lafranc-maçonnerie, s’engage à ne plus jamais yadhérer. Toute fausse déclaration vaut démis-sion d’office. Le Feuillet du 29 juillet 1943 signalele fait que Raymond Vergès a signé « un enga-gement d’honneur aux Vichystes de ne plus ap-
partenir à une loge, pour ne pas voir diminuer sesprébendes… »Les mesures de 1940 sont renforcées par Darlanet son ministre de l’Intérieur, Pierre Pucheu, pours’assurer de la sincérité des fonctionnaires francs-maçons vis à vis de Pétain. Ils ajoutent donc aupremier texte, une nouvelle loi (11 août 1941)qui interdit aux anciens dignitaires et hauts gra-dés de la franc-maçonnerie (Ndlr : les maîtres desloges bleues sont assimilés à des dignitaires), l’exer-cice des fonctions publiques listées par l’article 2du statut des juifs du 2 juin 1941. Les fonctionnai-res qui tombent sous le coup de ce texte sont dé-clarés démissionnaires d’office. Par ailleurs, àpartir du 12 août 1941, le Journal officiel dévoileles noms de 18 000 francs-maçons. Parallèlement,plus de 3 000 fonctionnaires sont révoqués. La Légion française des combattants qui accèdeaux listes de maçons, les passe en revue, de façonà procéder à l’épuration de la fonction publique. La position du régime de Vichy face à la maçon-nerie est clairement exposée par Pétain, le 30août 1942, à Gergovie où il la dénonce devantles membres de la Légion française du combat-tant : « Une secte, bafouant les sentiments les
plus nobles, poursuit, sous couvert de patrio-tisme, son oeuvre de trahison et de révolte. » Enjanvier 1943, il récidive : « Vous ne devez pas hé-siter. La franc-maçonnerie est la principale res-ponsable de nos malheurs ; c’est elle qui a mentiaux Français et qui leur a donné l’habitude dumensonge. Or, c’est le mensonge et l’habitudedu mensonge qui nous ont amenés où nous som-mes. » Enfin, Pétain résumera sa pensée danscet aphorisme : « Un juif n’est jamais respon-sable de ses origines ; un franc-maçon l’est tou-jours de ses choix. » Fait plaisant, le Docteur Vergès qui après sa pé-riode pétainiste et sa brève conversion gaulliste serevendiquera du communisme, ne sera pas plusennuyé par le PCF pour son appartenance ma-çonnique qu’il l’avait été par les pétainistes.Pourtant le Parti vouait les maçons aux gémoniesquasiment dans les mêmes termes que les pétai-nistes et les nazis : « La dissimulation par quiconque de son appartenance à la franc-maçon-nerie sera considérée comme une pénétrationdans le parti d’un agent de l’ennemi et flétrira l’in-dividu en cause d’une tache d’ignominie devantle prolétariat. » �
PÉTAIN ET LA MAÇONNERIE
Les parlementaires, relativement hostiles à Vichy,ne participeront pas à la vie politique nationale.Le député Brunet et le sénateur Bénard se re-tireront dans le midi de la France durant toutela guerre. A La Réunion, on élimine les mem-bres « douteux » du conseil privé, commeAnatole Hugot, ou le conseiller suppléant LeVigoureux, soupçonnés de sentiments anglophi-les. Le Conseil Général, quant à lui, est mis ensommeil, de même que la commission colonialeest dissoute. Plus tard une commission admi-nistrative dont les membres seront désignés parle gouverneur Aubert remplacera le ConseilGénéral. Enfin un arrêté ministériel du 16 oc-tobre 1942 remplacera cette commission par unconseil local composé de vingt-neuf membres.En septembre 1941 un conseil économiqueconsultatif est instauré. Dès le début, les mai-res et conseillers municipaux des différentescommunes sont démis d’office. Tous ces conseilsferont allégeance au gouverneur, au MaréchalPétain et une tournée d’Aubert dans les commu-nes sera l’occasion de déclarations favorables aurégime de Vichy. Outre la mise en place des ins-titutions de Vichy, on va voir, en France, la nais-sance du culte du Maréchal. On respectel’homme de Verdun et beaucoup pensent qu’ilest impossible que cet homme-là ait « vendu laFrance ». A La Réunion, ce cas de consciencene se pose pas. Puisque le Maréchal parle deredressement de la France, de conscience natio-nale, de réhabilitation par le travail, de moraleà inculquer à la jeunesse, on est prêt à le suivre.Beaucoup de réunionnais vont abandonner, ou-blier leurs hésitations d’hier, pour foncer avecobéissance dans la nouvelle voie qui leur est tra-cée. Les mesures autoritaires du nouveau gou-vernement, la restriction des libertésindividuelles choquent peu. Bien souvent onpense que cela s’avère nécessaire après le chaosdes années précédentes qui a entraîné la Francedans la défaite. Et puis lorsque l’on est à des mil-liers de kilomètres de la métropole et que l’on ne
sait pas ce qui s’y passe réellement, il est plusfacile de suivre un gouvernement sous influence.La Réunion aura la chance d’être « libérée »au moment où, avec l’occupation de toute laFrance par les Allemands, la cause de Vichy de-vient de plus en plus difficile à défendre. En effetsi la propagande a développé chez beaucoup lesentiment d’anglophobie, les Réunionnais sontrestés farouchement anti-allemands.
Arrivée du Léopard. A l’arrivée du« Léopard », l’île prendra, toujours de façon do-cile, un nouveau virage. La très grande majo-rité de La Réunion pense ce que la propagandelui dit de penser et seuls la haine de l’envahis-seurs et l’amour de la patrie restent constants.Même du côté de l’Eglise on retrouve cetteobéissance à Vichy. « A La Réunion, on se ré-volte pas contre le Gouverneur », diraMonseigneur de Langavant. Lui-même, anciencombattant, signataire au 20 juin 1940 d’une mo-tion adressée au gouvernement local et deman-dant de poursuivre la lutte au sein d’un pactefranco-britannique, ne peut, le 29 juin, que sui-vre le gouvernement légal. Ainsi dans une let-tre pastorale de mars 1941, l’évêque écrit entreautres : « La République n’existe plus ; seule, laFrance demeure. Le gouvernement des partis po-litiques a aussi disparu ; désormais le pays estentièrement représenté par celui qui le gouverne.On l’a déjà dit, nous le répétons, parce que c’esttout à fait exact : « la France c’est Pétain ». Biensûr tout le clergé ne sera pas d’accord avec cettevision des choses. Mais les prêtres qui montre-ront ouvertement leur désaccord, seront, sur de-mande du gouverneur, déplacés de leursparoisses. (…)En septembre 1941 on crée un bureau de presseadministré par le chef de cabinet Pillet. Cette créa-tion marquera le début des grandes « opérationspublicitaires » en faveur de Vichy. Mais on n’a pasattendu ce moment pour répandre, par tous les
moyens, l’optique officielle. Le premier moyen est,bien évidemment, la radio. Les émissions, quel-ques dizaines de minutes matin et soir, se com-posent d’un peu de musique, de quelquesinformations, filtrées bien entendu, et surtout dubillet quotidien de Jean-Jacques Pillet dirigé contreles Anglais et les Gaullistes. Cependant on se rendtrès vite compte que les possesseurs de radio (plusde mille fin 1941) n’écoutent pas seulement lesémissions locales ; ils ne se privent pas d’écouterMaurice ou les programmes français de Londres.Qu’à cela ne tienne ! On va étendre à La Réunionles lois sur la limitation de l’écoute radiophonique.De fait, le 29 novembre 1940 un arrêté interdit «laréception sur la voie publique ou dans les lieuxouverts au public, des émissions radiophoniquesdes postes britanniques et en général, tous postesse livrant à la propagande antinationale ». Les pei-nes pour infractions vont de seize à cent francs etde six jours à six mois de prison. Le 11 novembre1941, un deuxième arrêté étend cette interdic-tion à tous les lieux, privés ou publics. Les peines,quant à elles, passent de deux cents à dix millefrancs, et de six jours à deux ans de prison. Un moisauparavant un autre texte légal a déterminé lesconditions du contrôle de la presse, de la radiopho-
nie, des documents cinématographiques, phono-graphiques et photographiques. Et vive la censure!Cet arrêté, daté du 22 septembre 1941 soumet tousles journaux à un contrôle avant impression. Leslimites des émissions radiophoniques, des films ci-nématographiques sont également définies avecbeaucoup de rigueur et leur diffusion est soumiseà autorisation administrative préalable. Le mêmejour un second arrêté rattache au bureau de pressede monsieur Pillet le service de radiodiffusion.Mais il faut dire que de son côté la presse écritea, aussi, largement participé à la diffusion de la pro-pagande pétainiste. Elle a d’ailleurs abondammentfustigé les auditeurs de Rdio-Londres. Ainsi dansLe Peuple du 23 juin 1941 on pouvait lire : « Ilfaut écouter Radio-Londres si, Français douteux,à l’âme indécise et trouble, on reste attaché, parsnobisme, par ignorance ou par intérêt - plus qu’àsa propre patrie - au pays dont des gouvernementssuccessifs, à des siècles d’intervalle, ont brûlé viveJeanne d’Arc, fait mourir Napoléon sur son rocher,et insulté le Maréchal Pétain, sauveur de l’unitéfrançaise ». En revanche certains journaux,comme Le Progrès, ne sont pas très enthousias-tes à diffuser les thèmes de la « révolution natio-nale » du Maréchal Pétain. Cela leur vaudranombre de colonnes blanches et parfois l’interdic-tion et de la saisie totale du numéro. Mais tous cessupports sont sans doute jugés insuffisantspuisqu’un nouvel organe de presse « Chanteclerc»voit bientôt le jour et tire à 1 500 exemplaires.Le gouvernement achète à ces journaux la pu-blication d’articles de propagande, et certains jour-nalistes locaux rédigent, moyennant finance, desbillets virulents contre les Alliés ou les Français li-bres. L’exploitation d’événements tels Mers-el-Kébir, la Syrie, le blocus de Djibouti en mai 1941,les bombardements de la région parisienne enmars 1942, l’attaque de Diégo-Suarez – OpérationIron Clad - toujours en 1942 est faite à outrance.En 1941 un comité de propagande Pétain estcréé. Composé de personnalités et fonctionnai-res locaux, volontaires de la Révolution Nationaleet présidé par Armand Barau, ce comité a pourbut de rassembler ceux qui souhaitent « de tou-tes leurs forces et par tous les moyens, servir leMaréchal, chef de l’Etat, son gouvernement et lacause de la révolution ». La propagande se faitaussi par le biais de conférences et un certainnombre d’orateurs locaux se feront la voix de lapolitique de Vichy. Par ailleurs, à chaque visite denavire de guerre, le commandant est invité à pro-noncer un discours. Mais le plus surprenant restesans doute la mise en place, à partir d’août 1941,d’un « service des petits bruits ». Dans une let-tre confidentielle qu’il envoie le 27 août 1941 auChef de la Sûreté, le gouverneur en explique leprincipe : « au nombre des mesures appelées àdiffuser dans le public les idées et la doctrine dela Révolution Nationale, le « comité de propa-gande sociale du Maréchal » a conçu et organiséla propagande du « bouche à oreille ». Il s’agitde faire pénétrer dans la masse des thèmes d’ar-gumentation, des informations propres à établirun « climat » politique et une interprétation desévénements propres à faciliter l’action du gouver-nement.
Propagande à tout va. Pour cela, il estnécessaire de former un corps de propagandis-tes bénévoles, éprouvés, ayant à la fois du tact etdu dynamisme, auxquels une documentation pé-
le « comité depropagande sociale du Maréchal » a conçu et organisé la propagande du« bouche à oreille ».
���������������������������������������
16 UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
AU NOM DU PÈRE
riodique et des mots d’ordre pourraient être don-nés, qu’ils se chargeraient de répandre, soit di-rectement, soit par d’autres personnes,parfaitement connues d’eux, et capables, à leurtour, d’éclairer l’opinion, dans les conversationsprivées ou publiques... ». La jeunesse est par-ticulièrement visée par la propagande de Vichy.On tient à inculquer aux jeunes les notions demoralité, le respect du travail, l’amour de laPatrie et la confiance en son relèvement, etsurtout une « saine réaction contre les façonsd’antan, les habitudes de facilités, le relâche-ment de l’autorité entraînant la confusion despouvoirs et le favoristisme... Les causes denotre faiblesse et sans doute de notre défaite». Et dans son discours du nouvel an 1941 c’està cette jeunesse que s’adresse particulièrementle gouverneur Aubert. Mais si les jeunes par-ticipent aux manifestations patriotiques, lesmouvements de jeunesse - scoutisme ou socié-tés sportives - n’auront qu’une faible extension,faute d’encadrement approprié. La politiquefait également son entrée à l’école. Une listedes ouvrages exclusivement autorisés dans lesécoles et collèges est envoyée au Gouverneuravec un télégramme du ministre des colonieslui demandant de « Veiller à ce que école ani-matrice de l’unité française enseigne le respectde la personne humaine du travail, de la fa-mille, de la société, de la mère-Patrie... ». Dansles collèges et lycées, la cérémonie des cou-leurs est l’occasion d’une médiation quoti-dienne sur une « pensée du Maréchal ». Uncertain nombre de jeunes seront également in-corporés à la jeune garde du Maréchal.Plusieurs associations patriotiques rassemblentchez les adultes les partisans du maréchal.Parmi ces associations est née en septembre1940 la Légion des combattants et volontai-res de la Révolution Nationale présidée parRieul Dupuis et Roger Payet. Elle comptemille cinq cents membres. Les associations pé-tainistes ont l’occasion de se manifester aucours de nombreuses fêtes patriotiques. Pourbeaucoup appartenir à ces associations relèveplutôt de l’obligation comme on pourra leconstater en juillet 1941, lors de la semaine dela France d’outre-mer. Le 20 du mois estconsacré au clou des manifestations : la pres-tation de serment des volontaires, sur l’espla-nade du Barachois, récemment nommée «esplanade Maréchal Pétain ». Face aux tribu-nes officielles un millier de légionnaires, au-tant d’élèves des écoles et 250 hommes detroupe. Après les allocutions du maire deSaint-Denis, du Gouverneur, du Président dela Légion, les légionnaires prêtent serment defidélité au Maréchal. Beaucoup sont venusparce qu’ils ne pouvaient faire autrement etdans les jours qui suivront la cérémonie, leGouverneur expédiera à des fonctionnairesdont l’absence a été remarquée un certain nom-bre de lettres. Le gouverneur leur demande desexplications « pour apprécier l’opportunitéd’une sanction à leur encontre ». Ceux qui nefourniront pas d’excuse valable, feront l’objetd’un avertissement, voire d’une mutation. Onne plaisante pas avec le culte de Pétain. �
Publié initialement le 1er janvier 2005 dans le JIRSulliman Issop. « La Réunion et le régimede Vichy » (1e partie).
Le Feuillet, du 29 juillet 1943, dresse un portrait peu amène du Dr. Vergès. (1PER153/1 Archives dépardementales)
17UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
18
ACTE III
Paul Vergès, qui vient de sortir de laclandestinité en juillet 1966, harangue ses
troupes avant de quitter l’île pour la métropole.(Photos Antoine CHION HOCK - Collection S.I )
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
dans lequel se sont déroulés les faits auxquelsnous nous référons. Les démocraties ont terrassé un totalitarisme enécrasant les forces de l’Axe, mais c’est au prixd’une alliance avec un autre monstre de mêmenature, le régime stalinien de l’URSS. Et encore,cette union qui a permis aux communistes fran-çais de se proclamer « parti des fusillés » et derevendiquer la résistance intérieure, n’a-t-ellepu se réaliser qu’après l’échec du pacte ger-mano-soviétique signé les 19 et 23 août 1939,et l’agression unilatérale d’Hitler sur l’empiresoviétique. Auparavant, Hitler et Staline s’étaiententendus comme larrons en foire pour se par-tager la Pologne, prologue à l’invasion de laBelgique et de la France par le IIIe Reich, ainsique l’annexion de la Finlande et de la Bessarabie
roumaine par Staline. En ce temps-là, le Parti Communiste Français,totalement sous contrôle soviétique, ne trouverien à redire au pacte Ribbentrop-Molotov, pasplus qu’il ne condamne l’entrée de l’Arméerouge en Pologne, le 17 septembre 1939. Et sien France métropolitaine des syndicalistes ré-sistent dès le 15 novembre 1940, neuf dirigeantsde la CGT et trois de la CFTC, signant le« Manifeste des Douze », il convient de préciserque ces syndicalistes courageux n’étaient pas duParti. Il faudra attendre le 22 juin 1941, datede l’invasion de l’URSS par les troupes d’Hitler,pour que les communistes français entrent dansla résistance, une fois l’ordre venu de Moscou.
19
ACTE III
« C’est depuis le présent qu’on regarde le passé… » Françoise Vergès
Ce n’est certes pas Raymond Vergèsqui a tué Alexis de Villeneuve, maisc’était à son profit qu’était organiséela contre manifestation qui a servi dedécor au drame, c’est avec son armede service que les coups de feu ontété tirés, et ce sont ses militants en-
gagés dans l’algarade fatale à de Villeneuve, aupremier rang desquels son fils Paul, qui ont ététraduits en justice. Paul Vergès a été condamnépour ces faits, peine amnistiée en 1953 ; il lereconnaît dans le livre écrit en 2000 par ThierryJean-Pierre. Il est difficile aujourd’hui d’imagi-ner le chaos engendré par les forces qui sont auxprises dans l’immédiat après guerre, contexte
La tentation dela violence
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
20
LA TENTATION DE LA VIOLENCE
A La Réunion, faute d’occupation, c’est un « vi-chysme » à 100% franco-français qui s’est ré-pandu sur la société insulaire. Les actes derésistance n’y ont pas été nombreux et l’on estfier de pouvoir citer aujourd’hui l’industrielMaurice Samat qui rejoint l’île Maurice par ba-teau dès le 28 octobre 1940 pour s’engager dansla RAF ; le prince Vinh-San, empereur d’Annamexilé à la Réunion, qui s’est illustré es qualitéde radiophoniste de la France Libre, le syndica-liste marxiste Léon de Lepervanche condamnéà trois mois de prison en novembre 1941…Raymond Vergès ne figure pas au nombre de ceshéros. Quant à ses jeunes fils, ils s’engagerontdans le camp de laFrance libre le 28 novembre1942, après le ralliement de l’île à De Gaulle,suite au fait d’arme du contre-torpilleurLéopard. La Réunion ne rejoindra De Gaulleque bien après les Nouvelles Hébrides (juillet1940 ), le Tchad, l’Afrique équatoriale françaiseen août 1940, et la Nouvelle-Calédonie le 19 sep-tembre 1940. Le Gouverneur Capagorry n’appliquera pas sé-vèrement les ordonnances de 1944 sur l’épura-tion, estimant que le pétainisme local n’était pasassimilable à une collaboration avec les nazis,faute d’occupation véritable. La chose s’expli-que encore par le fait qu’aux yeux des FrançaisLibres, c’était une épuration des esprits qu’il fal-lait y mener, avec pour finalité une réhabilita-tion exemplaire des valeurs de la République. Eric Jennings, de l’Université de Toronto, dans« Les anciennes colonies : laboratoire de laLibération pour la France Libre ? » cite cette
lettre particulièrement indicative, adressée parRené Pléven, le 30 juillet 1943, au commissairegénéral Hoppenot, à Fort-de-France (Antilles): «Considérant les conditions anormales dans les-quelles ont vécu depuis trois ans les militaireset fonctionnaires réfractaires, le fait que le ca-ractère insulaire du territoire où ils servaient lesa rendus presque complètement dépendants,pour leurs informations, de sources de nouvel-les contrôlées par l’ennemi, le Comité est disposéà les considérer comme malades, je répète ma-lades, que notre sentiment de la fraternité fran-çaise nous fait un devoir de chercher àdésintoxiquer. »La « thérapie » appliquée par le gouverneurCapagorry ne sera que partiellement efficaceet si les élections de 1945 se déroulent bien, cel-les de 1946 aboutissent au drame que l’on sait,lequel marquera d’un sceau sanglant, et pour delongues années, la vie politique réunionnaise. L’arrivée du Léopard avait suscité un ralliementgénéral à la France Libre, mais les conversionsde convention n’ont pas tenu longtemps et la bi-polarisation du paysage politique réunionnais adécanté les appartenances et obédiences anté-rieures selon la bipolarisation planétaire qui agénéré « la guerre froide ».Gilles Gauvin, lors d’un colloque qui s’est dé-roulé en 2004, à Caen et qui était consacré àcette période trouble de l’histoire de France, aéclairé de manière fort instructive ces années oùLa Réunion a oscillé, balancé au gré des tem-pêtes déclenchées par la IIe guerre mondiale,dans son exposé intitulé « Pourquoi Résister ?
Résister pour quoi faire ? »Extraits. « La vie politique de l’immédiat après-guerre est marquée par la constitution d’un largefront de rassemblement progressiste – le ComitéRépublicain d’Action Démocratique et Sociale(CRADS) – autour des deux figures de prouedu syndicalisme de gauche : Léon deLepervanche et le docteur Raymond Vergès,considéré comme « le médecin des pauvres » (ilfaut dire qu’en 1938 on compte 7 médecins pour220 000 habitants). Tous deux revendiquent de-puis 1936, à la faveur de la dynamique de FrontPopulaire, le statut de département. Après l’ac-cès à la citoyenneté avec l’abolition de 1848, ladépartementalisation représente pour eux l’ac-cès à une égalité sociale trop longtemps et in-justement refusée par la France. Le journalTémoignages fondé par Raymond Vergès, et dontle sous-titre est « l’organe de défense des sans dé-fense », inscrit ce combat pour la justice socialedans une longue tradition révolutionnaire com-mencée en 1789. Le journal multiplie les référen-ces à 1830, à 1848, ou à la Commune de Parispour aboutir à la révolution d’Octobre. Commele souligne Richard Brugidou, les militants laï-ques et francs-maçons qui rédigent Témoignagesglissent ainsi de leur admiration des vertus ré-publicaines vers la fascination de l’URSS et deses héros (…) Alors même qu’il n’existe pas defédération communiste dans l’île, l’URSS se re-trouve naturellement associée à l’idée de la li-berté : « Pour l’URSS, la France demeure lapatrie de la liberté (…) Il n’est pas de pays aumonde où la France est plus aimée qu’en URSS» peut-on lire dans Témoignages, le 10 novem-bre 1944. Toute la Libération n’est ainsi relatéequ’à travers le prisme des victoires de l’ArméeRouge sur la barbarie nazie. Après avoir emportéles premières élections municipales puis canto-nales, le CRADS conduit de Lepervanche etVergès à l’Assemblée Constituante d’octobre1945. Les deux hommes font alors le choix del’étiquette communiste…»Il est vrai qu’en métropole, à cette époque, leParti Communiste Français est le premier partide France et qu’il est totalement subordonné àMoscou, politiquement et « philosophique-ment », si tant est que l’on puisse assimiler l’idéo-logie communiste à une philosophie. Au-delà des bouleversements politiques locauxqui seront provoqués par cet « alignement »,l’adoption du dogme communiste est lourde desens quant aux comportements qu’il induit et lé-gitime. En un premier temps, comme l’écritl’historien Gilles Gauvin, « en faisant le choix del’étiquette communiste, les deux députés ont faitéclater le CRADS et la vie politique se restruc-ture alors entre deux tendances : les communis-tes et les anticommunistes autour du MRP Alexisde Villeneuve. Les polémiques sont violentes dansles journaux et Raymond Vergès se voit repro-cher son attitude durant la guerre. Maire deSalazie et directeur du service de Santé, il avaitfait allégeance au chef de la colonie avant d’êtredémis de ses fonctions municipales en 1942 pourappartenance à la Franc-maçonnerie. Accusé «d’avoir accaparé tous les morts de la Résistancedans la tradition communiste», il est traité de«Grand chef stalinien local » de « membre in-fect du parti des salopards » ou encore de «pourriture communiste, vietnamien, fasciste,nazi, antipatriote ». De Lepervanche prend ladéfense de son collègue et attaque à son tour les
L’adoption du dogme communiste est lourde de sensquant aux comportements qu’il induit et légitime.
La poignée de main entre Staline et Ribbentrop, le 23 août 1939, marque la signature du pactegermano-soviétique. En conséquence les communistesfrançais, subordonnés à Moscou, ne s’opposeront à Hitler qu’une fois cet accord violé et l’opérationd’invasion de l’URSS engagée… Une résistancetardive que le PCF tentera de faire oublier. (Photo DR)
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
21
LA TENTATION DE LA VIOLENCE
« assassins d’ouvriers français, partisans du re-lèvement de l’Allemagne avant celui de la Francequi salissaient la Résistance, qui se vautraientà la Réunion dans la fraude électorale ! ».L’affrontement issu de la « bipolarisation » semanifeste, on le voit, par une radicalisation dudiscours et un brouillage des références et va-leurs morales. Ainsi, Raymond Vergès qui a collaboré aussi sû-rement que nombre de ses contemporains, serefait une vertu en endossant la pelisse com-muniste, (laquelle joue sur une identification to-tale – bien que frauduleuse - avec l’idéal et lessacrifices de la Résistance), quand les compa-gnons du Légionnaire Raymond Vergès rejoi-gnent les rangs gaullistes, le RPF, pour s’opposerà la menace communiste – on disait bolchéviqueavant guerre…Ce méli-mélo brouille à ce point les cartes quel’on verra Paul Vergès, dénoncer dansl’Humanité du 7 juillet 1959, le fait que : « DeGaulle sera reçu à la Réunion par l’ancien chefde la garde du maréchal Pétain » ; un jugementdu fils qui prend toute sa saveur quand on saitl’appartenance du père à la même garde pé-tainiste…D’autres que lui ont bien plus tôt éprouvé quel-que difficultés à tirer un trait sur le passé des in-tervenants politiques locaux sous prétexte depragmatisme ou de raison d’Etat. Gilles Gauvin relate avec précision ce désar-roi : « Le docteur Vinson, président de l’Amicaledes Résistants de France d’Outre-Mer, à l’ori-gine de la demande de création d’une fédéra-tion RPF se dit écoeuré en 1947 du choix deJean Chatel, maire de Saint-Denis, comme se-crétaire fédéral. Le 25 mai, il transmet àSoustelle un discours radiodiffusé de JeanChatel favorable à Pétain en juillet 1940 et ilexplique que cinq membres du bureau sont «d’anciens collaborateurs et pétainistes», maisSoustelle rétorque qu’il a fait son choix « entoute bonne foi » et demande, en vain, l’établis-sement d’un consensus. Jean Chatel décédantdeux jours après le premier congrès, Paris se re-trouve face à deux clans : d’une part le députéRPF Raphaël Babet et le notaire Gabriel Macéet d’autre part Jules Olivier, qui s’est imposécomme nouveau secrétaire fédéral du RPF, etqui s’appuie sur le MRP Marcel Vauthier.Jacques Foccart qui suit la fédération depuis lesorigines se défie pourtant de Jules Olivier qu’ilconsidère comme « farouchement arriviste»,et lui préfère Gabriel Macé, même s’il n’ignorepas qu’il fut « un pétainiste notoire », car cedernier représente « un efficace barrage contrele Parti communiste ». Mais Jules Olivier tireargument du passé pétainiste de Macé pour im-poser à Paris ses choix électoraux, ou pour pas-ser outre. En 1949, alors qu’il était convenu queGabriel Macé obtienne la présidence du ConseilGénéral, Jules Olivier manoeuvre pour faireélire le modéré Roger Payet (qui dirigeait poursa part la Légion des Combattants). Ulcéré,Gabriel Macé écrit alors à Jacques Foccart : «Quand on ose critiquer un RPF parce qu’il a étéun simple légionnaire, on devrait avoir la pu-deur de ne pas accepter que soit financée unecampagne électorale par l’ancien présidentDépartemental de la Légion, on devrait avoirla logique de ne pas soutenir à la Présidence duConseil Général l’ancien vice-président de cetteLégion ». �
Marronnageliberté et imposture
���������������������������������������Paul Vergès, condamné pour avoir involontaire-
ment ou presque « revolverisé » Alexis deVilleneuve (Ndlr : on est loin d’Alfred Jarry), s’estprudemment éloigné de La Réunion jusqu’en1953, date à laquelle, il a bénéficié de la loi d’am-nistie. Il succède à son père aux législatives de1956, puis en mai 1959 métamorphose la fédéra-tion réunionnaise du PCF en Parti CommunisteRéunionnais, tout entier voué à sa cause. Un outilpour réclamer l’autonomie et la décolonisation,pour le peuple réunionnais, par le communisme etsurtout par Paul Vergès. Il exploite intelligemmentla fracture qui s’est ouverte entre les gaullistes aux-quels se sont ralliés nombre de notables au passéaussi collaborationniste que celui de RaymondVergès et les militants progressistes sincères, pourlesquels cette alliance était incompatible avec latriade républicaine ; de plus, la départementali-sation était restée lettre morte, ou presque, dansles faits, ce qui entraînait de réelles frustrationsdans la population. Enfin, De Gaulle et Debré qui ont bien comprisle risque soviétique, tolèrent et cautionnent sur leterrain des méthodes manifestement illégales des-tinées à faire obstacle à la progression du PCR. Onbourre les urnes pour empêcher une hégémoniecommuniste dont on sait, à la lumière de ce qui s’estpassé dans les pays soumis à l’influence soviétique,qu’elle conduira fatalement et sans retour à l’indé-pendance et à la dictature. Le PCR de Paul Vergèsse positionne en conséquence comme le parti dela décolonisation, des opprimés, des victimes de l’in-justice et de la « pureté ». Faute de pouvoir reven-diquer l’étendard de la Résistance au sens propredu terme, il jouera sur une déclinaison localisée etanti-colonialiste de cette idée, en parallèle aux « lut-tes de libération » fort à la mode à l’époque. Paul
Le Super Constellation se prépare à décoller, Paul Vergès a été discrètement embarqué, au grand dam de ses partisans. (Photos Antoine CHION HOCK - Collection S.I.)
Le 31 juillet 1966, la foule des partisans de Paul Vergès amassée à Gillot pour voir le leader communistes’envoler à destination de Paris, où il entend faire valoir ses droits face à la Cour de sûreté de l’Etat. (Photos Antoine CHION HOCK - Collection S.I.)
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
22
LA TENTATION DE LA VIOLENCE
Galets ».Le discours de « l’héritier » qui tente de s’inscriredans la légende familiale sonne alors particuliè-rement faux : « Je dois reconnaître que nourri del’expérience douloureuse en tant qu’enfant âgé desix ans, lorsque mon père et camarade Paul Vergèsest entré en clandestinité, cela a été une des déci-sions les plus graves que j’aie dû prendre dans macourte vie. (…) Je l’ai fait avec mon kèr rébel quine cesse de se battre pour rester debout, an rézis-tans partou toultan, et mériter l’estime de nos amis,camarades, proches, parents et enfants ». �
Vergès posera au « libertador » péi, prétendant re-prendre le flambeau des « marrons » d’antan ; unefiliation un peu surréaliste au regard de ses origi-nes… mais chacun sait, hormis les progressistes demauvaise foi, que l’on n’est ni responsable, ni comp-table des actes de ses ancêtres. La cavale « histori-que » de Paul Vergès, mars 1964 à juillet 1966,marque le point culminant de son affrontement avecMichel Debré, élu député le 5 mai 1963. Mais en dépit de son admiration pour les assas-sins du FLN algérien, les révolutionnaires cubainsentre autres Hô Chi Minh, en dépit de discoursenflammés tenus à Hanoï ou Cuba, Paul Vergèsn’osera pas engager la lutte armée. Avec le recul,on peut le créditer de cette forme de sagesse – sansdoute contrainte – mais dont les Réunionnais peu-vent se féliciter. Paul Vergès s’en est expliqué à plusieurs reprises,Gilles Gauvin le cite dans son ouvrage « MichelDebré et l’île de La Réunion » en se référant auxpropos tenus par le leader communiste en 1966dans l’organe du PSU, Tribune Socialiste : « Etpourquoi pas l’indépendance ? Nous répondrons :l’autonomie doit conduire inévitablement à l’in-dépendance, mais nous sommes convaincus quece cheminement passe à la fois par des réformesde structures indispensables si nous ne voulons pas,du jour au lendemain, retomber dans les rapportsnéocolonialistes, et par des regroupements qu’im-pose la balkanisation et la petitesse de nos terri-toires… » Le moyen de cette autonomie provisoire,l’abandon de la voie démocratique et républicaine :« La voie électorale est une voie illusoire (…) nousreviendrons à ce jeu démocratique quand le rap-port de force nous sera favorable… »Ironie de l’histoire, c’est Debré et De Gaulle quiont joué avec les limites de la voie électorale, pouren garantir in fine le maintien, permettant à PaulVergès et à sa famille d’intégrer avec profit les man-dats, charges et prébendes de la République.Quand on relit aujourd’hui un article deTémoignages qui relate, le 22 décembre 1971, lediscours du secrétaire général du PCR à l’occa-sion du 153e anniversaire de l’abolition, on ne peuts’empêcher de sourire : « Notre camarade (Ndlr :Paul Vergès) montre le lien qui unit Cimandef,Anchain et Albius à Sarda Garriga au siècle der-nier et à Raymond Vergès aujourd’hui. Il termineen exaltant la lutte menée par les esclaves d’au-jourd’hui, par tout notre peuple pour l’abolition durégime colonial ». Raymond Vergès, « marron »,l’image ne manque pas d’audace. Paul Vergès mar-ron ? S’agissant d’un homme dont les modèles po-litiques ont conduit leurs peuples respectifs à laguerre, la misère la dictature, il y a de quoi fairese retourner les ossements des malheureux escla-ves dans leurs tombes anonymes. Quant à PierreVergès, il signe en 1995, l’une des pages les plus ri-dicules de la saga Vergès, lors de ses 18 mois de ca-vale, pour échapper à la justice dans la fameuseaffaire dite de « L’endiguement de la Rivière des
« Notre camarademontre le lien qui unitCimandef, Anchain etAlbius à Sarda Garrigaau siècle dernier et àRaymond Vergèsaujourd’hui. »
Avril 1979 . Paul Vergès et Elie Hoarau, autorités du Parti Communiste Réunionnais, reçoivent GeorgesMarchais. A noter le look rock’n roll d’Elie Hoarau. On s’attendrait presque à le voir entonner un tube deLed Zeppelin, ou le « Back from USSR » des Beatles ! (Archives JIR)
Affaire Dumez, le PCR moibilise en 1996et 97 pour soutenir Ti-Pierre, alias “ker
rébel” parti en cavale, puis en cabanne…
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
23
LA TENTATION DE LA VIOLENCE
La société réunionnaise de la fin des années40 est malade, contaminée par la guerre et
la perte de valeurs liée à la collaboration ; leshommes qui prétendent localement influer surle cours des choses sont eux aussi infectés parcette « peste ». Or à l’époque, la violence et lecrime n’étaient pas perçus comme nous lesconsidérons aujourd’hui dans un strict rapportà la Loi. Pour les communistes, l’action politi-que n’avait de sens que dans son rapport à la «révolte », laquelle était en relation avec une idéo-logie au contenu froidement théorisé. Sartre etMerleau-Ponty, dans leurs réflexions sur le co-lonialisme, ont considéré que la violence pro-létarienne justifie pleinement le meurtre dès lorsqu’elle est orientée vers une libération du peu-ple. Il y a donc une violence politique qui jus-tifie les actes de cette nature. Un Paul Vergès de retour de la guerre s’inscritdoublement dans une logique de violence, celleapprise au combat contre l’ennemi nazi ; cellelégitimée par l’exigence d’efficacité imposée parles luttes de « libération ». Albert Camus est l’undes rares intellectuels de son temps à s’être in-terrogé sur le coût humain des avancées histo-riques vers la cité parfaite annoncée par lesCommunistes. Dès 1943 (Ndlr : date des pre-mières ébauches de L’homme révolté), il posele problème du meurtre comme consubstantiel
à l’Histoire. S’il agit ainsi, c’est parce qu’il a vudans le jeu des « révolutionnaires », une authen-tique quête de puissance et non de Justice. Ils’inscrit dans la lignée d’un Gide qui avec«Retour d’URSS » sorti en pleine guerred’Espagne, en 1937, dénonçait au grand dam del’intelligentzia française les errements du stali-nisme, devenant de fait la bête noire des com-munistes. Mais Camus va plus loin. Le mondelibre n’a échapppé à l’instauration d’un régimede terreur qu’au prix de terrifiants massacres, etil voit les intellectuels, comme à La Réunionun Raymond Vergès et ses amis, s’égarer dansl’historisme, justifier la terreur, les procès deMoscou, les camps staliniens. Il dénonce donc:« Les camps d’esclaves sous la bannière de laliberté, les massacres justifiés par l’amour del’homme ou le goût de la surhumanité, désempa-rent, en un sens, le jugement. Le jour où le crimese pare des dépouilles de l’innocence, par uncurieux renversement qui est propre à notretemps, c’est l’innocence qui est sommée de four-nir ses justifications… » En 1948 dans L’exild’Hélène, il écrit « Dieu mort, il ne reste quel’histoire et la puissance (…) tandis que les Grecsdonnaient à la volonté les bornes de la raison,nous avons mis pour finir l’élan de la volontéau cœur de la raison qui en est devenue meur-trière. Les valeurs pour les Grecs étaient préexis-tantes à toute action dont elles marquaientprécisément les limites. La philosophie moderneplace ses valeurs à la fin de l’action. Elles ne sontpas mais elles deviennent, et nous ne les connaî-trons dans leur entier qu’à l’achèvement de l’his-toire… »Ironie de l’histoire, l’avocat communiste, hérosde la Résistance, qui a défendu Paul Vergès etses complices, à Lyon, en 1947, un homme quiavait reçu la reddition du général Von Choltitz,chef de la garnison allemande de Paris, aux côtésde son camarade Rol-Tanguy et du GénéralLeclerc, sera en 1961 accusé de «déviation op-portuniste» et de «rare duplicité» , puis exclu dela direction du PCF. Il signera, avec RogerGaraudy, une lettre de condamnation de l’in-vasion de la Tchécoslovaquie par les troupes dupacte de Varsovie en 1968. Puis, déniera le droità Georges Marchais, en raison de son passé du-rant la guerre, ouvrier chez Messerschmitt dansle cadre du STO, de diriger «le parti des fusil-lés»…On est bien loin de la fondation du PartiCommuniste Réunionnais !. �
L’ESPRIT CONTRE LA PESTE
Confronté à l’attachementdes Réunionnais à la mèrepatrie, Paul Vergès estcontraint de s’en tenir auconcept d’autonomie.
A la fin des années 70, le PCR à qui le PS de Mitterrand a promis l’autonomie,paraît à même d’infléchir fondamentalementl’avenir de La Réunion.
1982, Paul Vergès etRaymond Lauret reçoiventle ministre du logement du gouvernement Mauroy,au Port.
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
24
ACTE IV
Copie de l’acte d’accusation de Paul Vergès. Juillet 1947. Il y est bien question de meurtre
avec préméditation, ainsi que de coups et blessures avec préméditation.
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
25
ACTE IV
« Le jour où le crime se pare des dépouilles de l’innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre temps, c’est l’innocence qui est sommée de fournir ses justifications… » Albert Camus
Une arme, un mobile et pas d’assassinl’énigme de la main noire a 60 ans
Plus de soixante ans après l’homicided’Alexis de Villeneuve, le 25 mai 1946,place de la Cathédrale, à Saint-Denis,on peut s’interroger sur les motiva-tions qui ont conduit la justice à tra-duire devant la cour d’assises de Lyon,le 18 juillet 1947, Paul Vergès, alors
âgé de 22 ans, pour « meurtre avec prémédita-tion, coups et blessures avec préméditations », ettrois de ses camarades communistes, pour « com-plicité de meurtre avec préméditation, coups etblessures avec préméditations », alors qu’ils pro-testaient avec véhémence de leur innocence.
Paul Vergès et ses co-accusés ont fait la Une du Provençal du 22 juillet 1947, ainsi que de nombreuxquotidiens de métropole.Cette photo de l’AFP le montre à la barre, dans l’attente du verdict.Le procès avait débuté le 17 juillet.
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
26
L’ÉNIGME DE LA MAIN NOIRE À 60 ANS
« Vu la déclaration de la Cour et du Jury endate de ce jour ; attendu que des faits re-
connus constants pat la Cour et le Jury, il résulteque les accusés se sont rendus coupables :1° Vergès Paul. D’avoir, le 25 mai 1946, à Saint-Denis, volontairement porté des coups et faitdes blessures au Sieur De Villeneuve, avec cettecirconstance que les coups portés et les bles-sures faites sans intention de donner la mort,l’ont pourtant occasionnée.2° Bourdageau Roger. D’avoir le 25 mai 1946,à Saint-Denis, volontairement porté des coupset fait des blessures au Sieur Séverin Charles
(…) Attendu qu’il résulte de la même déclara-tion qu’il y a des circonstances atténuantes enfaveur de Vergès Paul (…) la Cour et le Jury réu-nis en Chambre du Conseil, après en avoir dé-libéré et voté, conformément à la loi, et à lamajorité absolue, condamnent : Vergès Paul à lapeine de cinq années d’emprisonnement ;Bourdageau Roger à la peine de un an d’em-prisonnement. Et attendu que Vergès etBourdageau étaient au moment des faits sansantécédents judiciaires, la Cour et le Jury disentqu’il sera sursis à l’exécution des peines qui vien-nent d’être prononcées contre eux… » �
Le texte exactdes condamnations du 23 juillet 1947
�������������������������
Et pourquoi donc les jurés du Rhône ont-ilscondamné le 23 juillet 1947 Paul Vergès à unepeine de cinq ans de prison avec sursis, sanctionmitigée, voire bâtarde si l’on veut bien admet-tre qu’on ne saurait être à la fois innocent et cou-pable d’un même crime ? Pourquoi deux de ses co-accusés ont-ils été ac-quittés alors qu’ils se trouvaient dans le mêmeimbroglio que lui ?L’actuel président du conseil régional de LaRéunion a lui-même rompu le silence imposé surcette affaire après l’amnistie dont il a bénéficiéen 1953. Il l’a fait sous la forme d’une confidenceà feu Thierry Jean-Pierre, « petit-juge » pourfen-deur de la corruption socialo-communiste, dansson livre intitulé « Vergès contre Vergès ».« Avez-vous tué M. De Villeneuve ? » demande-t-il. « Non, répond Vergès, mais on m’a dit quil’aurait tué. M. De Villeneuve aurait été victimede quelqu’un très lié à son entourage mais aussitrès proche de la police. On a retrouvé son ca-davre un beau jour sur le bord d’une route. Ilaurait été empoisonné… »Une explication embarrassée et alambiquée quiressemble en tous points aux réponses dilatoiresfournies devant la cour d’assises de Lyon en 1947,si l’on en croit les journaux de l’époque. Tout sepasse comme si les jurés et surtout les magistratsconcernés avaient voulu déminer une situationpolitique explosive et s’étaient déterminés en fonc-tion de critères extérieurs au procès lui-même. L’arme fatale remontait, on le sait, au DocteurVergès, père de Paul et de Jacques - député com-muniste, maire de Saint-Denis, membre de cé-nacles influents et candidat aux législatives dejuin 46 dans la première circonscription concur-rent d’Alexis de Villeneuve (MRP), maire deSaint-Benoît, très populaire auprès des plan-teurs. Nul n’a pu expliquer avec précision com-ment et pourquoi l’arme du père s’est retrouvéece jour-là dans les mains du fils… C’est le premier mystère du procès de « la mainnoire ». Pourquoi « la main noire » ? Parce quePaul Vergès a toujours prétendu devant les jurésqu’il avait lui-même désarmé un « tireur in-connu à la main noire » avant de donner l’armeà son camarade Orre, arrêté par les gendarmesavec le pistolet encore chaud dans la poche…Or, ce fameux assassin à la main noire n’a jamaispu être identifié, nul ne l’a vu, hormis VergèsPaul, et l’accusé Paul Vergès ne sait que répon-dre lorsqu’on lui fait observer qu’il aurait pu àtout le moins poursuivre le tireur pour tenterde le maîtriser et le remettre aux autorités depolice…
Curieux procès tout de même : les jurés ontl’arme du crime, le mobile (il s’agissait à l’évi-dence d’éliminer un concurrent politique d’im-portance) et tout se passe comme s’ils serefusaient à désigner un assassin ! Le plus in-croyable de l’histoire, c’est que les jurés n’ontfait que leur devoir, en leur âme et conscience.L’avocat général avait en effet « disqualifié » lecrime en modifiant le chef d’inculpation au der-nier moment, ce qui revient à dire qu’il nes’agissait plus d’un assassinat, d’un meurtre pré-médité à l’issue d’un guet-apens organisé, maisde vagues « coups et blessures ayant entraîné lamort sans intention de la donner ». En outre,les fameuses « circonstances atténuantes », trèsimportantes à l’époque, ont été accordées à PaulVergès à la demande même de l’accusation, cequi jette un trouble sur la réelle volonté du par-
quet de sanctionner le ou les auteurs du crime.« Il est d’usage de considérer le mobile politiquecomme une circonstance atténuante », avait sou-tenu l’avocat général, « donc vous ne condam-nerez Vergès à une peine qui ne sera ni tropélevée ni trop légère… Je requiers à son encon-tre cinq ans de travaux forcés. » Le magistrata été entendu. Les jurés ont rendu un verdictde complaisance, un verdict politique qui signi-fiait à la fois qu’ils n’étaient pas dupes mais qu’ilsdevaient composer avec les « interférences » dupouvoir politique et les craintes liées à de pos-sibles troubles à La Réunion si le fils deRaymond Vergès était condamné, par exemple,à 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, tarif ha-bituel dans ce style d’affaires. Ce fut une déci-sion rendue, non pas au nom de la justice, maisau nom de « l’ordre public » et d’un certainpacte entre les gaullistes et les communistes quivenaient de traverser, main dans la main, l’his-toire des Forces Françaises Libres, des ForcesFrançaises de l’Intérieur et de deux gouverne-ments de « cohabitation ». La bonne tenue dePaul Vergès en qualité de parachutiste dans l’ar-mée française a également pesé lourd dans labalance à une époque où le sentiment patrio-tique est encore très vif.Paul Vergès prétend n’avoir jamais compris ceverdict mi-chèvre mi-chou ; il s’en indigne dansle livre de Thierry Jean-Pierre : « De deux cho-ses l’une, ou bien le jury considérait que j’avaisvoulu éliminer De Villeneuve et cela valait vingtans de prison ou bien il n’en avait pas la convic-tion et il devait m’acquitter ». Naïveté ou cynisme ?Paul Vergès a donc été condamné à une peineavec sursis, non pas au bénéfice du doute, maisau « préjudice du doute ». Telle est la convic-tion de Pierre-Marie Train, directeur de la ré-daction du « Méridional », quotidienindépendant de Marseille, qui commente àl’époque cette décision judiciaire : « les jurésont jugé que Paul Vergès avait effectivement tirésur M. De Villeneuve mais sans vouloir lui don-ner la mort ! Cette solution intermédiaire estd’une grande clémence. Ceux qui clament qu’ilest innocent et qu’on a voulu le condamner toutde même parce qu’il est communiste se leurrent.Quel étrange raisonnement alors qu’un juryunanime par un scrupule total prend la décisionqui entraîne pour un geste aussi dramatique lapeine la plus légère ! »« Car enfin, conclut Pierre-Marie Train, ou bienVergès était coupable et il fallait le condamnersans faiblesse ou il ne l’était pas nettement etil fallait l’acquitter sans équivoque. Une déci-sion d’acquittement aurait été cent fois pluscourageuse que cette réponse couci-couça quiattente à l’honneur et à l’équité. Ceux quicroyaient l’accusé coupable se seraient alors in-clinés devant un acquittement et ceux qui lecroyaient innocent ne pourront se satisfaire devoir leur ami s’en sortir par un tour de passe-passe qui laisse peser sur lui la culpabilité d’uncrime, et d’un crime impuni. En cette affaire,le meurtrier et la victime se trouvent égalementinsultés : l’un y est considéré comme un incons-cient, l’autre, comme une quantité négligeable.La justice de ce pays va décidément au reboursdu droit, comme tout ce que gâte la politique.On acquitte au bénéfice du doute, on necondamne pas, même pour la forme, au préju-dice du doute… » �
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
27
L’ÉNIGME DE LA MAIN NOIRE À 60 ANS
Après avoir expliqué que le procès de PaulVergès et de ses complices avait été « dé-
paysé » à Lyon en raison de « l’exception de sû-reté publique » destinée à éviter de ranimer despassions et de provoquer des troubles dans l’île,le chroniqueur judiciaire Maurice Thiard accused’emblée Paul Vergès : « La propagande commu-niste s’est appliquée à déformer les faits, écrit-ildans l’édition du Méridional du 18 juillet 1947,ils se déroulèrent pourtant dans des circonstan-ces qui ne laissent planer aucun doute. L’assassinatse produisit au cours d’une émeute provoquée parles communistes alors que M. De Villeneuve se ren-dait à une réunion électorale. Plusieurs dizaines detémoins étaient présents mais leurs dépositions dif-
fèrent parfois pour des motifs partisans mais aussiparce que dans une suite de faits très précipités lestémoignages ne portent pas sur le même instant. »« Une chose est sûre, poursuit le chroniqueur, Alexisde Villeneuve a été tué à bout portant et l’armedu crime est le propre revolver du Dr RaymondVergès. Son fils Paul était à la tête des manifestantscommunistes. Des témoins l’ont vu tirer. D’autresaffirment que l’arme était entre les mains de deuxindigènes, Bourdageau et Orre. Vraisemblablement, le coup parti, Paul Vergèspassa le revolver à ses voisins qui essayèrent de s’en-fuir. La population de La Réunion ne s’est pas faitd’illusion sur la personne du meurtrier. Aucun avo-cat du barreau local n’a accepté de défendre PaulVergès. Celui-ci a dû choisir en métropole un avo-cat qui consente à l’assister au cours de son inter-rogatoire. »« Lorsque celui-ci demanda la mise en liberté del’accusé et des deux autres inculpés, Orre etBourdageau, non seulement on n’accéda pas à sademande, mais encore on procéda à une 4e arres-tation. »« Les communistes de La Réunion exécraient M.de Villeneuve qui leur avait arraché une bonne partd’adhérents tout désignés en la personne des pe-tits planteurs, explique le journaliste. M. De
Villeneuve avait été le premier à réussir la consti-tution d’un syndicat de défense des petits planteurs.Ils purent traiter les usiniers sur un pied d’égalitéet fixer un prix raisonnable pour la canne à sucre.Par la suite, les petits planteurs se rallièrent au MRP(mouvement républicain populaire) et à M. deVilleneuve qui avait su les protéger contre l’ex-ploitation des usiniers. »« Le Dr Vergès, spécialiste de l’opportunisme,était passé au parti communiste à la Libération,oubliant la lettre de menaces qu’il avait adresséeà tous les membres du service de santé s’ilsn’étaient pas loyaux envers Vichy. Cette épîtrefut citée à la tribune de la Chambre et la secondeassemblée constituante trancha le débat en dé-clarant M. Vauthier candidat MRP régulière-ment élu. Outre l’enquête judiciaire, deuxenquêtes politiques furent conduites à LaRéunion par le député communiste Kriegel-Valrimont et par le député républicain populaireSimonnet. Les juges lyonnais ont à débrouillerun écheveau fort compliqué. »« Les manœuvres, les pressions opérées par lesamis de Paul Vergès risquent fort de se retour-ner contre lui : certains agissements condamnentsans appel ceux qui y ont recours au mépris detoute justice ». �
« Le Méridional »éreinte Vergès
Sur les lieux du trépas d’Alexis deVilleneuve, une photographie de la reconstitution des événements. A gauche, Bourdageau et Paul Vergès,puis les autrtes protagonistes et témoinsdu drame.
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
28
L’ÉNIGME DE LA MAIN NOIRE À 60 ANS
«Vergès se défend avec souplesse et intel-ligence » (Le Méridional), « Vergès pro-
teste de son innocence » (Le Provençal), « PaulVergès affirme avoir désarmé la main noire quivenait de tirer sur M. de Villeneuve » (LeDauphiné-Libéré) : les journaux de l’époque(juillet 1947) se passionnent pour le procès dePaul Vergès devant les assises du Rhône.D’après le journaliste du Dauphiné, Paul Vergèsse défend avec assurance. « Je suis innocent,clame-t-il, en tant que militant discipliné de monparti, je réprouve tout attentat individuel, quelqu’il soit. Dans le tumulte de cette scène de meur-tre, Vergès n’a pu remarquer le signalement decet homme qu’il a désarmé, « ce qui semble assezsingulier », s’étonne le reporter lyonnais.Bourdageau, directeur du journal communistelocal, serait un « propagandiste assez violent ».Il n’a pu lui non plus identifier « l’homme en noir »,mais la veille il aurait déclaré : « il faut en finir avecla race des Villeneuve ! »Le Provençal, journal des « patriotes socialisteset républicains », évoque dans son édition du20 juillet 1947 la version de Paul Vergès : « Onapplaudissait M. De Villeneuve se rendant à laréunion et d’autre part on le conspuait. Tout à
coup, j’ai vu à ma droite une main noire tenantun revolver. J’ai entendu un ou deux coups de feu.J’ai tordu le poignet de la personne qui tenaitl’arme et je l’ai désarmée. J’ai aperçu Orre. Jel’avais connu au lycée. Je lui ai dit : prends cerevolver (…) Cinq témoins ont déclaré qu’ilsm’avaient vu tirer de la main droite, poursuitPaul Vergès, je leur ai tendu un piège en leur di-sant que j’étais gaucher. Alors ils ont modifié leursdépositions. On peut vérifier. Je suis droitier et lepiège montre la valeur qu’on peut attacher à cesdépositions ».Le Provençal du 23 juillet 1947 relate des ex-traits de la plaidoirie du bâtonnier Ribet, deParis, partie civile pour la famille de Villeneuve,qui reconnaît d’emblée « la belle conduite dePaul Vergès durant la guerre, son intelligenceet son esprit patriotique » et déclare : « je lui de-vais cet hommage avant de démontrer qu’il estun assassin ! » L’avocat laisse entendre que tousles témoins de la défense ont été « plus oumoins » condamnés à « différentes peines » etconclut avec brio : « Le Dr Vergès a voulu as-surer sa victoire électorale. A La Réunion, lePC tendit la main au MRP mais au bout de lamain, il y avait un revolver ! » �
«Vous n’écouterez ni la haine ni la crainte etvous songerez aux conséquences de votre
verdict dans une société démocratique », avait re-commandé l’avocat général Faivre. « La libertéde vote doit être respectée et l’assassinat ne doit pasêtre élevé à la hauteur d’une institution ! »Le journaliste du Méridional, lui, reste fasciné parle « sang-froid imperturbable » de Paul Vergès :« l’accusé est-il sincère ou bien son intelligenced’une indéniable souplesse se prête-t-elle à dissi-muler habilement la vérité sous une version ap-paremment plausible ? se demande-t-il. Sesorigines orientales expliquent-elles le calme décon-certant avec lequel il se déclare innocent ? On sou-haiterait qu’il apportât plus de sentiment et moinsde logique dans sa défense qui ne manque toutefoispas de dignité ». Le chroniqueur raconte en dé-tail le déroulement du guet-apens criminel du 25mai, précédé le 22 mai par d’autres échauffou-rées à l’issue desquelles Paul Vergès avait été pour-suivi pour « coups et blessures » : « Lacontre-manifestation consistait à frapper des bi-dons vides, à secouer des boîtes de conserve rem-plies de pierres et à mener un tel tapage que lesdiscours de M. De Villeneuve et de ses amis ne pus-sent être entendus des nombreux auditeurs venusà St Denis, chef lieu de la colonie. En présence decette obstruction, poursuit-il, M. De Villeneuves’adressa aux policiers municipaux qui se trouvaientsur les lieux pour rétablir l’ordre. Ce fut en vaincar ces policiers dépendant de la municipalité alorsprésidée par le Dr Vergès, maire de St Denisavaient reçu l’ordre de ne pas intervenir et refu-saient de faire cesser le vacarme assourdissant des-tiné à couvrir la voix des orateurs ». « Devant lacarence de la police, Alexis de Villeneuve s’avançavers le groupe des perturbateurs pour les haran-guer. A peine les avait-ils rejoints que quelquesdétonations claquaient et que M. De Villeneuve s’ef-fondrait mortellement atteint d’une balle en pleincœur… » « Lorsque la mort de De Villeneuve l’eutdébarrassé de son principal concurrent, le DrVergès maintint sa candidature. Aucun adversairene pouvait plus lui être opposé, le délai de dépôtdes candidatures étant alors passé. Le Dr Vergèsaurait été imparablement élu si l’élection n’avaitété renvoyée , ce qui permit à M. Vauthier, ami deM . De Villeneuve, de faire acte de candidature etd’être élu à une forte majorité ».Telle fut la vengeance posthume d’Alexis deVilleneuve. �
LLaa vveennggeeaannccee ppoosstthhuummeedd’’AAlleexxiiss DDee VViilllleenneeuuvvee
On le sait, la condamnation de juillet 1947 futamnistiée par la loi du 6 août 1953, article
29, lequel couvre toutes les infractions punies depeines correctionnelles lorsqu’elles ont été com-mises par des délinquants primaires, ancienscombattants de la seconde guerre mondiale ouengagés volontaires pour se mettre à la dispo-sition de la France Libre. Cette même amnis-tie couvrit également les condamnations renduespar Les Chambres civiques, instaurées par l’or-donnance du 28 Août 1944 et rattachées auxCours de justice, qui avaient jugé ceux qui avaientvolontairement exercé un emploi au service del’ennemi, s’étaient rendu coupables de faits decollaboration économique de marché noir,d’avoir tenu des propos antinationaux, adhérerà un organisme de collaboration… �
Les journalistes plutôt partagés
�������������������������
�����������
Amnistie
Marcel Vauthier, témoindirect de la mort d’Alexisde Villeneuve, il l’a tenudans ses bras pour son dernier souffle, succèdeau tribun décédé pour le compte du MouvementRépublicain Populaire. Il sera élu.
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
29
L’ÉNIGME DE LA MAIN NOIRE À 60 ANS
Interrogé par feu Thierry Jean-Pierre surl’affaire De Villeneuve, en l’an 2000, Paul
Vergès passe outre l’amnistie dont il avaitbénéficié depuis 1953.« J’étais renvoyé devant cette cour d’assises(Ndlr : le procès avait été dépaysé à la demandedu Dr Raymond Vergès qui craignait pour la viede son fils), pour meurtre avec préméditation au-trement dit assassinat. J’ai fait de la prison etla Cour m’a finalement reconnu coupable decoups et blessures avec cette circonstance que lescoups portés et les blessures faites sans intentionde donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.Ils m’ont collé cinq ans de prison avec sursis etnous ont tous libérés sans même nous infliger unepeine équivalente à la détention que nous avionseffectuée. Cette décision était absolument inco-hérente car enfin, de deux choses l’une : ou bienle jury considérait que j’avais voulu éliminer DeVilleneuve et cela valait vingt ans de prison, oubien il n’en avait pas la conviction et il devaitm’acquitter ».Selon le président du PCR, la réalité des faitsest la suivante : « Des coups de feu ont retenti.J’étais alors dans la mêlée, assez loin de DeVilleneuve. Je me suis approché et ai désarmé untype qui tenait un revolver. J’ai fait passer l’armeà un camarade, Orre, en lui disant qu’ils tiraientsur nos femmes »Cette version n’a pas varié depuis son procèslyonnais : « J’ai vu à ma droite une main noireavec un revolver. J’ai désarmé cette personne.Je me suis retourné et la seule personne que j’aireconnu à côté de moi était Orre que j’avaisconnu jadis à l’école. Je lui ai dit : “Orre, prendce revolver, on tire sur nos femmes. Toute la foulealors refluait. J’ai été emporté jusqu’à la mater-nité. J’ai vu alors Léger et lui ai dit : “J’ai prisle revolver de Villeneuve (…) L’homme au revol-ver ne faisait pas partie du groupe Vergoz despartisans de Villeneuve » Au Président de la courd’assises qui l’interroge sur le fait qu’il n’ait pasconservé l’arme, Paul Vergès répond : « Parceque je me sentais menacé par le groupe Vergozet je voulais avoir les mains libres »Paul Vergès admet clairement qu’il a tenu enmain l’arme du crime. Mais quand Thierry Jean-Pierre pose la question cruciale, « Avez-vous tuéAlexis de Villeneuve ? », Paul Vergés répond :« Non. Mais on m’a dit qui l’aurait tué. Deuxou trois ans après les faits - vous connaissez La
Réunion - les langues ont commencé à se délier.De Villeneuve aurait été victime de quelqu’un detrès lié à son entourage mais aussi très proche dela police. On a retrouvé son cadavre un beau joursur le bord d’une route. Il avait été empoisonné(…) Lorsque je l’ai appris, j’avais déjà étécondamné. je n’avais qu’une envie : en finir aveccette histoire … »La destin d’Alexis de Villeneuve est doublementtragique. La disparition de l’homme, abattuparce que politiquement gênant. Puis l’étouf-fement légal d’une affaire qui, au-delà du ju-gement d’assises – un tantinet cynique -décrétant Paul Vergès coupable d’avoir tiré surAlexis de Villeneuve, sans l’intention de don-ner la mort, va faire passer la victime, amnistieoblige, dans les limbes de l’Histoire.Longtemps, le sujet a été tabou. Il était inter-dit d’en parler. Il ne restait de l’homme abattuqu’un nom de rue, une plaque commémorative,que l’on a même essayé d’oublier. Fort heureu-sement L’association Vi souviens a procédé àun travail de mémoire, et restitué pour la po-pulation réunionnaise qui a le droit de savoir,quels étaient le contexte historique du drame,ses protagonistes, les péripéties judiciaires, leslignes de force politiques évidentes et occultes,le traitement de cette affaire dans le temps. �
Thierry Jean-Pierre « Vergès et Vergès. Del’autre côté du miroir »Paris, JC Lattès - 2000
La position de Paul Vergès
« J’ai vu à ma droite une main noire avec un revolver. [...] »
« Ils m’ont collé cinq ans de prisonavec sursis et nous ont tous libérés sans même nous infliger une peineéquivalente à la détention que nousavions effectuée… »
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
Un peu de Lecture...
30
ACTE V
« Il y a des livres dont il faut seulement goûter, d’autres qu’il faut dévorer, d’autres enfin, mais en petit nombre, qu’il faut, pour ainsi dire, mâcher et digérer. » Francis Bacon.
Pour traiter de l’assassinat d’Alexis deVilleneuve mais aussi des autres élé-ments épars constitutifs du revers dela légende familiale que le PCR etsa nomenklatura se sont efforcés degommer, nous avons fait référenceset emprunts à nombre de sources do-
cumentaires, dont certaines livresques, qui mé-ritent d’être connues du plus grand nombre.C’est le cas du “Vergès père, frères et fils. Unesaga réunionnaise” de Robert Chaudenson. Cetouvrage de démystification écrit par un univer-sitaire de bon aloi, linguiste distingué, qui a col-laboré à la rédaction d’une encyclopédie de LaRéunion en 10 volumes, a suscité l’énervementde tout ce que La Réunion compte de zélateursdu clan Vergès, à commencer par le thuriféraireofficiel de la famille, Eugène Rousse. LequelRousse admet à regret, que le livre en questiona été “rédigé par un universitaire, qui a observépendant tout son séjour dans l’île une stricte neu-tralité politique…” Las, le contenu du “Vergèspère, frères et fils… » n’est ni hagiographiquepar nature, ni un ouvrage de commande ; il estde plus rédigé par un homme qui a produit untravail « strictement historique », autant de taresinsupportables pour les courtisans et alimen-taires qui orbitent autour de la famille régnantedu PCR. En conséquence, Eugène Rousse, quiest aussi historien que Trissotin poète, s’est ré-pandu - Témoignages des 15 et 16 octobre2007– en commentaires édifiants sur les inten-tions, mauvaises, et les « erreurs « de RobertChaudenson. Extraits : «…dès la lecture des pre-mières pages du livre, on a vite fait de se ren-dre compte qu’un des buts essentiels recherchéspar Robert Chaudenson est de tenter d’accré-diter l’idée que le docteur Raymond Vergès - dontnous célébrons cette année le 50ème anniversairede la disparition - ne devrait sa notoriété qu’àson « considérable pouvoir de dissimulation »ainsi qu’aux « protections ou amitiés » qu’il seserait employé à rechercher afin de faciliter sonascension sur tous les plans. Comment ne pasfaire observer que dans son livre, qui s’apparente
à un pamphlet… » Ce qui vaudra à notreTrissotin-historien de se voir infliger une réponsepleine de saveur de la part de RobertChaudenson, en voici un extrait : « EugèneRousse a donné dans Témoignages, les 15 et 16octobre 2007, deux articles sous le titre « Un livretruffé d’erreurs ». Le premier article, le 15 oc-tobre comporte un relevé de prétendues erreursqui sont, comme on le verra, soit ridiculementinsignifiantes, soit des erreurs (ou, pire, des men-songes) d’Eugène Rousse lui même. En ce sens,le titre de cet article est, involontairement, par-fait. En effet, dans un ouvrage de 300 pages (nou-velle erreur de ma part, car il n’en a que 291),le pourcentage des erreurs réelles est effective-ment de la taille et du nombre des minusculesfragments de truffes que les charcutiers écono-mes mettent dans ces cervelas qu’on dit truf-fés… » La référence charcutière fleure lagouaille rabelaisienne… Il convient de préci-ser que Trissotin intervenait en service com-mandé après que Lulu, le célèbre rédacteur enchef retraité de Témoignages se fut essayé à lacritique. M.Chaudenson, qui pour être universitaire, n’enn’est pas moins fine lame, lui avait virgulé uneréponse bien entrelardée que nous ne pouvonsrésister à vous communiquer… d’autant queTémoignages a préféré la mettre au panier.
« Marseille le 6 septembre 2007
Cher Monsieur Biedinger
Avec un peu de retard car j’étais en voyage (àMadagascar d’ailleurs), je prends connaissancedans le numéro de Témoignages du 28 août 2007,de l’article que vous avez consacré à mon livreparu à l’Harmattan, Vergès, Père, Fils et Frères.Il ne vous a pas plu ce qui ne m’étonne guère.Je constate néanmoins qu’« en rentrant de laconférence de presse de Paul Vergès » (détail bio-graphique dont l’importance m’échappe, mais quivise sans doute à avérer votre qualité de journa-liste !), vous l’avez « lu en une soirée ». Comme ce
livre comporte tout de même 291 pages, ce dé-tail prouve au moins que, quoique « sans intérêt »selon vos dires, il ne vous a pas ennuyé !J’avais jugé bizarre de recevoir votre souscription,mais je vous devinais, serviteur fidèle, en servicecommandé, la famille n’osant apparaître au grandjour ; cela vous a donné le privilège de payer moinscher ce livre et de le recevoir chez vous avantmême sa parution, le 1er septembre 2007. Je suisen revanche très étonné que vous suiviez si peula presse réunionnaise que vous affirmiez que lelancement de la souscription a eu lieu « dans lesdeux autres quotidiens réunionnais », alors queles annonces n’ont paru que dans le Quotidien.Vous êtes sans doute conduit à cette erreur parl’habitude qu’a Témoignages, depuis un demi-siè-cle, de pleurnicher sur les exclusions dont il estl’objet. Vous passez toute la soirée où vous rece-vez ce livre à en lire les trois cents pages « futi-les », mais ce n’est pas la moindre de voscontradictions. Vous semblez me reprocher de« pipoliser » quand j’évoque le mariage de PaulVergès et de Laurence Deroin en 1949. Vous nesemblez pas avoir compris (mais bien des aspectsde ce livre vous échappent !) que ce qui est impor-tant dans ce mariage n’est pas l’anecdote, maisle fait que Paul Vergès, en 1949, épouse la secré-taire de Laurent Casanova, membre du Comitécentral du PCF ; ce fait n’a pas été sans consé-quence sur son ascension rapide au sein du Parti.A ce propos, vous évoquez de façon lyrico-comi-que (Etes-vous sérieux ou perfide ?) « LaurenceDeroin et Paul Vergès » qui sont « pour vous »« les témoins d’un merveilleux amour ». Je penseque ne pourront que s’amuser de cette formule enforme de bluette réunionnaise tous ceux qui, fortnombreux à la Réunion, connaissent un peu lesdessous de la vie du PCR. Vous auriez pu au moinsme savoir gré de ne pas avoir évoqué, tout à faitvolontairement, ces aspects « people » !Vous affirmez la présence de « pas mal d’inexac-titudes » et mettez en doute le « caractère scien-tifique de mon approche ». Vous en dites trop oupas assez. J’attends des critiques un peu plus fon-dées et des faits précis. Il faudrait en effet que ces
erreurs soient bien grossières pour que vous puis-siez les avoir « décelées ». En outre, vu l’indigencede votre compte rendu, comment auriez-vous purésister au plaisir de les mentionner vous-même?En fait, dans cette prétendue analyse qu’il au-rait mieux valu demander à d’autres, LucienBiedinger n’est même pas « la voix de son maî-tre », mais la simple et fastidieuse répétition desslogans les plus éculés de Témoignages sur « lamémoire collective « (je cite dans ce livre les pro-pos de Boris Gamaleya, infiniment plus sévèresque les miens !), « l’avenir partagé » (récemmentet brièvement avec Nicolas Sarkozy ) et « les com-bats à mener ensemble pour faire progresser lasociété » ( !!!).J’évoque brièvement (page 114) le cas des deux« zoreils » qui sont les vrais et seuls « bras droits »de Paul Vergès, dont vous êtes assurément le plusmaladroit vu le rôle qu’on vous attribue. Noussommes loin du temps ou Témoignages vouaitles métropolitains à la vindicte populaire, mais lesraisons qui font de l’un, vous-même, le rédacteuren chef de Témoignages (le journal de RaymondVergès !) et de l’autre le numéro 3 du PCR sontparfaitement claires, quoique inavouables. A côtéde ces deux médiocres, combien d’anciens mili-tants réunionnais et de vieux compagnons de luttesont restés au bord du chemin ou s’en sont vo-lontairement écartés ? C’est aussi un peu ce quedémontre ce livre mais que vous vous refusez àvoir… et je le comprends !Monsieur LucienBiedinger, surtout restez ce que vous êtes et oùvous êtes. Ne changez rien ! Vous êtes parfait enporte-serviette, porte-valise ou en porte coton,n’essayez surtout pas de vous faire porte-plume,vous n’en avez pas le talent, ni porte-flingue, vousn’avez pas assez d’esprit.
Robert Chaudenson »
Le genre épistolaire n’est pas en voie de dis-parition, il est plaisant de lire d’aussi lestescontributions à cet art qui a fait les riches heu-res du XVIIIe…
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
31
ACTE V
Vergès père, frères et fils. Une saga réunionnaise - Robert ChaudensonL’Harmattan 2007 – ISBN : 978-2-296-03690-1
Michel Debré et l’île de la Réunion. Une certaine idée de la plus grande France - Gilles Gauvin – PresseUniversitaires du Septentrion – 2006 - ISBN : 2-85939-884-8
Les traces de la résistance dans la vie politique réunionnaise sousla IVe et Ve République - Gilles GauvinColloque du Mémorial de Caen - Décembre 2004.
Vichy sous les tropiques - Eric T. Jennings
Bernard Grasset - 2004 - ISBN : 2 246 65371 1
Les anciennes colonies : laboratoire de la Libération pour la France Libre ? - Eric JenningsUniversité de Toronto
L’ Histoire politique de La Réunion de 1942 à 1963Faits historiques et compréhension sur la période de référenceYvan COMBEAU (professeur d’histoire à l’Université).
“L’exil d’Hélène” in L’été - Albert CamusFolio
Albert Camus soleil et ombre - Roger Grenier Folio
Vergès et Vergès. De l’autre côté du miroir - Thierry Jean-PierreParis, JC Lattès - 2000
Historia Thématique - 01/01/2005 - N° 093Rubrique Les francs-maçons - Michèle Cointet
Les Grandes affaires criminelles en France - Gilles Gauvin - Sous la direction d’Eric Alary - Geste Editions - Octobre 2007 - ISBN : 978-2-84561-366-9
La Légion française des combatants. Vers le parti unique… Vichy 1940-1944 - Jean-Paul CointetRevue française de science politique - Année 1992 - Volume 42 - Numéro 4.
Les Totalitarismes - Plan Académique de Formation. Académie de Bourgogne. 18 et 19 novembre 2004 - Christophe Capuano
histoire - La Télé remue-mémoires Procès Touvier.
Raymond Vergès 1882-1957- Chantal Lauvernier1994 – ISBN : 2.9508331 – 0.1.
La prestation du serment du service d’ordre légionnaire (S.O.L) aux arènes de Cimiez le 22 février 1942 - Dominique Olivesi (C.M.M.C.)Cahiers de la Méditerranée, vol. 62
Paul Vergès - Du rêve à l’action - Brigitte CroisierOcéans Editions 2007 - ISBN : 978 2 916 533 353
Gilles Gauvin nous a aidés dans notre travail ennous conseillant quelques saines lectures qui sontde sa plume, « Michel Debré et l’île de laRéunion. Une certaine idée de la plus grandeFrance », « Les traces de la résistance dans lavie politique réunionnaise sous la IVe et VeRépublique », mais aussi « Vichy sous les tropi-ques » et « Les anciennes colonies : laboratoirede la Libération pour la France Libre ? » de l’his-torien canadien Eric T. Jennings. Ouvrages deréférence s’il en est qui éclairent les périodes étu-diées d’une lumière érudite. Gilles Gauvin nousa aussi orientés vers un ouvrage grand public etrécent, « Les Grandes affaires criminelles enFrance », auquel il a participé et qu’il présenteà nos lecteurs comme suit : « c’est un ouvragecollectif dirigé par mon compère Eric Alary. Nousavons travaillé ensemble sur “Le quotidien desFrançais. 1939-1949” dans lequel j’avais étéchargé de tout ce qui concerne l’Empire colonial.Nous avons d’ailleurs en chantier un nouvel ou-vrage sur l’Empire colonial. Comme nous nousconnaissons depuis nos études supérieures, Erica toujours été très sensible à l’approche deconstruction d’une histoire partagée qui a guidémon parcours de chercheur. C’est pour cela quelorsqu’il a élaboré son projet sur la vie quotidienne il a tout de suite faitappel à moi. Il voulait en effet sortir du schémauniversitaire classique qui veut, lorsqu’onaborde un sujet concernant la vie des Français,que l’on ignore ou que l’on traite à part la ques-tion de l’outre-mer français. En effet l’histoirede la colonisation fait partie intégrante de l’his-toire nationale. C’est pour cela que, lorsqu’il a été contacté parles éditions Geste pour réaliser ce “beau livre”sur les grandes affaires criminelles en France,Eric Alary a tenu à intégrer quelques notices surla France d’outre-mer. Le choix s’est porté surdeux affaires: Sitarane et le meurtre d’Alexis deVilleneuve. On aurait pu élargir le champ à d’au-tres espaces ultramarins, mais il était difficilepour des raisons éditoriales de faire une réali-sation exhaustive à tous points de vue. Il s’agis-
sait juste d’ouvrir des pistes et d’inciter le lec-teur à ouvrir également sa curiosité à l’outre-mer. Eric Alary a tenu ainsi à préciser dans son in-troduction : “Grâce à deux retentissantes affai-res réunionnaises, nous aborderons en outre, defaçon inédite, l’histoire des grandes affaires cri-minelles dans les contrées d’outre-mer. Dans lesîles, ce furent des affaires qui marquèrent les es-prits; l’une d’elle a même défrayé la chroniquedans les grands journaux de la métropole. Dansle domaine des grandes affaires criminellesoutre-mer, il reste encore beaucoup à faire. Nousespérons avoir ouvert des pistes pour une étudeplus large et plus poussée à l’échelle de l’empire colonial et des DOM-TOM…” Alors pourquoi ces deux affaires? L’affaire Sitarane était intéressante à la fois parcequ’elle intègre la question des mémoires de cesgrands crimes (avec les pratiques occultes quisont encore liées à la tombe de Sitarane), maisaussi parce qu’indirectement elle permet d’abor-der la question de la vie des engagés et du mé-lange des cultures à la Réunion (…) L’affaired’Alexis de Villeneuve n’avait pas échappée àEric Alary qui connaît bien mes travaux surl’histoire politique de la Réunion. Ce qui étaitintéressant dans ce cas était comment un meur-tre politique commis à 10 000 kilomètres de lamétropole allait devenir lors du procès de Lyonen 1947 une terrible passe d’armes, via les grandsjournaux métropolitains, entre ténors du PCFet du MRP à un moment où la guerre froide s’ins-talle en France. Tout comme dans l’affaireSitarane, et pour des raisons différentes, cetteaffaire a également connu une postérité dansles mémoires réunionnaises. La récente polé-mique autour de la maison de la famille DeVilleneuve suffit à le rappeler. Enfin, on décou-vre à travers le procès de 1947 les représenta-tions que l’on se fait dans le monde médiatiqueet politique métropolitain de la population decette petite île de l’océan Indien qui vient justed’obtenir, dans la plus grande indifférence, lestatut de département… » �
Sources�����������
UNE TRAGÉDIE CRÉOLE
“Alexis de Villeneuve”
Une publication de l’association Vi Souviens ToujoursImprimé à 200 000 exemplaires par la SRICDistribué par Ti Boite DistributionConception et rédaction : Philippe Le Claire avec la collaboration de Sulliman Issop & François RaugerConseil historique : Gilles Gauvin et Robert Chaudenson.