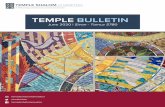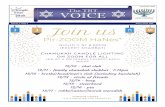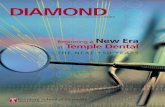A fundamento restituit. Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi
Transcript of A fundamento restituit. Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi
A FUNDAMENTO RESTITUIT ?
RÉFECTIONS DAN}iLE TEW:LE D'IS~S APOMPEI
Résumé. - Fouillé en 1765, sous les Bourbons, le temple d'Isis à Pom péi semblait jusqu'ici être un édifice bien d até par une inscription qui étaye une chronologie rept;se par de nombreuses publications . Mais, si cette inscription est confirmee par des élemenrs de la dernière phase de la ville, en particulier les décors de stuc et les peintures d u Quatrième Style du portique, il n'en demeure pas moins des traces d'un état antérieur
stylobate, chapiteaux et enduits de la cella . L'établissemen t d'un nouveau plan coté et un relevé systematique des élévations conduisent à réviser les anciennes hypothèses, alors que les proportions mettent en évidence une logiq ue architecturale jusqu ' ici ignorée. L' article analyse de façon détaillée les données architecturales - contraintes du site, dimensions et proportions, éléments constitutifs du sanctuaire, types de maçonnerie. Il démontre l'existence de deux états pour la construction globale du sanctuaire : une phase initiale d'époque augustéenne et non sarrmite comme on le pensait, tandis qu 'une deuxième phase, postérieure à 62, démontrée par l'analyse du décor stuqué, les mosaïques, ne modifie pas le plan d'ensemble mais procéde p lutôt d'une restaurat ion ~ à l'identique ». En définitive, le temple était debout après le séisme de 62 et sa prétendue reconstruction doit être ramenée à un simple ravalement.
U n riche dossier graphique et photographique appuie la démonstration.
Mots clés. - Monde romain. Italie. Pompéi. Temple. T empled'Isis. Sanctuaire . Architecrure. DécorarchitecturaI. Peinrure murale . Stuc. Mosaïque. T opographie. Chronologie. Reconstruction. Restauration. Période samnite. Période augustéenne 1 1« s. apr. J,-C.
REv. ARCH. 2/2000
par Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
A fimdamcllto restituit ? Restorations in the Isis temple in Pompeii.
Abstract. - The Isis temple in Pompeii, excavated in 1765, under the Bourbons, has seemed so far to be a construcüon weil dated by an inscription which supports the chronoJogy acknowledged by many publications. But, though this inscription is supported by elements of the last period of the town, particularly the stucco omament and painting of the Fourth Style of the portico, remains of a previous state - stylobate, capitals and stuccoes in the cella - still exist. The drawing of a new plan inc1uding measurements and the elevations leads to revision of the former hypotheses, whereas the proportions reveal an architectural logic, unknown so far. The article analyses the architectural data in detail - constraints of the site, dimensions and proportions, constituent elements of the sanctuary, types of masonry. It leads to the conclusion that two stages are to be distinguished in the overall construction of the sanctuary : a first phase of the Augustan period - and not Samnite as previously thought - whereas a second phase, after 62, is demonstrated by analysis of the stuccoes and mosaics, which does not modify the general plan and rather proceeds from a faithful restoration . In fact, the temple was still standing after the 62 earthquake and its so-called reconstruction must be considered a mere restoration.
Rich graphie and photographie illustration supports the demonstration.
Key-won/s. - Roman world . haly. Pompeii. Temple . Sancmary. Isis temple. Architecture. Architecrural decoration. Wall painting. Stucco. Mosaic. Topography. Chronology. Reconstruction. Restoraoon. SaffiIÙte period . Augustan period/l" AD.
228 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
S'il est un bâtiment bien daté à Pompéi, c'est le temple d'Isis (VIII, 7, 28). Récemment
encore, plusieurs publications l ont entériné une chronologie sur laquelle il semble inutile de
revenir: le séisme de 62 met à bas le vieux temple samnite (augustéen ?) dont seuls quelques
éléments de tuf sont récupérés dans une reconstruction a fundamenro qu'établit la dédicace,
toujours interprétée au pied de la lettre. Cette inscription semble en effet confirmée par la pré
sence d'éléments indiscutablement de la dernière période de la ville, tels le revêtement de stuc
et les peintures de Quatrième Style du portique; d'autre part, des traces d 'un état antérieur ont toujours été repérées au niveau du stylobate et des chapiteaux du sanctuaire.
Or, ce temple, fouillé en 1765, n'a jamais fait l'objet d'une étude architecturale appro
fondie, et le seul plan sur lequel s'appuient les publications est celui dressé par La Vega à l'époque des Bourbons. L'établissement d'un nouveau plan coté et de relevés systématiques des élévations amène à faire justice d 'anciennes hypothèses, tandis que l'analyse des propor
tions fait apparaître une logique architecturale jusque-là inaperçue.
Par ailleurs, le repérage de réfections dans le revêtement en stuc de la cella remet en
cause une reconstruction totale du temple. Ces reprises forcent à relire l'inscription et à revoir
l'histoire du temple que viennent également éclairer des archives inédites .
1. ÉTUDE ARCHITECTURALE (fig. 1)
Rappelons rapidement les différents éléments qui constituent le sanctuaire2 : à l'intérieur
du péribole, le péristyle [1] enserre trois autels, une fosse et deux bâtiments : le «purgato-
ABREVIATIONS
Arslan : E. A. Arslan éd., bide, Il mito, il m;stero, la magia, catalogue de l'exposition tenue à Milan, Palazzo Reale, Milan, 1997.
EAA-PPM : t Pompel~ Piullre e Mosaici . , Enciclopedia Îtaliana, 1- lX, Rome, 1990- 1999.
Golvin : J.-C. Golvin, t L'architecture de l'Iseum de Pompéi et les caractéristiques des édifices isiaques romains " dans Hommages à Jean Leclam, Tro is études isiaques (BIFAO, 106/3), 1993, p. 235-246.
Hoffmann : P. Hoffmann, Der l sis-Tempel ill Pompeji (Charybdis, Schn]ren zur Archiiologie), 7, MünstcrHambourg, 1993 (Diss. Trèves, 1991).
L 'lmmagine EAA-PPM, L 'Immagille di Pompei /lei secoli XVI1l e XIX, Rome, 1995.
N issen : H . Nissen, Ponipejanische SlIIdiUl, Leipzig, 1877. Overbeck: ]. Overbeck, Pompeji in seinen Gebiiudm, AiIer
IhümenJ /llId Kllnsrwerkell, 4< éd., Leipzig, 1884. PP: Alla ricerca di Iside, La Parola dei Pauato, 49, 1994. Ricerca : Alla 11'cerca di Iside, allalisi, slIIdi e restalld dell'Iseo
pompeia110 lIel Mliseo di Napoli, Naples, 1992 (catalogue publié il. l'occasion de la nouvelle présentation des peintures et du matériel du temple).
Nous remercions pour leur aide le Surintendant Pietro Giovanni Guzzo et le personnel de la Surintendance archéologique de Pompéi, Michel Bats et le Centre JeanBérard (Naples), Jean-Pierre Adam (Paris), MarieFrançoise Dumont-Heusers (Paris), Françoise Fouilland (Rome), Valentin Kockel (Augsbourg), Rui Nunes Pedroso (Soissons) et Margareta Staub (Fribourg i. Br.).
Jean-Michel LabarÙle (dessinateur IRAA-CNRS) a collaboré au relevé du sanctuaire et Véronique Picard (dessinatrice IRAA-CNRS) a mis au net toute l'i llustration sur Adobe IIlustrator: qu'ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance.
1. S. De Caro, dans Anlan, p. 338-343 j Id., Ricerca, p. 3- 18; Golvin, p. 239; Zevi, PP, p. 37-38; V. Sampaolo, EAA-PPM, VIIl, p. 732-734, et Hoffmann.
2. La numérotation des piéces suit celle é tablie dans Pit(Ure e Pavimemi di Pompei, l stituto centrale pcr il Catalogo e la Documentazione, Rome, 1986, complétée, Ricerca, p. 86, pl. 1. Sauf mention contraire, les clichés sont des auteurs.
0
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 229
i '" ~ " j;; ~
" -;;;
'" Q
[1] péristyle [li] niche axiale [Ig] porte
[5a]
[6]
[5]
[3] cella [3c] niche cintrée [4] pwgatorium [5] sacrarium
[ 1]
[1 h] niche rectangulaire [2] pronaos [5a1 niche du sacrarium
théâtre
5", ~-~~,
[1]
rue Nord
,
JnIll , ? 1 lI!l!- 0
-
- ~ " " 1 11111 11
Il [3] [2] [Je]
" " " ~ LU --" ':J n fQl ~
l!dnlD
T 'J
[Ig] [Ih]
o o
[6] ekklésiastérion [7] cubiculun/ [8] triclinium [9] cuisine
[10] pièce condamnée [11] balnéaire
o
- - -,-, :
c c
[7]
o
1. Pompéi, Le sanctuaire d'Isis, nomenclature des espaces et coupe sur le théâtre.
a " a
D 11 11 , 11 11 , 11 11 , 11 11 , 11 11 , [ 1] llil
0 ~~
" [4r
ml
~ " 2
230 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
1ïum» [4], aussi appelé nilomètreJ , ou megaron\ et le temple surélevé par un haut podium
comportant un pronaos [2] et une cella [3] plus large que profonde; en façade, cette largeur est
encore accentuée par deux ailes couronnées de petits frontons et abritant des niches; le centre
de la façade arrière est marqué par une niche cintrée [3c]. Cinq arcades) ouvertes dans le mur
Ouest du péribole) donnent accès à l' «( ekklésiastérion ) [6], Les pièces du logement des prê
tres (le «pastophorion ») occupent l'espace rés iduel entre le mur Sud du péribole et la cavea du
théâtre: ce sont le cubiculum [7], le triclinium [8], la cuisine [9], la pièce [10] condamnée par la
construction de l'escalier d'accès au théâtre et le balnéaire [Il]. Au Sud de l'ekklésiastérion, le
« sacrarium » [5] est partiellement installé entre les piliers du théâtre; une niche [Sa] est amé
nagée dans son mur Nord.
1. 1. LES CONTRAINTES DU SITE (fig. 1-2)
Le sanctuaire, mitoyen à l'Ouest avec la palestre samnite, est limité au Sud par le théâtre,
au Nord par une rue et à l'Est par une ruelle qui rejoint le portique annulaire du théâtre5,
Côté théâtre,' les angles Sud-Ouest du péribole du portique et de deux sanes annexes ([5]
et [11]) sont tangents aux arcades qui doublent extérieurement la crypta du théâtre. Mieux
encore, l'angle Sud-Ouest du péribole englobe un pilier de ces arcades (le second à l'Est de
l'axe du théâtre)) et surtout il vient l'habiller alors que sa maçonnerie de tuf avait déjà reçu un
enduit de surface6. Une préexistence du péribole par rapport au théâtre est donc exclue, et
l'arcade extérieure du théâtre était assurément achevée lorsqu'on bâtit (ou rebâtit) le péribole
du portique du sanctuaire dont l'angle vient s'appuyer sur le pilier enduit.
On sait ,par deux inscriptions que l'agrandissement et la m odernisation du théâtre sont
dus aux libéralités des financiers Marcus Holconius Rufus et Marcus Holconius Celer - le pre
mier duumvir en - 31- 2, le second en + 14 - et que la crypta a été construite par l'architecte
M, Artorius Primus, affranchi de Marcus1 . Toutefois, il semble que les duumvirs aient recons
truit une structure déjà existante: Overbeck8 avait noté que le mur du fond de la niche axiale
du théâtre (au niveau du sacrarium du temple) était construit en lave comme les parties les p lus
anciennes du théâtre; il en est de même pour les piliers cruciformes, certes largement recons
truits lors des fouilles, mais qui présentent, dans les parties non restaurées des arcs, des moel
lons de tuf en forme de briques caractéristiques de l'époque augustéenne.
L'extension du théâtre correspondait donc, dès avant sa restructuration, à ses limites
actuelles et sa masse constituait une donnée contraignante. L'angle Sud-Ouest du péribole est
venu après coup s'appuyer, on l'a vu, sur l'un de ses piliers cruciformes; nous reviendrons
plus loin sur la chronologie de ces aménagements .
3. M. de Vos. Aegyptiaca romalla, pp. p . 148; Hoffmann. p, 196. 207-208. 2 13.
4. Le tenne de megol'OII a été uti lisé par réfcrence à une inscription d'Ostie: Tran Tarn Tinh, u culte d'bis à Pompéi, Paris, 1964, p. 34.
5. Voir le plan de la zone dans A. et M . de Vos, Pompei, Ercolallo, Stabia, Rome, 1982, p, 63,
6. Même observation dans H offmann, p. 54. 7. Overbeck, p. 157 sq.; de Vos, Pompei, op, cil., p, 64. 8. Overbeck, p. 158.
A funda mento restituit? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 231
, , ' , , .. . . . . -. . . . . .. ' : '
1--" ...... . . r r r 1 1 •••• .... -----T
. ... .- .. -" .. , .. , ......... .. .. . ...... .:;;.".;:.::~c::·;~·"7".,..... ~~
.... 1 ,:-.--.- ... -""~. y .. o ..... ' .-
.... ,_.w,;·IY~,.I'r!fRJl'l'.\Çl A"lItTrTe !
~...:;;,_.~
.~ Vdf.TlW:.rn.V'-It{ •• Cf<.U"· P. .. )' 1
.;~\~;,,~~I· \ 1 -" ..... ",f'I>'I1f'I'. ~ ........ _.-.J_-=-
or ' • '.' l . . -._.' . . : .r::.. '
:Œ'fi 'i . . . . • ",' .. " r : ~:::- 0: ,-. .------.-.--,
f tA! ::1 \"'·1'''M1'f l· ,_" .,,,,,,,.. t " ~ . l·l.1.k ,~ t :(~" '/',t..t, J. .. ;.~i"....
:1 :1 t,
l
J l '~ , ...
2. Le sanctuaire d'Isis et son contexte. Plan de L. Rossin i, 1830,
Côté pales,re san",ite (fig. 3) : le mur Ouest de l'ekklésiastérion [6] est mitoyen avec la
palestre samnite qui a été amputée par la construction de cette salle, comme Nissen9 et Over
beck10 l'avaient déjà noté. Du côté de la palestre, on constate que les deux caniveaux orientés
Ouest-Est traversent le mur mitoyen; quant au caniveau qui longe ce mur, c'est un aménage
ment nécessaire au bon fonctionnement de l'écoulement des eaux pluviales et contemporain
du remaniement de la palestre (fig . 4). On peut observer en effet que, contrairement aux
angles Nord-Ouest et Sud-Ouest du caniveau, bien taillés et ravalés dans une unique pierre
qui amorce le retour à angle droit de la rigole, les angles orientaux du caniveau sont de mau
vaise facture: le long du mur mitoyen) ses blocs de tuf s' appuient contre ceux des deux côtés
longitudinaux dont les rebords ont simplement été retaillés pour le passage de l'eau p luviale. Il est donc évident que cette partie du caniveau ne se trouve pas à son emplacement primitif
mais a été avancée vers }'Ouestll .
9. Nissen, p. 170-175, et p. 161 en ce qui concerne le canÎveau.
10. Overbeck, p. 150, fig. 86.
11. Unc description en est donnee dans Nisscn, p. 160 ; voir aussi les observations de P. Hoffmann qui, toutefois, croi t voir, conlre toute evidencc, la fin des deux caniveaux
232 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
rue Nord
sanctuaire d'Isis
palestreisamnite
745
24111
o
3. Le sanctuaire et la palestre sam nite.
La longueur originelle de la palestre samnite se laisse restituer avec une bonne vraisem
blance. Overbeck supposait que la colonnade des longs côtés avait primitivement dix colonnes,
soit deux de plus que la colonnade actuelle, et qu'ainsi l'alignement de l'autel et de la porte
ouvrant sur la rue constituait l'axe de symétrie du portique.
Sachant que Pentraxe moyen pour les colonnes des longs côtés est de 269 cm, et en
tenant compte des 5 cm de débord du stylobate, il faudrait donc prolonger le portique de
375 cm depuis Pactuel mur mitoyen dont l'épaisseur est de 48 cm (soit 543 cm à partir des
dernières colonnes connues) . Ainsi, la longueur du stylobate Sud serait de 2 48 1 cm, et celle
du Nord, de 2 464 cm. Avec une largeur de galerie de 370 C± 10 cm), la limite orientale du portique samnite
devait se trouver à environ 745 cm du mur mitoyen actuel avant la construction de l'ekklésias
térion. Or la largeur de cette pièce est précisément une valeur comprise entre 745 et 750 : le
péribole Ouest du portique du sanctuaire se superpose donc au mur de clôture Est du portique
samnite dans son état primitifl2.
La construction de la palestre samnite est contemporaine du portique du forum triangu
laire réaménagé en fonction du théâtre au ne siècle av. J.-C . 13, comme le prouvent les colonnes
des longs côtés 10 à 15 cm en avant du mur milOyen (Hoffmann, p. 83-84), ce qui n'aurait guère de sens puisque les caniveaux su ivent le stylobate et que celui-ci se poursuivait primitivement plus à l'Est.
12. C'était déjà l'opinion de Nissen, p. 161 : _ Die Arkaden die Stelle der alten Ostwand der Curie bezeichnen. ,
13. Malgré les restaurations de l'après-guerre qui ont largement occulté les maçonneries, P. H offmann met en évidence la relation structurelle qui unit les murs extérieurs occidentaux de la palestre avec les propylées du Forum triangulaire, elles-mêmes vraisemblablement enrichies lors de l'agrandissement du théàtre (Hoffmann, p . 86).
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 233
4. Le portique samnite: remaniement du caniveau au Sud-Est.
de tuf, l'opus incertum et l' inscription osque mentionnant son financement par Vibius Ad:i
ranusl4 au profit d'une institution osque dédiée aux jeunes gens, la vereia Pompeiana. Quant à
la date du remaniement qui ampute la palestre de son extrémité orientale, elle remonte, selon
l'idée communément admise, à la .reconstruction du temple après le séisme; toutefois, N issen
lui-même se demandait si cette cession n'était pas intervenue déjà à la période osque. En
d 'autres termes, le sanctuaire a-t-il subi un agrandissement non prévu dès l'origine, ou bien at-il été conçu de façon unitaire?
Côté rue: seule la façade de l'ekklésiastérion poursuit le mur de clôture du portique sam
nite, tandis que celle du portique du sanctuaire empiète sur le trottoir de 44,5 cm. Cette ob
servation complète l' image du remaniement des deux parcelles, l'une agrandie au détriment de
l'autre.
Côté ruelle,' rien ne permet de savoir si la position du péribole du sanctuaire a modifié la
largeur du passage qui ne suit pas l'alignement de l'antique via Stabiana l5 et semble être un
aménagement consécutif à la construction du théâtre.
14. De Vos, Pompel~ op. cÎl. ) p. 7 1. 15. H . Eschebach, D ie stadrebauliche Elllwicklllng des QI/
liken Pompeji, RM, 17< Suppl., Heidelberg, 1970, p . 14-16.
234 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
Par conséquent, indépendamment du réseau de la voirie qui pouvait laisser une relative
tolérance (le tracé non rectiligne de la rue au Nord du temple porte en effet la trace) comme la
via della Regina devant la maison VIII,2,29, de limites de champs!'), le contexte urbain impose
des limites évidentes. Le sanctuaire est postérieur à l'agrandissement du théâtre ou du moins à la construction des arcades qui enserrent la clypta et imposent sa limite Sud; la limite Est de la
palestre samnite dans son premier état subsiste en tant que lim ite Ouest du péribole; l'implan
tation de l'ekklésiastérion [6) dépend en partie des limites de la palestre.
Dans la conception architecturale du temple, quelle est donc la part des contraintes urbanistiques et des restructurations successives? L'analyse des dimensions et des proportions
générales de l'ensemble du sanctuaire est l'une des méthodes qui permettent de saisir la cohé
rence du projet et d 'y détecter des perturbations, à condition toutefois de s'appuyer sur les
données les plus exactes possibles . C'est à quoi tend l'établissement de notre plan qui fait apparaître des différences substantielles par rapport au p lan de La Vega et aux mesures de N is
sen et d'Overbeck J7 • Le relevé a été effectué au moyen d'un distance-mètre à infrarouges de
haute précision, et l'étude des dimensions est issue de données en vraie grandeur sur logiciel de topographie.
I. 2. DIMENSIONS ET PROPORTIONS
Les dimensions du sanctuaire (fig. 5-6)
Dim. en pieds Rappon
Intirulé des dimensions Dimensions (P) Rapport à u x 5 p.
Longueur E-O du sancruaire 3 106 lOS p 3 u 21 Longueur E-O du péribole 2 356 80 P 16 Largeur N-S du péribole 2 076 70 P 2 u 14 Distance E temple / E péribole 1042 35 P u 7 Longueur E-O du temple 730 24,5 p .fi/2 u Largeur N-S du temple 614 2 1 P 2-.fi u=3/5u Longueur du stylobate du portique'8 1671 à l676 Largeur du stylobate du portique l9 1 380 à 1 400 H auteur des colonnes temple 364 12,5 P .fi / 4u 2,5 Hauteur totale du temple 617 2 1 P 2-.fi u = 3/5 u Hauteur du podium 147 5p 1 H auteur des colormes portique 298 10 p 2 Largeur galerie du portique 296 ± IO 10 P 2 Hauteur totale du purgacorium 298 10 P 2
16. Ibid., p. 22 et pl. 2. 18. Nissen : 1 650 cm. 17. Par rapport aussi aux nouvelles mesures données par
S. D e Caro, Ricerca, p. 8-9 et n. 73. 19. Nissen : 1 375 cm.
A fundamento restituit 7 Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 235
""' 1356 1
, 2ll 'n 1
'" 119~0 '"
,, -
• JOJ -
m
"
2258
167 1
'" , M
" 1582
28 2J6~m '" 59 0- -~
'" 1616
""
:===;J t Jh \
o
?
5. Le sanctuaire, plan coté.
Les proportions du sanctuaire: constats (fig. 7)
113 U6
o
2212 >W,
o
no
JI " ! 154! 190
nJ 113 '" 205 10
87 120 90 '" '" 106 51 1 g
'"'
o
- Le péribole de la cour: il s'agit d'un grand rectangle de 2356 cm extérieur sur
2 076 cm, soit de 80 pieds20 x 70 pieds21• Ce rectangle régulier avec ses quatre angles droits a
pour dimensions des valeurs approchées de mesures en pieds romain de 29,6 cm qui sont aussi
des multiples entiers de dizaines de pieds.
20. Valeur exacte: 79,59 pieds. 21. Valeur exacte: 70, 13 pieds.
~
• ~ ~ ~
~
236 Nico le Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
'95 726
124 185
1 340 1 104 1 " 1 211 1 169 1
:0
~ 511 ~ 1 58
1 " 1
7 " 7 2" 16 $-*
III * "1
-~ [] ~ J
~
~
" 1
1
1 1 ~ 1 __ 1
" " " JO 199 " JlJ " ~ li S
~ ~ ,-
1 1 ~ (» 1 1
~ ~ 1 1 1 1 1 1 50 31
~
"
1 1 1 1
] 1 1 1 1
~ 1 1 i'i ~ 0
1 1 N .
1 1 1 1
~
~ ~ ~
1 1 1 1 1 1 1 1 f----I::,--- [] 1 1 1 ~ 1 1 1 - - 1 '--
~
" ~
~ --, " 1 1
~ "> Ils
'" 1
1 1 1 1 1 ~ lt
~ ~
~ [] ~
1 "
~
~ ~
?I 56 111
1 1 1 1 1
~
*"
liS *34 1 L " - 0 lm
62 158 ISI 1 1 ~
" 1 II I 1 ,"0 1 53 1
146 172 2lS 169
7JJ
'112
6. Le temple, plan coté.
La longueur totale du sanctuaire, c'est-à-dire de l'extérieur du péribole à l'Est jusqu'au mur de la palestre à l'Ouest, est égale à 3 106 cm, soit 105 pieds" . En proportion, relati
vement à la largeur Nord-Sud du péribole, la longueur totale Est-Ouest du sanctuaire est donc
égale à 3/2 la largeur.
22. 105 x 29,6 = 3 108 cm.
"8
~
11
§ ~
11
~
~
A fu ndamento rest ituit ? Réfections dans le temple d 'Isis à Pompéi 237
80p. - 2356 cm
3u - 105p . ~ 3 1 06cm
" 1
" 1
,,~ 35 1042 ,.- om
( - 1-'--- V ~ ~ ~ / 750 cm
~ V c c 0 c
""-V /
V I~ ;t ~~ 7~ g
~ I ID'- 0
V '~I, ~ f:: ' '' '~ "- 1 i :-:1' 11 11 11 11 1 ~ b " ~o
K N :~I ~ : ~--~~------ ~~- -- -l ----- ' '" 1""
1 ~ 1-::1
l' / --;;- :;1. V " 0 <::!. I J v 2uJ2 ' ./ 0 ' -- 1
~ i' ~ , " , , /
-7 Q1 Q
~r ID <=; 1 ~
" V "-V D .""" .. "' ~ , ,, ' . "
1/1'" ..
/ " C __ '-'-_
~ / ~ ,
~ 0 8: 0 0 al. 5m 0 ~ / p C-, ,
~ K , 7. Le sanctuaire, tracé théorique.
Si l'on considère la largeur du péribole égale à 2 unités, l'unité étant de 35 pieds, la lon
gueur Est-Ouest du sanctuaire est alors de 3 unités (= 3 u).
- La façade principale orientale du temple (sans tenir compte de l'escalier) se situe à
1 042 cm de l'extérieur du péribole Est, c'est-à-dire encore à 35 pieds23. Cette distance est
donc égale à la moitié de la largeur Nord-Sud du péribole, La façade principale du temple a
été implantée à 1 unité de la face extérieure du péribole Est.
23. 35 x 29,6 = 1 036 cm.
l'
~ , 0
5 ~ , ~ , ~
0
~
f-
238 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
La longueur du temple (733 à 736 cm) est, elle aussi, en proportion directe avec la demi
largeur Nord-Sud du péribole (u) (733 = .fiu/2). Géométriquement, il s'agit du côté du carré
dont les diagonales auraient u pour longueur (c = .fiu/2). Si l'on considère, sur le plan, la
trame diagonale dessinée sur la base du maillage carré dont le côté est égal à u, la façade Est
du temple est tracée à l'extrémité d'un carré diagonale (A), et sa profondeur totale s'obtient
en rabattant le côté du carré sur la diagonale Est-Ouest; ce tracé défin\t l'axe du temple. En
prenant 7/5 pour approximation de .fi, la longueur du temple serait égale à 24,5 P
(24,5 P = 725 cm).
La largeur du temple se justifie suivant le même principe: à l'extrémité Ouest de la lon
gueur qui matérialise l'axe du temple, on trace une droite perpendiculaire. La largeur du
temple est égale au segment de cette droite limitée à ses intersections avec les côtés du
carré (A). Ainsi, la largeur du temple serait égale à u(2 - .fi), soit 21 p avec.fi = 7/5. C'est,
en effet, la largeur mesurée de la base du podium: 616 cm et u (2 -.fi) = 621 cm = 21 p.
- La largeur de la galerie, multiple de 10 p (296 cm ± 10 cm), équivaut à la hauteur
des colonnes actuelles qui correspondent au dernier état du portique du sanctuaire, ainsi qu'à
celle du purgat01'ium, fronton compris.
- En ce qui concerne l'ekklésiastérion, sa largeur Est-Ouest intérieure (750 cm) est
relative à la différence entre la longueur totale donnée au sanctuaire et celle du péribole du
portique (soit 105 - 80 = 25 p)", tandis que sa longueur Nord-Sud intérieure est multiple par
..fi, de sa largeur (750 x ..fi, = 1 299). Sa paroi Nord s'aligne sur celle de la palestre samnite.
- Le stylobate: c'est un rectangle aux dimensions imparfaites dont la largeur varie de
20 cm entre l'Est et l'Ouest (de 1 400 à 1 380 cm). Il est assez difficile sur cette base de déter
miner quelle est l'unité de composition employée. On constate cependant que le rapport entre
la moyenne des deux longueurs et celle des largeurs (1,204) s'approche d'une valeur de 6/5,
soit 1,200, mais aussi de 1,207 qui correspond au rapport entre la longueur e-r- Ia largeur du
temple.
On a souvent considéré les dimensions du stylobate comme des valeurs approchées de
dizaines entières de pieds osques: Nissen25 donnait comme mesures 1 375 cm - soit 50 pieds
osques - sur 1 650 cm - soit 60 pieds osques. Après lui, ces mesures ont toujours été reprises,
par Overbeck26, Tran Tarn Tinh27
, ].-C. Golvin28 ; or ces mesures tombent trop juste pour être
vraies, et il est probable que Nissen est parti de l'hypothèse du pied osque auquel il a fait cor
respondre, tant bien que mal, des mesures approximatives. S. De Car029 les révise et donne
1 390 cm x 1 678 cm au Sud et 1 687 cm au N ord, sans toutefois modifier l'équivalence en
pieds osques, égale pourtant, dans ce cas, à 50,54 po x 61 à 61,3 po.
Or les dimensions que nous avons relevées diffèrent assez nettement de celles qui ont été
établies aux XVIIIe et XIXC siècles et sur lesquelles repose, en bonne partie, la chronologie d'un
premier Iseum dont ne subsisterait que le stylobate. Il nous semble plus juste de formuler
24. Valeur exacte: 750 = 25,33 P et 27,27 po. 27 . Tran Tarn Tinh, op. cit., p. 30-31. 25. Nissen, p . 171. 28 . Golvin, p. 240. 26. Overbeck, p. 105. 29. Riccrca, p. 8 et n. 74.
A fundamento restÎtuÎt ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 239
œautres propositions appuyées sur les dimensions réelles et sur l'étude des proportions: le
péribole de la cour a été projeté à 70 P 1 80 p en dimensions hors œuvre j on a réservé à l'intérieur de l'enceinte périmétrale 10 P pour la largeur de la galerie du portique; par consé
quent, les dimensions du stylobate sont une résultante. Les données métriques orientent
l'interprétation; l'unité de mesure signalée entre les diverses parties du sanctuaire impose
dès à présent l'idée d'une unité de conception, et l'on ne peut admettre que les dimensions
globales du portique en multiples de dizaines de pieds de 29,6 cm soient fortuites .
D'autre part, reprenons un instant l'hypothèse selon laquelle le stylobate du premier Iseum
serait contemporain de la palestre samnite ; dans ce cas, la largeur de la galerie serait probable
ment équivalente à celle que nous connaissons puisque le mur Ouest du péribole se superpose à la paroi Est de la palestre dans son premier état: le péribole mordrait donc déjà sur la rue au
Nord30• Il faudrait alors admettre que les travaux d'extension du théâtre se sont pliés à la con
trainte imposée par le sanctuaire, ce que contredit la relation entre l'angle Sud-Ouest du péri
bole et le pilier stuqué du théâtre autour duquel il est construit: on ne peut pas négliger le fait
que les arcades du théâtre ont été immanquablement construites et stuquées avant la construc
tion de l'angle du péribole, voire du mur périmétral de la cour dans sa globalité.
Quant à la construction en tuf du stylobate et au profil de son caniveau, apparentés à ceux de la palestre samnite, il n'est guère possible de leur attribuer une valeur chronologique
très précise31•
Il nous semble donc légitime de retenir que les proportions générales du sanctuaire, qui
mettent en relation à la fois le portique, l'ekklésiastérion et le temple, dérivent d'une concep
tion unitaire; cette conception s' inscrit à l'intérieur d'une parcelle fortement contrainte par la
masse du théâtre et de ses arcades de soutènement.
Mais, à l'intérieur de ce cadre, on ne peut nier que diverses modifications, ajouts et
reprises ont conduit à l'état final de l'édifice découvert au XVIIIe siècle. Nous allons donc
reprendre rapidement l'examen des éléments constitutifs du sanctuaire et mettre en évidence
ses matériaux.
1. 3. LES ÉLÉMENTS DU SANCTUAIRE (fig. 8)
1. 3 . '1. Le temple [2-3] (fig. 9-11)
La cella et le pronaos s'élèvent sur un haut podium (hauteur 147 cm à partir du sol de la
cour ou 5 p) constitué d 'un socle en tuf, d'un corps en brique et d'une corniche en tuf. La
30. Nissen (p. 170) signale qu'à J'intérieur du mur Nord du péribole, le long du portique, il reste par endroits les fondations de lave d'un mur primitif aligné sur celui de la palestre samnite et qui aurait 41 cm d'épaisseur. Cette observation ne peut plus être vérifiée et elle n'est en tout cas pas confinnêe par le sondage de 1950 qui a, au contraire,
mis en évidence des aménagements dont la limite se sicue plutôt légèrement au Nord du mur périmétral.
3 1. Dans la plupart des cas, ils étaient recouverts d'un revêtement d'opus siguillum (portique des thennes de Stabies. VlI,I,S [B] ; Maison du Faune, VI,12,2 ... ).
240
CJ UpliS i",:~rl"", _ briques
c::::J OpllS ",ixlll'"
c:J tuf _ upUS "illul/It"
I=:::J op"_' ,'illtllll/ll 2 _ OP'(T rrlÎcu/tl/lim
c::J cipolin
o , AI, ',"
(6)
[Sa)
(5)
c
(1)
B
8. Le sanctuaire, matériaux de construction.
• [le)
[Je) (3) (2)
l.... L ___
[I g] [ lh]
[ la)
0 a 0
0 E
, ,
".' 1 • " 1 .. ' ,
11111 11
",' , : :: ~ [1] (iiI
0 F
-- (4)
11111111
A
(7) (8) (9)
[10)
D [li]
A fundamento restituit? Réfections dans /e temple d'Isis à Pompéi 241
.; .-: : : .
" ... ..... ... . ..... ........... ............ -j .... . . ,-I- ............ ..................... : .. : •
..... ·· · ·················· ······'····.-···'·t··············· ................... .-.-....... .-.-.-...... .-.-.-.•.. , ..
9. Le temple d'Isis. élévation frontale Est.
1 ,
construction de la cella est, pour l'essentiel, en brique. Les ailes latérales et les deux escaliers sont structurellement liés au noyau que forme le temple. Les différentes couches d'enduit appliquées sur cette âme en brique et tuf ne respectent pas en détail les découpes et profils
adoptés par la structure et en rendent parfois impossible la lecture.
Lepodium
Sur une fondation en opus caementiciwn court un socle en tuf dont la fondation ne peut s'observer que sur un vingtaine de centimètres de profondeur ; c'est un simple degré de 18 à 20 cm de haut, posé sur l'arase de la fondation et calé au moyen de pierrailles et de fragments
de brique. Il porte, en retrait de 18 cm, le corps du podium en brique haut de 105 cm ; au-
242 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
....
lm ,
10. Le temple, élévation arrière Ouest.
dessus, le profil de la corniche en tuf est constitué d 'un large cavet qui peut être assimilé à une
gorge égyptienne probablement terminée par un bandeau. Une couche de stuc, épaisse de 4 à 5 cm, recouvre l'ensemble du podium. S'il n'en reste, au niveau du sode, qu'un vestige dans
l'angle Sud entre l'autel et l'escalier principal, en revanche, le long du corps du podium, le
stuc est conservé sur 84 cm au-dessus du degré de tuf et recouvre une bonne partie de la cor
niche dont il modifie les dimensions et le profil (fig. 12) (voir, ci-dessous, II. 1.1).
Les deux escaliers sont de composition semblable. On ignore la structure du massif sur
lequel reposent les emmarchements de tuf mais les deux parois latérales de l'escalier principal
et la paroi Sud de l'escalier latéral sont en brique depuis l' arase des fondations. Elles ne com-
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 243
. -------- :: ;:::::;;:::;;:;:-::::::::::::::::::::::::- ---- ----- ---,
o 1 m , ,
11. Le temple, élévation latérale Sud.
portent donc pas de socle en tuf mais les élévations en brique sont indéniablement liées à celles
du corps du podium. Les sept marches supportaient probablement un revêtement aujourd'hui
disparu. En effet, la première marche se situe dans les deux cas 6 cm sous l' arase du socle, et la
dernière, quelques centimètres sous le niveau de sol de la cella et du pronaos.
Une autre caractéristique confirme l'existence d'un revêtement: les marches de tuf, en
limite latérale du limon sur la façade Sud, ne sont jamais assez larges pour occuper toute
l'emprise de l'escalier jusqu'au corps du podium, de sorte que l'espace restant est comblé au
moyen de briques dont on distingue mal la part des restaurations modernes. De même, les
marches de tuf de l'escalier principal n 'occupent pas toute sa largeur: leur dimension varie
de 145 à 150 cm alors que la largeur (actuelle) de l'escalier est de 165 cm (rampes non
comprises) .
244 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
Si l'escalier latéral semble ne jamais avoir comporté de rampe, en revanche l'aspect origi
nel de l'escalier principal est moins assuré: les dessins et les maquettes les plus anciens32
représentent des rampes latérales. Cependant des marques de restauration visibles à partir ou
en dessous du niveau de l'emmarchement empêchent d'affirmer que les rampes existantes sont
vraiment le reflet de la configuration antique.
Le pronaos [2 }
Les colonnes du pronaos~ d'une hauteur totale de 364 cm pour un diamètre de 38 cm,
reposent sur l'arase du couronnement du podium par l'intennédiaire d'une plinthe carrée
(fig. 12). De la plinthe au chapiteau, toute la structure est en tuf. La base de type attique com
porte deux tores encadrant une scotie limitée par deux listels; un troisième listel marque l'amorce du fût; ces fûts sont lisses, excepté celui de l'angle Nord-Est qui porte, à partir de
130 cm au-dessus de l'arase, le tracé de 20 cannelures gravées dans le tuP). S' agit-il d'un tracé
incisé préparatoire, destiné à guider la taille de cannelures restées inachevées, ou de repères
pour la pose d'un revêtement de stuc cannelé? Tout au plus peut-on constater l'absence
d'homogénéité avec les autres colonnes qui ne présentent pas cette anomalie)" ; elle devait être
dissimulée par un enduit: la colonne de l'angle Nord-Est35 a conservé un épais revêtement de
stuc qui modèle 20 cannelures depuis la base jusqu'à un astragale situé une dizaine de centi
mètres sous l'astragale du chapiteau de pierre; celui-ci, totalement rogné, a été réduit à l'état
de moignon pour servir d'accroche à la couche de stuc, aujourd'hui disparue. La base des
colonnes devait être, elle aussi, recouverte d'un enduit dont il ne reste plus trace.
Les colonnes portaient un chapiteau en tuf, de type siculo-corinthien36 : un seul est resté
en place, celui de l'angle Nord-Est, cité plus haut; deux exemplaires, mieux conservés, sont
posés à l'entrée de la cella)7 ; fortement épannelés pour recevoir la couche de stuc dans laquelle
ont été modelés les chapiteaux de la dernière phase, leur fonne d'origine peut toutefois se
déduire par comparaison avec les pilastres dont les chapiteaux, plus plats, n'ont pas eu besoin d'être retaillés et apparaissent aujourd'hui presque intacts, après la chute de l'enduit. Au
dessus de l'astragale se dressent les deux couronnes d'acanthes aux feuilles ourlées; les tiges
des hélices et des volutes naissent directement derrière les feuilles de l' inza corona sans cauli
cole intermédiaire, car ce sont les feuilles de la summa corona qui servent de calice sous les
32. G. B. Piranèse, dans V. Kockel, Phelloplastiea, Stockholm, 1998, pl. 6.8: vue exécutée dans les annèes 1770 et non intégrée par François Piranèse dans ses Amiquités de Pompéia; maquette d'Altieri, dans Kockel, op. cil., pL 6.6.
33 . EAA-PPM, VU!, p. 787, nn 90. 34. En l'ètat, ees colonnes semblent plutôt antérieures
au milieu du 1" siécle av. J.-C. ; en effet, les colonnes de tuf d'époque républicaine SOnt généralement cannelées j outre la palestre voisine, voir p. ex. VIII,3,8-9 [121 : EAA-PPM, VIII, p. 378, nC 25-26; VIIl,5,2. 5 [f]: ibid., p. 555, nO 17-18; VIII,5,9 [h]: ibid., p. 570-571, nO' 1-3;
VIII,5,28 [II): ibid., p. 617-618, n° 13-15; IX,I,20 [cl: ibid., p. 919, n° 4-5.
35. EAA-PPM, VIII, p. 786-787, n" 88-89.
36. C'est le vieux type appelé italo-républicain, dont l'origine et le dèveloppcmem sont maintenant bien connus par la synthése de H. Lauter-Bufe, Die Gesellichle des sikeliotisch-korilllhischell Kapitells, Mayence, 1987.
37. Lauter-Bufe, op. cit., p. 36-37, n° 61-62, pl. 26 e. Ce sont sans doute les deux chapiteaux que N issen a vus replacés ft tort sur deux tronçons de colonne du portique Ouest et qu' il restitue ft juste titre dans le prol/aos.
A fundamento restituit 7 Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 245
Pilash'e angle sud-ouest Colonne pronaos
WIIII
o lm , ,
12. Le temple d'Isis, profil du podium, colonne du pronaos et pilastre de l'angle Sud-Ouest
(en vert: éléments en tuf; en rouge: limite des éléments en brique).
volutes et les hélices ; dans les écoinçons, une feuille habille d 'abord la tige des volutes pour se
retourner sous l'abaque; elle resurgit ensuite, à l'extrémité des volutes. Les hélices sont à enroulement simple autour d'un œilleton central. Au-dessus, on aperçoit la trace laissée par un
fleu ron qui empiétait sur l'abaque. Ce dernier se compose de bas en haut d 'un bandeau suivi
de deux listels. On compte ainsi, pour l'ensemble de la colonne, 5,5 cm pour la plinthe,
18,5 cm pour la base, 298 cm pour le fût et 42 cm pour le chapiteau,
Les chapiteaux de type siculo-corinthien sont bien représentés dans les monuments de
Pompéi - 8 1 exemplaires recensés ~ car ils ne furent pas systématiquement remplacés après l'introduction du chapiteau corinthien. Les deux spécimens lisibles du temple d'Isis sont pro
ches, dans le détail de leur organisation, de ceux de la nef de la basilique, que leur style date
246 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
vers les années 150 av. J.-C.38 et de ceux de la Maison du Faune (exèdre d'Alexandre), qui
remontent à la fin du nC siècle au plus tard39 •
La cella !3]
Toute la structure verticale de la cella est constituée de briques de 4,5 cm d'épaisseur,
tout comme le grand podium qui en occupe le fond; seuls sont en tuf les quatre bases et cha
piteaux de pilastre des angles externes, les chapiteaux et les bases de la niche incluse à la
façade arrière du temple, qui disparaissent partiellement sous l'enduit, ainsi que six consoles, à vocation indéfinie, fichées dans les parois latérales internes de la cella. Les ailes latérales sont, quant à elles, a priori totalement en brique, mais l'excellente conservation du stuc ne permet
pas de s'en assurer sous les petits chapiteaux des angles externes .
a. Les pilastres
Avant d'être enduits, les six pilastres en brique qui marquent les angles du bâtiment sont exempts de cannelures, larges de 46 cm à la base et épais de 5 cm ; stuqués, ils s'élargissent à 56 cm et présentent sept cannelures de 5 cm de large séparées par un fin listel de 1,5 cm, sauf
aux angles où ce listel atteint 5,5 cm. En façade principale, les pilastres, une fois enduits, ne
mesurent que 47 cm de large ; cette différence d'aspect s'explique par l'effet de trompe-l'œil
qui semble superposer au pilastre d'angle de la cella celui, plus étroit, de l'aile latérale tandis
que ces deux fûts se résolvent en une base unique (fig. 14).
Le profil de la base en tuf posée sur l'arase des corniches du podium ne peut être observé
correctement que pour l'angle Nord-Est de la cella. La base elle-même se compose de deux
tores encadrant une scotie limitée par deux listels, comme celle des colonnes du pronaos. Mais
le tore inférieur est deux fois plus haut que le tore supérieur et l'on ne sait pas si un listel inter
médiaire séparait la base et le pilastre, totalement masqués par le stuc. Notons qu'en façade
principale cette base de tuf ne repose pas directement sur l'arase des corniches du podium,
mais sur un petit calage en brique, complètement apparent pour le pilastre Sud et haut de
6 cm.
Les chapiteaux de tuf" sont partiellement visibles sous l'enduit de stuc dégradé en plu
sieurs endroits; nous avons vu qu'ils sont de même type que ceux des colonnes du pronaos. L'exemplaire que l'on peut observer le plus complètement, celui de l'angle Sud-Est (fig. 13-
14), mesure 34 cm de haut et se compose de deux blocs superposés: la première assise com-
38. Ibid" p. 37-38, n'" 64-89, pl. 27 a-b, d; les études architecturales récentes viennent corroborer cette datation et clore momentanément la polémique longtemps très vive sur la chronologie de ce monument, le premier de ce type en Italie.
39. Ibid., p. 40-41, fig. 3, pl. 28 a-b, d. 40. Dans L'III/magi"e, fig. 13, p. 43, est reproduit le des
sin de La Vega, ADS 910 représentant les murs de la cella et
les chapiteaux avec le commentaire suivant: , Struttura muraria di laterizi priva dei rivestimento in stucco conservato solo per i capitelli che, per altro, sembrano essere costi[Uiti da bloccbi come se fossero in tufo . • De fait, on y voit deux incisions parallèles, une au milieu de la première couronne de feuilles, la seconde juste au-dessous des volutes qui est, en fait, la limite inférieure du chapiteau incomplet posé sur deux assises de brique.
A fundamento restituit? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 247
13. Le temple, chapiteau du pilastre Sud-Est: la brique, le tuf, le stuc.
prend les deux couronnes d'acanthe et la seconde les hélices et volutes ainsi que l'abaque4!. La
volute] intégralement conservée, montre un enroulement simple à œilleton central. Le chapi
teau repose sur deux arases de brique de 10 cm d'épaisseur légèrement en relief par rapport au
pilastre et 331 cm au-dessus des corniches du podium. Celui de l'angle Nord-Est est particu
lièrement intéressant car la dégradation de l'épaisse gangue de stuc supérieure laisse aperce
voir, en dessous, un enduit plus fin, de couleur crème, épousant exactement le détail du chapi
teau : c'est la couche qui revêtait le tuf dans la phase précédente. À l'angle Sud-Ouest, le
chapiteau de tuf dont on ne peut saisir le détail repose sur une seule assise de brique] 327 cm au-dessus des corniches, mais il mesure 40 cm de hauteur.
Les chapiteaux de tuf, qu'il s'agisse de ceux du pronaos ou de ceux des angles de la cella,
ont leur lit d'attente situé 364 cm au-dessus de la corniche du podium. Ils ont pour hauteur 43
à 45 cm, astragale compris, que celui-ci soit en brique pour les chapiteaux de pilastres] ou en
tuf pour celui des colonnes . À l'arrière, l'astragale des chapiteaux se situe 310 cm au-dessus de
la corniche du podium, mais leur arase supérieure (lit d'attente de l'abaque) est identique à celle des chapiteaux de tuf, 364 cm au-dessus des corniches du podium.
Il apparaît donc d'emblée que ces chapiteaux sont des éléments récupérés d'un état
antérieur lors duquel le premier enduit, qu'on observe encore par endroits, avait pour fonc
tion, entre autres, de dissimuler la différence de matériau42. La couche épaisse, qui recouvre
ensuite le tout dans une seconde phase, ne répond plus à la structure et modifie la hauteur des
chapiteaux: hauts de 43 cm en tuf, ils atteignent en stuc 57 cm à l'arrière et 62 cm à l'avant.
41. TI s'agit d 'un mode de construction courant pour les chapiteaux (voir Lauter-Bufe, op. cil., passim).
42. TI faut rappeler que les chapiteaux de tuf sont toujours enduits, tant pour des raisons esthétiques que techni-
ques, du fait de la porosité du matériau. Vitruve (De Arch.) II, 7) et Pline (N.H., 36, 166) viennent confirmer les témoignages archéologiques.
248 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
Les astragales du stuc se situent toujours 310 cm au-dessus du podium, ceux en tuf IO cm
plus haut comme pour les colonnes du pronaos (fig. 14).
b. Les ailes latérales (fig. 9 et 24)
E lles abritent des niches rectangulaires cintrées, encadrées de petits pilastres qui soutien
nent directement un fronton triangulaire. Les pilastres cannelés43 encadrant les ailes latérales
sont asymétriques : le pilastre intérieur se superpose, on l'a vu, à celui de la cella et le pilastre
extérieur est dépourvu de base.
Le bon état du stuc ne nous perm et pas de voir si des chapiteaux de tuf servent de support à ceux qui sont modelés dans le stuc (voir ci-dessous). L'absence de base permet d'en
douter.
c. Le mur extérieur du temple
À l'exception de la façade, depuis les corniches du podium et jusqu'à la frise architravée
de l'entablement, l'enduit simule un grand appareil isodome (voir, ci-dessous, II.I.I).
La niche arrière [3c l , bien centrée sur la façade Ouest du temple, mesure 58 cm de large
entre des pilastres de 25 cm à la base. Au-dessus, une imposte (qui sert en même temps de
chapiteaux aux pilastres) est surmontée d'un arc et est revêtue d'un décor de stuc (voir ci
dessous). Les pilastres sont en brique, mais la désagrégation de l'enduit laisse apparaître deux
petites bases à deux tores en tuf. Des éléments de tuf dont nous n'avons pu déterminer la
forme apparaissent également au niveau des chapiteaux grâce aux lacunes du stuc.
L'entablem ent est totalement bâti en brique tout comme la corniche à modillons qui ter
mine l'ordre de la façade et qui, haute de 26 cm, comporte 5 rangs de briques au profil moulé .
Les deux premières arases reçoivent les m odillons, la troisième décrit avec la quatrième un
profil en doucine, et la dernière, profilée en quart-de-rond, se termine par un m ince bandeau.
Au-dessus des chapiteaux, une large frise à rinceau en stuc (voir ci-dessous) occupe tout le
bandeau de 84 cm de haut. L'absence d' architrave est une caractéristique fréquente des enta
blements stuqués.
I. 3.2. Le purgatorium [4] (fig. 8 et 29)
Cette petite construction abrite un bassin souterrain censé contenir l'eau du N il, ali
m enté en réalité par le caniveau périphérique du portique; on y accède par un escalier que
protège un parapet de maçonnerie. Elle est bâtie en brique sur une fondation en opus caementi
cium ; l'enduit partiellement tombé laisse voir les bases et les chapiteaux en tuf des pilastres
d 'angle. Comme dans le temple, les bases sont à deux tores (fig. 24) et les chapiteaux de tuf
présentaient à l'origine un décor dont on aperçoit quelques lignes sans pouvoir définir quel en
43. Les pilastres ont 36 cm de large; deux larges listels de 3,5 cm les limitent latéralement, et les quatre cannelures de 6,5 cm sont séparées par de minces fi lets de 1,5 à 2 cm ;
sur le même plan, une cannelure supplémenta ire et le large filet d'angle simulent le débord du pilastre d'angle de la cella.
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple dIlsis à Pompéi 249
Édicule façade Est
~ 1 1111 1111 1
( )
o J m L' ____________ -L ____________ ~,
14. Le temple, détail de l'élévation frontale Est: le revêtement de stuc (en vert: éléments en tuf; en rouge: éléments en brique),
était le style. Il reste du seuil deux fragments de dallage, l'un à l'extrémité Ouest en marbre
cipolin, l'autre, plus petit, à l'extrémité Est, de marbre blanc.; l'un et l'autre sont creusés pour
recevoir les crapaudines.
La structure est unitaire, mais on a constaté que la paroi latérale Ouest avait été cons
truite postérieurement à l'escalier d ' accès et à son parapet en opus incertum dont l'enduit est
pris dans la maçonnerie. L'accès à la salle souterraine et par conséquent cette salle tout entière
250 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
seraient-ils antérieurs à la construction du petit édifice qui l'enclôt ? Le sol est privé de revête
ment, mais on note dans l'angle Sud-Est, face à l'escalier, une dalle calcaire (48 x 90 cm) dans
le prolongement de la volée de marches, mais non contiguë à celle-ci: s'agit-il du vestige du
précédent aménagement de l'escalier, avant la construction du bâtiment? Il faut noter que
celui-ci est hypèthre, puisque la couverture comporte une large ouverture centrale qui conser
vait ainsi au bâtiment son caractère originel.
1.3.3. Le portique (1) (fig. 8 et 15)
Les colonnes en brique enduite s'élèvent sur le stylobate en tuflongé par un caniveau"4. En
huit endroits, le stylobate a conservé des disques partiellement arasés, interprétés comme la
trace des colonnes d'un état antérieur45 • Leur diamètre est de 35-36 cm46. Le premier état du
ponique ainsi restitué comptait 10 colonnes sur les longs côtés, avec des entraxes de 181,5 cm
en moyenne, et 8 colonnes sur les petits côtés, avec des entraxes de 192 cm"7. Que le lit d'attente
des colonnes sur le stylobate soit en relief et non simplement ciselé ou même en creux, est
étrange: s'agirait-il de la trace d'un premier tambour sculpté sur le stylobate? Mais, outre qu'il
est difficile de prévoir exactement l'emplacement des colonnes lors de la taille des blocs, le fait
qu'un de ces disques sur le côté Sud soit taillé à cheval sur deux blocs du stylobate invalide cette
hypothèse. On pourrait également penser à un dispositif servant au positionnement des fûts; le
premier état du portique (36) de la Maison du Faune (VI, 12,2) a conservé un aménagement
comparable quoique plus accentué48, mais le bloc de stylobate excède alors à peine la largeur de
la colonne à laquelle il sert en fait de base; là encore, on voit mal pourquoi on aurait compliqué
la tâche en installant le fût à cheval sur deux blocs. De fait, une autre explication nous paraît
pouvoir rendre compte logiquement du phénomèné9. Les blocs du stylobate, de dimensions
très irrégulières, ont dû être installés avec une taille approximative, et ne recevoir l'arasement
de finition qu'après la pose des colonnes; c'est ainsi que l'emplacement des fûts s'est trouvé en
très léger surplomb par rapport à l'arase finale du stylobate. On objectera qu'il n'est pas com
mode d'installer un fût sur une surface non polie mais tout dépend du matériau qui constitue la
colonne, comme nous le verrons plus loin.
Dans le second état du portique du temple, un entraxe sur les petits côtés et deux sur les
longs sont supprimés, ce qui détermine une colonnade de 7 x 8, avec des entraxes moyens de
233,5 cm au Nord et au Sud, et de 224 cm à l'Ouest. À l'Est, le nombre des colonnes se réduit
44. JI en manque seulement un fragment du côté Est et un second du côté Sud, ce dernier retrouvé dans le sondage de 1950.
45. Nissen, p. 171, décrit ces , Lehren t , hauts de 1 cm au plus, et les appelle improprement des scamilli (POUf
l'interprétation de ce tenne, voir L. Callebat, Ph. Fleury éd., DictiOlmaire des tenncs techniques du De Architectura de Vitruve, HildesheimJZürichlNew York, 1995, col. 135); pour lui, ces éléments prouvent que la première colonnade était dorique ct semblable à celle de la palestre samnite, car, si les colonnes avaient eu des bases, la trace de celles-ci aura it été marquée par des Zapfenlikher (trous de tenons).
46. À titre de comparaison, le diamètre des colonnes dans la palestre voisine est identique (35-36 cm).
47. Nissen,p.171,donne 1,75m.
48. Entre les blocs du stylobate proprement dit, s'intercalent des blocs qui amorcent carrément les fûts sur plus d'une vingtaine de centimètres de haut, amorce qui fut noyée par un sol en mortier de tuileau. Au-dessus, les colonnes sont en tuf (EAA-PPM, V, p. 119, n° 48).
49. Nous remercions Gérard Montbel (UMR 7050 du CNRS) à qui nous devons cette hypolhèse.
A fundamento restituit? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 251
o
15. Le portique: a. les colonnes et les piliers.
b. Le stylobate, disque en reli ef de la première colonnade.
o c
n
o 1 m ,~~-~,
a
b
252 Nicole Blanc, Hélène Er;stov et Myriam Fincker
à 6 du fait de l'installation d'un dispositif axial : une large ouverture entre deux lourds pilastres
auxquels s'adossent des demi-colonnes, qui rappelle le portique des thennes de Stabiesso• La
structure des colonnes est en brique, chapiteau indus. Elles mesurent 55 cm de diamètre à la
base) enduit compris, et leur hauteur est de 296 cm. Le chapiteau n'est représenté que par la
dernière assise de briques moulées en quart-de-rond, en débord par rapport au fût (voir ci-des
sous). Les pilastres sont en opus mixtum faisant alterner une assise de pierre et deux de
brique; ils dépassent l'arase des colonnes de 92 cm et laissent voir, vers l'intérieur) au-dessus
des colonnes engagées) la cavité d'encastrement des poutres de l'architrave.
La disparition de la première colonnade pose un problème, surtout si on lie son rempla
cement, comme il est de coutume, au tremblement de terre de 62 ; on constate en effet) par
tout dans Pompéi, la réutilisation systématique des matériauxS!, tant à cause de leur pénurie
que de la difficulté de les évacuer. Il eût donc été beaucoup plus simple de garder les colonnes
de tuf et de les enduire, comme ce fut le cas dans de nombreuses demeures de Pompéi) restau
rées après la catastrophe. Et, si certains fûts avaient souffert52, il aurait suffi de ne refaire en
brique que ces exemplaires, solution adoptée dans la palestre des thennes de Stabies où
l'enduit cache la différence de matériau. Le seul fait d 'ailleurs qu'on ait conservé, outre les bases et les chapiteaux de pilastres, les colonnes du pronaos) rend encore plus invraisemblable
leur disparition du péristyle; c'est pourquoi il nous semble plus logique de faire l'économie de
cette hypothétique colonnade de tuf, et de la supposer réalisée dans un matériau moins
pérenne. La brique, utilisée déjà dans la basilique de Pompéi, constitue la solution la plus pro
bables3. On s'explique alors encore mieux les empreintes observées sur le stylobate, totalement
absentes de la palestre voisine où les fûts de tuf reposent directement sur les blocs. En effet) le
lit de mortier nécessaire à l'assemblage des briques adhère beaucoup mieux sur une surface
rugueuse que lisse, et justifie que l'arasement des blocs se soit fait après la pose des colonnes.
1.3.4. Le péribole [1] et les salles annexes [5-11] (fig. 8)
Tous les murs sont liés entre eux, sauf ceux du balnéaire [Il], et leur structure générale
est en opus incertum. La construction peut donc a pri011 sembler unitaire. Cependant diverses
techniques sont utilisées pour renforcer les angles entre deux murs perpendiculaires) les pié
droits des ouvertures ainsi que les linteaux ou les arcs au-dessus des portes. Ainsi, sur les murs
Sud du péribole et des pièces attenantes, tous les angles et piédroits de portes sont en moellons
50 . EAA -PPM, VI, p. 153, n° 7 ; Eschebach, op. cil. , p. 44; voir Vitruve (De Arch., V, 1,7) à propos de la Basilique de Fano où il supprime deux colonnes dans l'axe du sanctuaire • Ile impediam aspeclI/s prollai •.
51. J.-P. Adam, La cO/Ulruclioll roll/aille, Paris, 1984, p. 165 ; outre les observations faites sur les bâtiments, l'auteur observe que les dépotoirs provenant du dégagement de la ville n'ont livré que de menus fragments de mortier et d'enduit.
52. Hypothèse peu probable quand on voit l'état de conservation du portique de la palestre samnite contiguë.
53. Il n'est pas exclu non plus que la première colonnade ait été en bois; l'hypothèse est invérifiable mais elle rendrait compte du plus grand nombre de supports, donc plus rapprochés; dans la villa des Colonnes à mosaïques, une base de tuf surmontée d'un disque correspondait à une colonnade d'étage sur le toit [37] et peut avoir porté un support léger: V. Koekel et B. F. Weber, Die Villa delle Colonne a mosaico in Pompeji, RM, 90, 1983, p. 62 et pl. 38.2.
A fundamento restituit? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 253
16. Le sacrarium, montant Ouest de la niche l5a].
de tufs bien taillés (opus vittatum) ; il en est de même pour l'angle Sud-Est de la palestre sam
nite rentrant dans le sacrarium [5] . En revanche, les piédroits de la porte [la], ceux des portes
du mur Ouest du péribole (façade de [6]), les deux angles Nord et l'angle Sud-Ouest du péri
bole sont en opus mixtum. Les arcs ne reprennent pas pour autant la structure verticale: tous
ceux des portes d'accès aux salles annexes du Sud sont en opus mixtum (alternance d'un cla
veau de tuf et de deux briques) bien que les piédroits soient en opus viuatum ; il s'agissait là
d'arcs de décharge au-dessus d'un linteau de bois. Les cinq arcs d'accès à l'ekk1ésiastérion [6]
et l'arc de décharge de la porte d ' accès au sacranum [5] sont entièrement en petits claveaux de
tuf gris bien taillés, de même que le remplissage des écoinçons qui les séparent, alors que leurs
piédroits sont en opus mixtum (une assise de brique et deux de tuf) .
Les niches
Elles répondent, elles aussi, à des traitements différenciés: quatre niches sont incluses
dans les structures.
- La première, directement à côté de la porte d'entrée, est une simple cavité rectangu
laire de petites dimensions. Sa structure latérale est en opus mixtum, tout comme celle de la
porte. Les deux éléments sont assurément contemporains .
254 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
- La deuxième [li] - la niche de l'Harpocrate - , dans la façade Est du péribole, se situe
exactement sur l'axe du temple. C'est la niche la plus développée du sanctuaire, et le revête
ment peint, d 'où elle tire son nom, est aujourd'hui conservé au Musée de Naples. En relief sur le mur, deux piédroits sur consoles et un linteau fait d 'une plate-bande la ferment sur trois
côtés; l'étagère déborde du nu du mur par une petite corniche composée de deux assises de
briques moulées. La structure est en opus mixtum, les consoles en tuf, les bases, les chapiteaux
et la corniche en brique profilée comme la corniche du temple.
- La troisième [lh], dans la façade Sud du péribole, n'est qu'une grande cavité rectan
gulaire dépourvue de décor; un linteau en plate-bande en opus mixtum repose sur des mon
tants renforcés en opus vittatum de tuf gris.
- La quatrième [5a] se trouve contre la façade Nord du sacrarium [5] (fig. 16). Elle est
totalement bâtie en opus vittatunz, avec des montants de cipolin qui soutiennent un fronton
à segment. Sur celui de gauche se lit verticalement et placée à l'envers une inscription :
M. Lucretius Rufus Ilegavit. De toute évidence, il s'agit d'un élément de remploi.
I. 3.5. La zone Sud du sanctuaire (fig. 8 et 17)
La cuisine [9] ouvre sur l'espace [10] par une porte que la construction de l'escalier d 'accès à la galerie du théâtre a partiellement occultée; en réalité, cette porte donnait sans
doute, à l'origine, sur l'extérieur comme l'indique le chaînage en opus vittatum de l'angle Sud
Est. Les six degrés conservés de l'escalier s' appuient sur le mur extérieur de la pièce [9] et
reposent sur un massif d'opus incertum.
L'aménagement du balnéaire [Il ] est consécutif à la construction de l'escalier puisque
son mur Sud en opus incertum s'appuie sur lui et se raccorde par un muret oblique en opus qua
dratum au pilier du théâtre. La limite Ouest de la pièce est constituée par une section en quasi
réticulé qui relie le pilier à l'angle Sud-Ouest de la pièce [8]. Il se dégage de l'examen de ces
maçonneries l' impression d'un bricolage destiné à rentabiliser un espace auparavant inoccupé,
désormais couvert du fait de l' implantation de l'escalier, mais que Vexiguïté de son accès condamnait à une fonction humble.
Dans l'espace entre le mur extérieur du théâtre et le sanctuaire, des traces de reprises se
laissent discerner : le sacrarium [5] s' articule, au Sud, entre les piliers du théâtre; dans un pre
mier temps, un passage était ménagé entre le mur du théâtre et le pilier correspondant à l'angle extérieur Sud-Ouest du portique, ces deux structures étant revêtues d'un enduit. Dans
un second temps, ce passage a été obturé par une maçonnerie en opus incertum et une vasque
surélevée au-dessus de trois marches a été installée entre ce pilier et celui, plus à l'Ouest, qui
correspond à la niche située au centre de la galerie du théâtre54 ; ces ajouts recouvrent l'enduit
antérieur.
54. Cet aménagement, dont ne subsiste qu'un massif de maçonnerie infonne, apparaît clairement sur le modèle en
liège du temple: Kockel, Phelloplastica, pl. 6.5, p. 80 ; voir aussi Hoffmann, p. 202.
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 255
[ 11]
o lm
[10] 1 ~
ruelle orientale
17. Coupe Ouest-Est sur le balnéaire [11 J et l'escalier du théâtre (1 0J.
Il existait un autre passage similaire à l'extrémité Sud-Est du sanctuaire, le long du pilier
qui marque l'angle extérieur du balnéaire [I l] ; ici aussi l'enduit posé sur les structures du théâtre a été partiellement conservé par les vestiges de la maçonnerie qui a condamné ce passage 55.
Les circulations à l'extérieur du sanctuaire ont donc subi une modification d'autant plus
malaisée à interpréter que le niveau de sol n 'est pas dégagé et que les seuils ne sont pas repéra
bles . Toutefois, il apparaît clairement que, dans une première phase, les espaces [10] et [I l]
n 'étaient pas construits et que la circulation se faisait librement autour du théâtre ; mais alors,
soit le sacrarium avait des dimensions plus réduites et .se trouvait fermé par un mur au Sud56
(reste du mur primitif de la palestre ?), soit une porte installée au niveau du pilier corres
pondant à [Il] isolait le sanctuaire par rapport à la rue57. Dans une deuxième phase, la cons
truction de l'escalier du théâtre amena à repenser les circulations; le clergé récupéra les
espaces [10] et [11] , condamna les passages, agrandit peut-être le sacranum, ou du moins
en réaménagea une partie, laissant comme seul accès à l'espace extérieur la porte [l g] à droite de la niche. Il n'est pas exclu qu 'un étage ait été construit à cette occasion au-dessus du
pastophon·on58 •
55. Voir les mêmes remarques chez Hoffmann, p. 54, qui est le seul à s'être intéressé à cette partie du sanctuaire .
56. H offmann, p. 202, suppose que le 5acran·um devait être une cour séparée du théâtre, dans un premier temps, par une simple cloison.
57. Dans ce cas l'appareil quasi réticulé serait antérieur à l'implantation du balnéaire.
58. Hoffmann, p. 198 sq., analyse les données permettant de supposer la présence d'un étage, notamment les indices, lisibles sur les plans de La Vega, Piranèse, P. A. Pâ-
ris, d'un étroit escalier de bois le long du mur Est de la cuisine (9) ; de même sur le plan publié dans le Voyage pillOre5que de l'abbé de Saint-Non, vol. II, p. 120 et dû à JeanAugustin Renard. : voir Petra Lamers, If viaggio lIel Sud dell'A bbé de Saint-Non, Naples, 1995, p. 84, et catalogue nO 378 ; à cause de la présence des arcades du théâtre, cet étage ne pouvait guère concernee que les pièces [7J à (10) ; sur le plan de Luigi Rossini (fig. 2), le départ d 'un escalier plus large existait à l'extérieur, dans l'angle fo rmé par la pièce [7) et le mur Sud du péribole.
256 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
1. 4. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES TYPES DE MAÇONNERIE (fig. 8)
Le temple59 et le purgatorium sont entièrement en brique, à l'exception des bases et des
chapiteaux systématiquement en tuf, de même que les colonnes du pronaos. Les colonnes du
portique sont en brique. Les structures périphériques sont en opus incertum, complété par
l'opus mixtum et l'opus viuatum. L'opus mixtum est utilisé pour tous les piédroits des murs
Nord, Est et Ouest du péribole, y compris ceux de la niche du mur Est dans l'axe du temple,
ainsi que pour les deux piliers à demi-colonnes adossées du portique Est. En revanche, les pié
droits du mur Sud sont en opus viuatum. Les arcs de décharge de toutes les portes d'accès aux
salles annexes du Sud sont en opus mixtu1n, tandis que le vittatum caractérise ceux du mur
Ouest. Une plus grande variété règne dans les montants des niches: ils sont en opus mixtum à
l'Est, viuawm au Sud, marbre et viualum dans le sacrarium.
Même dans l'hypothèse de plusieurs étapes de construction, il est difficile de voir des différences dans l'opus incertum. En revanche, on peut noter deux types d'opus viuatum. Le pre
mier, utilisé pour toute la zone Sud du sanctuaire ainsi que pour l'angle Sud-Est de la palestre
samnite, est fait de moellons grossiers, alvéolaires, blanc cassé ou gris clair aux arêtes souvent
émoussées; le second, mis en œuvre pour les arcs du mur Ouest du péribole, est en moellons de lave très dense, gris foncé et taillés précisément à arêtes vives. On retrouve ce même maté
riau pour la niche du sacrarium [Sa]. Cette différence de matériau n'est pas nécessairement à mettre au compte d'un décalage chronologique; des ateliers distincts, un approvisionnement
hétérogène peuvent en être la cause.
L'opus mixUtnl se compose, dans tous les cas, d'une alternance d'un rang de pierres avec
deux arases de brique, même pour les deux piliers du portique associés à des colonnes enga
gées en brique. Les arcs du mur Sud du péribole, en opus mixtum, sont d'ailleurs aussi traités
par l'alternance de deux briques et d'un claveau de tuf.
Que tirer de ces observations structurelles diverses?
Il est à observer tout d'abord que le choix du matériau n'est pas nécessairement dicté par
la fonction: les piédroits peuvent être bâtis aussi bien en opus mixtum qu'en moellons de tuf. Il
en est de même pour le renfort des angles de mur. Les arcs sont indifféremment en opus mixtum ou en petits claveaux de tuf. Les colonnes du portique sont en brique, mais les piliers aux
quels sont liées les demi-colonnes dans l'axe du temple sont en opus mixtum. Est-ce parce que
le temple et le purgatorium sont en brique qu'il faut assigner leur construction à la même phase
que celle des colonnes du portique ? Probablement pas. Dans le cas du portique, la brique a
été choisie uniquement en rapport avec ses caractéristiques particulières: il est plus facile de
mouler des quartiers de colonnes que de les tailler en pierre, comme le montrent déjà les
colonnes hellénistiques de la basilique60.
59. A. Maiuri, L'uft/ma jase edilizia di Pompei, Rome, 1942, p. 69-70, note l'homogénéite des briques du podium et de celles de la cella.
60. Adam, op. cit.~ p. 168, fig. 370.
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 257
CONCLUSION PARTIEllE
L'analyse menée à partir de mesures précises permet de dégager un schéma proportion
nel à ce point cohérent sur l'ensemble du sanctuaire que sa conception globale ne peut, nous
semble-t-il, qu'être unitaire.
Le portique actuel est assurément l'œuvre d'une reconstruction sur la base d'un stylo
bate plus ancien. La réduction du portique samnite entre dans le plan de conception général
du sanctuaire et est, par conséquent, contemporaine de sa construction initiale. Enfin, la cons
truction du portique du théâtre est antérieure à l'implantation de ce sanctuaire, ce qui impose
un lernzinus post quem. On aurait donc deux états pour la construction globale du sanctuaire; le
second, indubitablement postérieur à 62, comme le montrera l'étude du décor stuqué, ne
modifie pas le plan d'ensemble mais est plutôt l'œuvre d'une restauration « à l' identique 1).
Du point de vue structurel, les parois perpendiculaires des pièces du Sud et celles de
l'ekklésiastérion sont bien liées, mais les techniques de construction sont variées et se distin
guent de celles mises en œuvre pour le temple et le portique, Seul le balnéaire se détache de
l'ensemble et atteste une totale restructuration postérieure à la construction de l'escalier
menant au premier niveau du portique du théâtre.
D'autre part, au terme de cette étude, la structure composite du temple ne peut plus être
considérée comme un indice de sa reconstruction après 62. Le stucage initial, fidèle aux for
mes du support, confirme que les éléments de tuf n'étaient pas destinés à être vus, et que le
mélange des matériaux dissimulés sous l'enduit existait déjà dans le premier état du temple.
L'étude plus fine des enduits conservés devrait nous permettre d'aller plus loin dans la
détermination chronologique de ces deux états.
II. DÉCOR
II,1. LE STUC
L'enduit de stuc recouvre la maçonnerie, de tuf ou de brique, d'une couverture en relief
autonome qui n'épouse pas le gros œuvre, mais crée un décor original obéissant à sa logique
propre, indépendamment de l'architecture. C'est pourquoi il convient de l'étudier à part.
11.1.1. Temple (fig, 9-11 et 12-13)
Extérieur de la cella
Les murs de la cella répondent à un système composite qui combine à la fois le répertoire
architectonique et le répertoire pictural familiers aux stucateurs.
258 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
Le podium est traité en orthostates séparés par une large ciselure de 8 à 9 cm coupée par
une incision centrale; en façade arrière, les blocs sont larges de 84 cm et de 52 cm dans les
angles, mais la largeur des blocs varie en fonction des dimensions de chaque face du podium
tout en conservant les 52 cm pour les angles et les 84 cm dès que faire se peut . Une cote angu
laire fait la jonction entre le corps et la corniche dont le profil en cavet est orné d'un anthé
mion (H. 27 cm) faisant alterner feuilles d'acanthe et feuilles d'eau61• Le motif est dérivé d'un
modèle augustéen, ornant généralement des doucines, où les lobes de l'acanthe recouvrent
partiellement la feuille intercalaire62 ; ici les éléments se succèdent sans se superposer, et la
feuille d'eau très déformée évoque un bouton de lotus, influence évidente des corniches mou
lurées de stuc où ce type de composition est habituel, à plus petite échelle63. C'est toujours une
demi-feuille d'acanthe qui amorce l'alternance aux angles, repère initial qui commande la lar
geur des éléments de la frise dont la répartition se fait au mieux dans l'espace ainsi délimité.
Nous verrons que cette composition se retrouve employée encore trois fois, à échelle plus
réduite, dans d'autres parties du temple. Le motif, en faible relief, a été modelé, et non moulé,
dans le stuc passé en une seule couche (ép. 4 à 10 cm), appliquée directement sur le tuf:
l'absence de mortier intermédiaire traduit une exécution rapide que confirme le caractère
sommaire du dessin. Un relevé de La Vega64 montre que la moulure terminale était ornée
d 'une frise de rais-de-cœur, dont ne subsiste aucun vestige.
Les murs sont ponctués par des pilastres qui offrent un intéressant exemple de
l'adaptation en stuc des motifs canoniques de la sculpture. Les chapiteaux « corinthisants »
sont modelés dans une couche d'un seul tenant dont l'épaisseur - de 4 à 8,5 cm - est inhabi
tuelle ; le poids excessif de ce revêtement explique qu'il se soit en grande partie décroché du
tuf sur lequel il était simplement plaqué: sur la façade Est, seule l'ima corona de feuilles
d'acanthe est bien préservée, mais l'exemplaire de l'angle N ord-Est se lit néanmoins jusqu'en
haut sur son petit côté Est65 ; la summa corona est surmontée d'un abaque complexe: d'abord
un rang de perles et pirouettes, puis une frise d'oves dont on devine la trace, couronnée par
une moulure en doucine terminée par un listel. Ce schéma s'interrompt sur la face principale
du chapiteau dont il ne reste que l'ima corona et le début du calice, sans caulicole, d'où nais
sent la volute tt l'h élice; de cette dernière, on distingue encore l'œilleton terminal, placé très
bas; si nous restituons une volute également peu développée, il reste alors la place pour les
deux rangs superposés de perles et pirouettes et d'oves66, Cette curieuse composition semble
61. EAA-PPM, VIII, p. 793, n° 110; 794, n° 113. 62. M.-F. Billot, BCH, 121, 1997, p. 243-244. Voir
aussi L 'acamhe dans la sculpture lIIonumemale de l'Amiquité à la Renaissance (Publications de la Sorbonne), P aris, 1993.
63. U. Riemenschneider, Pompejanische Stuckgesimse des Dritten und Vime/l Stils (Europiiische Hochschulschrifi, 38), Francfort, 1986, particulierement type XIV, p. 530; pour un motif proche, voir aussi Th. Fr6hlich, Meded, 54, 1995, p. 194, fig . 1-2. L'acanthe peut aussi alterner avec des palmettes: IX, 1, 22.29 (n) : EAA-PPM, VIII, p. 982-983, n° 50.
64. L'bllmagille, p. 41, n° 9.
65. EAA-PPM, VIII, p. 794, n" 11 4. 66. Un aurre départ de tige, conservé à gauche, a été
raccordé par La Vega à l'hélice, restituée avec un enroulement à l'extérieur, à l'inverse de l'ordre usuel (L'Immagine, p. 41, n° 9) ; de fait, il semble que le stucateur ait conservé la tige de J'ancienne hélice de tuf, décalée par rapport au nouveau schéma, dans lequel il l'a néanmoins intégrée; dans son dessin, La Vega inrroduit en ourre des volutes à la hauteur des rangs d'oves et de perles et pirouenes dans les angles, créant la curieuse impression d'un chapiteau ionique superposé au chapiteau corinthien; or, d'après nos observations des vestiges encore en place, il n'y a pas de
A fundamento restituit? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 259
déterminée par l'absence d'une double couronne d'acanthe, remplacée ici par une simple jux
taposition de feuilles hautes et basses qui en crée le simulacre mais n'occupe pas une hauteur
suffisante, d'où la nécessité des deux frises supérieures de remplissage. On retrouve une com
position voisine sur un pilastre également stuqué du péristyle de la Maison des Amours dorés,
qui confirme notre restitution". En revanche, le chapiteau d'angle Sud-Ouest (fig. 12), à l'arrière du temple, offre l'ordonnance habituelle d'un chapiteau corinthien: volute et hélice
bien conservées rejoignent un abaque classique, simplement mouluré68. Cette différence
s'explique peut-être par l' intervention en façade d'artisans différents, plus au fait du répertoire
pictural que des règles du décor architectonique. En effet, de part et d'autre de la porte, se développe un système d'architectures illusio
nistes, directement inspiré du Quatrième Style pompéien, suivant une mode que les stucateurs
introduisent après 62 et qu'on retrouve dans de nombreux monuments de Campanie. Au
dessus du socle lisse, commence, à 175 cm de hauteur, une structure à deux étages; le niveau
inférieur comporte un édicule central flanqué d'un portique en fer-à-cheva169 ; les fines colon
nettes cannelées ornées de chapiteaux (l corinthisants ) portent un linteau bordé d'une mou
lure d'oves. Au centre, accroché par un ruban, se détache un objet de forme circulaire
aujourd'hui très érodé, entouré de boules: on y reconnaîtra une couronne de laurier, ceinte de
bandelettes, d'où se détachent des baies70 • Au niveau supérieur, surgit une structure reposant
sur une base dont la forme circulaire est très approximativement suggérée. Au centre, une
large baie laisse apparaître un clipeus enrubanné d'où part une guirlande dont les extrémités
sont accrochées à des colonnettes végétalisées, posées sur les linteaux de la structure du pre
mier niveau. Une lecture réaliste de ces constructions est encore plus difficile qu'en peinture
où la couleur vient au secours des perspectives défaillantes. M. de Vos a voulu reconnaître,
dans le motif central, la couronne d'immortalité - corona analempsiaca - promise à l'initié
d'Isis7l : l'allusion est possible, mais la couronne de laurier se retrouve à l'identique sur de
nombreuses parois pompéiennes. La zone inférieure, laissée lisse plutôt qu'inachevée, était
peut-être cachée par un mobilier de culte (rideau ou panneau).
Les ailes latérales abritent une niche à fronton triangulaire reposant sur deux pilastres à
fût cannelé et chapiteau corinthien de (l fantaisie 1) : deux demi-feuilles ct>acanthe, suggérant en
trompe-l'œil le volume du chapiteau, encadrent une feuille centrale plus basse surmontée
d'une palmette inscrite dans un rinceau; l'abaque est orné d'un fleuron. Ici, n'étant pas con
traints par un chapiteau de tuf sous-jacent, les stucateurs ont abandonné le modèle corinthien
canonique, tout en gardant quelques éléments - acanthe, fle~ron -, sans doute dans un souci
d'harmonisation. Ces chapiteaux encadrent un pseudo-entablement, orné d 'un rinceau formé
place pour ces enroulements j les relevés que donne La Vega des chapiteaux de tuf sous·jacems montrent claire· ment que la zone supérieure de l'enduit avaÎt déjà disparu à J'époque, ct qu'il s'agit d'une reconstitution.
67. EAA·PPM, V, p. 748, na 64.
68. EAA·PPM, VIll, p. 796, na 119-120.
69. H. Eristov, Les élémellts architecturaux dans la peilltllre campaliielille du Q/latrième Style (coll. ErR, 187), Rome, 1994, p . 110 sq.
70. Pour la couronne de laurier à baies, vOÎr les Thermes de StabÎes, vestibule de l'apodytelium : EAA·PPM, Vl, p. 194, na 84 .
7l. De Vos, dans PP, p. 140· 143, fig. 5.
260 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
d'esses affrontées nouées à chaque extrémité par un lien d'où surgit au centre une palmette;
l'entablement de la palestre des thermes de Stabies est orné de rinceaux de même type, tandis
que, dans le caldarium féminin, on retrouve des chapiteaux identiques, avec ce curieux motif
central, présenté dans l'autre sens. Nous avons montré ailleurs, plus en détail, que c'est bien le
même atelier, actif après 62, qui a œuvré dans ces deux bâtiments72. L'archivolte est ornée
d'une guirlande accrochée au centre et aux deux extrémités par un ruban; de part et d'autre,
pend un rhyton. Sur les rampants et la corniche des frontons, court la même frise que sur le
socle du temple. Rendue à plus petite échelle (H. 12 cm), elle a été simplifiée: la feuille
d'acanthe a perdu tout caractère naturaliste et la feuille intercalaire voit son contour souligné
d ' une simple bordure73 • Le centre du fronton, aujourd'hui détruit, était orné d'un motif bien
conservé sur le mur postérieur: un clipeus à unzbo placé à l'intersection de deux lances
croisées74•
Les murs Nord, Sud et Ouest portent un simple revêtement à bossage qui simule un
grand appareil isodome75 . Les assises ainsi définies ont 52 à 53 cm de haut. Lorsque les
« blocs ~) sont entiers, ils mesurent 84 cm de large mais, près des pilas tres et sur les ailes latérales, ils s'adaptent simplement aux dimensions du support. L'exécution n 'en est pas très
soignée: ainsi, les blocs de la première rangée reposent directement sur le socle, sans que soit
figuré leur contour inférieur; même remarque pour les angles, où les blocs semblent entrer dans les pilastres. Le mur Ouest est orné, au centre, d'une niche où se retrouvent déclinés plu
sieurs motifs déjà présents en façade principale, façon d'assurer l' unité du bâtiment, mais aussi de conférer à cette niche, p lacée en face de l'entrée de l'ekklésiastérion, une dignité particu
lière76 . Les pilastres à lésène ont aujourd'hui perdu leur enduit originel, mais un dessin de La Vega montre que le fût était orné d 'une grande torche enflammée. Les chapiteaux sont formés
d'une feuille d'eau encadrée de deux feuilles d 'acanthe77; c'est un « extrait » de la frise du
socle, ici exécutée dans un troisième module (H. 18 cm) 78, avec le m ême traitement simplifié
que sur la façade principale. Au-delà des chapiteaux, le motif se poursuit d'ailleurs logique
ment en frise à l' intérieur de la niche. La lunette porte au centre une fine couronne, nouée par
un ruban dont les deux extrémités courent en ondulant au-dessus de la corniche. On retrouve
à l'intrados un rinceau du type employé sur l'entablement des ailes latérales. L'archivolte est
occupée par une frise de palmettes inscrites, motif courant dans les corniches pompéiennes 79
et employé d 'ailleurs sur le fronton du pUl'gawrium, mais décliné ici à plus grande échelle
(H . 16 cm)80: c'est, là encore, un rappel du motif central des chapiteaux de pilastres des
72. N. Blanc, H ommes et chantiers : il la recherche des stucateurs romains, Meded, 54, 1995, p. 91 -93, dessins C l -C3, fig . 7-10.
73. EAA-PPM, VIII, p. 787, nO 91-92; p. 788, n" 93; p. 789, n" 96-97.
74. Motif proche dans les caissons de l 'apodylelilllll des thermes de Stabies: EAA-PPM, VI, p. 198, n U 93.
75. A. Laidlaw, TIle Fim Slyle ill Pompeii : Paimillg alld Architecture, Rome, 1985, p. 31 1, pl. 102.
76. Elle abritait un Dionysos offert par Popidius Amp lia tus, père du dédicant : Ricerca, p . 70, 3 .7.
77. Ce système très schématique de décor t corinthisant ~ orne les chapiteaux de plusieurs maisons, restaurées dans la dernière période de la ville ; citons, p. ex., la Maison des Amours dorés, VI,16,7. 38 (EAA-PPM, V, p. 748, n" 65), les praedia de Julia F elix, II,4,3 (EAA-PPM, III, p. 207, nO 30-3 1).
78. EAA-PPM, VIII, p. 796, nO 122 ;p. 797, n"123-125. 79. Riemenschneider, op. cie., p. 51 1-512, rype Va, plus
particulièrement frise 47. 80. À comparer avec les dimensions des moulures du
purgatO/iu/lI (fig. 30) qui refl ètent les échelles habituelles.
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 261
niches latérales. Sur les deux blocs flanquant le cintre, étaient modelées les oreilles d 'Isis, seule
note spécifiquement isiaque du décor.
Enfin, des fragments de l'entablement, dépourvu d ' architrave, sont conservés en haut
des murs Nord et Sud; une simple moulure d ' oves marque la limite de l'extrémité supérieure
de la paroi; la frise est ornée d'un rinceau que seuls quelques fragments permettent de carac
tériser mais qui confirment le dessin de La Vega: plutôt grêle, il est « étoffé » par des vrilles qui
sinuent autour de la tige et se déploient dans l'intervalle des volutes; des rosettes en aS-?ez fort
relief ponctuent l' enroulement terminal. Ce traitement peu naturaliste se retrouve dans les
courts rinceaux qui ornent les caissons de l'apodyterium des thermes de Stabies8 1. De l'enduit
qui recouvrait les modillons de brique de la corniche, il ne reste aucun vestige.
Intél-ieur de la cella (fig. 18-19)
Un examen attentif de l'enduit permet de déceler les traces évidentes d'un décor sous
jacent dont le parti général suit la même esthétique que celui du dernier état mais en diffère
suffisamment pour que les divisions de l'un et de l'autre ne puissent se confondre.
1. Description des vestiges
Dans l'état actuel, le décor est conservé sur une hauteur maximale de 247 cm au-dessus
du podium du mur Ouest, 370 cm sur le mur Sud, 413 cm sur le mur Nord, 350 cm sur le
mur Est de part et d'autre de la porte. Sur les trois murs, le mortier rose sous-jacent apparaît
jusqu'à une hauteur de 245 cm au-dessus du podium (environ 425 cm du sol), surmonté de
quelques assises de brique: huit au maximum dans l' angle Sud-Ouest, soit environ 32 cm de
haut.
Il s'agit du système décoratif hérité du Premier Style et qui consiste à imiter, au moyen
d'un enduit stuqué en léger relief, les articulations d'une paroi appareillée dont les blocs sont
encadrés d'une ciselure large de 8,5 cm en moyenne, et séparés par des incisions.
Sur les murs gauche (Sud) et droit (Nord) (fig. 20), deux rangées de deux ortho states
exactement alignés hauts de 166 cm pour la première et 161 cm pour la seconde sont surmon
tés d'au moins deux assises; il n'en subsiste que des vestiges82 où se lit l'amorce de deux blocs
superposés à l'angle Ouest: l'assise inférieure a une hauteur de 43 cm entre les incisions et le
bloc est conservé sur une longueur de 45 cm, tandis qu'il ne reste que 20 cm du bloc de la
seconde assise. Sur le mur Sud, une incision verticale au-dessus de la console de droite donne
la limite d'un bloc dont le relief est conservé sur 42 cm de long à partir de l'angle; à droite de
81. EAA-PPM, VI, p. 194, n° 83. Un rinceau de stuc ornait également l'entablement du péristyle de la Maison des Vettii, VI,15,1 lm] : A. Mau, Pompej; in Lebell Ulld Kunst, Leipzig, 1900, p. 314, fig. 162; EAA -PPM, V, p. 518, nO 87.
82. Hauteur maximale: 40 cm sur le mur gauche (Sud) et 75 cm sur le mur droit (Nord).
262 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
1er état
D 2e état
couche de mortier de tuileau
CJ restauration moderne
~ brique
H G F
'"'
18. Le temple, l'enduit de la cella: tes deux états, coupe Est-Ouest.
la console centrale se lisent une autre incision à 86 cm de la précédente ainsi que l'empreinte
du relief d'un bloc.
Le décor du mur Est, de part et d'autre de la porte, se réduit à l'incision horizontale qui
sépare les ciselures des deux niveaux d'orthostates en relief.
Sur le mur du fond (Ouest), la première rangée d'orthostates est remplacée par le
podium au-dessus duquel court une assise (H. 153 cm) de quatre orthostates de largeur
inégale (nous les désignons par des lettres de droite à gauche) : A: III cm, B : 112 cm, C :
III cm, D : 119 cm, suivis, à l'angle gauche, par l'amorce d'un cinquième CE : 26 cm) censé
prolonger celui situé à l'extrémité droite du mur Sud. Une incision horizontale continue
sépare les orthostates des assises supérieures lacunaires dont les blocs sont, eux aussi, encadrés par une ciselure et séparés par une incision; il subsiste de la première assise, haute de 43 cm,
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 263
1 er état
o 2C état
couche de mortier de tuileau
Cl restauration moderne
o brique
19. Le temple, l'enduit de la cella: les deux états, coupe Sud-Nord.
l m
les éléments de cinq blocs dont un seul semble conservé sur toute sa longueur. À l'angle droit, l'amorce d'un bloc (A' : 9 cm) qui se prolonge sur le mur Nord est séparée par une incision (à 10 cm de l' angle) d'un deuxième bloc incomplet dont la longueur (B' : 84 cm, ciselure com
prise) est attestée par une incision verticale. Du troisième bloc (C'), il ne reste que la moitié gauche et ses dimensions sont voisines (86 cm) ; suit un quatrième bloc (D') long de 86 cm
dont une partie du relief a subi une cassure verticale et un glissement partiel; le bloc qui le suit (E') n'est conservé que sur 32 cm et a perdu son relief de stuc; au-delà d'une lacune d'environ 150 cm, le bloc de l'angle gauche est conservé sur 26 cm.
De la deuxième assise, il ne reste qu'une amorce de bloc conservée à l'extrémité droite sur 25 cm et qui se prolonge sur le mur Nord (25 cm conservés).
264 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
20. Le temple, l'enduit de la cella:
mur Sud, angle Ouest.
2. Restitution du dernier état
Murs gauche (Sud) et droit (Nord) (fig. 18) : les blocs sont désignés par des lettres à partir de l'angle Ouest. L'ordonnance des orthostates et leurs dimensions sont connues; la
hauteur respective de leurs deux registres est déterminée, pour le premier, par la hauteur du
podium, et) pour le second, par la base des consoles.
En revanche, les parties hautes laissent une certaine part à l'hypothèse. On dispose des
données suivantes à partir du mur Sud: le bloc H' a 86 cm de large entre deux incisions; le
bloc G') interrompu par l'angle, se prolonge sur le mur Ouest; sa largeur totale est donc
d 'environ 83 cm ; à l'extrémité gauche, de part et d'autre de la console, aucune incision verti
cale n'est conservée. Il est donc probable que l' assise se composait de trois blocs de même lon
gueur (86 cm).
Les rares vestiges conservés à l'angle gauche du mur Nord n'apportent rien à la compré
hension des zones supérieures mais confirment la présence d'une deuxième assise.
Mur Ouest (fig. 19) : si la zone des orthostates est restée lisible, en revanche il manque
une bonne partie des assises supérieures. On connaît la hauteur des blocs (43 cm entre les
incisions) ainsi que la longueur de trois blocs: en moyenne 86 cm. Cette relative régularité
permet de proposer pour les deux blocs manquants la même longueur, ce qui laisse pour
Pamorce de G') à l'angle gauche, environ 41 cm; le prolongement de ce dernier sur le mur
Sud lui confère également une longueur totale de 83 cm".
83. Mêmes dimensions (42,3 x 88 cm) dans la Tombe 13 West de la Via Nuceria = Tombe de M. Octavius et Vertia Philumina (Laidlaw, op. cit., p. 328, avec bibliographie), datée du milieu du 1" siècle apr. J,-c. par A. D'Ambrosio, S. De Caro, t FOlOpiano e documenta-
zione della nccropoli di Porta Nocera _, dans VII impegllo per Pompel~ Studi e comn'blftl~ Touring Club italiano, Milan, 1983, n° 13 os, ou de la République par de Vos, Pompei, op. cit., p. 159. Ailleurs les dimensions SOnt très diverses.
A fundamento restituit? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 265
La deuxième assise reprenait vraisemblablement le même schéma, comme l'attestent les
deux amorces du bloc (A') visibles à l'angle N ord-Ouest; même si sa longueur totale peut être
restituée (environ 85 cm), rien ne permet de fixer ses limites sur l'un et l'autre mur. La hau
teur de la cella laisse supposer la présence d'une troisième assise (soit env. 130 cm au-dessus
des orthostates) et d'une étroite corniche d ' une vingtaine de centimètres.
On remarque que, contrairement aux dessins de La VegaB4, Mazois85 et Piranèse86, les
blocs d 'assise n'ont pas la même largeur que les orthostates et qu 'ils ne suivent pas une dispo
sition régulière en quinconce par rapport à eux.
3. 1. Le décor antérieur du mur Sud (fig. 18)
C'est sur le mur Sud, largement érodé, que les traces d'un état antérieur apparaissent le
plus clairement. Sous le stuc de deux des trois ortho states, à 112 cm du haut du podium, court
une profonde incision horizontale recoupée par une incision verticale qui correspond à la
limite de l'orthostate gauche du dernier état. Parallèlement à la première horizontale, une
autre incision, tracée elle aussi sur la couche de mortier sous-jacente à celle du dernier état,
s'aligne sur la base des consoles de tuf insérées dans les deux murs latéraux. Au niveau des
assises supérieures, seule l' extrémité gauche du mur entre la dernière console et l'angle a
conservé un fragment d'enduit lisse et sans relief.
Sur le mur Nord, mieux conservé, les couches sous-jacentes n'apparaissent pas.
3.2. Le décor antérieur du mur Ouest (fig. 19 et 21)
À l'angle gauche, le stuc disparu de l'orthostate E laisse apparentes deux séries
d'incisions verticales: l'une, très fine, correspond à la ligne guide que suit l'artisan lorsqu'il
étend la couche de stuc en relief; la seconde, qui la double exactement, profonde, continue et
régulière, comparable à celles qui séparent les ciselures, est un élément de décor. Elle est
recoupée, à 112 cm du bas de }'orthostate (soit 43 cm au-dessous de la limite supérieure
actuelle), par une amorce d'incision horizontale qui se perd sous le stuc du dernier état et
s'aligne sur celle du mur Sud. Ces éléments très ténus sont confirmés par les vestiges lisibles
sous l'orthostate D : l'incision horizontale subsiste sur une longueur d'une vingtaine de centi
mètres, tandis qu 'une incision verticale passe sous le relief à 65 cm de l'angle du mur. D ' autres
détails peuvent également être rattachés à l'état antérieur: il s'agit, d'une part, en haut de
l'orthostate C, à 194 cm de l'angle du mur, d 'une amorce d'incision verticale qui passe au
dessous de son relief et ne correspond à aucun repérage du dernier état; au niveau de la pre
mière assise, une incision verticale qui disparaît sous le relief du bloc C', environ à mi
longueur, n'est de toute évidence pas cohérente avec le dernier état dont le relief la recouvre;
d'autre part, le bloc E' de la première assise semble se confondre, pour la partie conservée,
84. MNN 213492 = Ricerca, 7.10, fig. p. 8 . 85. F. Mazois, Les Rrânes de Pompéi, IV, Paris, 1838,
pl. IX.2.
86. Amiquités de la Grande Grèce, aujourd'hui Royaume de Naples, Paris, 1837, II, pl. LX.
266 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
21. Le temple, l'enduÎt de la cella:
mur Ouest, angle Sud.
avec l'état antérieur: le relief du dernier état a disparu et laisse apparent un enduit soigneuse
ment lissé difficile à admettre comme couche préparatoire à une couche de stuc en relief;
enfin, un lambeau d'enduit isolé entre les blocs BI et Cf porte une incision verticale non cohé
rente avec le dernier état.
3.3. Restitution de l'état antérieur sur le mur Ouest
Cet état se caractérise par un décor dénué de relief, où de profondes incisions déter
minent seules l'ordonnance des blocs.
Pour restituer la première assise, très lacunaire, on recherche un schéma géométrique
capable d'intégrer les diverses traces repérées . À partir de la présence d'un élément de 43 cm
A fundamento rest ituit? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 267
conservé à gauche du mur sous l'orthostate D, l'alternance de carreaux et de boutisses est sup
posée; en admettant que le carreau ait le double de la longueur de la boutisse et en projetant
cette alternance sur le mur, on obtient la séquence suivanteS7 : 22 cm*, 43 cm*, 86 cm, 43 cm,
86 cm (centre), 43 cm, 86 cm, 43 cm, 22 cm, soit 474 cm auxquels il faut ajouter environ
0,5 cm pour la largeur des huit ciselures = 478 cm. Ce schéma est corroboré par les traces de
la deuxième assise, également haute de 43 cm et organisée selon la même alternance: les inci
sions verticales sous C' et entre B' et C' coïncident avec les limites d'une boutisse de 43 cm et
l'enduit lisse sous E' correspond à l'extrémité droite d'un carreau, de sorte que les divisions
des deux assises se trouvent en quinconce l'une par rapport à l'autre.
Il ne subsiste aucune trace pennettant de déterminer l'aspect du décor au-dessous des
assises.
3.4. Restitution de l'état antérieur sur le mur Sud
L'incision horizontale qui court 112 cm au-dessus du niveau du podium est parallèle à
une autre incision située à la base des consoles ; l'espace de 43 cm qui les sépare correspond à
un niveau d'assises fictives où seule l'incision verticale située à 1 ° 1 cm de l'angle gauche (Sud
Est) donne la limite d'un bloc . Toutefois, si l' on étend au mur Sud le schéma restitué pour le
mur Ouest, il apparaît qu'un carreau de 86 cm dont la limite gauche est connue peut prendre
place au centre et que rien n e s'oppose à ce que deux boutisses de 43 cm l'encadrent . Dans ce
cas, il resterait à l' angle Sud-Ouest une amorce de carreau de 64 cm qui, ajoutée aux 22 cm du
mur Ouest, constitueraient un carreau de 86 cm, conforme à l'hypothèse de restitution. Le deuxième niveau n ' a pas conservé de traces évidentes du premier état, mais il est à remarquer
que les éléments de blocs en relief du dernier état coïncident parfaitement avec une assise de
carreaux et de boutisses en quinconce avec ceux du premier niveau.
Dès lors, la relation qui s'établit entre les deux états du décor est marquée par une cer
taine continuité; si la technique diffère et fait succéder des panneaux en relief à un décor
incisé, certaines grandes divisions demeurent stables, telles l'incision qui court à la base des
consoles et la répartition des orthostates des murs latéraux. En revanche, le remplacement du
système à carreaux et boutisses par de simples assises de parpaings amène nécessairement des
modifications, encore que certains éléments puissent se superposer (l'assise E' du mur Ouest
semble en témoigner). Dans le cas des murs latéraux qui n'étaient guère visibles de l'extérieur
et où la contrainte des consoles rendait sans doute le travail plus difficile, il n'est pas exclu que
l'on se soit contenté de reprendre le système sous-jacent en lui ajoutant du relief. De même, à l'extrémité gauche du mur Ouest, l'étroite amorce de 22 cm qui trouve sa logique, on l'a vu,
dans l'alternance du premier état ne se justifie guère dans le dernier, sinon en supposant que
les artisans ont cherché à modifier à moindres frais le décor préexistant.
87 . Suivis d'un astérisque: les blocs attestés.
268 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
Le bon état de conservation des orthostates du dernier état ne permet aucune hypothèse
sur l'aspect de cette zone dans la phase antérieure. Tout au plus peut-on remarquer que le
podium impose une tripartition de la paroi et qu'il n'y a guère de raison de penser qu'il ait pu
en être autrement dans le premier décor. Toutefois, l'assise centrale s'aligne exactement sur le
bord gauche de l'orthostate central lui-même aligné sur celui du premier niveau, ce qui crée un effet de quadrillage inhabituel et amène à se demander s'il existait des ortbostates dans le
premier état. L'alternative la plus conforme aux schémas du (1 Masonry Style )} consisterait
à restituer, à la base des assises, un bandeau assurant la transition avec une rangée
d'orthostates ; mais on pourrait aussi, selon une alternative plus économique, restituer un
enduit uni entre les assises et le niveau du podium. Il ne s'agit là que d 'hypothèses invérifiables
tant que la conservation de l'enduit du dernier état empêche de repérer les traces d'incisions
sous-jacentes.
4. Caractères du décor
4. 1. Le problème du socle dans les deux états
Dans le dernier état, les orthostates des murs Nord et Sud reposent directement sur le sol,
sans plinthe ni soubassement d 'aucune sorte; en ce qui concerne le podium du mur Ouest, on
sait par les rapports de fouille qu'il était stuqué, et le modèle réduit en liège de la collection de
G ustave III de Suède88 reproduit fidèlement la série d'ortho states en relief qui l'ornaient et dont
les divisions correspondent à celles du dernier état au-dessus du podium. D'autres exemples de (I pseudo-Premier Style)} sont également dépourvus de soubassement, tels le temple
d'Apollon VII, 7 ,3289, le temple de Jupiter VII,8, 190, la tombe via dei Sepolcri n° 4 a Ouest", la
tombe nO 18 Ouest92 ou encore le socle à l'extérieur de l'édifice d'Eumachia93 .
Le décor antérieur était-il également dépourvu de plinthe? En bas du mur Sud, à proxi
mité du podium, un reste d 'enduit sous-jacent qui subsiste sur une quarantaine de centimètres
de haut et une quinzaine de centimètres de large ne semble pas porter de traces incisées. li n'est pas exclu que, dans l'état antérieur, la zone correspondant, sur les murs Nord et Sud, à celle du podium ait pu comporter un enduit lisse et dépourvu de toute incision fonctionnant
comme haut soubassement, selon le modèle connu par l'ala [17) de la Maison de SaIluste94 et
d'autres exemples95 .
88. Kockel, PhellQplastica, pL 6.6. 89. Laidlaw, op. cil., p. 309-310. 90. Ibid., p. 310-3 11. 91. Ibid., p. 32 1-322; V. Kockel, Die Grabballtell val'
dem Herkulaner Tor ill Pompeji, Mayence, 1983, p. 67. 92. Laidlaw, op. cie., p. 323 ; Kockel, op. cil., p. 89.
93. La idlaw, op. cil., p. 320-321. 94. Ibid., pL 15 a. 95. Atrium [A1 de la Maison de G. Polybius (Laidlaw,
op. cie., pL 14), le péristyle [14] de la casa dei Scienzati (ibid., pl. 18 a), la Basilique (ibid., pL 21), le clibicu/unI (g] de la casa dei Cenacolo (ibid., pl. 27 b).
A fundamento restituit 7 Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 269
4. 2. Alignement des orthoslates
Dans le dernier état, les deux rangées d'orthostates se superposent strictement. Or ce par
ti, très inhabituel, ne se rencontre à Pompéi que de façon ponctuelle et par suite d'une erreur,
par exemple dans l'antichambre du cubiculu111 [3] de la Maison du Centaure, VI,9,3, où les or
thostates s'alignent sur l'assise de soubassement96 : (c Although this alignment occurs occasion
nally elsewhere, it is generally in unimportant rooms in obscure corners », d'après A. Laidlaw97.
Une te lle incompréhension du modèle architectural est peut-être à mettre au compte,
ici, de l'écart chronologique qui sépare l'époque de la réfection et celle de la floraison du Pre
mier Style.
4.3. Superposition irrégulière dans le dernier état
Le décalage des joints des assises du dernier état par rapport au centre des orthostates
n'est pas exceptionnel, même dans les exemples de Premier Style: dans le triclinium [35] de la
Maison du Faune, l'irrégularité est due à l'insertion de boutisses entre les carreaux98 ; dans le
tablinum [4] de la maison VI,2,13, toutes les assises sont irrégulièrement décalées, puisque,
comme au temple d'Isis, elles n'ont pas la même longueur que les orthostates99.
4. 4. Boutisses can'ées dans le premier état
Le décor de l'état antérieur intercale, entre les carreaux de la zone d 'assises, des boutis
ses carrées de 43 cm de côté . Il se distingue en cela des exemples du Premier Style où les bou
tisses sont toujours de petits rectangles dressés alors que la peinture du Deuxième Style fait le
plus souvent usage, dans les systèmes fermés, de boutisses carrées: citons, à Boscoréale, le cu
biculu111 [F] de la Villa de P . F. SynistoriOO, à Pompéi la pièce [39] de la Maison du Laby
rinthe'OI, l'atrium [dl de la Maison des Noces d'argent ''', les cubicula [4], [8], [1 5] de la Villa
des Mystères. Ce décor se distingue aussi des reprises tardives du système de Premier Style
qui, du moins dans les exemples conservés, renoncent à l'effet d'alternance et juxtaposent des
parpaings identiques; le mur extérieur du temple d'Apollon dont la qualité montre qu ' il date
de la réfection post-62 présente un cas un peu particulier: les blocs d'assises ont alternative
ment 66 à 69,5 cm et 96 à 106 cmlO\ mais, leur hauteur n'étant pas conservée, rien n'assure
que les plus petits étaient carrés et, même dans ce cas, la proportion des élém ents (les (1 carrés »
auraient les deux-tiers de la longueur des rectangles) diffère nettement de celle du temple
d'Isis où les carrés sont égaux à la moitié des rectangles. Nous reviendrons plus loin sur la da
tation du premier état ; en tout cas ces données stylistiques tendent à l' assigner à une période
postérieure au Premier Style, mais antérieure au milieu du Ier siècle.
96. Laidlaw, op. cit., fig. 35, pl. 61 cet p. 154. 97. Ibid., p. 154, n. 64. 98. EAA -PPM, V, p. 106, fig. 29; Laidlaw, op. cil.,
pl. 25 a. 99. EAA-PPM, IV, p. 165, fig. 6; Laidlaw, op. ci!.,
pl. 17 b. 100. Mctropolitan Museum of An, New York:
H. Beyen, Die polllpejollische Wallddekormio/l VOII/ zweÎtell bis Zlllll vierten Slils, 1, La Haye, 1938, pl. 90.
101. EAA-PPM, V, p. 34, fig. 57 ; V. M. Strocka, Die Casa dei Labilimo, Hauser in Pompeji, 4, Munich, 1991, pl. 239.
102. EAA -PPM, III, p. 687, fig. 19. 103. Laidlaw, op. cit., p. 310.
270 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Mvriam Fincker
CONCLUSION SUR LE DECOR INTÉRIEUR DE lA CELLA
La présence d'un état antérieur du décor discernable jusqu'à une hauteur de plus de 3 m
témoigne clairement de ce que les murs de la cella, loin de s'être effondrés lors du séisme de
62, avaient conservé leur élévation et leur revêtement que l'on s'est contenté de rénover sans
en bouleverser radicalement l'ordonnance. Celle-ci était, du reste, largement déterminée par la
présence des consoles de tuf insérées dans les murs latéraux: c'est sur leur limite inférieure
que s'aligne, dans l'état antérieur, le haut de la première assise, et dans le dernier état le bord
supérieur des orthostates. De toute évidence, un certain conservatisme a présidé à la réfection; au lieu d'adopter
un schéma de Quatrième Style, comme cela a été le cas dans le portique, c'est l'austérité du
système hérité du Premier Style que l'on conserve, selon un usage suivi dans d'autres monu
ments publics lO4, en particulier au Temple d'Apollon où l'on refait à l'époque néronienne les
orthostates de stuc blanc déjà présents dans le temple du II' siècle av. J. -C. '05. Au décor sim
plement incisé succède le jeu des reliefs et des ciselures mais sans le raffinement qu'ajoutent,
au Temple d'Apollon, les encadrements moulurés.
Cependant cette continuité n'exclut pas des différences significatives. Le décor du pre
mier état se signale par la régularité de l'alternance des carreaux et des boutisses, la superposition soigneuse des assises en quinconce, la cohérence des murs perpendiculaires. Par con
traste, le dernier état se caractérise par une simplification du schéma: tous les éléments des assises sont identiques mais leur superposition est hasardeuse et le souci de suivre aussi fidèle
ment que possible l'ancien canevas aboutit à des incongruités. A. Laidlaw lO6 avait déjà noté la
négligence de l'exécution, sensible dans l' irrégularité des épaisseurs, le manque de précision
dans les intersections, le décentrement des incisions par rapport à la ciselure, l'absence
d 'incision verticale pour séparer les orthostates d'angles. Ajoutons, sur le mur Nord, une
erreur d 'exécution à l'angle inférieur droit de l'orthostate central du second registre: au lieu
de prolonger la ciselure verticale jusqu'à l' intersection avec l'incision horizontale qui sépare les
deux registres, l'artisan l'a fermée avec une couche de stuc.
Les deux états se distinguent donc par une différence de qualité ; toutefois le premier ne
peut guère, on l'a vu, remonter à l'époque du Premier Style.
Il.1.2. Purgatoriwn (fig. 22-30)
Le décor se caractérise par l' importance de la figuration et son caractère très composite. Comme pour la cella~ l'enduit crée une ordonnance architecturale fictive sur la structure de
brique, mais les murs ont été traités comme de classiques parois peintes du Quatrième Style,
104. Ibid.) p. 307 sq. 105. EAA -PPM, VII, p. 286-304, fig. 17 à 21; Laidlaw,
op. cit., p . 309-3 10.
106 . Laidlaw, op. cÙ., p. 312.
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 271
o lm ~' --~-~'
22. Le purgatorium, élévation f rontale Nord.
où l'iconographie mythologique habituelle se mêle à des motifs isiaques qui règnent principa
lement en façade. Une polychromie très vive, parfaitement conservée au moment de la décou
verte, distinguait le bâtiment du temple lui-même. La couleur de fond était jaune entre les
pilastres, rouge sur la frise, verte dans l'espace intermédiaire entre arcs et fronton, et jaune à l'intérieur de l'arc lui-même.
1. La façade Nord
Elle a reçu un décor complexe (fig. 22 et 24), presque conservé dans son intégralité au
moment de la découverte: les relevés (fig. 27) effectués alors nous permettent de compléter les lacunes actuelles 107 .
Les pilastres à lésène, soulignés d'une moulure de languettes, sont couronnés de chapi
teaux qui offrent une nouvelle variante de l'anthémion déjà abondamment utilisé pour le décor
107. Les dessins des fig. 22-26 ne prennent en compte que le décor conservé aujourd'hui, sous fonne de relief, mais aussi d'empreintes et incisés dont le relevé nous a per-
mis de contrôler la fiabilité des dessins anciens . Voir aussi EAA-PPM, VIII, p . 798-811, n'" 127-166, dont les clichés reflètent un meilleur état de conservation qu'aujourd'hui.
272 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Mvriam Fincker
o lm ,
23. Le purgatorium, élévation frontale Sud.
de la cella : une alternance d'acanthes et feuilles d'eau, dont l'élément central logiquement
attendu - une feuille d'acanthe - est remplacé par un personnage: nu, de face, bras écartés, il
tient l'extrémité des deux feuilles d'eau qui l' encadrent ; sa tête a disparu mais sa forme enfan
tine, svelte et aptère, permet d'identifier Harpocrate plutôt qu'un Amour, habituel dans ce
rôle; la composition a été modifiée pour s'adapter au vœu des commanditaires et à la fonction
du bâtiment. Le même principe s'est appliqué au décor des lésènes ornées, aux deux angles,
d'un rinceau issu d'un culot d'acanthe, dont chaque enroulement porte un motif isiaque; on
reconnaît à gauche, de bas en haut: un sistre, une situle de forme globulaire, puis un élément
plus rare, une coiffe hathorique, assez maladroitement interprétée 108 : on identifie, de part et
d'autre du corps de la mitre, des plumes (plutôt que des uraei ou des cornes) et, au sommet,
deux épis; suit Anubis, figuré de trois-quarts dos à gauche, tête toulnée à droite 109 ; puis un
petit personnage, debout de face, tenant du bras gauche écarté un bouclier circulaire dont on
108. Un modèle proche figure sur une antèfixe qui appartenait à la toiture du temple: i'ANN 21 193, Ricerca, p . 7 1, nU 4.4; Arslan, p. 430, V.49: cornes de taureau stylisées et disque solaire surmonté de trois épis qui sont une réélaboration de la couronne are j, les deux plumes traditionnelles remplacées par les épis renvoyant à Isis Euthenia-Demctra.
109. Et non un léopard (selon Mazois) ou un hippopotame (selon M. de Vos, L'Egittomania i/1 pitwre e mosaici romano-campalli della prima età iII/pedale [EPRO, 84], Leyde, 1980, p. 61, pl. 35,3).
A fundam ento restituit 7 Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 273
....... ....
o ~5m ,'----------------',
24. Le purgatorium, élévation frontale Nord : détail du décor en stuc (en vert: le tuf).
274 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
voit la face interne: un pygmée, plutôt que Bès; viennent enfm un uraeus, un bucrane 1lO, et un
Amour en vol à droite . L'enduit du pilastre de droite a presque totalement disparu aujourd'hui; il reste les trois volutes supérieures dont les motifs sont illisibles; déjà au
moment de la découverte, il devait être dégradé car La Vega l ll ne relève lui aussi que ces trois
volutes, avec de bas en haut un uraeus, un bucrane, un Amour volant; toutefois, cette parfaite
symétrie avec le pilastre gauche nous semble douteuse car les empreintes conservées sur le
fond ne con'espondent pas à ces motifs.
Les deux pilastres qui flanquen t la porte sont ornés d 'un pseudo-candélabre à hampe
végétalisée dont l'ombelle centrale portait un personnage masculin, debout de face, jambes
croisées, tenant sur sa tête l'élément de couronnement: le motif était encore bien lisible
en 1974 112. On le rapprochera de celui, voisin mais plus complexe, qui orne les piédroits des
niches du nymphée de la Villa S . Marco à Stabies, décoré après 62"', où des personnages
féminins ass is en constituent la pièce centrale . Entre les pilastres réels, des architectures fictives de Quatrième Style occupent les deux murs de la façade, à l'instar de ceux de la cella. Des
colonnettes à chapiteau (1 corinthisant » portent un linteau reposant sur des consoles ouvra
gées; à l'extrémité de l'entablement orné d'une frise de bucranes se tient, en guise d'acrotère,
un Amour au corps de Triton, tenant su r l'épaule une rame; au-dessus de cette construction,
se déploie une tenture, dont le bord inférieur festonné évoque un vexillwll : elle est ornée d'un
Amour volant ou nageant derrière un dauphin qu'il tient par les rênes; accroché au centre, un
clipeus enrubanné d'où pend une bandelette - du type déjà observé sur la façade de la cella - est
relié par deux guirlandes aux linteaux. Cette sorte de dais protège la figure qui occupe le
centre du panneau, debout sur une console ornée de fe uilles d'acanthe: il s'agit d 'un person
nage féminin, figé dans une pose hiératique, bras le long du corps, vêtu d'une tunique à plis
serrés et d'un himation collant couvrant la tête et noué entre les seins; on a voulu reconnaître
Isis dans celui de gauche Il 4, mais, comme son pendant est identique, il s'agit plus probable
ment de prêtresses égyptiennes, revêtues du costume de la déesse l 15) gardant, telles des her
mès, l'entrée du bassin sacré.
La thématique égyptisante se poursuit de façon encore plus marquée au couronnement:
la frise représente une procession de dix personnages convergeant vers la porte: les empreintes
conservées sur le fond permettent encore de lire leur position: agenouillés, ou debout bras ten
dus, dans une pose figurée sur plusieurs peintures l16, et portant divers ustensiles de culte; mais
110. Non identifié sur le relevé donné par M. de Vos, dans EgilLOmol/ia, pl. 35,3.
Ill. EAA-PPM, VIII, p. 799, n" J 30. 11 2. Voir de Vos, Egiuomallia, pl. 38. 113. Voir N. Blanc, dans A. Barbet, P. Miniero éd., La
villa S. Ma rco à Stabia (coll. Centre J. -Bérard, 18; coll. EFR, 258 ; SAP), Naples, Rome, Pompéi, 1999, p . 108-109, fig. 192, 195, 197, 201.
114. Tran Tarn Tinh, op. cil., p. 35 j M . Malaise, Inventaire préliminaire des dOCllmcms égypticl/S découverts Cil Iralie (EPRO, 2 1), Leyde, 1972, p. 277; voir la description d ' Isis dans Apul., M er., Il ,3-4.
11 5. Sur ce costume, voir cn dernier lieu Tran Tarn T in h, s.v . • Isis t , dans LIMe, V, Zürich, Münich, 1990, p. 79 1-792 ; l'auteur note, p. 792: • Les prêtresses d'Isis sembla ient également s'habiller " â l'isiaque" et tenaient aussi le sistre et la siro1e ... La distinction entre celles-ci et hl déesse elle-même pose de sérieux problèmes. t La forme du nœud isiaque qui, avec le basi leion, serait en dernier recours le seul critère pertinent d' identification, n'est pas assez lisible ici pour permettre de trancher.
116. Voir de Vos, Egiuolllal/ ia, passim.
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 275
il n 'est plus possible d 'en identifier le détail. Sur le relevé de La Vegall7, on reconnaît, en partant
de la droite, un prophetes drapé portant un serpent sur une couronne de roses 11R, un autre tenant
patère et rameau feuillu, un troisième pourvu d'une sorte de lituus ; la description du journal de
fouille (8 juin 1765) 119 - « au fond Anubis avec un caducée et un long bâton, trois autres figures
portant un dragon, une situle, un poisson ) - est une mauvaise interprétation des personnages
dessinés par La Vega 120 . Le but de cette procession est figurée au fronton, sous la forme d'une
grande urne, contenant sans doute l'eau lustrale: deux personnages sont agenouillés de part et
d'autre, tandis qu' aux extrémités deux victoires en vol brandissent un vexillum l21•
~a thématique isiaque n'appartient pas au répertoire courant des stucateurs qui ont ici
transposé en relief des motifs dont le modèle leur était proposé dans le riche décor peint du
temple, en particulier celui du péristyle: prêtres et prêtresses au centre des panneaux, attributs
divers dans les volutes du rinceau sur fond noir qui couronnait la zone médiane l22 .
2. Les murs Est, Ouest et Sud (fig. 23, 25-26, 29)
Ils sont ornés d'un pseudo-appareil isodome, plus simple que celui de la cella: un simple
incisé suggère le contour des blocs. Sur les murs latéraux, seules figurent les deux rangées
supérieures, car, en dessous, la paroi est divisée en trois panneaux, selon le schéma habituelle
ment mis en œuvre dans la peinture pompéienne: deux panneaux latéraux flanquent un pan
neau central plus large, mis en valeur par une moulure de palmettes et fleurs de lotus qui le
bordent sur deux côtés: des figures volantes en occupent le centre, selon une mode typique du
Quatrième Style. Une draperie tendue, gonflée par le vent, sert de fond au couple du panneau
central; au mur Est, Persée, identifié par ses bottines ailées, nu, l'épaule simplement couverte
d 'une draperie dont un pan retombe sur la cuisse, emporte Andromède; le bras droit, disparu,
portait sans doute l'épée de la délivrance; l'héroïne demi-nue, manteau drapé aux hanches,
est figurée de trois-quarts dos: elle enlace son sauveur du bras droit qu'elle a posé sur son
épaule gauche 123 ; les panneaux latéraux, dont le côté supérieur est dessiné en accolade') sont
occupés par un Amour en vol qui fait escorte au couple amoureux124 ; celui de gauche, figuré
de trois-quarts droite, draperie passant derrière les hanches, tient sous le bras gauche un gros
117. EAA-PPM, VIII, p . 799, n O 130. 118. Lecture peut-être ~ inspirée » par le motif repré
senté en peinture sur un mur du portique: voir ci-dessous, n. 122.
119. VoirEAA-PPM, VIII, p. 801, n° 13l. 120. C'est cette description, reprise chez Mazois, op.
cil., p. 185, qui figure chez Tran Tarn Tinh, op. ciL, p. 35. 121. S. Adamo Muscetto!a (Ricc/'ca, p. 64-66, et n. 33)
fait le rapprochement avec une cima de terre cuite appartenant à la toiture du temple, ornée de Victoires affrontées portant un trophée (Ricerca, p. 7 1,4. 1), et lie cette thématique à l'instauration du culte d'Isis-Augusta qu'elle attribue à Vespasien. Mais le motif des Victoires affrontées se rencon tre dans d'autres contextes: on le trouve p . ex . au fronton de la tombe-exède 20 de la nécropole de la Porte d'Herculanum, où les divinités ailées portent la tabula all-
sala : Kockel, Grabbamell, op. cit., p. 90-97, pl. 34. A notre sens, sur !t: Pllrgarorilllll, le motif exprime plus largement la Victoire d'Isis et, partant, de l'initié, sur la mort.
122. Ricerca, p. 4 1-42, 1.6 (desservant tenant une palme et un bouquet d'herbes) ; p. 42, 1.8, pl. VIl! (propheres drapé portant un serpent sur une couronne de roses) ; p. 45, 1.2 1 (hiérodule tenant sistre ct vase à offrandes); p. 47, 1.26 (desservant portant une situle) ; p. 48, 1.30 (lychnophare tenant l'aurelllll eymbilllll) ; p . 52, 1.46 (hie/'Og/'al/ll/1a rClls lisant le rituel dans un l'Oculus) . Sur le rinceau peuplé de motifs isiaques, voir ibid., p. 40, 1.3; 40-41, 1.4, pl. VIII ; p. 48, 1.31; p. 50, 1.38, pl. VIII.
123. E. Schwinzer, Sehwebcnde GruppclI ill der pOlI/pejalIisehen Wandmalcre1, Würzburg, 1979, p. 81, pl. Il,1.
124. D'après Mau, ils se détachaient sur un fond bleu.
276
o
t o
! o
t o
! o t o
!
lm ~--~-~,
25. Le purgatorium, élévation latérale Est.
> '.
>f'(?~'
o 1 m ~' --~--~'
26. Le purgatorium, élévation latéra le Ouest et coupe sur la porte.
A fundamento restituit? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 277
coffret, et retient de la main droite baissée un pan de son vêtement. Celui de gauche, figuré
presque de face, retient, à hauteur de la hanche gauche, la draperie qui tombe de son épaule
droite en barrant son torse; son bras droit baissé est tendu en direction du couple; peut-être
tenait-il un rameau. Sur le mur Ouest, beaucoup moins conservé, le casque à cimier du per
sonnage masculin identifie Mars en compagnie de Vénus; la déesse figurée presque de face,
avec diadème et chignon, est demi-nue: elle retient du bras gauche son manteau à hauteur des
hanches, et a passé le bras droit derrière l'épaule de son compagnon. Le dieu est figuré de face,
nu, un pan de son manteau flottant passé sous le bras droit. Là encore, deux Amours escortent
le couple amoureux, en portant ses attributs; celui de gauche, figuré de trois-quarts dos à droite, tient sous son bras gauche un long bétyle dont il maintient l'extrémité du bras droit
tendu. L'Amour de droite, en vol de trois-quarts à gauche, tend de la main droite une épée,
qu 'il a saisie par la courroie, et porte au bras gauche un bouclier rond. L'état de conservation
des personnages permet ici d'apprécier le talent des stucateurs, très à l'aise dans ce répertoire
familier. Bien que les visages ne soient pas conservés, on peut mesurer ailleurs la finesse du
modelé, en très faible relief. Le mouvement et la vie sont habilement rendus par la torsion des
corps et l'envol des draperies, selon un procédé mis à l'épreuve sur les voûtes et les plafonds,
lieu d'action privilégié des stucateurs.
À l'entablement, sur les trois côtés Est, Ouest et Nord, court une frise d'Amours et de
dauphins, nageant et volant; l'élément aquatique et aérien dans lequel ils évoluent n'est pas
représenté mais habilement suggéré par leurs positions variées et toutes différentes; ils sont
esquissés en quelques coups de spatule rapides, qui témoignent, là encore, d'un réel métier. Si
Amours et dauphins sont souvent figurés, en particulier dans les thermes où les seconds ser
vent de monture aux premiers, cette ronde mouvementée qui les fait évoluer au même niveau
n 'a pas, à notre connaissance, d 'exact parallèle.
Des frises moulurées de cinq types différents ornent l'édifice (fig. 30) : languettes sur les
baguettes encadrant les pilastres (dimensions du moule: 1,6 cm [H.] x 4 cm [L.]) (fig. 30,6),
festons inscrits sous arceaux et fleurs de lotus au fronton (4 cm [H.] x 10 cm [L.]) (fig. 30,3),
palmettes sous arceaux et fleurs de lotus aux rampants (3,5 cm [H.] x 6,3 cm [L.]) (fig. 30,4),
trèfles et fleurs de lotus sur la corniche inférieure de l'entablement (fig. 30,1), et les baguettes
d'encadrement des panneaux centraux des murs latéraux (dimensions du moule:
2 cm [H.] x 5 cm [L.]) (fig. 30,2), et enfin palmettes inscrites et fleurs de lotus sur la corniche
supérieure de l'entablement (3,5 cm [H.] x 6,5 cm [L.]) (fig. 30,5) 125 ; ce dernier moule a été
employé à l'envers I26, par erreur sans doute, sur le mur Est. La diversité des moulures est habi
tuelle sur les corniches de stuc, et tous ces motifs se retrouvent dans d'autres monuments,
publics et privés, de la cité.
125. Pour les profils, voir Riemenschneider, op. cil., p. 289-290.
126. Les moules peuvent bien entendu s'employer dans les deux sens; mais la position avec palmettes à l'endroit
ayant été adoptée sur les trois murs Ouest, Sud et Nord, la position inversée, avec palmettes retournée sur le mur Est, ne peut pas être volontaire et traduit plutôt une erreur de coordination entre les artisans (au moins deux) à l'œuvre.
278 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Mvriam Fincker
. )
27. Le purgatorium, élévation frontale Nord. D'après La Vega.
28. Le purgatorium. Photographie de Rum ine.
CI. BNF.
280 Nicole Blanc, Hélène ErÎstov et Myriam Fincker
, ,
4
! 1
5
o IO~ L' __ ~ ______________ ~'
30. Le purgatorium, détail des empreintes des moules de stuc.
À l'exception de la façade principale, le vocabulaire ornemental mis en œuvre est carac
téristique des modes picturales alors en vigueur, et se trouve emprunté pour l'essentiel au
décor intérieur domestique. Tou tefois, il n'est pas exclu que ces couples divins dont les
mythes évoquent obstacles et épreuves, aient rappelé aux fidèles les tribulations d'Isis et Osiris,
et que la richesse de la thématique marine fasse allusion au « Navigium Isidis »J la grande fête de la déesse qui ouvrait chaque année, le 5 mars, la saison de la navigation 127.
Il. 1.3. Les colonnes du portique (fig. 15)
Les colonnes de briques, dépourvues de base, sont revêtues d 'une épaisse couche de
stuc, atteignant jusqu'à ± 2,5 cm. Le fût est rudenté et peint en rouge dans le tiers inférieur,
cannelé et laissé blanc dans la partie supérieure. De l'enduit des chapiteaux, il ne reste que quelques fragments 128 ; ils diffèrent radicalement de ceux de la cella, et les stucateurs ont ici
développé un modèle qui leur était propre, dépourvu de toute référence architecturale; le
motif en effet se développe horizontalement: la corbeille, très basse, limitée en bas par une
baguette, est ornée de rinceaux végétaux affrontés surmontés, à leur intersection, d'un fleuron
127. T. Tibiletti, La festa dei ~ Navigillnl l sidis _, dans Arslan, p. 658-659.
128. EAA-PPM, VIII, p. 737, nD 4, portique Nord, 4< colonne en partant de l'Est; p. 750-751, n° 26, portique Est, partie Nord, 2< colonne en partant du Nord.
A fundamento restituit? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 281
à pistil, unique souvenir du chapiteau corinthien l29. Ce dernier élément n'est plus lisible
aujourd'hui, mais il nous est conservé par un dessin de La Vega 130, dont la justesse est
confirmée par les chapiteaux intacts de la palestre des thermes de Stabies 13! : une fois encore,
les deux monuments offrent un parallèle saisissant,
II.2. LES MOSAÏQUES (fig. 31-35)
Il ne reste rien, aujourd'hui, des pavements du temple, mais la documentation exécutée
au XVIII'" siècle autorise sinon une étude technique, du moins des comparaisons stylistiques.
La gravure de Francesco La Vega et Carlo Nolli (fig. 31)\32 donne l'état de conservation
des pavements lors de la fouille: la lacune de la mosaïque de la cella y est fidèlement repro
duite, conformèment au rapport de fouilles du 28 juin 1765 133 qui signale, dans le temple, un
pavement de mosaïque colorée long de 18 palmes et large de 6, dont une partie (3 p. x 3,5 p.,
soit 79 x 92,3 cm) a été « prélevée dans l'Antiquité ). On voit en outre, dans ce document, le
pavement du pronaos .. ceux des deux entrecolonnements latéraux de la façade ainsi que le tapis
de seuil de l'entrée latérale Sud.
Dans ses Antiquités de la Grande-Grèce, auJOll1'd'hui Royaume de Naples publiés en 1802,
1804, 1837, Francesco Piranèse donne aux planches LVIII, LXX, LXXI du volume II, res
pectivement le plan du sanctuaire et de ses mosaïques, l'ensemble de la mosaïque de la cella et
celle du pronaos, sans tenir compte des lacunes (fig. 32).
Les volumes publiés des Ruines de Pompéi de Mazois ne contiennent qu 'une partie de
l'énorme documentation qu'il avait rassemblée entre 1809 et 1811. Et si les mosaïques
n'apparaissent pas sur la planche VIII du volume IV, en revanche les dessins préparatoires!34
les signalent: on y voit les inscriptions du pavement de l'ekklésiastérion [6], l'amorce du tapis
du pronaos complétée par des notes manuscrites (< 4 étoiles [dans la largeur], 5 étoiles [dans la
profondeur] ) ), les mosaïques des entrecolonnements ; de plus, de petits tracés croisés mar
quent la présence de mosaïques devant la niche gauche du pronaos.
Lorsque rien ne subsiste d'un décor et que la connaissance que nous en avons repose
tout entière sur la documentation ancienne, la prudence s'impose; il faut s'assurer que les des
sinateurs successifs ont effectivement travaillé à partir des vestiges et que les séries de gravures
ne dérivent pas toutes d'un prototype éventuellement douteux. Tout d 'abord se pose la ques
tion de la destruction de tous ces pavements. Une disparition aussi complète suppose souvent
un prélèvement de la part des Bourbons; or les journaux de fouilles n'en portent pas trace.
D'autre part, il semble que la gravure de La Vega n 'ait pas été tirée 135 et que, n ' ayant donc pas
129. L'effet obtenu n'est pas sans rappeler le chapiteau en sofa (voir R. Ginouvès, DiCliol/l/aire méthodique de l'architecture grecque et romaine, II, Rome, Athènes, 1992, pl. 56, 6) mais la fleur axiale, même très courte, part néanmoins d'un culot d'acanthe, référence perdue dans le chapiteau du portique.
130. L'/mmagille, p. 48, n° 20.
131. EAA-PPM, VI, p. 154-155, n° 9-11.
132. Rice/'ca, 7 . 10 - inv. 213492 -, p. 9, 84 et fig. p. 8.
133. G. Fiorelli, Pompeiallal'lllll Amiquîtatum H istoria (= PAH), III, Naples, 1860-1864, I. l , p. 173-174.
134. BN Est. vol IV, fol. 16.
135. Rice/"ca, p. 84 : 7.10.
282 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
31. Le temple d'Isis, les mosaïques. Selon La Vega.
circulé, elle n'ait pu servir de modèle à Piranèse. Les indications manuscrites de Mazois ten
dent à prouver une observation directe, de même que l'indication d'un pavement de tessellatum
devant les niches, indication absente chez les autres graveurs.
32. Le temple, les mosaïques se lon Piranèse.
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 283
33. Le temple. la mosaïque du pronaos selon Piranèse.
34. Le temple. la mosaïque de la cella selon La Vega.
..
•
•
•
•
35. Le temple. la mosaïque de la cella: croquis de Labrouste et schéma restitué.
•
284 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
Les pavements étaient donc au moins partiellement conseIVés vers 1810. Mais il y a plus:
un dessin inédit d'Henri Labrouste lJ6, daté de 1826, c'est-à-dire lors du premier voyage de l'architecte à Pompéi l )7, montre deux coupes du temple (fig. 35) ; dans la marge, le croquis d'un
schéma géométrique se révèle être celui de la mosaïque de la cella dont on voit quelques triangles
et carrés adjacents ornés d'un nœud de Salomon, selon une proportion qui ne correspond
d'ailleurs pas strictement avec celle donnée par Piranèse. En revanche, il ne donne aucune indi
cation pour les autres pavements, soit qu'ils aient disparu, soit qu'ils ne l'aient pas intéressé, à la
différence de celui-ci qui propose une organisation géométrique relativement complexe. De
toute évidence, Labrouste a donc relevé lui-même cette composition encore in situ en 1826.
Ce faisceau de témoignages indépendants les uns des autres autorise donc à analyser ces
mosaïques et à y chercher des indications chronologiques.
II. 2.1. Damier enl/"e les colonnes du pronaos (fig. 31-32)
Les deux entrecolonnements latéraux de la façade sont occupés par un damier droit noir
et blanc de 4 x 4 éléments d'environ 22,5 cm de côté. Il ne s'agit donc ni du damier sur pointe
dont sept exemples sont attestés à Pompéi IJ8, ni de l'alternance de files de tessères noires et blanches l39, ni de systèmes plus complexes dans lesquels le damier soit s'insère dans un
méandre '40 , soit comporte des carrés sur pointe inscrits l 41• Il est à noter que tous ces damiers
(sauf lX,3,25) datent du Deuxième Style.
L'exemple le plus proche de l'lseum remonte lui aussi à l'époque du Deuxième Style et
se trouve dans la maison VII,16,22 [32], dans une pièce condamnée par la construction du
péristyle lui-même transformé ensuite en oecus l<l2. Le cubiculum [46] de la Maison du Laby
rinthe offre, vers 70-60 av. J.-C., un schéma voisin, sinon identique: il s'agit d'un double
damier dans lequel les carrés noirs sont eux-mêmes constitués d'un damier l4J•
II. 2.2. Étoiles à quam branches dans le pmnaos (fig. 33)
Entre l'escalier d'accès au temple et la porte de la cella, un tapis d'environ 165 x 235 cm
portait un décor d'étoiles noires à quatre branches sur fond blanc. Ce motif connaît une popu
larité plus grande à Pompéi qu'ailleurs. Il apparaît au Deuxième Style où il est typique en
décor de seuil144 ; son usage s'étend au Troisième Style145 où il s'emploie seul pour omer des
tapis: les exemples les plus proches de l'lseum sont ceux de la Maison de Championnet
136. UN Est. \Tb 132 l, t. m. 137. Pompei, Travallx et ellvois des architectes/ral/çais ail
XIX siècle, catalogue ENSBA~EFR, Rome. 1981, p. 290. 138. VI,9,2 (31 ] ; VI,8,20 [11]; V,2,I (4]: en seuil,
avec double file de tessères alternées; V,2,1 [X]; V,5,3 [U] : en tapis avec double file de tessères ahemêes ; VII,16,22 [72] : en seui l, avec croisettes; VII.4,48 [10] : emblema à damier et sabliers inscrits.
139. 1,7, 1 [16]: deux files; VII, 1,40 [16]; VII,2,18 [TJ; II,4,3 [39] ; VII,2,16 (0].
140. vn,4,59 [L]; VI, 1 1,9 [39).
14J. Vll,7,5 {R].
142 . EAA-PPM, VII, p. 987, fig. 71.
143. EAA-PPM, V, p. 57, fig. 87.
144. M. E. Blake, The Pavements of the Roman Buil~ dings of the Republic and Early Empire, MAAR, VlII, 1930, p. 103-104.
145. Maison des Amours dorés VI,16,7 [G], Maison d'Orphée VI, 14,20 [1] : ibid., pl. 31. 3; Maison de Pupius Rufus VI,15,5 [SI : ibid., pl. 1,4 et p . 14, EAA ~PPM, V, p. 607, fig. 5.
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 285
VIII,2,1 [C]I46, de la boutique de la Maison des Vestales VI,I,? [8]"17, de la Maison de Lucre
tius Fronto V,4,A [9]'48, Il est à noter qu'au Quatrième Style le motif n'apparaît plus que pour
décorer, parmi d'autres, des tapis de formes diverses l49.
II . 2. 3. Le "ineeau de seuil de la porte Sud (fig. 31-32).
Le dessin schématique que donne Piranèse du seuil de la porte au Sud de la cella repré
sente une double volute partant d'un culot orienté de l'intérieur du temple, volutes enroulées
vers le bas. L'exemple pompéien le plus proche provient de la maison VI,16,36 : les deux
seuils du uiclinium [H] avaient reçu à l'époque du Troisième Style une mosaïque dont la
double volute ne diffère de celle de l'Iseum que par le sens de son enroulement, mosaïques
ensuite masquées par une dalle de marbre, pOUf l'un des seuils, de travertin pour l'autre 150.
II. 2. 4. Dodécagones sécants dans la cella (fig. 34-35)
Le tapis ornait la totalité de la cella entre le bloc de seuil et le podium, tout en ménageant le long des mUfS latéraux une bande blanche; il ne reste, en bordure du mur Est de part et
d'autre de la porte, que quelques tessères blanches qui sont d'ailleurs de taille légèrement différente (0,6 cm du côté Nord, 0,8 du côté Sud) et qui passent sous le stuc pour venir buter
contre les parois de la cella en brique, le second état de l'enduit des murs ayant été tiré après la
pose de ce revêtement de S01151.
À la différence des pavements déjà décrits, celui-ci était polychrome. Le schéma géomé
trique peut être décrit comme une CI composition triaxiale, en nid d'abeille de carrés et de trian
gles équilatéraux adjacents, en opposition de couleurs (faisant apparaître deux dodécagones sécants) »152. Les carrés qui défmissent six des côtés des dodécagones enferment des nœuds de
Salomon tandis que le carré central est formé d'une rosette à cinq pétales toumoyants ; les trian
gles équilatéraux enferment eux-mêmes un triangle inscrit. Sur les longs côtés seulement, la bor
dure est constituée de neuf peltes blanches séparant deux dodécagones tangents.
Ce schéma qui reflète un plafond à caissons l53 est peu courant à Pompéi: l'emblema cen
traI du ,ablinu", [il dans la Maison de Caecilius Jucundus V,I,26, daté du Troisième Style,
n'en présente que le squelette linéaire noir sur fond blanc, avec une rosette schématique au
146. Blake, IDe. cir., pl. 25. 1 ; EAA-PPM, VIII, p. 32, n" 6.
147. Blake, loe. cil., pl. 3 1 A et p. 97, p . 103, n. 5; EAA-PPM, IV, p. II, fig. 12.
148. EAA-PPM, III , p. 983, fig. 36.
149. VI,16,22 [27]: EAA-PPM, VII, p . 975-976, fig. 49.
150. Blake,loc. cil., pl. 34.4, EAA-Pl'M, V, p. 986~9B7, fig. 9-10; dans deux nUITes exemples, la longueur du seuil a amene li prolonger le rinceau au-delà des volutes: Maison de Caesius Blandus 7,1,40, ala r3al, Deuxieme Style final: Blake, IDe. cil., pl. lB. 3; EAA-PPM, VI, p. 393,
fig. 27-28, et Maison du Sanglier l, VIII,3,8, cab/illulI/ P], après 62 : Blake, lac. cil., pl. 26.3 .
151. P. Hoffmann (p. 2 13) pretend que cette mosaïque n'était pas terminée en 79 : on ne voit gut:re sur quoi se fonde cette opinion; d 'après PAH et le plan de la Vega, une partie du pavement manquait, mais l'emplacement de cette lacune, à peu pres au cenITe du tapis, ne peut qu'être nccidemel et interdi t d'y voir la trace de ITavaux en cours.
152. Décor géométrique de la mosaïqlle romaille, Paris, 1985, pl. 205.
153. Voir l'apodyte/llllll masculin des Thermes de Stabies, ct le tepidan'IIIII des Thermes du Forum: Blanc, Hommes el challliel'S, loe. cil., p. 8 1-95, fig. p. 84-85.
286 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
centre de chaque hexagone l54 , Un décor d'Aquilée au 1er siècle apr. J. -C . répond au même
schéma sans décor intérieur mais avec six carrés noirs par dodécagone l55. Le parallèle le plus
proche proviendrait d'une pièce de la Villa de Diomède156, dans un cercle inscrit dans le tapis
carré; mais l'incertitude de sa provenance interdit d'en tirer des conclusions,
À l'intérieur d'autres systèmes décoratifs, les nœuds de Salomon apparaissent à la fin du
Deuxième Stylel57 ; au Quatrième, dans le triclinium [15] de la Maison du Poète tragique
VI)8,3 l58, ils interviennent comme motifs annexes dans l'emblema. À la même époque, dans la
Maison du Sanglier l, VIII)3,8 159, les nœuds de Salomon voisinent) en bande de seuil) avec
d'autres motifs dont une rosette à pétales tournoyants.
La bordure de peltes blanches apparaît au Troisième Style, dans la maison VIII,5,16 et
36, antichambre rd], en seuil'60, et est attestée au Quatrième Style dans la pièce [26) de la
Maison de Méléagre VI,9,2 16' .
Ce pavement complexe apparaît donc peu représenté en Campanie: les exemples pré
coces de schéma à dodécagones sécants manquent en effet de la richesse décorative qui
caractérise la cella, et si le vocabulaire existait depuis le Deuxième Style) la combinatoire est
neuve; cette création ne peut être antérieure au milieu du 1er siècle et date probablement de la
réfection après 62.
D'autre part, il faut signaler que sur le dessin de la Vega le tapis polychrome ne remplit
pas totalement l'espace de la cella mais s'inscrit sur un champ blanc non matérialisé sur les
relevés l62. Les tessères conservées seraient alors les vestiges d'une mosaïque noire et blanche
de Deuxième Style appartenant au premier état.
CONCLUSION SUR LES MOSAlQUES
Étoiles à quatre pointes et damiers sont typiques des Deuxième et Troisième Styles, et le
rinceau de seuil trouve son parallèle le plus exact à l'époque du Troisième Stylel63 ; seule, la
mosaïque de la cella est postérieure au milieu du 1er siècle. La quasi-totalité des pavements
154. Blake, foc. cit., pl. 23.4, et p. 114-122; Decor giomien'que, pL 205 b ; EAA-PPM, m, p. 587, fig. 20.
155. Blake, IDe. cir., pl. 39.4 ct p. 113.
156. Roux et BalTe, Herculanum et Pompéi, V, Paris, 1870, Peintures V' serie, pl. 5 ; les auteurs attribuent globalement un ensemble de pavements il cette villa, mais on sait qu'ils ont recopié les planches des Omali delle pareti, elles-mêmes dépourvues, le plus souven t, de localisation ; toutefois, les journaux de fouilles des Bourbons (PAH, l, p. 260) mentionnent, il la date du 26 octobre 1771, un . intreccio . formé de triangles et d'un cercle en mosaïque noire dans une pièce de l'étage supérieur. On citera également le pavement de la pièce 116 de la Domus Aurea à Rome, ainsi qu'une mosaïque de triclinium du II· siècle apr. J.-C, trouvée récemment à Alexandrie, où le même schéma est employé sur un panneau latéra l : A.-M. C ·..limier-Sorbets, RA, 1998/1, p. 192, fig. 1-2.
157. Maison de Pupius Rufus VIJ I5,5 [1], seuil, associès à des peltes blanches : Blake, loc. cil., pl. 36.3; EAAPPM, V, p. 595, fig. 31.
158. EAA-PPM, IV, p. 565, fig. 76. 159. Blake,loc. cil., pl. 26.1 et p. 99, 103, 108, 120. 160. Ibid., pl. 33.2. 16 1. Ibid., pl. 32. 1, EAA-PPM, IV, p. 748, fig. 181. 162. À la différence de La Vega, Piranèse, AmiqlliIës de
la Grallde-Grèce, op. cil., vol. II, pl. LIX, dessine, au droit des ouvertures du podium, deux lignes qui pourraient délimüer un tapis d'environ 280 cm de large.
163. Dans le deuxième complexe de la villa d'Ariane à Varano, un ensemble de piéces remontant à la phase augustéenne ct documenté par M. Ruggicro, Degli scav; di Stabia 1749-/782, Naples, 188 1, pl. VI, présente un regroupement de motifs très voisins de celui du temple d'Isis; damier de carrés sur la pointe, rinceau de seuil, ainsi qu'un schéma complexe d'hexagones sécants.
""-~:-,._.,.-.. ~ .. . ,
,'"
, 1\'\ , , \;
111.
"
).'
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d 'Isis il Pompéi 287
J ~
~ !
.. _il
'.
, L
'." ~~~::::F-' ~ - :2"~]
,"'" ~ l,'
J:, ."., .... . ';;:". l"~
? :,. ,,. '" .;~(" . . \ ··m
36. L'ekk lésiastérion, décor du mur à arcades. D'après les Omati delle pareti.
remonte donc à un état de construction antérieur à 62 et n'a subi ni dommages sismiques, ni
restauration radicale. Certes la disparition des mosaïques ne permet pas de s'assurer si des res
taurations partielles ont été effectuées, mais la question est secondaire face à des schémas bien
datables qui prouvent que le temple avait p eu souffert du tremblement de terre.
II,3, PEINTURE DE L'EKKLÉSIASTÉRION [6] (fig, 36-39),
On connaît bien le décor de Quatrième Style de l'ekklésiastérion par les gravures de
C hiantarelli et Morghen; les panneaux en ont été prélevés l 64, comme le décor de la face
interne des piliers '65 à fond blanc et candélabre doré surmonté d ' une figure de prêtresse
isiaque, Q uant à la face Est du mur à arcades, «prospetto di porucato a fondo verde con
164. Ricerca, p. 34-35 et 54~59, OU 1 57 à 1 .70; EAAPPM, VIII, fig 184 sq., p. 823 sq.
165. Ricerca, l. 57 à l. 61= MNN 89 15, 891 7, 8926, 8928,9768, EAA-PPM, VIII, fig. 197-201, p . 832-833.
288 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Mvriam Fincker
37. L'ekklésiastérion, modèle en liège d'AltierÎ.
D'après Kockel, Phelloplastica, pl. 6 : 17.
38. L'ekklésiastéri on, bouchage des arcades en 1941. CI. d'archives SAP.
A fundamento restituit 7 Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 289
colonne corinzie marmoree scanalate) epistilio e fregio a fonda rossa con Nereidi su delfini )}166, elle n'est jamais illustrée!67.
Une planche des Ornati delle pareti l68 représente pourtant l'aspect de ce mur à arcades vu
de l'intérieur de l'ekklésiastérion (fig. 36). Six colonnes corinthiennes cannelées et rudentées
supportent chacune le retour en épi d'un entablement qui court immédiatement au-dessus des
arcades,; les épis servent de support à un atlante qui soutient) des deux bras étendus) la saillie
de la corniche et se détache sur le fond sombre de la frise conservée uniquement entre les qua
trième et cinquième colonnes de droite. À gauche de l'atlante) une néréide tournée vers la
droite) un bras levé, chevauche un animal non reconnaissable et se retourne vers un person
nage masculin qui s'avance derrière elle, un objet (vase ?) à la main. Le mur des arcades, situé
fictivement derrière les colonnes) est divisé en un soubassement à bord supérieur mouluré,
sensiblement de la même hauteur que les rudentures, et une partie médiane ornée de sinuosi
tés imitant le marbre. Comme le bas de la p lanche des Ornati représente la partie inférieure du
mur Ouest) on constate que les divisions des arcades et des colonnes fictives se répercutent
exactement sur l'articulation du mur qui leur faisait face.
Lorsque Altieri réalisa le modèle en liège commandé par Gustave III, une bonne partie
de ce décor était encore visible (fig. 37)169 : il a donc reproduit sur toute sa hauteur la colonne de l'extrémité gauche à l'angle avec le mur Nord) la colonne suivante dont l'inwnaco est
lésionné, une partie du fût de la colonne de l'extrémité droite; en revanche, il ne reste rien de l'ùuonaco entre les deux dernières arcades de droite) et, de part et d'autre de l'arcade centrale)
des murs boutants dissimulent le revêtement peint. Aujourd'hui encore il subsiste une trace de ce décor entre les deux premières arcades de
gauche: on y distingue le chapiteau ocre-jaune) l'amorce du fût cannelé blanc et des vestiges
de faux-marbre vert l7o.
Ce décor suscite un certain nombre de questions qui valent la peine d'être posées, même si
elles restent sans réponse, dans la mesure où elles touchent à la chronologie de l'architecture et
des enduits. La première concerne la date d'érection des murs boutants (fig. 38) . S. De Caro l7!
parle de (1 barbacani borbonici 1) ; de même EAA-PPM!72, quoique aucune m ention n'existe
dans PAH de tels travaux de contrebu tement ; or ces m urs, qui n'apparaissent pas sur le plan de
La Vega, ont été fidèlement reproduits par Altieri en 1784173. Faut-il pour autant les considérer
comme antiques l74 ? Quelques rares photos d'archives (n" A9672) nous en ont conservé
l'aspect: l'alternance de deux rangs de tuf et de deux rangs de briques diffère de l'appareil des
arcades en ce que ce dernier ne comporte qu'une assise de tuf et) d'après P. Hoffmann175, la ma-
166. Ricc/'ca, p . Il . 167. On ne la trouve ni dans Ricen:a, ni dans les vo
lumes L '/mll/agine et EAA-PPM, VIII. 168. DAI, numéro au crayon: 39-40. 169. Kockel, PhelloplaSlica, pl. 6.5 et 6.16; Ricerca,
p.4. 170. EAA-PPM, VIII, fig. 194, p. 830. 171. Ricerca, p. 4, légende de la figure.
172. VIII, p . 826, nO 190. 173. Ils apparaissent également sur un plan inéd it des
siné par Labrouste en 1826 : ON ES[. Vb 132 l, c. lIT. 174. C. F avicchio, / dalllli delurremoto deI 62 OC a POli/
pei Hella Regio V/JI: II/elodo di l1àrca, scopelte, Naples, 1996, p. 202-204.
175. H offmann, p. 58, qui s'appuie sur une photo de T. Warscher(DAI 1933.331 1).
290 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
çonnerie de ces murs bou tants ne peut se confondre avec la maçonnerie antique: « Oberhalb
der Kampferhôhe der Arkaden bestanden die Stutzpfeiler nur noch aus quaderfôrmigen, ab
geschragten Steinen . Bei diesen Stützmauern scheint es sich um massives, durchgehendes und
nicht um Schalenmauerwerk gehandelt zu haben. » Ajoutons quelques éléments tirés des ar
chives de la Surintendance de Pompéi, qui permettent de préciser les dates.
En février 1941, le Giornale di scavo précise : (~ In questo importante edificio di cuita allo
scopo di riconoscere il tipo delle decorazioni ancora esistenti al disotto dei grandi barbacani di
sostegno dei muro pilastrato dei grande salone degli ambienti isiaci, si è ravvisata la necessità
di procedere alla rimessa a piombo deI muro medesimo ad archi e pilastri onde eseguire susseguentemente la demolizione dei barbacani di contrafforte e di sostegno elevati nel periodo bor
bonico nell'area dei salone. » La paroi à arcades était en effet dangereusement inclinée et seuls
les contreforts la maintenaient. Une série d'opérations se sont alors succédé: construction
d'un échafaudage) bouchage des arcs sur 8 m) échafaudage le long des murs intérieur et exté
rieur; en mars 1941, arcs et piliers étaient redressés et consolidés par injection de ciment et
des armatures métalliques renforçaient l'extrémité Sud du mur de l'ekk1ésiastérion 176 . La
guerre a retardé l'achèvement des travaux, de sorte que le débouchage des arcades n'a eu lieu
qu'en janvier 1948177.
Ce que l'on peut conclure de ces données reste) malheureusement, très incertain: les pre
miers fouilleurs ont dû trouver ce mur déjà déstabilisé puisque, en effet, rien ne pesait contre lui.
Soit son inclinaison est une conséquence de l'effondrement du toit de l'ekklésiastérion en 79, et
ce sont les Bourbons qui ont construit les contreforts, soit elle remonte au séisme de 62 et les
contreforts sont antiques, hypothèse que pourrait confirmer le lambeau d'enduit que l'on dis
cerne faib lement sur la photo d' archives de 1941. Rien ne peut plus être vérifié aujourd'hui,
puisque même les matériaux de démolition des murs boutants, qui étaient restés accumulés
dans l'ekklésiastérion jusqu'à la fin des années 1970, ont disparu 178 ; de plus, la mosaïque de la
salle étant détruite, il est impossible d'y repérer des traces. Quant au silence du journal de fouil
les, il ne peut être invoqué comme argument pro ou contra, sachant que sa finalité principale
consistait à tenir un inventaire précis des morceaux antiques et des matériaux destinés au palais
royal. Si certaines restaurations sont mentionnées179, c'est d'autant moins la norme que les bâti
ments dégagés sont le plus souvent réenterrés et que la question de leur préservation importe
peu. Un fragile argument pourrait toutefois être invoqué en faveur de contreforts modernes : la
gravure de G iovanni Morghen dans les Ornatifigure la totalité des six colonnes fictives du mur à
arcades sans omettre celles qui encadraient l'arcade centrale et que dissimulaient les contre
forts ; or le dessinateur a pris soin d 'indiquer en grisé les manques du décor et s'est gardé de re
présenter ce qui n'était plus visible; on pourrait penser alors que, si les contreforts existaient
déjà, il n 'aurait pas représenté le décor qu'ils occultaient.
176. L'assistant qui dirigeait les travaux était Alterio; les photos d'archives nO A 967 1 et A 9673 de 1941 docu· mentent le bouchage des arcades; Maiuri, Ultimo fase, op. cit, p. 69, n. 2, fait allusion à ces travaux.
177. Photo d'archives A 9672.
178. C'est pourquoi nous ne pouvons :mivre sans rê· serve les conclusions de C. Favicchio, op. dt.
179. Villa de D iomède, PAH, l , 28 mai 1774: renforce· ment des murs et de la voûte à caissons d'une pièce au niveau du jardin.
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis il Pompéi 291
La seconde question concerne le décor peint des arcades (fig. 36 et 39) ; ces massives
colonnes corinthiennes en trompe-l'œil se raccordent mal aux fins candélabres dorés qui
ornent l'intrados; elles manquent également de cohérence avec le système pariétal des trois
autres murs, mise à part la division en cinq zones du mur Ouest, qui correspond aussi au
nombre et à la largeur des arcades. Les hauteurs de soubassement ne s'alignent pas et la frise
au-dessus des colonnes (à env. 342 cm) ne correspondait pas non plus à la limite supérieure de
la zone médiane (env. 448 cm). Ces lourdes colonnes supportant un entablement à épis rap
pellent divers décors de la Villa des Mystères''', le cubiculum [42] de la Maison du Labyrinthe
où une frise de griffons surmonte les colonnes ioniques l81 , le frigidarium de la Maison du Cryp
toportique, avec des atlantes au-dessus des entablements à épis encadrant l'édicule centra1'82.
C'est clairement au Deuxième Style que se rattache aussi la paroi de faux-marbres derrière les
colonnes .
Certes on connaît un pastiche de Deuxième Style exécuté au Quatrième mais son carac
tère hybride est évident l83. Ici, ni l'aspect et le module des colonnes et de l'entablement, ni le
traitement du fond veiné ne rappellent le Quatrième Style; d'autre part, on voit mal la néces
sité d'inclure un pastiche aussi discordant avec le décor de la pièce qu'avec l'intérieur des ar
cades; on attendrait ici des candélabres et non un ordre massif.
De toute évidence, il s'agit ici de la trace du premier décor de l'ekk1ésiastérion, conservé
après 62 alors que les trois autres murs ont été redécorés en Quatrième Style. On notera tout
de même que le parti décoratif de ces parois est relativement atypique; s'il a quelques parallè
les avec la pièce [27] de la Maison de Méléagre, la pièce [15] de la Maison de la Chasse, ou la
paroi du Macel1um, dans l'articulation architecturale de champs délimités par des colonnes
sur de hauts piédestaux saillants, en revanche les panneaux latéraux occupés par de grands
paysages au statut indéterminé (fenêtres? tableaux?) conservent des réminiscences de la
phase II a du Deuxième Sryle: l'Deeus [y] de la Maison des Épigrammes'" ou
l'antichambre [21] du frigidarium de la Maison du Cryptoportique'85 s'ouvrent, au-dessus de
massifs piédestaux à ressauts, sur de grands paysages mythologiques. Le décor de
l'ekklésiastérion n'est certes pas contemporain de ces réalisationsl86) mais il manifeste un cer
tain passéisme dont la raison d'être pouvait résider précisément dans la colonnade fictive du
mur des arcades. L'appartenance de cette colonnade au Deuxième Style est un argument sup
plémentaire en faveur de la relecture chronologique du temple d'Isis.
180. CubicululII [16J : J. Engemann, Archi!ekl/lrdarS!eIl/fl/gell des/nillell Zweiteu S1/1s, Heidelberg, 1967, pl. 18, cubiwlu/J/ [12/13], alcôve Il avec une figure sur la frise audessus de l'entablement a epis ; ibid., pl. 26 ; Beyen, op. dt, l , pl. 20 b.
181. Engemann, op. cil., pl. 43-44; EAA-PPM, V, p. 39, fig. 64-65.
182. Engemann, op. cil., pl. 62; EAA-PPM, l, p. 231, fig. 65.
183. Maison des Vestales, péristyle [dl : A. Mau, Osservazioni : Parete dipima nella casa delle Vestali, GdS, 24-2, 1874, p. 107-130.
184. K. Schefold, Ve/gesselles PO/J/pejl~ Berne, 1962, pl. 25 ; EAA -PPM, III, p. 569, fig. 60 .
185. Schefold, op. cir., pl. 35; EAA-PPM, l, p. 246, fig. 94-95.
186. La note technique de P. Cînti dans Rieerea, p. 120, met en évidence la similitude technique de l'imolloco du portique et de celui de l'ekklésiastérion, il l'exception du tableau avec 10 et Argus, techniquement identique à l'imolIaeo des candélabres sous les arcades.
292 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Mvriam Fincker
39. L'ekklésiastérion, co lonne peinte.
CI. d'archives SAP.
III. DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES: LE SONDAGE DE 1950 (fig. 40)
L'évolution architecturale d'un monument ne peut guère s'appréhender sans sondages;
ceux-ci font cruellement défaut à Pompéi où les fouilles ne sont que très exceptionnellement
descendues en dessous des sols de la fin du 1er siècle . Aussi la chronologie des édifices s'appuie-
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 293
~. , 40. Le portique, sondage de 1950. CI. d'archives SAP.
t -elle essentiellement sur les caractéristiques de la maçonnerie, critère fragile et incertain dans
un monde où la récupération et le remploi sont constants. Précisément dans le cas du Temple
d'Isis, seuls des sondages systématiques permettraient de résoudre les contradictions entre
l'observation des vestiges et les schémas préétablis. Or ces sondages existent: ils ont été réali
sés en février 1950 et les archives de la Surintendance de Pompéi en conservent le compte
rendu inédit187. Seules quelques photographies et deux relevés illustrent ces travaux, ce qui
rend parfois hasardeuse la localisation exacte des structures repérées, d'autant plus que les
indications de mesures manquent souvent; manquent aussi les numéros d'inventaire qui per-
187. O. Elia, • Osservazioni sull 'urbanistica di Pompei, Il nucleo originario dcll'impianto », dans G. Mansuelli et R. Zangheri ed., Swdi suNa città amica, Acti dei COllvegllo di sU/di sI/lia città etrt/sea e iraliea preromolla, Bologne, 1970, p. 183-190, a fait état de ces sondages mais leur a ôté toute crédibilité en datant les vestiges du IX' siècle av. }.-C. ; un plan sommaire de l'angle Sud-Ouest et un croquis des fondations sont donnés p. 185-186, fig. 2 et 3; plus récemment, A. Varone, Attività dell'Ufficio scavi, Rivisto di SU/di
Pompeioni, 3, 1989, p. 229-231, a publié un bref compte rendu de sondages exécutés fin 1988 - début 1989 dans le sOCl'an'um et l'ekklésiastérion, malheureusement sans donner ni plan ni cotes permettant de situer l'emplacement des fouilles par rapport aux structures du temple; l'auteur, qui conteste à juste titre l'hypothèse protohistorique d'Olga Elia, se contente de décrire des tronçons de mur sans les mettre en relation avec la palestre qui permet de les éclairer.
294 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Mvriam Fincker
mettraient de retrouver et de dater éventuellement les fragments de céramique signalés. Quoi
qu'il en soit, il nous a paru utile de retranscrire l'essentiel de ce journal de fouilles.
Giornale dei lavori di scavo stratzgrafico eseguici 1Zell'area deI tempio di Iside (febbl'aio 1950)
Entrepris d'abord sur le côté Sud du portique pour expliquer la présence de lapilli vierges
au-dessous du sol, ils ont progressivement été étendus à l'ensemble du portique entre le péri
bole et la colonnade; seule une brève exploration concerne l'espace compris entre le sanc
tuaire et la colonnade Nord.
Du côté Sud, on découvre, dans une cavité correspondant à la quatrième colonne à partir
de l'Est, un tambour de colonne en brique revêtu de stuc blanc cannelé à rudentures rouges,
trois b locs de tuf appartenant au stylobate, ainsi qu'un bloc de pierre appartenant à un orifice de
citernell~8. Ce sont là les traces d'un affaissement qui s'est produit lors de l'éruption: une cavité
correspondant à une citerne s'est ouverte dans le sol, et colonne et stylobate s'y sont effondrés de
même que l'embouchure. Il faut remarquer que cette citerne qui n'a pas été dégagée se situe net
tement à l'Ouest par rapport à celle du purgalOrium et ne semble pas communiquer avec elle: la
paroi Ouest de cette dernière est intacte ainsi que son enduit et elle ne comporte pas d'ouver
ture ; le seul orifice visible s'ouvre dans la paroi Sud et correspond au caniveau. La citerne ef
fondrée appartient donc probablement à un état antérieur à la construction du purgalOrium.
En continuant la fouille sur 0,60 m de profondeur vers l'Est, on met au jour la fondation
du stylobate constituée d'un blocage de calcaire, lave, tuf, cruma, liés avec un abondant mor
tier. C'est cette même technique que l'on retrouve d 'ailleurs sous l'ensemble du stylobate du
portique.
Sur le côté Est du péristyle, à la hauteur de la 2< colonne à partir du Sud, à 45 cm du sty
lobate et à 60 cm du niveau du sol, trois amphores vinaires anépigraphes dont il manque col et
panse reposent, panni divers débris et tessons, sur une couche de terrain vierge à côté d'une structure en gros éclats de lave disposés en anneau irrégulier et non liés au mortier, le centre
de l'anneau étant rempli de pierres plus petites.
Dans le quart Sud-Est du portique (l'emplacement exact ne peut être déduit du journal
de fouilles), « sur l'axe du pilastre du portique 1), une petite voûte en blocage de 0,80 x 0,60 m
de côté est construite sur le terrain vierge et «( non si puo accertare a che cosa fosse destinata )}.
À proximité, on repère également, à 40 cm au-dessous du niveau du sol, un muret moderne en
pappanlOnte l 89 d'orientation Sud-Nord ainsi qu'un fond de canal en tuiles posées à plat
d'orientation Nord-EstiSud-Ouest.
Dans l'aile Nord du portique, la culée Sud d'un caniveau orienté Sud-Nord, construit en opus incertum revêtu intérieurement de signinum grossier et de section rectangulaire, corres
pond au débouché d'un trou repéré sous le trottoir de la rue bordant le temple à 80 cm de l'angle de la porte: il s'agit donc du canal d'évacuation des eaux du péristyle 190.
188. Surintendance de Pompéi, Nég. A 9671. 190. Surintendance de Pompéi, Neg. A 7986. 189. Il s'agit du canal du Sumo, construit vers 1600.
A fundamento restituit? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 295
C'est probablement au niveau des deuxième et troisième entrecolonnements à partir de
l'Est que se situent plusieurs restes de maçonnerie en opus l:ncertum de lave lié par un mortier
terreux: l'un orienté Est/Ouest, le long du stylobate, est revêtu de mauvais signinwn sur sa face
Nord; un autre orienté Nord/Sud et dont la face Ouest porte le même signinu11l est conservé
sur deux tronçons; il doit s' agir d 'une sorte de bassin (( abolito probabilmente in seguito
aWerezione dell'attuale edificio )l. Le tronçon Nord-Sud s'appuie sur un niveau de sol ( (1 pla
tea ») constitué d 'un conglomérat de lave et de calcaire du Sarno lié à un mortier terreux,
situé le long du mur périmétral et interrompu par le stylobate. Les limites de ce bassin, au
Nord, s'étendaient donc à peine plus loin que le mur périmétral puisque l' amorce de l'angle a
été repérée au Nord; au Sud, elles correspondent à celles du stylobate et le bassin était cohé
rent avec un niveau de sol (le conglomérat de lave et de calcaire), qui dépassait les limites du
stylobate. Cet aménagement qui s'aligne sur les limites cadastrales témoigne donc d'une phase
dans laquelle il n'existait pas de mur d'enceinte.
À la hauteur de la quatrième colonne à partir de l'Est, une fondation orientée Nord-Sud est formée de gros éclats de lave polygonaux, de calcaire et de tuf implantés sur le terrain
vierge et non liés. Cette structure diffère nettement des fondations du stylobate; aussi entre
prend-on, à la hauteur de la cinquième colonne, un sondage entre le stylobate et le temple. On
y trouve un mur parallèle au précédent et du même type et deux blocs de , pappamonte » dont
l'un est aligné contre le stylobate et l'autre contre la culée Nord du mur en lave; il ne semble
donc pas que cette seconde fondation se prolonge sous le côté Nord du portique.
Dans l'aile Ouest du portique, on effectue un sondage jusqu'à 90 cm de profon deur
entre la colonne d'angle Nord-Ouest et le premier pilier de l'ekklésiastérion; les tessons de
céramique campanienne récupérés semblent appartenir à des plats ou à de petites coupes de
qualité assez grossière. Ici la fondation du stylobate semble être moins en blocage que presque
en opus incertum avec beaucoup de calcaire du Sarno et peu de sable volcanique. Quant à la
fondation du pilier, elle est du même type que celle de l)ensemble du stylobate, c'est-à-dire en
blocage de calcaire et de lave liés à un mortier de chaux grasse. De plus, «( proprio innanzi e
poco al disotto ) de la fondation du mur à arcades sont repérées les fondations d'une autre
structure d'orientation Nord-S ud, dont la technique est similaire à celle des autres vestiges
trouvés dans le portique Nord à la hauteur des quatrième et cinquième colonnes: il s'agit de
gros éclats polygonaux de lave volcanique sans mortier.
On prolonge le sondage jusqu'à l'extrémité Sud de l'ekklésiastérion sans trouver, non
p lus que dans les autres sondages, trace de pavement. En revanche, les deux fondations suc
cessives apparaissent clairement: à 20 cm du sol, c'est d 'abord la longue fondation des
piliers en blocage avec des matériaux hétérogènes liés au mortier terreux) un peu en dessous
et à côté de cette fondation, une couche de petites pierres (calcaire du Sarno) ; plus en des
sous, la fondation en gros éclats de lave se prolonge jusqu'à l'angle Sud de l'ekklésiastérion
sans aucune modification ni interruption et sans structure latérale (le journal de fouill es ne
donne pas de mesures).
(C Poichè non è chiara la funzionalità di questa ultima struttura si decide d i allargare il
296 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
cavo. » Cet élargissement n 'amène pas de trouvaille sinon quelques tessons de céramique cam
panienne. À la hauteur de l'un des piliers (sans que l'on puisse préciser lequel), à 50 cm du
mur à arcades et à 40 cm de profondeur, on découvre une structure circulaire faite de gros
éclats de lave sans mortier, implantée dans le terrain vierge; au niveau de la dernière arcade au
Sud, à 15-20 cm de distance du stylobate et à 95 cm de profondeur, un autre cercle semblable
de 130 cm de diamètre enferme une épaisse couche jaune soufré ( « terreno di colore giallo-
gnolo che sembra fior di zolfo bruCÎato » ). Il s'agit probablement d 'un foyer.
L a prolongation du sondage vers le Sud sur toute la largeur du portique met au jour, à la
hauteur de la deuxième colonne à partir du Sud, une structure orientée Est/Ouest, en opus incer
tum constituée de beaucoup de calcaire hé avec un mortier rosâtre contenant de nombreux élé
ments de lave et de cruma. Cette structure repose sur une petite fondation en lave dure et sans
mortier du même type que celle qui se trouve en avant de l'ekklésiastérion. Le tout repose sur un
niveau (platea unira) situé juste au-dessus d'une couche de terre rapportée dans laquelle on a
trouvé un fond de coupe à vernis noir décoré de quatre petites palmettes équidistantes.
À la limite du sondage, entre ekklésiastérion et sacrariwn, outre la fondation en blocage du
mur Ouest du portique, on repère, à 60 cm du montant N ord de la porte du sacrarium, une fon
dation en lave (i presque » alignée sur celle située en avant de l'ekklésiastérion. Ces deux murs
semblent bien contemporains et cohérents, de par leur technique et leurs éléments constitutifs.
Enfin, peu en dessous du sol, un caniveau part du montant Sud de la porte du sacrarium,
rejoint l'autel situé dans le premier entrecolonnement et passe sous le stylobate au-delà duquel
il se prolonge; en opus incertum de matériaux de remploi, il mesure 20 x 15 cm et est couvert
en partie de gros éclats de calcaire et de lave.
CONCLUSION SUR lES SONDAGES
Malgré ses ImpréclslOns, ce journal de fouilles contient nombre d'éléments nouveaux . Résumons-les.
Tout d ' abord se distinguent deux types de fondations successives: la plus ancienne
(entre les quatrième et cinquième colonnes du côté Nord du portique, en avant du mur de
l'ekklésiastérion et deux segments Est/Ouest entre l'angle Sud de l'ekklésiastérion et la porte
du sacrarium) est constituée de gros éclats de lave sans liant; la plus récente (fondations du
stylobate et des piliers de l'ekklésiastérion) est un blocage de calcaire hé au mortier. Les fonda
tions du stylobate et celles des piliers de l'ekldésiastérion sont de même type (blocage). Le mur
à arcades a été précédé par un mur aux fondations de lave qui formait un retour au Sud, au
niveau de la deuxième colonne l91. D ' autre part, les limites du bassin Nord, antérieur à la cons-
191. Nissen, p. 161, avait déjà note la présence de cene première fondation sans que l'on sache d'où il tirait cette observation, absente de PAH : ~ Les arcades qui separent la piece contiguë du péribole ont dû prendre la place d'un
mur plus ancien. Cene hypothèse permet de comprendre pourquoi, aussi bien entre que sous les pilastres qui portent les arcs, les mêmes vieilles fondations couraient sans discontinuité. ~
A fundamento restituit? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 297
truction du stylobate, montrent que les divisions cadastrales correspondant aux premiers amé
nagements étaient celles définies au II~ siècle av. ].-C. lors de la restructuration de la zone du
Forum triangulaire. Les aménagements repérés sont deux grands foyers (ou du moins un foyer
et une structure circulaire) à l'Ouest du portique, une citerne au Sud, un bassin au N ord, des
canalisations à l'Est et à l'Ouest, un dépôt d'amphores vinaires à l'Est. À l'exception des
foyers, toutes ces structures se situent hors de l'emprise de la construction aux fondations de
lave pour laquelle nous ne pouvons proposer que des dimensions approximatives: 14,50 m du
Nord au Sud et 12 m d'Est en Ouest.
Comment interpréter les sections de fondations qui redoublent à 2 m - 2,50 m de dis
tance le tronçon Est/Ouest perpendiculaire au mur à arcades et le tronçon Nord/Sud reconnu
au Nord du portique? Définissaient-ils une galerie autour d'un bâtiment principal? S'agissait
il de plusieurs unités distinctes? Enfin, on note que ces structures, à l'exception des foyers qui
devaient être creusés, ne sont pas à plus de 40 cm au-dessous du niveau du sol et reposent sur
le terrain vierge. Elles ont donc précédé immédiatement la construction du temple qui les
entaille (bassin et fondations du côté Nord). En tout état de cause, foyers et citernes d 'une
part, céramique de l'autre, semblent désigner cet espace soit comme un ou plusieurs habitats,
soit comme une zone d'artisanat: la couleur jaune soufré du foyer n'évoque guère une activité
domestique. L'unique statuette en bronze d'Hercule n'incite pas non plus à y voir un temple,
d'autant qu'elle a été trouvée dans l'emprise de la Palestre avant son amputation!92.
IV. VALEUR ET LIMITE DE L'INSCRIPTION
Si la reconstruction totale du temple après 62 n 'a jamais été mise en doute, c'est d'abord
et surtout à cause de la dédicace, placée au-dessus de la porte d'entrée (CIL, X,846) :
N. Popidius N . f Celsinus aedem Isidis ten'ae motu evnlapsam a fundamento p. s. restituit "
hune deeuriones ob liberalitaten'l, cum esset annorum sexs, ordini suv gratis adlegerunt.
« Numerius Popidius Celsinus, fils de Numerius, a reconstruit à ses frais depuis les fon
dations le temple d'Isis détruit par le tremblement de terre; sa libéralité lui a valu, bien qu'âgé
de 6 ans, d'être reçu gratuitement dans l' ordre des décurions. »
Cette traduction littérale de a ftmdamento restituere a été, jusqu'à présent, unanimement
retenue, y compris dans des travaux récents sur les tremblements de terre!93 ; elle est pourtant
loin d'être assurée, comme une étude récente de E. Thomas et Ch. WitscheP9", consacrée
192. C 'est cependant l'opinion de F. Zevi, Sul tempio d'Iside a Pompei, PP, 49, 1994, p. 44-45, tout en notant que ce bronze semble davantage entrer dans le contexte de la Palestre; sur la découverte: Varone, loe. cil., p. 229 ct fig. 6.
193. E . Guidoboni éd., Cala/ogo dcllc cpigmfi lal/llc l'iguardami !en'cIIIDti, dans 1 ICI'I'CmOl/ pl'ima de! "''fillc i/1 ltalia e IIcll'area /IIediterrallea, Bologne, 1989, p. 135-168.
194. E. Thomas, Chr. Witschd, Constructing Reconstruction : Claim and Reality of Roman Rcbuilding Inscriptions from the Latin West, PBSR, 60, 1992, p. 135-177.
298 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Mvriam Fincker
aux inscriptions mentionnant des travaux de reconstruction, en fa it, indirectement, la
démonstration.
Certes, quand le séisme ne fait pas de doute, comme à Pompéi, il paraît naturel de com
prendre le texte stricto sensu: le formulaire est bien attesté dans les contextes de catastrophe, et
la reconstruction radicale après destruction totale semble aller de soi. On objectera toutefois
que les preuves archéologiques font défaut, les inscriptions datées n'étant jamais associées à un
monument suffisamment conservé pour que l'on puisse apprécier son homogénéité. De fait, le
temple d 'Isis à Pompéi constituant le seul cas où la confrontation est possible, c'est raisonner
de façon tautologique que d'en tirer argument pour dater le sanctuaire . Il nous faut donc exa
miner les autres occurrences du formulaire, pour tenter d'éclaircir le sens de l'inscription .
Remarquons d'abord que l'expression afundamcnto rcstituere n'est pas associée de façon
spécifique à des catastrophes naturelles, supposées génératrices de destruction totale. Plus
souvent, c'est la vetustas que l'on associe à la ruine195 : le participe passé collapswn n'implique
donc pas un écroulement réel, qu 'il soit total ou partiel, mais une dégradation due au temps,
qui ne peut être évidemment que sélective ; cette notion de veWstas est d'ailleurs toute relative
et ne saurait se traduire en années: elle n'implique pas que le bâtiment soit réellement victime
de son âge: c'est la façon h abituelle d'inscrire l'acte d'évergétisme dans un grand processus
historique. Rappelons d'ailleurs que la destruction totale du temple en 62 est peu probable:
stabilisé par le théâtre, il a sans doute été protégé, comme la palestre samnite contiguë qui a
subi des dégâts mineurs.
Il faut ensuite faire justice du termefundamentum : il n'a le sens architectural de « fonda
tion )) - la partie construite mais enterrée, par opposition au sol naturel - que dans des textes
techniques, ou des inscriptions qui décrivent sa nature: fundamenta lapidefacta (CIL, 1,603),
ftmdamentum ex caemento (CIL, IV,5927), etc . ; dans ce cas, il est d'ailleurs plus souvent
employé au pluriel, et associé à des verbes comme facere (CIL, VIII,1320, add. 9010;
Xl,5838-5840) ou extruere (CIL, X,6811)1 96. M ais, au singulier et accolé à restituere, il n'a
qu'une valeur métaphorique puisqu'on le trouve appliqué à des structures qui sont dépourvues
de fondation, comme un autel ou, mieux encore un simulaclum 197• Il signifie en fait le caractère
novateur de l'opération, qui substitue du neuf à quelque chose d'ancien.
En effet, le verbe restituere, plus couramment employé que reficere198, a deux sens: rem
placer par une nouvelle version une statue, un autel ou un bâtiment, mais aussi le restaurer
dans son ancien aspect. Autrement dit, il désigne deux opérations a priori radicalement diffé
rentes: une reconstruction ou une restauration. La distinction entre les deux n'est toutefois
pas si évidente qu'il y paraît. Une inscription d'Ostie, d'époque antonine, indique sobrement
les travaux effectués par un certain Publius Lucilius Gamala en ces termes: aedem Veneris resti
tuit (CIL, XIV,376). Ce qu'on serait tenté au premier abord de prendre pour une simple res-
195. Ibid., p. 143-149. 196. Voir E. De Ruggiero, Dizùman'o Epigrafieo di Ami
ehità Romane, Rome, 1922, s.v. « Fundamcntum », p. 337-338.
197. Thomas, Witschel, loe. cit., p . 159-160.
198. CIL, X,829 (Thermes de Stabies): notion d'extension (Thomas, Witschel, /oe. cit., p . 152).
A fundamento restituit 7 Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 299
tauration a de fait changé radicalement l'aspect du bâtiment: le socle républicain fut conservé,
mais les murs de la cella reconstruits et quatre colonnes rajoutées en façade pour créer un pro
naos tétrastyle. Le choix du formulaire prend tout son sens grâce à une seconde inscription
d'un ancêtre de ce Gamala qui se donne pour le fondateur du temple sous Sylla: aedem Vene,.is
constituit (CIL, XIV,375) ; le descendant a donc situé son action dans l'histoire de sa lignée;
mais le problème se complique du fait que les vestiges syllaniens laissent entrevoir deux pha
ses: c'est à la plus récente que se rattache l' intervention de Gamala, qui se révèle être non une
construction a nova, mais une reconstruction sur d'anciens murs, reprenant la même orienta
tion l99. Cet exemple privilégié nous permet de saisir la portée souvent fortement symbolique
de restiwere. Mais, en dehors même de toute signification métaphorique, le même intitulé peut
indiquer, à la même époque et dans la même région, des interventions très différentes qui impliquent à des degrés variables le bâtiment concerné. La Gennania Superi.or en fournit deux
témoignages significatifs au Ille siècle: le même formulaire - balneum vetustate conlapsu11l l'esti
cuit - désigne, à Walldürn en 232 apr. l-C. (CIL, XIII,6592), la reconstruction totale, sur
d'anciennes fondations mais avec de nouveaux plans, de thermes détruits par un incendie, tan
dis qu'à Jagsthausern en 244-247 (CIL, XIII,6562) on a procédé à l'adjonction de nouvelles
salles, sans toucher aux anciennes200. Ironie dont on goûtera tout le sel; le seul cas où le for
mulaire s'appliquerait sans conteste à une reconstruction intégrale est le temple d'Isis201.
Peut-on dans ces conditions caractériser, à l'aide de l'inscription, la nature des travaux
entrepris par Numidius Popidius ? Lorsqu'il est complété, comme c'est le cas dans le temple
d 'Isis, par le nom générique du bâtiment - aedem -, le verbe restituere n'implique-t-il pas, ipso
facto, le caractère radical de l'opération? Paradoxalement ce serait plutôt l'inverse: les recons
tructions a nova en effet détaillent complaisamment les différentes parties du bâtiment refait,
et tout se passe plutôt comme si la longueur du formulaire était proportionnelle à l'ampleur de
l'intervention. À Vindolanda, la reconstruction complète du fort, dans les années 223-225, est
signifiée à travers sa partie la plus symbolique, la porte et ses tours: portam cunz wrl'ibus a fun
danzentis restituel'unr02• S'il avait réellement reconstruit le temple d'Isis, Popidius aurait pu
choisir un texte mettant davantage en valeur l'ampleur des travaux réalisés; mais ce n'est pas non plus une règle, comme le montre l'exemple d'Ostie, cité plus haut. En revanche, le afun
damento qui compléte le l'estituere peut caractériser des travaux qui, sans affecter sa structure,
modifient sensiblement l'apparence d'un bâtiment: on le constate dans les thermes d'Hadrien
à Leptis Magna, qui furent enrichis de revêtements de marbre, de colonnes, et d'une statue
d'Asklépios203 . Or, s'il est un point prouvé par les données archéologiques, c'est que les tra
vaux ont radicalement changé l'aspect du sanctuaire pompéien. Ainsi, se trouvait justifiée
l' inscription de Numerius Popidius puisque la nouvelle colonnade, associée à une réfection
199. Thomas, Witschel, loc. cil., p. 156.
200. Ibid., p. 152-1 53.
201. Ibid., p. 160 ; gênés par ce contre-exemple, les auteurs s'efforcent d'ailleurs de montrer le caractère mappro-
prié de l'expression, en soulignant l' importance des remplois dans la construction.
202. RIB, 1706; Thomas, Witschel, loc. cit., p. 153-154.
203. IRT, 396; Thomas, Witschel, loc. cil., p. 162.
~
6 • ~
'.
r,
" ~ 1 , r, ~ ;;.r -
300 Nicole Blanc, Hélène ErÎstov et Myriam Fincker
générale des peintures et des stucs, avait suffi à métamorphoser le vieux sanctuaire. En
résumé, aucune information pratique ou technique sur la nature des travaux ne peut être
déduite de la seule dédicace: son sens métaphorique conjugué à un champ sémantique très
large interdit toute extrapolation de nature architecturale, si hypothétique soit-elle.
Reste à s'interroger sur le choix d'un tel formulaire; soupçonnera-t-on le commanditaire
de l'avoir choisi à dessein très vague, pour éviter de détailler une intervention, finalement
limitée, camouflée sous le afundamemo ? Ce n'est pas certain, car, sur le simple plan architec
tural et pratique, la différence entre une reconstruction et une réfection n'était pas aussi claire
ment définie dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. En théorie, c'est d'abord la mise en œuvre de
nouveaux matériaux qui distingue la première; or, dans les fa its, la reconstruction radicale est
assez rare. Le premier Isewl1 lui-même, on l'a vu, remployait des chapiteaux de tuf p lus
anciens. Indépendamment des préoccupations d'antiquaire qui ne sont pas absentes à cette
époque, la récupération des matériaux se justifiait par la lenteur, la difficulté et, partant, le coût du transport. Cette pratique apparaît clairem ent dans un passage du Contre Verrès204 :
Cicéron y détaille une escroquerie qui consiste à avoir facturé, comme une réfection a novo,
une simple restauration; il s'agit de travaux sur le temple des D ioscures à Rome, dont le cas offre un parallèle intéressant avec l' Iseum de Pompéi. Au lieu de refaire intégralement la colon
nade avec des matériaux nouveaux, l'entrepreneur s'est contenté de remonter les colonnes
avec les mêmes blocs; mieux, en plusieurs endroits, il n'a même pas démonté les colonnes
pour retailler les blocs et s'est contenté de refaire l'enduit. Atque in illis colormis, dico esse quae a
tuo redemptore commotae non sim ,. dico esse ex qua tantwn tectorium vetus deletum sit et nOVWll
inductum. Ici, tout le travail a été exécuté en réutilisant les vieux matériaux - rediviva - qui,
dans le cas contraire, pouvaient être laissés à l'entrepreneur, selon la formule consacrée - redi
viva sibi .habelO - que Cicéron extrait du cahier des charges. Mais on notera bien ici que ce
n 'est pas l'opération elle-même, tout à fait normale, qui est critiquée, mais sa surfacturation. De fait, le premier contresens fait sur la dédicace, prise au pied de la lettre, se double
d'un second qui consiste à entendre le verbe restituere dans sa seule acception matérielle. Ce
n 'est pas un hasard si l'on retrouve une inscription exactemen t parallèle à Herculanum, concernant le temple de Cybèle205
: Imp. Caesar Vespasianus .. . templum matris deae terrae motu
conlapsum restùuit (CIL, X,1406) . Les implications politiques et religieuses du terme apparais
sent immédiatement si l'on considère que l'empereur Vespasien, suivant en cela l'exemple d'Auguste, pouvait se proclamer restitutor aedium sacrarum206
• La reconstruction d'un temple,
avant d 'être une opération architecturale, signifie d'abord la restauration d ' un culte. C'est pro
bablement ce qui s'est passé à Pompéi pour le sanctuaire d'Isis. Après la catastrophe, la désor
ganisation de la cité, bien plus que la dégradation du bâtiment, ne permettait plus le déroule-
204. Cic., Vm·., II, l , 145. 205. L'inscription ne peut malheureusement pas être
mise en parallèle avec l'édifice dom on ignore jusqu'à la loca lisation . La grande plaque de marbre inscrite a été retrouvée dans le vestibule d'accès à la terrasse inférieure de
la palestre où elle avait sans doute t:té cmreposée en attendant d'être placée: M. Pagano, La nuova pianta della città c di alcuni edifici pubblici di Ercolano, Crollache ercolalles,~
26, 1996, p. 245-246. 206 . CIL, VI,934.
A fundamento restituit? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 301
ment normal des cérémonies; les travaux entrepris, en donnant un nouvel aspect au vieux
temple, symbolisaient de façon éclatante cette refondation - a fundamento - du culte; c'est à cela, et non à de simples travaux édilitaires, que la famille de Numerius Popidius entendait
attacher son nom. C'était de plus une manière de créer un passé au sanctuaire, et donner ainsi
une légitimité à un culte, somme toute récent, et qui n'avait pas toujours été agréé par le pou
voir. On constate que ce formulaire est appliqué de façon privilégiée à des sanctuaires primi
tifs, ou à des divinités d'origine étrangère (Isis, Cybèle, Sérapis) : elles y trouvaient le moyen
de se parer du caractère antique et vénérable propre aux dieux de la cité207.
V. CHRONOLOGIE
Résumons les acquis: la présence dans la cella d'un premier état de l'enduit sous la
réfection postsismique permet d'affirmer que le temple était debout après le tremblement de
terre et que la prétendue reconstruction n'a été qu'un ravalement; dans sa structure, le bâti
ment tel que nous le voyons aujourd'hui n'est pas le (4 second Iseum 1) mais le premier. En effet,
l'étude des proportions a montré que la conception du sanctuaire est unitaire et comporte dès
le début l'ensemble du péribole avec l'ekklésiastérion pris sur la palestre samnite. Ce sanc
tuaire s' implante nécessairement après l'agrandissement du théâtre dans les premières années
du I cr siècle. Tentons maintenant de cerner p lus précisément l'histoire architecturale en par
tant de l'état le plus récent et qui conserve les vestiges les plus lisibles208 : il s'agit essentielle
ment du décor.
O utre les peintures du portique qui datent sans conteste de la dernière période du Qua
trième Style209, le revêtement de stuc du purgatorium et de la cella est bien daté de par sa simili
tude avec le décor des Thermes de Stabies restauré après le tremblement de terre ; on y décèle
la main des mêmes artisans . L'épaisseur de l'enduit qui masque les chapiteaux et modifie leurs proportions rend méconnaissable l'ancienne structure de tuf et de briques. À l'intérieur de la
cella, le même processus est à l'œuvre mais avec une certaine volonté de conservatisme qui
amène à rem anier le système décoratif en préservant ses divisions essentielles. Si la mosaïque
de la cella a disparu, la documentation atteste un riche tapis dont la composition ne peut être
antérieure au milieu du Icr siècle et qui s'est substitué à un pavement dont subsistent quelques
tessères . Mais l'élément le plus symptomatique de la réfection est la colonnade du portique
m énageant dans l'axe du temple une vue majestueuse sur la nouvelle façade.
207. Thomas, Wirschel, loc. cir., p. 173.
208. Sur la foi de la maquette en liège d'Altieri (Kockel, Phelloplaslica, p. 87, pl. 6. 16), on peut penser que le revêtement du mur d 'enceinte qui simule un décor d'appareil
- encore partiellement visible aujourd 'hui - n'était pas termine au niveau de l'ekklesiastérion.
209. V. Sampnolo, La decorazione pittorica, dans Ricerca. p. 23-39; cud., 1 decoratori dei tempio di !side, PP, p. 57-82.
302 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
Cette colonnade a pris la place d 'une structure antérieure dont subsistent des traces sur
le stylobate de tuf qui s'inscrit, nous l'avons vu, dans la conception globale du sanctuaire.
Ce que l'on a donc toujours considéré comme le second Iseum n'est en fait que le pre
mier encore présent sous l'enduit qui le dissimule. La structure de brique et de tuf appartient à la même phase de construction; elle intègre dès le départ des éléments récupérés (les chapi
teaux siculo-corinthiens) 21O, tandis que d'autres (bases21l , corniche du socle, colonnes du pronaos212
, chapiteaux du purgatorium2i3) ont été mis en œuvre lors de l'érection du monument.
Contrairement à une idée reçue, le mode de construction en brique est largement répandu à Pompéi dès le Deuxième Style, tant dans les édifices publics (Odéon) que dans les maisons et
les tombes où, d'ailleurs, la brique s'allie à des éléments de tuf: les tombes augustéennes de la
nécropole de Porta Nocera en offrent plusieurs exemples214 ; ces comparaisons sont justifiées
dans la mesure où le temple d'Isis, rappelons-le, est un bâtiment de petite taille. Dans son ana
lyse de l'opus testaceum à Pompéi, K . Wallat215, tout en classant le temple avec les édifices de la
dernière période, s'inscrit en faux contre une lecture simpliste qui consisterait à dater toute maçonnerie régulière en briques d 'après 62.
Nous avons vu que le premier Iseum est forcément postérieur à l'agrandissement du
théâtre216 et que sa structure en brique l'apparente à d'autres édifices augustéens. D'autres
indices permettent de confirmer cette date: les mosaïques du pronaos et du seuil de la porte
Sud datent de l'époque augustéenne. La majeure partie du mobilier est julio-claudienne2 17 :
citons le très bel hermès de Norbanus Sorex au début de l'époque augustéenne, deux portraits
210. P. Hoffman n, dont les conclusions chronologiques rejoignent les nôtres, tend pourtant à croire que les éléments récupérés, datables du II' siècle av. ],-C., proviendraicnt d'un bâtiment de même fonne que le temple que nous connaissons (H offmann, p. 2 12) ; or, rien dans les sondages ne permet de le supposer et l'origine de ces élêments reste obscure.
2 11. Voir Nissen, p. 173: , So schlecht gearbeitet, dass sie schwerlich früher ais nach 63 und in der Eile hergerichtet sÎnd. ,
2 12. Non cannclées: voir n. 34. 213. D e peti te taille, proportionnés au bâtiment, ils Ont
difficilemem pu être récupérés ailleurs. 214. L Vlad Borre1li, F. Parise Badoni et al., dans VII
impegllo pel' Pompei, op. cil, tombe 20 EN, p. 29 et fig. p. 33 ; voir aussi de nombreuses maisons de Pompéi : K. Wallar, Opus testacellm in Pompeji, RM, 100, 1993, p. 353-382, plus particulièrement p. 363-366.
2 15. Loc. cil.; un faisceau d'arguments techniques (mesures des briques, du mortier, texture, cuisson) l' amène li mettre les briques du temple en relation avec celles des T hermes centraux et à dater cc groupe de peu après 62, en fonction de la date communément admise pour ces deux monuments. 11 nuance néanmoins cette approche: , Es ist leider nichr môglich, eine Wand allein anhand des Ziegelmatcrials exact zu datieren. , Selon "emplacemcnt où sont effectués les repérages, l' interprétation des données peut différer : dans ce CaS précis, la conservation de J'enduit ne permet que des approches partielles et les mesures om été
prises à l'angle Sud, près de la porte latérale, en un point où l'on ne peut exclure une réfection; il resterait li vérifier si ces briques sont idemiques à celles du noyau de la cella, sous l'enduit du premier état, e t, si c'est le cas, à relativiser totalement la portée chronologique de ces données techniques.
2 16. C'est également la conclusion à laquelle parvicnt Hoffmann, p. 87 sq ., insistant sur le fait que la datation [lavienne de j'oplls vittallllll a été établie à partir de la dédicace du temple, alors q ue cette technique existe depuis l'époque augusto-tibérienne; ibid., p. 2 12: , Der T erminus post q uem für die Erweiterung des Isis-T empels liegt um das Jahr 2/3 n. Chr., denn erst nachdem die in diesen Jahrcn durchgeführte Vergrosserung des Theaters beendet war, wurde auch das Areal, auf dem der Isis-Tempel grasser oder volkommen neu errichtet wurde, erweitert. , Cependant, faute d 'analyser le revêtement interne de la cella et le style des mosaïques, il en reste à une datation pas! 62 du lIaos et du pWgalO/Ù/lII, pour la seule raison que leur structure est en brique; or le même raisonnement s'applique ici comme sur l'opus vitrallllll.
2 17. Ricerca, p. 67 sq.; mais O. Elia, Le piullre dei Tell/pia di bide, Monumenti della Pittura antica scoperti in Italia, Pompei Ill-IV, Rome, 1941 , p. 2-3, et fig. 3-4, attribue à tort au temple deux peintures égyptisantes de Troisième Style qui viennent en réalité toutes deux d'Herculanum : l' une (MNN 8970) de la Palestre (de Vos, Egiuomallia) nO 10, p. 2 1 et pl. XXI) et l'autre (MNN 8566) de provenance inconnue (ibid. ~ n° Il, p. 22, et pl. XVll . 2).
A fundamento restituit? Réfections dans te temple d'Isis à Pompéi 303
féminins tardo-augustéens (6289, 6284), tandis qu 'un troisième buste (6285) porte la coiffure
d'Antonia Minor; la statue d'Isis (976), restaurée dans l'Antiquité, est claudienne21 fl, ainsi
qu'une tête d'Isis (6290) .
À cela s'ajoute le montant en cipolin de la niche [5a] du sacrarium qui porte l' inscription
M. Lucretius Ru/us Ilegavit (fig. 13). La même inscription se rencontre cinq autres fois à Pom
péFl9, dont trois sur des hermès acéphales, groupe auquel nous serions tentées d'adjoindre
l'exemplaire du temple d'Isis, qui devait, selon toute vraisemblance, présenter cette form e
avant remploi. L e personnage est identifié avec le M. Lucretius Decidianus Rufus dont le cur
sus est développé sur "une grande inscription du forum 220• Bien qu'on ne puisse lui attribuer
avec certitude un monument précis, les lieux de découverte de ses dédicaces - le forum civil,
l'Odéon, et le forum. triangulaire - parlent en faveur d 'une activité évergétique forte. Comme
son titre de tribunus militum a populo n'est pas attesté après Auguste, c'est bien à cette période
qu'il faut situer ce notable221 ; on supposera avec une bonne probabilité qu'il figura parmi les
généreux donateurs de l' Iseum, et que c'est lors de la phase de restructuration que son hermès
passa en remploi dans une niche, sans doute par pénurie de matériaux ; peut-être aussi les
nouveaux il fondateurs » ne tenaient-ils pas à perpétuer la mémoire des premiers et authen
tiques instaurateurs du culte.
L ' abondance des témoignages augustéens, au premier rang desquels une statuaire de
bonne qualité, parle donc en faveur d 'une construction et d'un aménagement du temple à
cette époque. En outre, l'érection d 'un temple à cette déesse (l étrangère » se conçoit mieux
lorsque l'Égypte est devenue province romaine et ses divinités intégrées dans la religion de
l'Empire, qu'à l'époque samnite où il aurait pour seul antécédent le Serapeum de Pouzzoles
connu par la Lex parietifaciundo de 105 av. }._C. 222•
L'attention des chercheurs n'a guère été retenue par l'aspect particulier de la façade
principale223; or elle n'a pas de parallèle avec les autres édifices isiaques orientaux ou occiden
taux, qu'ils soient réellement construits ou représentés en peinture. Ici, les deux ailes latérales
qui ont été conçues dès l'origine, puisque le podium en détermine la forme, élargissent nette
ment la façade et accentuent encore les proportions de la cella plus large que profonde. La
seule référence envisageable est celle des temples à cella barlongue: le temple de Veiovis dans
sa phase syllanienne et le temple augustéen de la Concorde présentent le même type de p lan
caractérisé par il la mise en place d'un vestibule à colonnade en saillie sur la partie centrale
d'un corps de bâtiment qui lui est perpendiculaire »224. i( Cette formule, dit P. Gros, doit sur-
218 . Toutefois, elle est très proche de la Diane archaïsante de Pompéi, d'époque augustèenne : Ricerca, p. 68.
2 19. CIL, X,788-789; 815; 85 1 ; 952-954; P. Castrén, Ordo popl/Jusque pompeial/lls. Polit y and society il/l'oman Pompeii, Rome, 1975, p. 185-186, n° 227.
220. CIL, X,788; Castrén, op. cil., p. 103.
221 . Le premier de son nom anesté à Pompéi, adopté sans doute par un Lucretius ; Castrén, op. cit., p . 95, le situe parmi les partisans d 'Octave.
222 . Sur la politique augustéenne envers le culte d'Isis, voir Arslan, p. 123-125; sur les persécutions et la destruction des temples d'Isis et Sérapis à Rome, voir M. de Vos, DiollySIIS, Hylas e Isis slii momi di Roma, Rome, 1997, p. 121-122.
223. Hoffmann, p. 197, n'analy~e la façade que par comparaison avec la majorité des édifices isiaques qui présentent deux colonnes ill amis ou sont prostyles tétrastyles.
224. P. Gros, L'architeclllre romaille du dêbut du Il! siècle av. ].-G. à laiill dll Haut-Empire, Paris, 1996, p. 133.
304 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
tout son existence à la souplesse avec laquelle elle peut s'insérer dans un tissu urbain trop
dense ou sur un espace trop restreint pour accueillir des constructions développées sur un seul
axe. )225 Dans le cas de l' Iseunl, l'exiguïté du péribole justifie en effet un tel parti; toutefois, il
faut noter que, contrairement aux exemples romains où l'extension visible de la cella depuis la
façade correspond effectivement à ses dimensions réelles, on assiste, à Pompéi, à un effet de
trompe-l'œil: les ailes de la façade, occupées par des niches226 et non des fenêtres, fonction
nent comme un placage destiné à élargir fictivement la cella; il s'agit alors ici de ce que l'on
pourrait appeler une cella pseudo-barlongue. L'adoption de ce plan par les constructeurs de
l' Iseum qui se sont référés, de toute évidence, à un modèle existant, confrrme encore une chro
nologie julio-c1audienne227 •
Entre l'époque de la construction et celle de la réfection, des aménagements ont eu lieu;
les modifications de la zone au Sud du temple ont pu entraîner une reprise des arcs de
décharge au-dessus des portes menant aux pièces [7) [8) [9) et expliquer la différenciation des modes de construction (opus vittatum pour les piédroits et opus mixtum pour les arcs) par rap
port aux arcades de l'ekklésiastérion où l'on observe un usage inverse.
Antérieurement à la construction du premier Iseum, et lorsque la palestre sarnnite a toute son extension, comment était occupé cet espace? Les quelques vestiges repérés lors des fouil
les des années 1950 - des foyers, des citernes, un bassin, des murs délimitant un espace res
treint - ne peuvent guère le caractériser et le seul élément de mobilier est le puteal en bronze à
thématique dionysiaque228, puisque la statuette d'Hercule provient, nous l'avons vu, de la
Palestre.
y avait-il un culte isiaque avant l'époque augustéenne dans ce secteur? Si on ne peut
l'exclure, l'absence de données archéologiques rigoureuses ne permet pas d'en préciser la
forme.
Nicole BLANC, CNNSIUMclMaùon René-Ginol/ves,
21, allée dt /'Ulliwrsiré, 92023 Namem: Cedex.
225. P. Gros, op. cil., et Al/rea Templa, Rome, 1976, p. 143-1 46: façade du temple de la Concorde, pl. XXV, fig. 2-3; pour ce temple, voir également H. F. Rebert, H. Marceau, The temple of Concord, N!AAR, 5, 1925, p. 53-75.
226. Ces niches, vides au moment de la découverte, éta ient occupées par des statues, soit en pennanence (de Vos, Pompei, op. cit., p. 212), soi t temporaÎrement, nu cours des stations d 'une procession (H offmann, p. 205-
Hélène ERISTOV, CNRslAOHOclh'NS,
45, me d'U/III, 75005 l'arÙ.
Myriam FtNCKER,
CNN.'liIRAA,
IRSriM, avel/!IC l'op/aws)iI~
64000 l'al/.
206) ; contrairement à ce qu'écrit Malaise (op. cil., p . 276), repris par Golvin (p. 24 1), la niche de gauche n'a jamais contenu de statue d'Harpocrate: l'auteur a probablemcm confondu avec la peinrure representant Harpocrate dans la niche du mur Est.
227. Pour Hoffmann, p. 212, cette phase de construction est à placer immédintemem après l'agrandissement du théâtre en 3/2 av. j.-C.
228. Riccl"ca, inv. 5. l , p. 73.
A fundamento restituit 7 Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 305
,:', .' "1, 1 ,;", , IN,
t , '. l', '.','. ~ " .-,','
41. Le cubiculum 171. décor. D'après les Omati delle pareti,
306 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
EXCURSUS
LE DÉCOR DU PASTOPHORJON DANS LE TEMPLE D'ISIS
par Hélène ElislOV
Les pièces [7] et [8] du logement des prêtres étaient peintes, comme en témoignent des
restes d'enduit dont l' unique couche, épaisse de 3 cm, indique que le décor n 'a pas subi de réfection, ou que l'enduit antérieur a été éliminé. Dans leur état actuel, ces vestiges ne sont
guère identifiables. Dans la pièce [7], le soubassement de faible hauteur (45 cm au-dessus de
la limite supérieure) semble avoir été ocre-jaune. La zone médiane, rouge sur 140 cm, est sur
montée d 'une zone claire conservée sur une hauteur de 22 cm. Les seuls éléments de décor
que l'on puisse encore discerner sont d'une part une incision horizontale de 10 cm au-dessus
du soubassement et se poursuivant jusqu'à l'angle du mur, d'autre part de légers tracés en
forme d'arceaux en limite supérieure de la zone rouge, 143 cm au-dessus du socle. Dans la pièce [8], les quelques lambeaux d'enduit décoloré qui subsistent à l'extrémité
gauche du mur Ouest et aux angles du mur Sud ont les mêmes caractéristiques techniques que ceux du cubiculum [7] . Aucune trace de décor n 'est plus lisible.
Sources
Dans la littérature consacrée au temple, le décor perdu du pasLOphori.ol'l est toujours passé
sous silence. Seuls sont mentionnés les fragments identifiés à partir des indications de PAH; les uns n'existent plus que dans le catalogue de Helbig229
, d'autres, prélevés, se trouvent au
Musée de Naples : il s'agit d'un tableau avec Endymion ainsi que de médaillons représentant
un Satyre, Pâris, et une nature morte à oiseaux. N on seulement rien n 'est dit de leur contexte, m ais encore la publication d 'O. Eliano qui désigne les pièces en chiffres romains, non sans
confusion typographique, m élange le contenu des pièces, ce qui se répercute dans les notices
de l'Enciclopedia231 : elles ne mentionnent rien pour la pièce [8], et anribuent à tort les médail
lons au cubiculum [7] où sont signalées « tracce della decorazione di IV stile con 20ccolo giallo,
zona mediana rosso scuro nei cui pannelli c'erano medaglioni con nature morte 0 busti ; la
zona superiore era a fondo bianco con architetture definite "grottesche" nel rapporta dei
19 luglio 1766, delle quali non possediamo alcun e1emento ». Récemment encore, P. Hoff-
229. W. Helbig, WOl1dgemalde der Will Vesuv verschiitteIell Siiidu: Compolliem, Leipzig, 1868 (abrége H .).
230. Le PieU/re dei Tell/piD di bide, op. cir., indique que le CIIbiculum et le tn'cliniul1I avaient une décoration à sode rouge ou jaune, une zone médiane rouge cinabre ou jaune,
une zone supérieure blanche. Dans la pièce , V1 • (= [7]) se trouvaient des lableaux à sujets mythologiques. et dans la pièce , VIT • (= [8]) des medaillons en grande partie disparus.
231. EAA-PPM, VII!, p. 842-845.
A fundamento restitu it 7 Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 307
mann232 s'est contenté de noter la présence de vestiges d'enduit attestant dans la pièce [8] un
socle sombre et des panneaux médians b lancs ou jaunes, et dans la pièce [7] un socle noir sur
monté d'une zone rouge sur laquelle subsistent des traces jaunes.
Or le compte rendu de fouille du 19 juillet 1766 transcrit par Fiorelli'" donne des indi
cations très précises sur ces pièces découvertes en déblayant le terrain autour du temple pour
évacuer les eaux de pluie:
« Essendosi fatto levare dei terreno all ' interno dei tempio d'Iside, per dare la scola alle
acque piovane, si sono scoperti due stanzini sino al basamento, con intonachi dipinti. Uno di
questi, ch 'è il primo all'entrarsi di una casa, ha il campo principale dell'intonaco rosso, e in
ciascuna facciata vi è un tondo de' quali vi sono degli uccelli uccisi, ma molto patitF34 ; in un
altro vi è impressa una mezza donna con cuffia, che sta scherzando con un Amorin0235 e in un
altro vi è un uomo coronato di lunghe foglie in atto di bere ad un vasa a due manichi, che
regge con la destra, e con la sinistra sostiene un timone236 : la parte più alta deI medesimo into
naco tutto all'intorno è omato di varie architetture grotesche in campo bianco. L'intonaco più
grande dell'altro stanzino è divis~ egualmente da due compartimenti : nel mezzo dell'inferiore,
attomiato da una leggiadra architettura e da alcuni ramoscelli, vi è un quadro di circa 1 pal.
e 1/2 con un Chirone che insegna a suonare la lira ad Achille237, il quale non differisce dal già
pubblicato nel 1 volume delle Antichità di Ercolano, che per essere il sua campo di paese; dai
due Iati vi sono delle architetture grottesche, con in mezzo de' candelabri, sopra de' quali
posano due aquile ; e nelle estremità della stessa facciata vi sono due genj in campo rossa. Nel
m ezzo dei compartimento superiore, vi è un giovane, che credo un Bacco, nudo della m ezza
vita in sopra, coronato di palme, che tiene con la sinistra un tirso, il destro braccio la appoggia
sopra la tes ta, esta assis a in un nobile sedile 0 letto con spalliera238• Questa figura viene com
presa da un architettura, sopra la di cui cornice vi è una maschera ,; dai lati vi sono due donne
alate, una che porta una canestra di fiori ed un festone. Il restante dei compartimenta, ch'è tutto in campo bianco, viene coronato da architetture grottesche e da ramoscelli e festoni, e da
alcuni piccioli riquadri con paesini, e vi sono sospesi de' nastri, de' corni, de' cembali et de'
canestri. L'altro intonaco della stesso stanzolino resta ornato con poca differenza dei descritto,
e nel quadrato che sta nel m ezzo deI compartimento inferiore vi è espresso un giovine tutto
po sato su di un sasso, con le sole casee ricoperte da un panno rossa, con un braccio appog
giato sopra la testa, e con l'altra mana tiene due dardi, e vicino vi resta una clava ; alla genti
lezza deI corpo e agli altri indizi, sembra un Endimione239• Nel mezzo deI compartimenta di
232. Hoffmann, p. 53-54; selon sa numérotation personnelle, la pièce {71 devient 6 et la pièce [8J devient 5.
233. PAH, J, l, p. 190. en revanche, les Addenda IV= PAH, l , 2, p. 134- 151 ne contiennent aucune mention.
234 . Ricerca, n° 1.80, ancien inventaire MCDXlX, D. 29, 8 cm.
235. H. 127 1 = u Piuure allliche d'Ercola llo e co/ltol'lli, 1-VII, Naples, 1757-1779 (= PdE), V, 5 p. 27 = MNN 8989 = Ricerca, J . 82, D. 0,26 m.
236. H . 1013 = PdE, V, 5 p. 27 = MNN 8877 = RicercQ, 81, D. 0,26 m.
237. H. 1293,0,36 x 0,36 m, MNN s.n.
238. H. 3916.
239. H. 1338 / H . 962 pour Schefold, W'P, p. 234-= MNN 9379, PdE, V, pl. 29 = catal. 1 .83. 37,5 x 36,7.
308 Nicole Blanc, Hélène Eristov et Myriam Fincker
sopra vi è un Centauro. La facciata a questa opposta è molto patita e pero solo resta ad Qsser
varsi un Centauro come l'altro . » La précision de cette description permet immédiatement d'identifier le décor de l'une
des deux pièces décrites avec une gravure publiée dans les Omati delle pareti, dessinée par Gio
vanni Morghen et gravée par F. Campana (fig. 41)240.
On y reconnaît, au-dessus d'un soubassement à panneaux et compartiments, deux
échappées architecturales ornées de candélabres que surmontent des aigles; elles encadrent
un panneau central dont le tableau représente Achille et Chiron dans un paysage; au centre de la zone supérieure, dans un édicule couronné d'un masque, est effectivement assis un Bac
chus tenant un thyrse et le bras droit posé sur la tête; de part et d'autre, deux figures fémi
nines ailées portent des guirlandes, tandis que le reste de la zone supérieure à fond blanc
comporte tympanons suspendus, vases et guirlandes. La seule discordance par rapport à la
description est l'absence, sur la gravure, des Amours des champs latéraux.
Incontestablement, c'est donc bien du même décor qu'il s'agit.
Raoul-Rochette241 reproduit le même décor mais il omet les champs latéraux et interpole
le décor du socle avec un large panneau portant un ichtyocentaure et un monstre marin accompagnés de dauphins242
.
L'échelle de la gravure des Omati donne une largeur de 11,5 palmes nap., soit 3,03 m 24J.
Or, dans la mesure où la description fait état, outre ce mur, de deux autres parois se faisant face, l'une d'entre elles avec l'Endymion, ce qui est représenté sur la gravure ne peut être que
le mur du fond (Sud-Est) ; il mesure 309 cm, enduit non compris, et concorde avec les dimen
sions du décor, tandis que le mur Nord-Ouest est long de 295 cm et le mur Nord-Est de
268 cm24<\. Ces dimensions ne laissent place à aucun doute quant à l'attribution du décor au
cubiculum [7] ; toutefois elles se heurtent à une légère contradiction dans la description des
deux pièces adjacentes par le rédacteur du journal de fouilles: soit que l'on entre par la ruelle
sur laquelle donne directement une porte indépendante, soit que l'on passe par le portique du
temple, la (i première pièce en entrant dans la maison ) est le triclinium [8] qui portait un décor
de médaillons; mais c'est aussi la pièce la plus grande avec 347 cm (mur Sud-Est) x 475 cm (mur Sud-Ouest = droit), 473 cm (mur Nord-Est = gauche), alors que PAH qualifie le décor
de la seconde pièce, nettement plus petite, comme « intonaco più grande 1). Soit il s'agit d'une
erreur de rédaction, soit l'auteur de la notice entendait non les dimensions de la pièce, mais
celles du décor conservé sur une p lus grande surface dans le cubiculum que dans le lriclinium245 .
240. On sait que ces planches, non insérées dans les volumes des Piullre d'Ercolano, ont été reliées diversement, de sorte que les tomaisons el les numéros de planches ne correspondent pas d'une collection ou d'une bibl iothèque à l'autre; à l'American Academy de Rome, il s'agit du vol. 1, pl. 48, tandis qu'au DAI cette planche se trouve dans les vol. II, 1808, pl. 8 et 1 (Rés.), pl. 43.
241. Pompéi, choix d'édifices ;,zedùs, deuxième partie, Paris, 1840) non paginé.
242. Ce panneau est illustré dans PdE, Il, pl. 39, RP, 45.6 = H. 1070, la largeur du panneau à fond clair est de
5,3 palm. nap. = 1,39 III, sa hauteur de 1,6 = 0,42 III, la largeur du fragment avec un piédestal à gauche: 6 palm. nap. = l,58 III). Je n'ai pu repérer ce panneau au Musée de Naples.
243. 1 palme nap. = 0,26367 m : Catello Salvati, Misllre e pesi uella dOCl/l/1elltaziolle slOlica dell'Italia dellHezzogio/'llo, Naples, 1970, p. 27 sq.
244 . Épaisseur de l'enduit à l'angle gauche: 4 em. 245. Lorsque Giovanni Altieri exécute le modèle réduit
du temple en 1784, le décor a déjà beaucoup souffert: les parties hautes se som effondrées et des lacunes défigurent
A fundamento restituit ? Réfections dans le temple d'Isis à Pompéi 309
Aujourd'hui, le sol antique n'est pas dégagé et le seuil de tuf se trouve 17 cm plus bas
que le sol de terre actuel. Cependant le graveur des Omati a représenté la plinthe qui devait
donc être lisible au moment des fouilles.
Ces rares éléments sont superposables aux données fournies par la gravure. Le tracé
incisé correspond à la bordure supérieure du soubassement, constituée de palmettes et lotus
agrandis. Quant à la zone médiane, elle doit mesurer, d'après la gravure, 168 cm au-dessus du
soubassement; deux bordures ajourées horizontales à palmettes circonscrites subdivisent les
panneaux latéraux en ménageant, en haut et en bas, un étroit bandeau horizontal de 13 cm
environ. Les contraintes chromatiques de la gravure ne différencient pas ces subdivisions;
mais les vestiges conservés permettent de préciser que seul le champ principal des panneaux latéraux était rouge jusqu 'à une hauteur de 140 cm) et probablement jaune au-dessus. D'après
le fond de panneau visible autour du tableau prélevé avec EndymionlNarcisse, on sait que
le panneau central était jaune, ce qui correspond à l'indication de PAH. C'est aussi ce
qu'indique la planche de Raoul-Rochette.
La zone supérieure était blanche comme l'indique la notice de PAH et comme l'attestent
les vestiges; quant au bandeau inférieur, dénaturé par l'humidité des parties basses du mur,
on ne peut reconnaître s'il était rouge ou jaune.
Ce décor) qui appartient sans conteste à la réfection de la dernière période) présente
quelques parallèles avec d'autres peintures du Quatrième Style dans sa phase finale ; en parti
culier l'aspect des architectures de la zone médiane rappelle celles de la Maison du Prince de
Naples, VI,15)8) [f) , mur Nord: il s'agit d'une rotonde schématique au toit triangulaire et
incu rvé246 ; quant à la structure des échappées, traversées par un candélabre que surmonte un
sphinx de face, elle est proche du décor de la Maison des Amants, 1,10,11, [1 2]'47.
les parois; de plus, l'aniste a réinterprété et simplifié le décor: les candélabres de la zone médiane deviennent de simples tiges feuillues, des oiseaux en vol occupent les champs latéraux et le tableau central du mur du fond n 'est guère reconnaissable; une lacune au centre du mur droit
Hélène ERISTOV)
CNRs/AOIIOC,
ENS, 45, mt d'Ulm, 75005 Paris.
doit correspondre au prélèvement de l'Endymion. Je re· mcrcie V. Kockel de ces informations .
246. Eristov. op. cir.) p. 136-137.
247. EAA-PPM, II, p. 493, n° 81.