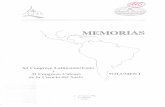8577 Randriamalala et al 2012
Transcript of 8577 Randriamalala et al 2012
KARTHALA sur internet: http://www.karthala.com(paiement sécurisé)
Couverture : 30 mars 2009, Razily, armé d’un sac d’écolier et du drapeaunational défie l’armée, cyber héros des internautes malgaches.Collection privée.
© Éditions Karthala, 2012ISBN : 978-2-8111-0605-8
Solofo Randrianja (éd.)
Madagascar,le coup d’État de mars 2009
Éditions Karthala22-24, boulevard Arago
75013 Paris
Carte 1. Les principales villes citées
Source : dhttp : //www.lib.utexas.edu/maps/madagascar.html?p=print
« Ce que je défends, c’est la possibilité et la néces-sité de l’intellectuel critique. Il n’ y a pas de démocratieeffective sans vrai contre-pouvoir critique. L’intellec-tuel en est un, et de première grandeur ».
Pierre Bourdieu, 1992.
Les auteurs
MboaraANDRIANARIMANANA, journaliste.
Ndimby ANDRIANAVALONA, éditorialiste politique de Madagascar-Tribune.com. Blogueur sur http://fijery.wordpress.com.
Mathilde GINGEMBRE, université Paris 1 (La Sorbonne). Université d’An-katso (Madagascar).
Patrick RAKOTOMALALA (Lalatiana PITCHBOULE) Madagoravox.wordpress.com.
Juvence F. RAMASY, Chercheur en science politique, Institut d’études poli-tiques de Toulouse, France. Laboratoire pluridisciplinaire, Universitéde Toamasina, Madagascar.
Vony RAMBOLAMANANA, avocate.
Hery Randriamalala, Cybervert.
Solofo RANDRIANJA, université de Tamatave.
JUSTINE RANJANITA, juriste.
Raymond RANJEVA, ancien vice-président de la Cour internationale deJustice.
LucienneWILMÉ, Missouri Botanical Garden, Madagascar Research andConservation Program.
Patrick O. WAEBER, Forest Resources Management, UBC Forestry,Vancouver, Canada.
Avertissement
Nos remerciements vont aux centres de documentation, aux nombreuxindividus, aux organisations et autres institutions qui ont permis la rédac-tion des contributions.Chaque contribution peut se lire de manière indépendante et leurs
auteurs respectifs assument la responsabilité de l’élaboration et de l’écri-ture.Les noms des villes sont donnés en fran�ais en dépit de leur malgachi-
sation. Se rendre à Londres plutôt qu’à London paraît plus conforme à lalangue fran�aise.Solofo Randrianja a rassemblé les contributions, assuré la coordination
et rédigé l’introduction.
1) Ancienne province de Tananariverégion d’Itasy (3)région d’Analamanga (4)région de Vakinankaratra (5)région de Bongolava (6)
2) Ancienne province de Diego Suarezrégion de Diana (1)région de Sava (2)
3) Ancienne province de Fianarantsoarégion d’Amoron’i Mania (14)région de Haute Matsiatra (15)région de Vatovavy-Fitovinany (16)région d’Atsimo-Atsinanana (17)région de Ihorombe (18)
4) Ancienne province de Majungarégion de Sofia (7)région de Boeny (8)région de Betsiboka (9)région de Melaky (10)
5) Ancienne province de Tamataverégion d’Alaotra-Mangoro (11)région d’Atsinanana (12)région d’Analanjirofo (13)
6) Ancienne province de Tuléarrégion de Menabe (19)région d’Atsimo-Andrefana (20)région d’Androy (21)région d’Anosy (22
Carte 2. Les 22 régions et les 6 anciennes provinces
5
Les cyber-verts contre le traficde bois de rose malgache
Hery Randriamalala Patrick O.WAEBER
LucienneWILMÉ
« Si notre indolence dure, si l’envie pressante que nous avons dejouir continue à augmenter notre indifférence pour la postérité ;enfin si la police des bois n’est pas réformée, il est à craindre queles forêts, cette partie la plus noble du domaine de nos rois, nedeviennent des terres incultes. »
Buffon, Histoire Naturelle, tome VIII, 1804.
Rappel du contexte
Par son arrêté interministériel n°003/2009, en date du 28 janvier 2009,le président Ravalomanana a ouvert les forêts aux coupeurs et aux expor-tateurs de bois de rose1. Il n’avait sûrement pas prévu l’ampleur de la crisepolitique de février-mars 2009, au cours de laquelle il allait perdre lecontrôle de l’appareil de l’État, puis le pouvoir. Saisissant l’occasion avecune stupéfiante rapidité, aidés en cela par l’appât du gain et peut-être parune bonne anticipation des événements, les exportateurs ont alors envahiles parcs nationaux et se sont mués en trafiquants2. Va s’ensuivre la pirecampagne de déforestation de toute l’histoire malgache.
1. Cet arrêté autorise à titre exceptionnel l’exportation de bois précieux à l’état brutpour treize opérateurs, nommément désignés. Il est dérogatoire par rapport à l’interdictiond’exporter en cours depuis le 3 juillet 2007.
2. Débois 2009.
124 MADAGASCAR, LE COUP D’ÉTAT DE MARS 2009
Carte3.Lesairesprotégéesdégradéeslorsdelacampagnedecoupe2009-2010etautreslocalitéscitéesdansletexte
LES CYBER-VERTS CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE 125
Rappelons-en les grands traits :– de février 2009 à janvier 2011, au minimum 57 000 tonnes de bois de
rose et d’ébène ont quitté officiellement Madagascar depuis les ports deVohémar et Tamatave. La plus grande partie de ce bois venait des parcsnationaux. La quasi-totalité a été exportée vers la Chine.– Les aires protégées suivantes ont été livrées à la hache des coupeurs :
Masoala, Marojejy, Makira, Mananara, Ranomafana, Montagne d’Ambre,Ankarafantsika (Carte 3). Le statut des autres aires protégées n’est pasencore connu avec précision.Le trafic est passé par quatre phases successives3 :1. Février à avril 2009 : exportations massives depuis Vohémar. C’est la
période de « folie », qui coïncide avec le paroxysme de la tourmente poli-tique à Tananarive.2. Avril à août 2009 : arrêt des exportations par la fermeture du port de
Vohémar. La coupe continue en forêt. La Haute autorité de la transition(Hat) prend progressivement le contrôle de l’appareil d’État mais n’exerceson autorité que sur les ports4.3. Septembre 2009 à mars 2010 : les exportations reprennent à un
rythme un peu moins soutenu qu’au début 2009. La coupe continue dansles aires protégées. La Hat, maintenant installée au pouvoir, contrôle toutl’appareil d’État, mais elle connaît des dissensions internes, des difficultésde trésorerie et elle vend le patrimoine national et mondial pour sur-vivre5.4. Mars 2010 à janvier 2011 : arrêt des exportations officielles de bois
de rose et d’ébène, sous la pression des bailleurs de fonds internationaux.Les exportations de palissandre6 continuent, vers la Chine et la Malaisie.Les exportations de bois de rose se poursuivent, sous forme de contre-bande, donc à petite échelle. La coupe en forêt continue (Masoala etMakira), toutes essences confondues : les trafiquants attendent la prochainecirconstance favorable pour exporter leurs stocks. Des membres de la Hattirent des profits personnels de ce trafic, tandis que d’autres le combattentcomme ils peuvent.
3. Randriamalala et Liu 2010.4. Schuurman et Lowry 2009.5. Randriamalala et Liu 2010.6. D’un point de vue scientifique, il existe une grande confusion entre le palissandre
et le bois de rose. Plusieurs espèces du genre Dalbergia sont commercialement appelées« palissandre » tandis que plusieurs autres du même genre sont appelées « bois de rose ».Commercialement bien sûr, il n’y a aucune ambiguïté, n’importe quel observateur avertisaura du premier coup d’œil faire la différence entre ces bois. Il faut cependant rester vigi-lant sur un point : le décret 2010-141 du 24 mars 2010 ne vise que l’interdiction du bois derose et d’ébène. Il ne dit rien sur le palissandre. Or, on a observé depuis cette date uneforte augmentation des exportations de palissandre (Mahajanga, décembre 2010) ainsi quedes demandes d’exportation de palissandre (Vohémar, février 2011). Vu l’ampleur de lacorruption dans la filière, il est fort probable que les trafiquants vont tenter d’exporterleurs stocks de bois de rose sous de fausses déclarations de palissandre.
126 MADAGASCAR, LE COUP D’ÉTAT DE MARS 2009
Durant toute cette période, une âpre guerre d’image va se livrer, parmédias interposés7, avec comme enjeu le basculement de l’opinion publique.C’est cette confrontation que ce texte va maintenant analyser, en abordantles acteurs en présence et leurs stratégies face à l’opinion publique. Puis lesrésultats obtenus par les uns et les autres dans la campagne médiatiqueseront examinés, tant qualitativement que quantitativement.
Les acteurs, leurs stratégies de communication et leurs moyens
Avant d’évoquer les acteurs en présence, il est nécessaire de faire unbref rappel sur le fonctionnement des médias et de définir l’opinion publi-que-cible de cette campagne.Il convient de ne jamais perdre de vue qu’un journal, même gratuit, est
avant tout une entreprise commerciale. Si le journal n’équilibre pas sescharges et ses recettes, il fait faillite plus ou moins vite et disparaît, sauf s’ilest subventionné par un acteur externe. Donc, quelle que soit la ligne édito-riale choisie, un journal doit avoir de l’audience. Et pour faire monterl’audience, il faut étonner, intéresser le lecteur et pas seulement l’informer.Si E est un événement et p
Ela probabilité pour qu’il survienne, alors la
valeur informative v de cet événement varie comme logarithme de 1 sur p :
v (E) = log (1/pE).
• Exemples :
– Événement « demain le soleil se lèvera ». Cet événement étant certain,sa probabilité vaut 1, log (1/1) = 0. La valeur informative de cet événementest nulle, mieux vaut donc ne pas en parler car il n’intéressera personne.– Événement « demain, le soleil ne se lèvera pas ». Cet événement est
impossible, sa probabilité est donc nulle, log (1/0) = ∞. C’est la définitionmathématique du scoop, de l’information sensationnelle. La valeur de cetteannonce est infinie, le journal va avoir une grande audience, car il a annoncéquelque chose d’étonnant, voire d’improbable.
7. Des journalistes en seront victimes, suite à des condamnations pour diffamation ouincitation au désordre public. Or, selon le Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA)Madagascar (Jütersonke et Kartas 2010), p. 60, « La liberté d’expression et la liberté desmédias est garantie par la Constitution et la Loi sur la Communication (loi 92-039), et laviolation de la loi des médias est punissable par l’emprisonnement. En effet, le Code Pénalet la loi 90-031 sont régulièrement et strictement appliqués contre des journalistes pourdes délits contre le chef de l’État, pour l’incitation au désordre public et pour diffamation.Pourtant le texte pour la mise en application de la loi 92-039 n’existe pas, et le Code decommunication déjà mentionné n’a pas été mis en place. En d’autres termes, le cadre légalest d’une imprécision et d’un flou instrumentalisés, rajouté à un degré d’ignorance juri-dique parmi aussi bien les législateurs que les journalistes. »
LES CYBER-VERTS CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE 127
En théorie de l’information, cette relation est connue sous le nom dethéorème de Shannon8. Il y a bien sûr beaucoup d’autres obligations àprendre en considération pour publier une information : son exactitude, sarelation avec les événements qui lui sont liés et les autres événements dujour, sa conformité avec la loi et avec celle de la ligne éditoriale du journal,par exemple. Mais le théorème de Shannon explique pourquoi les journauxne parlent jamais (ou rarement) des « trains qui arrivent à l’heure ». Ilsparlent principalement de ce qui ne va pas ou qui est étonnant, car là résidela motivation de l’acheteur du journal ou l’auditeur.Ainsi est-il dans l’ordrelogique des choses que les médias dits « classiques » évoluent vers desformes plus critiques, avec une plus grande participation des consomma-teurs d’information, qui deviennent ainsi consommateurs-producteurs9.L’opinion publique est toujours un enjeu dans les démocraties, surtout
lorsque survient un coup d’État. Compte tenu de l’évolution des techniquesde communication, même si certains médias restent de portée modeste, onpeut reprendre trois catégories, dont les deux mondes classiques décrits parCouldry (2004), à savoir le « monde ordinaire » et le « monde desmédias »,puis ajouter le « monde des médias alternatifs » d’Atkinson (2009). Dansla crise du bois de rose malgache, on peut définir ainsi les contours del’opinion publique par rapport à son accès aux médias et à son interactionavec les médias :– En sont malheureusement exclus les coupeurs de la forêt : ils n’ont
accès ni aux journaux papier, ni aux journaux télévisés, ni aux journaux enligne sur Internet. La majorité de la population rurale n’a accès à aucunmédia et appartient exclusivement au « monde ordinaire. »– La population urbaine fait partie de l’opinion publique, ainsi que les
trafiquants par conséquent, car elle a accès à ces médias et son opinion surla coupe du bois de rose est évolutive. Les trafiquants savent qu’ils sontdans l’illégalité, mais ils se soucient plus de leur compte en banque que deleur image. Ils tiennent cependant à garder un profil bas et une apparencerespectable. Les trafiquants sont dans le « monde ordinaire » et peuvent seprojeter dans le « monde des médias ».– La classe dirigeante du pays : elle a accès à une vaste panoplie de
moyens d’information, elle peut faire ou défaire les rois et elle a le souci del’image du pays à l’étranger. C’est une cible majeure en communication.– Les Organisations non gouvernementales (Ong) internationales œu-
vrant dans la protection de l’environnement : elles ont les moyens de savoirce qui se passe mais pas forcément envie de le publier, car cette campagnede coupe catastrophique pourrait apparaître, aux yeux de leurs donateurs,comme un échec dans leur rôle de protection de l’environnement et donccomme une menace pour leurs financements. D’autre part, si elles restentsilencieuses alors que les médias parlent de la crise du bois de rose, ellesrisquent d’apparaître inefficaces. En outre, ces Ong ont des représentations
8. Ébrahimi et al., 2010, Shannon, 1948.9. Sandoval et Fuchs, 2010.
128 MADAGASCAR, LE COUP D’ÉTAT DE MARS 2009
àMadagascar, des conventions avec l’État malgache, du personnel nationalet étranger, elles sont donc « sous pression »10.– Les bailleurs de fonds : ils sont bien sûr acteurs de la crise, mais aussi
une cible en matière de communication. Ils n’ont pas une totale libertépour accorder des financements, les retirer, les suspendre partiellement ouprovisoirement. Ils sont soumis aux réactions de leurs sources internes definancement : contribuables et parlementaires pour les ambassades et lesagences de coopération, États pour la Banque mondiale et le Fonds moné-taire international. Ils sont donc aussi influentables et constituent une autrecible majeure de communication.– Les citoyens connectés par des téléphones cellulaires ou par Internet.
L’attention du public est constamment remodelée par l’interaction des genset des nouveaux médias qu’ils utilisent11.L’opinion publique malgache se répartit ainsi entre les différents types
de média12 :– Radio : 75% des ménages. Seule la radio d’État couvre toute l’île, les
radios privées sont essentiellement urbaines tandis que les radios reli-gieuses dominent dans les zones rurales.– Télévision : moins de 30%. Elle appartient à l’État, les chaînes privées
ont été fermées.– Journaux papier : 25% en zone urbaine, 0% en zone rurale. Le
tirage quotidien pour l’ensemble du pays, tous titres confondus, atteint200000 exemplaires par jour (à rapporter aux 20 millions d’habitants dupays). Les trois plus importants journaux sont : Midi-Madagascar (30511exemplaires par jour), Tribune Madagascar (15 000), Express de Mada-gascar (15 000)13.La pauvreté du pays a pour conséquence des taux d’audience très
faibles. Beaucoup de ménages n’ont pas les moyens de posséder un postede télévision ni ceux d’être raccordés au réseau électrique. Les quotidienssemblent chers pour beaucoup de citoyens qui se contentent de lire lesmanchettes en passant devant les présentoirs. Et la diffusion en ligne resteréservée à une élite, celle qui a accès à un ordinateur et a la capacité de s’enservir. Mais la faiblesse de la couverture médiatique doit être relativisée.La partie de la population qui s’informe a plus de poids dans la vie du paysque celle qui ne s’informe pas. Et dans ce pays de tradition orale, le bouche-à-oreille fonctionne à merveille.Examinons maintenant les acteurs de cette campagne médiatique. Trois
groupes, d’importance fort inégale, méritent l’attention.
10. Les visas de certains collaborateurs étrangers d’Ong n’ont d’ailleurs pas étérenouvelés à leur expiration par les autorités malgaches, suite à la signature d’une pétitionsur ce qui se passe dans les forêts (WWF, 13 janvier 2011). Voir les liens électroniques.
11. Gibbens 1984, inWebster 2011.12. Jütersonke et Kartas 2010.13. IREX et US-AID 2009.
LES CYBER-VERTS CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE 129
L’équipe au pouvoir (Hat et gouvernement)
L’équipe au pouvoir est initialement préoccupée par l’acceptation de salégitimité (voire de sa légalité), en premier lieu par le peuple malgache, ensecond lieu par la communauté internationale. Sa communication est doncaxée sur ces deux thèmes et la crise du bois de rose est traitée comme unévénement secondaire, un problème annexe qui trouvera sa solution au fildu temps ou lorsque les urgences du moment seront réglées. La stratégie decommunication correspondante est donc sommaire, elle consiste jusqu’enmai 2009 à minimiser les faits, puis une fois connue leur ampleur, à leslégitimer jusqu’en mars 2010 (« le bois de rose rapporte des taxes quipermettent au pays de vivre »14), enfin à se montrer lénifiant envers lesélecteurs (« nous contrôlons la situation »15). L’équipe au pouvoir disposede tous les moyens afférents à sa position : accès illimité et sans préavisauxmédias publics, accès aisé auxmédias privés, plus tout l’appareil d’Étatpour mener son action environnementale et communicationnelle.
Les trafiquants
Les trafiquants communiquent peu et maladroitement, ce qui n’est guèreétonnant dans leur position. Ils sont dans des logiques d’enrichissementmassif à court terme, avec une forte pression financière, sociale et psycho-logique : un jour ils gagnent beaucoup, le lendemain ils dorment en prison,une semaine plus tard ils rentrent chez eux et reprennent leurs affaires16.Avoir une stratégie de communication dans ces conditions est difficile. Ilsessayent cependant, avec deux thèmes récurrents :– nous sommes des professionnels ordinaires, notre travail est légal,
arrêtez de nous harceler17 ;– nous avons des stocks importants de bois de rose, dus aux cyclones et
aux troubles politiques. Cela représente un manque à gagner important entaxes pour l’État et en chiffre d’affaires pour nous. Puisque le bois est déjàcoupé, il faut tenir un atelier de « remise à plat » de toute la filière, procéderà un inventaire des stocks et accorder une dernière fois l’autorisation d’ex-porter18.Leur vraie communication n’est pas médiatique, ils font du lobbying.
Ils comptent exclusivement sur leur puissance financière pour influencerl’équipe au pouvoir, ainsi que les fonctionnaires régionaux. Ils naviguenten permanence entre l’influence et la corruption.
14. L’Express de Madagascar, 13 novembre 2009.15.Midi Madagasikara, 2 décembre 2009.16. Randriamalala et Liu, 2010.17. La Vérité, 24 février 2010.18. Midi Madagasikara, 20 juillet 2010, L’Express de Madagascar, 21 juillet 2010, Le
Courrier de Madagascar, 20 juillet 2010.
130 MADAGASCAR, LE COUP D’ÉTAT DE MARS 2009
La société civile et les cyber-verts
La société civile comprend l’ensemble des acteurs qui n’appartiennentni au corps des fonctionnaires de l’État, ni aux partis politiques tradition-nels. On y trouve donc des Ong ou des regroupements d’Ong, comme l’Al-liance Voahary Gasy, des Églises, des groupements d’intérêts profession-nels, des citoyens ordinaires. Parmi ces derniers, un groupe s’est mobiliséen février 2009 dès les premiers troubles. À l’instar d’autres communautésd’internautes engagés, ce groupe informel n’a pas de chef. Par commoditéde discours, nous le baptiserons « les cyber-verts ». Ils appartiennent exclu-sivement au « monde des médias alternatifs » comme le définit Atkinson(2009) ou des médias critiques19. Ils se sont trouvés sur Internet où ils ontcréé spontanément leur propre réseau. La plupart ne se connaissent pasphysiquement. Il s’agit de Malgaches soucieux de l’avenir de leur pays,mais également d’étrangers amoureux de Madagascar et désireux d’enpréserver l’environnement. Ils ne se réclament d’aucun parti politique,d’aucune Église, d’aucune Ong environnementale. La collaboration descyber-verts avec les Ong internationales est limitée à l’échange temporaired’informations lorsqu’il y a convergence d’intérêts. Les cyber-verts ont encommun la conviction solidement ancrée que Madagascar serait moinsbelle sans ses forêts et qu’on ne peut laisser la cupidité de quelques-unsruiner l’avenir de tout un peuple20. Ils sont extrêmement discrets, car dansce combat, ils ont tout à perdre et rien à gagner, si ce n’est la fierté d’avoirécarté pour un moment les nuages noirs qui pèsent sur l’avenir du pays.Chacun des cyber-verts a monté son propre réseau de recueil d’informa-tion, l’ensemble s’étend des États-Unis à la Chine, en passant par laNorvège et Madagascar, bien sûr. Leur seule règle est de partager cetteinformation avec les autres membres du groupe, après en avoir vérifié etévalué la crédibilité. Puis chacun est libre d’utiliser cette information selonune ligne stratégique décidée par le groupe et de la communiquer auxmédias classiques avec lesquels il est en contact. Ce groupe auto-organiséfonctionne donc au rebours d’un réseau d’espionnage : tous les « secrets »recueillis sont publiés, comme fait le site WikiLeaks, mais à une échelleplus vaste. Les cyber-verts ont ainsi développé un réseau de médias alter-natifs fondés sur unevision respectueusede l’environnement, des ressourcesnaturelles et des populations rurales. Cette vision est une alternativepublique aux dérives politiques actuelles. Leur outil est typiquement lemédia critique21.La stratégie générale des cyber-verts tient en trois mots : « name, shame,
jail » (nommer, faire honte, emprisonner). Seuls les deux premiers thèmesseront abordés dans ce texte car eux-seuls font appel aux médias.
19. Sandoval et Fuchs 2010.20. La notion de crime contre l’environnement mérite de voir le jour au plan interna-
tional et de relever du Tribunal Pénal International, comme les crimes de guerre ou lescrimes contre l’humanité (Débois 2009).
21. Sandoval et Fuchs 2010.
LES CYBER-VERTS CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE 131
Les cyber-verts ont cadencé leur action en plusieurs phases. Pendant lapériode de folie (février à avril 2009), il fallait parer au plus pressé etstopper les exportations, espérant que peu de temps après, la coupe s’arrê-terait. Ils ont donc ciblé les compagnies maritimes, plus sensibles à leurimage de marque que les trafiquants.Entre mai et décembre 2009, les cyber-verts ont accumulé une abon-
dante documentation sur les trafiquants, les acheteurs et les zones de coupe.Ils restent discrets sur les méthodes utilisées pour recueillir cette informa-tion, car elles sont toujours en vigueur.De janvier à décembre 2010, ils ont étendu leur réseau de surveillance
au fur et à mesure que le trafic se dépla�ait vers le sud, tout en continuantà accumuler de la documentation sur la région d’origine du trafic, la Sava(région Sambava, Antalaha, Vohémar, voir la carte 1).Ces deux dernières phases ont été marquées par plusieurs publications
dans la presse journalistique et scientifique, tant internationale que natio-nale, selon un rythme calculé pour obtenir l’effet suivant : convaincre laclasse dirigeante malgache et les bailleurs de fonds internationaux de lagravité de ce qui se passe dans les aires protégées, et que la Hat est respon-sable de cette situation car elle seule dispose de moyens pour mettre fin àce crime contre la nation. Il s’agit donc de sensibiliser l’opinion publiquemalgache au trafic de bois de rose, puis de placer ce scandale au cœur dudébat politique pour mettre la Hat face à ses responsabilités. Pour atteindrecet objectif, les cyber-verts ont utilisé une émotion fournie par les trafi-quants eux-mêmes : l’indignation soulevée par la cupidité à l’origine de ladestruction d’un patrimoine apprécié mondialement. C’est cette indigna-tion et elle seule qui a permis aux cyber-verts de trouver des relais d’opi-nion et de diffusion de masse par Internet. Aucun de leurs nombreux etinconnus alliés n’aurait agi ainsi s’il n’avait été indigné à son tour par lesinformations recueillies et diffusées.Les cyber-verts ont utilisé aumaximumle théorème de Shannon : renseigner la presse sur tout ce qui ne va pas dansle commerce du bois de rose, puis la laisser faire son travail de vérificationet de publication, en espérant que cette indignation atteindra enfin l’opi-nion publique. Les cyber-verts ne disposent d’aucun moyen financier, ilsont seulement du temps, un accès à Internet et de bons carnets d’adresses,conformément aux acteurs des médias alternatifs22.C’est la confrontation de ces trois stratégies qui va être examinée main-
tenant.
22. Atkinson 2009.
132 MADAGASCAR, LE COUP D’ÉTAT DE MARS 2009
Analyse des publications nationales et internationales
Après avoir défini les différents types de publication, nous examineronsgraphiquement la répartition dans le temps des publications relatives aubois de rose et commenterons ces résultats.
Typologie des publications
Les publications prises en considération pour l’étude de cette campagnemédiatique sont les suivantes :– articles scientifiques et posters affichés à l’occasion de conférences
scientifiques (ce type de publication est soumis à un comité de lecture,garant de son sérieux) ;– articles de magazines (publication mensuelle ou hebdomadaire) ;– articles de quotidiens ;– articles en ligne (publiés sur Internet).Ces documents sont sélectionnés à la condition qu’ils traitent du bois de
rose malgache, quel que soit l’angle et le thème : trafic, saisies, coupe illi-cite, procès, blanchiment d’argent, blocage de comptes en banque, expor-tations, acheteurs chinois, etc. Les publications de la presse étrangère ontété incluses dans l’étude. En revanche, ont été exclus de l’étude :– les rapports internes (Banque mondiale, Fonds monétaire interna-
tional, Ong, gouvernement malgache). N’étant pas destinés à la publica-tion, ils ne modifient pas l’opinion publique ;– les blogs des internautes : très actifs sur le sujet, ils ont souvent servi
de « poisson pilote » à la presse nationale, en focalisant son attention surun sujet particulier. Nous les avons cependant exclus car on ne peut lesconsidérer comme des médias classiques, n’étant pas tenus à l’exactitudedes informations publiées. Toutefois, en l’absence d’institut de sondage àMadagascar, le suivi des commentaires postés par les internautes sur lesblogs ou sur les journaux en ligne est souvent riche d’enseignements. Lesblogs apparaissent donc sur le graphique ci-après à titre d’indicateurs detendance d’opinion.Sur ces bases, nous avons retenu et étudié 480 publications entre
février 2009 et décembre 2010. L’échantillon n’est probablement pas com-plet, mais il est suffisant pour voir apparaître des enchaînements significa-tifs. Les cyber-verts sont à l’origine directe de trois publications majeureset de nombreuses autres de moindre importance. Les majeures sont :– le poster « Precious trees pay off – but who pays? », publié le 18 octobre
2009 lors du Congrès Forestier Mondial à Buenos Aires, Argentine, du18 au 23 octobre 200923. Il sera appelé ici « poster MBG 1 » (voir photos) ;
23. Ce poster donne les noms des exportateurs de bois de rose actifs entre janvieret avril 2009, avec le nombre de conteneurs expédiés, le chiffre d’affaire réalisé et une
LES CYBER-VERTS CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE 133
– le poster « Precious trees pay off – but who pays?An update. » publiéle 9 décembre 2009 lors de la Conférence des parties (COP 15) de laConvention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, àCopenhague, Danemark, du 7 au 18 décembre 200924. Il sera appelé« poster MBG 2 » ;– l’article de Hery Randriamalala et Zhou Liu : « Bois de rose de Mada-
gascar : Entre démocratie et protection de la nature. », publié le 25 juin2010 par le journal Madagascar Conservation & Développement (MCD).Il sera appelé « article HR & ZL ».Un mot sur la création des posters : les cyber-verts ont rassemblé et
vérifié les données, puis ils se sont mis en quête d’une occasion de publier.Ces deux conférences internationales furent des opportunités parfaites :– l’audience y est large (presque tous les pays du monde sont présents,
représentés par des spécialistes des forêts, de l’environnement et des déci-deurs politiques) ;– les dates coïncident parfaitement avec le déroulement de la crise du
bois de rose (octobre-décembre 2009 : reprise des exportations depuisVohémar, donc les faits rapportés sont aisément vérifiables) ;– le lieu de publication est très éloigné de Madagascar, ce qui permet
d’amplifier la portée informative des faits publiés : si les spécialistes inter-nationaux se penchent à BuenosAires sur la coupe de bois de rose dans lesparcs nationaux malgaches, alors les faits doivent être avérés et méritentplus d’attention. C’est l’application directe de la théorie du levier, bienconnue en désinformation25, bien qu’en l’occurrence, il ne s’agisse pas dedésinformation, mais d’information.Ne restait plus qu’à trouver une signature de poids pour donner du crédit
à ces publications. Ce fut fait par l’implication de l’équipe dirigeante duMissouri Botanical Garden (MBG) de Saint-Louis, États-Unis, et notam-ment celle de son directeur, Peter Raven, botaniste de réputation mondiale.En outre, les cyber-verts contribuèrent indirectement (en guidant, en
fournissant des bases de données ou en relisant les épreuves) à plusieurspublications dans de prestigieux médias étrangers. Citons, par ordre chro-nologique :
– Washington Post du 16 octobre 2009 ;– Science du 2 avril 2010 et du 27 mai 2010 ;– New York Times du 13 mai 2010 et du 24 mai 2010 ;– Geo Magazine du 24 mai 2010 ;– National Geographic du 1er septembre 2010.
estimation des stocks en attente. Il estime le nombre total d’arbres coupés et la superficieimpactée dans les Parcs du Marojejy, du Masoala et du Makira.
24. Cette mise à jour actualise la liste des noms d’exportateurs de bois de rose actifsentre janvier et décembre 2009, le tonnage expédié et le chiffre d’affaire réalisé par cha-cun. En outre, elle cite les acheteurs connus, ainsi que la principale compagnie maritimeconcernée par le transport du bois. Elle diffuse des images de dépôts de bois prises parsatellite.
25. Boghardt 2009, Wolton 1986.
134 MADAGASCAR, LE COUP D’ÉTAT DE MARS 2009
La figure 2 montre la répartition dans le temps du nombre de publica-tions relatives au bois de rose, pour chaque semaine entre février 2009et décembre 2010, presses nationale et étrangère confondues.
Figure 2. Nombre de publications portant sur le bois de rose et activitédes blogs actifs à Madagascar du 1er janvier 2009 au 31 décembre2010 (trois publications majeures – MBG 1, MBG 2 et HR & ZL –ont servi de catalyseurs mais selon des modalités distinctes)
Analyse du graphique (figure 2) de la campagne médiatique
Jusqu’en mars 2009, la presse parle très peu du bois de rose (moins d’unarticle par semaine), alors que la coupe est à son paroxysme dans les parcs.C’est normal, l’attention des médias est focalisée sur les événements poli-tiques en cours dans la capitale.Le poster MBG 1 du 18 octobre 2009 provoque une vague de publica-
tions dans la presse nationale malgache moins de deux semaines après sadiffusion. Il est une publication-clé à trois titres : il est publié à l’autre boutde la terre (théorie du levier) devant une assistance mondiale ; il est signépar des botanistes de renommée internationale ; il donne les noms des trafi-quants et les chiffres de leurs gains. Il correspond donc totalement aupremier point de la stratégie des cyber-verts : « name ». Cette liste de nomsprovoque un « électrochoc » dans la presse malgache, où il est peu fréquentet risqué de s’attaquer frontalement à quelqu’un de « puissant », en généralsynonyme de riche26.
26. Exemple : La Gazette, 22 avril 2010.
LES CYBER-VERTS CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE 135
Mais le fait que les noms soient révélés par ce poster libère la plume desjournalistes : ils reprennent les informations du poster (noms, quantités etprix du bois exporté) à satiété27. À partir de cette date, la machine média-tique est en marche et elle ne faiblira plus : tous les articles publiésentre novembre 2009 et juin 2010 ont participé à la constance de la pres-sion, le bois de rose devenant un symbole de la dérive de la HAT. Le rapportGW/EIA du 26/11/200928 viendra à point nommé pour entretenir l’intérêtde la presse nationale sur le sujet.La réaction des trafiquants est double :– une justification, comme celle de Martin Bematana, trafiquant de bois
de rose : « Ce n’était pas illégal d’exploiter le bois de rose dans les parcsnationaux pendant la crise politique car il n’y avait ni gouvernement ni loisà cette période »29 ;– la dissuasion de se lancer dans l’aventure du bois de rose pour quel-
ques-uns « par crainte d’avoir mon nom publié dans la presse »30. L’ob-jectif « shame » (faire honte) des cyber-verts a fonctionné pour au moinsune personne. Il a aussi fonctionné pour certaines banques qui ont ferméles comptes de leurs clients cités par le poster31. Rien n’effraie tant lesbanques que la peur du scandale.La réaction de la Hat est discrète, réduite à celle de l’un de ses membres,
qui fait savoir qu’il offre 120 millions d’ariary (environ 10 000 euros) pourconnaître l’identité de « l’informateur du MBG qui connaît tous les détailssur les trafiquants »32.Le poster MBG 2 du 9 décembre 2009 connaîtra un retentissement
moins fort, ce qui est normal car il n’apporte guère d’information vraimentnouvelle, sauf la preuve qu’il est possible de photographier les dépôts debois de rose depuis l’espace. Depuis lors, les dépôts de bois de rose enattente d’évacuation à l’embouchure des rivières du Masoala sont recou-verts de feuilles de ravenala. Ce n’est pas pour protéger le bois du soleil oudes intempéries, mais des satellites33. Par le crédit de ses signataires et lescirconstances de sa diffusion (la principale conférence internationale de2009, celle où tous les médias du monde sont présents), le poster confortel’opinion publique internationale dans l’idée qu’il se passe quelque chosede vraiment grave à Madagascar. C’est l’image-même du pays à l’extérieurqui commence à être écornée. La classe dirigeante malgache s’en rendmaintenant compte.
27. tribune.com, 10 novembre 2009.28. GW et EIA 2009.29. Dan Rather Reports 2009. Le lecteur appréciera le sens civique de cet ancien
député !30. Anonyme, comm. pers. 2009. Pour des raisons de sécurité, certains témoins sont
laissés sous anonymat.31. tribune.com, 31 octobre 2009.32. Anonyme, comm. pers. 2009.33. Touriste, comm. pers. 2010.
136 MADAGASCAR, LE COUP D’ÉTAT DE MARS 2009
L’article HR & ZL du 25 juin 2010 passe initialement totalement ina-perçu34. C’est le site madagate.com, pourtant considéré comme le portailde la Hat, qui va en faire un vibrant éloge et le lancer près d’un mois aprèssa sortie35. Cet article connaît alors un grand succès de diffusion : plus de50000 téléchargements en six mois sur le site du journal MadagascarConservation & Développement, auxquels il faut ajouter ceux des autressites l’ayant mis en ligne36, et les diffusions en pièce jointe de message, fortnombreuses et impossibles à estimer. Chose surprenante : l’intérêt du publicne faiblit pas avec le temps, l’article est toujours autant téléchargéen janvier 2011 que lors de sa parution37. La figure 2 montre très clairementun pic de publications fin juillet 2010, et ce dans les trois types de publica-tion : blogs, journalisme et presse scientifique. C’est la caractéristique d’un« événement » médiatique.L’analyse des données fait également ressortir deux points qui n’appa-
raissent pas sur le graphique :– les médias en ligne ont plus publié sur le sujet que les médias
« papier » : c’est normal car ils sont plus réactifs que ces derniers ; en outre,le résultat est probablement biaisé par le fait que presque tous les médias« papier » publient aussi leurs articles en ligne38. Les moteurs de recherchene trouvent bien sûr que les textes en ligne, d’où cet effet grossissant ;– les médias internationaux réagirent les premiers sur cette crise du bois
de rose, entraînant dans leur sillage les médias nationaux après un certaindélai. Cet effet avait été anticipé par les cyber-verts qui, pour sensibiliser etencourager la presse nationale, principale source qui fa�onne l’opinionpublique malgache, choisirent de commencer par les médias majeurs del’étranger. Ils touchèrent ainsi leurs deux cibles principales en communica-tion : la classe dirigeante de ce pays et les bailleurs de fonds présents dansla Grande Île.Le graphique montre un phénomène de vagues dans le nombre de publi-
cations. L’explication en est la suivante : l’opinion publique malgache estindignée par ce pillage. La presse est donc désireuse de publier sur ce sujet,sûre d’intéresser son lectorat (théorème de Shannon). Ainsi, à chaqueévénement survenant dans ce dossier, les journaux publient abondamment.Exemples : le blocage des comptes bancaires et l’enquête du Samifin(service chargé de combattre le blanchiment d’argent) sur l’argent saledans cette filière39 ; le procès de Tamatave40 ; le départ du Kiara, dernier
34. En cause, probablement la Coupe du Monde de Football qui a eu lieu au mêmemoment et a accaparé l’attention des médias.
35. madagate.com, 18 juillet 2010.36. vatofototra.com par exemple.37. Source journal MCD.38. tribune.com est un média indépendant, sans attache avec le journal papier du
même nom. Seul le média en ligne tribune.com est considéré dans ce texte. Les autresquotidiens de Madagascar présentent des articles en ligne qui ne diffèrent pas de leurversion papier.
39. tribune.com, 31 octobre 2009.40. L’Express de Madagascar, 13 novembre 2009.
LES CYBER-VERTS CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE 137
bateau de bois de rose41 ; la saisie de 300 tonnes de bois de contrebande auxComores42 ; la tentative avortée d’embarquement à Vohémar43. Le sujetétant devenu très sensible, la presse est réactive.
Impact médiatique des acteurs
Cette partie va maintenant évaluer la performance médiatique des troisprincipaux acteurs.
L’équipe au pouvoir
L’équipe au pouvoir n’a jamais vraiment pris la mesure de la campagnemédiatique en cours sur le bois de rose. Force est de constater qu’elle a étéle plus souvent acculée à la défensive, qu’elle a réagi plus qu’elle n’acommuniqué en disposant d’une vision et d’un plan d’ensemble. Citonspar exemple l’intervention télévisée du 25 juillet 2010 du chef de la Hat :« Les responsables sont en train de se pencher sur ce trafic »44. Cette réac-tion est très faible et elle ne porte pas la marque d’un chef. On attendait del’indignation, unmessage clair venant d’en haut. Cette déclaration prudenteaurait pu être celle d’un haut fonctionnaire attentiste, mais elle n’est pas duniveau d’un chef d’État. La semaine précédente, la Hat avait pris une initia-tive dans la médiatisation de ce dossier : la perquisition dans l’usine Tikode Sambaina Manjakandriana45. Au lieu de choisir de s’attaquer frontale-ment à ce pillage, la Hat choisit d’incriminer le président Ravalomanana àtravers les agissements coupables d’une de ses sociétés. Comme si lepartage des responsabilités les rendait moins lourdes ! Certes, le trafic debois de rose ne date pas du Président de la Hat, mais désigner ainsi le prési-dent Ravalomanana ne change rien au trafic en cours dans la forêt. Lemessage est donc toujours aussi peu clair.L’étau médiatique se rapproche chaque jour un peu plus du chef de
l’État :– son Premier ministre Monja Roindefo a été publiquement mis en
cause dans un clip vidéo46. Il aurait détourné trois millions de dollars d’unprojet d’adduction d’eau dans la région de Toliara pour les confier à untrafiquant notoire de bois de rose47 ;
41.Midi Madagasikara, 18 mars 2010.42. 24heures.mg, 22 juin 2010.43. tribune.com, 12 novembre 2010.44. orange.mg, 25 août 2010.45. sobika.com, 14 juillet 2010.46. Youtube Dezza London, 11 décembre 2010.47. Le Courrier de Madagascar, 21 septembre 2009.
138 MADAGASCAR, LE COUP D’ÉTAT DE MARS 2009
– le Premier ministre suivant, Eugène Mangalaza, n’a eu que le tempsde publier une note de fermeture de la forêt (30 novembre 2009) avantd’être remercié ;– son successeur, Camille Albert Vital, malgré ses promesses répétées,
n’a toujours pas publié le nom du propriétaire des 300 tonnes de bois derose de contrebande saisies aux Comores le 22 juin 201048. En outre, sesliens de parenté avec le Colonel Balbine, son cousin et chef de l’éphémèreet très corrompue Task Force chargée de reprendre le contrôle de la forêt,ont fait l’objet d’un coup de colère public entre Andry Rajoelina et lui-même49 ;– le président lui-même est attaqué du côté familial : sa sœur, madame
Voahirana, est accusée par le Lieutenant-Colonel CharlesAndrianasoavina,d’être partie prenante dans le trafic de bois de rose50. Il est personnellementmis en cause dans un clip vidéo de l’Environmental Investigation Agencyet de Global Witness51 par des acheteurs chinois qui disent traiter directe-ment avec lui leurs achats de bois de rose.Dans ces conditions, il semble difficile de convaincre l’opinion publique
que l’équipe au pouvoir va juguler le trafic de bois de rose. Que les faitsévoqués ci-dessus soient vrais ou non52 importe peu dans le cadre de cetteétude, qui analyse la conquête de l’opinion publique. L’important est qu’ilsaient été publiés.Avec le recul, l’Histoire jugera le fait suivant : c’est durantla période de transition que l’on a le plus coupé dans les forêts protégées,le pouvoir savait et il n’a pas empêché. Une exception, toutefois, se faitjour dans l’équipe dirigeante. Il s’agit du général Herilanto Raveloharison,ministre de l’Environnement et des forêts. Non seulement il mène uneaction pugnace contre les trafiquants, mais il le fait savoir, comme lors desa descente à Majunga53. Le ton de ces articles est très offensif : le ministreattaque pour rétablir la vérité lorsqu’elle est déformée, expliquer sonaction et énoncer les mesures prises pour mieux faire appliquer la loi. Il semontre compétent et actif, il est donc rassurant pour l’opinion publique.Si nul ne met en doute son intégrité54, il n’en demeure pas moins que samarge de manœuvre est fort étroite et qu’il ne peut poursuivre en justicedes trafiquants dont les relations remontent jusqu’au cœur même de la Hat.Il est la caution du gouvernement en matière de communication sur la luttecontre le trafic de bois de rose. Mais Andry Rajoelina le reconnaît lui-même : « Nous avons, par exemple, fait appel à des militaires indemnisés à
48. Le Courrier de Madagascar, 25 juin 2010.49. tribune.com 6 juillet 2010, in litt. Cet article a été publié mais son lien électro-
nique a été brisé rapidement.50. Tananews.com, 8 janvier 2011.51. Mongabay.com, 16 novembre 2010.52. Andry Rajoelina conteste ces faits dans la Revue de l’océan Indien n°321 de jan-
vier 2011.53. La Gazette, 9 décembre 2010, madagate.com, 9 décembre 2010, L’Express de
Madagascar, 22 décembre 2010.54. Le Courrier de Madagascar, 20 juillet 2010.
LES CYBER-VERTS CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE 139
30000 ariary (environ 15 usd) par jour pour effectuer des contrôles dansles zones suspectes. La corruption aidant, ils ferment parfois les yeux etlaissent les convois continuer leur route. Certains d’entre eux sont aujour-d’hui en prison. On leur propose une somme dix fois, voire cent fois plusélevée que le montant de leurs indemnités. C’est toute une négociationentre les agents verbalisateurs et les fraudeurs »55. Cet aveu d’échec estconsternant : Madagascar serait-elle donc devenu un État mafieux où, pourpeu que l’on dispose de beaucoup d’argent, on peut violer la loi au vu et ausu du chef de l’État ? Les trafiquants auraient-ils « capturé » l’État ?On peut donc estimer que l’équipe dirigeante a échoué à persuader
l’opinion publique qu’elle pourrait juguler ce trafic, poursuivre les respon-sables et ramener l’ordre dans les forêts.
Les trafiquants
La vraie communication des trafiquants ne passe plus par les médiasmais par du lobbying et des coups d’éclat locaux. Pendant la période defolie (février-avril 2009), certains d’entre eux parlaient souvent à la radiolocale pour délivrer des messages comme: « Maintenant, nous sommes endémocratie, personne ne peut vous interdire de couper ce que vous voulezdans la forêt ». Il s’agissait surtout pour eux de lancer les villageois à l’as-saut des parcs nationaux et d’intimider les fonctionnaires des Eaux etForêts. Ils ont réussi sur ces deux points au-delà de leurs plus folles espé-rances. Depuis juin 2009, ils donnent, lorsque l’occasion se présente, desfêtes somptueuses pour la population environnante, notables locauxcompris. L’alcool y coule à flots, la musique y est entraînante et l’ambiancefestive. Même en prison, ils « régalent » : sacs de riz pour tous les détenuset les gardiens, matchs de basket entre gardiens et prisonniers56. Ils impres-sionnent le peuple ordinaire par leur train de vie, comme cette femme,grossiste en riz et propriétaire de plusieurs machines à décortiquer le rizdans la Sava, que les détaillants du marché de Sambava considèrent avecrespect. Ils disent qu’elle a fait fortune dans le « bolabola » (bille de boisde rose) et qu’elle a investi ses gains dans le riz57. Pour ceux qui n’ont pasla possibilité de lire le journal, cette communication-là est très efficace !Elle donne un exemple de réussite sociale et elle inspire le respect. Lestrafiquants l’ont bien compris, qui tiennent localement le haut du pavé. Ilsn’hésitent pas, lorsque c’est nécessaire, à exercer une influence active, à lalimite de la corruption et du trafic d’influence. C’est ainsi qu’ils affrètentun vol privé le 19 avril 2009 pour convaincre la Hat de rouvrir le port deVohémar, fermé depuis la veille58, ou qu’ils se rendent à Antsiranana pour
55. La Revue de l’Océan Indien, janvier 2011.56. Prison d’Antalaha, octobre 2009, obs. pers.57. Témoin oculaire, comm. pers. 2010.58. Débois 2009.
140 MADAGASCAR, LE COUP D’ÉTAT DE MARS 2009
tenter d’y rencontrer le ministre de l’Environnement et des forêts lors deson passage59. L’influence que leur confère l’argent est grande.La stratégie de communication des trafiquants, par le lobbying notam-
ment, est un succès, même s’ils ne réussissent pas à faire rouvrir les portspour reprendre les exportations officielles. Leurs coupeurs continuenttoujours à saccager le Parc National du Masoala.
Les cyber-verts
Lors de la période de folie, pour persuader les compagnies de transportmaritime de ne plus charger de bois à Vohémar, les cyber-verts utilisèrenttrois moyens :– la correspondance directe, faisant appel à l’intelligence et au sens de
la responsabilité environnementale de la compagnie. Deux compagniesarrêtèrent, Safmarine et UAFL, tandis que Delmas continua ;– en cas d’échec, l’atteinte à l’image en diffusant par voie de presse les
agissements de la compagnie récalcitrante60. Delmas poursuivit cependantses transports ;– en cas de nouvel échec, l’attaque frontale en envoyant, grâce aux
sympathisants de l’Internet Écologique61, des centaines de milliers de mes-sages de protestation à la compagnie récalcitrante. Le 1er juillet 2010,Delmas se retira de l’océan Indien où son image est maintenant trèsdégradée.Dans les ports que les cyber-verts ne surveillaient pas en 2009 (Tama-
tave, Antsiranana, Majunga), d’autres compagnies internationales ontexporté des bois précieux : Parc de la Montagne d’Ambre via Antsiranana,Parc d’Ankarafantsika via Majunga, Parc duMasoala, Parc de Mananara etParc Naturel du Makira via Tamatave. Les compagnies non épingléesjusqu’à présent se montrent dorénavant prudentes.La constance de la pression médiatique exercée au cours de 2009 et de
2010, ainsi que la faiblesse de la communication du gouvernement face àces écrits, poussent la presse nationale à reprendre à une plus importanteéchelle les détails révélés dans l’article HR & ZL. À partir de juillet 2010,il n’y a plus qu’une seule interprétation du trafic, les liens sont établis entrela politique et le trafic, les scandales sont suffisamment étayés pour êtreadmis par tous. Ce texte établit une norme, une référence pour qui veutparler de trafic de bois de rose malgache. Pour se persuader que les publi-cations « poster MBG 1 » et « article HR & ZL » sont bien la cause despics correspondants sur le graphique (figure 2), il suffit de lire n’importelequel des articles : ils parlent des faits révélés dans ces deux publications.Elles apparaissent donc comme des publications-pivots qui ont fait basculer
59. Témoin oculaire, octobre 2010.60. Marseille l’Hebdo, 2 février 2010.61. http ://www.ecologicalinternet.org/
LES CYBER-VERTS CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE 141
la campagne médiatique et l’opinion publique. Il est très possible, maisbien sûr invérifiable, que l’article HR & ZL ait contribué au revirementspectaculaire de la France à l’égard de la Hat. Jusqu’en juin 2010, neutra-lité bienveillante. À partir du 14 juillet 2010, soit deux semaines après lapublication de l’article HR & ZL, une prise très nette de distance avec laHat lors du discours de l’Ambassadeur de France qui évoqua, entre autres,le trafic de bois de rose62. La Hat en tomba même momentanément enpanne de communication63 !Les cyber-verts ont donc réussi leur communication alternative au-delà
de ce qu’ils pouvaient espérer initialement :– les ports malgaches sont fermés au bois de rose ;– les compagnies maritimes sont devenues très réticentes à embarquer
cette marchandise ;– les banques ont fermé de leur propre initiative les comptes de certains
trafiquants ;– comme les autres bailleurs de fonds de la communauté internationale,
la France a pris ses distances avec la Hat ;– l’opinion publique internationale a pris conscience de ce qui se passait
dans les aires protégées et l’Unesco a déclaré « en danger »64 les sitesinscrits au patrimoine mondial de l’humanité ;– l’opinion publique nationale a constaté la lenteur de la Hat pour
juguler ce trafic et son incapacité à contrôler les aires protégées.
Conclusion
Cependant, les coupeurs sont toujours dans la forêt, financés par lesavances sur facture des acheteurs chinois. Aucun des trafiquants impor-tants n’a été incarcéré. Plus grave encore, les stocks de bois de rose enattente d’exportation sont supérieurs à 15 000 tonnes65. Certains membresde la classe dirigeante malgache sont maintenant en possession d’un stockde bois de rose, acheté à bas prix dans la forêt et parfois transporté parl’armée nationale66. Les trafiquants ont fait plus que capturer l’État, ils ontgangrené une partie de la classe dirigeante du pays. Face à cette situationd’anarchie, que devrait faire la Hat ? On peut lui suggérer un plan aussisimple que spectaculaire :
62. La Gazette, 16 juillet 2010, Midi Madagasikara, 16 juillet 2010, L’Express deMadagascar, 17/07/2010.
63. Le Courrier de Madagascar, 2 août 2010.64. Unesco 2010, Le Courrier de Madagascar, 2 août 2010, Midi Madagasikara, 2
août 2010, tribune.com, 2 août 2010.65. Randriamalala et Liu, 2010 (p.11).66. La Vérité, 20 décembre 2010.
142 MADAGASCAR, LE COUP D’ÉTAT DE MARS 2009
1. saisir tous les stocks de bois de rose, les inventorier et poursuivre enjustice les propriétaires des locaux pour recel ;2. poursuivre en justice tout propriétaire de bois de rose qui, muni d’un
permis d’exploiter en bonne et due forme, ne pourra pas prouver que lenombre de billes de bois qu’il détient correspond au nombre de souchescomptées dans son lot forestier, essence par essence (le bois provient doncd’ailleurs, ce qui le rend illégal) ;3. détruire ces stocks, dans une grande opération médiatique et symbo-
lique, destinée à frapper les esprits et à redorer le blason de la Hat67.Et pourtant, la Hat tergiverse : « L’État tarde à trancher sur l’avenir des
cargaisons de bois de rose saisies depuis 2009. Un véritable dilemme entrela manne financière d’une vente aux enchères et l’image négative du paysvis-à-vis de l’opinion internationale. »68Nous sommes bien, effectivement,dans une guerre d’image.S’il est évident, au dire des trafiquants eux-mêmes, que le coup d’État
du 17 mars 2009 a créé une situation de chaos politique, légal et adminis-tratif qui a ouvert les parcs aux coupeurs, il apparaît de fa�on claire que lacampagne médiatique en a limité les effets. Ainsi, « il est communémentadmis que la résolution d’un problème social dépend de la quantité d’infor-mation disponible. Si un groupe est suffisamment saturé d’information,selon ce point de vue, alors il développera une compréhension générale dece sujet »69. On peut affirmer que la société malgache a été saturée d’infor-mation sur le bois de rose. Espérons que sa bonne compréhension duproblème lui permettra de prendre conscience qu’il serait grave de ne rienfaire pour mieux protéger ses forêts.Il apparaît également que cette campagne aurait été impossible sans
Internet. Seul cet outil a permis aux cyber-verts de recueillir et de diffuserune information que les trafiquants, tout comme le gouvernement, auraientpréféré taire. Certes, Internet n’est pas la démocratie, car en démocratie, unhomme égale une voix, alors que sur la toile, certaines voix portent plusque d’autres. Mais par quel autre moyen de simples citoyens, ne représen-tant qu’eux-mêmes, auraient-ils pu se faire entendre au point de fairereculer un gouvernement ou d’acculer à la défensive une puissante compa-gnie maritime? Internet n’est que le moyen, pas le moteur. Le moteur decette campagne a été l’indignation, que les cyber-verts ont réussi à commu-niquer à l’opinion publique. Indignation contre les trafiquants : trop gour-mands, ils pensent, comme Andrianapoinimerina70, que seule la merpourra les arrêter ; indignation contre la Hat : empêtrée dans ses querellespoliticiennes, elle laisse le patrimoine national filer à l’étranger71. Constitué
67. Wilmé, et al., 2010.68. L’Express de Madagascar, 12 janvier 2011.69. Donohue, et al., 1975.70. Roi Merina, fondateur du royaume d’Imerina (1787-1810), Il a commencé l’uni-
fication du pays avec « la mer comme seule frontière ».71. Près de 100% des ébènes et des bois de rose ont été exportés vers la Chine depuis
2009, contre 98% en 2001 (Randriamalala et Liu 2010).
LES CYBER-VERTS CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE 143
sur des siècles, reconnu mondialement, ce patrimoine s’érode inexorable-ment.S’ils peuvent faire reculer des gouvernements, les « e-lecteurs »72
peuvent aussi agir contre des grosses sociétés. L’actualité récente en donnedeux exemples :– des internautes ont détourné le slogan publicitaire de Nokia (Nokia
connecting people) en l’apposant sur des photos de la répression policièreen Iran, après que Nokia eut vendu à ce pays des systèmes d’interceptiondes communications entre les téléphones portables. Ces photos ont étémises en ligne sur beaucoup de blogs, portant ainsi gravement atteinteà l’image de Nokia. Le Parlement européen s’est même saisi de l’affairele 3 mars 2010 en critiquant sévèrement Nokia dans une de ses résolu-tions73 ;– en mars 2010 toujours, Greenpeace s’attaque au géant de l’agro-
alimentaire Nestlé. Celui-ci incorpore dans ses productions de l’huile depalme indonésienne, laquelle est produite au prix d’une déforestationmassive et d’un saccage de l’environnement. Greenpeace détourne le logode la marque Kit-Kat, une filiale de Nestlé, quelques internautes suivent,Nestlé censure alors le site de Greenpeace. Toute la communauté Facebookse rue sur l’événement, s’approprie le logo détourné et le cours en boursede Nestlé commence à chuter.Démocratie, lutte contre la cherté de la vie, défense de l’environnement,
voilà les thèmes qui mobilisent sur Internet. En 1983 Edward Barrett avaitécrit que la « vérité est notre arme »74, il ajouterait aujourd’hui « qu’In-ternet est notre vecteur ». Les cyber-verts ont acquis la conviction que lebois de rose acheté par la Chine n’est pas exclusivement destiné à sonmarché intérieur. Une partie est revendue en Europe ou aux États-Unissous forme de planchers et de meubles. Les marques qui revendent cesproduits finis, peu soucieuses de l’environnement, pourraient subir uneopération de détournement de logo ou de slogan qui serait très domma-geable pour leur image. Ainsi, la perquisition, fin 2009, chez le fabriquantde guitares Gibson par le Fbi (Federal Bureau of Investigation) pour avoiracheté de l’ébène malgache via l’Allemagne, a fait couler beaucoupd’encre75.Tout autre scandale susceptible de soulever la même indignation peut
aboutir aux mêmes résultats si quelques-uns s’y mettent avec détermina-tion et enthousiasme. La preuve a été faite qu’une masse menée par unpetit nombre, si la cause est juste, peut faire reculer un gouvernement quin’a pourtant rien de démocratique. Les événements récents en Tunisie ensont l’illustration. La « Révolution de jasmin » devrait plutôt s’appeler la« Révolution Facebook » :
72. Néologisme signifiant à la fois lecteur numérique (internaute) et électeur.73. Epelboi 2010.74. Barrett 1983 : 10.75. Nashville Post, 17 novembre 2009.
144 MADAGASCAR, LE COUP D’ÉTAT DE MARS 2009
– « Le jour, on était dans la rue. La nuit, devant l’écran »76 ;– « Grâce à Internet, la barrière de la peur a sauté »77 ;– « Ce sont les citoyens qui sont devenus journalistes »78.La contestation des résultats de l’élection présidentielle iranienne,
en juin 2009, fournissait déjà un avant-goût de cette citoyenneté numé-rique : « La révolution ne sera pas télévisée, elle sera twitterisée »79. Plusprès de nous, les événements en Égypte donnent la juste mesure de l’irrup-tion de la toile dans la sphère politique. La première réaction du gouverne-ment égyptien pour empêcher la contagion de la révolution tunisienne àl’Égypte a été de fermer les accès à Internet80. En réaction, les sociétésGoogle et Facebook se sont mises d’accord pour permettre la diffusion descourriels par les textos des téléphones portables, donc sans connexion àl’Internet81. Prudente, la Chine interdit alors le mot « Égypte » dans sesmoteurs de recherche sur Internet, pour éviter que ses ressortissants nepuissent s’inspirer des méthodes employées par les internautes égyptienspour organiser leurs propres manifestations82.Le point commun entre ces gouvernements (Iran, Tunisie, Égypte,
Chine et hélas beaucoup d’autres encore) est de vouloir contrôler l’infor-mation, de ne laisser circuler qu’une vérité officielle, lénifiante, où lesdifficultés sont minorées, les problèmes en cours de résolution et les scan-dales étouffés. Or, le départ du président Ben Ali de Tunis, tout comme lafermeture des ports malgaches au bois de rose, montrent l’importancecroissante des « e-lecteurs » dans la vie sociale.Et Madagascar alors ? Doit-on s’attendre à une « Révolution du Bois de
Rose », où de jeunes Malgaches s’organiseraient sur Facebook ou Twitterpour obliger la Hat à endiguer l’hémorragie des forêts ? Il est à craindre quenon :– le pays est tellement pauvre que les internautes y sont peu nom-
breux ;– la culture malgache voit d’un mauvais œil la mise en cause des ray
amandreny par les plus jeunes :
« Le principe de ray amandreny est une source importante du pouvoirsymbolique dans le domaine de la politique. La constitution de la IIIe Répu-blique utilise le terme malgache pour désigner le rôle des dirigeants poli-tiques (article 44). En fait, toutes les formes de direction dans la société seréfèrent directement au concept de l’aîné, indépendamment de l’âge réeldu dirigeant »83.
76. Le Monde, 18 janvier 2011.77. Libération, 11 janvier 2011.78. Libération, 17 janvier 2011.79. Libération, 15 juin 2009.80. RFI, 28 janvier 2011.81. RFI, 1er février 2011.82. RFI, 29 janvier 2011.83. Jütersonke et Kartas, 2010.
LES CYBER-VERTS CONTRE LE TRAFIC DE BOIS DE ROSE 145
Ou encore :
« Traditionnellement, les citoyens n’ont pas de pouvoir et ne sont pasorganisés pour s’exprimer individuellement ou collectivement afin d’exigerla transparence et de demander des comptes aux dirigeants »84
La « malédiction des ressources naturelles » veut qu’un pays pauvre etautocratique qui dispose de ressources naturelles ne se développe pas enproportion de ses ressources (Bhattacharyya et Hodler 2010). Elles consti-tuent une rente – et donc un enjeu de pouvoir – au profit exclusif de saclasse dirigeante. La population en est exclue. Ce phénomène est parti-culièrement évident dans la filière des bois précieux. Mais il existe unautre domaine où il pourrait se produire dans quelque temps : l’industrieminière.
« Madagascar va peut-être entrer dans le club des économies riches enressources au cours des prochaines décennies, lorsque les deux gros projetsminiers industriels vont atteindre leur pleine production et que d’autresseront en phase de développement. Les recettes minières vont alors proba-blement modifier fortement la distribution des rentes entre les élites enoffrant une forte récompense à ceux qui contrôleront le pouvoir politique.En réduisant l’importance relative de la perception de recettes par l’impôt,les recettes minières risquent d’affaiblir encore la responsabilité de l’Étatmalgache à l’égard de ses citoyens et d’éroder la capacité des institutionspubliques »85.
Il est possible que Madagascar soit frappée de cette « malédiction desressources naturelles ».
84. Banque mondiale 2010.85. Banque mondiale 2010.