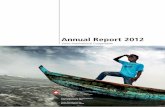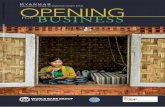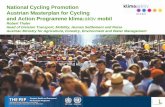40827254.pdf - OECD
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 40827254.pdf - OECD
HERA Alter HEALTH RESEARCH FOR ACTION .
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Évaluation thématique
Volume II
Laarstraat 43 tel. 32-3-8445930 B-2840 Reet Belgium fax. *32-3-8448221 Bank No 401-2025551-15 e-mail [email protected]
www.herabelgium.com
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Table des matières VOLUME II Annexe 1. Termes de Référence Annexe 2. Note méthodologique Annexe 3. Liste des projets santé des Communautés / Régions Annexe 4. Diagramme d’impact du secteur de santé. Note explicative. Annexe 5. Matrice. Les soins de santé primaires. Annexe 6. Liste des documents utilisés Annexe 7. Liste des personnes interviewées Annexe 8. Tendances et concepts internationaux relatifs au secteur de la santé & à l’aide au développement (anglais) VOLUME III Annexe 9. Rapports Pays
Annexe 9.1 Rapport Bénin Annexe 9.2 Rapport Cambodge (anglais) Annexe 9.3 Rapport Équateur (anglais) Annexe 9.4 Rapport Niger Annexe 9.5 Rapport République Démocratique du Congo Annexe 9.6 Rapport Rwanda
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 2
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Annexe 1. Termes de Référence
EVALUATION DU SECTEUR DE LA SANTE DE LA COOPERATION BELGE
Thème : « accès aux soins de santé globaux de base de qualité »
TERMES DE RÉFÉRENCE
Version finale
19 octobre 2004
HERA – ALTER – ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 1
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
1. CONTEXTE Dans sa note stratégique en évaluation approuvée par le comité de gestion de la DG D en janvier 2004, le service de suivi, évaluation et statistiques (D0.2) recommande l’identification, annuellement et de concert avec la Direction, de thèmes ou préoccupations importantes pour la coopération belge et ses partenaires, communes à plusieurs programme/projets/pays, en vue de les étudier plus en profondeur.
L’objectif de ces évaluations thématiques/sectorielles et/ou conjointes dépasse le cadre d’un programme/projet et d’un pays ou continent. Il est important de dégager de ces évaluations des leçons en vue de contribuer à la pertinence des actions de la DG D. La note stratégique de D0.2 met en évidence l’importance de la diffusion des conclusions et recommandations des évaluations. C’est particulièrement le cas des conclusions et recommandations qui visent des changements plus larges au niveau des politiques ou éventuellement au niveau de mesures de procédures administratives ou légales au sein de la DG D. Ces enseignements méritent une diffusion ciblée non seulement sur les gestionnaires et sur les partenaires mais aussi sur le management et sur les analystes politiques. Un des thèmes retenus dans le programme d’évaluation pour l’année 2005 concerne la santé ; il s’agit de l’accès aux soins de santé globaux de base de qualité. Afin de viser une plus grande cohérence dans le secteur santé, le DG D a préparé en 2002 une note stratégique1 portant sur les soins de santé primaires ; elle a créé un groupe de travail officialisé en 2001 pour le suivi interdirectionnel des soins de santé et a organisé conjointement avec l’Institut de Médecine Tropicale (IMT) d’Anvers2 une conférence à Anvers sur « l’accès aux soins de santé pour tous ». La DG D participe également à une plate-forme nouvellement créée sur la santé internationale initiée par l’Institut de médecine tropicale (IMT). Le contenu de la note stratégique n’est pas étranger à l’expérience pratique passée de coopération bilatérale de la DG D dans les pays d’intervention. La réflexion, la priorité stratégique d’aborder le secteur santé principalement par l’accès aux soins de santé globaux de base de qualité se sont affirmées suite à la conceptualisation de l’organisation des soins de santé primaires et à sa mise en œuvre dans des programmes concrets appuyés par la DG D depuis près de 30 ans dans plusieurs pays. Les universités belges et les instituts de recherche (par exemple l’IMT) ont formé nombre de médecins et personnel médical ayant par la suite contribués à la coopération belge et à façonner de manière plus cohérente une approche « belge » qui s’est développée et consolidée sur le terrain. Dans la note stratégique, le concept d’accès aux soins de santé globaux de base de qualité est défini de façon à couvrir les champs suivants :
- « donner une réponse globale aux principaux problèmes de santé des populations - assurer des soins de bonne qualité et accessibles à tous, donc aussi aux pauvres, en termes
autant financiers que géographiques et culturels - tabler sur une participation active de la population concernée, et - assurer des soins à la fois efficaces, efficients et durables ».
La note stratégique d’août 2002 donne la priorité pour la programmation future « en premier lieu aux services de santé qui visent à offrir des soins de santé essentiels de qualité y compris des mesures de prévention, de réadaptation et de promotion à un groupe de populations déterminé et par le biais d’un système de santé intégré ; incluant des centres de soins de santé primaires ainsi qu’un hôpital de première référence et géré par une administration de santé locale. Ils doivent améliorer la santé du groupe cible, répondre aux attentes de la population et offrir une protection financière contre les coûts induits par un mauvais état de santé ». La coopération belge vise, dans sa note stratégique, quatre niveaux d’intervention :
- niveau international : assistance et actions internationales 1 Note stratégique : soins de santé primaires. DGCD. Août 2002. 2 Rapport de la conférence et déclaration disponibles à D0.2
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 2
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
- niveau national : les pouvoirs publics des pays partenaires - niveau opérationnel : les services de soins de santé primaires - niveau local : les communautés.
Plusieurs principes guident les interventions, notamment ceux de la santé comme droit universel aux soins de santé et comme moyen de réduction de la pauvreté. Une approche intersectorielle est privilégiée ainsi que des actions internationales, des interventions et recherche basées sur les évidences, le respect du partenaire dans ses priorités et sa vision de l’avenir. Enfin, les interventions de la coopération belge sont orientées vers les résultats et l’impact. De façon générale, la DG D adhère à l’atteinte des Objectifs de Développement du Millénaire et à l’approche de la Stratégie de Lutte contre la Pauvreté approuvé par les Nations-Unies en 2000. Par conséquent, elle se préoccupe du problème de la coordination de l’aide. Cette préoccupation est prise en main par le CAD-OCDE qui a publié des lignes directrices « Harmonisation de l’aide pour renforcer son efficacité ». Un grand consensus autour de ce document a été obtenu avec la Déclaration de Rome – février 2003). La Belgique, comme membre actif du groupe de travail sur l’efficience de l’aide mis en marche pour appliquer cette déclaration, développe un plan belge d’harmonisation et d’alignement de l’aide. La direction de la DG D a entrepris plusieurs actions en vue de déboucher sur une approche3 plus sectorielle à la santé (SWAPs). Le secteur santé n’échappe pas à ces efforts pour une plus grande efficacité et l’évaluation thématique prendra en compte les principes promus par le CAD-OCDE pour une plus grande efficacité de son aide. Il est important de se rappeler que les projets sélectionnés pour l’évaluation thématique ont évolué dans un contexte qui leur est propre, antérieur à la rédaction de la note stratégique qui est le résultat d’un cumul des connaissances de la coopération belge en soins de santé primaires. Il est important d’apprécier ces projets dans le contexte de leur propre histoire. Bien que la note stratégique concerne directement la programmation bilatérale plutôt que les nombreux acteurs indirects dont la programmation est souvent fragmentée, les grands principes qui sous-tendent la note stratégique sont des principes de développement (entre autres, la santé comme droit universel aux soins de santé et comme moyen de réduction de la pauvreté ; le respect du partenaire dans ses priorités et sa vision de l’avenir ; les interventions axées sur l’atteinte de résultats et de l’impact) qui devraient concerner l’ensemble des acteurs de la coopération belge en santé. Puisqu’il s’agit d’une évaluation thématique et prospective (orientée vers des options futures), il est nécessaire d’éviter une appréciation projet par projet mais bien de rechercher le tissu des forces et des faiblesses communes à ces expériences, qu’elles soient endogènes ou exogènes, avec comme point de repère une revue éventuelle de la note et sa mise en œuvre plus systématisée et de faire des recommandations pour les décideurs et les exécutants sur les changements souhaitables à apporter à la stratégie actuelle et/ou à sa mise en œuvre. 2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION THEMATIQUE L’évaluation vise à: 2.1. Confirmer si la coopération belge actuellement reflète bien, dans la pratique l’esprit/la
cohérence/la priorité de la note stratégique, à savoir de « contribuer à l’amélioration des soins de santé globaux de qualité pour tous, accessibles, adéquats et équitables ».
2.1. Vérifier si la note stratégique est toujours pertinente 2.2. Vérifier dans quelle mesure la coopération belge a fait des apports significatifs concernant
l’accès aux soins de santé globaux de base de qualité: - le soutien aux politiques nationales en santé des pays partenaires et l’appui aux institutions de
santé
3 Cette évaluation-ci ne concerne pas les nouvelles formes de coopération. Une autre évaluation thématique de la DG D est prévue en 2005 à cet effet.
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 3
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
- la conception et la mise en œuvre d’interventions de santé belges répondant aux politiques et stratégies et aux institutions, ressources nationales/locales existantes (ownership/alignement/harmonisation)
- le suivi et l’évaluation des interventions en vue de tirer les leçons pour les pays partenaires et pour la coopération belge visant à améliorer les concepts et les pratiques en matière de soins de santé globaux de base de qualité
- la recherche de cohérence dans le secteur de la santé dans les pays partenaires et entre les acteurs belges de la coopération (ONG, bilatéral, multilatéral, universités et programmes spéciaux) et recherche de complémentarité entre les partenaires.
- la mémoire corporative de la coopération belge en santé (leçons tirées des expériences) - les mécanismes de coordination dans les pays partenaires, entre les bailleurs de fonds actifs sur le
terrain - La complémentarité avec d’autres secteurs de coopération. - l’influence des experts belges à l’OMS et l’ONUSIDA) - la participation active à la réflexion et à la définition de positions communes sur la scène
internationale (Union européenne, OMS, UNDP, ONUSIDA, UNICEF, B.M., Fond Global de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et la Malaria).
2.3. Identifier les contraintes liées à la mise en œuvre du contenu de la note stratégique, et cela
dans tous les types d’interventions en santé (projets/programmes/acteurs/multi ou non multi-bailleurs, etc.)
2.4. Formuler des recommandations concrètes sur une stratégie d’opérationalisation optimale de la
note stratégique en santé dans les nouveaux programmes en santé de la DG D et sur le « rationnel » du choix entre les divers types d’interventions en santé
2.5. Diffuser les résultats de l’évaluation aux acteurs/partenaires pertinents dans le secteur de la
santé en vue d’alimenter la réflexion sur les enjeux posés dans la note stratégique et sur les principes d’harmonisation et d’alignement promus par le CAD-OCDE.
3. QUESTIONS D’ÉVALUATION 3.1. L’atteinte des résultats Les questions d’évaluation sont articulées selon le Graphique 9 de la page 30 de la note stratégique explicitant les relations entre l’offre, la demande, les besoins et l’utilisation des soins de santés. L’évaluation cherche à : - Mesurer le degré d’efficacité des programmes de soins de santé de la coopération belge en terme
des résultats attendus et atteints et du type de résultats. - Questionner la pertinence des résultats en regard des grandes lignes stratégiques en soins de santé
tels que conçus localement et dans la note stratégique.
Le degré d’atteinte des résultats est appréhendé autant du côté de l’offre des soins de santé que du côté de la demande. Les questions d’évaluation concernent les aspects énumérés ci-dessous.
Du côté de l’offre des services de santé
Les inputs : - la pertinence (quantitative et qualitative) des ressources humaines, matérielles et financières
fournies par la coopération belge par rapport aux ressources nationales/locales existantes, y compris celles des bailleurs de fonds
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 4
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
- le renforcement du système formel de santé en place (formation, renforcement des capacités de fourniture de services en général)
- l’intégration, s’il y a lieu, d’éléments informels de soins locaux de santé (non traditionnels) existants
- la prise en compte ou la stimulation de complémentarités ou synergies avec les interventions locales d’autres secteurs pertinents à la santé.
Les outputs - La pertinence et l’efficacité de la structure d’offre des soins mise en place dans les interventions
(hôpital de référence, centres de santé en réseau, stratégie de disponibilité des médicaments, etc.) par rapport au concept d’organisation des soins de santé primaires promus dans la note stratégique en santé. La structure répond-elle au concept intégré de système local de santé tel que promu dans les concepts décrits dans la note stratégique ? Si oui, pourquoi ? Si non pourquoi ?
- la pertinence et l’efficacité des services en termes quantitatifs et qualitatifs (les résultats d’activités curatives et préventives de toutes les maladies générales et spécifiques, et promotionnelles -voulant induire des changements de comportement dans le domaine de la santé)
L’accessibilité est une des conséquences de la qualité et de la quantité de la structure de l’offre. Elle est un indicateur indirect de résultat à moyen terme et devrait conduire à un meilleur accès des populations aux services de santé offerts. On entend par accès la disponibilité des services au niveau géographique, financier et culturel, dans une perspective du principe promu dans l’approche revendiquée dans la note stratégique du droit de santé pour tous. Dans ce cadre, dans quelle mesure les soins de santé fournis avec l’appui de la coopération belge sont-ils accessibles aux populations visées ?
Du côté de la demande
Les outputs Il ne suffit pas de fournir des services de santé. Encore faut-il que les services soient façonnés pour répondre aux besoins de la population tels qu’ils sont techniquement définis et qu’ils coïncident davantage avec l’utilisation des soins de santé offerts. L’organisation des soins de santé primaire inclut le renforcement des capacités des communautés à mieux comprendre leurs besoins et à mieux les prioriser collectivement. Elle comprend aussi la collaboration avec des intervenants d’autres secteurs dans la région touchée. Dans ce sens, la demande n’est pas appréciée seulement en termes d’utilisateurs mais inclut également des autres acteurs de la communauté (leaders communautaires et politiques).
L’impact L’impact est considéré comme un résultat de l’offre des soins et de leur pertinence par rapport aux
besoins réels des populations concernées. L’impact sur la santé (par exemple, diminution de la mortalité infantile ou autres indicateurs d’objectifs du millénaire pour le développement) ne peut se matérialiser que si une approche multisectorielle est utilisée (sécurité alimentaire, formation, résolution des conflits, etc.). L’impact sera analysé ici en terme des dispositifs mis en place du côté de l’offre pour obtenir un impact. Dans quelle mesure le leadership du modèle d’organisation de soins primaires sert-il à établir des complémentarités ? Dans quelle mesure ce leadership favorise-t-il le renforcement du système de santé de façon à ce qu’il produise des outputs pertinents aux besoins des populations ?
3.2. Les préoccupations transversales L’évaluation examine la prise en compte de principes transversaux inhérents à l’approche des soins de santé globaux de base de qualité. Ces thèmes ne sont toutefois pas exclusifs à cette approche. Les principes retenus ici devraient concerner toute intervention de développement, y compris les interventions en santé, même si l’intensité de leur prise en considération peut varier selon le type de /programme/projet et/ou d’acteur.
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 5
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
L’évaluation examinera plus particulièrement les principes de durabilité (changements structurels), de partenariat et d’égalité des chances entre les femmes et les hommes. La note stratégique sur les soins de santé primaires encourage toutes les interventions appuyées par la coopération belge à se situer au sein du concept général des soins de santé primaires et des principes qui y sont associés. Les questions transversales s’appliquent donc à toutes les interventions sélectionnées pour cette évaluation. Toutefois, les questions ne concernent pas les interventions d’urgence qui ne sont pas prises en compte dans l’évaluation thématique. Une note stratégique sur le SIDA pour la coopération belge est en fin d’élaboration. Elle est trop récente pour que l’on s’y réfère de façon systématique et elle est davantage l’expression d’une vision que d’une stratégie. La note met de l’avant la coopération avec la communauté internationale et une meilleure harmonisation de la politique et de l’appui des donateurs en matière de SIDA. Bien que l’accent ne soit pas mis dans cette évaluation sur la lutte contre le SIDA, les projets/programmes concernés seront examinés dans les mêmes dimensions transversales, par rapport à leur relation avec l’organisation des soins de santé globaux de base de qualité. 3.2.1 Durabilité4
L’évaluation s’intéresse aux questions suivantes : - Dans quelle mesure les partenaires sur le terrain (au niveau national, provincial, local, gouvernemental et
non gouvernemental y compris les bénéficiaires/patients), participent-ils à la conception des programmes ?
- Dans quelle mesure la coopération belge appuie–t-elle le développement des politiques nationales en santé
de ses partenaires ? Dans quelle mesure la coopération belge fait-elle, à l’occasion de ces appuis, la promotion du renforcement des systèmes de santé et des principes tel que mis en évidence dans sa note stratégique santé ?
- Dans quelle mesure la coopération belge fait-elle la promotion du renforcement des systèmes de santé dans
les programmes qu’elle met en route sur le terrain (horizontaux et verticaux, avec les divers acteurs de la coopération belge, avec les bailleurs de fonds et les partenaires nationaux et multilatéraux) ?
- Dans quelle mesure les interventions appuyées par la coopération belge renforcent-elles une approche des
systèmes de santé existants ? Dans quelle mesure les interventions se positionnent-elles par rapport à d’autres interventions plus verticales ? Quelle est la stratégie (dialogue politique, solutions pratiques, travail en parallèle, etc.) de la coopération belge si des interventions exogènes aux systèmes de santé en place compromettent l’efficacité de ceux-ci ? La marge de manœuvre de la Belgique est-elle significative dans le contexte des réalités géopolitiques présentes en coopération ?
- Dans quelle mesure le renforcement des capacités (des individus et surtout des institutions locales) est-
il exploité pour favoriser la durabilité ? A quels niveaux (Etat, élus locaux, ressources en santé, société civile, secteur privé)? Dans quelle mesure le renforcement des capacités est-il repensé en fonction des défis actuels ? En termes de développement des politiques, de leadership politique? En termes de mobilisation et gestion des ressources, de la gestion/organisation, de l’administration, du suivi-évaluation des systèmes de santé ? En termes d’environnement politique, économique et socioculturel ? De participation de la société civile ? De la participation du secteur privé ? (Et non plus centrés sur de transfert de connaissances techniques)
- Dans quelle mesure la coopération belge contribue-t-elle à résoudre le financement durable du secteur, en
particulier la stabilité de ressources humaines ? - Y a-t-il des évidences d’appropriation comme conséquence directe du renforcement des capacités des
acteurs des interventions ? Quels sont-elles ? Contribuent-elles à la définition de politiques nationales de santé ? A un renforcement systémique de l’organisation des soins de santé ? Mènent-elles à envisager un désengagement progressif (financier et technique) éventuel de la coopération belge ou à transiter vers des nouveaux instruments d’aide? Des mesures sont-elles prises dans ce sens ? En particulier une
4 La définition de la durabilité ici est plus large que celle utilisée dans la loi belge 1999 sur la coopération.
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 6
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
programmation et engagement financier à plus long terme ? Une stratégie de ressources humaines à long terme ?
- Dans quelle mesure les programmes/projets de lutte contre les maladies transmissibles se positionnent-ils
pour être endogènes aux systèmes de santé existants ? Dans quelle mesure l’organisation des soins de santé primaires inclut-elle les préoccupations d’hygiène en lien avec ces maladies ?
- Dans quelle mesure les interventions à court terme contribuent-elle à la durabilité des soins de santé ? - Dans quelle mesure les expériences sont-elles utilisées pour tirer les leçons/documenter les forces et les
faiblesses en vue d’améliorer la performance des soins de santé primaires ? Quels sont les processus et les mécanismes institutionnels mis en œuvre pour les apprentissages sur le terrain et l’accumulation d’un mémoire corporative belge ?
- 3.2.2 Partenariat Un des principes promus dans la note stratégique est le partenariat dans la solidarité. Il y a plusieurs niveaux de partenariat à examiner dans l’évaluation thématique. Ils rejoignent les niveaux d’intervention promus par la coopération belge. Partenariat international Dans quelle mesure la coopération belge a t-elle une influence sur le leadership stratégique des instances/organisations internationales dans lesquelles elle est représentée ou pour lesquelles elle finance la présence d’experts en santé ? A-t-elle une influence sur les politiques des organisations internationales dont elle fait partie ? Comment ? Dans quelle mesure appuie-t-elle l’agenda d’harmonisation sur la scène internationale ? Quelles sont les contraintes internes à ces efforts ? Partenariat national Dans quelle mesure la coopération belge s’aligne t-elle sur les politiques nationales en santé et les renforce-t-elle ? Y a-t-il synergie ou non avec sa stratégie en santé ? Dans quelle mesure la coopération belge facilite-t-elle une transparence et simplicité des procédures? Dans quelle mesure la coopération belge assure-t-elle une cohérence et complémentarité des interventions belges en santé avec les politiques nationales et avec les politiques des autres bailleurs ? Quels sont les mécanismes nationaux et belges et/ou mixtes via lesquels la Belgique peut jouer ce rôle de coordination ? Sont-ils utilisés ? Sont-ils efficaces ? Partenariat avec les communautés locales (niveau périphérique et local) La coopération belge favorise-t-elle l’organisation décentralisée des soins de santé globaux de base, ainsi que les activités de surveillance des programmes nationaux de contrôle contre les maladies transmissibles ? Le modèle d’organisation de soins de santé globaux de base de qualité promu par la coopération belge inclut-il des mécanismes de solidarité et des dispositifs locaux appropriés afin d’éviter l’exclusion des soins aux plus défavorisés ? La coopération belge se positionne-t-elle pour favoriser une approche multisectorielle locale ? Si oui, est-elle pertinente ? Efficace ? Quels sont les mécanismes locaux de coordination et dans quelle mesure la coopération belge est un intervenant actif en vue d’apporter l’approche holistique en soins de santé qu’elle promeut dans la note stratégique ? 3.2.3 L’Egalité des chances La DG D a défini une note stratégique en mai 2002 sur l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes. Les consultants utiliseront cette note stratégique comme document de référence. La préoccupation telle qu’elle est exprimée dans la note couvre le secteur de la santé. Elle s’exprime certainement en terme d’égalité à l’accès aux soins de santé. Dans quelle mesure l’offre des soins de santé reflète-t-elle cette préoccupation ? Dans quelle mesure l’offre répond-t-elle aux besoins spécifiques des femmes ? Outre la préoccupation de l’accès aux soins par les femmes, l’évaluation s’intéressera au degré d’implication des femmes ( tant au niveau gouvernemental qu’au niveau de la société civile, au niveau international, national et local) dans la définition des politiques de santé, dans les stratégies mises en place, dans la participation des femmes aux mécanismes de définition des besoins dans la communauté et dans la gestion des ressources humaines.
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 7
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
4. MÉTHODOLOGIE Les bureaux d’étude/Instituts de recherche/Universités qui répondent à l’appel d’offre pour l’évaluation expliciteront la méthodologie qu’ils choisissent de suivre pour trouver des réponses aux questions élaborées au point 2. 4.1. Sélection des programmes/projets et pays Les critères de sélection des programmes/projets/pays sont les suivants :
Concentration des programmes/projets par pays et par acteur (ex. RDC) Couverture géographique5 (Afrique principalement, Amérique latine) Niveaux d’intervention (international, national, local) Durée de l’intervention Diversité des canaux (bilatéral direct, indirect, FBS, Fond Global Santé organisations multilatérales). Type de programme/projet : approche horizontale, verticale Intervenants du public-privé Milieu rural-urbain
De plus, les intervenants retenus offriront le plus de potentiel possible pour la réflexion sur des défis particulièrement difficiles à relever en soins de santé globaux de base de qualité. Par exemple, des interventions se déroulant dans des situations de gestion difficile des ressources médicales locales, d’isolement géographique, etc. (partenariats difficiles). Les interventions d’urgence ne font pas partie de l’évaluation thématique. La liste finale des projets/programmes retenus sera confirmée par la direction générale de la DG D. Sur la base des entretiens de préparation des termes de références, 10 pays semblaient offrir le plus de potentiel pour tirer un éventail de leçons correspondant aux problématiques soulevées et aux critères de sélection ci-haut. Il s’agissait de : République démocratique du Congo, Rwanda, Ouganda, Bénin, Sénégal, Mali, Niger, Bolivie6, Equateur et Cambodge. Le comité de pilotage (voir gestion au point 7), lors de sa première rencontre du 19 octobre, a retenu 6 pays parmi les 10 pays présélectionnés : La RDC (capitale et Bas-Congo) et le Rwanda pour leur concentration, tous acteurs confondus, le Bénin (capitale, centre et sud) et le Niger (en une seule mission – capitale et environs). L’Ouganda n’a pas été sélectionné car il est pris en considération dans le cadre d’une autre évaluation thématique de la D GD portant sur l’appui au processus de décentralisation. Puisque les projets santé en Bolivie sont pris en compte dans l’évaluation-pays du bureau de l’Evaluateur Spécial, l’Equateur a été retenu en Amérique latine ( capitale et 2 régions) car il offre également une grande diversité d’acteurs. Enfin, le Cambodge (capitale et 2 provinces) est retenu pour des raisons de couverture géographique et parce que le contexte de la santé y est assez spécifique. Les projets/acteurs les plus pertinents pour chacun des pays seront priorisés – et le choix sera motivé par chacun des représentants du comité en concertation avec leurs collègues, en raison des critères établis, tout en tenant compte des contraintes budgétaires. Le comité de pilotage participera au choix final des projets. Tous acteurs confondus, le total des projets pour les 6 pays qui feront l’objet de visites-terrain se situe entre 25 et 30.
5 Plusieurs personnes interviewées considèrent que l’évaluation devrait se concentrer sur l’Afrique et la région andine. En Asie, la coopération belge en santé a été discontinue, les pays de concentration ayant changés à plusieurs reprises (aux Philippines, en Thaïlande, en Indonésie, au Vietnam, au Cambodge.) 6 Le bureau de l’Evaluateur Spécial engage, dans la même période, une évaluation pays en Bolivie. Il est intéressant d’intégrer les préoccupations soulevées dans l’évaluation thématique de la DG D à celles de l’évaluation en Bolivie, qui concerne, entre autres, quatre projets en santé.
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 8
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
4.2. Source de données 4.2.1. Documentation écrite :
Une liste de documents de références bibliographique est à l’annexe 1. Ils incluent la note stratégique santé et les notes stratégiques pays pertinentes au mandat de l’évaluation, les politiques nationales en santé, autres documents nationaux pertinents et documents de références sur les problématiques soulevées dans les questions d’évaluation, en particulier celles traitées dans le cadre du CAD de l’OCDE (harmonisation, renforcement des capacités, partenariat et autres nouveaux paradigmes en coopération internationale), rapports d’évaluations en santé, documents propres aux projets/programmes sélectionnés. Note : Les consultants se réfèreront au glossaire du CAD pour les définitions des termes en évaluation
et aux définitions inclues dans la note stratégique santé pour la définition des termes en santé. 4.2.2. Entrevues individuelles et en groupe/questionnaires
Catégorie de répondants :
- Au niveau international • Organisations internationales en santé (à Genève notamment)
- Au niveau belge DG D
• Direction D0 et D0.1 • Experts santé • Gestionnaires des projets/programmes sélectionnés
Acteurs indirects • ONG concernées (francophones et néerlandophones) • Universités/Instituts (francophones et néerlandophones) • Représentants de mécanismes belges en santé (plateforme, etc.) • Fonds belge de Survie • VVOB, APEFE
CTB • Gestionnaires de la CTB
- Au niveau national du pays concerné
• Attaché(s) de la DG D • Représentants permanents de la CTB • Ministères pertinents au secteur santé • Bailleurs de fonds impliqués en santé • Représentants des organisations multilatérales concernées • Représentants de mécanismes de coordination/concertation nationale en
santé • Représentants des structures mixtes de concertation locale (SMCL) • Instituts de santé (écoles de santé publiques) • ONG internationales
- Au niveau local • Gestionnaires des projets (belges et nationaux) et assistants techniques • Autorités locales • Organisations de la société civile en santé et dans les secteurs connexes • Organisations internationales œuvrant en santé • Secteur privé • Bénéficiaires • Médecins/directeurs d’hôpitaux et autres agents de santé
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 9
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
5. CALENDRIER L’évaluation se déroulera de février à novembre 2005. 6. NIVEAU D’EFFORT Le volume approximatif de jours est à déterminer en fonction des projets/programmes sélectionnés et après finalisation des termes de référence. A titre indicatif, le budget prévu ne dépassera pas 200 000 EUR. 7. GESTION DE L’ÉVALUATION La sélection des bureaux d’étude/instituts/universités se fera par offre de marché générale au niveau belge et européen. Le Service de suivi, évaluation et statistiques (D0.2) est le service de la DGCD chargé de la mise en marché de l’évaluation et du suivi administratif du contrat. Un comité de pilotage sera constitué pour gérer le processus d’évaluation. Il sera présidé par DO.2. Il réunira des représentants de la DG D : D0.1 (cellule stratégique), D0.2, D1 (programme bilatéral, D2 (FBS), D3 (ONG, universités, APEFE, VVOB) et D4 (multilatéral), d’un représentant/expert de la CTB et d’un représentant de S0.4, service d’évaluation spéciale. Il comprendra également un représentant des ONG et des universités (francophones et néerlandophones). 8. RESTITUTION La restitution est un aspect non négligeable du mandat d’évaluation. En Belgique, plusieurs mécanismes ( plates-formes, groupes de travail, assemblées annuelles) existent déjà et peuvent être utilisés pour canaliser les résultats de l’évaluation, en collaboration avec les partenaires de la DG D engagés dans ces réseaux. D’autres séances de restitution, internes et externes à la DG D peuvent être organisées en vue de capter les acteurs belges divers oeuvrant dans le secteur de la santé. Dans les pays partenaires, les ambassades diffuseront le rapport final. 9. OUTPUTS DE L’ÉVALUATION L’équipe d’évaluation fournira :
• Un plan de travail détaillé après avoir consulté les gestionnaires à Bruxelles et les responsables des organisations internationales concernées à Genève et effectué une revue de littérature. Le plan inclura le détail de la répartition des tâches des membres de l’équipe d’évaluation, le chronogramme des activités, la liste des personnes à interviewer, un résumé des projets sélectionnés et les guides d’entrevues/questionnaires et autres mécanismes de collecte de données qui seront utilisés.
• Une présentation orale durant une séance de restitution au comité de pilotage suite aux missions dans les pays sélectionnés (avec support pédagogique).
• Un rapport provisoire détaillé présentant les constats, conclusions et recommandations de l’évaluation.
• Un rapport final. • Un résumé administratif • Des présentations orales (avec support pédagogique) à divers fora des acteurs belges actifs dans le
secteur de la santé. La langue de travail sera le français et/ou l’anglais. La connaissance du néerlandais sera assurée au sein de l’équipe. 10. STRUCTURE DU RAPPORT FINAL Outre le contexte général de l’évaluation thématique, la méthodologie utilisée et les contraintes rencontrées, le rapport final comprendra une partie analytique transversale (constats, conclusions et recommandations reflétant les préoccupations inscrites aux termes de références). On trouvera en annexe un rapport des missions sur le terrain, les outils de collecte de données, la liste de tous les intervenants rencontrés ainsi qu’un résumé descriptif des projets/programmes.
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 10
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
11. EQUIPE D’EVALUATION 11.1. COMPÉTENCES DES EXPERTS L’équipe d’experts proposée par les soumissionnaires sera composée de consultants du Nord et de consultants du Sud. La DGCD encourage fortement la constitution de consortia en vue de répondre de façon à maximiser aux exigences et à la spécificité du mandat. L’équipe cumulera l’expertise requise suivante :
• Expertise en évaluation de programmes de coopération dans les pays sélectionnés et expérience d’évaluations thématiques.
• Expertise dans le secteur de la santé, plus particulièrement en soins de santé primaires et les grands enjeux actuels de la santé dans les pays en développement.
• Très bonnes capacités de recherche et de synthèse • Très bonnes capacités pédagogiques • Très bonne connaissance de l’anglais, du français et de l’espagnol. La connaissance du néerlandais doit
être assurée au sein de l’équipe. 11.2. PROFIL DE L’ÉQUIPE
Les membres de l’équipe, idéalement, réuniront plusieurs qualifications :
• Un médecin spécialisé en soins de santé globaux de base • Un expert ayant au moins 5 ans d’expérience en évaluation dans les pays en développement • Un expert en développement des politiques de soins de santé globaux de base (PhD un atout) • Expérience pratique d’au moins 5 ans dans un service de soins de santé primaires dans un ou des pays
en développement (de 1980 – 2004) • Expérience pratique d’au moins 5 ans en développement des politiques nationales de santé • Français, anglais ; au moins une personne doit pouvoir communiquer en néerlandais et en espagnol.
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 11
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
ANNEXE 1
DOCUMENTS DE REFERENCE
• Note stratégique: soins de santé primaires DGCI, Août 2002 • Note stratégique: Egalité des droits et des chances entre les femmes • et les hommes, DGCI, Mai 2002 • Note stratégique sur le Sida pour la coopération au développement belge, DGCD. 25
novembre 2003 • Notes stratégiques pays (pays retenus pour l’évaluation thématique) • Note stratégique du FBS: Amélioration de la sécurité alimentaire
et réduction de la pauvreté. 2000-2010 • Documents de stratégies nationales en santé (des pays retenus pour l’évaluation thématique • Documentation relative aux projets retenus pour l’évaluation thématique (conventions,
rapports narratifs et financiers, rapports de suivi) • Rapports d’évaluations des projets retenus pour l’évaluation thématique. • Rapport de l’évaluation externe PIKINE, UCL • Référence du CAD : Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité. Document sur les bonnes
pratiques.) • Documentation relative aux divers mécanismes de concertation sur la santé (Table ronde santé
en RDC ; Conférence d’Anvers sur « l’accès aux soins de santé pour tous » de l’Institut de Médecine Tropicale (IMT) ; Plateforme sur les soins de santé primaire initiée par l’Institut de médicine tropicale (IMT) et la DG D)
• Millennium Development Goals. First progress report by Belgium on PDG 8 (Global Partnership for Development), 2004
• Autres documents disponibles à D0.2. • Document des ONG sur la durabilité
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 12
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Annexe 2. Note méthodologique pour l’évaluation
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Note méthodologique pour l’évaluation
18 mai 2005
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 1
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Table of contents
INTRODUCTION................................................................................................................................. 4
OBJECTIF GENERAL DE L’EVALUATION (VOIR TDR) .......................................................... 4
APPROCHE GENERALE DE L’EVALUATION............................................................................. 5
METHODES D’EVALUATION................................................................................................................... 5 OUTILS D’EVALUATION ......................................................................................................................... 6 L’ETUDE DE TERRAIN ............................................................................................................................ 6 L’ETUDE SUR DOSSIER ........................................................................................................................... 9
L’UTILISATION DE LA NOTE STRATEGIQUE......................................................................... 10
PERTINENCE DES PROJETS ET PROGRAMMES D’UN POINT DE VUE SECTORIEL ET DU PARTENARIAT........................................................................................................................... 10
IMPACT SUR LE SYSTEME DE SANTE ................................................................................................... 10 PERTINENCE DU PARTENARIAT INSTITUTIONNEL ............................................................................. 12
EFFICACITE ET PERTINENCE DES PROJETS ET PROGRAMMES PAR RAPPORT A LA NS.......................................................................................................................................................... 12
REFERENCE AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES DECRITS DANS LA NOTE STRATEGIQUE .................. 13 PERTINENCE DES RESSOURCES ........................................................................................................... 16 RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE ........................................................................................... 17 COHERENCE ET COMPLEMENTARITE ................................................................................................ 17 REPONSE AUX BESOINS DE SANTE ....................................................................................................... 19 IMPACT POTENTIEL SUR LA SANTE ..................................................................................................... 20
PREOCCUPATIONS TRANSVERSALES...................................................................................... 20
DURABILITE.......................................................................................................................................... 20 LES APPROCHES CHOISIES POUR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES ................ 23 PARTENARIATS INTERNATIONAUX ..................................................................................................... 24 PARTENARIATS NATIONAUX................................................................................................................ 25 PARTENARIAT AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES (NIVEAU PERIPHERIQUE ET LOCAL).............. 26 L’EGALITE DES CHANCES FEMMES / HOMMES................................................................................... 27 LA LUTTE CONTRE LE SIDA................................................................................................................ 29
PREOCCUPATIONS DE DEVELOPPEMENT ISSUES DE LA NOTE STRATEGIQUE ....... 30
DEVELOPPEMENT DURABLE................................................................................................................ 30 METHODES ET STRATEGIES OPERATIONNELLES ............................................................................... 32 RENFORCEMENT DES CAPACITES ....................................................................................................... 33
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 2
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge STRATEGIES DE FINANCEMENT........................................................................................................... 35 ACTIONS DE PLAIDOYER...................................................................................................................... 36 PLAN D’ACTION PAR PAYS ................................................................................................................... 37 LA RECHERCHE .................................................................................................................................... 37 FONDS GLOBAL .................................................................................................................................... 38
ANNEXES : SUPPORTS METHODOLOGIQUES ........................................................................ 39
ANNEXE 1. DIAGRAMME D’IMPACT DU SECTEUR SANTE................................................................... 39 ANNEXE 2. LISTE D’INTERVENTIONS DE SANTE D’IMPACT POTENTIEL IMPORTANT SUR LA SANTE............................................................................................................................................................... 48 ANNEXE 3. CLASSIFICATION DES PROJETS ET PROGRAMMES SELON LA NOTE STRATEGIQUE ...... 49
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 3
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
1. Introduction Le présent document comprend : 1. L’approche méthodologique 2. Le cadre qui structure l’évaluation selon les :
- Thèmes - Critères de jugement - Indicateurs
Ce cadre a été élaboré sur la base:
a) Des TdR ; b) De la Note stratégique ; c) Des expériences d’autres bailleurs d) De la note méthodologique HERA ; e) Des expériences d’HERA en matière d’évaluation; f) Du Diagramme d’impact sectoriel santé ; g) De la Note stratégique « genre » h) De la Note stratégique VIH/SIDA
3. La liste des questions qui seront utilisées par les équipes d’évaluation. Ces questions
leur permettront, de manière standardisée, de mener des interviews et de consulter les documents pour la collecte des données.
4. Les projets concernés par l’évaluation et auprès desquels l’équipe d’évaluation trouvera
concrètement des réponses par interview et/ou analyse documentaire
2. Objectif général de l’évaluation (voir TdR) L’évaluation a pour objectifs de : 2.1. Confirmer si la coopération belge actuellement reflète bien dans la pratique, l’esprit/la
cohérence/la priorité de la Note stratégique, à savoir de « contribuer à l’amélioration des soins de santé globaux de qualité pour tous, accessibles, adéquats et équitables ».
2.6. Vérifier si la Note stratégique est toujours pertinente 2.7. Vérifier dans quelle mesure la coopération belge a fait des apports significatifs
concernant l’accès aux soins de santé globaux de base de qualité: - le soutien aux politiques nationales en santé des pays partenaires et l’appui aux
institutions de santé - la conception et la mise en œuvre d’interventions de santé belges répondant aux
politiques et stratégies et aux institutions, ressources nationales/locales existantes (ownership/alignement/harmonisation)
- le suivi et l’évaluation des interventions en vue de tirer les leçons pour les pays partenaires et pour la coopération belge visant à améliorer les concepts et les pratiques en matière de soins de santé globaux de base de qualité
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 4
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
- la recherche de cohérence dans le secteur de la santé dans les pays partenaires et entre les acteurs belges de la coopération (ONG, bilatéral, multilatéral, universités et programmes spéciaux) et recherche de complémentarité entre les partenaires.
- la mémoire corporative de la coopération belge en santé (leçons tirées des expériences)
- les mécanismes de coordination dans les pays partenaires, entre les bailleurs de fonds actifs sur le terrain
- La complémentarité avec d’autres secteurs de coopération. - l’influence des experts belges à l’OMS et l’ONUSIDA - la participation active à la réflexion et à la définition de positions communes sur la
scène internationale (Union européenne, OMS, UNDP, ONUSIDA, UNICEF, B.M., Fond Global de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et la Malaria).
2.8. Identifier les contraintes liées à la mise en œuvre du contenu de la Note stratégique, et cela dans tous les types d’interventions en santé (projets/programmes/acteurs/multi ou non multi-bailleurs, etc.)
2.9. Formuler des recommandations concrètes sur une stratégie d’opérationnalisation
optimale de la Note stratégique en santé dans les nouveaux programmes de la DG D et dans ce contexte, sur la rationalité du choix entre les divers types d’interventions de santé
3. Approche générale de l’évaluation Méthodes d’évaluation Pour chaque thème, les paragraphes ci-dessous détaillent les méthodes proposées.
1. La Coopération Belge (CB) reflète-t-elle l’esprit, la cohérence, la priorité de la Note stratégique ?
Evaluation transversale d’un échantillon de projets / programmes dans les 6 pays
participant dans l’évaluation Etude sur dossier limitée d’un échantillon de projets en cours et/ou récemment
formulés, par type d’acteur Interviews de personnes-ressources sur des appuis et activités divers de la CB
(présence dans des fora; publications; financement / organisation de conférences internationales; appui d’organisations internationales …)
2. La Note stratégique est-elle toujours pertinente ? Revue des orientations et principes internationaux de développement / des
tendances politiques globales Revue d’un échantillon de politiques de coopération sanitaire / stratégies de santé
d’autres pays européens, partenaires de développement Revue de la politique de développement belge Evaluation transversale d’un échantillon de projets / programmes dans les 6 pays
participant dans l’évaluation : l’évidence du terrain Interview de personnes-ressources sur la pertinence de la Note stratégique
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 5
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
3. La contribution de la CB à l’accès aux soins de santé globaux de base de qualité
Évaluation transversale d’un échantillon de projets / programmes dans les 6 pays
participant dans l’évaluation Étude de bureau limitée d’un échantillon de projets en cours et/ou récemment
formulés, par type d’acteur (seulement au niveau des résultats visés) Interviews de personnes-ressources (plaidoyer belge pour les soins de santé globaux
de base)
Outils d’évaluation Les outils suivants sont utilisés pour l’évaluation :
1. Outil pour l’évaluation au niveau des pays / projets Outil spécifique pour le niveau national Outil spécifique pour le niveau « acteurs ». Outil spécifique pour le niveau local
2. Outil pour l’évaluation ‘étude sur dossier’ 3. Outil / questionnaire pour les personnes ressources au niveau international et
national belge Note : Le présent document présente les différent thèmes, critères de jugement, indicateurs et questions à poser pour l’ensemble de l’évaluation (tous niveaux et/ ou acteurs inclus). Après l’acceptation par le Comité de Pilotage du cadre méthodologique, sur base du présent document, les questionnaires par niveau et/ou acteur seront développés (sélection des questions par niveau et/ou acteur) ; ainsi que les formats pour les rapports projets et pays. L’étude de terrain
Critères de sélection
Le comité de pilotage a proposé une liste de projets à évaluer dans 6 pays partenaires. L’équipe d’évaluation a revu cette liste en fonction des critères suivants : • La variation des types de projets (voir typologie) dans l’échantillon globale • La variation des acteurs impliqués • Des projets éventuellement non inclus dans l’échantillon (récemment formulés ;
seulement pour les pays / régions proposées) • La faisabilité (critère d’accès pendant la durée de la visite de terrain + nombre total de
projets à évaluer) • Le point de vue du pays (attaché, acteur ; seulement achevé pour le Cambodge et
l’Équateur) Liste de projets En principe la liste originale de projets est largement maintenue avec quelques modifications.
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 6
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge L’étude de terrain comprend (actuellement) 45 projets dans 6 pays. La répartition est présentée dans les deux tableaux suivants :
Acteur Nombre Projet bilatéral 18 Projet multilatéral 6 ONGs 12+ APEFE 3 IMT 7 Université 1 FBS 1
Typologie Nombre
Appui institutionnel 2 Financement 4 Formation / RH 3 Santé reproductive 3 Programme santé 22 (dont SIDA) (6) Services de santé 11
(Voir tableau Excel en annexe 2 pour la liste des projets à évaluer par pays - liste finale à décider lors de la réunion).
Personnes à interviewer : La liste ci-dessous définit le champ des personnes / organisations à rencontrer. La liste exacte par pays sera décidée par l’équipe d’évaluateurs en fonction des projets sélectionnés et le contexte du pays (éléments de faisabilité opérationnelle). Le niveau « national » inclût les partenaires suivants : • Le Ministère responsable pour la Santé, et/ou le cas échéant et si possible
celui qui était en poste lors de la décision et de la mise en œuvre des projets • Autres Ministères éventuellement impliqués dans la santé (dépend du pays,
mais ceci pourrait inclure le Ministère des Finances, le Ministère du plan, le Ministère des Affaires sociales, Ministère responsable du suivi de l’action ONG..)
• Ambassade Belge (Attaché) • Représentants de mécanismes de coordination/concertation nationale en
santé • Représentants des structures mixtes de concertation locale (SMCL) • Organisations Internationales (par exemple OMS, ONUSIDA, UNICEF,
Bailleurs de Fonds bilatéraux et multilatéraux « leader » dans le secteur, Délégation CE, ONG Internationales impliqués dans le secteur)
• Organisations professionnelles (par exemple Associations Professionnelles) • Institutions nationales (par exemple Assurance Maladie, Université, Ecole
Santé Publique, ...)
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 7
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Le niveau « acteur » inclût les partenaires suivants : Les organisations belges, internationales et nationales qui sont responsable de la mise en œuvre du projet. • Le Ministère de tutelle sur la mise en œuvre du projet (en principe le Ministère
de la Santé, parfois aussi le Ministère responsable des contrats ONG étrangères)
• Représentant de La CTB • Représentant de l’ONG belge • Représentant de l’université belge • Représentant de l’Institut de Médecine Tropicale • Représentant de l’APEFE/VVOB • Représentant de l’organisation internationale (ONUSIDA, FNUAP, UNICEF,
BM) • Représentant du partenaire local (p.ex. ONG locale ; mutualité) Le niveau « local » inclût les partenaires suivants : • Les autorités locales responsables pour l’exécution du projet (équipe
régionale ou de district, école de formation, gouvernement local, la mutualité, ...)
• Le personnel de santé (public, privé, ...) • La société civile (structures locales, comités de santé, ONGs locales, ...) • Bénéficiaires • Assistants techniques
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 8
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
L’étude sur dossier Le but de l’étude sur dossier
Le but de l’étude sur dossier est : • d’élargir l’échantillon de projets (pour éviter une critique éventuelle sur la représentativité
de l’échantillon des projets visités sur le terrain) ; • de compléter éventuellement des types d’intervention qui ne sont pas suffisamment
représentés dans l’échantillon • de compléter des acteurs qui sont insuffisamment représentés dans l’échantillon (p.ex.
spécifiquement les universités) Proposition de projets à évaluer et critères de sélection L’étude sur dossier fera une analyse limitée, seulement sur base de documents disponibles et interviews téléphoniques, d’un échantillon complémentaire de projets et/ou programmes. La décision sur l’utilité d’une étude additionnelle sur dossier, son contenu, les dossiers à revoir, les interviews à faire sera fonction de l’étude des pays. Après l’évaluation de 48 projets dans 6 pays, il a été décidé de limiter l’étude sur dossier aux intervenants et programmes suivants :
- la revue de 4 programmes quinquennaux ONG médicales + une réunion avec les ONG médicales;
- la revue de la documentation concernant l’aide multilatérale + des interviews avec la DGCD, l’OMS (Genève) et l’ONUSIDA ;
- la revue de la documentation des projets universitaires + interviews avec CIUF et VLIR
- la revue de la documentation du contrat cadre (2003-2007) de l’IMT + interviews avec l’IMT
- la revue de la liste des projets santé des communautés/régions - des interviews avec la DGCD, CTB
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 9
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
4. L’utilisation de la Note stratégique Évaluation de la pertinence de la NS L’évaluation sur le terrain concerne également la Note stratégique santé et son contenu. Lors des rencontres avec les acteurs de la CB au niveau du terrain, de Bruxelles et au niveau international, l’équipe d’évaluation recueillera les avis concernant la NS. Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quel usage est fait de la Note stratégique ? X X X X Quelle est sa valeur ajoutée pour le cadrage des interventions ?
X X X X
Quels sont ses manques d’un point de vue conceptuel ? X X X X Quels sont ses manques ou contraintes d’un point de vue opérationnel ?
X X X X
Quels sont ses manques d’un point de vue des normes et procédures ?
X X X X
INT = niveau international (voir plus haut la liste des organisations) BRX = niveau belge (Bruxelles) NAT = niveau national du pays visité (voir plus haut la liste des organisations) ACT= Acteurs = organisations responsables pour la mise en œuvre des projets (voir la liste plus haut) LOC = niveau local (voir la liste plus haut) Commentaire : la Note stratégique n’est en général pas connue au niveau local.
5. Pertinence des projets et programmes d’un point de vue sectoriel et du partenariat Impact sur le système de santé
Le secteur de la santé ne peut être performant que si tous aspects importants du secteur sont suffisamment bien mis en œuvre et reçoivent suffisamment de ressources (know-how, temps, financier, ressources humaines, ....). Typiquement, un projet ne couvre en général pas tous les éléments du secteur et sa performance dépend aussi de la performance d’autres acteurs et des inputs qu’ils fournissent. Lors de la formulation on doit tenir compte de ces opportunités et contraintes. Au niveau pays et/ou global la CB appuie de préférence certains aspects du système de santé mais pas tous (la note stratégique ; valeur ajouté de la CB, etc.). Le but de la question est de faire une brève analyse des différentes fonctions clés du système de santé du pays, apprécier l’appui par le projet au système de santé (définir quels aspects
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 10
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
sont appuyés), les appuis par d’autres intervenants et éventuellement les contraintes majeures pour une bonne performance du système de santé. La question permettra de mieux « visualiser » les appuis- « types » de la CB dans le secteur de santé, dans un contexte donné et éventuellement les lacunes / contraintes de cet appui. Par « impact » sur le système de santé, on entend la somme des effets (des interventions) sur les différentes fonctions d’un système de santé.
Critères de jugement
- Tels que conçus, les actions développées et les dispositifs mis en place ont (peuvent avoir) potentiellement un impact sur les fonctions d’un système de santé
- L’ensemble des fonctions essentielles du système de santé sont prises en compte
Modalités de vérification des critères
- Réalisme et pertinence des actions sur les fonctions décrites dans le diagramme d’impact (voir annexe 1).
- Couverture des fonctions et des résultats essentiels (voir annexe 2) : tableau dans lequel reporter les actions pour chacune en face des fonctions décrites dans le diagramme.
Questions [Utiliser l’annexe 1 pour remplir les questions ] INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Indiquer (par projet, pour l’ensemble des interventions belges dans le secteur, pour l’ensemble des intervenants) quelles fonctions essentielles du système de santé sont appuyées.
X X X X X
Indiquer (par projet, pour l’ensemble des interventions belges dans le secteur) sur quelles fonctions essentielles du système de santé le projet a eu un impact important (changement de politique, renforcement de la capacité, ...).
X X X X
Indiquer les fonctions essentielles qui ne sont pas suffisamment appuyées, ce qui expliquerait une performance insatisfaisante du secteur.
X X X X
Indiquer les résultats sectoriels qui ne sont pas suffisamment atteints ou posent problèmes
X X X X
Indiquer sur quels autres secteurs le projet a un impact X X X X Indiquer les autres secteurs ou les aspects santé ne sont pas suffisamment couverts
X X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 11
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Pertinence du partenariat institutionnel Critères de jugement
- Le partenariat institutionnel ouvre les projets et programmes à la prise en compte réelle et au dépassement des contraintes existant dans le système de santé (ressources financières, personnel soignant, ….).
- Le partenariat institutionnel dynamise l’ensemble des acteurs des soins de santé : publics, privés à but non lucratif, privé à but lucratif, associations professionnelles, organismes de financement des soins de santé, … .
- Le partenariat institutionnel permet d’appuyer la complémentarité et la coordination entre les acteurs.
- Le partenariat institutionnel permet de développer des actions multisectorielles
Modalités de vérification des critères
- La mesure dans laquelle les contraintes, hypothèses et risques énumérés dans les documents de projets sont liés au partenariat institutionnel.
- La mesure dans laquelle le partenariat institutionnel touche les différents acteurs du système de soins de santé
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quel est le partenariat institutionnel du (des) projet(s) ? X X X X X Quelles sont les hypothèses, risques et contraintes liées à ce partenariat ?
X X X X X
Quelles sont les initiatives et les contraintes intersectorielles « vécues de l’intérieur » de ce partenariat ?
X X X X X
Quelle serait le bénéfice d’élargir le partenariat (p.ex. associations professionnelles, le privé, ...)
X
Quelle est la valeur ajoutée de ce partenariat (exemples) ? X X X X X
6. Efficacité et pertinence des projets et programmes par rapport à la NS L’évaluation cherche à :
- Mesurer le degré d’efficacité des programmes de soins de santé de la coopération belge en terme des résultats attendus et atteints et selon les types de résultats.
- Questionner la pertinence des résultats attendus et/ou atteints en regard des grandes lignes stratégiques en soins de santé tels que conçus localement et dans la Note stratégique.
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 12
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Référence aux soins de santé primaires décrits dans la note
stratégique Critères de jugement
- Le projet ou programme évalué est cohérent avec le cadre stratégique. de la NS - Pertinence du dispositif d’offre de soins, c’est à dire correspondance de ce
dispositif avec le concept intégré de système de santé local. - Efficacité du dispositif d’offre de soins, c’est à dire l’exploitation optimale de ce
dispositif par les équipes locales pour une production de soins de qualité. - Accessibilité des soins pour les habitants de la région, en particuliers pour les
personnes démunies. Modalités de vérification des critères
- Le projet ou programme appuie principalement la stratégie principale des SSP - « Complétude du dispositif » : soins hospitaliers, centres de santé, aires de
couverture, système de référence, approvisionnement en médicaments, programmes de formation, de supervision, stratégie de développement).
- Analyses des contraintes opérationnelles, économiques et sociales à l’offre de soins, pour le niveau de développement auquel le dispositif se situe.
- Analyses des résultats de l’offre de soins sur la base de 35 indicateurs essentiels, mesurés en variation dans le temps.
- Analyse de l’accessibilité par les indicateurs choisis pour ce thème. Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Dans quelle mesure le projet appuie-t-il principalement la stratégie principale des SSP ?
X X X X
Dans quelle mesure la CB (plan d’action santé belge, tous projets) appuie-t-elle principalement la stratégie principale des SSP
X X X X X
Dans quelle proportion (en %) de ressources et d’activités le(s) programme(s) contribue-t-il (contribuent-ils) au développement du système de soins de santé tel que défini dans la Note stratégique ? (*)
X X X X X
Quels sont les appuis du (des) programme(s) dans ce sens ?
X X X X X
Quelle(s) explication(s) peut-on donner à cette forte ou faible proportion ?
X X X X X
(*) « … en premier lieu aux services de santé qui visent à offrir des soins de santé essentiels de qualité y compris des mesures de prévention, de réadaptation et de promotion à un groupe de populations déterminé et par le biais d’un système de santé intégré ; incluant des centres de soins de santé primaires ainsi qu’un hôpital de première référence et géré par une administration de santé locale. Ils doivent améliorer la santé du groupe cible, répondre aux attentes de la population et offrir une protection financière contre les coûts induits par un mauvais état de santé ». INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Pour chaque projet/programme, quels sont les résultats d’activités curatives et préventives de toutes les maladies générales et spécifiques, et promotionnelles (les activités
X X X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 13
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge INT BXL NAT ACT
EUR LOC
qui visent à induire des changements de comportement dans le domaine de la santé). Voir liste (1 et 2) d’indicateurs. Si pertinent, donnez d’autres exemples de résultats (hors indicateurs sélectionnés). Pour chaque projet/programme quel est l’accès (la disponibilité) des services au niveau géographique, financier et culturel pour les populations visées. Voir liste (3) d’indicateurs.
X X X X
Liste d’indicateurs Liste 1. Indicateurs d’impact global (MDGs) : Malaria, TB, … Critères de jugement
1. Decrease in prevalence of and mortality due to malaria 2. Decrease in prevalence of and mortality due to tuberculosis Indicateurs 1a. Percentage of children under 5 sleeping under insecticide treated bed nets 1b. Percentage of children under 5 who are appropriately treated 1c. Number of notified TB patients per 100,000 population 1d. Tuberculosis cure rate (proportion of TB patients successfully completing treatment as compared to patients starting treatment) HIV/AIDS Critères de jugement
1. Decrease in HIV prevalence or incidence 2. Increased knowledge and reduced misconceptions regarding HIV-AIDS by 15 - 24 year olds Indicateurs 1a. Condom use rate of the contraceptive prevalence rate 1b. Appropriate diagnosis and treatment of STIs 1c. Proportion of women attending ante-natal care who have been counselled and tested for HIV and have received their results 2a. HIV knowledge, percentage of (wo)men 15-24 year olds with comprehensive correct knowledge of HIV/AIDS Maternal Health Critères de jugement
1. Decrease in number of women who die in a given year as a result of child bearing (due to complications of pregnancy and child birth), per 100,000 live births 2. Increase in attendance of delivery by a midwife or other skilled attendant 3. Failure of the referral system to deal with obstetric emergencies Indicateur : 1. Maternal mortality ratio 2. Proportion of births attended by skilled health personnel 3. Number of referral facilities providing essential and emergency obstetric care per 100,000 women in the reproductive age group
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 14
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Child health Critères de jugement
1. Decrease in numbers of children dying before the age of 5 years, including still-births and neonatal deaths, infants (below the age of 1 year) and children between 1 and 5
Indicateur : 1a. Under-five mortality rate 1b.Infant mortality rate 1c. Prevalence of underweight children under 5 years of age Liste 2. Indicateurs de résultats intermédiaires et de processus : Critères de jugement : 1. Existence, et qualité du concept de soins de santé de base 2. Disponibilité, en quantité et qualité, des ressources humaines 3. Degré de décentralisation dans la prise de décision et de la gestion au niveau le plus approprié 4. De systèmes de performance appliqués 5. Transparence de l’information sur la performance pour le public 6. Increased involvement of all stakeholders in society in policy-making and decision-making in health sector (at all levels) 7. Improved consideration of and respect for clients’ needs Indicateurs : 1. La sélection des soins de santé de base couvre les soins les plus coût efficaces avec un potentiel d’impact important sur la santé, spécialement pour les pauvres (utilisez le tableau en annexe 2) 2a. Médecins par 10,000 habitants (urbain, rural) 2b. Infirmières et accoucheuses par 10,000 habitants (urbain, rural) 2c Nombre de postes remplis, par cadre et par région 2d. Pourcentage de clients satisfaits avec la qualité des services ? 3. Des plans sanitaires de district budgétises et « globaux» (tous acteurs) existent 4. La performance des soins de santé (ou du secteur) sont discutés annuellement avec les différents partenaires (national, district, local) 5. Données de performance des soins et données financières localement publiées 6a. Regularity of meetings of local health committees (e.g. at facility level, community level) 6b. Inclusion, in local health planning and plans, of participation of community institutions and civic associations 7. Respect of privacy and confidentiality by health service providers (e.g. percentage of clients satisfied with the way privacy and confidentiality is dealt with by health service providers) Liste 3. Indicateurs d’accès aux soins : Critères de jugement : 1. Proportion plus importante de la population a accès aux soins de santé de base 2 Couverture de soins de santé de base, par le réseau public et privé 3. Accessibilité financière des médicaments y inclus les médicaments essentiels 4. Increased existence and application of provisions to ensure protection of vulnerable groups from financial risks
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 15
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Indicateurs : 1. Proportion de la population qui vit à une distance de moins de 5 km ou une heure de marche à pied d’une 2a. Inpatient admission rate (% of population) 2b. Outpatient contacts per capita 2c. PHC units and centres per 10,000 people 2d. Pourcentage des enfants < 1 ans complètement vaccines 2e Pourcentage des infrastructures de santé sans “out-of-stock” d’une sélection de médicaments essentiels à un moment spécifique ou pendant une période limitée 2f. Contraceptive prevalence rate 3. Monthly household health expenditure as a percentage of monthly total household expenditure (by income group, age-group and gender) 4a. Availability of national waiver or exemption schemes or social security net for paying user fees by poor people 4b. Availability of health insurance scheme / pre-payment scheme Pertinence des ressources Critères de jugement Adéquation (quantitative et qualitative) des ressources humaines, matérielles et financières fournies par la coopération belge par rapport aux ressources nationales/locales existantes, y compris celles des bailleurs de fonds
(La pertinence est vue dans le sens de) l’adéquation des ressources par rapport aux résultats planifiés et de la manière dont elles sont appropriées (adaptées) au contexte.
Modalités de vérification des critères
- Les ressources du (des) projet(s) sont raisonnables par rapports à celles dont disposent l’Etat, les usagers des services de santé, les cadres et les personnels de santé.
- Les ressources, y compris celles consacrées aux programmes de lutte contre les maladies, contribuent au développement des services de soins de santé
- Lors de la planification des projets et programmes, la complémentarité des ressources de la CB avec celle des autres intervenants a été prise en compte (définition du mixe de ressources)
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Comment a-t-on déterminé les ressources nécessaires ? X X X X Sont-elles (ont-elles été) suffisantes, insuffisantes ou excessives pour atteindre les résultats?
X X X X
La balance entre les investissements, les ressources humaines, le fonctionnement et la formation a-t-elle été estimée de façon adéquate?
X X X X
Les ressources étaient-elles complémentaires à celles de l’Etat et des autres bailleurs ?
X X X X
Les biens acquis avec les ressources étaient-ils de bonne qualité ?
X X X X
Quel est le coût annuel du (des) projet(s)/programme(s) par habitant ? Que représente-t-il par rapport aux ressources annuelles locales et nationales consacrées à la santé ?
X X X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 16
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Renforcement du système de santé Critères de jugement
- Les forces et les faiblesses du système de santé font l’objet d’analyses qui objectivent les situations avec des méthodes et des critères qui dépassent les impératifs locaux
- Les interventions renforcent le système de santé dans une perspective à long terme, dans ses mécanismes et ses processus
Modalités de vérification des critères
- Le renforcement des capacités fait l’objet de démarches inspirées d’autres expériences (dans le temps et dans l’espace)
- Le renforcement des capacités est formalisé - Les processus de développement du système de santé sont étudiés et les
pratiques sont comparées avec d’autres pratiques en cours dans le pays, les pratiques en cours au niveau international, et avec celles de la CB dans d’autres contextes.
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Par quels moyens concrets, selon quelles modalités et quelles méthodes le(s) projet(s) / programme(s) renforce(nt)-il(s) le système de santé ?
X X X X
Comment fait (font) concrètement le(s) projet(s) / programme(s) pour tenir compte de tous les acteurs du système formel (public, not for profit, for profit) ?
X X X X
Est-ce que le(s) programme(s) pourrai(en)t renforcer le système formel différemment, de manière plus efficace ?
X X X X
Comment le(s) programme(s) assure(nt)-il(s) le partenariat public privé ?
X X X X
Cohérence et complémentarité
La stratégie insiste sur une meilleure cohérence et une complémentarité accrue entre les différents acteurs de la coopération belges ainsi qu'avec les autres donateurs, en vue d'augmenter l'impact des interventions. Par ailleurs, elle s'aligne d'autre part sur les principales pistes de réflexion définies au niveau international
Critères de jugement
- Les actions d’un projet sont complémentaires entre elles et l’ensemble des actions d’un projet couvre de façon adéquate la problématique identifiée (cohérence interne des projets).
- La problématique identifiée et les actions programmées envisagent les soins de santé de manière globale et dans l’analyse de la globalité, les actions et les potentialités des autres acteurs de la CB dans le pays sont pris en compte (cohérence et complémentarité avec/entre les acteurs de la CB)
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 17
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
- La problématique identifiée et les actions programmées prennent en compte les actions et les potentialités des acteurs internationaux (cohérence et complémentarité avec les intervenants internationaux y compris l’UE).
- Les pistes de réflexion internationales concernant les fonctions du diagramme d’impact (voir annexe 1) sont prises en compte (voir aussi la question de la pertinence ; même analyse du diagramme d’impact).
- Les acteurs locaux et le niveau national sont pris en compte pour renforcer les complémentarités et les synergies
- Les expériences et les résultats des actions d’autres acteurs/intervenants sont pris en compte
Mode de vérification des critères
- L’ensemble des actions d’un projet recouvre la problématique étudiée, en
particulier dans les aspects peu ou mal couverts par les autres intervenants. - Les processus de recherche de complémentarité avec les autres acteurs CB et
les autres intervenants internationaux existent. - (Mesure dans laquelle) les actions autres de la CB et des autres intervenants sont
analysés : comparaison de ces analyses avec la « couverture » des fonctions reprises dans le diagramme d’impact (voir pertinence).
- Les synergies et complémentarités sont prises en compte de manière réaliste et faisable dans les documents de projet
- Il existe des éléments concrets de synergie et de complémentarité pour des actions en commun, des mises en commun d’expériences et des renforcements méthodologiques réciproques avec les acteurs locaux, les acteurs de la CB et les acteurs internationaux.
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quelles sont les positions qui ont été prises et les actions qui ont été menées pour améliorer la cohérence et la complémentarité des interventions des différents acteurs de la CB en santé ?
X X X X
Dans quelle mesure les procédures administratives et financières (belges) viennent-elles en appui à une meilleure cohérence et une meilleure complémentarité entre différents acteurs belges?
X X X
Comment la CB coordonne-t-elle ses actions pour que celles-ci soient complémentaires avec celles des autres bailleurs de fonds et avec celles des autres acteurs du secteur santé (mutuelles, organismes de financement des soins de santé, associations professionnelles, ONG’s, écoles paramédicales, facultés de médecine, programmes nationaux …)?
X X X X X
Comment le(s) programme(s) prend-il (prennent-ils) en compte et cherche(nt) la complémentarité ou la synergie avec les interventions locales d’autres secteurs pertinents pour la santé ?
X X X X
Comment le(s) programme(s) intègre-t-il (intègrent-ils) les éléments informels de soins locaux de santé (non traditionnels) existants ?
X X X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 18
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Réponse aux besoins de santé
« Il ne suffit pas de fournir des services de santé. Encore faut-il que les services soient façonnés pour répondre aux besoins de la population tels qu’ils sont techniquement définis et qu’ils coïncident davantage avec l’utilisation des soins de santé offerts. L’organisation des soins de santé primaire inclut le renforcement des capacités des communautés à mieux comprendre leurs besoins et à mieux les prioriser collectivement. Elle comprend aussi la collaboration avec des intervenants d’autres secteurs dans la région touchée. Dans ce sens, la demande n’est pas appréciée seulement en termes d’utilisateurs mais inclut également des autres acteurs de la communauté (leaders communautaires et politiques). »
Critères de jugement
- La détermination des besoins de santé se base sur des études d’ordre épidémiologique et sur des débats qui envisagent les actions et les techniques de soins en fonction des ressources disponibles
- L’approche technocratique de la définition des besoins est complétée par les aspects opérationnels (organisation et délivrance des soins au quotidien) dont les modalités sont définies en partenariat avec les communautés concernées (habitants, leaders, associations, groupements professionnels, …).
Modalités de vérification des critères
- Les documents de projet mentionnent les démarches qui ont été menées pour la définition du (des) projets
- Les démarches participatives sont formalisées, d’une part, et effectives, d’autre part.
- L’énoncé des contraintes à la réalisation de démarches réellement participatives est indispensable pour l’anticipation à la mise en évidence des travers dans lesquels la participation peut tomber
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quels sont les domaines dans lesquels le(s) programme(s) promeuvent la participation de la population ?
X X X X
Quels sont les « dispositifs », les approches et les méthodes utilisées pour assurer la promotion de la participation des différents groupes sociaux (usagers, leaders, …)?
X X X X
Quels sont les résultats formels de ces processus participatifs ?
X X X X
Quels sont les résultats effectifs de ces processus participatifs ?
X X X X
Quelles sont les principales contraintes pour la promotion des démarches participatives ?
X X X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 19
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Impact potentiel sur la santé
L’aspect d’impact est couvert sous la section « Références aux SSP contenus dans la Note stratégique » (voir liste d’indicateurs). Le paragraphe présent envisage l’impact du côté multisectoriel. En effet, si l’impact des soins de santé est considéré comme le résultat de l’offre des soins et de leur pertinence par rapport aux besoins réels des populations concernées, l’impact sur la santé (par exemple, diminution de la mortalité infantile ou autres indicateurs d’objectifs du millénaire pour le développement) ne peut se matérialiser que si une approche multisectorielle est utilisée (sécurité alimentaire, accès à l’eau et assainissement, formation, résolution des conflits, etc…).
Critères de jugement
- Une approche multisectorielle est nécessaire pour que les interventions aient un impact sur la santé
- Si l’impact sur la santé n’est pas toujours vérifiable dans les périodes couvertes par les projets et programmes, l’attention concrète pour une approche multisectorielle doit être présente
Modalités de vérification des critères
- Ouvertures que donnent les acteurs du système de santé aux acteurs des autres secteurs
- Souplesse du modèle organisationnel par rapport aux autres secteurs - Souplesse et réalisme du modèle organisationnel pour le devenir du système de
santé Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quel est l’effet du modèle organisationnel proposé pour l’organisation des soins de santé sur la complémentarité des actions avec les autres secteurs ?
X X X X X
Quels sont concrètement les éléments positifs du modèle d’organisation des soins proposé en tant que moteur du renforcement du système de santé ?
X X X X X
Dans le modèle d’organisation des soins proposé quels sont concrètement les éléments contre-productifs pour le renforcement du système de santé ?
X X X X X
7. Préoccupations transversales Durabilité
Les aspects essentiels de la durabilité (telles que présentés dans les TdR de l’évaluation) concernent le renforcement des capacités des individus et des institutions locales à tous les niveaux (Etat, élus locaux, ressources en santé, société civile, secteur privé). Le renforcement des capacités doit être pensé en fonction des défis actuels en termes de développement des politiques et du leadership.
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 20
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Les préoccupations de durabilité nécessitent la mobilisation et la gestion des ressources, l’organisation administrative et technique, ainsi que la mise en place de dispositifs autonomes de suivi-évaluation des systèmes de soins de santé. Le partenariat est une condition essentielle de la durabilité ; il tient compte de l’environnement politique, économique et socioculturel au niveau de la société civile, comprenant le secteur privé. En terme de partenariat, le transfert de connaissances techniques est nécessaire mais pas suffisant. Le financement durable du secteur et les perspectives durables à long terme pour les personnels de santé sont parmi les aspects clés de la démarche. L’autonomie des acteurs nationaux et locaux pour le développement et le suivi au quotidien des soins de santé doivent être une conséquence directe du renforcement de leurs capacités et contribuer aux adaptations des stratégies nationales de santé, et en particulier au renforcement systémique de l’organisation des soins de santé. Les interventions doivent mener au désengagement progressif (financier et technique) de la coopération belge ou vers des nouveaux instruments d’aide selon une programmation et un engagement financier concertés.
Critères de jugement
Une intervention est durable si - elle a été conçue selon un partenariat qui prend en compte les besoins et les
attentes des acteurs nationaux à tous les niveaux - elle renforce le système de soins de santé - elle tient compte des relais réalistes pour l’apport de ressources dans l’avenir - les acteurs nationaux et locaux sont autonomes pour assurer le développement
futur et le suivi des soins de santé. - elle est conçue de manière complémentaire aux autres actions de santé au
niveau national et local - elle s’appuie et valorise ses propres expériences et celles qui ont été
développées ailleurs ou dans le passé. Modalités de vérification des critères
- La durabilité fait réalistement partie de la conception du (des) projet(s) - La mesure dans laquelle les stratégies de financement des soins de santé
promues et soutenues s’inscrivent durablement de façon acceptable pour les usagers des services de santé et pour le système dans son ensemble
- La mesure dans laquelle les acteurs du (des) projet(s) sont impliqués dans la démarche qui vise la durabilité
- La mesure dans laquelle les acteurs nationaux et locaux peuvent assurer le développement futur et le suivi du système de soins de santé de manière autonome
- La mesure dans laquelle l’intervention est complémentaire à d’autres et valorise les expériences.
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 21
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Qui a participé à la conception du (des) programme(s) ? X X X X Comment chacune des personnes (chacun des acteurs) s’est-il impliqué dans les réunions, les analyses de terrain, la rédaction. A quelles occasions et pendant combien de temps ?
Quelle est l’analyse critique qui a été faite de la (des) politique(s) de santé nationale(s) ? (voir aussi Dév. Durable)
X X X X X
Que propose la CB comme appui ou comme réforme de la politique de santé ? A quel(s) niveau(x) ?
X X X X X
Quel impact a-t-on choisi d’avoir sur le renforcement du système de soins de santé ? Comment s’y prend-on ? Auprès de qui ?
X X X X X
Quels sont les résultats et quelles sont les contraintes des procédures, des actions et du plaidoyer pour le renforcement des services de santé de base ?
X X X X X
Quels sont les processus de développement des services de santé de base qui se sont installés de façon durable au cours des différentes phase du (des) projet(s) (ou de la phase en cours ou précédente si projet récent) ?
X X X X X
Quelle(s) stratégie(s) de financement des soins de santé a-t-on choisi ? Pourquoi ?
X X X X X
Quels sont les éléments du (des) programme(s) qui ont une action structurelle durable (et pertinente !) sur l’avenir des personnels de santé ?
X X X X X
Quelles sont les actions concrètes menées pour assurer l’autonomie des acteurs du développement des services de santé de base ainsi que celle des canaux de financement et des procédures de gestion ?
X X X X X
Quels sont les acteurs et les institutions (les services) qui réalisent au quotidien de façon autonome le développement des services de santé de base , (moyennant le cas échéant un appui léger ou à distance de la CB)?
X X X X X
Quelles sont les canaux de financement et les procédures de gestion des actions de développement des services de santé de base qui sont autonomes (y compris pour l’utilisation de l’aide extérieure, belge en particulier).
X X X X X
Quelles sont les possibilités de complémentarité des actions de la CB qui sont offertes ? Comment sont-elles valorisées ?
X X X X X
Quels sont les enseignement qui ont été tirés de l’expérience du (des) projet(s) ? Comment ont-il été valorisés et formalisés ? A qui et comment sont-ils transmis ?
X X X X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 22
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Les approches choisies pour la lutte contre les maladies transmissibles
Critères de jugement
- La prévention, le traitement et les soins des maladies liées aux infections transmissibles doivent être, dans la mesure du possible, intégrés dans les services de soins de santé primaires.
- Les moyens de contrôle disponibles doivent aussi renforcer la mise en place de structures de base, comme la formation et l'assurance de l'approvisionnement et de l'utilisation adéquate des médicaments et des moyens de diagnostic.
- La spécificité des infections et leur charge de morbidité particulière justifient un soutien prolongé aux programmes de santé (verticaux), à condition que ceux-ci soient bien adaptés aux services de soins de santé primaires et incluent la surveillance et le suivi indispensables
Modalités de vérification des critères
- La conception et l’ancrage institutionnel des appuis aux programmes de lutte contre les maladies transmissibles sont, dans chaque contexte, compatibles avec la contribution de ces programmes au renforcement des services de soins de santé
- La conception et les modalités opérationnelles des programmes de lutte contre les maladies transmissibles appuyés par la CB sont tournés vers l’intégration de ceux-ci au niveau des équipes polyvalentes des services de santé.
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quel est l’ancrage institutionnel du (des) programme(s) (des volets) de la CB dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles ?
X X X X X
Comment a-t-on envisagé l’intégration (versus la juxtaposition) du (des) programme(s) de lutte contre les maladies transmissibles dans les processus de développement des services de santé de base ?
X X X X X
Quelles sont les contraintes concrètes (institutionnelles, opérationnelles) à l’intégration ?
X X X X X
Quels sont les résultats positifs et les résultats moins encourageants des actions d’hygiène menées dans le cadre des programmes de lutte contre les maladies transmissibles ?
X X X X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 23
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Partenariats internationaux
Un des principes promus dans la Note stratégique est le partenariat dans la solidarité. Il y a plusieurs niveaux de partenariat à examiner dans l’évaluation thématique. Ils rejoignent les niveaux d’intervention promus par la coopération belge.
Critères de jugement
- Le partenariat international a pour but de promouvoir les axes stratégiques de la Belgique en matière de santé
- Les experts belges mis à disposition des organisations internationales sont les agents de la promotion des valeurs inscrites dans la Note stratégique
- Les actions/interventions des experts belges au niveau international sont suivies d’effets significatifs dans les politiques et stratégies des organisations.
- Modalités de vérification
- Les « chevaux de bataille » des experts belges mis à disposition des organisations internationales sont ceux de la Note stratégique
- Les modalités d’action des experts sont adéquates et pertinentes pour faire passer les messages
- Les textes des organisations internationales contiennent de manière significative des stratégies ou des recommandations qui vont dans le sens du développement des services de santé.
- Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Comment les experts belges sont ils mis en place dans les différents dispositifs internationaux multilatéraux (Famille UN, BM, CE), ou globaux (TRP du GFATM, etc.)
X
Quels sont les chevaux de bataille de l’expertise de la CB au niveau international ?
X X X
Quels sont les domaines, les actions, les stratégies que les experts de la CB ont pu faire inscrire dans les agendas internationaux ?
X X X
Quels sont les aspects de développement des services de santé de base que les experts de la CB ont pu faire inscrire dans les agendas internationaux ?
X X X
Comment les experts de la CB procèdent-ils pour valoriser leurs idées et leurs expériences au niveau international ?
X X X
Comment les experts de la CB affrontent-ils les points de vue globalisants et verticaux des approches internationales pour la lutte contre la pauvreté, les MDG, la santé reproductive ou les programmes du GFATM ?
X X X
Quelles sont les contraintes au niveau international pour la promotion de l’approche belge du développement des services de santé contenue dans la NS?
X X X
Comment les experts de la CB appuient-ils l’agenda d’harmonisation au niveau international ?
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 24
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Partenariats nationaux Critères de jugement
- Les procédures de cycle de projet contribuent à leur pertinence - Les procédures de cycle de projet peuvent être autonomes au niveau national et
local - La CB est un acteur significatif de la coordination des interventions dans le
secteur santé - La CB est un promoteur significatif de la capacité de ses différents partenaires
belges Modalités de vérification des critères
- Maîtrise des procédures par les acteurs nationaux et locaux - Pertinence des procédures pour la pertinence des projets - Contributions de la CB aux processus de coordination - Effets concrets des actions de coordination de la CB - Mécanisme de renforcement des capacités des partenaires belges
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Qui sont les membres des comités mixtes et comment les décisions/ les choix d’une nouvelle interventions sont-ils faits ? Quel est le cycle de décision pour les projets bilatéraux directs et indirects ?
X X
Quels sont les aspects des procédures d’identification et de formulation des projets et programmes qui sont les plus difficiles à maîtriser par les acteurs nationaux et locaux?
X X X X X
Quels sont les aspects des procédures de gestion, de monitorage et d’évaluation des projets et programmes (procurement, finances, …) qui sont les plus difficiles à maîtriser par les acteurs nationaux et locaux?
X X X X X
Quelles sont les procédures de définition, de gestion et de monitorage / évaluation des projets et programmes « belgocentrée » qui échappent à la gouvernance des partenaires nationaux ?
X X X X X
Quels sont les expériences positives (voire originales), les souhaits et les propositions concrètes pour améliorer la pertinence des projets/programmes et fluidifier les procédures ?
X X X X X
Quelles sont les actions de coordination auxquelles la CB participe ? A quel niveau ? En tant que quoi ?
X X X X X
Quels sont les résultats des actions de coordination auxquelles la CB participe, en particulier pour la cohérence des interventions et de la (des) politique(s) nationale(s) avec la NS (développement des services de santé) ?
X X X X X
Comment les experts de la CB (attachés, assistants techniques, cadres CTB, personnel ONG, …) appuient-ils l’agenda d’harmonisation au niveau national ?
X X X
En plus de financements, quels sont les supports de la CB à ses partenaires belges ?
X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 25
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Partenariat avec les communautés locales (niveau périphérique et local)
Les aspects de participation et de d’analyse / prise en compte des besoins locaux ont été abordés dans d’autres chapitres. Sont envisagés ici les aspects de décentralisation et les aspects multisectoriels, au niveau local, en complément de ce qui a été abordé sur l’impact.
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Comment a-t-on développé les actions multisectorielles au niveau local ?
X X X X
Quels sont les résultats en terme de santé des actions multisectorielles locales ?
X X X X
Quelles sont les instances de coordination locale concernées par les actions multisectorielles ?
X X X X
Quel est l’impact réel et quelle est l’autonomie des instances locales chargées de la coordination multisectorielle ?
X X X X
Quels sont les changements survenus dans l’organisation des soins de santé à l’occasion des processus de la décentralisation administrative et civile?
X X X X X
Quel est l’action des projets santé de la CB dans le domaine de la décentralisation ?
X X X X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 26
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge L’égalité des chances femmes / hommes
Les éléments important de la stratégie de la Belgique concernant l’approche genre, pour ce qui concerne la santé, sont repris dans l’annexe 5.
Critères de jugement
- L’analyse des inégalités entre les homes et les femmes en matière de santé et d’accès aux soins est présente dans les projets et programmes
- La CB a développé des approches progressives et à long terme pour améliorer la condition des femmes dans le domaine de la santé (approche intégrée)
- La CB développe des actions spécifiques au contexte pour affronter les problèmes d’inégalités entre les homes et les femmes dans le domaine de la santé (approche par discrimination positive)
- La CB intègre les préoccupations de genre dans ses actions de renforcement des capacités et de renforcement institutionnel
- La CB donne des appuis pertinents à la société civile pour le renforcement des associations et des groupements féminins
- La CB se préoccupe de promouvoir l’accès aux soins pour les femmes
Modalités de vérification des critères
- Toutes les étapes du cycle des projets contiennent une analyse, des actions et un suivi des problèmes de santé et de soins de santé liés aux inégalités des chances entre les femmes et les hommes
- Toutes les étapes du cycle des projets analysent de manière participative et prennent en compte les besoins spécifiques des femmes.
- La CB est active au niveau international pour ce qui concerne les problèmes de santé et de soins de santé liés aux inégalités des chances entre les femmes et les hommes.
- Les actions sur le terrain visent, par une approche intégrée, à développer les activités de santé reproductive, de maternité et les services pour les adolescentes.
- Sur le terrain, les acteurs des projets réalisent des analyses et les actions nécessaires pour lutter contre les violences faites aux femmes et leurs conséquences.
- Il existe des indicateurs qui permettent de suivre les actions qui visent à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes en matière de santé et qui visent à suivre les actions de santé spécifiquement tournées vers les femmes (santé reproductive et maternité à moindre risque en particulier, vulnérabilité face au VIH).
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Dans quelle mesure les documents de la CB (plans d’action santé; Note stratégique par pays; Note stratégique santé, manuels, guides, etc.) prennent-ils en compte les inégalités liées aux genres dans le domaine de la santé et les inégalités pour ce qui concerne les besoins de santé des femmes ?
X X X
Comment les femmes sont-elles impliquées dans la conception, la formulation, la gestion, le monitoring et l’évaluation des projets ?
X X X X
Comment la CB plaide-t-elle le « gender mainstreaming » et les droits de la femme aux foras internationaux ?
X X
Comment la CB plaide-t-elle le « gender mainstreaming » et les droits de la femme aux organisations internationales ?
X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 27
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Comment la CB assure-t-elle l’accessibilité des soins de santé aux femmes (et les femmes les plus démunies) ? Et plus spécifiquement pour les aspects de santé reproductive, soins obstétriques d’urgence, etc. (voir tableau OMS) ?
X X X X
Comment la CB assure-t-elle des soins de santé reproductive et sexuelle de qualité ?
X X X X
Comment la CB assure-t-elle des soins obstétricaux d’urgence de qualité ?
X X X X
Comment la CB assure-t-elle l’accès aux soins pour les adolescents (family planning, MST, ...)
x x x x
Les soins de santé ont-ils intégrés des stratégies de prévention, d’information et de traitement de la violence sexuelle
X x x x
Comment la formulation du projet tient-elle compte de l’égalité des chances et attribue les ressources nécessaires pour ce faire?
X X X X
Est-ce que les initiatives de playdoyer incluent les droits des femmes ? (Voir plus haut)
x X X X X
Quel est le résultat de l’analyse genre pendant la formulation de projet ?
x x x x
Est-ce que les indicateurs sexo-spécifiques de résultats indiquent des inégalités ?
x x X
Quels sont les indicateurs de monitorage qui visent l’égalité des chances ?
X X X
Est-ce que le projet inclut une stratégie spécifique de renforcement des capacités au niveau macro, meso, micro ?
x x x
Quelle est la perception des femmes du (des) projet(s) en cours ?
x x x
Indicateurs de base pour le suivi des actions: 1. Comprehensive gender analysis carried out 2. National health policy and strategies reflect main results of gender analysis 3a. Percentage of pregnant women receiving at least one prenatal visit 3b. Proportion of births attended by skilled personnel (MDG) 3c. Prevalence of modern contraception 3d. Maternal mortality ratio (MDG) 3e. Gender mix of MOH health staff dealing with reproductive health services 4. Other health status national indicators as per WHO draft list on gender & health
4a. Percentage girls / boys malnourished (e.g. under height for age) 4b. Percentage of boys / girls fully immunised by their first birthday (MDG) 4c. Male / female below 1 and 1 to 4 mortality rates 4d. Male / female healthy life expectancy at birth 4e. Male / female prevalence of HIV infection 15-24 years old (MDG like)
5. Resource allocation reflects gender-responsive budget analysis
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 28
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge La lutte contre le SIDA
Les éléments importants de la stratégie de la Belgique en matière de lutte contre le SIDA sont repris dans l’annexe 5.
Critères de jugement
- La CB est active dans la lutte contre le SIDA de manière cohérente et complémentaire au niveau international, au niveau des pays partenaires et au niveau de ses projets et programmes.
- Les actions de lutte contre le SIDA promues au niveau international par la CB et planifiées dans ses interventions sont conçues de manière intégrée aux systèmes de santé nationaux et contribuent à leur renforcement
- Les actions de lutte contre le SIDA de la CB prennent en compte de manière complémentaires aux autres initiatives/interventions l’ensemble des aspects actuels de la lutte à savoir : le dépistage volontaire, la prévention, les traitements, la prévention de la transmission mère-enfant et la lutte contre la discrimination/stigmatisation.
- La CB est active à tous les niveaux pour promouvoir l’accès aux traitements anti-rétroviraux
Modalités de vérification
- Analyses et programmation des activités de lutte contre le SIDA présentes dans les documents de stratégie et dans les documents de projets.
- Présence de la CB dans les fora internationaux et nationaux (pays partenaires) - Approche intégrée mise en œuvre dans les projets - Cohérence des approches entre les différents niveaux d’action de la CB, en
particulier dans les pays partenaires - Analyses et prises de décisions contextualisées de l’ensemble du dispositif
curatif, préventif et promotionnel en matière de lutte contre le SIDA
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Comment la prévention et le traitement du SIDA sont-ils intégrés dans les soins de santé, et plus spécifiquement dans les soins de santé reproductive et sexuelle, ainsi que dans la prise en charge des maladies chroniques ?
X X X X X
Comment les soins de santé de base intègrent-ils le dépistage volontaire et le traitement ?
X X X X
Comment les soins de santé de base intègrent-ils la promotion universelle de la prévention de la transmission de la mère à l’enfant
X x x x
Comment la CB assure-t-elle le développement de centres adaptés d’information et de soins pour les jeunes ?
X X X X
Comment la CB appuie-t-elle la lutte contre la discrimination et la stigmatisation ?
X X X X X
Comment la CB fait-elle la promotion de programmes spécifiques destinés à accroître de manière urgente les capacités en matière de traitement (infections opportunistes et antirétroviraux)
X X X X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 29
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quelle est la perception des partenaires nationaux et internationaux de la valeur ajoutée de l’appui belge dans le domaine du SIDA
x x X
Quel est le résultat concret de l’appui belge à l’innovation et la recherche dans le domaine du SIDA
X X X
Indicateurs : voir plus haut dans la liste des indicateurs
8. Préoccupations de développement issues de la note stratégique
(166) « La Belgique entend soutenir ses pays partenaires à ces quatre niveaux d’intervention [international, national des pays partenaires, périphérique / opérationnel, communauté locale] en favorisant le développement des capacités humaines et institutionnelles, en mettant à leur disposition les moyens financiers et matériels nécessaires comme les médicaments et l'infrastructure, en déployant des activités de plaidoyer et de sensibilisation et en finançant la recherche fondamentale et appliquée. Elle veillera d'autre part à tenir compte de l'impact sur la santé de l’ensemble des activités menées dans et avec le pays partenaire. »
Développement durable Critères de jugement La DGCD (ainsi que chaque projet) doit contribuer au développement durable du pays partenaire et doit veiller à réaliser celui-ci de manière efficace selon les principes suivants (227): 1- respecter et favoriser l’appropriation du plan de développement du pays partenaire; 2- limiter l'aide directe accordée aux gouvernements nationaux aux pays qui se sont dotés
d'une bonne gouvernance et cibler l'appui, dans les autres, sur les autorités locales faisant preuve d'une bonne gouvernance et sur la société civile;
3- inscrire, dans la mesure du possible, son action dans les approches sectorielles (SWAp); 4- accorder uniquement des aides déliées; 5- proportionner les appuis en fonction de la charge de morbidité et des capacités
financières locales; 6- trouver un équilibre entre les avantages de l'aide aux programmes de contrôle des
infections transmissibles et le renforcement du système de soins de santé primaires; 7- considérer les soins de santé comme un des maillons de la santé et assurer une
complémentarité avec les interventions dans d’autres secteurs favorisant autant la santé; 8- intégrer systématiquement le suivi, la surveillance, l'évaluation et les enseignements tirés
de nos interventions; 9- mener une politique étrangère cohérente en matière de santé.
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 30
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Mode de vérification des critères 1- Le(s) objectifs des projet(s) et programme(s) sont issus des plans de développement
national. 2- Une analyse de la gouvernance fait partie des processus d’élaboration des projets. 3- L’approche sectorielle (SWAP) est systématiquement envisagée à la mesure du
développement de cette stratégie dans le pays. 4- La question de l’aide déliée est traitée 5- Les pays les plus pauvres et ayant des problèmes de santé majeurs bénéficient des
appuis les plus importants 6- L’aide aux programmes de contrôle des maladies apporte des contenus techniques et
des ressources intégrées aux ressources générales du système de santé. 7- Les projets et programmes sont multisectoriels et/ou plaident pour une approche santé
dans les autres secteurs (« health promotion framework ») 8- les projets sont suivis, évalués et les enseignements sont pris en compte 9- La politique étrangère belge propose en priorité le développement des services de santé
de base. Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
L’action de la CB fait-elle partie intégrante du plan de développement national ? Si non, dans quelle mesure (i) reflète-t-elle ou est-elle en ligne avec les priorités du plan de développement (PRSP ; politique de santé ; plan sectoriel de santé ; MTEF), (ii) permet-elle d’améliorer l’efficacité et/ou l’efficience des politiques locales?
X X X X
Quel regard critique a été posé sur le plan de développement national ? Sur la politique de santé ? Exemple(s).
X X X X
Comment la question de la gouvernance a-t-elle été traitée ?
X X X X
Comment la CB implique-t-elle ses différents acteurs dans le développement de l’approche sectorielle santé existante, néant?(peu existante) ou non existante?
X X X X
Comment la CB appuie-t-elle le MS dans son rôle de coordinateur?
X X X X
Comment la CB agit-elle au plan national pour appuyer la coordination entre les acteurs du secteur santé: bailleurs de fonds, société civile, … La CB est-elle chef de file ? Participe à des fora nationaux ? Assure le secrétariat de la coordination ? Organise des échanges ou des study tours ? Autre?
X X X X
Dans quelle mesure l’aide est partiellement ou totalement déliée?
X X
Comment a-t-on pris en compte la charge de morbidité et les capacités financières nationales et locales ?
X X
Quels sont les éléments qui montrent que l’on a envisagé les appuis aux programmes de lutte contre les maladies transmissibles comme une contribution au renforcement du système de soins de santé ?
X X X X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 31
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Comment les appuis de la CB au(x) système(s) de soins de santé sont-ils complémentaires avec les appuis aux autres secteurs pour assurer une approche globale de promotion de la santé ?
X X X X X
Quels sont les systèmes de suivi, de surveillance et d’évaluation utilisés ?
X X X X X
Quels sont les mécanismes et les éléments qui montrent que l’on a pris en compte les leçons des expériences antérieures, les expériences issues des autres contextes et le savoir-faire du secteur ?
X X X X X
Existe t’il un mécanisme par lequel la CB a partagé les enseignements tirés de la mise en œuvre de ses projets avec l’ensemble de ses partenaires
X X X X X
Quels sont les exemples que les expériences et connaissances ont été traduites dans la politique nationale?
X X
Dans quelle mesure l’appui de la CB a été adapté (par ex. après la formulation) pour mieux prendre en compte certaines contraintes ou opportunités non envisagées au moment de la formulation (flexibilité de la mise en œuvre du programme)
X X X X X
En quoi et comment la CB a-t-elle influencé la politique étrangère belge ?
X X
Méthodes et stratégies opérationnelles La CB doit intervenir en utilisant des approches et des méthodes actualisées, qui ont fait leurs preuves et qui sont reconnues au niveau international (« evidence-based »). C’est le cas par exemple pour des protocoles de traitements, des techniques médico-chirurgicales ou pédiatriques, des modèles de gestion (hospitalière en particulier) ou des stratégies de financement. En marge des méthodes de prestation de services sanitaires ou de gestion proprement dites, il est important que les acteurs maîtrisent les savoirs faire nécessaires à leur mise en œuvre et leur usage, ce qui relève de stratégies d’implantation, relevant du changement social. L’actualisation et les performances des stratégies et méthodes concernent ainsi également les approches développées, par exemple, pour le renforcement institutionnel, le renforcement des capacités, la pédagogie, l’encadrement ou le questionnement socio-anthropologique. Critères de jugement
- Le choix des stratégies et méthodes utilisées dans le(s) projet(s) et programme(s) sont explicités et motivés.
- Un mécanisme existe permettant de vérifier si les fondements méthodologiques des interventions sont adéquats lors de l’instruction des projets
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 32
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Mode de vérification des critères
- Les documents de projet comportent un chapitre de stratégies et méthodes - L’explicitation des stratégies et méthodes couvre les « focus » importants du
projet - Il existe des références nationales et/ou internationales pour les stratégies et
méthodes choisies Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quels ont été les modes opératoires, les stratégies opérationnelles qui ont été choisies ?
X X X
Sur quelles bases et par qui les modes opératoires ont-ils été choisis ?
X X X
Existe t’il un mécanisme transparent d’assurance que les méthodologies sont adéquates (Directives aux soumissionnaires de projets dans les appels à projets, sélection des panels d’évaluateurs, grilles d’évaluation des projets, etc.)
x X x x x
Quelles sont les stratégies et méthodes innovantes introduites par le(s) projet(s) ?
X X X X
Renforcement des capacités
(167) « Renforcement des capacités: La coopération belge privilégie l'amélioration des capacités du personnel. Pour ce faire, il convient d’établir la description des tâches précises et adéquates, de conférer aux ressources humaines nationales un degré d'autonomie approprié et de les responsabiliser davantage. »
Critères de jugement
- mise à disposition d’expertise à forte valeur ajoutée en termes de développement et de transfert de compétences
- organisation et/ou soutien de la formation initiale et de la formation continue - facilitation de l'accès à l'information - appui aux échanges d'expériences et d'expertises Nord-Sud et Sud-Sud - appui novateur aux descriptions de tâches - support à l’encadrement du personnel - préservation des temps de travail cliniques des personnels - Prise en compte de la dimension de motivation des personnels bénéficiaires, de
son niveau en comparaison avec le reste du système, et du devenir du système de motivation, en particulier en fin de projet.
- Rôle de la recherche dans le renforcement des capacités
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 33
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Mode de vérification des critères
- présence dans les documents de projets d’analyses des problématiques professionnelles et sociales des personnels de santé et des cadres.
- des actions sont programmées pour apporter des solutions aux problématiques identifiées (en complémentarité avec les autres acteurs/intervenants).
- La ressource d’expertise est utilisée de façon cohérente avec le type de problématique (ex. long terme : transfert de compétence, de culture d’organisation, court terme : solution de problèmes techniques ponctuels, etc.)
- les experts mis à disposition ont l’expérience des stratégies/modalités du transfert de compétences.
- Existence de mécanismes d’échange (voyages d’études, Change agents, etc.) - Des chercheurs et/ou des praticiens des pays bénéficiaires sont impliqués dans
des actions de recherche Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quelles sont les analyses qui ont été conduites auprès des personnels de santé et des cadres avant les interventions et au cours de celles-ci d’un point de vue managérial, social et professionnel ?
X X X X X
Quelles sont, les recherches qui ont été conduites en réponse aux constats concernant les ressources humaines ?
X X X X X
Quelles ont été les interventions ou volets d’intervention ciblées sur le développement des capacités humaines et institutionnelles ? Quelle en est la pertinence ?
X X X X
Quels sont les résultats de ces interventions/actions de développement des capacités humaines et institutionnelles ?
X X X X
A quel niveau et dans quelle(s) fonction(s) l’assistance technique travaille-t-elle ?
X X X X X
Quel type d’assistance technique est mobilisé (gestionnaire, prestataire, national/international), à quel terme, et sur quelles missions ?
X X X X
Quelles sont les modalités prévues pour assurer le transfert des compétences des assistants techniques aux partenaires nationaux ?
X X x X X
Quel est la valeur ajoutée de l’AT perçue par le partenaire local ?
x x x x
Quels sont les dispositifs de motivation utilisés, comment se situent-ils par rapport à la situation des bénéficiaires directs (systèmes) et ultimes (usagers des services).
X
L’impact des dispositifs de motivation a t’il été analysé, pour le cours de l’action et après l’action
X X X X X
Quel est le rôle donné aux pays dans les actions de recherche ?
X X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 34
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Stratégies de financement
(168) « Moyens financiers. Comme ce sont surtout les pays les plus démunis qui manquent des moyens financiers nécessaires au secteur de la santé, la Belgique accroîtra ses investissements dans ce secteur, par l'augmentation de son aide bilatérale et multilatérale et de sa contribution financière au GFATM. Elle aidera dans le même temps ses pays partenaires à accroître leurs propres sources de financement, en améliorant entre autres la gestion des moyens budgétaires. Une des pistes envisagées sur ce plan consiste à développer et/ou à soutenir des systèmes d'assurance maladie appropriés au niveau national, régional ou local communautaire. De tels systèmes peuvent être intégrés ou non aux systèmes de micro-crédits existants. Voir aussi (86). »
Critères de jugement
- Les projets et programmes procèdent à des analyses critiques des systèmes de financement des soins de santé en terme d’équité et de réalisme par rapport aux ressources de l’Etat et des individus.
- Les acteurs des projets et programmes sont expérimentés et/ou proactifs dans le domaine du financement des soins de santé.
- La CB promeut des stratégies de financement « pro-pauvres ». - La CB promeut des stratégies de financement alternatifs au paiement à l’acte
(user fees), par exemple pre-payment schemes, fonds tiers-payant, assurance maladie…
- La CB appuie et contribue à une réflexion sur le financement des services pour lesquels la gratuité est requise
Modalités de vérification des critères
- Les documents de projets contiennent des analyses des systèmes de financement
- La CB offre à ses acteurs un cadre de réflexion dynamique sur les stratégies de financement
- Les acteurs de la CB mènent une réflexion actualisée sur les stratégies de financement des soins de santé
- La CB prend positions dans les débats nationaux et internationaux pour des stratégies de financement innovantes et pro-pauvres.
- Les projets et programmes comportent des chapitres qui formalisent des actions sur les stratégies de financement dans un sens novateur et pro-pauvre.
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quelles analyses et réflexions ont été menées concernant le financement du secteur des soins de santé ? Quels en ont été les résultats ?
X X X X X
Quelle(s) stratégie(s) de financement des soins de santé ont été promues ou renforcées ?
X X X X X
Quelles stratégies de gestion financières ont été appuyées aux différents niveaux?
X X X X X
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 35
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Est-ce que la CB prend position vis-à-vis du débat (inter)national et/ou local concernant le paiement par les usagers et la protection financière des pauvres ? Si oui, sur quelles bases et de quelle manière vis à vis des acteurs belges ?
X X X X X
Quels sont les mécanismes prévus et les mécanismes mis en place dans le(s) projet(s) pour assurer l’accès aux soins des personnes démunies ? Quels aspects de solidarités promeuvent-ils ?
X X X X
Quels sont les résultats et la durabilité des mécanismes mis en place pour assurer l’accès aux soins pour les personnes démunies ?
X X X X
Actions de plaidoyer
(169) « Stratégies de plaidoyer ». La Belgique continuera à plaider en faveur :
des droits en matière de reproduction pour les individus et les couples, en ce compris les adolescents;
d'une politique de promotion de la santé comme droit humain et comme moyen de lutte contre la pauvreté, en participant et en accordant un appui aux législations, réglementations et conventions appropriées;
des droits de la femme et de son rôle spécifique dans la société;
des droits des personnes contaminées par le VIH. »
« Compte tenu de l'importance de l'information et de la communication pour la promotion d'une vie saine, le dépistage précoce des maladies et un meilleur suivi des traitements médicaux, les initiatives dans ces domaines bénéficieront d'une attention spéciale. »
Critères de jugement
- La CB mène des actions de plaidoyer structurées, suivies et formalisées (versus des actions uniquement dues aux personnes de la CB individuellement selon leurs préoccupations personnelles).
- La CB mène un plaidoyer spécifique dans le domaine de la santé de la reproduction, du VIH/SIDA et l’accès aux soins pour les femmes.
- Les actions de plaidoyer de la CB sont traduites en procédures ou en textes législatifs.
- Les plaidoyers de la CB sont traduits en actions dans les projets qu’elle appuie - Les moyens engagés par la CB sont cohérents avec ses plaidoyers
Modalités de vérification des critères
- Existence de documents qui formalisent les actions de plaidoyer - Plaidoyer spécifique femmes, SIDA, santé de la reproduction - Textes produits suite au plaidoyer(s) de la CB - Cohérence des thématiques des actions avec les plaidoyers
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 36
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quelles sont les actions de plaidoyer qui sont menées ? X X X X X Quels plaidoyers sont pris en compte dans la Note stratégique du pays et dans le plan d’action santé?
X X X
Comment les plaidoyers de la CB contribuent-ils concrètement à la lutte contre la pauvreté ?
X X X X X
Quel sont les supports formalisés (documents, vidéo, …) des plaidoyers et de leurs résultats
X X X X X
Comment les projets eux-mêmes intègrent-ils les plaidoyers et de quelle manière la CB assure t’elle l’intégration de ses plaidoyers à l’action
X X X X
Plan d’action par pays Critères de jugement La CB propose de diviser en périodes de 4 ans le délai imparti par la communauté internationale pour réaliser les objectifs du Millénaire (2015). Pendant la première période 2003 - 2006, l'approbation de la Note stratégique doit être suivie de l'élaboration, par pays, d'un plan d'action relatif à la santé et ce en concertation avec les services géographiques de la DGCD et l'attaché de la coopération sur place. Celui-ci doit faire l'objet d'une évaluation tous les 2 à 3 ans, être établi à la fin de chaque période de quatre ans pour la suivante et tenir compte des éventuelles actualisations de la stratégie. Mode de vérification des critères
- Les plans d’action relatifs à la santé de la CB existent - Les plans d’action de la CB sont systématiquement pris en compte lors de la
définition des projets et programmes - Les plans d’actions de la CB contribuent aux axes principaux de la politique
nationale de santé et de la politique nationale de lutte contre la pauvreté. Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Existe-t-il un plan d’action relatif à la santé 2003-2006 ? X Existe-t-il des plans d’action relatifs à la santé 2003-2006 pour chacun des 18 pays partenaires ?
X
Quelle est la pertinence opérationnelle de ce (ces) plan(s) ? Quel en est l’usage ?
X X X
Comment la CB assure-t-elle la complémentarité entre différents acteurs dans le domaine de la santé, si le plan d’action sectoriel n’existe pas ?
X X X
La recherche
169 « La recherche scientifique, aussi bien fondamentale qu'opérationnelle, doit venir en appui à l'approche stratégique. La recherche internationale sur les vaccins, les médicaments et les moyens de diagnostic pour les maladies qui touchent essentiellement les pauvres et qui n'intéressent pas l'industrie à but
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 37
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
lucratif, doit être encouragée et soutenue. Mais la recherche locale portant sur des méthodes de traitement efficaces, la résistance aux médicaments, les plantes utilisées en médecine traditionnelle, les modèles de soins de santé primaires et les systèmes d'assurance maladie socio-économiquement et culturellement appropriés, demeure tout aussi importante. Cette recherche s'inscrit dans le renforcement des capacités locales. »
Critères de jugement
- La recherche est développée dans une mesure appréciable par la CB (% des financements de projets à Objectif spécifique de recherche, de projets dont un résultat à atteindre est celui d’une recherche(-action))
- La recherche prend en compte le questionnement du terrain - Le terrain se pose des questions - Les questions du terrain bénéficient des relais nécessaires pour pouvoir être
adressées à la recherche - Les résultats de la recherche contribuent à l’amélioration de soins de santé, en
particulier pour les personnes démunies. Modalités de vérification des critères
- Contenus, ressources, acteurs de la recherche financée par la CB - Circuits d’information terrain recherche et recherche terrain. - Liste des interventions ou stratégies dont la conception est issue de la recherche.
Questions INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quels projets de recherche sont menés / financés ? X X X X X Quels projets incluent un volet de recherche(-action) X X X X X A quel(s) besoin(s) (inter)nationaux et/ou locaux répond(ent) le(s) projet(s) de recherche ? Le(s) besoin(s) a (ont) été identifiés par qui ?
X X X X X
Comment la CB valorise t’elle les recherches qu’elle finance ?
X X X X X
Quel est l’impact concret de la (des) recherche(s) sur le système de santé ?
X X X X X
Fonds Global Lors des réunions préparatoires du GFATM, la Belgique a entre autres plaidé en faveur de:
- la participation à part entière des pays en développement et des organisations civiles aux organes de gestion et de conseil et à la prise de décision au sein du Fonds;
- la prudence à l’égard de la création d'une nouvelle grande organisation: le Fonds devrait tabler d’abord sur les mécanismes et structures existants et entre autres sur l'expertise de l'ONUSIDA et de l'OMS;
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 38
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
- l'importance d'une approche coordonnée et intégrée des trois maladies au niveau des pays: il faut veiller à ne soutenir, par pays, qu'un seul programme qui assure un bon équilibre entre les mesures préventives, curatives et sociales;
- un accès facilité des ONG et des organisations civiles aux moyens du Fonds; - le principe de la récompense des bons résultats; - l'utilisation du Fonds en vue du renforcement du système global de santé; - la possibilité de financer l'achat de médicaments antirétroviraux
INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Dans quelle mesure ces aspects ont-ils été pris en compte par le GFATM ? (1, 2, 3, 4, 5, 6)
X X
Dans quelle mesure ces aspects sont-ils pris en compte au niveau du pays ? (3, 4, 5, 6)
X X
Quels facteurs peuvent être invoqués pour les aspects pas ou peu repris par le GFATM ?
X X X
9. Annexes : Supports méthodologiques Annexe 1. Diagramme d’impact du secteur santé Le diagramme d’impact résume les fonctions essentielles du pouvoir public et les aspects essentiels du secteur de la santé (ainsi que des secteurs liés à la santé) qui, s’ils sont mis en place et exécutés correctement mènent aux objectifs prioritaires d’amélioration de la santé et de réduction de la pauvreté. Le diagramme intègre également les deux autres objectifs de « protection financière » et de « réponse aux attentes non médicales des populations » définis par l’OMS. Pour l’analyse d’une intervention, d’une stratégie par pays ou de la stratégie globale de la CB, des tableaux permettent d’utiliser le diagramme de manière opérationnelle.
Ce diagramme est utilisé pour
démontrer sur quels aspects une intervention se concentre indiquer les aspects complémentaires à une intervention qui sont pris en charge par
l’Etat, par d’autres intervenants et/ou non pris en charge ; indiquer les aspects insuffisamment couverts et qui peuvent éventuellement
influencer le degré de performance d’une intervention ; indiquer le focus (et éventuellement les faiblesses) de l’appui belge au secteur santé
national ; indiquer les points forts et les points faibles de l’appui belge au secteur santé de
manière globale.
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 39
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Rôle et fonctions du Gouvernement proprement établies dans le secteur santé
Pauvreté réduite e t éventuellement éradiquée
Croissance économique et développement socia l amélioré
Soins de santé essentiels offer ts ou contractés en fonction des besoins
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la socié té civile, les partenaires et organisations locale étab li
Outputs Impact intermédiaireRésul tats
Développement durable
Éta t de santé et qualitéde vie améliorés, particulièrement pour les pauvres
Groupes vulnérables protégés de la pauvreté
Ressources humaines compétentes e t motivées en place
Access aux médicaments essentiels e t approvisionnement assuré
Les soins de santéessentie ls sont abordables et durables
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration e ffective entre les secteurs public e t privés
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Usagers sensibilisés aux aspects de compor tement sain
Le financement de la santéest e fficace
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
Politique d’ in for mation e t système d’information é tablis
Diagramme d’Impact – secteur santé
La performance des soins de santé améliorée
Législa tion et fonctions régulatrices étab lies
Soins de santé essentiels définis et disponibles
Les stratégies liées à la santé dans les autres secteurs bien é tablies
Stra tégies de financement de la santé établies
Participation du parlement, société civile, par tenaires e t communautés locales assurée
Secteur Pharmaceutique réguléet organisé
La contr ibution financière individuelle pour la santé est juste
Le know-how et les attitudes de santé des communautés, des familles e t des individus améliorés
Les individus utilisent « correctement » les services de santé
Les communautés, les familles et les individus changent leur style de vie et leurs pratiques de santé
Politique nationale e t stratégies du Service Publique établies
Le cadre «global» de la promotion de la santé bien établi et institutionnalisé
Politique nationale e t stratég ies de financement établies
Cadre Institutionnel pour la planifica tion stra tégique établie
Allocation des ressour ces améliorée
Pouvoir de décision et de gestion décentralisé au niveau approprié
Le financement de la santéest équ itable e t juste
Autres Politiques Gouvernementales qui influencent le secteur de la santé
Environnement sain et sauf ?? assuré
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés
Système d’encouragement à la performance en place
Impact global
Information basée sur l’évidence u tilisée pour l’améliora tion de l’o ffre des services
Politique et stratégies environnementales é tablies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
Politique et stratégies de l’éducation é tablies
Politique et stratégies d’eau et hygiène é tab lies
Politique et stratégies de nutrition é tablies
Politique et stratégies de population é tablies
Infrastructure de base en p lace (réseau de routes, communication, réseau d’électr icité, moyens de transpor t, e tc.)
Les risques financières liées à la santé réduites
Environnement pour u tilisa tion efficiente des ressources é tab li
Autres influences
Autres influences
Politique et stratégies de sécurité routière é tablies
Environnement hab ilitant pour un compor tement sain ?? en place
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 40
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Tableaux à remplir concernant le diagramme d’impact
Fonctions essentielles du secteur public appuyées
Projet Tous projets belges
Autres intervenants
Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
Législation et fonctionrégulatrices établies
s
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Allocation des ressources améliorée
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
Politique d’information et système d’information établis
Stratégies de financement de la santé établies
Tableau 1
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 41
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Fonctions essentielles du secteur public appuyées
Projet Projets belges Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
Législation et fonctions régulatrices établies
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Allocation des ressources améliorée
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
Politique d’information et système d’information établis
Stratégies de financement de la santé établies
Tableau 2
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 42
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Fonctions essentielles du secteur public généralement faiblement prises en charge dans le secteur santé
Oui / non Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
Législation et fonctions régulatrices établies
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Allocation des ressources améliorée
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
Politique d’information et système d’information établis
Stratégies de financement de la santé établies
Tableau 3
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 43
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Résultats sectoriels : focus principal de l’appui du projet Projet Projets belges
Commentaires
Soins de santé essentiels définis et disponibles
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre le secteur public et les secteurs privés
Ressources humaines compétentes et motivées en place
Pouvoir de décision et de gestion, décentralisé au niveau approprié
Système d’encouragement à la performance en place
Accès aux médicaments essentiels et approvisionnement assurés
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins
Participation du parlement, de la société civile, des partenaires et des communautés locales assurée
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés
Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services
Le financement de la santé est efficace
Le financement de la santé est équitable et juste
Tableau 4
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 44
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Résultats sectoriels faibles ou problématiques Oui / non Commentaires
Soins de santé essentiels définis et disponibles
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre le secteur public et les secteurs privés
Ressources humaines compétentes et motivées en place
Pouvoir de décision et de gestion, décentralisé au niveau approprié
Système d’encouragement à la performance en place
Accès aux médicaments essentiels et approvisionnement assurés
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins
Participation du parlement, de la société civile, des partenaires et des communautés locales assurée
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés
Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services
Le financement de la santé est efficace
Le financement de la santé est équitable et juste
Tableau 5
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 45
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Autres secteurs appuyés Projet Tous projets belges
Autres intervenants
Commentaires
Politique et stratégies de population établies
Politique et stratégies de nutrition établies
Politique et stratégies d’eau et hygiène établies
Politique et stratégies de l’éducation établies
Politique et stratégies environnementales établies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
Politique et stratégies de sécurité routière établies
Environnement favorisant un comportement sain en place
Tableau 6
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 46
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Autres secteurs faibles concernant les actions liées à la santé Oui /non Commentaires
Politique et stratégies de population établies Politique et stratégies de nutrition établies Politique et stratégies d’eau et hygiène établies Politique et stratégies de l’éducation établies Politique et stratégies environnementales établies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
Politique et stratégies de sécurité routière établies Environnement favorisant un comportement sain en place
Tableau 7
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 47
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Annexe 2. Liste d’interventions de santé d’impact potentiel important sur la santé Table 1: Health services with a large potential impact on health outcomes
Examples of interventions Main contents of interventions Treatment of Tuberculosis Directly observed treatment schedule (DOTS):
administration of standardized short-course chemotherapy to all confirmed sputum smear positive cases of TB under supervision in the initial (2-3 months) phase
Maternal health and safe motherhood interventions
Family planning, prenatal and delivery care, clean and safe delivery by trained birth attendant, postpartum care, and essential obstetric care for high risk pregnancies and complications
Family planning Information and education; availability and correct use of contraceptives
School health interventions Health education and nutrition interventions, including anti-helminthes treatment, micronutrient supplementation and school meals
Integrated management childhood illness
Case management of acute respiratory infections, diarrhea, malaria, measles and malnutrition; immunization, feeding / breakfeeding counseling, micronutrient and iron supplementation, anti-helminthes treatment
HIV/AIDS prevention Targeted information for sex workers, mass education awareness, counseling, screening, mass treatment for sexually transmitted diseases, safe blood supply
Treatment of sexually transmitted diseases
Case management using syndrome diagnosis and standard treatment algorithm
Immunization (EPI Plus) BCG at birth; OPV at birth 6, 10, 14 weeks; DT at birth 6, 10, 14 weeks; HepB at birth, 6 and 9 months (optional); measles at 9 months; TT for women of child-bearing age
Malaria Case management (early assessment and prompt treatment) and selected preventive measures (e.g. impregnated bed nets)
Tobacco control Tobacco tax, information, nicotine replacement, legal action
Non communicable diseases and injuries
Selected early screening and secondary prevention
Source: WHO, World Development Report 2000
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 48
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 3. Classification des projets et programmes selon la note stratégique
L’approche stratégique de la Note Stratégique vise une priorité (« soins de santé primaires »), trois accents (soins de santé reproductive ; lutte contre la VIH/SIDA ; le paludisme, la tuberculose et les maladies négligées) et quatre niveaux (international, national des pays partenaires, niveau périphérique, communautés locales). L’outil issu de la Note stratégique pour réaliser la typologie des projets (pour l’étude de bureau et étude sur le terrain) est présenté dans les pages suivantes. INT BXL NAT ACT
EUR LOC
Quel est le focus prépondérant du projet (Objectif spécifique ou % majoritaire des résultats à atteindre) (cochez la matrice stratégique ci-dessous)
X X X X X
Quel est le focus prépondérant du projet sortant de la matrice stratégique)
X X X X X
Résumez les interventions principales du projet utilisant la matrice en annexe 3
X
SSP en général SS reproductive VIH/SIDA Maladies
transmissibles International National Système de soins SSP
Communauté Si le projet ou le programme ne peut pas être classifié selon la matrice ci-dessus, décrivez le :
a) le niveau d’intervention : .................................................................................. b) le focus du projet / programme : ......................................................................
Pour les programmes quinquennaux, indiquez le focus (foci) majeur(s) du programme : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 49
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Matrice : Les Soins de Santé Primaires : trois accents et quatre niveaux
Graphique 10 Matrice : Les soins de santé primaires: trois accents et quatre niveaux
LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES (SSP)
SOINS DE SANTE REPRODUCTIVE
LUTTE CONTRE LE VIH/
LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES
TB -PALUDISME- Maladies négligées
NIV
EAU
INTE
RN
ATI
ON
AL Politique
reconnaissance du droit aux soins reconnaissance que les services de santé sont essentiels à la lutte contre les maladies épidémiologie surveillance des indicateurs de santé coordination des donateurs
Solidarité financière Fonds internationaux pour des moyens accrus pour les services de santé
R&D recherche sur les médicaments essentiels recherche sur les formes d'assurance maladie et les modèles de soins de santé primaires renforcement des capacités par l'information internationale mise en réseau internationale, experts, décideurs politiques, société civile
Actions régionales (coopération entre pays) forums
idem SSP + plaidoyer santé et droits reproductifs idem SSP idem SSP idem SSP
idem SSP + reconnaissance de la lutte contre le VIH/ comme bien public global VIH/ sur les forums politiques internationaux surveillance supranationale idem SSP idem SSP + recherche sur les vaccins, les médicaments, les traitements idem SSP + + mise en réseau + IPAA
idem SSP + reconnaissance de la lutte contre les maladies transmissibles comme bien public global système de surveillance supranational TB-paludisme-maladie du sommeil à l'ordre du jour international Roll Back Malaria: Faire reculer le paludisme et Stop TB OCP (onchocercose)
idem SSP idem SSP + recherche sur les vaccins, les sets de diagnostic, les médicaments mise en réseau internationale idem SSP + + mise en réseau + approche régionale lutte
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 50
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
POU
VO
IRS
PUB
LIC
S Politique appui à la politique, à la planification… SWAp renforcement des capacités suivi épidémiologique
Budget aide budgétaire SWAp partenariat public-privé
Politique autres secteurs appui enseignement, environnement, sécurité alimentaire
idem SSP + plaidoyer : droits des femmes et adolescents santé et droits reproductifs idem SSP moyens suffisants idem SSP + enseignement filles, intégration éducation sexuelle dans les curricula scolaires
idem SSP + priorité VIH/ collaboration interministérielle droits VIH+ personnes idem SSP moyens suffisants idem SSP + coordination différents secteurs politique VIH/ dans tous les secteurs politique en matière d'orphelins (du )
idem SSP + sensibilisation population contrôle, prévention, traitements accessibles aux pauvres développement des capacités nationales système d'information et de surveillance national idem SSP moyens suffisants idem SSP + enseignement,
environnement
SYST
EME
DE
SOIN
S D
E SA
NTE
PR
IMA
IRES
Organisation organisation et prise de décision
décentralisées organisation pyramidale
Services de soins de santé primaires moyens humains (formation, perfectionnement, motivation) médicaments, moyens de diagnostic (e.a. laboratoires), produits de consommation infrastructure meilleure qualité des soins promotion de la santé attention spéciale aux femmes, aux enfants attention spéciale aux pauvres collaboration services publics et privés contrôle MST; soins aux mères; soins aux nourrissons; attention portée à la violence à l'égard des femmes; adaptation des services de santé aux besoins reproductifs de groupes cibles comme les jeunes; optimisation de la communication
Financement mécanismes de solidarité contre l'exclusion des pauvres
+ distribution et utilisation efficaces contraceptifs, + planification familiale
Programme national: information, établissement d'instructions, suivi idem SSP + prévention VIH/SIDA tests prévention transmission mère-enfant traitement ART si possible soins palliatifs, soins à domicile renforcement personnel idem SSP
Programmes nationaux: surveillance, information, suivi idem SSP + prévention, contrôle, dépistage, traitement application à grande échelle de tests diagnostics pour la maladie du sommeil renforcement accessibilité suivi moustiquaires imprégnés (paludisme) surveillance locale
idem SSP
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 51
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
CO
MM
UN
AU
TES Sensibilisation
(IEC, changement habitudes insalubres, droits, environnement) meilleure utilisation services
Organisations locales développement capital social plus grande participation soins de santé primaires eau, installations sanitaires, alimentation
augmentation revenu répartition revenus dans la famille (droits mère) crédits participation assurance maladie
idem SSP + pratiques sexuelles contre la mutilation féminine droits des femmes planification familiale idem SSP + organisations de femmes clubs de jeunes (activités adolescents & rapports sexuels) idem SSP
idem SSP + renforcement VIH+personnes anti-discrimination IEC: utilisation préservatifs, prévention SIDA, promotion, utilisation services de santé, transmission mère-enfant, aliments pour bébés …. idem SSP + organisations orphelins organisations VIH+ personnes clubs de jeunes possibilités compensation perte revenu VIH/SIDA associations professionnelles (transport,….) idem SSP
idem SSP + prévention (protection vecteur, dépistage, contrôle, hygiène..) idem SSP + pour le contrôle des vecteurs: distribution moustiquaires, pièges à glossines information préventive idem SSP
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 2 - 52
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Annexe 3. Liste des projets santé des Communautés / Régions
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 3 - 1
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking - sector gezondheidLand Titel Operationele partner(s) Periode van uitvoering 2002 2003 2004 2005 Totaal
Mozambique De partnermethodeUniversiteit Gent - International Centre for Reproductive Health
2003-2006 600.000 600.000
MozambiqueDREAM-project (Drug resource enhancement against AIDS in Mozambique)
Viva Africa (Sant'Egidio) 2003-2004 100.000 145.000 245.000
MozambiqueGeïntegreerd netwerk voor de strijd tegen HIV/AIDS in Tete en Moatize
Ministerie van Gezondheid (MISAU), Provinciale Gezondheidsdiensten provincie Tete, Artsen zonder Grenzen, Instituut voor Tropische Geneeskunde, Universiteit Gent (International Center for Reproductive Health)
2004-2007 2.216.624 2.391.013 4.607.637
MozambiqueBouw van een nieuwe afdeling in het centraal hospitaal van Beira
Ministerie van Gezondheid (MISAU) 2005-2006 1.043.082 1.043.082
MozambiqueConstructie en rehabilitatie van gezondheidsinfrastructuur in de provincies Inhambane en Gaza
Ministerie van Gezondheid (MISAU) 2005-2006 560.000 560.000
MozambiqueStrategie voor de aanpak van de toenemende vervrouwelijking van de HIV-epidemie in Mozambique
UNAIDS 2005-2008 815.000 815.000
MozambiqueSteun aan PROSAUDE (gemeenschappelijk fonds voor de gezondheidssector)
Ministerie van Gezondheid (MISAU) 2006-2007 4.000.000 4.000.000
Zuid-AfrikaStrengthen Voluntary Confidential Counselling and Testing in the Free State Province
Free State Department of Health 2005-2007 613.585 613.585
Zuid-Afrika Voluntary counseling and testing Limpopo Department of Health & Welfare 2004-2006 847.445 847.445
Zuid-Afrika Home band community based care Limpopo Department of Health & Welfare 2005-2007 841.478 841.478
Financiering in EURO
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 3 - 2
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Projets du Commissariat général aux Relations internationales de la Communauté Wallonie-Bruxelles ( CGRI- DRI)7
Projets « bilatéraux » en santé :
- République Démocratique du Congo (appui à des actions menées par les
Universités francophones) : Aide à la construction d’une pharmacie au sein de l’hôpital général de
référence à Bukavu Prise en charge d’une mission de formation à Bukavu en matière
d’endoscopie digestive - Burkina Faso (CGRI-DRI, APEFE et CIUF) : programme de soutien à la pharmacie
dans son enseignement et en matière de recherche et de développement. - Bénin (CGRI-DRI et APEFE) :
Appui à l’Ecole Supérieur de Kinésithérapie de Cotonou Consolidation du Centre de réadaptation et de l’Atelier d’appareillage
orthopédique de l’hôpital de Cotonou Relance du programme de réadaptation à base communautaire via la
remise en fonction de six centres de rééducation sur le territoire national.
- Tunisie (Ministère tunisien de la Santé et l’asbl ‘Les amis des aveugles de Glin’) : participation à la création à Sfax du premier centre de rééducation fonctionnelle –centre basse vision – pour enfants atteint de déficience visuelle
- Sénégal : soutien à la Direction de l’Action Sociale et de la Santé dans ses politiques en direction des toxicomanes, des personnes précarisées et des handicapés
- Bolivie (CGDRI-DRI, APEFE et CIUD) appui à la mis au point du protocole d’intervention du contrôle de la maladie du Chagas congénital.
Fonds de cofinancement des ONG de développement
- Depuis 1998, le CGRI et la DRI mettent en œuvre un programme d’appui financier aux actions des ONG de développement. Pour l’ensemble des projets soutenus, les principaux secteurs d’intervention sont l’économie sociale, la formation technique et professionnelle, l’audiovisuel, la jeunesse, le développement agronomique et pastoral, l’environnement et la gestion des ressources naturelles, les droits de l’Homme, l’éducation et la santé.
- Depuis août 2002 la Région wallonne avait lancé un premier appel à des projets de coopérations par toute une série d’acteurs indirects (syndicats, communes, ONG, provinces, intercommunales, hautes écoles) en vue du Développement durable. Parmi ces projets il y a quelques projets santé, plutôt liés à l'hygiène, l'assainissement à Cotonou (Bénin), l'eau potable à Kabongo (RDC), la gestion des déchets. En Bolivie (La Paz) il y a un projet de prévention des brûlures et réinsertion des brûlés.
7 CGRI, DRI, Rapport d’activités 2004
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 3 - 3
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Annexe 4. Diagramme d’impact du secteur santé. Texte explicatif.
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 4 - 1
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Rôle et fonctions du Gouv ernement proprement établies dans le secteur santé
Pauvreté réduite et éventuellement éradiquée
Croissance économique et développement social amélioré
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la sociétécivile, les partenaires et organisations locale établi
Outputs Impact intermédiaireRésultats
Développement durable
État de santé et qualitéde vie améliorés, particulièrement pour les pauvres
Groupes vulnérables protégés de la pauvreté
Ressources humaines compétentes et motivées en place
Access aux médicaments essentiels et approvisionnement assuré
Les soins de santéessentiels sont abordables et durables
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre les secteurs public et privés
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain
Le financement de la santéest efficace
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
Politique d’ information et système d’information établis
Diagramme d’Impact – secteur santé
La performance des soins de santé améliorée
Législation et fonctions régulatrices établies
Soins de santé essentiels définis et disponibles
Les stratégies liées à la santé dans les autres secteurs bien établies
Stratégies de financement de la santé établies
Participation du parlement, société civile, partenaires et communautés locales assurée
Secteur Pharmaceutique réguléet organisé
La contribution financière individuelle pour la santé est juste
Le know-how et les att itudes de santé des communautés, des familles et des individus améliorés
Les individus utilisent « correctement » les services de santé
Les communautés, les familles et les individus changent leur style de vie et leurs pratiques de santé
Politique nationale et stratégies du Service Publique établies
Le cadre «global» de la promotion de la santé bien établi et institutionnalisé
Polit ique nationale et stratégies de financement établies
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
Allocation des ressources améliorée
Pouvoir de décision et de gestion décentralisé au niveau approprié
Le financement de la santéest équitable et juste
Autres Politiques Gouv ernementales qui influencent le secteur de la santé
Environnement sain et sauf ?? assuré
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés
Système d’encouragement à la performance en place
Impact global
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services
Politique et stratégies environnementales établies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
Politique et stratégies de l’éducation établies
Politique et stratégies d’eau et hygiène établies
Politique et stratégies de nutrition établies
Politique et stratégies de population établies
Infrastructure de base en place (réseau de routes, communication, réseau d’électricité, moyens de transport, etc.)
Les risques financières liées à la santé réduites
Environnement pour utilisation efficiente des ressources établi
Autres inf luences
Autres inf luences
Politique et stratégies de sécurité routière établies
Environnement habilitant pour un comportement sain ?? en place
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 4 - 2
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 4 - 3
Introduction La santé est influencée par bon nombre de facteurs qui interviennent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du champ de la santé. Le modèle d´organisation des systèmes de santé varie considérablement d´un pays à l´autre et le secteur suit une logique assez complexe. Afin que le diagramme d´impact du secteur de la santé reste relativement compréhensible et simple d´utilisation, il se limite à représenter les liens principaux entre les différentes cases. D´autres liens pourraient être proposés mais ils rendraient la présentation du diagramme extrêmement complexe. D´un côté, les liens logiques entre les outputs (réalisations concrètes, productions) dans le secteur de la santé directement influencées par le Ministère de la santé, leurs résultats, les impacts intermédiaires et les impacts globaux sont indiqués. D´un autre côté, deux responsabilités spécifiques qui incombent au Ministère de la Santé sont expliquée de manière détaillée :
Création d´un cadre général de promotion de la santé regroupant toutes les stratégies en matière de santé qui sont de la compétence d´autres secteurs
Collaboration avec les ministères les plus importants dont les politiques et les stratégies mises en place influencent directement les performances du secteur de la santé
Objectifs du diagramme d´impact Offrir une vue d´ensemble des impacts attendus des mesures d´actions soutenues par la Belgique dans le secteur de la santé des pays tiers.
Structure du diagramme d´impact La santé, la qualité de la vie et la pauvreté sont des facteurs qui dépendent directement des choix politiques et économiques du gouvernement, autrement dit des décisions et les mesures d´actions qui sont de la compétence du Ministère de la santé et d´autres ministères. Le diagramme d´impact doit être lu de gauche à droite. A gauche, on retrouve (i) les outputs (réalisations, productions) les plus significatives du Ministère de la santé, (ii) toutes les questions en relation avec la santé qui sont du ressort d´autres ministères (cadre de promotion de la santé) et (iii) les liens avec d´autres ministères clés, présentés aux rubriques suivantes:
1. Principales responsabilités du Ministère de la santé explicitées à la rubrique suivante: Rôle du gouvernement et fonctions bien établies dans le secteur de la santé 2. Responsabilités d´autres Ministères dans des domaines directement en relation avec la santé présentés à la rubrique suivante: Cadre général de promotion de la santé mis en oeuvre et institutionnalisé 3. Les nécessités d´instaurer une collaboration entre le Ministère de la Santé et d´autres ministères clés afin de gérer le secteur de la santé de façon efficiente. Ces ministères clés sont repris à la rubrique: Politiques gouvernementales dans des domaines non sanitaires mais ayant une influence sur le secteur de la santé
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 4 - 4
Rôle du gouvernement dans le secteur de la santé Deux critères économiques justifient et déterminent le rôle du gouvernement dans le secteur de la santé: Equité: les investissements des pouvoirs publics en faveur de la santé des couches les plus pauvres de la population peuvent entraîner une réduction de la pauvreté ou juguler ses conséquences les plus néfastes; l’amélioration de l´accès des populations les plus défavorisées aux services de santé de base pourrait permettre d’augmenter leur bien-être et leur productivité ; Défaillances du marché (cfr. présentation): certaines mesures promotrices de santé ne pourraient pas (ou de façon insuffisante) être produites par le secteur privé. Les défaillances du marché dans le secteur des soins de santé et des régimes d´assurances maladies doivent être corrigées afin d´offrir aux populations un mieux-être et un meilleur système de prévoyance sociale. Même si tous reconnaissent le rôle primordial que le gouvernement doit assumer dans l´offre de santé, il ne fait cependant aucun doute que ce rôle doit être extrêmement ciblé et proportionnel à ses capacités (critère qui peut, bien entendu, varier d´un pays à l´autre). Habituellement on distingue trois fonctions principales dans la fourniture de soins de santé. Le rôle du gouvernement dans chacune de ces catégories sera fonction de la situation du pays en question: L´Offre de services de santé doit être confiée tant aux pouvoirs publics qu´au système privé. Dans bon nombre de pays, les services public sont assurés par le Ministère de la santé (en tant qu’ autorité centrale ou confiés à des organes décentralisés du Ministère) ; on constate – de façon variable selon les pays – une certaine tendance à décentraliser la fourniture des services et les placer entre les mains des administrations locales ou des institutions publiques sous leur propre statut juridique et à limiter la marge de manoeuvre du secteur privé dans l´offre de services de santé public. Le Rôle de financement est du ressort du Ministère de la santé dans de nombreux pays à faible et moyen revenu alors que dans un nombre croissant de pays à moyen revenu et dans la plupart des pays industrialisés, il est pris en charge par d´autres organes - externes au Ministère de la santé (par l´intermédiaire du Ministère des finances ou du Ministère des affaires sociales ou par des régimes de sécurité sociale semi-publics). La Réglementation du secteur de la santé (y compris du secteur privé) fait partie des compétences du Ministère de la santé. Ce pouvoir de réglementation comprend ou suppose d´autres fonctions cruciales telles que la prise de décisions politiques, la formulation des stratégies, le contrôle de la qualité et le suivi des opérations.
Cadre de promotion de la santé La Charte d´Ottawa (adoptée à la Conférence de l´Organisation mondiale de la santé en 1986) a marqué une nouvelle approche dans la promotion de la santé et la fin d´une conception qui limitait la promotion de la santé à des mesures dans le domaine de l´information, l´éducation et la communication en matière de santé. Depuis la Charte d´Ottawa, la promotion de la santé fait partie d´une démarche plurisectorielle : élaboration de politiques publiques saines, création d’un environnement favorable à la santé, renforcement de l’action communautaire, actions en faveur de l’acquisition d’aptitudes individuelles, etc. La collaboration à l´échelle mondiale connue sous le nom de “Healthy Cities” (villes saines) est le fruit de cette nouvelle orientation. La participation de plusieurs ministères et secteurs est nécessaire au développement de politiques publiques saines et à la création d’un environnement favorable à la santé. Les responsabilités qui incombent à ces organismes sont reprises dans le diagramme d´impact (cfr. cadre de promotion de la santé):
Politiques et stratégies établies en matière de population Politiques et stratégies établies en matière nutritionnelles Politiques et stratégies établies en matière d´eau et d´assainissement Politiques et stratégies établies en matière d´éducation
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 4 - 5
Politiques et stratégies établies en matière d´environnement (y compris l´habitat, le lieu de travail et le milieu ambiant)
Politiques établies en matière de sécurité routière Créer un environnement favorable aux comportements sains
Politiques gouvernementales non sanitaires ayant une influence sur le secteur de la santé En vue d´une gestion efficiente du secteur de la santé, le Ministère de la santé se doit de collaborer étroitement avec l´ensemble de la fonction publique et d´autres ministères de premier plan, tels que le Ministère des finances et d´autres ministères responsables de la mise à disposition des infrastructures et des moyens de transport, etc.
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 5 - 1
Annexe 5. Matrice. Les soins de santé primaires. Trois accents et quatre nivaux (voir note stratégique santé) Graphique 10 Matrice : Les soins de santé primaires: trois accents et quatre niveaux
LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES (SSP)
SOINS DE SANTE REPRODUCTIVE
LUTTE CONTRE LE VIH/
LUTTE CONTRE LES MALADIES
TRANSMISSIBLES
TB -PALUDISME- Maladies négligées
NIV
EAU
INTE
RN
ATI
ON
AL Politique
reconnaissance du droit aux soins reconnaissance que les services de santé sont essentiels à la lutte contre les maladies épidémiologie surveillance des indicateurs de santé coordination des donateurs
Solidarité financière Fonds internationaux pour des moyens accrus pour les services de santé
R&D recherche sur les médicaments essentiels recherche sur les formes d'assurance maladie et les modèles de soins de santé primaires renforcement des capacités par l'information internationale mise en réseau internationale, experts, décideurs politiques, société civile
Actions régionales (coopération entre pays) forums
idem SSP + plaidoyer santé et droits reproductifs idem SSP idem SSP idem SSP
idem SSP + reconnaissance de la lutte contre le VIH/ comme bien public global VIH/ sur les forums politiques internationaux surveillance supranationale idem SSP idem SSP + recherche sur les vaccins, les médicaments, les traitements idem SSP + + mise en réseau + IPAA
idem SSP + reconnaissance de la lutte contre les maladies transmissibles comme bien public global système de surveillance supranational TB-paludisme-maladie du sommeil à l'ordre du jour international Roll Back Malaria: Faire reculer le paludisme et Stop TB OCP (onchocercose)
idem SSP idem SSP + recherche sur les vaccins, les sets de diagnostic, les médicaments mise en réseau internationale idem SSP + + mise en réseau + approche régionale lutte
POU
VO
IRS
PUB
LIC
S Politique appui à la politique, à la planification… SWAp renforcement des capacités suivi épidémiologique
Budget aide budgétaire SWAp partenariat public-privé
Politique autres secteurs appui enseignement, environnement, sécurité alimentaire
idem SSP + plaidoyer : droits des femmes et adolescents santé et droits reproductifs idem SSP moyens suffisants idem SSP + enseignement filles, intégration éducation sexuelle dans les curricula scolaires
idem SSP + priorité VIH/ collaboration interministérielle droits VIH+ personnes idem SSP moyens suffisants idem SSP + coordination différents secteurs politique VIH/ dans tous les secteurs politique en matière d'orphelins (du )
idem SSP + sensibilisation population contrôle, prévention, traitements accessibles aux pauvres développement des capacités nationales système d'information et de surveillance national idem SSP moyens suffisants idem SSP + enseignement,
environnement
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 6 - 2
SYST
EME
DE
SOIN
S D
E SA
NTE
PR
IMA
IRES
Organisation organisation et prise de décision
décentralisées organisation pyramidale
Services de soins de santé primaires moyens humains (formation, perfectionnement, motivation) médicaments, moyens de diagnostic (e.a. laboratoires), produits de consommation infrastructure meilleure qualité des soins promotion de la santé attention spéciale aux femmes, aux enfants attention spéciale aux pauvres collaboration services publics et privés contrôle MST; soins aux mères; soins aux nourrissons; attention portée à la violence à l'égard des femmes; adaptation des services de santé aux besoins reproductifs de groupes cibles comme les jeunes; optimisation de la communication
Financement mécanismes de solidarité contre l'exclusion des pauvres
+ distribution et utilisation efficaces contraceptifs, + planification familiale
Programme national: information, établissement d'instructions, suivi idem SSP + prévention VIH/SIDA tests prévention transmission mère-enfant traitement ART si possible soins palliatifs, soins à domicile renforcement personnel idem SSP
Programmes nationaux: surveillance, information, suivi idem SSP + prévention, contrôle, dépistage, traitement application à grande échelle de tests diagnostics pour la maladie du sommeil renforcement accessibilité suivi moustiquaires imprégnés (paludisme) surveillance locale
idem SSP
CO
MM
UN
AU
TES Sensibilisation
(IEC, changement habitudes insalubres, droits, environnement) meilleure utilisation services
Organisations locales développement capital social plus grande participation soins de santé primaires eau, installations sanitaires, alimentation
augmentation revenu répartition revenus dans la famille (droits mère) crédits participation assurance maladie
idem SSP + pratiques sexuelles contre la mutilation féminine droits des femmes planification familiale idem SSP + organisations de femmes clubs de jeunes (activités adolescents & rapports sexuels) idem SSP
idem SSP + renforcement VIH+personnes anti-discrimination IEC: utilisation préservatifs, prévention SIDA, promotion, utilisation services de santé, transmission mère-enfant, aliments pour bébés …. idem SSP + organisations orphelins organisations VIH+ personnes clubs de jeunes possibilités compensation perte revenu VIH/SIDA associations professionnelles (transport,….) idem SSP
idem SSP + prévention (protection vecteur, dépistage, contrôle, hygiène..) idem SSP + pour le contrôle des vecteurs: distribution moustiquaires, pièges à glossines information préventive idem SSP
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 6 - 1
Annexe 6. Liste des documents utilisés La liste des documents utilisés pour chaque évaluation pays est présentée en annexe de chaque rapport pays. La liste ci-dessous est la liste complémentaire des documents reçus avant l’évaluation pays, pour l’étude sur dossier et pour la revue globale.
Pays Organisa-tion Auteur Titre du document Date
BENIN APEFE Iweins V. Rapport de fin de mission "Appui au Service de Kinésithérapie de l'Hôpital de Ouidah"
17.03.02/31.08.04
BENIN APEFE Dossier d'instruction d'une intervention de longue durée de l'APEFE: Hôpital de Ouidah
novembre 2001
BENIN APEFE Demande d'intervention Centre Hospitalier Départemental du Zou
BENIN APEFE
Procès verbal de réunion du Comité Technique de suivi de l'intervention APEFE au sein du Service de Rééducation Fonctionnelle et Réadaptation du Centre Hospitalier Départemental du Zou et des Collines
BENIN APEFE Moraine J.J. Rapport de mission d'évaluation des projets d'appui au développement de la kinésithérapie au Bénin
oct-nov.2003
BENIN APEFE Dossier d'instruction d'une intervention de l'APEFE: Appui à l'Ecole supérieure de Kinésithérapie de la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou (BN 01/01)
BENIN APEFE
Contractualisation des interventions BN 01/01" Appui à l'Ecole Supérieure de Kinésithérapie" BN03/03 et BN 04/04: "Appui structurel au développement de la Kinésithérapie au Bénin" + avenant 01
BENIN APEFE Dossier d'instruction d'une intervention de longue durée APEFE: "Appui structurel au développement de la kinésithérapie au Bénin"
avril 2004
CONGO APEFE Note concernant l'état d'avancement du projet d'APEFE au Programme National de Lutte contre la Tuberculose en RD Congo
RWANDA APEFE Parent F. DTF: Renforcement de la formation des formateurs des Ecoles de Sciences Infirmières
février 2003
RWANDA APEFE Parent F.
Rapport complémentaire au DTF: Renforcement de la formation des Ecoles des Sciences Infirmières/ Appui aux ecoles en sciences infirmières au Ruanda
oct. 2004
RWANDA APEFE Dossier d'instruction d'une intervention de courte durée APEFE: Appui national aux Ecoles de Sciences Infirmières (TdR)
NIGER CTB Porignon D., Maïga I.
Evaluation à mi-parcours du projet "Appui au district sanitaire urbain de la Commune III à Niamey"
avril 2003
BENIN CTB Rapport de formulation: "Appui à la zone sanitaire de Klouékanmey, Toviklin et Lalo (PAZS-KTL) au Bénin (BEN0203P)
juillet 2002
BENIN CTB
Callewaert B., Ouendao,
Inoussa, Gibigaye ea
Rapport de formulation du "Projet d'appui à la zone sanitaire de Bassila (PAZS-Bassila)
janvier 2002
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 6 - 2
NIGER CTB de Caluwe P., Inrombe J;, Sambo A.
Evaluation à mi-parcours du "Projet d'appui au développement des districts sanitaires de la région de Dosso" (NER 00/009)
juillet 2003
ITG Aids impulsprogramma II (AIP-II), verlenging impulsprogramme aids-onderzoek in ontwikkelingslanden 2001-2002 tot 2002-2003 i.o.v. DGIS
décembre 2002
ITG Raamakkoord ITG-DGIS Jaarprogramma 2003 deel 1 / 2
décembre 2002
ITG Vijfjarenplan 2003-2007 ITG Jaarplan 2005 ITG Jaarplan 2004 ITG Jaarplan 2003 ITG Vijfjarenplan 1998-2002
CONGO Solidarité protestante
Plans d'action 2003-2004-2005: Lutte contre la lèpre et la TBC dans la province du Bas Congo (2003.08)
CONGO Solidarité protestante Kimpanga D.
Rapport d'évaluation: Appui à la lutte contre la lèpre et la TBC dans la province du Bas-Congo
sept.2004
BENIN Louvain
Développement
FP/BEN/53 Amélioration de l'accès aux soins de santé pour les populations rurales dans le Mono: projet initial, plans d'action 2003-2004-2005
BENIN Louvain
Développement
2005-04-15. DTF LISA actualisé
avril 2005
BENIN Louvain
Développement
2004-12-16. GG LISA Mutuelles( demande de rallonge budgétaire)
BENIN Louvain
Développement
Berti F. Evaluation mi-parcours : Lutte intégrée pour la sécurité alimentaire dans l'Atacora Ouest (LISA)
déc.2004
BENIN Louvain
Développement
Rapport narratif cloture LISA 2003
RWANDA CARAES
Action 05: Hôpital Neuro-Psychiatrique Caraes, Ndera au Ruanda: présentation générale, canevas de référence, plan de formation 2004 & 2005, canevas de référence- évolution 2004 et questionnaire de satisfaction
RWANDA CARAES
Action 06: Centre de formation Caraes (Kigali Health Institute) à Ndera.Développement de la formation en nursing psychiatrique pour le Ruanda: présentation générale, canevas de référence, plans de formation 2004 & 2005, questionnaire de satisfaction et résultats 2004.
RWANDA CARAES Action 13: Projet de réhabilitation Ndera CONGO FOMETRO Rapport d'activités 2002 juin 2003
CONGO FOMETRO Programme Fometro 2003-2007: Investissement dans le capital humain et dans les zones de santé en RDC
avril 2002
CONGO FOMETRO Plan d'action 2003 adapté/Fometro co-financement DGCD: Investir dans le capital humain dans 5 zones de santé en RDC
janvier 2003
CONGO FOMETRO Rapport d'activités 2003 juin 2004
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 6 - 3
CONGO FOMETRO Rapport annuel: Appui à la zone de Gombe Matadi en RDC
mars 2004
CONGO FOMETRO Rapport annuel: Appui à la zone de Kangu en RDC mars 2004
CONGO FOMETRO Rapport annuel: Appui à la zone de Kwamouth en RDC
mars 2004
CONGO FOMETRO Rapport annuel: Appui à la zone de Mangembo en RDC
mars 2004
CONGO FOMETRO Rapport annuel: Appui à la zone de Mushie en RDC mars 2004
CONGO FOMETRO Plan d'action 2004 adapté, co-financement DGCD: Investir dans le capital humain des zones de santé en RDC
janvier 2004
CONGO FOMETRO Rapport annuel 2004 DGCD:Financement du partenaire: Appui aux zones de santé en Mushie, Kwamouth, Gombe, Matadi, Kangu et Mangembo en RDC
mars 2005 (version provisoire)
CONGO FOMETRO Plan d'action 2005 adapté, co-financement DGCD: Investir dans les zones de santé en RDC
juin 2004
CONGO DAMIEN
FOUNDATION
Ondersteuning van het nationale TB en lepra controle programma in de Oost provincie, Zuid en West-Bandundu. Actieplan 2003
2003
CONGO DAMIEN
FOUNDATION
DGIs uitzenden van personen. Ondersteuning van het nationale TB- en lepraprogramma in RDC. Actieplan 2003 en 2005
CONGO DAMIEN
FOUNDATION
DGCD financement du partenaire. Appui à la lutte contre la lèpre et la tuberculose au Congo.Plan d'action 2005.
CONGO DAMIEN
FOUNDATION
Vue synthétique des projets appuyés
CONGO A-COR-D Programme quinquennal du consortium A-COR-D 2003-2007
avril 2002
CONGO A-COR-D Soins de santé primaire Kisantu : rapport d'activité 2004
CONGO A-COR-D Plan d'action 2006 SSP Zone de Kisantu juin 2005 CONGO SLCD Rapport d'activité SLCD 2004 CONGO A-COR-D Plan d'action A-COR-D 2004 DGCD févr.2004 CONGO A-COR-D Plan d'action A-COR-D 2005 DGCD juin 2004
CONGO Wereldsolidariteit Rapport intégré 2004-2005-2006
CONGO Wereldsolidariteit Fiche de présence MOCC fin 2004
BENIN Wereldsolidariteit Stratégie du programme 2003-2007
BENIN Wereldsolidariteit
Fiche Promusaf Benin: rapport d'activités 2003 et rapport provisoire 2004 du programme d'appui aux mutualités en Afrique de l'Ouest
BENIN GRAP-SWAP
Grodos D., Paul E. Mission exploratoire au Bénin nov. 2004
BENIN DGCD Note stratégique Benin nov. 2004
BENIN DGCD Accès aux soins de santé globaux de qualité: PV de la réunion du 28-29 avril 2005
avril 2005
CONGO DGCD Note stratégique RD Congo déc.2002
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 6 - 4
CONGO Gouvernement Document intérimaire de stratégies de
réduction de la pauvreté mars 2002
CONGO Gouvernement Déclaration politique sectorielle déc.2001
CONGO Coopération belgo-congolaise oct.2002
CONGO Calendrier pour la rédaction de la nouvelle note stratégique et du programme indicatif de coopération
RWANDA DGCD DGIs uitzenden van personen. Ondersteuning van het nationale TB- en lepraprogramma in Ruanda. Actieplan 2003 en 2005
RWANDA DGCD Note stratégique Rwanda déc.2002
RWANDA Gouvernement Health Sector Policy sept.2004
RWANDA Gouvernement Poverty Reduction Strategy Paper juin 2002
RWANDA Gouvernement Poverty Reduction Strategy Paper Progress
Report juin 2003
RWANDA Gouvernement Health Sector Strategic Plan 2005-2009
CONGO CUD Malengreau M. Appui à l'école de santé publique de Kinshasa 2003
CONGO FOMETRO Mukungo M.; Sinda B.
Rapport d'évaluation des zones de santé de : Kwilu-Ngongo; gombe Matadi et Mushie
mai 2001
International Social Security Association (ISSA)
International Social Sectorlink Review
jan-fév 2005
RWANDA Solidarité protestante
Plan d'action 2003: Lutte contre le SIDA en milieu rural au Rwanda (EPR) + budget approuvé
avril 2003
RWANDA Solidarité protestante Plan d'action 2004: Lutte contre le SIDA en
milieu rural au Rwanda
RWANDA Solidarité protestante Plan d'action 2005: Lutte contre le SIDA en
milieu rural au Rwanda juin 2004
CONGO DGCD La Table Ronde Santé mai 2004 RWANDA DGCD Note stratégique Rwanda déc 2002
RWANDA DGCD Terms of reference : Health Sector Cluster Group
RWANDA DGCD Note pays janv.2005 RWANDA DGCD Belgische interventies avril 2005 RWANDA DGCD Partnership Framework Agreement
RWANDA DGCD Joint Review: Helath Sector Strategic Plan 2005-2009
juin 2005
RWANDA DGCD TOR of Technical Working Groiups inside the Health Sector Cluster Group in Rwanda
RWANDA DGCD Poverty Reduction Strategy Paper: third Annual Progress Report
RWANDA CTB Projet d'appui au programme national de santé mentale Pahse 2: appui à la poloitque nationale de santé mentale 2005-2010
RWANDA CTB DTF: appui institutionnel du ministère de la santé au Rwanda Phase 3
jan.2005
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 6 - 5
RWANDA CTB
Berenguer B.,
Munyandamutsa N.
Appui au programme national de santé mentale Phase 2: mission d'identification
mai 2004
RWANDA CTB
Porignon D., Bucagu M., Sekabaraga
C. Appui institutionnel au ministère de la santé Phase 3: étude d'identification
RWANDA CTB Renforcement institutionnel du ministère de la santé Phase 1999-2002, DTF
août 1998
RWANDA CTB Rapport final: Projet Renforcement Institutionnel du ministère de la santé Phase 2: 1999-2004
RWANDA CTB Identification: appui au district de santé de Kigali ville 2003
RWANDA CTB Identification: appui au district santé de Kigali Ngali
RWANDA CTB DTF Programme d'appui aux districts de santé du Rwanda: appui aux districts de santé de Kigali Ngali
RWANDA CTB DT Programme d'appui aux districts de santé du Rwanda: appui au district de santé de Kigali ville
RWANDA CTB Parent F. DTF: Renforcement de la formation des formateurs des Ecoles de Sciences Infirmières
févr.2003
RWANDA CTB DTF RSK: Appui aux districts sanitaires de Kigali-Remera, Kigali-Muhima et Ruli
mai 1998
RWANDA CTB
Avenant au DTF concernant la prolongation jusqu'au 31/12/97, relatif à l'interevntion "appui aux soins de santé primaires dans la région sanitaire de Kigali"
RWANDA CTB
Bucagu M., Rwakunda
D., Van Doren W;, Tockert R.,
Wéry E. DTF: Appui au Centre Hospitalier de Kigali (CHK) 2002-2005
RWANDA CTB DTF: Appui au Centre Hospitalier de Kigali: DTF 1996-2000
RWANDA CTB SEMA Suivi-évaluation de l'appui au CHK, la gestion hospitalière
2001
RWANDA CTB
de Caluwe P.,
Sebanganji M.
Suivi-évaluation du niveau de réalisation des résultats intermédiaires de l'intervention "Appui a Centre Hospitalier de Kigali"- volet concernant les "services offerts à la population"
déc 2000
NIGER CTB Proignon D.,
Maïga Idrissa
Rapport de la mission d'évaluation à mi-parcours du "Projet d'appui à l'unité d'orthopédie traumatologie de l'hôpital national de Niamey (HNN) et à la formation en orthopédie traumatologie au Niger (NER/00/007)
avril 2003
CAMBODIA CTB Provision of Basic Health Services (PBH) in the provinces of Siem Reap and Otdar Meanchey
avril 2003
CAMBODIA CTB HERA Final Draft : Identification of the project "Basic Health Services in th eprovince of Kampong Cham, Cambodia"
mars 2003
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 6 - 6
CAMBODIA CTB Apsasa
Development Consulting
Technical and Financial File of Provision of Basic Health Services to the province of Kampong Cham
avril 2004
NIGER CTB Cereps Dossier technique et financier: Appui pour la mise en œuvre du PDS Formulation
sept.2004
BENIN CTB
Dauby C., Ouendo E.
Vangeenderhuysen C., Dujardin B.
Suivi scientifique des projets CTB au Bénin: projet d'appui à la zone sanitaire de Klouékanme-Toviklin-Lalo, projet d'appui à la zone sanitaire de Bassila. Aide mémoire
mai 2004
CONGO FOMETRO DTF: Appui à la lutte contre la trypanosomiase en république démocratique du Congo Phase 2: 1999-2002
CONGO FOMETRO DTF: Appui à la lutte contre la trypanosomiase en république démocratique du Congo plan à moyen terme (pour les années 3 à 5) + cadre logique et budgets
oct. 1999
CONGO FOMETRO DTF : Appui à la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine phase 3, rapport de formulation
fév.2004
CONGO FOMETRO Annexe 18: fiche provinciale Moniema, Nord-Katanga et Sankuru + budget
CONGO FOMETRO Rapport annuel PALT III
CONGO CTB Stanghellini A., Lokonga
Appui à la lutte contre la trypanosomiose humaine africaine dans la RD Congo Phase 2
mars 2003
CONGO CTB Identification : Appui à la lutte contre la trypanosomiose humaine africaine dans la RD Congo. Phase 3
CONGO CTB DTF "Appui à la lutte contre la trypanosomiose humaine africaine phase 3" 2003-2008, Rapport de formulation
fevr 2004
CONGO CTB DTF Appui au secteur santé au Bas-Congo
CONGO CTB Planche P., Milenge P.
Rapport d'évaluation à mi-parcours. Projet belgo-congolais d'appui institutionnel à la fonction d'étude et planification
BENIN CTB Projet d'appui à la zone sanitaire de Bassila. Rapport de formulation (version 5)
janv.2002
NIGER CTB DTF "Projet d'appui et de formation en chirurgie orthopédique et traumatologique à l'hôpital national de Niamey"
janv.1999
NIGER CTB Dugas S., Meloni R.
Suivi scientifique du projet: "Appui au développement des districts sanitaires de la Région de Dosso, Niger"
juin 2003
NIGER CTB Meloni R. Suivi scientifique du projet: "Appui au développement des districts sanitaires de la Région de Dosso, Niger"
oct.2003
NIGER CTB Appui au développement du sictrict sanitaire urbain de la Commune III de Niamey en Niger, phase III, mai 1999- avril 2002
NIGER CTB DTF: Appui au développement des districts sanitaires du Département de Dosso, 1999-2003
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Note méthodologique / Décembre 2005 Annexe 6 - 7
Documents de référence générale
Note stratégique: soins de santé primaires DGCI, Août 2002 Note stratégique: Égalité des droits et des chances entre les femmes
et les hommes, DGCI, Mai 2002 Projet de note stratégique sur le SIDA : La Belgique et la lutte contre le Sida, DGCD.
Version septembre 2004 Notes stratégiques pays (pays retenus pour l’évaluation thématique) Note stratégique du FBS: Amélioration de la sécurité alimentaire et réduction de la
pauvreté. 2000-2010 Rapport d’évaluation, Lumières et ombres sur la coopération entre la Belgique et la Bolivie
(1992-2004), Octobre 2005 Rapport de l’évaluation externe PIKINE, UCL Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité. Document sur les bonnes pratiques, CAD Examen des politiques et programmes de la Belgique en matière de coopération pour le
développement, CAD (version provisoire 26 octobre 2005) Déclaration d’Anvers sur « l’accès aux soins de santé pour tous » de l’Institut de Médecine
Tropicale (IMT), 2001. Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, exposé des résolutions,
mars 2005. Millennium Development Goals. First progress report by Belgium on MDG 8 (Global
Partnership for Development), 2004 Note des ONG médicales à la DGCD. Pour un dialogue régulier entre la DGCD et les ONG
médicales, mars 2005 Réactions et commentaires de la DGCD / D 3.1 sur le document des ONG médicales,
septembre 2005. Note santé, La coopération au développement dans le secteur de la santé, proposition
pour une politique sectorielle, AGCD, janvier 1996 Annuaire de la coopération belge en chiffres de 1998 à 2003, SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au développement, juillet 2004. Annuaire de la coopération belge en chiffres de 1997 à 2002, SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au développement, juillet 2003 Rapport d’activités 2003, DGCD Aperçu des contributions de la DGCD aux organisations internationales, août 2004. Discours du 7 mars 2005 par le ministre De Decker au Sénat à l’occasion du colloque sur
les ODMs Note stratégique de coopération avec les organisations internationales, Le partenariat avec
le programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA Note de travail pour le GRAP-SWAP, Comment exécuter un projet en évitant « l’approche
projet », L’exemple du projet de développement des districts sanitaires de Dosso, D. Grodos, août 2005.
World Health report 2005, Make every mother and child count, WHO 2005. CTB, base de données projets santé (fichiers Excel) DGCD, liste de projets des acteurs indirects HERA, documents de travail pour le développement d’outil d’évaluation du secteur de la
santé, pour la CE (version 20005, prochainement disponible sur le site web EuropeAid)
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 7 - 1
Annexe 7. Liste de personnes interviewées La liste des personnes interviewées au niveau des pays évalués se trouve en annexe de chaque rapport pays. La liste ci-dessous est complémentaire aux évaluations pays. DGCD Dr. Marc De Feyter (D3) Dr. Jacques Laruelle (D4) Dr. Joseph Vanderheyden (FBS) Mr. Ludo Van Rossum (D0.1) CTB Dr. Paul Bossijns, expert sectoriel santé Dr. Paul Verlé, Unité experts thématiques et sectoriels ONG médicales Dr. Karel Gyselinck, Memisa Dr. Peter Persijn, Fometro Dr. Vincent Janssens, Caraes Mr. Hugues d'Ydewalle, Christelijke Blindenmissie Dr. Tine Demeulenaere, Damiaanactie Dr. Christian de Clippele, Louvain Développement COPROGRAM Mr. Johan Slimbrouck, Coprogram ACODEV Mr. Etienne Van Parijs IMT Dr. Bruno Grijsseels, Directeur Dr. Wim Van Damme (Conseiller concernant le GFATM) CIUF Mme. Monique Goyens VLIR Mme Kristien Verbrugghen Mme Caroline Deneweth OMS Dr. Tim Evans, Assistant Director General, Evidence and Information for Policy Dr. Guy Carrin, Health Financing Policy Dr. Patrick Kadama, Health Systems Dr. Abdelhay Mechbal, Director, Health financing and Stewardship Dr. Paul Van Look, Reproductive Health and Research Dr. Wim Van Lerberghe, Evidence and Information for Policy (Dr. Michel Jancloes, retired) ONUSIDA Dr. Peter Piot, Directeur Exécutif
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 8 - 1
Annexe 8. Tendances et concepts internationaux relatifs au secteur de la santé & à l’aide au développement
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Tendances et concepts internationaux relatifs au secteur de la
santé & à l’aide au développement
18 mai 2005
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 2
Table of contents
1. CONTENT......................................................................................................................................3
2. GLOBAL POLICY FRAMEWORK/INTERNATIONAL TRENDS.......................................3
2.1. MAIN PLAYERS IN THE POLICY ARENA.....................................................................................3 2.2. SOME MAJOR PERCEPTIONS OF “HEALTH” AND “HEALTH CARE”........................................3 2.3. SOME MILESTONES IN HEALTH 1978 – 1993.............................................................................4 2.4. RECENT DEVELOPMENTS AND TRENDS ....................................................................................5 2.4.1. THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) ..........................................................5 2.4.2. REPORT OF THE COMMISSION ON MACROECONOMICS AND HEALTH ................................6 2.4.3. PUTTING HEALTH INTO A FRAMEWORK OF POVERTY ALLEVIATION AND OF EQUITY ........6 2.4.4. HEALTH AS A NATIONAL AND GLOBAL PUBLIC GOOD........................................................7 2.4.5. EFFICIENCY OF INTERVENTIONS: COST EFFECTIVENESS AND MINIMUM PACKAGE OF CARE7 2.4.6. EFFICIENCY OF HEALTH SYSTEMS: THE PUBLIC-PRIVATE MIX OF SERVICES ......................8 2.4.7. MEASURING HEALTH SYSTEM PERFORMANCE ...................................................................8 2.4.8. ESSENTIAL STEPS FOR SUSTAINABLE HEALTH....................................................................9
3. OVERVIEW OF BILATERAL DONORS IN HEALTH ........................................................11
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 3
10. Content A brief description of the historical global policy framework in health on relevant policy shifts regarding the health sector
• Main players in the international policy arena • Some major perceptions of “health” • Some milestones 1978-1993 • Recent developments and trends
A short overview of aid policies of other bilateral donors in health
11. Global policy framework/international trends
Main players in the policy arena The key agencies in the health field are the competent technical agencies in the UN system, i.e. WHO, UNAIDS, UNICEF, and UNFPA. Since the early 1990ies, the World Bank has increasingly turned its attention to the health sector. But also other Development Banks (i.e. AsDB, AfDB, IADB) and multilateral organisations (i.e. EC). Some major bilateral development agencies have also increased their resources for health sector co-operation and became more recognised players in the international policy arena (see further donor overview). Other players that play an important role are the major schools of public health. The current concepts of those schools may strongly influence the thinking of the participants and the kind of planning and policy approaches they will favour in their work environment. Most of the renowned schools are still in the rich countries but some developing countries start having schools of international reputation (e.g. Bangkok). Finally, some regional or international NGOs also play a role in health policy development such as the International Red Cross, Aga Khan, AMREF. More recently, some global initiatives such as the Global Fund, GAVI and other private foundations (e.g. Bill Clinton, Bush Initiative) have contributed to increased health investments in LICs.
Some major perceptions of “Health” and “Health care” Health and health care as a basic human right Health is viewed by some as a right, analogous to justice or political freedom. Indeed, the WHO constitution states that “…the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition” (WHO Constitution). Few would, however, believe that equal health status is attainable in the same way that equal political freedom may be. However, health is seen as so fundamental that constraints to its full attainment must be minimised. Part of this involves ensuring access to health-care, which is the second possible perspective. Logically it would also require a commitment to removing all the other constraints to full health (such as limited access to education, safe water, food, etc.), as health-care is only one of the factors affecting an individual’s health. Access to health care is viewed by others as the appropriate right. Under such a view a government will be particularly concerned with issues of equity in health-care. Access to health-care may be viewed as similar to access to a minimal level of food and shelter. Indeed, a frequent version of this attitude is that there is a right to basic health-care rather than all levels of health-care (An introduction to health planning in developing countries, A. Green). Health systems are rarely designed along rational public health, human right or economic analysis alone, but it’s organisation and financing is more often a result of play of power, forces and interest
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 4
of different stakeholders. Hence the primary importance of stakeholder analysis, including the poor. Health, a national and global public good Public goods are goods that are non-rival (consumption by one user does not reduce the supply available for others) and non-excludable (users can not be prevented from consuming the good). The control of infectious or communicable diseases is considered a national and global public good (as infectious diseases do not stop at the borders of a specific country). Those programmes benefit the public at large rather than specific individuals. Any gap in the provision of these programmes will not be taken up by private expenditures. These are amongst the main priority expenditures requiring public financing. Governments have the responsibility to ensure the provision of public goods (e.g. provision of public health information; creating a healthy environment), services that have positive externalities (e.g. immunisation) and cost-effective health services, at least to the poor. Countries with limited state capability or limited resources are supposed to focus first on basic functions addressing market failures, notably the provision of pure public goods such as property rights, macroeconomic stability, control of infectious diseases, safe water, roads and protection of the poor. Market failure refers to a set of conditions under which a market economy fails to allocate resources efficiently. Typically market failure in health concerns issues such as public goods, information asymmetry and reduced consumer sovereignty. Health, a poverty issueThe health of individuals and populations is a major determinant of economic gain and impacts significantly on poverty reduction. There is a strong correlation between investment in public health, better health outcomes and economic growth. The central importance of health to development and poverty reduction is reflected in the prominence of health gains within the Millennium Development targets. Better health improves quality of life, extends the scope of possibilities and preserves the means of subsistence. Improving intellectual capacity and physical well-being increases the individual’s productivity as well as his per capita income and the total time of his economic productivity. Ill health, malnutrition, poor hygiene and high fertility cause households to become or remain poor. They cause poverty through diminishing productivity, reducing household income and increasing health expenditures. The poor spend more of their income on health care and catastrophic illness can precipitate the poor into a poverty trap. Poverty leads to poor health outcomes. The poor typically have higher levels of female illiteracy, lack access to clean water and sanitation, face food insecurity, have poor household caring practices, lack control of their fertility and have low levels of access to preventive and basic curative care. The end result is ill health, malnutrition and high fertility. Improving health outcomes and involving the poor actively in these efforts are major elements of economic development, poverty reduction and social development.
Some milestones in health 1978 – 1993 • Primary Health Care (PHC) is a policy approach formulated by an international WHO conference in Alma Ata 1978, which was later approved in various resolutions of the World Health Assembly and which has substantially shaped concepts and rhetoric of health policy in developing countries. It should not be confused with primary care, a term that describes the first contact level of the health care pyramid. • Comprehensive and Selective PHC: These terms reflect a policy debate on implementation issues of PHC in the 1980ies. Comprehensive refers to a more integrated approach of PHC services dealing with a wide scope of primary care services (also called ‘the horizontal
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 5
approach’); selective refers to a more focused approach on selected primary care services (also called the ‘vertical approach’) • The Ottawa Charter (1986) advocated a new approach to health promotion, abandoning the older concepts that limit health promotion to health information, education and communication (IEC) measures and opening health promotion to a much wider framework: Building healthy public policy, creating health-supporting environments, strengthening of community action, developing personal skills for health etc. The world-wide “Healthy Cities” collaboration was a result of this new orientation. • The Bamako Initiative was a policy initiative by African Ministers of Health, UNICEF and the WHO in 1987, which introduced increased participation of users in the management and financing of health care and drug supply at the health facility level. • Investing in Health is the 1993 World Development report of the World Bank. It was the first time that the WB dealt in such depth with health matters and the studies commissioned for the preparation of this report were probably the largest ever comprehensive public health studies done so far. Important tools for health planning (like DALYs – Disability Adjusted Life Years) were developed and published in this context.
Based on these and other works, health has been increasingly recognised not only as a humanitarian issue, or as health as a basic human right, but also as an important motor of overall and economic development particularly in the poorer low-income countries. Subsequently advocacy for investment in health interventions has substantially increased and health targets were introduced in the international development frameworks.
Recent developments and trends
The Millennium Development Goals (MDGs) The Development Assistance Committee (DAC) of the OECD proposed a set of objectives and indicators as a common framework for international development assistance. This work has largely contributed to the definition of eight major development goals at the UN Summit held in New York in the year 2000 (the so called Millennium Development Goals, MDGs). National health sector and poverty reduction plans increasingly focus on or mainstream MDG targets. As presented in Table 1, three of those 8 goals address health directly: Table 1: The Millennium Development Goals that address health issues directly
GOALS AND TARGETS OF THE MILLENNIUM DECLARATION
INDICATORS FOR MONITORING PROGRESS
GOAL 4: REDUCE CHILD MORTALITY Target 5: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate
Under-five mortality rate Infant mortality rate Proportion of 1 year-old children immunised against measles
GOAL 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH Target 6: Reduce by three-quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio
Maternal mortality ratio (WHO estimates) Proportion of births attended by skilled health personnel
GOAL 6: COMBAT HIV/AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES Target 7: Have halted by 2015 and begun to reverse the spread of HIV/AIDS
HIV prevalence among 15-24 year old pregnant women Condom use rate of the contraceptive prevalence rate Number of children orphaned by HIV/AIDS
Target 8: Have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria and other
Prevalence and death rates associated with malaria
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 6
GOALS AND TARGETS OF THE MILLENNIUM DECLARATION
INDICATORS FOR MONITORING PROGRESS
major diseases Proportion of population in malaria risk areas using effective malaria prevention and treatment measures Prevalence and death rates associated with tuberculosis Proportion of tuberculosis cases detected and cured under directly observed treatment short course (DOTS)
Report of the Commission on Macroeconomics and Health In January 2000, upon the initiative of the WHO Director General, a “Commission on Macroeconomics and Health” (CMH) was established and given the task to assess the place of health in the global economic development. Its work has implied leading scientists and policy makers in the fields of health, economics and development policy from all over the world. The final report was presented in December 2001. Although not entirely the volume and the originality of work that characterised the preparation of the World Bank’s Annual Report 1993 “Investing in health”, the report of the CMH constitutes a landmark and reference point for international health policy discussion and the relative importance of health within development assistance. The report addresses almost exclusively the problems of low-income countries, but also makes some comments on how to address problems of the poor in middle-income countries. The report of the CMH has contributed much to the growing international consensus that health is an essential prerequisite for development and not merely a consequence of socio-economic development. It has raised important issues that are being debated in international fora on development. While its analysis is generally accepted, the proposed solutions are not that simple to be implemented. Apart from the debate whether the increase of financial resources as calculated in the report is feasible in a medium term, the issue is much more complex than only increasing financial resources for health. Do health systems and societies in LDCs have the capacity to make efficient use of these increased financial resources? Are the competent human resources in place? Are the health systems sufficiently efficient? Increase in resource availability will have to go step by step while systems are built that are capable of making proper use of these resources. And building efficient health systems may prove to be difficult when other sectors do not follow (e.g. wider public sector reforms), and may not be sustainable when there is no sufficient economic progress.
Putting health into a framework of poverty alleviation and of equity Poor people tend to be more ill and require more health care, relative to richer people. While government public expenditure on health usually aims to cover at least the needs of the poor, it often favours more the non-poor, mainly due to constraints of (financial, geographical, cultural) accessibility to services and to information (for example, poor people often are not aware of their rights or of the availability of special funds, e.g. social funds). Generally, equal access is more achieved at the level of primary care services and low-cost technologies than at the level of hospital services and more expensive technologies. Reducing inequity in health care between the poor and the rich can be attained by pro-poor focused strategies that aim at reducing disparities in accessibility to and utilisation of public health services. This should be the objective of any major health sector reform in the context of a poverty reduction policy. As a matter of social justice, improving the health status of the poor is a top priority for donor agencies and development partners. As such, they advocate for poverty-oriented public policies and for a full government commitment to such a goal.
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 7
Poverty Reduction Strategies (PRS) have become the main tool for coordinating ODA at the national level in low-income countries. PRS is used for access to the Word Bank’s Poverty Reduction Support Credit, to the IMF’s Poverty Reduction and Growth Facility and increasingly for access to other donor funds including the EC. In many countries, through Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs), political attention is now more focused on poverty reduction, particularly with regard to health and health care. Although the content of PRSPs may vary substantially from country to country, they always contain a health component which is often dealing with specific health strategies and health sector organisation. Whether PRS have an impact on health or health care of the poor is too early to assess. Often PRSPs are mainly a summary of selected sector specific strategies that already exist, and therefore not very innovative. However, greater awareness of inequalities between rich and poor may lead to new or more effective strategies that will result in lessening inequalities of access to care (e.g. subsidising health care for the poor; increasing financial contributions by the rich to cross-subsidise services for the poor; different financing schemes in urban and rural areas) and in better informing poor sections of the population about their rights. Reducing the debt burden of low-income countries through the HIPC initiative is one mechanism that can limit the financing gap for the provision of essential services. National resources that become available through lowering debt payments should be allocated to poverty reduction strategies, especially in the social sectors. The effect of PRS on health is still to be demonstrated but in many low-income countries the share of the national budget allocated to health has increased through the HIPC initiative. However, the financing gap for providing a basic package of care for all citizens is large in most LICs and additional funds, both national and international, are needed.
Health as a national and global public good Public health or the control of infectious or communicable diseases is considered a national and global public good (as infectious diseases do not stop at the borders of a specific country). Globalisation and increase in travel have resulted in communicable diseases increasingly spreading from one country to the other. This is particularly the case for HIV/AIDS and resistant tuberculosis. The control of communicable diseases is clearly a global public good in a sense that everybody could enjoy its benefits and nobody could be excluded from it. Somehow, rich countries have an immediate interest in controlling the spread of communicable diseases and are increasingly willing to develop successful co-operation to influence national policies of other countries and to secure financing towards reaching these objectives. The concept of global public good offers an additional, albeit somewhat selfish, rationale for co-operation and aid. In response to the global threat of communicable diseases, global initiatives have been developed, targeted at specific diseases or at a specific activity such as immunisation. Examples are the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria; Stop TB; Global Alliance for Immunisation (GAVI). They combine a variety of stakeholders (international organisations, private companies, advocacy and influence groups, national authorities) and focus on various activities such as advocacy, policy guidance, production and dissemination of information, intervention financing, research and development).
Efficiency of interventions: cost effectiveness and minimum package of care
As public funds are limited and costs and benefits of health interventions vary considerably, choices have to be made which interventions can be subsidised by the public purse, when and for whom. The health gain per invested $ varies considerably across interventions. The higher the health gain (often expressed in disability adjusted life years or DALYs) per invested $, the more cost-effective the intervention is. Redirecting resources presently allocated to interventions that produce DALYs at a higher cost towards interventions that produce DALYs at a lower costs can
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 8
increase the impact on health while maintaining the same level of health expenditure. Within a context of budgetary constraints, societies have to decide on a limited package of public health interventions and essential clinical services that constitutes the national basic package of services to be financed by the public budget. Some aspects related to the concept and implementation of basic or minimum packages are still being debated: for example (i) should the minimum package be fully or partly financed through the public budget for all socio-economic groups or only for the poorest sections of the society; (ii) which elements of (more expensive) hospital care should be be part of the basic package or part of a ‘complementary package’, (iii) some interventions such as antiretroviral therapy (ARV) are still expensive but important in the context of ‘global public goods’; is cost-effectiveness the only criteria to be used in deciding which interventions should be part of the basic package of care to be subsidised by the public purse?
Efficiency of health systems: the public-private mix of services National health policy documents and medium term strategic plans usually focus mainly on public sector services if the public sector is the main health services provider. However they usually include a (rather vague) section on private sector or public-private partnership. In countries where the not-for-profit private sector (often largely faith-based) provides a major share of the health services and is partly subsidised by the public budget (which is not always the case), they are usually part of the national health plan. The for-profit private sector is often only marginally covered in national policy and strategic planning documents and information on private sector activities is often lacking. However, this is now somewhat changing with the increasing growth of the private health sector, worldwide. It is being argued that the primary economic rationale for increasing or extending the role of the private sector in delivering health services is to promote allocative and productive efficiency. The public sector should (at least) finance and provide purely public goods (e.g. public health), while the private sector should be encouraged to participate in providing private goods (e.g. curative care). As regarding allocative efficiency, it is argued that if the private sector takes care of health services for certain population groups, this will free up resources for public service provision for the poor and high-risk groups. Apart from potential benefits (e.g. provision of high quality curative services, freeing up public resources), private sector growth in health carries potential problems, such as: competition for scarce human resources; loss of important advocates or political support for the public sector as higher income groups use private sector services; creation of different standards of care for different population groups. In general, private sector growth has increased service provision (mainly to those who can afford it), capital investment in health and upgraded quality of service provision. Concerns are, whether such growth adds to achieving the national health objectives. Experience suggests that demand for curative services from those who can pay may skew the health system away from promoting national welfare and responding to the needs of the population in general. Growth in the private sector creates opportunities for national authorities and other stakeholders to review or reappraise the existing ways of health service organisation and financing, and decide what mix of public and private sector could best meet the national health goals.
Measuring health system performance In May 2000, the WHO published in its annual World Health Report (WHR) for the first time an international comparative ranking of health systems’ performance. The performance indicators developed in this report and their use have been object of quite some criticism from WHO member states as well as from the scientific community. WHO has opened a particular web site that presents some of these discussion results. After wide consultation the WHO Executive Board has decided to continue publishing a performance analysis and ranking every two years. The main criteria for health systems’ goals attainment were:
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 9
• Health, measured as Disability Adjusted Life Expectancy (DALE) • Inequality in the distribution of health attainment (measured for child survival) • Responsiveness of the health system to non medical expectations • Inequalities in the responsiveness of the health system and • Fairness in financial contribution
Overall goal attainment for a health system was measured by a composite indicator of the above 5 criteria. Attainment was then related to health expenditure, and the resulting performance indicators report how efficiently a health system translates expenditure into attainment of health or attainment of overall health goals respectively. Whatever further complaints of WHO member states or future scientific debate will yield as a result, it can be expected that a major part of the methods developed will survive and will increasingly play a role in the improvement of health systems and in the international competition for a better health system. Officials from the national and international health administration will increasingly use the concepts and terms used in this context. It is not excluded, that improvement on one or several of these indicators will be used in project planning matrices or financing agreements, most probably however at the overall goal level (at least so far as attainment and performance are concerned). Data on the input side of health systems (health expenditure) have become widely available through the National Health Accounts (NHA) approach, and are already used in current health planning in many countries. The availability of these data was very much improved through the preparatory work on the WHR 2000, and they are since 2000 reported annually (in the WHR) for most member states and on an increasingly comprehensive basis. Criteria for measuring health sector performance have been developed by a number of countries and are increasingly used in monitoring support of development aid to national sector plans. Many different sets of sector performance criteria exist, developed through national consensus. In LICs they often do not include the exact set of indicators proposed by WHO, but rather proxy indicators for a broader set of health sector goals.
Essential steps for sustainable health Low-income countries face difficult choices in the health sector where budgets typically fall far short of the minimum required to deliver the most basic package of essential services to the population. Policies and plans are often over-ambitious and under-resourced. There is need to prioritise interventions for the best returns to health outcomes and poverty reduction. Taking into account the above described international developments, recent global experience suggests that the following approaches offer the best potential health outcomes.
• Site health policy within a national poverty reduction strategy. This should make the case for additional spending on the social sectors including health, and outline ‘best buy’ investments and policies to improve the health outcomes of the poor. These need to be further defined in the national health plan and in sectoral policies. • Political commitment and leadership is needed to drive forward a process of sector reform, to attract adequate finance, from both government and donors, to improve management and governance and to ensure fair resource allocation within the sector often against the wishes of vested interests. • Review the role of the state. Health services are usually provided by a variety of providers (public, private, NGO and faith-based organisations). The role of government is changing from sole provider of services to ‘stewardship’ of the sector whereby government assumes responsibility for oversight, regulation and quality control and with services provided by a range of providers contracted by government. • Ensure system accountability through encouraging wide participation of stakeholders in policy dialogue and development, in prioritising investment, in delivery of services and in monitoring sector performance. Effective mechanisms are needed for coordination of donors. Explore opportunities to extend public-private partnerships.
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 10
• Promote and pursue a sector wide approach. The limits of the project approach are well recognised and early experience of the sector wide approach is encouraging. The government and its main partners will take a long-term view of the needs of the whole sector and all significant funding should support a single sector policy and expenditure programme under government leadership. The sector wide approach offers greater coherence between policy, plans and available budgets. • Aim to provide universal access to a core package of essential services defined according to the epidemiological profile and the economic situation of the country. The package should address the major causes of ill health and mortality. The focus should be on the primary level, the health centre supported by the district hospital. Investment should ensure an appropriate mix of prevention, curative treatment, care and support and health promotion. • Strengthen health systems to increase their quality, efficiency, efficacy and equity of access and ensure broad-based participation. This is a wide-ranging and long-term agenda and includes organisational reform, human resource planning and management, pharmaceutical policy and procurement of essential health commodities, financial management and information systems, surveillance, health financing, and optimising management of essential commodities. A strong and effective health system is the mainstay for delivery of all health interventions. • Support targeted interventions towards the major determinants of ill-health and fertility. Interventions to address the major communicable diseases and to improve nutrition and reproductive health are likely to benefit the poor disproportionately. Action to ensure access to contraceptives, to prevent and manage HIV/AIDS and other sexually transmitted diseases, to improve maternal health and to confront the communicable diseases-particularly HIV/AIDS, malaria and tuberculosis-is likely to deliver major health benefits. • Focus on the health problems of the poor. There is a case to target poor areas, communities and households with the greatest health needs and the highest levels of poverty. Targeted investment in women’s health benefit women by improving their well-being and quality of life but also have wider benefits for families, communities and society. • Ensure fair financing mechanisms that encourage use of services and protect the poor from the risks of impoverishment due to health expenditure. Social safety nets can ensure that basic services remain affordable to the poor. Budget allocations should reflect population distribution, the cost of service delivery and the burden of disease and poverty levels. • Establish outcome based performance targets and effective monitoring systems. These will involve information from formal and non-formal sources. • Act on the wider determinants of better health of the poor. Investment in education, particularly that of girls, water and sanitation, and the environment will have significant impact on health. All opportunities should be taken to mainstream health concerns into other sectors. This is vital in relation to HIV/AIDS which can be expected to impact on all development efforts. Provide an enabling environment for healthy behaviour. • Invest in people / human resources. They are the main factor determining performance of, access to and continuity of care.
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 11
12. Overview of bilateral donors in health Below we present a brief overview of aid policies of other bilateral donors in health. The purpose is to present the scope of European and non-European countries active in the health sector, which countries focus on the health sector in bilateral development aid, whether they have a health sector strategic paper (or policy paper), and what the focus of their health sector support is. This type of overview is always limited by the available information and needs to be updated regularly in order to correctly present other countries’ strategies and inputs. The overview is mainly based on a website review (relevant web links are provided in the table below) and may lack some updated information. Key words (policy or strategy focus) listed in the table are taken either from the overall development policy or, if existing, from the health sector and/or HIV/AIDS strategy paper. The review also indicates whether a recent “global” review of the health sector (or sub-sector) strategy has been carried out. From the review it is clear that many countries focus on the health sector as a focal or priority sector in development aid but only some countries have a formal health sector strategic paper (as developed by DGCD) (Denmark, France, Ireland, Sweden, United Kingdom, Canada, Switzerland and USA; of those some are considered outdated such as Denmark, Sweden). The evaluation team is also not aware of other countries having a legal requirement to updating sector policies / sector strategic papers on a regular basis (as is the case for Belgium; this could be checked for those countries that have a formal health strategic paper). Key words suggest that the scope of the health sector support is often rather focused on aspects or sub-sectors of the health sector. Only few countries have a sector approach that covers most important aspects of the sector (and deal with strengthening of health systems and/or sector-wide approaches). The latter are mainly Denmark, Ireland, France, Germany (?), United Kingdom, Canada and Switzerland (and arguably the USA). In the third phase of the evaluation (post-country evaluation) a selection of some relevant strategy papers will be used in order to assess the comprehensiveness of the Belgian Health Sector Strategy paper and/or learn possibly from alternative or innovative approaches. Interestingly, 3 countries have recently implemented a “global” strategic review of their health sector strategy as indicated in the table below (Denmark, Finland, France and Norway)
Country Health as
a focal sector
Formal health sector strategy paper Key words (health policy / health strategy)
European member states Denmark Yes Danida sector policy in health, 1995
(somewhat out-dated) Programme of Action against HIV/AIDS, 2001 A World of Difference: The Government’s Vision for New Priorities in Danish Development Assistance 2004 – 2008 (2003 update) Evaluation of Danish Bilateral Assistance to Health 1988-1997
Poverty reduction Sector-wide approach Health system & Health services Community development HIV/AIDS
Finland Yes Development policy (brief health chapter) Global evaluation of Finland’s health
Poverty reduction & MDG Health care system, basic health care Sexual & reproductive health
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 12
Country Health as
a focal sector
Formal health sector strategy paper Key words (health policy / health strategy)
sector interventions (ongoing). Social security HIV/AIDS Clean water & hygiene
France Yes French health care co-operation strategyFrench development aidFrench policy on international co-operation in the fight against HIV/AIDS in developing countries Évaluation de la Coopération du Ministère des Affaires étrangères dans le secteur pharmaceutique (1994-2001)
Fight against AIDS and other infectious diseases Strengthen health systems (district, sector policy, decentralisation, health management systems, other sub-sectors such as drugs, HRD, hospitals) Financing health
Germany Yes German Federal Government’s action plan for 2015 (brief) health chapter “Health, Development and Globalisation: Guidelines and Recommendations for International Cooperation – Executive Summary” (a joint publication of German actors in health and development; non-official).
Poverty reduction Access to care, especially for the poor Essential services package, pro-poor Health care financing Health promotion Quality management
Ireland Yes Development Co-operation Ireland Guidelines for Health, April 2000 A HIV/AIDS Strategy for Development Cooperation Ireland, 1999 The Status of Sector Wide Approaches, 2000
Sector wide approach National ownership, strengthening health systems HIV/AIDS mainstreaming
Italy Yes (?) No health sector strategy paper Support to GFATM Emergency assistance Roll Back Malaria HIV/AIDS (ESTHER)
Luxemburg Yes Declaration of the policy for development aidNo health sector strategy paper
Poverty Partnership Basic health care HIV/AIDS (ESTHER)
Netherlands Yes (?) “New Priorities for Development Aid Report” Dutch aid policyNo health sector strategy paper
Reproductive health and rights HIV/AIDS
Portugal Yes A Cooperação Portuguesa no limiar do século XXI, Documento de orientação estratégica No health sector strategy paper
Basic health care Health education Basic health for refugees
Spain Yes Plan anual de cooperación internacional para 2004 Plan director de la cooperación española 2001-2004 Programa Vita (Co-operation Programme for Health Development in Africa) No health sector strategy paper
Basic health care Population Reproductive health & family planning Sanitation
Sweden No (but 12% of ODA)
Policy for Development Cooperation, Health Sector, June 1997. Sida Looks Forward – Sida’s Programme for Global Development
HIV/AIDS Health systems & district health services Public health
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 13
Country Health as
a focal sector
Formal health sector strategy paper Key words (health policy / health strategy)
Perspectives on Poverty provides an overview of the current development policy.
Health reforms Decentralisation Health financing & regulation
United Kingdom
Yes Better health for people, 2000 Taking Action: The UK's strategy for tackling HIV and AIDS in the developing world, 2004 HIV and AIDS treatment and care policy, 2004
Poverty reduction and MDGs priority problems of the poor Access to care, services and products Health systems (public & private) HIV/AIDS Enabling environment for poor to maintain health (Health knowledge research, Global Health initiatives, Resource Centres)
New EU member states Poland Yes (?) No health sector strategic paper Health protection Czech Republic
Yes (?) Development aid strategy No health sector strategic paper
Removing inequalities in the status of women Reducing infant and maternal mortality Making health services available Promoting sustainable development.
Slovak Republic
Potentially future sector
Medium-Term Strategy for Official Development Assistance: 2003 – 2008No health sector strategic paper
Health care infrastructure
Hungary Potentially future sector
No health sector strategic paper Pharmaceutical products, hospitals & polyclinics, birth control, reduction of epidemics
Slovenia Latvia Lithuania Estonia Cyprus Malta
No No health sector strategic paper NA
Non EU countries Canada Yes CIDA’s Strategy for Health
Cida’s action plan for health and nutritionCIDA'S Policy on Meeting Basic Human NeedsCIDA's HIV/AIDS Action Plan
Women’s health Child health Micronutrients / malnutrition Infectious diseases Clean water Population HIV/AIDS
Japan Yes Japanese Development Partnership StrategyNo health sector strategic paper
Poverty reduction Institutional support Basic health care Infectious diseases Population Community participation & sustainable development
Norway Yes Strategy of the Norwegian development aidFighting Poverty, Norway's Action Plan 2015for Combating Poverty in the South Norwegian Policy Positions: HIV/AIDS
HIV/AIDS Malaria, TB, Infectious diseases Sector support
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Tendances et concepts internationaux / Décembrei 2005 Annexe 8 - 14
Country Health as
a focal sector
Formal health sector strategy paper Key words (health policy / health strategy)
and DevelopmentNo health sector strategic paper Review of Norwegian Health-related Development Cooperation 1988 -1997
Switzerland Yes Health Policy 2003-2010 Sustainable development Poverty reduction Good governance in health systems Pro-poor health structures Empowering communities & users Communicable diseases Sexual and reproductive health
USA Yes Website of USAID presents USA health sector policy and strategies
Integrated approach to population, health & nutrition Health Systems Environmental health Child health & maternal health Nutrition Family planning Infectious diseases HIV/AIDS
This review could be complemented with a review of multilateral donors (World Bank, AsDB, AfDB, EC) and UN Agencies (WHO, UNAIDS, UNICEF, UNFPA).
HERA Alter HEALTH RESEARCH FOR ACTION .
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Évaluation thématique
Volume III
Laarstraat 43 tel. 32-3-8445930 B-2840 Reet Belgium fax. *32-3-8448221 Bank No 401-2025551-15 e-mail [email protected]
www.herabelgium.com
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 2
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Table des matières VOLUME III Annexe 9. Rapports Pays
Annexe 9.1 Rapport Bénin Annexe 9.2 Rapport Cambodge (anglais) Annexe 9.3 Rapport Équateur (anglais) Annexe 9.4 Rapport Niger Annexe 9.5 Rapport République Démocratique du Congo Annexe 9.6 Rapport Rwanda
HERA – ALTER - ETC / Évaluation thématique / Décembre 2005 3
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge Annexe 1. Rapport Bénin
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 1 - 0
HERA HEALTH RESEARCH FOR ACTION .
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Rapport pays
Bénin
Laarstraat 43 tel. +32-3-8445930 B-2840 Reet Belgium fax. *32-3-8448221 Bank No 401-2025551-15 e-mail [email protected]
www.herabelgium.com
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Tableau de matières
1. FICHE SIGNALETIQUE ...................................................................................................5
2. FOCUS DE L’APPUI BELGE ET POLITIQUE DE SANTE NATIONALE........................6
2.1. FOCUS DE L’APPUI BELGE............................................................................................6 2.2. RESUME DE LA POLITIQUE NATIONALE DE SANTE..........................................................7
3. L’UTILISATION DE LA NOTE STRATEGIQUE...............................................................8
4. PERTINENCE DU PROJET D’UN POINT DE VUE SECTORIEL ET DU PARTENARIAT 9
4.1. IMPACT SUR LE SYSTEME DE SANTE .............................................................................9 4.2. PERTINENCE DU PARTENARIAT INSTITUTIONNEL .........................................................10
5. EFFICACITE ET PERTINENCE DES PROJETS PAR RAPPORT A LA NOTE STRATEGIQUE......................................................................................................................12
5.1. REFERENCE AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES DECRITS DANS LA NOTE STRATEGIQUE .12 5.1.1. UTILISATION D’INDICATEURS ...............................................................................12 5.1.2. RESULTATS........................................................................................................13 5.2. PERTINENCE DES RESSOURCES .................................................................................13 5.3. RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE ....................................................................14 5.4. COHERENCE ET COMPLEMENTARITE ...........................................................................15 5.5. REPONSE AUX BESOINS DE SANTE ..............................................................................15 5.6. IMPACT (POTENTIEL SUR LA SANTE) INTERSECTORIEL ..................................................16
6. PREOCCUPATIONS TRANSVERSALES .....................................................................16
6.1. DURABILITE...............................................................................................................16 6.2. L’APPROCHE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES.................................18 6.3. PARTENARIATS INTERNATIONAUX...............................................................................18 6.4. PARTENARIATS NATIONAUX........................................................................................19 6.5. PARTENARIATS AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES....................................................20 6.6. L’EGALITE DES CHANCES FEMMES / HOMMES ..............................................................21 6.7. LA LUTTE CONTRE LE SIDA........................................................................................21
7. PREOCCUPATIONS DE DEVELOPPEMENT ISSUES DE LA NOTE STRATEGIQUE21
7.1. DEVELOPPEMENT DURABLE .......................................................................................21 7.2. METHODES ET STRATEGIES OPERATIONNELLES...........................................................22 7.3. RENFORCEMENT DES CAPACITES ...............................................................................23 7.4. STRATEGIES DE FINANCEMENT ...................................................................................23 T
7.5. ACTIONS DE PLAIDOYER.............................................................................................24 7.6. PLAN D’ACTION PAR PAYS ..........................................................................................24 7.7. LA RECHERCHE .........................................................................................................24 7.8. FONDS GLOBAL .........................................................................................................24
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 2
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS .................................................................25
8.1. CONCLUSIONS ......................................................................................................25 8.2. RECOMMANDATIONS ...........................................................................................28
9. ANNEXE 1. TABLEAUX A REMPLIR CONCERNANT LE DIAGRAMME D’IMPACT..30
10. ANNEXE 2. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES.........................................37
11. ANNEXE 3. LISTE DE DOCUMENTS CONSULTES .................................................38
12. ANNEXE 4. PROGRAMME DE LA MISSION ............................................................40
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 3
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Liste des abréviations APEFE Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger AT Assistant Technique BIT Bureau International du Travail CADZS Cellule d’Appui au Développement des Zones Sanitaires CB Coopération belge (ensemble du dispositif) CHD Centre hospitalier départemental CNHU Centre national hospitalier universitaire CTB Coopération technique Belge DGCD Direction Générale de la Coopération au Développement DTF Dossier Technique et Financier EEZS Equipe d’Encadrement de la Zone Sanitaire FBS Fond Belge de Survie GROPERE Groupement pour la Promotion et l’Exploitation des Ressources de l’Environnement IMT Institut de Médecine Tropicale (d’Anvers) IRSP Institut Régional de Santé Publique (de Ouidah au Bénin) KTL (Zone sanitaire de) Klouékanmé – Toviklin - Lalo LD Louvain Développement LISA Projet de lutte intégrée pour la sécurité alimentaire dans l’Atacora Ministère de la Santé Ministère de la Santé Publique
NS Note Stratégique (de la Coopération belge dans le secteur santé) PAZS Projet d’appui à la Zone Sanitaire PIC Programme Indicatif de Coopération PROMUSAF Programme d’appui aux mutuelles de santé en Afrique PTF Partenaires techniques et financiers STEP Stratégies et Techniques contre l’Exclusion Sociale et la Pauvreté UCL Université Catholique de Louvain ULB Université Libre de Bruxelles WS Wereld Solidariteit (Solidarité Mondiale) Zone de Santé Zone sanitaire
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 4
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Fiche signalétique
Nom du pays Bénin
Projets évalués • Projet d’appui à al zone sanitaire de Bassila (PAZS-Bassila),
bilatéral, CTB • Projet d’appui à la zone sanitaire de Klouékenmé (PAZS-KTL),
bilatéral, CTB • Santé maternelle et infantile, multilatéral, UNICEF régional • Projet de Kiné-Réadaptation à Cotonou, Ouidah et Abomey, acteurs
indirects, APEFE • Projet de mutualisation dans l’Atacora, acteurs indirects, Louvain
Développement • Projet de lutte contre l’ulcère de Buruli, acteurs indirects, IMT • Programme d’appui aux mutuelles de santé en Afrique, Fond belge
de survie, Wereld Solidariteit Budget annuel belge d’appui au secteur santé (+) pour les années 2003, 2004, 2005
2003 santé: 1.599.427 Euros soit 0,23 Euros / habitant + 2003 eau et assainissement : 262.173 + 2003 population et fertilité : 852.152 = 2003 total secteur santé : 2.713.752 soit 0,39 Euro / habitant [Total aide publique belge au Bénin (2003) : 9.349.895 Euros. Enveloppe indicative 2005-2007 : 30 millions Euros.]
Budget annuel national du secteur santé (+) pour les années 2003, 2004, 2005
2004 : 45.639.126.000 Fcfa soit 6.354 Fcfa / habitant soit 9,69 Euros / habitant 2005 : 46.854.527.000 Fcfa soit 6.334 Fcfa / habitant soit9,66 Euros / habitant 2005 (hors acquisitions, investissements et autres budgets): 27.166.465.000
Fcfa dont 18% pour le personnel APE (agents permanents de l’Etat). Nom de l’attaché
Roland Provot Karl Vandepitte Stefan Meesschaert
Partenaire local responsable
• Ministère de la Santé Publique • PROMUSAF • Ecole de kinésithérapie (Cotonou) • Centre Hospitalier Régional d’Abomey • GROPERE • Equipe d’Encadrement de Zone de Santé de Bassila et de
Klouékenmé • Laboratoire de référence TBC et Mycobactéries • Associations de développement de l’Atacora
Nom des évaluateurs
Dr Matamba M.M . Dr Vincent Litt
Date de l’évaluation de terrain
11 – 20 juillet 2005
Personnes rencontrées Voir annexe 2 Documents consultés Voir annexe 3 Programme et calendrier de la mission Voir annexe 4
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 5
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Focus de l’appui belge et politique de santé nationale
Focus de l’appui belge [(*) Projets ciblés par l’évaluation] L’aide directe est plutôt focalisée sur des projets d’appui aux zones sanitaires (le « district sanitaire » au Bénin) et donc sur les soins de santé primaires [ (*) PAZS – Bassila et (*) PAZS – Klouékenmé]. Le précédent projet d’appui à la zone sanitaire de Comé (commencé en janvier 1999 et clôturé en décembre 2003 et dont une nouvelle phase est en identification) a donné un appui au niveau central à la Cellule d’Appui au Développement des Zones Sanitaires (CADZS, devenue depuis 2005 une Direction du Ministère de la santé). L’aide directe concerne aussi un projet d’amélioration de la sécurité transfusionnelle (début en 2005). L’aide indirecte ONG concerne :
- L’amélioration de l’accès aux soins de santé pour les populations rurales dans le Mono, Louvain Développement (projet visité en lieu et place du projet LD de mutualisation dans l’Atacora)
- Missions d’assistance médicales, Médecins Sans Vacances, dans 4 hôpitaux confessionnels.
Les projets inter-universitaires ciblés concernent :
- (*) L’appui au laboratoire de référence TBC et Mycobactéries du Ministère de la Santé et extension au niveau national du projet de lutte contre l’Ulcère de Buruli, IMT- Anvers
- L’appui au développement des systèmes de micro-assurances santé pour le renforcement des capacités d’enseignement et de recherche en Afrique de l’Ouest, Ulg, ULB.
- Formation et création d’un réseau de futurs enseignants de l’anesthésie-réanimation pour l’ensemble des pays d’Afrique francophones au Sud du Sahara – Bénin, UCL.
Les projets de l’APEFE sont :
- (*) Renforcement structurel du service de rééducation fonctionnelle du centre Hospitalier Départemental du ZOU (Abomey, clôturé en mai 2005)
- (*) Renforcement structurel de l’Ecole de kinésithérapie - (*) Appui structurel au développement de la kinésithérapie au Bénin - Renforcement structurel du Service National de Transfusion Sanguine (projet visité). - Renforcement structurel du programme « Matériel éducatif pour la Santé »
Coopération multilatérale :
- Stratégies et Techniques contre l’Exclusion Sociale et la Pauvreté (STEP), BIT (projet visité), composante assurance santé pour les bénéficiaires de micro-crédits.
- Santé Maternelle et Infantile, projet régional UNICEF Bénin, Burkina Faso, Guinée. - Programme Onchocercose en Afrique de l’Ouest, OMS.
Fond belge de survie :
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 6
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
- (*) Projet de lutte intégrée pour la sécurité alimentaire dans l’Atacora Ouest (LISA),
Louvain développement, composante santé de base et mutuélisation. - (*) Programme régional d’appui aux Mutuelles de Santé (PROMUSAF),
Wereldsolidariteit On note aussi une intervention de l’Armée belge en santé, pour la construction du bâtiment qui abrite le service de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle de l’hôpital d’Abomey (CHR) et pour la construction d’une route qui a permis de désenclaver la région de Lalo. SSP en général SS reproductive VIH/SIDA Maladies
transmissibles International National + Système de soins SSP
+++ + +
Communauté +++ Du point de vue du focus, les projets de kinésithérapie et de sécurité transfusionnelle sortent de la matrice habituelle de la coopération belge. Les autres projets concernent
(1) les services de santé de base (CTB et UNICEF) (2) les mutuelles (BIT, LD et WS) (3) certaines maladies transmissibles (Buruli-IMT et Onchocercose-OMS).
Résumé de la politique nationale de santé Face au diagnostic réalisé à l’occasion de l’élaboration du document de Politique et Stratégies Sanitaires 2002-2006, le Ministère de la santé Publique a décrit les principales préoccupations du secteur comme suit :
- le taux de consommation des ressources financières reste encore faible, - l’allocation des ressources financières, matérielles et humaines n’est pas
suffisamment orientée vers les zones défavorisées, - la programmation, le suivi et l’évaluation sont insuffisamment assurés, - les supervisions sont faibles, - une frange importante de la population (les indigents) n’a pas accès aux soins, - la coordination des actions des différents acteurs n’est pas encore effective, - la décentralisation de la gestion des ressources n’est pas encore suffisante, - les normes et standards sont peu appliqués, - la vente de médicaments d’origine douteuse persiste, - la qualité des soins n’est pas encore ce que les populations attendent des centres
de soins, - le financement du secteur reste insuffisant.
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 7
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Les axes stratégiques de la politique sanitaire sont :
• La réorganisation de la base de la pyramide sanitaire et renforcement de la couverture sanitaire. Cet axe met l’accent sur le développement des 34 zones sanitaires, le renforcement de la participation de la communauté et de la collaboration avec les collectivités locales dans la mise en œuvre effective de la décentralisation.
• Le financement du secteur et l’amélioration de la gestion des ressources. Cet axe
porte essentiellement sur les systèmes de recouvrement des coûts et des formes de mobilisation des ressources impliquant les communautés.
• La prévention et la lutte contre les principales maladies et l’amélioration de la qualité
des soins. Cet axe comporte entre autres le renforcement du système hospitalier et celui du sous-secteur pharmaceutique en mettant l’accent sur la prise en charge des populations pauvres et indigentes.
• La prévention et lutte contre les maladies prioritaires : SIDA, paludisme et
tuberculose.
• La promotion de la santé familiale Dans son introduction au document de Politique et Stratégies (2002-2006) la Ministre de la Santé Publique insiste plus particulièrement sur :
• Les systèmes alternatifs de financement des services de santé au premier échelon et pour les soins hospitaliers, y compris les stratégies spécifiques pour les indigents
• La gestion du personnel de santé, pour palier la pénurie, y compris sous la forme de contrats externes ainsi que le développement de la motivation du personnel, c’est à dire du cadre de travail et des plans de carrière
• L’indépendance vaccinale • La collaboration avec le secteur privé • Les urgences (aide médicale urgente), les références et les contre-références • La maintenance préventive des infrastructures et des équipements • La lutte contre le VIH/SIDA, paludisme et tuberculose ainsi que la prise en charge
des problèmes des personnes âgées • L’attention particulière à donner aux pauvres et aux populations défavorisées
L’utilisation de la note stratégique La note stratégique santé est quasi inconnue au Bénin. Elle a été résumée en avril 2005 lors d’un atelier qui rassemblait les acteurs et partenaires de la coopération belge au Bénin, mais en fait personne ne l’utilise. Lors des identifications et des formulations, elle n’est pas citée et pas utilisée. Dans le rapport de formulation du PAZS-Bassila, une annexe résume la politique belge en matière de coopération en santé, mais il n’y a pas de référence explicite à la Note Stratégique. La méconnaissance du document est générale et concerne les partenaires nationaux, les acteurs directs, indirects et les partenaires multilatéraux.
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 8
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Il n’y a pas eu de discussions approfondies sur le document, malgré que celle-ci ait été prévue lors de la réunion générale des acteurs et partenaires de la CB (19 juillet, « brainstorming » préparé par l’Ambassade) dans la suite de l’atelier d’avril, préparé par l’Ambassade également. Dans l’intervalle, le document n’a pas été analysé en vue de la discussion durant l’évaluation. On pourrait analyser la non-utilisation de la note stratégique comme suit :
- Annoncé comme politique, ce document énonce les options de la Belgique (Soins de Santé Primaires, ses axes et ses accents). Celles-ci sont larges, consensuelles, et il serait difficile d’en écrire le contraire. La NS serait une compilation de ce que la Belgique entreprend en général dans les pays en développement et on n’y apprendrait rien de vraiment neuf.
- Ce document n’est pas vraiment stratégique car il ne répond pas aux questions comment ? qui ? où ? par où commencer ? On ne précise pas comment agir, comment conduire des projets/programmes de santé. L’expérience de la CB n’y est pas reprise pour ouvrir des pistes aux acteurs de terrain, ni pour éviter de commettre les erreurs du passé.
Les autres notes stratégiques (HIV/SIDA et Genre) ne sont pas non plus connues des acteurs et des partenaires belges en santé au Bénin.
Pertinence du projet d’un point de vue sectoriel et du partenariat
Impact sur le système de santé
L’impact important des projets belges concerne la disponibilité des soins de santé de base, dans les zones sanitaires (Comé, Bassila, Klouékenmé) et les mesures développées en amont par le PAZS-Mono (1999-2003) au niveau de la Cellule d’Appui au développement des Zones Sanitaires. Ces mesures ont permis au MSP de disposer d’un cadre de planification pour l’extension de la couverture sanitaire et de pouvoir inscrire au budget national une ligne budgétaire pour le fonctionnement des Zones de Santé. Un autre impact important est le développement des services de kinésithérapie (Cotonou et Abomey) et de l’école de kinésithérapie de Cotonou (APEFE). Ces projets ont permis de compléter les paquets d’activités et la réhabilitation fonctionnelle, l’habituel « parent pauvre » des services de santé, se développe de manière autonome et durable. En matière de ressources humaines, de systèmes de financement et de partenariat public – privé, les projets belges n’ont pas d’impact significatif. Ces aspects restent de très gros problèmes dans le système de santé béninois. Dans les DTF de l’aide directe, ces éléments sont plutôt énoncés dans les contraintes et hypothèses. Les projets mutuellistes développent un travail de base progressif et reconnu. Un cadre de concertation au niveau national vient de se constituer et ces approches auront certainement d’ici peu un impact sur la politique de financement du secteur. Il persiste néanmoins le risque que ces approches confortent le système actuel (très dépendant du financement communautaire et du financement des partenaires) sans avoir les leviers nécessaires pour des réformes, par exemple pour réduire les coûts.
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 9
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Les projets de recherche sur la mycobactérie de l’ulcère de Buruli et de santé maternelle et infantile (projet régional UNICEF), sont innovateurs mais ne sont pas actuellement structurés pour avoir un impact sur la politique de santé étant orientés vers leurs résultats immédiats. Dans le domaine des ressources humaines, les projets belges ont réalisé des formations cliniques pour les médecins des zones de santé (Brevet de Médecine Aiguë, « chirurgie de district ») et de nombreux travaux et réflexions sont développées sur ces sujets, en commun avec les projets des pays voisins (Niger, Burkina Faso). Par ailleurs, la Belgique a financé de nombreuses bourses de Santé Publique (à l’ULB, UCL et IMT). A leur retour, ces médecins de Santé Publique sont nommés Coordonnateur de Zone Sanitaire ou au niveau Départemental (niveau intermédiaire). Ils se consacrent aux tâches de gestion et de planification, délaissent la clinique et consacrent beaucoup de temps à des séminaires, des réunions parfois au détriment des supervisions. Il y a donc un certain « contre-effet » de ces formations. En guise de synthèse de ce paragraphe sur l’impact, on pourrait dire que l’impact principal de la CB au Bénin concerne le développement de services. L’impact au niveau central (CADZS) a été important également, mais conçu un peu comme une opportunité temporaire, sans relais par la suite pour aider le MSP dans les autres domaines importants pour le développement du système de santé. L’impact sur le système de santé est donc relativement limité, mais est-il en fait souhaité ou politiquement énoncé comme un but de la CB ?
Pertinence du partenariat institutionnel Partenariats institutionnels Projet Organisation de coopération b Partenaire(s) PAZS-Bassila CTB MSP PAZS-Klouékenmé CTB MSP Recherche Ulcère Buruli IMT Laboratoire de référence
Mycobactéries Rééducation fonctionnelle Abomey
APEFE Centre Hospitalier Départemental du Zou et MSP
Renforcement structurel école de kinésithérapie
APEFE Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche
Appui structurel au développement de la kinésithérapie au Bénin
APEFE -MSP -Ministère de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité -Faculté des Sciences de la santé
Réduction de la mortalité maternelle
UNICEF -MSP / Direction de la Santé Familiale
Lutte Intégrée pour la Sécurité Alimentaire dans l’Atacora Ouest
Louvain Développement (FBS) -ONG’s locales
Projet « Promusaf » Solidarité Mondiale -Programme Régional d’Appui aux Mutuelles de Santé
Le projet « LISA » de Louvain Développement (FBS) a développé un partenariat avec cinq catégories d’organisations ou institutions partenaires. Il s’agit surtout d’un projet de sécurité alimentaire du FBS, mais il montre, à titre d’exemple, combien le partenariat peut être étendu :
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 10
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
1- Les organisations paysannes: groupements paysans partenaires (63) dans 16 villages, et les unions faîtières d’organisations paysannes (11) présentes dans les 2 Communes.
2- Cinq organisations non gouvernementales locales 3- Les organes communaux et infra communaux élus dans le cadre de la
décentralisation : il s’agit du Conseil Communal, du Conseil d’Arrondissement et du Conseil de Village.
4- Les organisations partenaires techniques pour la capitalisation et les partenaires techniques prestataires de services
5- Les partenaires institutionnels du projet : L’Agence pour la Promotion de Petites et Moyennes Entreprises (PAPME), La Fondation UNIDEA, le Bureau de la Zone Sanitaire de Tanguiéta (BZ) et l’Hôpital St Jean de Dieu, qui est le centre de référence de la zone du projet ; Le PROMUSAF, L'Institut Régional de Santé Publique (IRSP), Le PAMRAD (CTB/DGCD) et le ProCGRN (GTZ), PROTOS/HAADI, Iles de Paix, Le Centre Régional pour la Promotion Agricole (CeRPA, Ex CARDER), Le PRODECOM et le PDL-Zou Collines.
Pour les projets très techniques comme celui de l’UNICEF ou de Recherche sur l’Ulcère de Buruli, les partenariats ciblés concordent bien avec les objectifs précis de ces projets. Pour les projets d’appui aux mutuelles de santé, il s’agit soit d’un partenariat ciblé sur l’objet « mutuelle » (Solidarité Mondiale avec PROMUSAF), soit de partenariats avec des associations et ONG’s locales (Louvain Développement). L’APEFE développe des partenariats directs avec les structures appuyées (école, hôpitaux). Pour les projets d’appui aux Zones Sanitaires, la CTB est en partenariat avec le Ministère de la santé. En tant que partenaire du MSP pour ces projets, la CTB « partage ses souffrances », dans le sens que les aspects concernant l’eau et l’assainissement, les aspects financiers et de ressources humaines, les questions relatives au partenariat public - privé dépendent aussi d’autres ministères. La coopération indirecte a bien sûr une structure et un fonctionnement différent de la coopération directe. En matière de partenariat on peut cependant en tirer des leçons qui peuvent être utiles au direct. Si le système de santé – et son ministère - connaissent des problèmes importants de ressources humaines, ne pourrait-on pas élargir le partenariat des projets bilatéraux en santé à d’autres ministères (fonction publique, enseignement supérieur) ou à des instances proches des réalités sociales des travailleurs en santé (syndicats, associations professionnelles, …). Les discussions menées au Ministère de la Santé ont été très ouvertes sur ces points : élargissement du partenariat au ministère des Mines (approvisionnement en eau potable), de la Famille et de la Solidarité (indigence), ou de la Décentralisation (pouvoirs communaux).
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 11
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Efficacité et pertinence des projets par rapport à la note
stratégique
Référence aux soins de santé primaires décrits dans la note stratégique
Les projets de la Coopération belge au Bénin reflètent tous bien l’esprit de la note stratégique : soins de santé primaires, services de santé avec souci d’intégration des activités, travail en profondeur sur les systèmes de mutualisation et prise en compte de « pathologies oubliées » (Ulcère de Buruli). Les projets kinésithérapie / rééducation fonctionnelle ne sont pas explicitement contenus dans la note stratégique. Ces activités sont un peu « le parent pauvre » des soins de santé primaires (comme les soins dentaires ou la santé mentale) et par là, de la note stratégique. En matière de lutte contre le SIDA, la CB au Bénin n’a pas d’actions spécifiques, hormis l’appui à la sécurité transfusionnelle et la prévention de la transmission de la mère à l’enfant et le dépistage volontaire du HIV développés dans le programme de l’UNICEF. Dans les projets bilatéraux (ZS), des études de prévalence, la promotion du dépistage volontaires et la prise en charge des malades (infections opportunistes) sont proposés. La raison essentielle de cette faible prise en compte tient au Programme Indicatif de Coopération (PIC) 2004-2007, résultat des travaux de la Commission Mixte et des requêtes adressées par le Gouvernement béninois ne mentionnant pas de besoins particuliers à soumettre à la Belgique dans ce domaine. On peut donc s’interroger sur le mécanisme mis en jeu pour l’élaboration des PIC et l’utilisation de la NS qui est faite à cette occasion (question à approfondir avec la DGCD). En comparaison avec les autres projets (indirects, universitaires, FBS), les projets bilatéraux de la CTB sur les zones sanitaires sont laborieux, conflictuels et les services de santé mis en place restent peu utilisés malgré les investissements, les formations et les travaux de « fine tuning » de type intermédiation sociale et études socio-anthropologiques relatives à cette sous-utilisation. Mais dans l’absolu il est difficile de critiquer la pertinence de programme d’appui à des zones sanitaires – un hôpital de référence et des centres de santé avec leurs systèmes de référence et de supervision – qui concernent plus de 200.000 habitants ! (voir plus loin).
Utilisation d’indicateurs Chaque zone sanitaire (projets coopération directe) fait l’objet d’un monitoring semestriel des activités de tous les centres de santé. La raison d’être de ce suivi rapproché semble tenir au suivi du « financement communautaire », mais à cette occasion l’Equipe d’Encadrement de la Zone Sanitaire (EEZS) recueille les indicateurs de couverture et d’utilisation pour toutes les activités de chaque structure de santé : vaccinations, consultation curative, consultations pré-natales, accouchements, … . Un rapport annuel de la ZS reprend également les indicateurs, y compris ceux qui concernent le fonctionnement de l’hôpital. Pour les projets ONG, les indicateurs sont plutôt de type « processus ». Par exemple, les projets de kinésithérapie recueillent des informations sur le nombre et le type de malades pris en charge. L’origine des patients fait partie du recueil de données mais ce type
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 12
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
d’information « populationnelles » ne sont pas utilisées pour des études de couverture ou d’aires d’attraction. PROMUSAF utilise des indicateurs propres au suivi de son programme (nombre d’adhérents par exemple) et des indicateurs de fonctionnement des services (taux d’utilisation). Si on peut dire que les indicateurs classiques (couverture, utilisation des services, …) sont mentionnés, les projets de la CB n’utilisent pas d’indicateurs plus spécifiques comme par exemple le taux d’hospitalisation (admissions), avec ou sans consultations de références, les besoins obstétricaux non couverts calculés en routine ou une approche de « couverture » pour les soins de kinésithérapie / réhabilitation.
Résultats Les projets d’appui aux zones sanitaires (Klouékenmé et Bassila) sont trop récents pour pouvoir en mesurer encore les résultats. Les évaluations mi-parcours restent à faire. Les aspects « hardware » progressent bien (construction et équipement des hôpitaux et des centres de santé). Les aspects de recherche et de contractualisation se développent petit à petit. Les aspects de formation sont bien développés. Des études socio-anthropologiques ont été menées dans les deux ZS. De ces études il découle que d’importants « chantiers » sont à mettre en oeuvre pour améliorer le contact avec les patients et la gestion des équipes. Les projets de kinésithérapie et de mutuelles de santé atteignent leurs résultats, sauf pour le volet mutuelles du projet « LISA » (Louvain Développement dans le Département de l’Atacora) qui a mis plus de temps que prévu pour trouver les partenaires locaux garantissant la qualité des soins. PROMUSAF obtient des résultats en termes d’ouverture de nouvelles mutuelles (documentation plus précise à notre disposition pour le Bénin, PROMUSAF étant un programme régional), de formations, d’augmentation du nombre d’adhérents, de plaidoyer et de renforcement du réseau mutueliste. Pour les recherches sur l’ulcère de Buruli, les informations ne sont pas complètes à ce stade (août). Les projets de kinésithérapie (APEFE) sont remarquablement aboutis et transmis aux nationaux ; les services de kinésithérapie de Cotonou et d’Abomey sont autonomes et fonctionnels et l’école de kinésithérapie poursuit son chemin vers cette autonomie prévue pour 2011.
Pertinence des ressources Mode de détermination des ressources :
- pour les projets bilatéraux, données du dossier d’identification, sans toujours bien savoir comment les montants sont déterminés, probablement entre autres sur des bases démographiques (PAZS-Bassila 3,8 Millions EUR ; PASZ-Kouékenmé 4,8 millions EUR)
- pour les projets ONG, le budget indicatif du plan quinquennal est reconsidéré chaque année (en fonction du total de l’enveloppe disponible pour l’ensemble des ONG).
- pour l’APEFE et les projets universitaires : donnée non récoltée.
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 13
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Pour les ZS, la détermination des ressources (un peu arbitraire et un peu standard) passe outre l’estimation des capacités d’absorption locale (équipe de ZS). Le paquet de ressources doit être consommé et en ce sens, cela gène les approches adaptatives et progressives qui sont tentées par les équipes d’assistants techniques. Pour les ONG, la réévaluation annuelle des budgets est une source majeure de problèmes pour le fonctionnement des projets et surtout pour l’engagement et la confiance des partenaires. Une négociation et un engagement quinquennal seraient plus adéquats. Ressources et résultats sont liés dès le départ dans les DTF. En termes de ressources par habitants (contribution belge et béninoise au projet) le PAZS-B = 9,5 EUR / habitant / an et le PAZS-KTL = 3,84 EUR / Habitant / an. En contribution belge : PAZS-B 2,8 M EUR 7 EUR / hab / an PAZS-KTL 2,6 M EUR 2 EUR / hab / an Les projets d’appui aux ZS sont donc des projets « généreux ». Cette « générosité » est liée au montant des enveloppes budgétaires pré-établies lors des identifications / formulations (sans savoir comment ces montants ont été décidés ni par qui, ni pourquoi il y a une telle différence entre les montants par habitant et par ZS) et aux standards (normes) du MSP. Les normes béninoises sont proportionnellement élevées par rapport aux autres pays de la sous-région. Cela se marque surtout au niveau des infrastructures (m² de surface, longueur et hauteur des clôtures) et des véhicules (5 à 6 véhicules 4 X 4 par ZS). La CB est consciente qu’il y aurait moyen de faire autant avec moins de ressources et le MSP insiste fort sur l’aspect de mise aux normes des ZS. La pertinence des ressources a donc ses points de vues. Nous en pensons qu’il faut pouvoir mieux privilégier des approches progressives, bien documentées de manière anticipée et consensuelle, par exemple en relevant de manière précise l’occupation des espaces (services de santé, cours d’hôpitaux et de centres de santé, …) et l’utilisation du matériel (kilométrage de service, privé, …).
Renforcement du système de santé Les projets ZS bilatéraux renforcent le système de santé en rendant fonctionnel des zones de santé. Jusque 2003 (PAZS-Comé), la coopération bilatérale a renforcé le niveau central (CADZS) pour la mise en route et le développement de l’approche zone de santé dans le pays (diagnostics, normes, procédures, suivi, évaluation). Les projets de kinésithérapie renforcent sensiblement le système de santé directement, en développant un secteur « non couvert » et indirectement par l’approche d’autofinancement qui est promue et par le renforcement de la collaboration interuniversitaire. Les projets de renforcement du secteur des mutuelles ne renforcent pas à proprement parlé le secteur formel du système de santé ; ils agissent plutôt au niveau de la société civile. A terme, les approches fédératives des mutuelles agiront sur le secteur par les aspects de négociations qu’ils induiront. . Le projet LISA s’appuie sur des structures de santé privée (confessionnelle) et dans ce sens renforce le partenariat public-privé. Les autres projets n’ont pas d’actions franches pour renforcer ce partenariat (excepté le projet PAZS-Mono 2 en cours d’identification qui se base
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 14
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
sur la contractualisation des structures de santé, en particulier de l’hôpital de Comé construit sous le PAZS-Mono 1). Les projets de la CB renforcent donc tous le système de santé à leur niveau. Ce renforcement ne fait pas forcément partie des objectifs ou des résultats attendus de ces projets. Cela montre que si ce renforcement était pensé en tant que tel, il serait très significatif.
Cohérence et complémentarité Il y a beaucoup d’actions qui visent la cohérence et la complémentarité : « Atelier Santé » organisé par l’Ambassade en avril 2005, réunions régionales pour la formation en chirurgie et en obstétrique au niveau des zones de santé, contenus du suivi scientifique réalisé par l’Ecole de santé Publique de l’ULB, visites entre les projets (Klouékenmé-Bassila). On note aussi des visites et des échanges avec les projets de zones sanitaires appuyés par les autres coopérations (suisse, néerlandaise). Le Comité de Coordination des partenaires est l’instance officielle chargée d’assurer la cohérence entre les intervenants. Parmi les préoccupations de ce Comité, on évite le plus possible les doubles emplois et les superpositions géographiques des projets. Dans l’ensemble, la cohérence des projets « zone sanitaire » est bonne, car en ligne avec la politique de santé du pays (qui va entièrement dans ce sens). Pour ce qui est des contenus et des processus, on peut remarquer que les projets sont définis un peu en « vase clos » et le souci de complémentarité surgit en cours de projet, à l’initiative des acteurs, souvent les assistants techniques. A titre d’exemple, le projet Santé Maternelle de l’UNICEF dans le Département du Zou (Abomey) développe des approches innovatrices (consultation prénatale « recentrée » par exemple) qui ne sont pas, ou pas encore, partagées avec les autres intervenants au niveau des services de santé de base. Les problèmes d’accès aux soins et de gestion d’équipe mis en évidence par les études socio-anthropologiques ne font pas l’objet d’échanges sur ces thématiques pourtant très présentes et très problématiques sur l’ensemble du pays. L’articulation avec les projets ONG/APEFE (mutuelles et kinésithérapie) est présente sur le terrain (les gens se voient et se parlent) mais tant du point de vue géographique que de l’offre de soins, il n’y a pas eu de réflexions au préalable, lors de la conception des projets. Structurellement, les projets ONG/APEFE sont autonomes dans leur conception (et soumis à la DGCD pour co-financement), mais il n’y a pas de démarches formalisées préalables pour que ces projets soient réalisés dans les zones où la coopération directe intervient (ou l’inverse). Les tentatives de rapprochements sont nombreuses et se négocient, souffrant ainsi de « l’après-coup », chargé de la nécessité pour chacun d’accomplir les priorités définies dans son DTF.
Réponse aux besoins de santé Pour les projets d’appui aux ZS, la réponse aux besoins de santé est traduite concrètement en projets de développement de l’offre de soins. On peut noter (est-ce d’ailleurs une « spécificité belge » ?) que ces projets s’appuient fortement sur le développement de l’hôpital de district (ce fut le cas aussi dans le projet PAZS-Mono 1). Les problèmes d’offre, d’accès, de qualité des soins sont envisagés de manière détaillée. On peut certainement poser le jugement qu’il s’agit de réponses pertinentes aux besoins de soins de santé.
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 15
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Les projets de mutuelles abordent les choses autrement, par l’induction d’une demande et d’un besoin. Ce besoin est reconnu au niveau international, mais le démarrage très progressif de ces initiatives montre que les habitants couvrent ce nouveau besoin très prudemment (« on attend de voir »). Les projets de kinésithérapie et de recherche sur l’Ulcère de Buruli (dont on ne connaît pas encore la « trajectoire » épidémiologique !) répondent à des besoins ; ils ont du pour cela s’affirmer et se développer. Sauf pour les projets de mutuelles qui, sans adhésion libre et ferme des membres à l’organisation perdent leur sens, les processus participatifs de définition des besoins sont probablement plus réels (et réalistes) avec les autorités et les agents de santé qu’avec les populations. En effet, les processus d’identification et de formulation sont trop rapides et trop cadrés (arbres à problèmes et à objectifs) pour qu’on puisse raisonnablement les qualifier de participatif au niveau des populations. Par ailleurs, les responsabilités limitées que prennent les comités de gestion (des centres de santé et des zones sanitaires) et dans certains cas leur absence (à Bassila, une des composantes du projet est de les rendre fonctionnels), ne plaident pas pour un processus réellement participatif dans les limites imposées par un projet de santé qui multiplie par 2 ou par 3 les ressources.
Impact (potentiel sur la santé) intersectoriel Les projets mutuellistes sont tous insérés dans des dispositifs plus vastes (micro-crédits, activités génératrices de revenus, projets agricoles et environnementaux). Pour les projets plus orientés vers les soins de santé, les approches multisectorielles ne sont pas vraiment présentes. Il est probablement difficile d’envisager des actions de développement des soins de santé en même temps que d’autres actions, vu la logique très spécifique et très technique de ces projets (zones de santé, santé maternelle, kinésithérapie, ulcère de Buruli). Par contre, il pourrait y avoir plus de synergie entre les projets mutuellistes et les projets « services de santé ».
Préoccupations transversales
Durabilité Pour envisager cette question de façon quelque peu dynamique, nous partirons de l’exemple du projet de kinésithérapie de l’APEFE. Non pas que ce projet soit à copier où qu’il ait « mieux » agit que les autres ! C’est un projet qui a eu des « chances » très spécifiques, pas vraiment reproductibles mais dont on peut tirer des enseignements :
- le développement d’une nouvelle activité, presque d’un nouveau secteur, - une approche très progressive, étalée sur 20 ans : premières actions en 1991,
autonomie de la formation initiale et de plusieurs services prévue pour 2011, - un partenariat avec une institution belge (académique, UCL) développé sur une
base de similarité et d’équité des services et des techniques, - un appui personnalisé à des leaders porteurs de changements, - un cadre scientifique et organisationnel de soutien aux leaders (et la possibilité
donnée à tous de le devenir)
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 16
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
En revanche, les projets d’appui aux ZS ont une durabilité qui reste questionnable. Les projets interviennent de manière importantes dans le fonctionnement des services, plusieurs personnels-clés (gestionnaires, cliniciens) sont payés sur les fonds du projet et la « rente » du projet est un enjeu majeur à plusieurs niveaux (perdiems, véhicules, logements, indemnités de déplacement, de formation, …). Quand tout cela s’arrête, la relève est difficile (voir le cas du PAZS-Mono 1, en particulier de l’hôpital de Comé gravement sous-utilisé) en l’absence des apports et des bénéfices matériels du projet. En comparant les approches, ont pourrait dire que la durabilité des projets d’appui aux ZS souffre structurellement de handicaps tels que :
- le développement d’une approche d’emblée conflictuelle, entre autres parce que le « chef lieu » de la zone de santé et donc l’implantation de l’hôpital est choisi au « bénéfice » d’une commune (sur 2 ou sur 3), et donc difficile à proposer comme un plus, une nouveauté, un projet qui emballe,
- l’attrait des ressources du projet (indemnités, véhicules) comme facteur important de motivation,
- l’attention privilégiée des équipes bénino-belges pour les objectifs du projet, qui sont des objectifs de développement, mobilisateurs, liés à un changement, à une situation nouvelle et cette attention particulière n’est pas (ou plus) consacrée au fonctionnement courant des services qui concerne des tâches plus routinières et moins passionnantes
- les responsabilités parfois écrasantes de la gestion des fonds et des intérêts qu’ils suscitent,
- une approche rapide (projets de 4 ou 5 ans) de transformation brutale de l’environnement (véhicules 4X4 neufs, bâtiments, …),
- un « bricolage » scientifique de la ZS, plus gestionnaire et gestion de conflits que santé publique,
- l’isolation, voire « l’auto-proclamation » des cadres de district comme entité professionnelle et scientifique après leur formation en santé publique,
- un appui indifférencié aux responsables (« l’administration c’est la continuité ») favorisant aussi bien un leader qu’un suiveur,
Dans le projet multilatéral de l’UNICEF (Santé Maternelle), on retrouve certaines des conditions de faible durabilité liée à l’approche d’un projet classique (résultats attendus quelles que soient les conditions, staff local payé sur le projet, temps court, …) mais on y trouve aussi des approches novatrices (dépistage volontaire du HIV chez les femmes enceintes, consultation prénatale recentrée) qui « jouent » sur la capacité de mobilisation pour la nouveauté. De nos analyses, il ressort que, certes la durabilité d’une zone sanitaire est problématique, mais que le dispositif de projet tel qu’il est conçu, permet peu de développer des approches novatrices et de soutenir des équipes qui apprennent à devenir gagnantes par rapport aux contraintes du développement des services de santé. Le projet de recherche sur l’Ulcère de Buruli a développé, selon cette grille d’analyse, une approche durable dans le sens qu’il fut tout d’abord une collaboration avec l’IMT, qu’il est novateur car beaucoup reste à faire pour trouver le mécanisme de transmission, et surtout parce que (comme le projet de kinésithérapie) il s’appuie sur un partenariat scientifique très égalitaire (thèses, publications en commun, intéressement à la recherche, …). Les projets mutuellistes restent aussi très fragiles, entre autre parce que les cotisations des membres (quelques centaines de FCFA) couvrent les frais de traitement au centre de santé mais tout « l’amont » de l’approche est encore financée sur des fonds extérieurs. Ces projets s’inscrivent cependant dans une logique et une dynamique qui affirment le long terme comme une nécessité et qui travaillent aux regroupements nécessaires pour y arriver (travail en
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 17
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
réseaux, fédéralisation, plates-formes de concertation). On retrouve dans ces projets un partenariat avec une institution (les Mutualités Chrétiennes) qui fonctionne sur une base d’échanges d’expérience et de valorisation des actions. Pour mettre cela en perspectives (plutôt que d’accabler les projets bilatéraux d’appui aux zones sanitaires !), on pourrait plaider pour :
- des projets progressifs, modulables en fonction de priorités concrètes, limités et créatives (le développement global et réfléchi d’un centre de santé ou d’un service « pilote » par exemple),
- le soutien à une entité professionnelle de santé publique basée sur une reconnaissance nationale et internationale par des pairs (association de santé publique par exemple),
- un partenariat scientifique entre une équipe locale et une équipe belgo-internationale, basé sur des engagements réciproques en termes de résultats, de promotion, de publications,
- un montage de coopération qui ne lie pas l’instance de mise en oeuvre (la CTB) aux décaissements prévus (overhead) mais qui permet à celle-ci de réellement moduler les appuis,
- par là, un dispositif de coopération alternatif, un genre de « fond » de projets, finançant des initiatives porteuses.
L’approche de lutte contre les maladies transmissibles Le projet de recherche sur l’Ulcère de Buruli est très spécifique. Il s’insère au niveau du laboratoire national de mycobactérie. Bien que spécifique, cet appui est en lien avec des structures elles aussi spécifiques pour des raisons cliniques évidentes (exemple de du service au centre de Santé de Lalo, dans la zone sanitaire de Klouékenmé) mais qui s’insère dans le dispositif « zone sanitaire » par des formations intégrées du personnel (dépistage précoce). Les projets de Klouékenmé et de Bassila (zones sanitaires) prévoient des actions de lutte contre le SIDA et contre la malaria. Il n’y a pas au niveau opérationnel de services spécifiques pour les maladies transmissibles. L’intégration des activités est donc d’emblée effective. Pour le PAZS-KTL, une étude CAP sur le SIDA a été réalisée (sous contrat ONG) et est prévue pour les moustiquaires imprégnées. Il est donc difficile de mesure actuellement le degré d’intégration effective de ces activités. Pour le PAZS-Bassila, une étude a été réalisée à l’hôpital et montre que parmi les séro positifs dépistés, peu consultent pour le traitement des infections opportunistes. Ceci montre néanmoins un souci de la part du staff d’intégrer l’approche du traitement des personnes vivant avec le VIH dans les services hospitaliers généraux.
Partenariats internationaux Au Bénin, l’apport belge tourne essentiellement autour du développement des soins de santé de base, au niveau des zones sanitaires. La Belgique est active au niveau central pour les travaux qui concernent l’approche sectorielle.
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 18
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
A ce chapitre, notons les partenariats avec les institutions belges (Buruli / IMT, Kiné / UCL, PROMUSAF / Mutualités Chrétiennes). Ces partenariats sont des points-clés des projets ONG / APEFE en termes de professionnalisation, d’engagements scientifiques réciproques et de promotions personnelles.
Partenariats nationaux Les questions relatives au cycle de décisions préalables pour l’identification d’un projet n’ont pas été résolues sur place ; ces questions seraient à examiner à Bruxelles de manière plus globales, avec, entre autres, celle de la détermination des montants disponibles annoncés lors d’une identification. Au niveau du partenaire principal de la coopération directe en santé (le Ministère de la santé), la coopération belge est très appréciée parce qu’elle est pragmatique, concrète et qu’elle aide le ministère pour le développement de sa politique de santé. La coopération belge est aussi appréciée parce qu’elle intervient au niveau des infrastructures et aide à réaliser la couverture sanitaire. Les cadres du ministère sont associés à toutes les étapes du processus. La co-gestion est, à ce niveau, appréciée, tandis qu’au niveau local, elle peut être perçue par les cadres nationaux comme une surcharge ou un facteur de ralentissement. Au niveau des points faibles, le MSP déplore que la CB ne respecte pas toujours les normes nationales en matière de constructions et que la Direction du ministère chargée du suivi des infrastructures n’est pas suffisamment impliquée (à cela la CB répond que la fonctionnalité prévaut sur la norme et que celle-ci est un idéal). Le MSP déplore également le manque d’information sur le suivi financier des projets belges ; les rapports sont pourtant transmis régulièrement mais la CB devrait prévoir dans ses DTF les formes et les périodicités de suivi financier propres au MSP. Concernant les infrastructures (en tant que point habituel de divergence), on peut prendre cela comme exemple de dialogue difficile. Il semble que le MSP et la CB n’arrivent pas toujours à exprimer leurs points de vue sereinement (d’autres partenaires, moins participatifs, n’ont bien sûr pas ces problèmes !). Toujours comme exemple, en approfondissant le dialogue, le MSP est tout à fait d’accord pour des approches progressives et réfléchies en termes d’infrastructures, pour qu’elles soient pertinentes et viables (ce qui rejoint les préoccupations belges), mais les dimensions des structures doivent être respectées. Peut-être pourrait-on voir dans cette difficulté de dialogue la tension excessive qu’induit un projet, son temps d’exécution court et son budget conséquent. Quant à l’aide budgétaire, le MSP est tout à fait preneur, mais suggère, comme le fait la coopération suisse, de continuer aussi les projets. Le MSP trouve qu’il faut arrêter de former des cadres en Santé Publique. Le pays manque plutôt de cliniciens. Nous (la mission) pensons qu’effectivement la spécialité de santé publique pose problème de plusieurs points de vue : formé en 1 an, contre 4 ou 5 pour les autres spécialités, le médecin de santé publique sort des tâches cliniques, en particulier des gardes. Il est propulsé à un poste de responsabilité, s’il a de la chance, là où il y a un projet, et dans ce cas il est doté de moyens conséquents (logement, véhicule) et a accès à des moyens supplémentaires (perdiems, indemnités diverses). La profession devient plus attractive que celles de cliniciens. Ces préoccupations sont d’ailleurs relevées dans le projet PAZS-Bassila, dès le DTF.
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 19
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
D’un autre côté, les médecins de santé publique au Bénin sont regroupés dans une association qui, au dire de quelques-uns de ses membres, n’affronte pas encore les vraies questions de la profession. Côté belge, les écoles et instituts de formation (UCL, IMT, ULB) n’assurent pas ou ne peuvent pas assurer, au pays, le rôle continu de pair et de garant que l’on peut retrouver dans les spécialités cliniques. L’Institut Régional de Santé Publique de Ouidah, sur place, non plus. Les formations d’Anvers et de Bruxelles ont certes des contenus techniques pertinents pour l’organisation des services de santé, mais soit elles devraient mieux préparer les médecins à gérer des projets (au sens large et engagé), soit elles devraient promouvoir la formation, au pays si possible, de personnels gestionnaires de projets et de systèmes de santé pour laisser les médecins à la santé publique de terrain et surtout, à la clinique. Le MSP est d’accord avec l’idée d’élargir le partenariat à d’autres ministères (Mines pour l’eau, Affaires Sociales pour les fonds de solidarité et la question des indigents). Un partenariat national qui participerait à la professionnalisation des différentes professions en santé manque et serait essentiel (suivant l’exemple, transposé « au pays » des partenariat APEFE/UCL, PROMUSAF/Mutualité Chrétiennes, …). Les projets ONG et APEFE ont des partenariats plus directs avec leurs homologues (CNHE par exemple, ou partenaire local de mise en oeuvre).
Partenariats avec les communautés locales Partenariat fort pour les projets de mutuelles. C’est d’ailleurs leur fondement. Nous avons pu voir combien ce partenariat est effectif. La structure mixte de concertation locale (SMCL) des projets bilatéraux est composée de (exemple du PAZS-KTL):
- Le représentant du Ministre chargé de la Coordination de l’Action Gouvernementale, de la Prospective et du Développement,
- Le représentant du Ministre des Finances et de l'Economie, - Le représentant du Ministre des Affaires Etrangères et de l'Intégration
Africaine, - Le responsable du niveau central du Ministère de la Santé Publique,
Ordonnateur du projet, - L’Attaché de la Coopération Internationale (ou la personne faisant
fonction) auprès de l'Ambassade de Belgique à Cotonou, - Le Représentant Résident de la CTB, Coordonnateur du projet (ou son
délégué), - Le Préfet du Département du Mono-Couffo (ordonnateur des crédits), - Le Directeur Départemental de la Santé Publique du Mono-Couffo, - Le Président du Comité de santé de la ZS de Klouékanmè-Toviklin-
Lalo. De plus, le délégué permanent du Comité de santé est statutairement tenu de cogérer les fonds de la ZS avec le Médecin-Chef ZS, en co-gestion avec l’AT belge. Le partenariat local est donc effectif mais limité.
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 20
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Au Bénin, les Communes mise récemment en place, cherchent leur place dans les dispositifs des projets (elles bénéficient d’appuis spécifiques de la CB par d’autres projets que les projets santé).
L’égalité des chances femmes / hommes Thème envisagé lors des formulations ; soins obstétricaux, affectation de personnels féminins dans les centres de santé. Thème peu suivi et peu monitoré (indicateurs).
La lutte contre le SIDA La lutte contre le SIDA n’a pas fait l’objet de la requête adressée par le Gouvernement béninois au Gouvernement belge lors de la Commission Mixte (mai 2004). Sauf l’appui à la sécurité transfusionnelle, il n’y a donc pas d’actions spécifiques en matière de lutte contre le SIDA, pour ce qui concerne la coopération directe. Au niveau des projets d’appui aux ZS, les DTF prennent en compte la lutte contre le SIDA pour les aspects de dépistage volontaire et de prise en charge des infections opportunistes. Des actions ont été menées dans ce sens, de manière intégrée aux activités de la ZS. Le projet « Santé Maternelle » de l’UNICEF (Département du ZOU) comporte un important volet d’information du public, de formation du personnel de santé, de dépistage volontaire et de prévention de la transmission mère-enfant. L’appui de la CB en matière de SIDA est donc pertinent quoique assez limité, et ce, en accord avec les autorités béninoises. La prévalence générale du VIH/SIDA est relativement faible (elle était de 1,9 % en 2003). Mais si la situation n’est pas préoccupante, c’est aussi l’occasion de débuter un appui à des prises en charge structurées et bien organisées, réalisées dans de bonnes conditions, avant que les services soient débordés par les malades atteints du SIDA.
Préoccupations de développement issues de la note stratégique
Développement durable
L’aide belge suit la politique nationale de santé. On notera que celle-ci est quelque part inspirée d’un savoir-faire belge centré sur le développement de districts opérationnels. D’un point de vue plus critique, on peut dire que cette politique, comme la NS belge, manque totalement de stratégies opérationnelles : Par où commencer ? Comment s’empêcher de tout faire à la fois ? Comment être efficient ? ….. . Ces questions sont absentes des documents de politique sanitaire nationale, ou disons qu’elles n’ont pas fait l’objet de réflexions et de documents stratégiques. Ces questions sont laissées aux équipes en périphérie. Dans ce sens, les zones sanitaires développées comme des pavés que l’on dépose sur la terre nue sont une saine illusion qui n’a rien de durable ! On retrouve au Bénin un travers non
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 21
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
durable issu de la Santé Publique : les problèmes sont exprimés sous la forme de prévalences et d’incidences (de maladies transmissibles le plus souvent) et les programmes nationaux ainsi que les projets ont pour objectif essentiel de réduire ces taux. Le moyen utilisé – le système de santé et son développement – est malheureusement bien maigre et partiel pour ce genre d’objectif. Le système de santé sert à offrir des soins, dont on appréciera éventuellement l’action en mesurant des incidences ou des prévalences, mais pris comme des indicateurs et non pas comme des objectifs. Confusion de but et d’objet, et par là, durabilité inaccessible. Il serait donc plus approprié de définir les problèmes en termes opérationnels ou en termes de management plutôt qu’en termes épidémiologiques. Les projets kiné de l’APEFE proposent un développement de services en réponse à un besoin de soins « non couverts » (il est vrai qu’en matière de handicap, il n’y a pas vraiment « d’incidence »), ce qui est probablement plus réaliste, moins sous tension, plus adapté à ce que des hommes et des femmes ont besoins (les patients) et ont à faire tous les jours, soigner (le personnel de santé). [Voir à ce sujet le nouveau « langage » de l’UNFPA qui parle d’EFFET et de PRODUIT plutôt que d’objectifs et de résultats. Il semblerait aussi – à vérifier – que même l’UNICEF soit en train de « changer » et de passer à des approches de type produits de services plutôt qu’action sur des indicateurs]. La Belgique est très présente au niveau de la coordination des partenaires en santé. Elle est chef de file adjoint de la Suisse. Au Bénin, ce processus de coordination fonctionne bien et à la satisfaction du Ministère de la Santé. Mécanismes de suivi-évaluation réguliers (rapports, …). Guidance scientifique organisée (Ecole santé publique ULB pour les projets appui aux ZS). La guidance scientifique concerne principalement les activités de recherche dans les ZS, ce qui est en soi pertinent mais pas à tout moment. La guidance gagnerait à concerner aussi d’autres aspects de santé publique (design hospitalier, aspects de gestion des personnels, pédagogie, …), de management ou de conduite de projet. Les évaluations à mi-parcours et les évaluations de fin projet sont programmées. Pour des projets/approches complexes du genre de ceux qui sont développés par la CB au Bénin, il vaut peut-être mieux concevoir du monitoring continu plutôt que des évaluations ; cela peut éviter de laisser enkyster des problèmes. Si on poursuit dans la logique des évaluations, vu le niveau de formation et d’expérience des cadres béninois de la santé et des assistants techniques on peut aussi raisonnablement organiser des auto-évaluations, comportant éventuellement un appui méthodologique externe. Les projets bilatéraux souffrent d’une faible mémoire et de faibles capitalisations inter et intra projets.
Méthodes et stratégies opérationnelles Les projets de la CB montrent des méthodes très valables et très affinées tant du point de vue clinique que du point de vue de santé publique. On a parlé plus haut d’un certain « bricolage », mais ce n’est pas sur les méthodes (conduites à tenir, schémas de gestion, stratégies de type tutorat, …), plutôt sur l’agencement de l’ensemble de ces éléments - très professionnels - au niveau de la zone sanitaire.
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 22
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Les projets Kiné de l’APEFE et les projets de mutuelles sont très professionnels également.
Renforcement des capacités Au Bénin, la CB fait et a fait beaucoup pour renforcer les capacités des personnels de santé et des cadres. Les problèmes d’affectation du personnel, surtout féminin, en périphérie, de turn-over, de fuite de cerveau vers les organisations internationales, les ONG’s et les projets persistent. La CB a réalisé peu d’études approfondies sur ces questions (ce n’est pas son mandat non plus). On citera cependant les processus d’intermédiation sociale et les analyses socio-anthropologiques conduites dans les zones sanitaires. Au Bénin, le contexte général est en plus très difficile car il y a peu d’ouverture vers des approches plus personnelles, plus professionnelles, on en reste à la « gestion des ressources humaines » et tout cela semble un peu trop mécanique ou logistique, comme s’il suffisait de « gérer » des hommes et des femmes, or que ceux-ci et celles-ci ont des propositions à faire, des avis, des contraintes à exprimer. Du côté de la coopération indirecte, les choses se passent différemment ; les personnels sont attirés vers les projets et ils y sont attirés par un ensemble de facteurs – dont le facteur financier – de promotion personnelle : scientifiques, humains, environnementaux, sécuritaires. Exemples dans le projet de kinésithérapie, Ulcère de Buruli et mutuelles. Ce qu’il y a de commun dans ces approches c’est le fait de soutenir et/ou de révéler un projet personnel mobilisateur. A côté de cela, les dispositifs de « motivation » sont beaucoup plus éphémères (voir la suite du projet PAZS-MONO 1 à Comé). Côté de l’assistance technique bilatérale (CTB), les choses sont difficiles et la co-gestion est toujours conflictuelle. On peut y voir des problèmes liés à « l’exécution » de projets fortement prédéterminés qui limitent la créativité de chacun des partenaires et les aménagements possibles, par exemple sur des aspects plus conflictuels comme les véhicules (nombre, utilisation) et les infrastructures (surface, dimension des clôtures). En pratique, la co-gestion est appréciée par les cadres nationaux surtout parce qu’elle est décentralisée.
Stratégies de financement Pas mal de travaux (dont ceux de la CB et CTB) montrent combien le financement de la santé pose problème au Bénin, entre autre parce qu’il s’appuie fortement sur le « financement communautaire », c’est à dire la participation financière de la population. Au niveau des services de santé et des zones sanitaires, les réflexions sur la réduction des coûts sont quasi inexistantes. On continue ainsi à voir des infrastructures sortir de terre, or qu’on ne sait pas comment on va en financer le fonctionnement ni l’entretien. Le financement par exemple d’un véhicule et de son fonctionnement au niveau des centres de santé de commune dans lesquels sont affectés des médecins est sujet de débats entre la CB et la MSP. L’approche des projets de mutuelles est prometteur mais celle-ci requiert au préalable des services de santé fonctionnels et en interaction constructive avec la population, ce qui n’est
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 23
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
pas le cas partout (voir par exemple le retard pris par le projet LISA dans l’Atacora du à la recherche prolongée de partenaires-prestataires de soins acceptables). Une approche pro-pauvre se dessine au niveau du MSP (un milliard de FCFA est à répartir entre les structures de santé), ce qui est encourageant. Le projet PAZS-Mono 2 en cours d’identification propose une vision différente de l’habitude, c’est à dire de financer la demande plutôt que l’offre, par un « Fond d’achat de services ».
Actions de plaidoyer La mission n’a pas relevé d’actions spécifiques structurées dans ce sens.
Plan d’action par pays Plan d’action pays en santé non disponible.
La recherche Le projet d’appui à la lutte contre l’Ulcère de Buruli est un projet de recherche à part entière. Les projets d’appui aux ZS comportent des volets de recherche opérationnelle, et la guidance scientifique de l’Ecole de Santé publique de l’ULB en assure l’appui. Le processus est en cours et intéresse le système de référence et contre-références, les coûts de prise en charge hospitalière, la consultation prénatale et l’efficience des vaccinations. Ces besoins en recherche ont été élaborés localement, à l’occasion d’un séminaire encadré par l’équipe de l’ULB et de l’IRSP.
Fonds global Sans objet
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 24
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Conclusions et recommandations
CONCLUSIONS Les projets de la CB au Bénin rentrent dans le focus de la note stratégique (soins de santé primaires, santé reproductive et lutte contre les maladies transmissibles) sauf pour ce qui concernent les projets de l’APEFE, mais tant du point de vue du processus de coopération que des contenus, ces projets apportent des innovations très pertinentes.
L’aide directe (CTB) est focalisée sur des projets d’appui aux zones sanitaires (le « district sanitaire » au Bénin) et donc sur les soins de santé primaires. La CB a également fourni un appui au niveau central à la Cellule d’Appui au Développement des Zones Sanitaires. L’aide indirecte (ONG) concerne des projets de création de mutuelles (Louvain Développement) et d’assistance médicale (Médecins Sans Vacances). Les projets inter-universitaires ciblés concernent l’appui au laboratoire de référence TBC et Mycobactéries et l’extension au niveau national du projet de lutte contre l’Ulcère de Buruli, (IMT- Anvers), l’appui au développement des systèmes de micro-assurances santé pour le renforcement des capacités d’enseignement et de recherche en Afrique de l’Ouest (Ulg, ULB) et la création d’un réseau de futurs enseignants de l’anesthésie-réanimation (UCL). Les projets de l’APEFE concernent le renforcement du service de rééducation fonctionnelle du centre Hospitalier Départemental du ZOU, le renforcement de l’Ecole de kinésithérapie, l’appui structurel au développement de la kinésithérapie au Bénin, le renforcement du Service National de Transfusion Sanguine et le renforcement structurel du programme « Matériel éducatif pour la Santé ». La Coopération multilatérale intervient au niveau du BIT (Stratégies et techniques contre l’exclusion sociale et la Pauvreté), de la Santé Maternelle et Infantile (projet régional UNICEF) et du Programme Onchocercose en Afrique de l’Ouest (OMS). Le Fond belge de survie finance le projet de lutte intégrée pour la sécurité alimentaire dans l’Atacora Ouest (Louvain développement) et le programme régional d’appui aux Mutuelles de Santé (PROMUSAF, Wereldsolidariteit).
Méthodologiquement, le nombre et la variété des projets a permis, tout en utilisant la même grille d’analyse et en procédant à des visites complémentaires de projets non ciblés au départ par l’évaluation, de faire des comparaisons entre les différents processus de coopération. Note stratégique Au Bénin, la note stratégique est peu connue et peu utilisée. Elle serait en fait une compilation de ce que la Belgique entreprend en général dans les pays en développement et on n’y apprendrait rien de vraiment neuf. Par ailleurs, ce document n’est pas vraiment stratégique car il ne répond pas aux questions comment ? qui ? où ? par où commencer ? On ne précise pas comment agir, comment conduire des projets/programmes de santé.
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 25
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Impact et résultats Un impact important des projets belges concerne la disponibilité des soins de santé de base, dans les zones sanitaires et les mesures développées en amont, au niveau de la Cellule d’Appui au développement des Zones Sanitaires du MSP. L’impact de cet appui au niveau central a été important mais conçu un peu comme une opportunité temporaire, sans relais par la suite pour aider le MSP dans les autres domaines importants pour le développement du système de santé : en matière de ressources humaines, de systèmes de financement et de partenariat public – privé, les projets belges n’ont pas d’impact significatif. Ces aspects restent problématiques dans le système de santé béninois. Dans les DTF de l’aide directe, ces éléments sont énoncés dans les contraintes et hypothèses plutôt que lors de la définition des problèmes généraux, exprimés habituellement en termes épidémiologiques. En comparaison avec les autres projets (indirects, universitaires, FBS), les projets bilatéraux de la CTB sur les zones sanitaires sont laborieux, conflictuels et les services de santé mis en place restent peu utilisés malgré les investissements, les formations et les travaux de « fine tuning » de type intermédiation sociale et études socio-anthropologiques relatives à cette sous-utilisation. Par ailleurs, la Belgique a financé de nombreuses bourses de Santé Publique (à l’ULB, UCL et IMT). A leur retour, ces médecins de Santé Publique sont nommés Coordonnateur de Zone Sanitaire ou au niveau Départemental. Ils délaissent malheureusement les activités cliniques et les conflits de pouvoirs, liés à la maîtrise des ressources des projets qui leur sont confiés, sont fréquents. On peut noter (est-ce d’ailleurs une « spécificité belge » ?) que les projets d’appui aux ZS prennent comme base le développement de l’hôpital de district Les projets de recherche sur la mycobactérie de l’ulcère de Buruli et de santé maternelle et infantile, sont innovateurs mais ne sont pas actuellement structurés pour avoir un impact sur la politique de santé étant orientés vers leurs résultats immédiats. Un impact important de la CB est le développement des services de kinésithérapie. Ces projets ont permis de compléter les paquets d’activités. Ainsi, la réhabilitation fonctionnelle, habituel « parent pauvre » des services de santé, se développe de manière autonome et durable. Les projets mutuellistes développent un travail de base progressif et reconnu. Un cadre de concertation au niveau national vient de se constituer et ces approches auront certainement d’ici peu un impact sur la politique de financement du secteur. L’attention des acteurs est néanmoins focalisée sur le risque de conforter le système actuel - très dépendant du financement communautaire et du financement des partenaires - sans avoir les leviers nécessaires pour des réformes, par exemple pour réduire les coûts. Les projets de la CB renforcent donc tous le système de santé à leur niveau. Ce renforcement ne fait pas forcément partie des objectifs ou des résultats attendus de ces projets. Cela montre que si ce renforcement était pensé en tant que tel, il serait très significatif. L’impact global sur le système de santé est donc relativement limité, mais est-il en fait souhaité ou politiquement énoncé comme un but de la CB ?
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 26
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Point particuliers concernant les partenariats Le projet « LISA » de Louvain Développement (FBS) a développé un partenariat avec cinq catégories d’organisations ou institutions partenaires. Il s’agit surtout d’un projet de sécurité alimentaire du FBS, mais il montre, à titre d’exemple, combien le partenariat peut être étendu. Au niveau du partenaire principal de la coopération directe en santé (le Ministère de la santé), la coopération belge est très appréciée parce qu’elle est pragmatique, concrète et qu’elle aide le ministère pour le développement de sa politique de santé. La coopération belge est aussi appréciée parce qu’elle intervient au niveau des infrastructures et aide à réaliser la couverture sanitaire. Les cadres du ministère sont associés à toutes les étapes du processus. La co-gestion est, à ce niveau, appréciée, tandis qu’au niveau local, elle peut être perçue par les cadres nationaux comme une surcharge ou un facteur de ralentissement, bien qu’on en apprécie l’aspect fortement décentralisé. Pour les projets bilatéraux, le MSP est favorable à l’élargissement du partenariat à d’autres ministères (fonction publique, enseignement supérieur, ministère en charge de l’eau) ou à des instances proches des réalités sociales des travailleurs en santé (syndicats, associations professionnelles, …) afin de pouvoir agir sur les problèmes récurrents du secteur comme celui des ressources humaines ou des approches intersectorielles ( dans les projets de la CB orientés vers les soins de santé, les approches multisectorielles ne sont pas vraiment présentes). Un partenariat national qui participerait à la professionnalisation des différentes professions de santé manque et serait essentiel, suivant l’exemple, transposé « au pays » des partenariats étroits de l’APEFE avec l’UCL ou de PROMUSAF avec les Mutualité Chrétiennes. Ceci s’appliquerait en particulier à la Santé Publique. Sauf pour les projets de mutuelles qui, sans adhésion libre et ferme des membres à l’organisation perdent leur sens, les processus participatifs de définition des besoins sont probablement plus réels (et réalistes) avec les autorités et les agents de santé qu’avec les populations. Au Bénin, la Belgique est fort active au niveau de la coordination des partenaires (co-chef de file). Cet aspect du partenariat souffre cependant de l’impact partiel des projets belges sur le système de santé. En effet, n’étant actuellement plus un acteur de l’appui au niveau central, l’action au niveau de la coordination des partenaires peut difficilement être suivie d’une participation opérationnelle aux adaptations nécessaires de la politique de santé. Ressources Pour les ZS, la détermination des ressources (un peu arbitraire et un peu standard) prend peu en compte les capacités d’absorption locale (équipe de ZS). Le paquet de ressources doit être consommé et en ce sens, cela gène les approches adaptatives et progressives qui sont tentées par les équipes d’assistants techniques. Pour les ONG, la réévaluation annuelle des budgets est une source majeure de problèmes pour le fonctionnement des projets et surtout pour l’engagement et la confiance des partenaires. Une négociation et un engagement quinquennal seraient plus adéquats. Management du développement et des projets
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 27
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Concernant les synergies et les complémentarités, il n’y a pas de démarches formalisées préalables pour que les projets de la CB interagissent dans une aire géographique. Les tentatives de rapprochements sont nombreuses et se négocient, souffrant ainsi de « l’après-coup », chacun étant responsable d’accomplir les priorités définies dans son DTF. Les projets bilatéraux souffrent aussi d’une faible mémoire et de faibles capitalisations inter et intra projets. Les projets de la CB sont pleinement en phase avec la politique nationale de santé. Mais la politique nationale (comme la NS belge) manque encore de stratégies opérationnelles : Par où commencer ? Comment s’empêcher de tout faire à la fois ? Comment être efficient ? ….. . Ces questions n’ont pas fait l’objet de documents stratégiques. Elles sont laissées aux équipes en périphérie ou aux projets et la créativité nécessaire s’accommode parfois mal avec les détails précis des cadres logiques des DTF. Les zones sanitaires sont donc un peu développées comme des pavés que l’on dépose sur la terre nue (« mise aux normes »), ce qui, par manque d’adaptation locale, rend les choses difficilement durables. L’approche qui prévaut au Bénin – celle de répliquer des zones sanitaires de manière normative – empêche également les réflexions sur la réduction des coûts. Le MSP souhaite développer sa couverture sanitaire et a pour cela recours aux offres des coopérations, sans imposer une stratégie pré-déterminée d’extension quantitative et qualitative des services de santé. La CB, en partenariat étroit, offre son appui et respecte les besoins exprimés, en particulier pour ce qui concerne les normes. Mais c’est probablement en grande partie la CB, par des cycles de projets courts et des enveloppes financières conséquentes, qui induit des stratégies rapides et intensives, laissant peu de place aux adaptations nécessaires, en particulier en regard des engagements, forcément hétérogènes, des équipes des ZS (même le vocable « exécution d’un projet » ne laisse pas la place aux adaptations) . En cours de projet, le MSP et la CB n’arrivent pas toujours à exprimer leurs points de vue sereinement, par exemple en ce qui concerne les infrastructures. En fait, le MSP pencherait plutôt pour des approches progressives et réfléchies pour qu’elles soient pertinentes et viables (ce qui rejoint les préoccupations belges), à condition que les normes soient respectées. On peut voir dans cette difficulté de dialogue la tension excessive qu’induit un projet, son temps d’exécution court et son budget conséquent. Pour ce qui concerne le renforcement des capacités, le ton général de la coopération internationale laisse aujourd’hui peu d’ouverture vers des approches plus personnelles, plus professionnelles. On prône la « gestion des ressources humaines », ce qui semble un peu trop mécanique ou logistique, comme s’il suffisait de « gérer » des hommes et des femmes, or que ceux-ci et celles-ci ont des propositions à faire, des avis, des contraintes à exprimer. En comparant les différentes approches, on peut remarquer que du côté de la coopération indirecte, les choses se passent différemment ; les personnels sont attirés vers les projets et ils y sont attirés par un ensemble de facteurs de promotion personnelle, financiers certes, mais aussi scientifiques, humains, environnementaux et sécuritaires.
RECOMMANDATIONS
- Éclaircir les mécanismes mis en jeu pour l’élaboration des PIC (montants, priorités) et l’utilisation de la NS qui est faite à cette occasion (question à approfondir avec la DGCD).
- Elargir la politique belge en santé (NS) aux aspects de politiques et de stratégies nationales pour permettre aux acteurs de la CB d’appuyer le MSP ou d’autres
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 28
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
partenaires institutionnels plus globalement sur les problèmes clés, en particulier de ressources humaines et de financement des soins de santé.
- - Développer dans la NS les stratégies de mise en œuvre des appuis aux systèmes
de santé entre autre sur la base de l’expérience belge dans l’ensemble des pays partenaires.
- Promouvoir dans les processus d’identification et de formulation les synergies et
les complémentarités entre tous les éléments du dispositif belge de coopération.
- Déterminer les engagements budgétaires de co-financement des ONG par la DGCD sur la base des plans quinquennaux plutôt que sur des bases annuelles.
- Adapter le processus de coopération bilatérale directe en s’inspirant des processus
développés par les autres éléments du dispositif de la CB :
• des projets progressifs, modulables en fonction de priorités concrètes, • le soutien à des entités professionnelles basées sur une reconnaissance
nationale et internationale par des pairs, • un partenariat scientifique entre une équipe locale et une équipe belgo-
internationale, • un montage de coopération qui permet des approches progressives et ne lie
donc pas l’instance de mise en oeuvre (la CTB) aux décaissements prévus (overhead).
• développer une dynamique de suivi-évaluation : monitoring continu, auto-évaluations. Éventuellement remplacer les évaluations externes par des appuis méthodologiques à cette dynamique de suivi-évaluation.
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 29
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 1. Tableaux à remplir concernant le diagramme d’impact
Fonctions essentielles du secteur public appuyées
Projet Tous projets belges
Autres intervenants
Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
X Approche Zones Sanitaires mise en œuvre sur le terrain (3 ZS) et appuyée au niveau central entre 1999 et 2003 (appui à la Cellule du MSP dans le projet PAZS-Mono 1).
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
X Appui à la Cellule d’Appui au Développement des Zones Sanitaires (CADZS)
Législation et fonctionrégulatrices établies
s
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Allocation des ressources améliorée
X Travail de la CADZS pour nouvelle ligne budgétaire de fonctionnement pour les ZS
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
X Participation active à la coordination des partenaires
Politique d’information et système d’information établis
Stratégies de financement de la santé établies
+/- Approches mutuellistes et « Fond d’achat de services » contenu dans l’identification du nouveau PAZS-Mono 2.
Tableau 1
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 30
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Impact sur les fonctions essentielles du secteur
public
Projet Projets belges Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
X Zones Sanitaires et développement de la Kinésithérapie
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
X Normes et procédures pour les Zones Sanitaires
Législation et fonctions régulatrices établies
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Allocation des ressources améliorée
X Travail de fond pour la ligne budgétaire de fonctionnement des ZS
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
X La Belgique est parmi les plus actifs au comité de coordination
Politique d’information et système d’information établis
Stratégies de financement de la santé établies
X Approches mutuellistes
Tableau 2
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 31
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Fonctions essentielles du secteur public faiblement prises en
charge dans le secteur santé Oui / non
Oui = faible
Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
Non Politiques et stratégies claires
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie Non
Législation et fonctions régulatrices établies Oui
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé Oui
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé Non
Allocation des ressources améliorée Non Ressources de fonctionnement aux ZS
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi Oui Par exemple, pas d’approche de réduction des coûts
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
?
Politique d’information et système d’information établis Non
Stratégies de financement de la santé établies
Non et oui
La stratégie de financement est bien définie, mais le secteur est extrêmement dépendant du financement communautaire et des partenaires au développement
Tableau 3
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 32
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Résultats sectoriels : focus principal de l’appui
du projet Projet Projets belges Commentaires
Soins de santé essentiels définis et disponibles X Zones Sanitaires, paquets d’activités Approches novatrices de santé maternelle (UNICEF) Développement de la kinésithérapie
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre le secteur public et les secteurs privés
Ressources humaines compétentes et motivées en place
Pouvoir de décision et de gestion, décentralisé au niveau approprié X Au niveau des ZS
Système d’encouragement à la performance en place
Accès aux médicaments essentiels et approvisionnement assurés
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins
Participation du parlement, de la société civile, des partenaires et des communautés locales assurée
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés X Nombreux travaux socio - anthropologiques sur la qualité des
soins et l’utilisation des services. Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services
Le financement de la santé est efficace
Le financement de la santé est équitable et juste
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 33
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Tableau 4
Résultats sectoriels faibles ou problématiques Oui / non Commentaires
Soins de santé essentiels définis et disponibles Non
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre le secteur public et les secteurs privés Oui Les démarches pour les contractualisation des services de
santé sont en cours Ressources humaines compétentes et motivées en place Oui Turn-over rapide, démotivation, attraction de la capitale
Pouvoir de décision et de gestion, décentralisé au niveau approprié Non
Système d’encouragement à la performance en place Oui
Accès aux médicaments essentiels et approvisionnement assurés Non
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins Oui
Participation du parlement, de la société civile, des partenaires et des communautés locales assurée Non
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés Oui
Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services Non Les informations sont disponibles mais peu utilisées
Le financement de la santé est efficace Oui Les soins sont coûteux
Le financement de la santé est équitable et juste Oui Le système de santé fonctionne en grande partie sur le « financement communautaire »
Tableau 5
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 34
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Autres secteurs appuyés Projet Tous projets belges
Autres intervenants
Commentaires
Politique et stratégies de population établies ―
Politique et stratégies de nutrition établies ―
Politique et stratégies d’eau et hygiène établies ―
Politique et stratégies de l’éducation établies ―
Politique et stratégies environnementales établies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
―
Politique et stratégies de sécurité routière établies ―
Environnement favorisant un comportement sain en place ―
Tableau 6
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 35
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Autres secteurs faibles concernant les actions liées à la santé Oui /non Commentaires
Politique et stratégies de population établies ? Politique et stratégies de nutrition établies ? Politique et stratégies d’eau et hygiène établies ? Politique et stratégies de l’éducation établies ? Politique et stratégies environnementales établies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
?
Politique et stratégies de sécurité routière établies ? Environnement favorisant un comportement sain en place ?
Tableau 7
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 36
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Nom Organisation Fonction E-mail M Stefan Meesschaert Ambassade de
Belgique Attaché [email protected]
Mme Jeanine Simbizi CTB Rep. Résidente [email protected] M Soulé Abdoulaye Manigui
CTB Chargé de programme
Dr Andrétinarivo Andriamanday
CTB / PAZS Bassila Co-responsable [email protected]
Mr Philippe Pire CTB / PAZS Bassila Infrastructures [email protected] Dr Geneviève Michaux CTB / PAZS KTL Co-responsable [email protected] Dr François Kossouh EEZS KTL Resposable [email protected] Mr Christian Eyebiyi MSP / Direction
Planification et prospective
Directeur [email protected]
Dr Sidonie Barra Direction de l’Appui au développement des ZS
Directrice
M. Auguste Sagbohan MSP / Etudes et stratégies
Chef de service
Mr Thierry Soyez Union Européenne Chargé de programme
Mme Merci Tohi Athiou BIT / STEP Expert [email protected] M Aboubakar Koto-Yerima PROMUSAF Coordonnateur [email protected] Dr Yves Sossou AMCES Directeur [email protected] M Ilère Ngongang Solidarité Mondiale Coordonnateur [email protected] M José K. Houngué GROPERE Coordonnateur [email protected] M Olivier Jadin APEFE / programme
Kiné Coopérant [email protected]
M Karol Service Réhabilitation Fonctionnelle CHR Abomey
Chef de service [email protected]
Mme Anne Dujardin APEFE / programme Kiné
Coopérante [email protected]
Dr Olatoundji M. Gbadamassi
Sécurité Transfusionnelle
Chef de service [email protected]
M Gery Van Nieuwenhuysen
Louvain Développement
Coordonnateur [email protected]
Dr Houiley D. Comlan DDS Mono-Couffo Directeur [email protected] M Megbedji H. Christophe Commune de
Klouékanme Maire [email protected]
M Euloge Pascal Segla GROPERE Chargé de projets [email protected] M Loko Finagnon Jérôme CHD Zou Directeur Dr Paul Adovohekpe UNICEF Chef de
programme [email protected]
Dr Séverin Anagonou Laboratoire Mycobactéries
Chef de service [email protected]
Dr Roch Christian Johnson
Lutte Ulcère de Buruli Chef de Programme
Dr Adolphe Kpatchavi Laboratoire d’Etude des Dynamiques Appliquées au Développement
Responsable [email protected]
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 37
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 3. Liste de documents consultés
• Accès aux soins de santé globaux de base de qualité, atelier des 28 et 29 avril 2005, Ministère de la Santé Publique et Ambassade de Belgique, Cotonou.
• Etudes des causes de la faible utilisation des services de santé dans la zone
sanitaire de Klouékenmé, Toviklin, Lalo, Laboratoire d’études appliquées aux dynamiques de développement, CTB / PAZS-KTL, juin 2004.
• Document de présentation du PROMUSAF-Bénin et ses activités, Aboubakar Koto-
Yerima, 2005
• La Coopération belge au Bénin, DGCD, juin 2005
• Programme indicatif de coopération 2004-2007, Coopération bénino-belge, mai 2004.
• Stratégies du projet de santé maternelle dans le Département du Zou, UNICEF, 2004-2005.
• Projet LISA, Dossier Technique et Financier, Louvain Développement, avril 2005
• Amélioration à l’accès aux soins de santé pour les populations rurales dans le Mono,
fiche de projet, cadre logique et rapport d’activités, Louvain Développement, juin 2005
• Appui structurel au développement de la kinésithérapie au Bénin, dossier
d’instruction, APEFE, mai 2005
• Rapport d’activités du service de rééducation fonctionnelle de réadaptation, CHD du Zou, 1ier semestre 2005
• Statistiques 1999-2004, service de rééducation fonctionnelle de réadaptation, CHD
du Zou
• La kinésithérapie au Bénin, projets APEFE depuis 1991, présentation powerpoint.
• PAZS-Bassila, dossier de formulation, janvier 2002
• PAZS-KTL, dossier de formulation, juillet 2002
• PAZS-Bassila, rapports de suivi, 2003 et 2004
• PAZS-Bassila, documents et rapports des réunions de la Structure Miste de Concertation Locale
• Pazs-KTL, rapports de suivi, 2004.
• PAZS-KTL, documents techniques et de formation, équipe du projet, 2003-2005.
• Utilisation de l’hôpital de zone de Klouékanmé 2003-2005, Direction de l’HZ,
présentation powerpoint.
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 38
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
• Note stratégique Bénin, DGCD, novembre 2004
• Stratégie 2004-2007, PROMUSAF
• Fiche projet, PROMUSAF, juin 2005
• Mission de suivi des projets CTB au Bénin, aide-mémoire, ULB-IRSP, mai 2004
• Rapport de mission exploratoire au Bénin, GRAP-SWAP, Groupe de recherche sur
les instruments de coopération en appui aux politiques sectorielles, ULB, UCL, Université de Liège, novembre 2004
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 39
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 4. Programme de la mission Lundi 11/07/05 :
- 9h00 : Séance de briefing avec le Comité Lieu : Ambassade
- 13h00 : Déjeuner avec Stephan Meesschaert - 15h00 : Visite à l’Union Européenne (Thierry Soyez)
- 16h30 : Réunion à la CTB, avec les projets PAZS-Bassila et PAZS-KTL :
Res.rep, Chargé de programme, Responsables et co-responsables des projets. Mardi 12/07/05 :
- 9h00 : Réunion avec les acteurs indirects « mutuelles » : Louvain Développement, Solidarité Mondiale, STEP/BIT, PROMUSAF (+ quelques partenaires locaux) Lieu : Ambassade
- 15h00 : Visite Transfusion sanguine et Kinésithérapie
Lieu : CNHU Mercredi 13/07/05 : Journée à Abomey
- 8h00 : Départ pour Abomey. Visite du projet Kinésithérapie (APEFE) - 14h00 : Visite des appuis de l’UNICEF à Abomey (soins de santé maternels et
néonataux) Jeudi 14/07/05 :
- 8h00 : Départ vers Lokossa - Rencontre avec le DDS à Lokossa - Visites à Klouekanmé (KTL), Lalo (KTL et Buruli)
Vendredi 15/07/05 :
- Deuxième journée à Klouekanmé (PAZS KTL)
Samedi 16/07/05 - Visite du projet d’initiative mutuelliste à Houeyogbe (GROPERE et Louvain
Développement) Dimanche 17/07/05 : Rédaction de rapport Lundi 18/07/05 : Autres rencontres à Cotonou :
- Responsable du projet IMT (Ulcère de Buruli) - MSP : Directeur de la Planification et de la Prospective et Directrice du
Développement des Zones Sanitaire. Mardi 19/07/05
- 9h00 : Journée de « brainstorming » : tous les participants de l’atelier santé. - 15h00 : Visite du projet de mutuelles/micro-crédits, STEP/BIT, Cotonou
Mercredi 20/07/05
- Matin : imprévus et pré-enregistrement AIR France - 15h00 : Séance de debriefing avec le Comité
Lieu :Ambassade
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 40
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 2 - 0
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 2. Rapport Cambodge
HERA / Rapport pays Bénin / Décembre 2005 Annexe 1 - 1
HERA HEALTH RESEARCH FOR ACTION .
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Country Report
Cambodia
Laarstraat 43 tel. +32-3-8445930 B-2840 Reet Belgium fax. *32-3-8448221 Bank No 401-2025551-15 e-mail [email protected]
www.herabelgium.com
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Table of Content
1. SUMMARY OF PROJECT PROFILE....................................................................................... 6
2. FOCUS OF THE BELGIAN SUPPORT AND OF THE NATIONAL POLICY.................... 6
2.1. FOCUS OF THE BELGIAN SUPPORT ........................................................................................ 7 2.2. SUMMARY OF THE NATIONAL HEALTH POLICY ................................................................... 7
3. UTILISATION OF THE HEALTH STRATEGY NOTE ......................................................... 8
4. HEALTH SYSTEM AND PARTNERSHIP ............................................................................. 10
4.1. IMPACT ON THE HEALTH SYSTEM......................................................................................... 10 4.2. RELEVANCE OF THE INSTITUTIONAL PARTNERSHIP.......................................................... 12
5. RELEVANCE AND EFFECTIVENESS OF PROJECTS VIS-À-VIS THE STRATEGIC NOTE .................................................................................................................................................... 13
5.1. REFERENCE TO PHC SERVICES AS DESCRIBED IN THE STRATEGIC NOTE ....................... 13 5.2. RELEVANCE OF RESOURCES ............................................................................................... 15 5.3. STRENGTHENING THE HEALTH SYSTEM .............................................................................. 16 5.4. COHERENCE AND COMPLEMENTARITY................................................................................. 17 5.5. HEALTH NEED........................................................................................................................ 18 5.6. MULTI SECTORAL APPROACH............................................................................................... 18
6. CROSS-SECTOR ISSUES ......................................................................................................... 19
6.1. SUSTAINABILITY................................................................................................................... 19 6.2. COMMUNICABLE DISEASES.................................................................................................. 21 6.3. INTERNATIONAL PARTNERSHIP........................................................................................... 21 6.4. NATIONAL PARTNERSHIP .................................................................................................... 21 6.5. PARTNERSHIP WITH LOCAL COMMUNITIES / CIVIL SOCIETY ................................................. 22 6.6. GENDER EQUITY................................................................................................................... 23 6.7. HIV/AIDS .............................................................................................................................. 24
7. DEVELOPMENT ISSUES EXTRACTED FROM THE HEALTH STRATEGY NOTE ... 25
7.1. DURABLE DEVELOPMENT .................................................................................................... 25 7.2. OPERATIONAL METHODS AND STRATEGIES ....................................................................... 26 7.3. CAPACITY BUILDING............................................................................................................ 26 7.4. FINANCING STRATEGIES...................................................................................................... 27 7.5. PLEA / BELGIAN VIEWPOINT ............................................................................................... 27 7.6. COUNTRY ACTION PLAN........................................................................................................ 28 7.7. RESEARCH ............................................................................................................................ 28 7.8. GLOBAL FUND ATM............................................................................................................ 28
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 3
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
8. CONCLUSIONS.......................................................................................................................... 29
9. ANNEXES.................................................................................................................................... 31
9.1. ANNEXE 1. TABLES RELATED TO THE IMPACT DIAGRAM.................................................. 32 9.2. ANNEXE 2. LIST OF PEOPLE MET........................................................................................ 39
List of abbreviations ADB Asian Development Bank ARV Anti Retro Viral BCC Behaviour Change Component BRX Brussels BTC Belgian Technical Cooperation CBO Community Based Organisation CDC Chronic Disease Clinic CPA Complementary Package of Activities CRO Consumer Rights Organisation CSO Civil Society Organisation DfID Department for International Development (UK) DGDC Directorate General Development Cooperation EPI Expanded Programme of Immunisations GFATM Global Fund Aids Tuberculosis Malaria HAART Highly Active Antiretroviral Therapy HC Health Centre HI Handicap International HIS Health Information System HRD Human Resource Development ITM Institute of Tropical Medicine IEC Information Education Communication KC Kampong Cham LF Logical Framework MCH Mother and Child Health MD Medical Doctor M&E Monitoring and Evaluation MOE Ministry of Education MOH Ministry of Health
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 4
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
MOSALVY Ministry of Social Affairs MPA Minimum Package of Activities MSF Médecins sans Frontières MTEF Medium Term Expenditure Framework NA Not Applicable NCHAD National Centre for HIV and Aids NCMC National Centre for Malaria Control NGO Non Government Organisation NHSP National Health Strategic Plan OD Operational (Health) District OPM Oxford Policy Management PBH Provision of Basic Health Services PHC Primary Health Care PHD Provincial Health Directorate PMTCT Prevention of Mother to Child Transmission PMU Project Management Unit PRSP Poverty Reduction Strategy Paper SR Siem Reap SWAp Sector Wide Approach SWiM Sector Wide Management RC Rehabilitation Centre RH Referral Hospital RS Road Safety RTA Road Traffic Accident TA Technical Assistance TB Tuberculosis TOR Terms of Reference TWG Technical Working Group USD United States Dollar VCT Voluntary Counselling and Treatment WB World Bank
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 5
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Summary of project profile Country
Cambodia
Projects evaluated 1. BTC, Provision of Basic Health Services (PBH) in the Provinces of Siem Reap and Otdar Meanchey
2. BTC, Provision of Basic Health Services (PBH) in the Province of Kampong Cham
3. MSF, Améliorer l’accès au soins pour les malades atteints du SIDA et de maladies négligées. Siem Reap.
4. ITM, Cambodia Clinical Aids Care including the use of HAART 5. ITM, National Institutes of Malarialogy, Parasitology and
Entomology (NIMPE) in Vietnam, Cambodia and Laos 6. HI, Soutien aux Centres de Réadaptation physique et sociale
dans les provinces de Siem Reap et Takeo 7. HI, Soutien au développement des capacités des personnes
handicappées dans 2 provinces du Cambodge (CABDIC) 8. HI, Prévention des invalidités dues aux accidents par mines et
UXO et de la route
Annual Belgian support to the health sector (period 2003-2005)
Belgian investments for health is roughly about 3 to 4 M€ annually. Or about 0.25 to 0.3€ per capita.
Annual government and donor budget (period 2003-2005)
MOH budget is about 2.5 to 3€ per capita year (3-3.5USD). Donor contributions is estimated at 5€ (6USD) per capita per year.
Name of the responsible staff at the embassy
M. Marc Leroy M. Carlos Lietaer
Local partner(s)
Ministry of Health (MOH) Ministry of Social Affairs (MOSALVY) Ministry of Transport HOPE hospital
Name of the evaluators
M. Leo Devillé M. Heng Thay Ly
Mission dates
31 May to 11 June 2005
Documents consulted See annex
Persons interviewed See annex
Other sources Not relevant
Focus of the Belgian support and of the national policy
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 6
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Focus of the Belgian support Cambodia is no longer a partner country. The draft country strategy paper (dated September 2002) mentions the health sector as a priority sector (next to education, rural development). The “Belgian” health sector strategy (summarised in 1 paragraph) mentions the following objectives:
a) promote PHC services accessible to all b) improve quality of existing public health services c) increase utilisation of public health services d) special focus on HIV/AIDS e) support focus at provincial level
Based on the evaluation, present Belgian support focuses mainly on the following areas (as per health strategy note) and levels. General PHC
services Reprodcutive health
HIV/AIDS Communicable diseases
International (X) (regional) National (x) X PHC system XXX XX XXX X Communities x x x The main focus outside of the above matrix: • HI, Provincial rehabilitation centre and Cabdic (community rehabilitation services) that
use the network of Ministry of Social Affairs (MOSALVY) rather than of MOH. Rehabilitation is however part of PHC and could be considered part of the above matrix. Rehabilitation is not specifically addressed in the health strategy note.
• HI, Road safety: responds to a major (and increasing) health issue, but is not specifically addressed in the health strategy note.
Summary of the national health policy A recent report of IDA / IMF (Country Assistance Strategy, April 2005) in collaboration with ADB, DFID and UN makes the following observations regarding the national context in Cambodia:
i. Cambodia has made some significant achievements since the United Nations (UN)-supervised peace process of 1991-93. However, after decades of war and authoritarian government, Cambodia is in many ways still a post-conflict society and political system. Governance issues are considered the primary obstacle to sustainable poverty reduction in Cambodia.
ii. Strong economic growth between 1994 and 2003 has been narrowly based in a few sectors and to date appears to have had little impact on poverty (unequal distribution of benefits of growth).
iii. Over the last decade, uncoordinated and donor-led aid has often slowed or even undermined the evolution of good governance. Increasing recognition of this problem led in 2004 to a Government-donor consensus on an agenda for harmonization and alignment.
Poverty reduction and health sector development is to a large extent determined by the constrained national socio-economic context, the unequal distribution of benefits, overall
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 7
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
governance and the opportunities and limitations of harmonisation and donor support. The sector is very much dependent on external donor support and this situation is not likely to change in the nearby future. Main reference national documents for the health sector are the National Poverty Reduction Strategy 2003-2005, (which is in support of the NHSP) and the National Health Strategic Plan 2003-2007 (NHSP). The Health Policy Statement 2003-2007 seeks to provide high quality, evidence-based health services, with equity, and no discrimination by gender, age, place of residence, or ability to pay, that are pro-poor, and are based on trust between providers and users. The working principles include ensuring social protection for vulnerable groups, listening to what people want, at appropriate, sustainable cost, focusing on rural areas, involving capacity building and human resources development, and partnership. A recognised critical underlying need is to increase public support for health care. The share of the current budget directed to health was projected to increase from 9.5 percent in 2001 to 13 percent by 2005, a rise of more than 30 percent, to be accompanied by better public management. The MOH has established the targets to be achieved based on Millennium Development Goals (MDG). These are impact and outcome indicators, which are presented in the NHSP Monitoring and Evaluation Framework. To reach the set targets the MOH is aiming at targeting service delivery at poor people, including reallocating resources in favour of poorer geographical areas. The key strategic objectives are to (1) promote health service coverage and utilisation, (2) enhance accessibility and affordability of key essential services, and (3) provide information, improve participation and empower the poor to make informed choices. The NHSP has identified 6 key areas of work: a) health service delivery; b) behavioural change; c) quality improvement; d) human resource development; e) health financing; and f) institutional development. It is estimated that MOH’s budget is about 3USD per capita per year, complemented by 6USD per capita donor resources. People spent between 30 and 35USD per capita on health annually.
Utilisation of the health strategy note The health strategy note is not known by the representatives of the Belgian partners (BTC, MSF, HI, ITM); or by the institutional partners (MOH), or by the donor community (Unicef, WHO, DFID). One TA knew of the existence of the previous health strategy paper. There is no evidence that the health strategy note (present or previous version) has been used in the identification or formulation of the projects evaluated during this assignment. The health strategy note is not available in English and opportunity to share with national counterparts and other donors is therefore limited. One issue mentioned by the Belgian stakeholders is the lack of library services (lessons learned) at DGDC or BTC in Brussels. Also, BTC Brussels is said to be more interested in administrative or financial information (up to 2 mails per day), and much less in project results or content (this may be explained by DGDC administrative requirements on BTC – see contract between DGDC and BTC). DGDC Brussels nor BTC Brussels provide significant technical support to field staff (« this was better in the time of MSF »).
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 8
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Stakeholders in the sector are aware of interventions supported by MSF (who is a well-known partner having supported the sector since 19891), by HI (active in rehabilitation for more than 20 years and in road safety since 2002) and to a certain extent by ITM. BTC has started implementing the health sector interventions at provincial level between 6 and 12 months ago and is not yet well known as a stakeholder in the sector. BTC TA have expressed their wish to become more involved at national level (technical working groups, annual sector reviews). Belgian cooperation activities are generally not well known by the donor community (WHO, Unicef, DFID), although BTC made one presentation at the SWiM (Sector Wide Management) group. Stakeholders and MOH are interested in regular feedback on main experiences related to equity funds, contracting, BCC (components of the BTC projects). The strategy notes (health and draft HIV/AIDS) have been discussed with the stakeholders during this evaluation. Main observations were as follows:
i. Health strategy note: - The note has nothing controversial, is well written. - Issue of governance not sufficiently addressed. Good governance should be /
or not a conditionality in bilateral aid (However there was no consensus between participants). Donors should use their leverage jointly to motivate government curbing corruption (but corruption is also perceived as a shared responsibility as donors are not tough / explicit enough).
- Human resources development (all aspects) is insufficiently addressed. Issue of pre-graduate training (and competency-based?) training not well addressed.
- Addressing development issues in Cambodia (including HRD) requires an investment plan for 20 years or so, not just 4-5 years. The need for medium to long-term time horizon for durable development is not sufficiently addressed.
- Public Private Mix (PPM), the role of private sector is not well developed. Guidance is needed, as also in Cambodia it is difficult to design effective strategies to address the private sector.
ii. HIV/AIDS draft note:
- The draft note has nothing controversial - Integration of HIV prevention and AIDS care into general health services is
relevant, but prevention of HIV transmission should be organized separately as it must target specific groups of vulnerable or high risk people. Marginalised people do not make use of general health services for HIV/AIDS
- As far as TB and HIV/AIDS care is concerned, donors should consider it as their responsibility to support or assure good care for all PLWHA that are found through VCT if they support the VCT centre.
- No quantitative targets mentioned. The draft Strategic Note has no “extraordinary ambition”. The strategic note does not say “what is not acceptable”.
- The Strategic Paper should consider to include "out of school" adolescent and children as the target of group.
1 MSF worked from about 10 years before 1989 in the border camps in Thailand with Cambodian refugees.
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 9
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Health system and partnership
Impact on the health system With the exception of the HI road safety intervention and the ITM malaria research project, all evaluated interventions mainly support essential service delivery (minimum and complementary package of activities (MPA, CPA); HIV/AIDS care ; physical and social rehabilitation). Based on the impact diagram tables (see annex), the main focus of the Belgian health system support can be summarised as follows: • Essential health services available and accessible (BTC, HI, MSF, ITM) • Competent and motivated human resources in place (BTC, HI, MSF, ITM –on-the-job
training and capacity building; performance-based incentives; no comprehensive HRD) • Incentives for performance applied (BTC, HI, MSF, ITM) • Patient rights respected (BTC, HI) • Users sensitised to healthy behaviour (BTC, HI – behaviour change component - BCC) • Fair and equitable health financing (BTC) And other sector health related elements: • Education policy and strategies established (BTC, HI) • Road safety policy established (HI) All health interventions face a problem of financial sustainability, given the socio-economic environment (poverty) and the limited government resources (3 to 4 USD per capita per year for the health sector). Donor dependency is important, both in terms of financial resources (6 USD per capita per year) and in terms of technical capacity. However, annual household health expenditures are said to be 30 to 35 USD per capita per year, of which most is spent in a poorly performing and poorly regulated private sector (in general poor quality private providers – but noticeable exceptions exist-, problem of fake drugs in private drug outlets). A major challenge for the government is how to make better use of the limited household resources, limiting household expenditures of the poorest and introducing effective solidarity mechanisms (by improving the supply side: both public and private sector performance ; and by influencing the demand side : by introducing behavioural change, influencing health seeking behaviour, introducing prepayment / health insurance mechanisms). There is some evidence in Cambodia of reduced household health expenditure in an environment where public sector service delivery improves and attracts more users (as the public sector raises only marginal fees). The main emphasis of the Belgian interventions is on the public sector. The only private sector intervention is the ITM support to Hope hospital. Other constraints for improving health sector performance and that are generally not sufficiently supported (by most stakeholders) are human resource development (e.g. pre-graduate training), private sector regulation (including pharmaceutical sector) and private sector development in urban areas. Importantly, only about one third of the districts receive direct donor support for improving service delivery and are able to implement the performance based incentives. Support to essential service delivery responds to a major need and has potentially a direct impact on health. Lessons learned can influence national policy development if the necessary mechanism for evaluation, sharing of information and participation in national fora, national technical working groups, and annual sector performance review is foreseen.
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 10
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Potentially the CTB interventions can influence the national strategy, especially in the area of performance based incentive schemes, the equity funds (equitable financing) and behavioural change strategies. MOH is eager to learn from different field experiences and invites BTC to actively participate in national fora, technical working groups, annual sector reviews, and donor coordination meetings. Lessons learned from HIV/AIDS care (MSF, ITM) could influence national care strategies and treatment guidelines through the National Centre for HIV and AIDS (NCHADS has a major responsibility in building national strategies upon local experiences through coordinating different stakeholders). HI rehabilitation projects provide (together with the other NGOs active in the sector) the national experience base in rehabilitation, which could feed into and support national strategic development. This experience seems so far to have been underutilised by MOSALVY to update / develop national rehabilitation strategies. Previous MSF support (1995 -2001) to the sector has resulted in influencing the national strategic plans 2003-2007 (e.g. the introduction of new concepts such as the new deal and equity funds; the standardisation of health centre infrastructure plans). The MOH has developed a very well articulated health strategic plan 2003-2007. Its implementation is however largely dependent on continuous donor support and ambitious. The Belgian health interventions are in line with the national strategic plan. From a health system point of view, the following observations can be made: o A strategic planning framework exists (but provincial/district planning is not yet fully
comprehensive as it does not include private providers, but it includes donor resources; and is done mainly for administrative purposes to get the money, less for operational planning).
o Legislation is not updated and the regulatory framework is generally weak. Laws are not
sufficiently enforced. o The labour market is not well regulated (main problems: number of midwives and quality of
staff; public doctors provide private practice ; non licensed private providers ; poorly regulated but expanding private sector ; unofficial payments in public sector ; no incentive system for rural posts ; political interference with posting). Potential development of a national incentive system is presently being explored through OPM (DFID).
o Poorly regulated pharmaceutical sector with problem of fake drugs in private drug outlets
(80% of clients use private drug outlets or pharmacies for malaria drugs), free price setting and irrational prescribing. Drug supply through public facilities seems generally to be ok, especially at health centre level.
o Public budget resource allocation is not based on a transparent formula but this is presently
being developed at MOH. Cash systems allow manipulation of funds. o Performance monitoring is in place (e.g. annual sector review). Health sector monitoring
indicators have been defined in the NHSP, but accountability systems are weak. HMIS is in place but data reliability is somewhat questionable. A lot of information is produced but not always shared.
o No comprehensive sector budget exists, including all resources. MTEF exists but is either
not reliable or not comprehensive. Long-term health financing strategies need to be developed.
Strategic support from the Belgian inputs to the above constraints in the sector is limited and mainly focused at operational (e.g. provincial/district level) or project level (e.g. performance based incentive
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 11
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
payments). There is no direct strategic or institutional support at central level to support MOH addressing those issues (with the exception of road safety). However, projects can have an impact on policy level, using lessons learned from project level, if this is actively pursued. Relevance of the institutional partnership The preferred partner is government, mainly MOH but also other ministries such as MOSALVY (HI) and MoTransport, MoInterior, MoEducation (HI). As most projects focus on health service delivery through public facilities, this partnership is a logic choice. Partnership with government is perceived as positive, although the problem of corruption is recognised and local political will to improve governance not always translated into concrete actions. Good governance would also require government to raise the national budget, by increasing its resource base, e.g. through raising taxes. This aspect seems to receive little attention at government level. MDG targets are generally not achievable within the set timeframe, partly because of partnership with a weak government. Partnership with private sector providers is the exception (only ITM) rather than the rule and project formulation has generally given little attention to opportunities to work through private providers. Cambodia is no longer a partner country in the Belgian development aid. This is likely to limit the BTC projects to the present 4 year period. This is a major concern as the project objectives are not achievable in 4 years. More importantly, the intervention through financial incentives and other inputs will raise expectations that cannot be sustained after the projects stops. If no other donor steps in, this may result in even poorer future performance as compared to the pre-intervention period (local examples exist). A longer time-horizon is needed for this type of interventions, especially when support aims at durable development. MOSALVY is the institutional partner for HI and its network is used to expand rehabilitation services throughout Cambodia (12 provincial centres). 5 NGOs are supporting MOSALVY in rehabilitation. Developing national capacity through public sector is relevant. Partnership with MOSALVY is less strong (as compared to partnership with MOH) although actively pursued by NGOs active in rehabilitation. MOSALVY has no very elaborate strategic plan for the sector, regarding rehabilitation. HI considers to eventually changing partnership to MOH (for at least part of its intervention regarding physical rehabilitation). The lack of communication / collaboration with MOH peripheral health services is a constraint and limits opportunities for more effective resource use. Interestingly, MOH Planning Department knows little about HI (partner with MOSALVY) although rehabilitation is health related; and has limited information about the ITM interventions (not actively communicated). Partnership between HI and MOI, MoTransport, MoE, MoH is a potentially powerful set-up to address road safety at the highest intersectoral level. The creation of a National Road Safety Committee under the Chairmanship of the Prime Minister is promising. Partnership of ITM with HOPE hospital is an interesting example of how strategic partnership with a private institution can work well. The hospital is used as a national and regional training centre. Providing good quality care in a private setting confirms that private sector partnership in Cambodia is possible, relevant and can be promising. Over the past 20 years, MSF has developed a long-term partnership with MOH (district health services support; construction of health facilities; etc.) until it withdrew / limited its sector
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 12
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
support. Logically MSF opted also for a public sector partnership in HIV/AIDS care (MOH, NCHADS) but may also consider the added value of working with the private sector in the future. ITM has opted for a partnership with a private hospital for HIV/ADS care. NCHADS has a good working relationship with some major NGOs but not with all (e.g. Hope Aids Care Centre, Public Health Association of Cambodia). The general environment is a donor-friendly government, with a history of donors being too much in the driving seat and a lot of resources available form donors/NGOs. In general MOH has limited technical capacity. Quality of human resources, managerial skills and coordination between different departments is said to be a constraint. Low salary level is one major constraint to retain competence and capacity. The Steering Committee of the bilateral projects is composed of senior leaders of the Ministry of Health, Local Authority High Official, project Directors, Co-director, and Assistant project Directors. It is in fact the mechanism to smooth the implementation of the project and it does play that role seemingly effectively. It is supposed (1) to provide/maintain the direction of the project; (2) to make a decision on critical/main issues; (3) to address/handle problems; (4) to share lessons learned. It assures some flexibility in project implementation.
Relevance and effectiveness of projects vis-à-vis the strategic note
Reference to PHC services as described in the strategic note The NHSP 2003-2007 is very much in line with the health strategy note and the health system in Cambodia is based on the PHC approach and district health system. It is therefore not surprising that Belgian projects are also in line with the health strategy note. In general, all Belgian interventions are in line with the philosophy of the strategy note, providing essential services (minimum and complementary package of activities; reproductive health services ; HIV/AIDS care ; rehabilitation); or supporting policy and results oriented research (malaria) ; or dealing with a major and increasing health problem such as road traffic accidents and road safety. However, the health strategy note is not very specific on rehabilitation services (clinical, social) or on road safety. Both HIV/AIDS care projects are also in line with the draft HIV/AIDS strategy paper and care services are well integrated in general hospital service delivery. MSF’s innovative approach of integrating HIV/AIDS in a chronic disease clinic has drawn the attention to the generally poor care chronic patients receive in public facilities and the under diagnosis of some health problems such as diabetes. It also helped reducing stigmatisation by treating HIV/AIDS patient in a « normal » hospital outpatient environment. There seems not to be an integrated approach to TB and HIV/AIDS at public hospital level in Cambodia. However, at HOPE hospital there is an integrated approach to both health problems. Regarding indicators
A framework for monitoring and evaluation with specific sector monitoring indicators is part of the NHSP.
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 13
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
BTC projects use as many as 67 monitoring indicators, most of which are part of the NHSP (including output / impact indicators).
HIV/AIDS care indicators are being developed (cohort type of indicators) by ITM and MSF.
HI indicators are more process/activity than result/impact oriented. National reports are produced, integrating the same indicators for all NGOs active in rehabilitation.
ITM indicators for monitoring research are mainly process/activity oriented. Impact on policy development is only “vaguely” monitored by a broadly defined output indicator (“recommendations to MOH”).
Monitoring seems an area that needs strengthening and/or guidance. Results For BTC projects it is too early to assess whether results are achieved, but generally initial progress is in line with plans (taking into account the late start of the programme). The project design is interesting and challenging. The proposed timeframe is too short for achieving the desired objectives. The proposed monitoring framework allows for monitoring outputs and impact. Services delivered in HIV/AIDS care are substantial (MSF Siem Reap : more than 2200 patients registered, 1344 active follow-up, 776 on ARV ; taking care of provincial needs and beyond ; ITM HOPE hospital Phnom-Penh 150 patients on ARV treatment). MSF also provides ARV treatment in other provinces. The two stakeholders together cover about 1/2 of the patients currently on ARV treatment in Cambodia. Apart from the quality services provided both projects build capacity in HIV/AIDS care management, support the national level in developing training curricula, national treatment guidelines and monitoring systems. Important numbers of rehabilitation services are being delivered: HI Provincial Rehabilitation centre Siem Reap : 2500 clients treated per year, which is about 10% of the national figures. The centre does cover more than the provincial needs and provides services of good quality, responding to an important health need (clinical and social). Project experience is shared nationally, between NGOs and with MOSALVY. It does marginally influence national policy development, although this is being actively pursued by the NGOs. Cabdic community based rehabilitation programme covers 400 to 500 children annually. This is an innovative approach to developing community responsibility, pro-active identification of handicapped people, reducing stigmatisation, improving social and school integration and cost-effective treatment. It could influence national policy development for community-based rehabilitation. Motor drivers wearing the helmet in Phnom Penh increased from 8% to 12.5-15% over the last two years. Road safety and road traffic accidents are now being actively monitored (national intersectoral information database being established), reported on (daily newspapers, monthly feedback to decision-makers and civil society) and put on the national political agenda. A National Road Safety Committee has been nominated. The project started too recently to measure impact on road traffic accidents (multi-causal).
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 14
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Relevance of resources The health sector in Cambodia is very much dependent on financial and technical resources from donors (bilateral, multilateral, NGOs) and private sector investments, as discussed above. In general, resources provided within the project context are adequate, take into account complementarity with other sources (government, donors, NGOs), and are not exaggerated when compared with national figures (e.g. BTC projects contribute between 1.15 and 2€ per capita, complementary to 2.4€ and 1.5€ government resources in 2 different provinces; comparable to an overall national 3 to 4 USD per capita available from government and 6 USD from donor resources). Technical assistance & project management, including M&E in BTC projects is rather substantial at 29% of total costs, but TA (international and national) is (still) an essential input in the context of Cambodia and is mostly (but not always sufficiently – see administrative workload of BTC TA) well used for local capacity building aiming at sustainability. The assumption of the BTC interventions is that government or other donors will complement consumables (drugs, reagents), essential equipment, etc. to provide quality services and cover increased demand, when contracting is « on stream ». This is an assumption that may be unrealistic (although government confirms that it will be capable) and eventually result in lower achievement of results, if those complementary resources would not be available. The HSSP approach (SWiM by WB-DFID-ADB-UNFPA) is more comprehensive regarding resources provided. All projects, including BTC, spent a substantial amount of resources on performance based incentives to complement the very low government salaries and assure better staff performance (locally known as the “new deal”). While this makes sense, especially in the context of a resource-poor country like Cambodia, and raises the fundamental question about whether donor support should or should not support staff emoluments in resource-poor countries, the un-standardised approach to “topping up” has the constraint of attracting best staff to the best bidder and donor-dependency outside of a SWAP context results in only 1/3 of districts being covered by the incentive schemes. It can be argued whether the available resources will allow achieving the set BTC objectives in a 4-year period (see before). The project may be over-ambitious. Donor-dependency of financing rehabilitation services is a major concern. In general, project resources are adequate to achieve set project results, but government inputs are estimated at less than 10%. This equilibrium is at odds with the fact that supporting NGOs have difficulties influencing national policy development. HIV/AIDS care is not financially sustainable in Cambodia, as in most developing countries. MSF in Siem Reap provides most of the needed resources and optimises resources from a project point of view, not yet from an institutional point of view (e.g. ARVs are not supplied through the national drug supply system). This may be a short-term rational approach but strengthening national supplies systems would be more effective in the longer-term. The project works through the provincial hospital and with mainly MOH staff plus some contracted staff (same issue of staff salary supplements). Cost of MSF intervention is roughly 550.000USD for 1.500 patients, equal at 367 USD per patient per year. The collaboration between MSF and ITM (standard treatment guidelines, training, telemedicine) does increase effectiveness of resource use. ‘Competition’ between ESTHER and MSF, providing AIDS care in the same hospital may reduce effectiveness of resource use. TA provided under the MSF and ITM projects is relevant.
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 15
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Malaria research and road safety may be quite cost-effective projects if indeed they influence national policy and result in preventing morbidity/ mortality. Project costs are relatively low and potential benefits are important at a nation-wide level (examples are malaria prevention schemes, hammock-bednets, drug sensitivity, changing road safety behaviour). TA provided under the above projects is relevant. Strengthening the health system The BTC and HIV/AIDS projects (and to some extent also the malaria research project) strengthen the existing public health system by using and supporting the existing public health system structure. The BTC project supports the entire health system at the service delivery level that includes both administrative - Provincial Health Department and Operational District Office- and health facilities such as Referral Hospitals and Health Centres. The project provides technical support; incentives to staff, training and some running costs. It does test a number of innovative approaches such as performance contracting, equity funds, consumer rights organisation, behaviour change strategies through MOE, etc. The project works specifically through public sector providers and has little emphasis on private sector actors (providers, drug sellers, etc.). This is an area where project implementation could eventually be adjusted. But, interestingly, the project does promote private management of the equity fund through a local NGO. The MSF HIV/AIDS project does strengthen the health system by integrating HIV/AIDS care in the general hospital inpatient services and in the hospital chronic disease clinic. It provides useful local experience for influencing national policy development (which is being actively pursued by MSF, especially after the 2003 evaluation). The project makes use of both public (hospital) and private providers (e.g. lab tests) and works with local NGOs. This is a rational approach. The project could strengthen the ARV drug supply through national supply systems, as indicated above. The ITM malaria research project supports the National Centre for Malaria Control (NCMC) through training, capacity building and regional exposure. NCMC is the right partner to ensure that malaria research is translated into national policy. ITM builds training and HIV/AIDS care capacity of the private HOPE hospital which provides good quality general outpatient and limited inpatient services. This is an interesting example of PPM. Through NCHADS, ITM aims at influencing and supporting national policy development and training capacity. This opportunity could however be better used by NCHADS. Rehabilitation services are under the responsibility of MOSALVY and do not make use of the MOH network. This situation leads to rehabilitation centres being housed within the premises of the provincial hospital, but with little communication and collaboration with MOH management. Sub-optimal use of resources is a consequence. The project could strengthen the health system, but does not do so (given the local context). HI together with other NGOs has planned an evaluation that will look into present and future partnerships. Road safety is an intersectoral action involving the right ministries and approaching the problem of road safety through the right institutional partners, while building networks through government, private sector and civil society. It puts road safety rightly on the political agenda and also on the agenda of MOH. Potentially it can influence MOH health policy. Overall, taking all projects into account and with the exception of road safety, institutional strengthening at central ministry level is very limited to non-existent.
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 16
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Coherence and complementarity The BTC project is a nice example of how bilateral projects can make use of experience and previous investments of NGO projects, in this case MSF. Rather than re-inventing the wheel, BTC has taken over from MSF, while expanding coverage and complementing some innovative approaches, all in line with the national health strategic plan. The proposed approach is coherent with previous Belgian investments in the health sector (long-term MSF support during two decades), with future government plans (national health strategic plan 2003-2007) and with other donor investments. It is ambitious in what it wants to achieve, has probably overestimated government capacity and requires a longer time horizon for implementation. The project seeks active involvement through MOE (behaviour change component) and in Siem Reap also has initiated some joint action with Handicap International (road safety). Complementarity with other donors and NGOs was actively sought during project formulation and during project implementation this can be achieved / maximised to a certain extent through the Steering Committee. This however requires that BTC and/or embassy staff is actively involved in relevant national fora (donor coordination meetings, technical working groups, annual sector performance reviews). This is an area for future attention (BTC was not present during the 2005 annual sector review meeting, TA is not yet member of relevant technical working groups at national level but aims at doing so; MOH and other donors are much interested in active participation by BTC TA in order to share project experiences). BTC does not play a role of coordination between different Belgian players and is not requested to do so. Other Belgian players do not know well the content of the BTC projects (e.g. project formulation is not shared with other Belgian players) and vice-versa. This limits the opportunities for cooperation and increases the risks of duplication or inefficient use of Belgian resources. There are no formal meetings between Belgian stakeholders in the health sector, apart from ad hoc one-to-one meetings. The evaluation mission was the first time to bring all Belgian actors in health together. Participants felt that this type of meetings could be useful, but only if the meeting has a clear purpose. Examples of collaboration between Belgian partners are: • MSF and BTC collaborated during the formulation and transition phase of the BTC project; • MSF and ITM on HIV/AIDS care (ITM developed HIV/AIDS treatment guidelines; training;
tele-medicine) • BTC and HI in Siem Reap: road safety
Additional areas for possible collaboration are the following (examples within the context of the NHSP and aiming at developing national capacity / policy):
a. All projects: standardised approach to performance incentives b. BTC and HI: consumer rights charter, client rehabilitation charter; c. BTC and HI: link with MoE for teaching school kids in health, prevention and
rehabilitation related matters d. ITM and BTC: pilot testing hammock bednets as malaria prevention strategy e. MSF and ITM: monitoring indicators for HIV/AIDS care f. BTC and MSF: diabetes care g. BTC training facility project: share information with all
In general all projects are coherent with the national policies and complementary with other donor / government inputs. The only example of potential duplication of efforts noted by the mission is the presence of ESTHER and MSF in the same provincial hospital, both for HIV/AIDS care.
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 17
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
HI coordinates its rehabilitation projects with other NGOs, which are all in line with the national plan. Also the HI road safety project is very much actively seeking coordination with other donors involved and promoting intersectoral collaboration. Both could be optimised when the National road Safety Committee will become effective. Health need Provision of basic health services (basic and complementary package of activities) responds to a well-recognised health and poverty need. The same applies to provision of HIV/AIDS care services and rehabilitation services (clinical and social). Providing these services through the public health system network is a rational choice, especially in order to limit health expenses of poorest people. The introduction for equity funds improves access for the poorest to essential services. Involving NGOs for taking care of complementary costs (transport, lodging) is also relevant. Addressing both the demand (behavioural change, information, community participation, school health) and supply sides (staff motivation, quality of care, training, etc.) is a rational (and to some extent innovative) approach. The integration of HIV/AIDS care in general hospital services has a positive effect on utilisation and stigmatisation. Integration in the CDC has drawn the attention to other major chronic health problems such as diabetes and improved diabetic care. MSF and ITM are at the forefront of HIV/AIDS care in Cambodia, an important health need that is insufficiently covered. The focus of HI support has evolved from mine victims to road traffic accidents (a rapidly increasing health problem), taking into account changing health needs. Multi sectoral approach Several projects (BTC, HI rehabilitation, HI road safety) have a relevant multi-sectoral component with MOE, developing primary school curricula for health, rehabilitation and road safety related issues. HIV/AIDS care is being addressed through MOH / NCHADS (no other sectors involved). Malaria research has no inter-sectoral component. HI rehabilitation services are under MoSALVY (no other sectors involved). Road safety is being properly addressed through the Ministry of Interior (Police Force), MoH, MoE, MoTransport. Other sector health-related issues (population, nutrition, environment, water &sanitation) get less attention in the Belgian support. However, several projects involve local NGOs (Consumer Right Organisation, indirect costs of health services, community rehabilitation) and local communities. Private sector involvement (except for ITM HOPE) is an area that could be strengthened. The proposed health system model is the national model, which is very much a PHC based district concept approach. This makes sense in the Cambodian context. However, more involvement of the private sector could probably improve sector performance and would assure better quality throughout the system (the private sector is fast growing entity and many public providers are also privately active). People spent a lot on health (30 to 35 USD per capita per year), much more than the 9USD provide by government and donors. One of the questions is
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 18
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
how to attract at least part of that money to good quality public (and good quality private) services. The “project model” nor the “national model” gives a lot of priority to this issue of PPM.
Cross-sector issues Sustainability All stakeholders consider financial sustainability impossible over the next 5 to 10 years. But technical and institutional sustainability should be and is being pursued by all projects (training of staff, strengthening health system, capacity building). Even achieving technical sustainability in a 4-year project is questionable. Institutional sustainability can be further promoted through strengthening decentralisation. As far as sustainability is concerned, the major areas of concern are:
1- Technical and managerial sustainability The capacity building component of projects contributes to better performance of the system if there is good management in place. All projects invest a lot in capacity building and training of local staff. However, retaining good staff is an issue because of low government wages. All projects support performance incentives (increasing temporarily staff income through donor resources), which has become ‘standard practice’ in Cambodia (although only about 1/3 of the districts have performance incentive systems in place). None of the projects does (yet) take a comprehensive view on human resource development and all deal with the problem at project level (no support to developing a national strategy / system of human resource management & development). However MOH/DFID has now contracted OPM to address the issue of standardisation of performance based incentives. As discussed under human resources this raises the question whether the international community should or should not support government salaries in development aid. On the international scene, traditional resistance against supporting recurrent budgets is progressively –and rightfully- reducing. HIV/AIDS care is not yet sustainable in the medium term mainly because of its costs and to a lesser extent because of technical capacity requirements. MSF supports national plans to build capacity at selected provincial and district hospitals (kick-starting activities at several sites in addition to its main support in 3 provincial hospitals). ITM approach shifted from « best intervention » to « most cost-effective » intervention (e.g. procurement of ARVs). Technical sustainability of the RTA intervention is still an issue, but mainly because of the financial support needed to continue managing / implementing the systems. Integration of management of the database in the government structure and the information system in the national information system is being addressed. Sustainability is being promoted through behaviour change. 2- Financial sustainability None of the projects has a clear strategy on financing of the health system. The BTC project document states that [at 3.65€ per capita] it is too early to be concerned, as financial sustainability of health services is still far off. There is somewhat confusion between insufficient financial resources being available to deliver proper health services
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 19
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
(where indeed 3.65€ per capita is very limited and largely explained by the very low wages) and financial sustainability of the interventions / strategies being introduced / supported. It does not make sense (and raises even an ethical question) to support staff wages for a limited time period of 4 years (incentives tend to increase levels of staff wages by a factor 5 to 30 (!) in Cambodia, depending on type of staff and donor). The mission does not question the need to support staff incentives in Cambodia, but this should be done over a reasonable time frame in order to indeed allow government to “buy in” and should preferably be done in a standardised way, nationwide to avoid negative consequences and staff moving to the highest bidder. Project assumptions of the capacity of the Cambodia government to “buy in” and increase sufficiently staff salaries over the 4-year period prove not to be realistic (at least up to now, 3 years after project formulation). A reasonable exit strategy is not discussed in the BTC project document probably because it was assumed that support would continue beyond the 4-year period. Within the next 3 to 4 years, if the government salary will continue to increase at the present level (net annual salary increased by 15%), the staff salary will not reach a level where staff motivation and performance can be improved or maintained. Financial sustainability is even more an issue in rehabilitation services where government resources cover only 10% of the total costs; and in HIV/AIDS care where treatment costs per patient are considerably high (300-400USD annually). In this context it may be necessary for the international community to engage jointly in a much longer timeframe than traditional project cycles allow. A challenging viewpoint is how to make use of the 30-35USD annually spent by Cambodian people on health, of which less than 1USD are captured by the public health services; how to achieve more national solidarity (between the rich and the poor; and between the healthy and the sick); and how to limit health expenditures for the poor. The equity fund (used by BTC projects and HIV/AIDS care projects) covers only the fee for service at hospital level. In principle health centre services would be free of charge to the poor (as part of the performance contract). Implementation of this nice principle would require close monitoring (human resources, ethical code and attitude, etc.). The equity fund does not cover the direct full costs of services (true cost of a hospital service) or the indirect costs (transport, time-off). It could be an interesting idea to let the equity fund evolve in a true health services fund that can contract for services with for example the hospital (and also with the health centres). Also, the project formulation documents do not envisage financial strategies to guarantee sustainability of the equity funds. The BTC project formulation proposes some developments regarding pre-payment and health insurance schemes in a later phase of the project. The 4-year timeframe is again a major constraint for starting such initiatives. 3- Institutional sustainability The BTC projects work through the public institutions and support capacity development and civil society involvement (hospital board, CRO, health centre committees). This makes sense. Real capacity development will also require close collaboration and good working relations between the Project management Unit (PMU) and the Provincial Health Directorate (PHD). The issue of the missing partner (private sector) has been discussed above. MSF HIV/AIDS care projects strengthen technical capacity of public provincial / district hospitals. At Siem Reap the focus was more on technical than institutional strengthening. But MSF coordinates closely with NCHADS, aiming to some extent at building NCHADS capacity. The ITM HIV/AIDS project builds the HOPE hospital capacity as a training centre for HIV/AIDS care. The ITM malaria research project does aim at building research capacity of
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 20
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
NCMC. Institutional strengthening of NCHADS is essential for longer-term sustainability but NCHADS does reportedly not optimise its use of capacity or experiences of all NGOs active in HIV/AIDS. Regarding reporting requirements by DGDC, NGOs seem to have no complaints (reporting requirements are not too cumbersome and DGDC is a “nice donor”). BTC staff however complains about the high workload involved in monthly reporting.
Communicable diseases The mission has not had the time to address this issue in detail but has the impression from the interviews that infectious diseases are managed largely within the general health services and as part of the minimum / complementary package of care. According to the formulation report, all vertical programs (TB, Malaria, EPI, MCH, HIV/AIDS (NCHAD), CMS, NCHP....) have their own plans and supporting partners (TA, funding) and have provincial counterparts within the Technical Bureau in the Provincial Health Departments. TB, malaria, HIV/AIDS and MCH are strongly supported by the HSSP project. EPI has UNICEF as a main partner. JICA is a major supporter for TB. The EU supports malaria programs, and UNFPA supports MCH work, particularly reproductive health. All donors support common activities such as training, supervision, capacity building, and infrastructure development, including provincial level program and often OD level as well. Integrated approach to HIV/AIDS care is implemented in general hospital setting (MSF, ITM) and in outpatient chronic disease clinic (MSF). It is not clear yet what the national policy will be regarding integration of HIV/AIDS care in chronic diseases clinics. International partnership This aspect of the evaluation is generally not relevant at project level and will be addressed at the international level. The malaria research project covers 3 countries: Vietnam, Laos, and Cambodia. Regional capacity building is a major aim and according to the people interviewed much appreciated. This includes one regional meeting of 3-4 days annually, sharing staff between institutions, joint publications (1 planned), regional website and internet communications. National Partnership Generally, for all projects, partnership with the national partner is well structured, as discussed above. The national and provincial partners appreciate involvement in the identification and formulation of BTC projects. The process of formulation and the mechanism of the steering committee strengthen local ownership. Integration of the BTC intervention in the national health strategic plan facilitates implementation by the PHD and health staff and supports national policy implementation. The steering Committee mechanism is very much appreciated by the MOH and Provincial authorities. It allows flexibility in project implementation and joint decision-making. However, the role / authority of BTC is not always clear to the provincial partner (PHD).
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 21
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Both BTC projects in Cambodia seem not very well known by major international stakeholders such as WHO, UNICEF, World Bank, DfID, etc. The BTC projects are not well known by health or health related NGOs, even those NGOs that are present in the project areas such as in Siem Reap province (while NGOs know that BTC is present, they do not know what the BTC support entails). Even Belgian NGOs (e.g. HI) who are working at the same site (provincial hospital) have no concrete idea of what the BTC project is doing / aiming at. And the opposite is true as well. (e.g. HI working at a client charter for handicapped people does not know that BTC aims at supporting developing a customer rights charter; both HI and BTC have a project component of working with MOE on training modules but no consultation has taken place between partners to discuss whether there could be something gained from coordination; this does not seem to be an issue of unwillingness to collaborate but rather lack of knowing what each one is doing). BTC could be more involved at the national level in order to assure that relevant information is regularly shared with other partners, that lessons learned go beyond project borders and influence national policy / strategies and that BTC is recognised as an important stakeholder in the sector (which it is de facto, given the well designed, innovative and challenging projects and the population coverage – 12%). MoH would like BTC to be more proactive (such as DFID, EU, WB, ADB) in supporting sector review, participating in the technical working groups. Only MSF participated in 2005 annual sector review. Administrative workload limits the possibility for the national BTC representative and even the provincial TAs to be sufficiently involved at the national level. Administrative workload of the national representative is estimated at 80%; of the provincial TA at 60%. All three are public health experts, investing most of their time in administrative work that could be – at least partly- done by a project administrator. This is rather inefficient use of expertise. While administrative and financial follow-up and accountability is indeed very important (and as such reflected in the DGDC-BTC agreement?), implementation could be organised differently. It is unclear how much BTC project staff are accountable for reaching project outputs rather than mainly for administrative/financial targets. The set-up of BTC Project Management Units has a number of potential drawbacks. It is acknowledged that the context of Cambodia does not yet allow for integrating project resources in national budgets and budget systems. But, this does not stop a project of “simulating” this optimal situation by drawing a “shadow budget” and dealing with it as if it would be part of the district / provincial / national budget. Also, PMUs could best be integrated as an integral part of the PHD, aiming particularly at strengthening PHD capacity. The mission also acknowledges that reality in the field (e.g. availability of office space) is not always optimal to foster integration. NGOs coordinate with other “like-minded” NGOs and have regular meetings. Examples are Medicam, an umbrella organisation for all medical NGOs, which is the official representative NGO channel with MOH and chaired by MSF; NGOs active in rehabilitation also meet regularly and have jointly planned together with MOSALVY an institutional and strategic evaluation. . Partnership with local communities / civil society Involvement of local communities happens in principle already during project formulation (BTC, but participation of local communities have been limited to some NGO participation) and in implementation (Consumer Right Organisations managing the equity fund, Health Centre Committees, Hospital Board). Community awareness is also raised through the BCC.
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 22
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Teaching school kids in health-related messages allows taking into account health behaviour issues outside of the health sector (tobacco, alcohol, road safety, healthy food) and typical health sector related issues (e.g. malaria prevention). The BTC project supports decentralisation efforts to district level and involves local authorities. Community participation in HIV/AIDS care and rehabilitation services is manly limited to NGOs participating in taking care of people who have difficulties in paying indirect costs. Cabdic does active partnering with CBOs and community volunteers to identify handicapped people at community level. Cabdic (being a HI project) will itself become a local NGO. Civil society is a major partner for the road safety project in developing local safety networks. Gender equity Gender is generally receiving some but limited attention. In the BTC project formulation gender is generally not perceived as an important issue to be specifically addressed. The formulation report however indicates that A) The project aims at reducing maternal mortality through introducing emergency obstetric care services and safe abortion. B) Reproductive health services are part of the MPA. C) Female headed households are disproportionately poor and taken care of by the equity fund. D) And the CRO actively seeks female participation in its Board. The PMUs have actively sought for female TA but partly failed. This reflects the male dominance in health services (and in general in government services senior posts). The Consumer Right Organisation and other community advisory bodies also aim at attracting women as members. The BTC project design allows for a stronger focus on gender, especially the components of behavioural change, consumer rights charter and monitoring indicators (e.g. adolescent health, disaggregated health data to inform strategy development). The equity fund focuses on the poorest. Female-headed households are disproportionably represented amongst the poorest. However, women are generally under-using the health services more than men (« women have to look after the children and stay at home »). Specific project strategies could be developed to attract women to health services (BCC). It could be interesting to have a national gender expert looking at project interventions through a gender perspective and advising PMUs. BTC project formulation in principle happens through participatory workshops. From the Siem Reap project formulation report, participation by women seems to have been very limited (2/27, 3/32 and 6/42 in 3 planning workshops). The situation in Kampong Cham was similar with 4/29 females in the planning workshop (3 out of 4 were donor representatives). Rehabilitation patients tend to be 75% male, mainly because mine victims are more often men but also because women tend to come less easily forward with their handicap. Active registration of girls and women with handicaps is being pursued by CABDIC project. And media campaigns address specifically gender issues such as stigma, client rights and under-utilisation of services. The rehabilitation centre has no gender policy. Malaria research (ITM) has shown that men are more prone to malaria attacks because of their overnight stay in the forest. Hammocks with bednets are being pilot tested. A larger pilot test could eventually be implemented in BTC provinces.
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 23
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
HIV/AIDS care. According to MSF there is no gender bias in access to services. In principle a client has to bring his partner before treatment is started. MSF and ITM try to have male and female counsellors and peer educators. ITM/ HOPE lottery system for selection of patients for HAART does not include gender criteria. Road safety does not (yet) include gender specific strategies. However, accidents are mainly caused by young male drivers at night (e.g. students). Preventive strategies focus on children, adolescents, drivers and civil society at large. HIV/AIDS The vision of NCHADS is to integrate HIV/AIDS care in general health services and by doing so strengthen the existing health system. MSF and ITM share this view and projects are developed that way. Training capacity of ITM/ HOPE hospital in HIV/AIDS care is not yet fully exploited by NCHADS (e.g. training of trainers). However, training is the primary objective of the ITM intervention. MSF supports NCHADS in developing guidelines for HIV/AIDS care and training curricula; and MSF supports decentralisation of HIV/AIDS care (within NCHADS plan). MSF has never met UNAIDS in Cambodia. The BTC formulation report states that “The health projects would pay specific attention to HIV / AIDS. This was formalized in the Specific Agreement signed in Brussels between the two Ministers on 29 May 2001, with the agreement being detailed in the Cambodian-Belgian Bilateral Co-operation Indicative Co-operation Program for 2002-2004 (ICP)”. The project HIV focus is mainly on prevention through the BCC component. Other actors are active in HIV/AIDS care (e.g. MSF, Esther). It is not clear whether in KC and M provinces HIV/AIDS care needs are sufficiently covered. Nor whether other aspects such as PMTCT, VCT are sufficiently addressed through BTC projects.
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 24
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Development issues extracted from the health strategy
note Durable development The context of Cambodia makes the health sector (similar to other social sectors) still much dependant on outside resources but that will be so for some time to come. Investing in developing longer term financing strategies for the health sector is essential (but investing in other factors that determine economic growth and national tax systems is equally or even more important). Belgium needs to continue supporting countries such as Cambodia in service delivery (making essential services accessible to the poor), while at the same time developing strategies that support the medium to longer-term development of country. The donor community should invest in durable development and good governance. It may be beyond the objectives of some of the Belgian projects but building capacity in the private sector may help support longer-term development. One possibility within the limits of the projects (especially BTC, HIV/ADS, rehabilitation) is developing longer term financing strategies including principles of a health services fund, pre-payment or insurance schemes. Attracting some of the present health expenditures made outside of the public sector to good quality public (and private) services is a major challenge for the government. Most projects are part and parcel of the national health strategic plan (or other sector development plan: e.g. rehabilitation) and BTC projects have taken the NHSP plan format (6 components) as the project format, while using national indicators for M&E and building upon local existing public structures. However, the BTC project formulation has overestimated national capacity and the project will not be able to reach the project objectives in the 4-year time frame. The latter is at odds with a longer-term development perspective. NGO projects take a longer time perspective to development. All projects aim at sustainability (see higher) and building local capacity to take responsibility and assure ownership. Improving health, assuring access to health services for the poor, limiting the consequences of handicaps and reinserting individuals in schools and local economy, all have in principle a potential positive impact on durable development if local ownership is assured and lessons learned are translated into local policy and strategies. As discussed earlier local ownership is very much assured through the institutional partnerships but there is room for improvement in how lessons learned can be shared and used. Lessons learned in HIV/AIDS care are shared nationally (Medicam, NCHADS) and internationally (ITM, MSF global efforts). Good governance is a major issue in Cambodia, which is not always dealt with explicitly or coherently by the donor community. Part of the problem is related to the extremely low public sector wages. The project (as many other donors) deals with this through performance based incentive schemes and managing project resources parallel to the government system. While it is rational to support wages over a medium-term time period in order to guarantee essential service delivery, especially to the poor, it is important to develop longer-term financing strategies in parallel. Some donors have joint forces (WB, ADB, DfID, UNFPA) and are implementing a so-called SWiM approach (HSSP). It is not clear why Belgium has decided not to join this initiative (which is a potential vehicle to developing progressively a SWAp). However, the BTC support is very much aligned with the
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 25
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
national plan and to some extent similar to the components of the HSSP. The national health strategic plan is the main vehicle assuring that “most stakeholder noses point in the same direction”. Operational methods and strategies All Belgian supported health interventions are in line with the national strategies, agreed with the main stakeholders. Generally, these are based on common sense and present international and national experiences (and constraints). The national health strategic plan is quite well focused but ambitious. It has obviously been written to a large extent by (capable) international experts together with MOH. Its constraint is that achievements largely depend on substantial (financial and technical) support from the donor community. It’s weakness is mainly the lack of long-term development of financial strategies (beyond the principles of the equity fund and user fees), its lack of a pro-active comprehensive strategy to attract consumer expenditures to the public sector (beyond the principles of improving staff motivation by paying them better which does lead to increased utilisation of public services) and leaving the private sector out. At the same time some projects test out innovative strategies such as the CRO, equity fund (principle that already existed), BCC, HIV/AIDS care strategies (MSF guidelines developed with ITM), community based rehabilitation, road safety strategies. Intersectoral collaboration between MOH and MOE in BCC and between HI (MOSALVY) and MOE in rehabilitation awareness is a potential promising approach. High administrative workload of the BTC representative and TAs limits the efficient use of their professional technical know-how. The real technical input by the TAs is limited by their administrative workload, which could be done to a large extent by administrative staff. Intersectoral collaboration between MoTransport, MoH, Mo, MoInterior, DAC and CRC relative to transport safety (through the set-up of a national committee) is a strong mechanism to improve awareness and introduce appropriate action regarding transport safety. Active lobbying has put road safety on the political agenda and resulted in involvement of the King and Prime Minister. Road safety now considered as second health priority after HIV/AIDS. Capacity building Capacity building is one of the 6 key areas of MoH' s Health Strategic Plan 2003-2007. Capacity building and training is one of the main objectives of each of the projects. This covers different targets groups such as managerial and technical/ clinical staff. BTC training and capacity building efforts are based, at least partially, on a training needs assessment, which makes sense. The BTC project formulation report present a short analysis of issues related to HRD in Cambodia. This is not translated into support of a comprehensive HRD strategy in the project formulation beyond the performance-based incentive schemes (which are in principle relevant and essential to achieve better sector performance), training needs assessment and training / capacity building efforts. The latter are important elements of HRD and may feed into developing national HRD capacity. To some extent project formulation has been done from a project perspective (how can we make health services operational at provincial/district level in the provinces where the project is active; which can produce relevant lessons for the national level) rather than from a national health system perspective (how can the HRD issue be dealt with at a national scale; testing out different options at the operational level, province / district). The same observation applies to training / capacity building in other projects. In HIV/AIDS care high quality technical back-up is provided (ITM, HOPE, telemedicine). Capacity building is the main objective of the ITM HIV/AIDS care project, building the training capacity of the hospital as a national and regional training centre. It is directed to both hospital staff and outside health
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 26
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
staff, but not part of an overall HR plan (the “HIV doctor” certificate is not recognised nationally). Local and regional capacity building is also a main objective of the malaria research project, which fosters staff exchange between national institutions in the region. Rehabilitation projects also focus on local capacity building of MOSALVY networks. In general TA is needed and well used (with the limitations regarding administrative workload in BTC project set-up as discussed above). Capacity building requires close collaboration and true partnership. The PMU set-up in BTC projects may render capacity building less effective, as discussed above. Operational research could be used more as a means to build local capacity. Financing Strategies Some aspects have been covered under 6.1 and 7.1. Most projects have some aspect of health financing strategy, e.g. the equity fund (BTC, HIV/AIDS) and the performance based incentives (BTC, HIV/AIDS, HI). The BTC project is interesting in the sense that it introduces the concept of the equity fund (managed by local NGOs, evolving in Consumer Right Organisations) and addresses the constraint of increasing staff salaries. Those funds have a direct impact on accessibility to hospital services for the poor. Equity funds cover presently only user fees that do not cover full costs of services delivered. It could be interesting to develop the equity fund in a health services fund covering full costs of services. The concept of performance-based incentives (also called the “new deal”) is a nice example of how project experiences (in this case amongst others MSF) can develop into national policy. It is also a nice example of how project experiences (with close supervision, additional resources) are not always easily replicable at a national level (today only 1/3 of districts have some new deal element in place; it is not clear how much better performance is solely linked to increased salaries and/or other project/donor inputs; will performance be maintained when all civil servants will get increases – when salary increase becomes the rule rather than the exception? And how feasible is it to increase salaries across the board to a level that it is meaningful? Local examples suggest that when salary supplements are withdrawn, the cake collapses: how can the system be sustained?). Contracting at present is limited to performance incentives. Future strategies could aim at « full » contracting for providing the services at the real cost. No specific longer-term financing strategies have yet been developed but the project formulation mentions the possibility to introduce pre-payment and/or health insurance schemes at a later stage. Again, the limited project duration is a constraint to start such initiatives, unless assurance is provided that the project will be extended. As mentioned earlier it would be a challenge (and a necessity from a Cambodian health system point of view) to develop long-term financing strategies. This is one of the main challenges faced by the MOH and the sector. This is also an area where Belgian projects could collaborate more. Another issue for debate is whether HIV/AIDS care (and other chronic diseases) should be free of charge for everybody. Financing strategies should also take into account in the medium-term the (non)availability of GFATM funds. Plea / Belgian viewpoint BTC and other Belgian actors do not raise the Belgian Flag too often or too obviously. In general project interventions, logos, etc. are appropriately modest in “selling the Belgian Flag”.
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 27
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
On the other hand, as mentioned earlier, BTC could be more pro-active at the national level (see 6.4). BTC (and probably also other Belgian actors) make some publicity about their interventions. BTC has raised the issue of the limited timeframe of the intervention through an article in the international press. Articles written by local or international reporters carry the risk that some messages are not properly translated or may not be fully in line with BTC’s profile. This may have been the case with one article concerning BTC’s interventions in Cambodia. Although BTC staff does not know the health strategy paper, the projects are well in line with the strategy note and BTC’s “trademark” in Cambodia reflects this. In general the Belgian Cooperation is not well known by other partners in Cambodia. The Belgian « approach to health sector development » is not well known, apart from some who participated in the BTC project formulation. Work by NGOs is generally better known, but BTC only started relatively recently. MSF is off course well known by its global efforts to put HIV/AIDS care on the international agenda. MSF plays a similar role in Cambodia, being at the forefront of HIV/AIDS care, managing a significant percentage of all treated patients, and influencing national policy development through NCHADS and Medicam. HI is known as an active promoter of awareness regarding socially and physically handicapped people and regarding road safety. HI is present in the “streets” through posters, leaflets, etc. and in the “media” through awareness campaigns (rehabilitation and road safety). HI has managed putting road safety on the national agenda. Country action plan A national action plan for Belgian interventions does not exist. Cambodia is no longer a partner country. The draft country strategy paper (2002) does not contain an overview of Belgian interventions. Research The BTC project formulation report does foresee some funds for operational research and some funds for attending meetings at central level. No operational research has started yet. MSF claims to do some small operational research and develops a cohort based monitoring system together with EPIcentre. The ITM HIV/AIDS care project trains staff in some operational research (which has not yet resulted in formal publications). The ITM malaria research project has resulted in several national publications (one regional publication is planned). HI rehabilitation projects do not seem to have a research component. The HI road safety project has completed several action-oriented studies (knowledge and behaviour of motorbike taxi drivers; road safety experience of communities). These are mainly oriented towards national strategy development and have not (yet) resulted in publications. In general operational research does not get a lot of attention in the projects reviewed. Global Fund ATM Cambodia has applied to the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria rounds one, two, three and four. In 2003 the Global Fund Round 1 project started and in 2004-5 the Global Fund Round 2 project, which will allow to treat about 5000 HIV/AIDS patients in a public-private partnership. The proposal for Global Fund Round 3 was refused but in 2004 a proposal for Global Fund Round 4 was
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 28
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
accepted, which will increase the number of patients on antiretroviral therapy in Cambodia to over 20.000 by the year 2009. HOPE hospital has no access yet to GF drugs (expected to arrive in 2005). (To be completed with GFATM evaluation report).
Conclusions Based on this short assessment the mission is of the opinion that in general all interventions aim at and are of high quality, are well integrated in either the health strategic plan 2003-2007 (BTC, HIV/AIDS care, malaria research) or other ministries development plans (HI -rehabilitation) or are addressing new health related strategies (HI, Road safety). All interventions try to avoid duplication and pursue harmonisation with other partner and government’s inputs. National institutions do not always optimise the use of project resources to strengthen national capacity (e.g. ITM HIV/AIDS care training). All interventions do reflect the main concepts and priorities of the Health Strategy Paper; focus on essential services and/or essential health problems and in general strengthen the health system. HI does strengthen rehabilitation services through MOSA’s separate network and road safety is being adequately addressed through several ministries. The health strategy note does not sufficiently address issues such as human resource development, private sector development, rehabilitation and road safety. Some interventions test or introduce innovative or relatively new approaches (equity fund, performance based incentives, consumer right organisation, behavioural change, road safety, community based rehabilitation). Lessons learned could be useful for interventions in and outside Cambodia. All interventions are constrained by financial and to a lesser extent technical / institutional sustainability. This is the context of Cambodia, but Belgian interventions (and/or the donor community at large) could do more to address the long-term consequences of low technical and financial capacity, such as:
Donor community to support government to increase national budget (tax systems; economic activities)
Projects to support the introduction or pilot test health financing strategies (BTC, HI, ITM, MSF)
Projects to be planned over reasonable time horizon allowing achieving sustainability (BTC)
All interventions put a lot of emphasis on capacity building (training, training facility project), but these inputs are not part of or in support of a well established human resource development plan; donor support to pre-graduate health staff training seems limited; and use of training capacity is not always maximised (ITM).
In order to foster sustainability and stimulate local ownership, lessons learned should be shared as much as possible through national fora and support national policy development; TA should participate actively in TWG and ASR, and support donor coordination; opportunities for pursuing project flexibility (BTC) should be used if project formulation has not adequately foreseen all resources or constraints to achieve results; the set-up of project management units should be in support of local capacity building; and national systems should be supported whenever possible (rather than developing project owned systems). HI as well as other NGOs active in rehabilitation face an acute problem of sustainability as government inputs is extremely limited (10%) and the institutional partner does not take full advantage of the presence of NGOs and the lessons learned to develop national strategy.
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 29
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Complementarity between Belgian actors could be strengthened by simply sharing project documents and relevant information; and by alertness to pursue opportunities for complementarity or collaboration within the framework of the national health strategic plan. Examples of collaboration exist, but there are additional potential opportunities for collaboration, as suggested above (section 5.4). Capacity building and institutional strengthening is well addressed by most projects but to some extent constrained by the typical set-up of project management units. Gender issues receive some attention but could be more articulated (e.g. consumer rights charter, client rehabilitation charter, BC, malaria prevention, sexual violence, access to rehabilitation services). Administrative workload of BTC representative and TAs limits effective use of technical support. This is less of an issue in NGO and ITM projects. Delay in starting a project (BTC) carries a risk of reducing local dynamics and changing local expectations. A major challenge for the Cambodian health system is how to assure that health expenditures (30-35 USD per capita) are optimally used for better health and reducing poverty. How can health expenditures of the poorest be reduced by improving quality of public and private providers and stimulation change of health (seeking) behaviour; and how can national resources be best used to improve access to essential services? This requires national political willingness to effect changes and to reduce dependency on donor resources. It also requires political courage to address the human resource development of the public sector and the regulation, stimulation of the private sector development. Projects should define (in coordination with the government and donor community) what is achievable in a longer-time framework and define actual short or medium-term project inputs and results as a benchmark in reaching those longer-term development results. These include fundamental issues such as health financing and human resource development which may be beyond the scope of a particular project and project time frame but to which achievement project inputs should be clearly assigned (rather than define those inputs only as part of a project element). Strategic support from the Belgian inputs to the above constraints in the sector is limited and mainly focused at operational (e.g. provincial/district level) or project level (e.g. performance based incentive payments). There is no direct strategic or institutional support at central level to support MOH addressing those issues (with the exception of road safety). However, projects can have an impact on policy level, using lessons learned from project level, if this is actively pursued. While donors still refrain from SWAp in Cambodia, a SWAp could be exactly the means to achieve sector-wide development more timely and in a more substantial way (e.g. by motivating government to curb corruption) than by continuing donor projects that can be negotiated independently. during formulation
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 30
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Annexes
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 31
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Annexe 1. Tables related to the impact diagram Fonctions essentielles du secteur public appuyées
Projet Tous projets belges
Autres intervenants
Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
(x)
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
(x)
Législation et fonctionrégulatrices établies
s
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Allocation des ressources améliorée
(x)
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
(x)
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
(x)
Politique d’information et système d’information établis
(x)
Stratégies de financement de la santé établies
(x)
Tableau 4
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 32
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Impact sur les fonctions essentielles du secteur
public
Projet Projets belges Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
(x) Potentiel
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
Législation et fonctions régulatrices établies
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
(x) Performance-based incentives
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Allocation des ressources améliorée
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
Politique d’information et système d’information établis
Stratégies de financement de la santé établies
(x) Aspect of equity funds
Tableau 5
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 33
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Fonctions essentielles du secteur public faiblement prises en
charge dans le secteur santé Oui / non Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
Non HSP 2003-2007
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie Non Exists but can be strengthened through decentralisation
Législation et fonctions régulatrices établies Yes Generally weak and not enforced regulatory framework
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé Yes Major problem determining health sector performance
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé Yes/No No major problem in public sector, but problem in private sector
Allocation des ressources améliorée Yes No transparent allocation formula, but being developed Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi Yes Problem of corruption
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
No Annual HSR, donor cordination
Politique d’information et système d’information établis ?
Stratégies de financement de la santé établies
No/Yes Short-term strategies being tested but long-term strategies missing
Tableau 6
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 34
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Résultats sectoriels : focus principal de l’appui
du projet Projet Projets belges Commentaires
Soins de santé essentiels définis et disponibles X
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre le secteur public et les secteurs privés
XX Private sector not sufficiently involved
Ressources humaines compétentes et motivées en place X No well developed national HRD strategy, support at project level
Pouvoir de décision et de gestion, décentralisé au niveau approprié X Support to decentralisation
Système d’encouragement à la performance en place X
Accès aux médicaments essentiels et approvisionnement assurés X
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins X
Participation du parlement, de la société civile, des partenaires et des communautés locales assurée
(x) Some aspects of community participation in place
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés X Aspects of BCC, CRO, CR charter
Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain x Through BCC
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services ?
Le financement de la santé est efficace
Le financement de la santé est équitable et juste (x) Equity Fund
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 35
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Tableau 4
Résultats sectoriels faibles ou problématiques Oui / non Commentaires
Soins de santé essentiels définis et disponibles Yes & No MPA/CPA defined but availability limited because of limited resources
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre le secteur public et les secteurs privés No Private sector strategy weak
Ressources humaines compétentes et motivées en place Problem Main problem determining sector performance
Pouvoir de décision et de gestion, décentralisé au niveau approprié Partially Decentralisation being pursued, but not always effectively
Système d’encouragement à la performance en place Yes Major element of the sector (known as the “new deal”)
Accès aux médicaments essentiels et approvisionnement assurés Yes / no Said not to be a problem in the public sector, but problem in private sector
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins Partially Interesting activities of contracting in & out; boosting. Attempts to make MPA available through contracting but no national effective coverage (yet)
Participation du parlement, de la société civile, des partenaires et des communautés locales assurée Partially
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés ? Consumer rights charter being established by MOH
Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain Project initiatives (BCC is one of the 6 main NHSP strategies)
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services Partially TWGs use operational experiences; Mechanisms for sharing
of lessons learned at national level exist. Le financement de la santé est efficace No Major challenge for the sector
Le financement de la santé est équitable et juste No But attempts are made by introducing equity funds. This is however only one element. RAF is being worked on.
Tableau 5
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 36
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Autres secteurs appuyés Projet Tous projets belges
Autres intervenants
Commentaires
Politique et stratégies de population établies No But potentially addressed through BCC
Politique et stratégies de nutrition établies No But potentially addressed through BCC
Politique et stratégies d’eau et hygiène établies No But potentially addressed through BCC
Politique et stratégies de l’éducation établies Partially Scholl kids training in health related matters through MOE
Politique et stratégies environnementales établies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
No But potentially addressed through BCC
Politique et stratégies de sécurité routière établies (Yes) Addressed through BCC
Environnement favorisant un comportement sain en place No But potentially addressed through BCC
Tableau 6
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 37
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Autres secteurs faibles concernant les actions liées à la santé Oui /non Commentaires
Politique et stratégies de population établies ? The evaluation did not cover these issues
Politique et stratégies de nutrition établies ? The evaluation did not cover these issues
Politique et stratégies d’eau et hygiène établies ? The evaluation did not cover these issues
Politique et stratégies de l’éducation établies ? The evaluation did not cover these issues
Politique et stratégies environnementales établies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
? The evaluation did not cover these issues
Politique et stratégies de sécurité routière établies (x) The evaluation did not cover these issues
Environnement favorisant un comportement sain en place ? The evaluation did not cover these issues
Tableau 7
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005 Annexe 2 - 38
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Annexe 2. List of people met
Organisation Name Function E-mail address BTC Alain Devaux Resident Representative [email protected] Leang-Hy Liv Programme officer [email protected]
BTC Dr. Dirk Horemans
PHBS Project Management Unit, Kampong Cham, Project
coordinator [email protected]
BTC Dr. Georges Dallemagne PHBS Project Management Unit, Siem Reap, Project coordinator [email protected]
BTC Dr. Rida Slot
BCC T.A., PBHS- Project Management Unit, Provincial
Hospital of Siem Reap [email protected]
Institute of Tropical Medecine Dr. Paul De Munter ITM Technical Advisor HOPE
Hospital [email protected]
Institute of Tropical Medecine Dr. François Crabbé Technical Advisor on STI
Management [email protected]
Ministry of Health Prof. Eng Huot Secretary for Health
Ministry of Health Dr. Duong Socheat
Director National Center for Parasitology, Entomology and
Malaria Control [email protected]
Ministry of Health Dr Lo Veasna Kiry Director of the Department of Planning & Health Information [email protected]
Ministry of Health Dr. Nguon Sim An Director of PHD-Kampong Cham,
Project Director [email protected]
Ministry of Health Dr. Lon Chan Rasmey Deputy Director of PHD-Kampong Cham & project Director Assistant [email protected]
Ministry of Health Dr. Dy Bun Chhem Director of Prov Health Department
Siem Reap Ministry of Health PHD staff PHD Kampong Cham [email protected] of Health PHD staff PHD Siem Reap [email protected]
MSF Belgium Dr. Bart Janssens Medical Coordinator [email protected] MSF Belgium Kheang Soy Ty Deputy Medical Coordinator [email protected] Belgium Dr. Sophie Duterme Project Coordinator Siem Reap [email protected]
Handicap International Mr. Bruno Leclercq Project Director [email protected]
Handicap International Mrs. Edith Van Wijngaarden Rehabilitation department
coordinator Handicap International Mr. Ouch Sary PRC Manager, Siem Reap Handicap International Mr. Sok Sophorn PRC Coordinator, Siem Reap
Handicap International Mr. Chan Nith Cabdic Field Supervisor, Siem
Reap Handicap International Mr. Jean Van Wetter Road Safety coordinator [email protected]
National Institute of Public Health Dr. Thay Ly Heng Head of Technical Office [email protected]
National Institute of Malariology, Parasitology and
Entomoly Dr. Doung Socheat Head of Department Mariology
Royal Embassy of Belgium (Mr. Marcus Leroy) Attaché [email protected]
Royal Embassy of Belgium Mr. Carlos Lietaer First Secretary Development
Cooperation [email protected] Mrs. Elisabeth Smith Health Advisor
Unicef Thazin Oo Head Health and Nutrition
Programme [email protected] Rasoka Thor MCH Project Officer [email protected]
WHO Paul Weelen Health systems Development
Adviser [email protected]
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 2 - 39
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 3 - 0
Evaluation of the Belgian Cooperation health sector support
Annexe 2. Rapport Équateur
HERA / Country Report Cambodia / Décembre 2005
HERA HEALTH RESEARCH FOR ACTION .
Evaluation of the Belgian co-operation to the health sector
Country report
ECUADOR
Laarstraat 43 tel. +32-3-8445930 B-2840 Reet Belgium fax. *32-3-8448221 Bank No 401-2025551-15 e-mail [email protected]
www.herabelgium.com
Evaluation of the health sector support of the Belgian Cooperation
Table of Contents
1. FICHE SYNTHESIS..................................................................................................................... 6
2. FOCUS OF THE BELGIAN SUPPORT AND THE NATIONAL HEALTH POLICY ........ 8
2.1. FOCUS OF THE BELGIAN SUPPORT ........................................................................................ 8 2.2. SUMMARY OF THE NATIONAL HEALTH POLICY ................................................................... 9
3. UTILISATION OF THE STRATEGIC NOTE........................................................................ 11
4. RELEVANCE OF THE PROJECTS FROM THE SECTORAL AND PARTNERSHIP POINT OF VIEW................................................................................................................................ 11
4.1. IMPACT ON THE HEALTH SYSTEM......................................................................................... 11 4.2. RELEVANCE OF THE INSTITUTIONAL PARTNERSHIP.......................................................... 12
5. EFFICACY AND RELEVANCE OF THE PROJECT WITH REGARD TO THE STRATEGIC NOTE ............................................................................................................................ 13
5.1. REFERENCE TO THE PRIMARY HEALTH CARE SERVICES DESCRIBED IN THE STRATEGIC NOTE 13 5.2. RELEVANCE OF THE RESOURCES ........................................................................................ 13 5.3. STRENGTHENING OF THE HEALTH SYSTEM........................................................................ 14 5.4. COHERENCE AND COMPLEMENTARITY................................................................................. 14 5.5. RESPONSIVENESS TO THE HEALTH NEEDS .......................................................................... 15 5.6. MULTISECTORAL APPROACH................................................................................................ 15
6. CROSS-SECTOR ISSUES ......................................................................................................... 16
6.1. SUSTAINABILITY................................................................................................................... 16 6.2. THE APPROACH TOWARDS THE FIGHT AGAINST COMMUNICABLE DISEASES .................. 17 6.3. INTERNATIONAL PARTNERSHIP........................................................................................... 17 6.4. NATIONAL PARTNERSHIP..................................................................................................... 17 6.5. PARTNERSHIP WITH THE LOCAL COMMUNITIES................................................................ 18 6.6. EQUAL CHANCES FOR WOMEN/MEN ................................................................................... 18 6.7. THE FIGHT AGAINST AIDS .................................................................................................... 18
7. DEVELOPMENT CONCERNS OF THE STRATEGIC NOTE............................................ 19
7.1. SUSTAINABLE DEVELOPMENT ............................................................................................. 19 7.2. OPERATIONAL METHODS AND STRATEGIES ....................................................................... 19 7.3. STRENGTHENING OF CAPABILITIES .................................................................................... 20 7.4. FINANCING STRATEGIES ...................................................................................................... 20 7.5. ADVOCACY ACTIONS............................................................................................................ 21 7.6. COUNTRY HEALTH ACTION PLAN........................................................................................ 21 7.7. RESEARCH ............................................................................................................................ 22
HERA / Country Report / Ecuador / Décembre 2005 Annexe 3 - 3
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
7.8. GLOBAL FUND ...................................................................................................................... 22
8. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS .................................................................... 23
9. ANNEX 1. TABLE TO FILL OUT WITH REGARD TO THE IMPACT DIAGRAM....... 25
10. ANNEX 2. LIST OF PERSONS MET.................................................................................. 35
11. ANNEX 3. LIST OF DOCUMENTS CONSULTED ........................................................... 37
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 4
Evaluation of the health sector support of the Belgian Cooperation
List of abbreviations AUS Universal Health Insurance BC Belgian Cooperation BTC Belgian Technical Cooperation CONAMU National Women Commission CONASA National Health Commission DGCD General Directorate for Development Cooperation DMQ Metropolitan District of Quito/ Strengthening of the public health services of
the Quito Metropolitan District EB PHC Ecuadorian-Belgian Primary Health Care Project FASBASE Strengthening and Expansion of Basic Health Services Project GEPADEIB Participatory management, decentralisation and environmental
development, health and tourism in the municipality of San Miguel de Ibarra
IESS Ecuadorian Institute of Social Security INECI National Institute for International Cooperation INNFA National Institute for Children and Family ISSFA Social Security Institute of the Armed Forces MODERSA Project Modernisation of Health Services MoH Ministry of Public Health PAHO Pan American Health Organisation PHC Primary Health Care PROECOS Programme for Extension of Health Service Coverage PUCE Project Development of a Master Course and Institute of Public Health at
Pontificia Catholic University of Ecuador SILOS Integrated Local Health Systems UNFPA United Nations Agency for Population UNICEF United Nations Children Fund
HERA / Country Report / Ecuador / Décembre 2005 Annexe 3 - 5
Evaluation of the health sector support of the Belgian Cooperation
Fiche synthesis Name of country Ecuador
Projects evaluated Finished : • Operational fight against goitre and endemic cretinism (finished in
1999) • Ecuadorian-Belgian Primary Health Care Project (finished in 2003) Ongoing : • Started in 1998 as « Institute of Public Health of the Pontificia
Catholic University of Ecuador (PUCE) » and then continued as Development of a Master Course and Institute of Public Health at PUCE.
• Promotion of Sexual and Reproductive Rights of Adolescents in Ecuador (Ecuador Adolescente). Started in April 2004
• Strengthening of the public health services of the Quito Metropolitan District (DMQ). The project will officially star in August 2005. The Belgian co-ordinator was appointed in July 2005, the national co-ordinator to be appointed in August 2005.
• Participatory management, decentralisation and environmental development, health and tourism in the municipality of San Miguel de Ibarra (GEPADEIB). Started in June 2005
Annual Belgian budget to support the health sector (+) for the years 2003, 2004, 2005
After the finalization of the Primary Health Care Project in 2003, more than a year went without a bilateral health project under implementation. The estimated total
Belgian Budget for the projects under implementation at the time of the evaluation is :
Bilateral projects : Ecuador Adolescente : 2.060.000 Euros Quito: 4.000.000 Euros GEPADEIB in Ibarra : 3.000.000 Euros
Non-bilateral (with Royal Tropial Institute in Amberes) : PUCE :
1998-2002 1.059.378 USD 2003-2007 1.197.000 Euros
Annual national budget for the health sector (+) for the years 2003, 2004, 2005
2003 : USD $ 385,62 millions (of these 86% actually transferred) 2004 : USD $ 386,90millions (of these 50 % actually transferred)
2005: not available Between 1997 and 2000 the percapita health expenditure declined from USD $52
to USD $262.
Name of attaché
Ronny Dynoodt
Local responsible partner
The following are the institutional counterparts for the on-going projects: • The Pontificia Catholic University of Ecuador (PUCE) • The Municipality of San Miguel de Ibarra • The Quito Metropolitan District (DMQ) • National Institute for Children and Family (Instituto Nacional del Niño y la
Familia, INNFA) and National Council of Women (Consejo Nacional de Mujeres, CONAMU)
For the two finalised projects the institutional counterpart was the Ministry of
Public Health (MoH). (+) En Euro; à spécifier par phase, si nécessaire
2 Country Profiles : Ecuador, Epidemiological Bulletin, Vol. 25 No.2, June 2004
HERA / Country Report / Ecuador / Décembre 2005 Annexe 3 - 6
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Nom des évaluateurs
Mónica Cañas Marta Medina
Date for the field evaluation
4th – 15th July 2005
Documents consulted See annex 2 Persons met See annex 3 Other sources Telephone interview with Jean Pierre Unger, former responsible for
scientific follow-up to the Primary Care Project and responsible for the project Development of a Master Course and Institute of Public Health at the Pontificia Catholic University of Ecuador (on behalf of the Royal Tropical Institute in Amberes)
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 7
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Focus of the Belgian support and the national health
policy Focus of the Belgian support In Ecuador, the Belgian co-operation is known mainly for the support provided through two projects, each one implemented throughout a decade or more. Their focus is rather different. The project Ecuadorian-Belgian Primary Health Care Project (EB PHC 1993-2003) is a full fledged support to strengthening the delivery of primary health care services with interventions at national, primary health care and community levels. The project « Operational fight against goitre and endemic cretinism » (1984-1999) started as a research project and continued as a mix of interventions geared towards the control and virtual eradication of goitre and cretinism. It implemented activities mainly at national and community level. Some of its activities can be characterised as primary health care activities, particularly health education and promotion in communities. In the past Primary Health Care (PHC) has been the main focus of the Belgian support. This focus is now changing in Ecuador. PHC components are still integrated into the new projects - the Ecuador Adolescente (started in 2004), Strengthening of public services in DMQ (initiating activities in July/August 2005) and the GEPADEIB (started in June 2005) - but not as the main focus area. The projects initiated after the closing of the EB PHC3 project (2003) and those under discussion for future support show the following trend: a) the municipal governments or other institutions and not the Ministry of Health (MoH) as
main counterpart, b) new focus area of support such as :
• strengthening municipal government towards the establishment of conditions to take over responsibility for health and other services in their respective territories,
• reproductive health rights and adolescents health, • strengthening public primary health care services so they can be contracted as
providers for health insurance schemes, • including components of access to safe water, disposal of solid waste at municipal
level, as well as prevention and control of HIV/AIDS/STI and some communicable diseases of local interest.
3 The following acronyms are used in the report to refer to the various projects : Goitre : Project Operational fight against goitre and endemic cretinism, EB PHC :Ecuadorian-Belgian Primary Health Care Project, PUCE : Development of a Master Course and Institute of Public Health at PUCE, E Adolescent : Promotion of Sexual and Reproductive Rights of Adolescents in Ecuador Quito : Strengthening of the public health services of the Quito Metropolitan District (DMQ), GEPADEIB : Participatory management, decentralisation and environmental development, health and tourism in the municipality of San Miguel de Ibarra.
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 8
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Strategic matrix for Ecuador PHC in general SR health VIH/SIDA Communicable
diseases International National EB PHC project Ecuador
Adolescente
Primary Health care systems
- EB PHC project - Strengthening of public services in DMQ - GEPADEIB4
Ecuador Adolescente5
Community EB PHC project Ecuador Adolescente
Summary of the national health policy The health sector in Ecuador comprises a number of public and private organisations among others, the Ministry of Public Health (MoH), the Ecuadorian Institute of Social Security (IESS), Farmers Social Insurance, ISSFA, ISPOL, Municipal Patronatos, Junta de Beneficencia de Guayaquil, Private sector organisations, Non-Government Organisations and providers of traditional medicine. It is estimated that 22% of the population has no coverage with health services and that another 22% has formal health insurance coverage (public or private). There is a weak coordination between these actors. The fiscal crisis at the end of the 90’s, has meant a reduction of the investment in the social sector and particularly in health. In 2001, only 2.9 % of the fiscal budget was allocated to health. The increase in poverty has meant a deterioration of the quality of life of a great sector of the population. In 2000 Ecuador went from place 72 to 91 in the worldwide scale of Human Development Index. The groups most affected are the population living in rural areas and the ethnic minorities traditionally more affected by poverty and exclusion. The country epidemiological profile shows improvement in some health indicators such as decrease in maternal and child morbidity and mortality. Easily preventable diseases are still prevalent such as diarrhoea, acute respiratory infections. At the same time it can be observed an increase in the prevalence of chronic diseases and traffic related accidents. Emerging and re-emerging diseases such as HIV/AIDS and tuberculosis are also present. The health sector faces great challenges when trying to promote reforms in the management, organisation, financing and provision of services. The aim is to improve equity, effectiveness, efficacy, efficiency, quality, access and coverage to health services. It has to compete for resources with other sectors. Not enough attention has been paid yet to recognising the potential of intersectoral action for promoting improvements in health conditions and quality of life. The Ecuadorian Constitution advocates for universal health and public health as a state responsibility.
4 The project include intervention for strengthening the delivery of primary health care services, but not as a main focus. 5 The project includes some interventions in this area, but not as a main focus.
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 9
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
The reform process and the definition of health policies The health sector reform process in Ecuador is part of the national effort to modernise the State. It began 15 years ago. José Sola describes three « moments » plus a present moment6. First moment 1992-1994 or Introducing the health reform process through the debate of the Modernisation Law approved by Congress. A bi-ministerial Commission was established (Ministries of Health and Ministry of Social Welfare) to elaborate a proposal. In this period, the World Bank supported the project Strengthening and Expansion of Basic Health Services –FASBASE- started implementation. FASBASE expected to cover 2 million inhabitants. Second moment 1994-1996, this moment was characterised by a debate over the proposal made by the National Modernisation Commission (CONAM) to privatise the pension system and to create a public/private model for Social Security System. The National Health Council (CONASA) was reactivated with the purpose to lead the the formulation, content and discussions on health sector reforms. The MoH formulated a proposal for a Law for the Unification of the health sector, which was rejected. In 1995 through a plebiscite the Ecuadorian population rejected the proposal for privatization of the IESS. Other proposals were prepared during this period such as a new proposal for reforming the social security system, a proposal for the articulation of the local, provincial and central level into local Integrated health systems (SILOS) and a proposal for Sectoral Reform and Hospital Modernisation7 Third moment, 1996-1997. The reform process did not advance, health was not a priority for the Government, the functioning of CONASA was not emphasised during this period. The participation of the MoH in the total national budget was reduced from 4,6 % in 1996 to 2,8 % in 1997. Efforts were initiated during this period to promote autonomy in the management of health services with the purpose of improving efficacy and efficiency. User fees are introduced. With a view towards decentralisation, attempts were made to transfer some hospitals to municipalities. These efforts did not succeed due to pressures from citizens and health workers unions. Present moment 1999-2004. A number of reforms are introduced in the MoH in 1999 such as the creation of decentralised health systems, cantonal health councils, social participation committees and a model for self-management of health services. In 2001, the Social Security Law introduced the separation of the various insurance schemes, provider’s autonomy, payments for production, increase in the family and special coverage. In May 2002, the First National Congress for Health and Life approved the National Policy for Health and Life, the proposal for the Organic law of the Ministry of Health (made official later that year) and the National Agenda for Health. The present Government 2002 – 2006 offered during its electoral campaign the implementation of a plan for Universal Health Insurance (Aseguramiento Universal en Salud, AUS). The then Vice-president (now president) was charged with designing the model. The model has been designed by a consortium made of CARE and John Hopkins University. Simultaneously the MoH has been promoting a plan for extension of coverage, which includes the licensing of MoH facilities and the Programme for Extension of Health Service Coverage (PROECOS) which provides the Free Health Card (intended for identification and
6 Sola, José. 2004. Una desconcentración incompleta: la reforma de la salud en el Ecuador, en: Revista Ecuador Debate No. 61. Centro Andino de Acción Popular. Quito, Ecuador. Pgs. 122-125. 7 Intended to negotiate a new credit with the World Bank.
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 10
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
affiliation of the poor population). With this card it is expected that 4,6 million people from the poorest two quintiles will be covered with health services through the MoH facilities network.
Utilisation of the strategic note The Belgian strategic note is not known by national counterparts, nor other development partners. Only one of those interviewed knew the strategic note. To some of those interviewed we presented the strategy paper together with a short Spanish summary and asked for comments. Additionally a short presentation of the content of the strategic note was made at the brainstorming meeting. The note was considered outdated. Mention was made of a world-wide meeting held to discuss and update the health policies of the General Directorate for Development Co-operation (DGCD) and the Belgian Technical Co-operation (BTC). 8The results of this meeting are probably most relevant for the present situation. Other comments were related to having a Spanish version and the need for it to be a short document. Furthermore, the note needs an up-date as new issues arise in the health development co-operation. Among others, sector wide approaches, decentralisation, public-private partnership in health, health insurance. We found no evidence of the strategic note being used in the identification or formulation of the interventions. Nevertheless, the interventions reflect in general the concepts and priorities of the strategic note, particularly primary health care. The Belgian Country Strategy paper and the country policies are the main references and guidance when deciding on the type of support to be provided to the country. It was pointed out that the reality in which the development co-operation operates in Ecuador is very dynamic and changing very rapidly, making strategy papers obsolete rather quickly. The last Country strategic note dated 2001 is somewhat obsolete in the present context.
Relevance of the projects from the sectoral and partnership point of view
Impact on the health system The projects evaluated have supported or are supporting the implementation of existing national health policies at local level, such as the primary health care policy, the policy on access to affordable, safe and quality essential drugs, the national policy on health and reproductive health rights and the decentralisation policy. In addition, nation-wide implementation the policy on iodination of salt was supported. The EB PHC project provided support for the elaboration of health plans at health area level (the basic administrative unit within the public sector). The GEPADEIB project considers the elaboration of comprehensive health plans at municipal and canton level. All projects have a strong component related to enhancing community participation, intersectoral collaboration and co-ordination among stakeholders. All projects with a component related to PHC include activities in support of strengthening of information systems and capacity building to collect and analyse data. The EB PHC project
8 It is not clear which joined meeting is being referred to.
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 11
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
implemented various alternative financing mechanism for health care provision and securing access to affordable, safe and quality essential drugs. The scope of influence of the Belgian interventions has been limited to those geographic areas where the interventions took place. Exceptions are the iodination of salt and the adoption by the MoH as norms of some of the tools elaborated by the EB PHC project (Manual on Organisation of the health areas, Monitoring and supervision Manual, Referral and counter-referral Manual). The Belgian Cooperation (BC) has concentrated its support to those public health functions related to service delivery. No support has been provided to aspect related to regulatory functions and the efficient use of resources. Relevance of the institutional partnership The projects evaluated have been able to establish favourable relationships with various institutions. In the Goitre project close ties for implementation were established with the national and provincial levels of the MoH. The EB PHC project worked closely with the local level of the MoH (health area and facility level). Efforts were made to establish links with the provincial and national levels. The unclear definition of its role within the framework of the decentralisation and the re-structuring of the MoH is a constraint for the establishment of a fruitful partnership with the provincial level. In general, the partnership with the MoH was greatly affected by the instability of personnel and the frequent change of health authorities at all levels due to political reasons. During our interviews, the need to strengthen the collaboration with the central and provincial levels of the MoH was emphasised. Local governments have also been important partners in the implementation of the Belgian projects. The national law on decentralisation provides the opportunity for local governments to take on the responsibility for health service provision. Therefore, the new trend observed in the BC of collaborating with local authorities in the establishment of the conditions for taking over this responsibility (Quito and GEPADEIB projects). The E Adolescent project is developing partnership with a variety of stakeholders: various government institutions (INNFA, Ministry of Education), civil society organisations, non-government organisations, and others. The nature of this project demands the creation of alliances with relevant stakeholders, this is a difficult task. To facilitate the development of this partnership the project is involving these stakeholders in all stages of project formulation and implementation. The establishment of partnerships with the Ministry of education has been weak.
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 12
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Efficacy and relevance of the project with regard to the
strategic note Reference to the primary health care services described in the
strategic note The activities supported by the projects reflect the priorities of the strategic note. There has been great emphasis in the strengthening the provision of primary health care services at the local level. Major emphasis has been capacity building for organisation and management of services, implementation of maternal and child health related activities (probably as a result of the overall nation-wide emphasis on these activities), health education, community participation, and access to drugs. There have been difficulties in integrating the hospital in the service provision model and it has not been possible to improve the specificity and complementarity between the primary and secondary level. Topics related to sexual and reproductive health rights, HIV/AIDS have been introduced rather recently (after 2003). Aspects related to communicable diseases have been included as part of the primary health care services and not as vertical interventions. It has been difficult to find reliable quantitative information/indicators that can show the results of the various activities supported. The Goitre project contributed to revert the endemic condition of Goitre in both the Sierra and the Central areas of the country and obtained its virtual erradication in the country. Additionally, it established a nation-wide surveillance system. The documentation revised related to the EB PHC presents qualitative information showing that the project increased the access, quality and availability of primary health care services in the areas of intervention. Those interviewed pointed out the difficulties encountered in defining and obtaining projects baseline as well as defining proper indicators. Relevance of the resources The contribution of international co-operation to financing of health sector in Ecuador represents 9% of the total financing of the sector. Other sources of financing include households (49%), State (24%), employers (13%) and National Lottery and municipal income (5%). The contribution of international co-operation amounted to USD $ 60.5 million in 1997. The greatest amount is provided through credits from the World Bank: Project Fasbase 1993-2000 (USD 70 million), Project Modersa 1999-2003 (USD $ 45 million), Project Health and Development 1998-2001 (USD $ 20 million) and Project Roll Back Malaria (USD $ 3 million)9. Those interviewed reported that the allocated projects resources were/are adequate to achieve the projects expected results. In general the equipment and other supplies acquired with projects funds are of good quality. The Government contribution to the projects is not always specified in detail and little attempts are made to monitor this contribution. Depending on the type of interventions supported, the project time-frame does not seems to be adequate for the full achievement of expected results, particularly in those projects dealing with sensitisation, changing of mind-settings, attitudes and behaviour (i.e. the E Adolescent project).
9 Country Profiles : Ecuador, Epidemiological Bulletin, Vol. 25 No.2, June 2004
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 13
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Strengthening of the health system The strategies adopted for strengthening of health systems include: strengthening the managerial and services delivery capacities at local level, capacity building of human resources, promotion of community participation in decision making (particularly monitoring and control of funds collected at the facility level) and securing access to essential drugs. Concentration on the local level was in part a strategic decision in order to follow the principle of the BC of securing access to services to the population and to avoid the complexities of dealing with a very weak central level, also as a measure to secure the achievements of the projects results. The contribution of the BC to the training of a number of professionals specialised in public health, as well as training in management and clinical skills to health personnel is highly appreciated in the country. It is said that there is public health thinking in the country that is a mix of Belgian public health thinking and Ecuadorian flavour. It is this public health thinking the one that the Institute of Public Health and the Master in Public Health Programme at PUCE are trying to disseminate. One common problem confronted by the projects has been the frequent changes of personnel, removed from their posts for a variety of reasons (including political). Often those returning back from training were not assigned to the posts in which they could make the most use of the new skills and capabilities acquired or they were transfer to other health areas. This affected greatly the possibility to consolidated processes and securing its continuity. Throughout our visit it was stressed that those places where one can see consolidation and continuity of achievements of the interventions supported by the BC are those were there has been a continuity in the human resources involved (i.e., in the health area of Azogues, considered as one of the health areas that managed to implement better the various features of the primary health care model supported by the BC). The projects have attempted to establish coordination at local level with other health care providers in the public and the private non for profit sector. Collaboration with the private sector has not been a common feature, in part because there is an overall reluctance within the public health sector to liase with the private sector. Nevertheless, a good collaboration was established in the Goitre project with the private salt industry, among others, for the establishment of laboratories of quality control in their production centres and securing the supply of the necessary material required for iodination of salt. During the brainstorming session the need to better articulate with the private sector and the ability to learn from it and apply relevant private sector experiences in the public sector was emphasised. Coherence and complementarity Important efforts have been made to co-ordinate activities of various Belgian initiatives. There are regular meetings of Belgian actors for exchange of experiences (bilateral and NGOs). The PUCE project is not sufficiently integrated with the other Belgian co-operation projects, mainly due to the fact that it is not bilateral or NGO project (i.e. PUCE does not participate in the meetings of Belgian actors). PUCE is invited by BTC to present tender proposals for certain jobs and the Embassy provided financial support for the organisation of the Public Health Jornada in 2004). Some of those interviewed manifested that a more systematic co-ordination among the Belgian actors is desirable. For example, discussions about co-ordination mechanisms,
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 14
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
complementarity and collaboration in a particular area of work could take place at the time of project formulation and not only when project activities have already initiated. The Government and particularly the leadership role of the MoH in co-ordinating health sector activities is weak. There are a number of commissions established around specific themes, for example nutrition, reproductive health, immunisation programme, etc., but there is no specific mechanism in place to facilitate a systematic overall sector co-ordination. There are not many international actors in the health sector. Among them, the United Nations Agencies such as UNFPA, UNICEF, PAHO, the Japanese, The World Bank. In the recent years the European Union has initiated support to the health sector and the BC is co-ordinating efforts with them for the support HIV/AIDS activities in the province of Esmeraldas. In most cases the complementarity is established on-site, with the local actors. The main mechanisms used for this purpose are first the identification of relevant actors and then (when relevant) invite them to form part of the local co-ordinating committee for the project, when possible efforts are made to elaborate common plans of action. This is the case for example in the E Adolescent project. The Goitre project established good coordination and collaboration with UNICEF, and there was complementarity particularly with regard to the areas of technical assistance. Efforts to incorporate the traditional health knowledge have been minimal. Responsiveness to the health needs The participatory planning mechanisms used in the projects (EB PHC, GEPADEIB, E Adolescent) are the main tool used to secure that projects activities are responsive to local needs and realities. The extent to which real empowerment of those participating in these activities is achieved was not possible to assess. In the EB PHC project the institutionalisation of health committees at various levels was the main vehicle to enhance community participation. The representativity of their members is difficult to assess. The quality of the dialog within the committees is heterogeneous. The committees receive information from health facilities and support these in the improvement of quality of services. Most committees were involved in the co-management of the funds recovered from user fees and the revolving fund for drugs. Recent legislation in the country mandates the creation of various committees with duplication of roles and functions, for example health committees, the committees to oversee the enforcement of the law for Free Maternity and Child Care. Multisectoral approach Most projects have a multi-sectoral component of some sort. The Goitre project worked in close collaboration with the salt industry and the Ministry of Education. The E Adolescent is being addressed through Ministry of Education, INNFA, CONAMU, local governments and civil society organisations. The Quito project is addressed through the local government. GEPADEIB is addressed primarily with the local government as well as with the local government departments of tourism and environment.
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 15
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
The BC is planning to integrate other sector health related issues such as water and sanitation in future projects. Other sectors (nutrition, population) get little or no attention from the Belgian support.
Cross-sector issues Sustainability The continuous changes of health authorities and health policies with each new authority10 is a constant in the work with the health sector in Ecuador. The central level of the MoH is very fragmented and disarticulated. The role and functions of the provincial level are not well defined. In spite of efforts made to deconcentrate certain functions, and decision making to the health areas, decision making is still highly centralised. The organisation and management capacity at the health area is weak. In the search for sustainability the BC has opted for working in support of implementation of policies that are likely to have continuity in spite of the political changes. Policies that will increase access to services, particularly to the poor and that will strengthen the health care system. Therefore, the focus chosen to work in support of strengthening primary care systems at the health area and facility level. PHC is a policy that has universal acceptance within the country. A more recent approach of the BC has been to work in the strengthening of local government so they can take on new competencies. Local governments are closer to the population and more receptive to their problems and needs. Those interviewed manifested that the issue of sustainability is not sufficiently addressed during project formulation and it is essential that it can be discussed this early in the project process, with the purpose of being able to introduce the necessary elements that would allow for greater sustainability of the projects, once the Belgian support is not present anymore. Those interviewed agreed that financial sustainability is difficult to obtain, due to the economic situation in the country. Efforts should be made to introduce (when possible or relevant) elements of financial sustainability, such as the interventions supported by the EB PHC project to secure access to essential drugs and the introduction of various financing mechanisms. More likely to be achieved are the technical and institutional sustainability. The technical sustainability of the BC has been threatened by the great instability of health personnel. See section 5.3. Capacity building of human resources has been the main strategy to secure technical sustainability. In the EB PHC the efforts concentrated in providing managerial skills for the organisation and management of health services at the health area level. Activities were also carried out to improve clinical skills for direct service provision. It can be said that the BC cooperation has left a critical mass with knowledge and know-how in public health in the country. This capacity is there now, working in the public and private sector. Provision of equipment has also made a contribution to technical sustainability. For example the Goitre project left behind a laboratory capacity to carry out the necessary surveillance. An un-solved problem is securing maintenance and replacement of equipment. Institutional sustainability has been more difficult to achieve. The Goitre project has had continuity as the National Iodine Deficiency Disorders Programme. The Programme
10 Deciding, without a careful analysis, not to give give continuity to previous policies
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 16
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
continues to be dependent on external financing as it does not have yet a budget line within the MoH budget. Among others UNICEF has been providing financial and technical assistance support, but this is due to terminate this year. The EB PHC project focussed on the strengthening of deconcentrated and to some extent decentralised health areas and health facilities. Its local impact was significant. The project worked alongside the central MoH and did not succeed to integrate itself into the Ministry. Where EB PHC delivered support, the MoH withdrew funds. Some of the tools produced by the project have been adopted as national norms, but the MoH has not had an active commitment to enforce their application. In the PUCE project there is technical sustainability as it has capable human resources able to run the institute and its programmes. The institutional sustainability is in principle secured by the University, but in practice it has to be secured by those working at the institute as the Institute has to cover all its expenses. The Institute is facing financial problems - as the Belgian support has been reduced- but its management is already implementing a number of strategies to secure the financial survival of the Institute. This will require an extra effort and commitment of all staff. The approach towards the fight against communicable diseases None of the projects evaluated had a focus on communicable diseases. In the EB PHC aspects related to communicable diseases were included as part of the overall primary health care services provided. International partnership This aspect of the evaluation is generally not relevant at project level. National partnership The INECI (National Institute for International Cooperation) is the principal partner when it comes to deciding on the overall direction of the development co-operation in the country. INECI is the responsible national institution for preparing the Mixed Commissions. INECI coordinates with the relevant government institutions that will be responsible for project implementation. Presently the BC has defined two priority sectors for support: rural development and health. It has also decided on a geographic concentration in the northern part of the country including the provinces of Manabi and Carchi. A cause of concern for both the BC and the government has been the long period between identification, formulation and start of implementation (two-three years). For the next Mixed Commission the Embassy, the BTC and INECI have adopted a new initiative: initiate jointly discussions on future interventions rather early and work on the elaboration of identification documents which are rather elaborated in order to reduce the time for formulation (if the intervention is approved) and actual start of implementation. Those interviewed believe that with this way of operating they can reduce the required time in one to two years. INECI has established seven “round tables” on various topics as a mechanism to enhance coordination and complementarity between development partners working in the same sector. The BC is a very active member in these round tables and is presently coordinating the economic round table. No health round table has been established yet. The need to
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 17
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
establish such a round table has been expressed to the MoH by various development partners. A health round table would greatly facilitate the coordinating and leadership role of the MoH. Partnership with the local communities The law of decentralisation and social participation was enacted in 1994. This law mandates among others the creation of a series of spaces for community participation (committees of participation). Furthermore, defines which of the central level competencies can be taken over by municipalities, if they voluntarily request to do so. For example, municipalities could take on the responsibility for health service provision, tourism, environment, education and others. The enforcement of this law has been rather slow and problematic. Among others it is a very sensitive issue, particularly because the law implies that there would be transfer of both competences and resources. The details for operationalising the mechanisms for decentralisation have not been fully work out yet. In principle the local governments should promote and coordinate multi-sectoral activities at local level. The capability to do so varies but seems to be increasing. In general there is an effort to co-ordinate health and water sector activities at the local level. The Health Committees at the level of health centre are also for coordination of health activities, but its functioning and operation is rather weak. Equal chances for women/men Gender focus and promotion of equal chances for women and men are in practical terms weakly or not included. The project formulation contemplates only in a few cases, a gender approach. There are no differentiated indicators for women/men and a proper analysis of the conditions of women and men is lacking. The capacity building activities up to now (training, elaboration of educational material) have only superficially addressed the gender aspect.. Some of the recently formulated projects address gender issues more directly. The E Adolescent project promotes having equal number of girls and boys in training sessions. There is great awareness among those interviewed on how social norms do affect differently men and women’s ability to exercise their health and sexual reproductive rights and there are plans to include those issues into the training sessions. During the formulation of the GEPADEIB project discussions were held with women groups that suggested including activities related to the prevention of intra-family violence. The project considers addressing this activity within the support to demonstrative projects for vulnerable groups. The fight against AIDS As of 2000 Ecuador had accumulated 1559 HIV + cases and 1561 cases of AIDS. These numbers are likely to be an underestimation. The epidemic seems to be on the increase, particularly in the Coast Provinces such as the Province of Esmeraldas. There are worrying indicators such as the fact that the male-female ratio has gone from 40/1 to 2/1 over the last ten years. There is a National AIDS control programme. The GFTAM funds will allow this programme to scale up activities including treatment to prevent mother to child transmission. The facilities of the MoH seem to be ill prepared to face the epidemic. The MoH has trained staff to be able to provide counselling, care and proper referral. Referral centres have been designated in Quito, Cuenca and Guayaquil. Local initiatives to co-ordinate efforts among institutions and organisations working with HIV/AIDS population can be observed at local
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 18
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
level. For example in Esmeraldas, the Red Cross has established centres for counselling and testing, some NGO are providing care and health education, at risk groups are organising themselves (commercial sex workers, gay people ), there are also organisations of people living with AIDS. HIV /AIDS has not been a focus of the Belgian co-operation in Ecuador. The E Adolescent project contemplates carrying out health education and promotion of condom use among adolescents. The future project sexually transmitted and tropical diseases in Esmeraldas will address this issue as well.
Development concerns of the strategic note Sustainable development See also section 6.1 The frequent changes of government policies and the lack of continuity of policies (between government periods or changes of Ministers of Health) do not favour sustainable development. Similarly the instability of authorities limits the implementation of the health sector strategies. The leadership and co-ordinating role of the MoH have been insufficiently supported by the Belgian co-operation. CONASA is another institution having and important role in sectoral co-ordination with whom there has been no collaboration. The need to collaborate more closely with both institutions was stressed during the brainstorming session. Ecuador does not have a poverty strategy paper. The Secretariat for the Social Front has been established with the purpose to monitor and follow up the performance of the social sectors. During our stay discussions were taking place about the creation of the Secretariat for the Millenium Development Goals, with the purpose to monitor and follow up the progress towards the achievement of these goals. The planning capabilities of the MoH are not well developed. There is no national health plan. The new health authorities are discussing the possibility to start a process that could lead to a sector wide approach in health and initial discussions are taking place within the MoH. The BC has always advocated for health as a right of the population and health as a public good. There is an increasing trend towards privatisation of health service provision in the country, faced with resistance from various constituencies in the country. There is no clear position of the Government with regard to this issue. Operational methods and strategies In the opinion of those interviewed, the introduction of the Belgian financing and administrative mechanisms is a factor that contributes to transparency and accountability. People are aware of the widespread corruption in the country and prefer that strict control mechanisms are required for the administration and management of external co-operation. The existence of an international co-ordinator and a national director is considered positive. This arrangement facilitates exchange of experiences, brings in new points of view and a different perspective and it also contributes to transparency and accountability.
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 19
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
With the purpose of securing continuity of the main cadres in the projects, an agreement has been made with the Government through which it is mandatory that the national director be selected through a process of public competition. The project management committee is responsible for the appointment. There is approximately a two to three year gap between project identification/formulation and the actual start of activities. This makes imperative the review and adjustment of the project at the time of initiating implementation, as many conditions might have change. There has been/is flexibility to make adjustment to the projects once implementation has started. Adjustments can be made at the level of activities, not at the level of objectives or results. Occasionally, it has been possible to adjust indicators as well. Making these adjustments has been facilitated since the establishment of BTC, as many decisions can be taken locally by the Management Committee of each project. As a result of these adjustments funds can be allocated to activities not previously considered or originally proposed allocations can be reviewed. The evaluation team observed that the methods and strategies applied in the different projects were sound methods of work, in line with current national and international thinking regarding health service delivery and health development cooperation. During the brainstorming session a reflection took place regarding the duration of the projects. It was pointed out that frequently the projects do not keep the perspective that they are contributing to overall development and concentrate only on achieving the project results (i.e the short term vision of development). With this in mind, then it is important to discuss at the time of formulation, how far into the development process the BC would like to collaborate and trying as much as possible that key processes are left consolidated. Strengthening of capabilities See also sections 5.3, 6.1 A more comprehensive and multisectoral approach is required to address issues related to development of human resources for health. Health staff is insufficient in number and skills, salaries are low, there is no incentive system in place and there are many labour laws and regulations that require revision. Doctors have been on strike demanding for higher salaries. The negotiations resulted in a 4-hour contract for doctors (so they can have other jobs in the private sector, open private practice, work in teaching institutions, or others). This has created a great disruption in service provision at health facilities (i.e. in some places doctors are available only at certain hours). The technical assistance provided by the BC is perceived as being of high quality and providing inputs otherwise not available. Through the years, national capacities are being built resulting in less dependency/need for international technical assistance. This was observed for example in the EB PHC. During the first phase there was more demand and need for international technical assistance than in the second phase. Financing strategies There is a strong debate in the country regarding the financing of the health sector, including public vs. private financing and provision.
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 20
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
The EB PHC provided support for testing out and implementing various alternative financing mechanisms for health service provision and availability of drugs. The establishment of mechanisms for charging user fees for episode or for specific services was implemented in some health facilities. Charges were established, discussions about charges took place with communities and committees were created to oversee for the collection and deciding on the use of funds. It was shown that the charges for disease episodes were better accepted by the users. The introduction of a family health insurance was another financing strategy supported. In the health centre in Azogues the system has been operating for 5 years. It has more than 10000 affiliates and it has been able to offer additional services, such as regular dental cleaning. The insurance can cover a variety of services because most of the costs of service provision are subsidised 96% by the government (i.e. salaries, equipment, etc) and 4% by the contribution of the affiliates. Another financing strategy supported was the provision of a seed fund for the purchasing of essential drugs. This system secures the availability of drugs which are sold to the users at cost price plus a small additional percentage to cover administration cost. The introduction of the system was accompanied by promotion of good prescribing practices, rational use of drugs and treatment protocols. Through this mechanism it has been possible to secure availability to safe, quality and affordable drugs at the facility level. These experiences have not been able to transcend the local areas in which they were implemented with support of the EB PHC project. These systems are still operating in some facilities, particularly in those were the functioning of the committees have reached a certain degree of consolidation and were the health staff remains the same. A different approach is taken in the Quito project. The DMQ has created the Metropolitan Health Corporation. The Corporation sells an insurance package and will contract out the provision of services to private and public providers. The purpose of the Quito project is to strengthen the network of public health facilities in the district (human resources skills, equipment, information systems, planning capacity, etc). in order for them to be able to become providers for the Corporation. Advocacy actions In general the BC is rather shy in publishing or disseminating the results of the support provided. The interventions supported in the health sector have been/ are relevant and addressing issues of interest to those working in the sector. The most common used mechanisms for disseminating the experiences have been through meetings or workshops, the elaboration of the local regular publication ‘Primary Health Care’. This does not give enough visibility. More efforts should be made towards having a more active role in national discussions and sharing the field experiences. Other strategies could be tried out: for example peer reviews, audiovisual methods, pamphlets, etc. Country health action plan
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 21
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
There is no specific country health action plan. As mentioned before, the Country strategy and the national policies are the guides used for deciding on the interventions to be supported. There is a regular and continuos communication and collaboration between the Attaché for the Co-operation at the Embassy and the BTC representative. Furthermore there is good communication and collaboration between the Belgian Embassy, the BTC and the INECI (responsible for the co-ordination of external development co-operation in the country). These mechanisms facilitate the analysis of complementarity between projects/initiatives of other stakeholders in the health sector. Research Most projects have a research component. In most cases the research activities supported are directed to providing answers to key problems identified during project formulation or implementation or to provide guidance on how to improve the processes supported. There is always the intention to make use of the results and recommendations emanating from the research. The Goitre project started as a research project. The results of the research activities during the first phase were used to design project intervention strategies for the next phase and to monitor their impact. Research was also carried out to provide inputs for the design of a radio education campaign on health and goitre and the elaboration of educational material directed to various audiences (local leaders, teachers, students). In the EBPHC the focus was operational research, mainly to provide guidance for the organisation and management of health services, to systematise the processes and interventions being implemented, to identify mechanisms for improving service provision. The project supported the printing and dissemination of a publication called Primary Health Care where among others the articles resulting from the research activities made within the framework of the project were publicised. The E Adolescent project is planning to train adolescent to carry out research, particularly in issues related to their perceptions, attitudes and practices related to sexual and reproductive health. The project intends also to use research activities to provide scientific information on controversial topics. The results of these research activities will support advocacy efforts. One of the key activities of the Institute of Public Health and the Master in Public Health Programme at PUCE is to carry out research and provide training in research methodologies. The focus of the master programme is on health services organisation. All students of the Programme have to carry out a research project before graduation. The research carried by the Institute aims at providing input for national policy formulation. The Institute also aims at promoting activities (i.e. scientific conferences, publications) to facilitate discussion of health policy. Last year, the Institute organised the First Public Health Jornadas, a space for exchange and dissemination of research carried out and a space for open discussion of health policies. Global Fund
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 22
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Ecuador has applied for the Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria. The first disbursement for HIV/AIDS has been made. The disbursement for Malaria has been delayed due to government bureaucracy. .
Conclusions and recommendations The following are the main conclusions of the evaluation: - The projects evaluated reflect the priorities of the strategic note. Some aspects of the
strategic note are still relevant, but the note needs to be revised in order to reflect the new dynamics within the health sector.
- The BC has contributed to improve the access and quality of primary health care services
in the health areas of intervention. - The health sector in the country is not well articulated. There is a weak leadership and
coordinating role of the MoH. The instability and discontinuity of health policies threatens the efficacy of the BC and its sustainability.
- The types of projects and interventions supported reflect the ability of the BC to adapt
and adjust to the changing policy environment. The projects supported include some vertical interventions such as the Goitre project, interventions related to strengthening the organisation and management of primary health care services, support to the processes geared toward the strengthening of local governments to take on new responsibilities for services provision, advocacy for sexual and reproductive health. The main emphasis has been on primary health care, concentrating efforts at the health area and facility level and working with local governments.
The team presents the following recommendations for consideration: - The BC should support interventions geared towards strengthening of the role of the MoH
as leader and regulator of the health sector. A proper balance between the support to national and local levels is necessary.
- Consider supporting a more integrated approach to human resources development for
health. - There is a need to promote opportunities for open discussion of national health policies
and formulation of relevant proposal for adjustment / improvement. The BC could be involved in supporting activities that will create and institutionalise these discussion fora.
- A greater visibility of the BC is necessary, sharing and exchanging experiences, making
use of innovative methods and strategies for information and communication. - Support the MoH in the establishment of mechanisms to better articulate the role and
functions of the public and private health sector. - The cooperation agreements with the country should include clauses requesting stability
of the staff. The BC should be stricter in following up and demanding that the government complies with the agreed government contributions, as stated in the financial agreement of the project.
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 23
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
- Project duration should be determined by the type of interventions and processes being supported. Development processes have a long term perspective and for projects it is generally not possible to accompany processes for that long, unless continuity of support is assured and projects are formulated with a view of the longer timeframe required for development processes. At the time of the project formulation, it is important to clarify the longer term vision for development vis-à-vis the situation at the time of project initiation and discuss how much and how long the development cooperation (or a particular project) would like to support this development. For example, how much and how long the Belgian Cooperation would intend to support Ecuador in the process of enhancing sexual and reproductive health rights. In the first project under implementation, it might be possible only to consolidate some networks and give more visibility to the issue at hand. Other issues addressed by the project will take longer, such as changing mind sets, organising and operating adequate health and education services for adolescents, etc. It is important at the time of formulating the project as one step in the development chain, to already visualise the full chain and indicate to what level the Belgian Cooperation is willing to support different elements of the chain over-time (beyond the timeframe of the particular project). Another example, if Ecuador is planning to start working on HIV/AIDS in the Esmeraldas Province, what would be the desired situation or the vision at the time of withdrawal of the support to HIV/AIDS activities in the Province?
- Consider to support the creation of a Fund for health research. Consideration should be
given to make greater use of and maximise (?) the capacities of the Institute of Public Health at PUCE.
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 24
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annex 1. Table to fill out with regard to the impact diagram
Essential functions of public
health supported Project All
Belgian Projects
Other partners
Comments
Health policies developed and translated into health strategies
Yes No - The Goitre project played a very important role in making it possible the enforcement of the national policy related to iodisation of salt for human consumption (essential element for prevention of goitre).
- The EB PHC project supported the government in the implementation of the national PHC policy as well as the introduction of a financing strategy to secure access to affordable, safe and quality essential drugs in the project’s health areas of intervention.
- The E adolescent project is one way of operationalising the national policy on health and reproductive health rights.
- The GEPADEIB project is essentially supporting the implementation of the decentralisation policy.
Institutional framework for strategic planning established
Yes No - At the health area level the EB PHC developed and used strategic health planning tools. These tools were only used in the project’s health areas of intervention.
- The GEPADEIB project contemplates activities geared towards having a comprehensive health plan at the municipal an canton levels.
Oversight and regulatory functions established
No No
Health labour market regulated and organised
No No
Pharmaceutical market regulated and organised
No No
Resource allocation improved No No Framework for efficient use of resources established
No No
Enabling environment for communicating with Parliament, civil society, stakeholders and stakeholder organisations
Yes Yes - All projects include activities related to strengthening community participation. In the EB PHC the creation of various types of committees provided space for this participation. The recently initiated projects (EA, GEPADEIB) include activities to promote a multisectoral approach to the issues addressed by the projects or the creation/strengthening of existing
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 25
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Essential functions of public health supported
Project All Belgian Projects
Other Comments partners
established networks. - The PUCE project has the potential to facilitate the creation of a new space
for wide discussion and critical analysis of the national health policies and formulation of new proposals.
Information policy and systems established
Yes No - The Bocio project supported the establishment of a surveillance system for monitoring the levels of iodine consumption within the population.
- All projects having a PHC component include activities related to strengthening existing information system at the health area and health facility level.
- The EB PHC worked in the development of a health information system for the health areas of intervention. This system was replaced later on by the national health information system.
Health financing strategies established
Yes
No - The EB PHC project tested the implementation of various alternative financing mechanisms such as the introduction of a family health insurance, user fees (for encounter, for each service), revolving fund for essential drugs.
- The Quito project will support the strengthening of public services in order for them to become health care providers for the Metropolitan Health Insurance.
Table 7
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 26
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Impact on the Essential Functions of the public
sector
Project All Belgian Projects
Comments
Health policies developed and translated into health strategies
Yes No - The EB PHC project supported the government in the implementation of the national PHC policy. Some of the products of this project were adopted by the government as national norms but not enforced nationwide. For example the Manual for the Organisation of the health areas, the Monitoring and Supervision Manual, Referral and Counter-Referral Manual. Another important health policy supported and implemented was the availability to affordable, safe and quality essential drugs.
- It is to early to say anything about the impact of the E adolescent project on the implementation of the national policy on health and reproductive health rights.
Institutional framework for strategic planning established
No No
Oversight and regulatory functions established
Yes No - A legislation regarding iodination of salt was made in 1969 in the country, but this law was never enforced. The Goitre project worked in the creation and establishment of mechanisms for its enforcement and application.
Health labour market regulated and organised
No No
Pharmaceutical market regulated and organised
No No
Resource allocation improved No No Framework for efficient resource established
No No
Enabling environment for communicating with Parliament, civil society, stakeholders and stakeholder organisations established
Yes (x) The National Health Policy, the Organic Law for the National Health System and its respective regulation, the National Health Agenda contemplate this as a key area to promote and establish in the operation and functioning of the sector. The actual functioning of these mechanisms is rather weak. The support in the Belgian projects includes the support to the creation, operation and functioning among others of those coordination and communication mechanisms established in the above mentioned documents.
Information policy and systems established
Yes No As mentioned above: establishment of a surveillance system for monitoring the levels of iodine consumption within the population.
Health financing strategies established
Yes (x) The Quito project has the potential of making it possible for the public sector to be able to be a health care provided for a Metropolitan Health Insurance Scheme working more on the principles of a private health insurance, that with the concerted efforts of various stakeholders (central government, Ministry of Public, Municipality, private sector) could eventually provide universal coverage.
Table 8
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 27
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Essential functions of the public sector: indicate whether in general
insufficiently developed / supported or not yesi / no Comments
Health policies developed and translated into health strategies (x) - The main weakness is the ability of the country to translate the policies into strategies and actions. The Belgian support has been directed to the implementation of priority health policies.
Institutional framework for strategic planning established No Insufficiently developed in the country. Oversight and regulatory functions established No Insufficiently developed in the country. In the recent years there has
been discussions of separating the regulatory/normative, financier, provider functions within the sector, but not much progress have been made. A lot of un-definition remains with regard to the rol of the Provincial level.
Health labour market regulated and organised No Insufficiently developed in the country. It is a very sensitive and political issue to deal with. In the health sector, particularly within the MoH, there is a big opposition by the labour unions to introduce changes in labour agreements. This seems to be an area not receiving much support from development partners.
Pharmaceutical market regulated and organised No Insufficiently developed in the country.
Resource allocation improved No Insufficiently developed in the country.
Framework for efficient use of resource established No Insufficiently developed in the country.
Enabling environment for communicating with Parliament, civil society, stakeholders and stakeholder organisations established
(x) See comment in table 2
Information policy and systems established (x) Insufficiently developed in the country. There are great problems related to the completeness, reliability and validity of data still persist. Weak capabilities for use and analysis of the available data.
Health financing strategies established (x) Insufficiently developed in the country.
Table 9
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 28
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Sectoral results:
main focus of support of the project
Project All Belgian Projects
Comments
Essential health services defined and provided Yes No - All projects having a PHC component focus on the provision of the essential services defined by the country. A main focus has been the provision of maternal and child health related services.
Essential health services accessible through effective public private mix No
No - Until now the Belgian cooperation has supported only the provision of health services by the public sector. Although, the Quito project is a new initiative in which provision of health services to the insured population will be done by public and private providers.
Skilled and motivated human resources in place Yes Yes - All Belgian projects have a human resources component which includes the training or continuing education of the health staff. These has provided necessary skills and contributed to motivation of the staff. In those projects where improvements were made in infrastructure, equipment, medical supplier and drugs contributed to the improvement of the working environment and indirectly to increase motivation of the staff.
Decision-making and management decentralised to the appropriate level
Yes No - The projects to be implemented with/by the municipal governments aim at strengthening the local government capacity to take over among others health service provision.
- The EB PHC project supported the strengthening of the management capacities of the health teams at the health areas in order for them to respond to on the challenges of deconcentration of some functions and appropriate decision-taken.
Incentives for performance applied No No -
Access to essential drugs and medical supplies ensured Yes No - As mentioned before, the EB PHC project supported the establishment of a revolving fund to secure the access to essential drugs.
Essential health services provided or contracted as needed No No -
Participation of parliament, civil society, stakeholders and local communities ensured
Yes Yes - All projects include activities related to strengthening community participation. Efforts have been made to cooperate/collaborate and establish alliances with other stakeholders at various levels.
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 29
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Sectoral results: Project All Belgian Comments Projects main focus of support of the project
Cultural norms and values, local priorities and patient rights are respected
Yes Yes - In all projects there has been/is an effort to respect cultural norms, values. Efforts are made to secure that local priorities are included, mainly through the participation in the local planning activities.
Clients sensitised to health behaviour issues
Yes Yes - Health education activities have been the key tool to promote sensitisation of clients to health behaviour issues.
Evidence-based information used for improving service provision
Yes (x) - In the EB PHC evidence based information was used for
improving service provision. This was facilitated by the establishment of a health information system and mechanisms for regular analysis of the information. The research results in the Goitre project led to adjustments in the strategies / activities to be supported. The curriculum of the Master in Public Health Programme at PUCE has strong emphasis in evidence-based information for decision making. It is too early to say this for the projects under implementation as they have started recently.
Health financing is efficient No No
Health financing is fair and equitable Yes No - The support to the establishment of the alternative financing mechanisms mentioned above was geared towards securing a fair and equitable health financing.
Table 4
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 30
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Weak or problematic sectoral results Yes / no Comments
Essential health services defined and provided No - To a large proportion, a great majority of the public health services
provided are of child and reproductive health nature. Presently there is a greater emphasis on these services as the MoH is strongly promoting the implementation of the law for insurance of maternity and child care ( initially a set of 55 interventions, increased then to approximately 90,related to reproductive and child health, that should be provided free to the eligible population in public health facilities). Some interventions are directed also to men. Although not called essential health services, this is certainly a set of services that the Government is committed to provide.
Essential health services accessible through effective public private mix Yes
- Public-private collaboration in Ecuador is not well developed yet and there is a lot to do in order to break existing barriers of mutual mistrust. There is rather large private sector in the health sector, and many of the medical doctors working in the public sector are involved in private medical practice. In general there is a strong opposition to privatisation of health services.
Skilled and motivated human resources in place Yes - The issue of human resources development is a matter of great concern in the country. The public health systems lacks having staff in quantities and the proper mix of skills in the health facilities. Issues of low salaries, inadequate working environment are source of de-motivation for the staff. Labour regulation, civil service legislation needs revisiting.
Decision-making and management decentralised to the appropriate level Yes - The policies and efforts towards securing/promoting/supporting a decentralised management and decision making are constrained by the difficulties and resistance to introduce changes and the inadequate definition of roles and responsibilities for each level in the decentralised system. The public health sector is still rather centralised.
Incentives for performance applied Yes - Such a system does not exist in the public health sector. It is badly needed. Those interviewed manifested it should be part of overall human resource development as well as for performance of health facilities. The Belgian projects have not addressed this issue.
Access to essential drugs and medical supplies ensured Yes - Drugs can be obtained easily without prescription over the counter. There is a weak system for quality control of the drugs
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 31
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Weak or problematic sectoral results Yes / no Comments
in the market. Prescription practices are not the best (over prescription is common)..
Essential health services provided or contracted as needed Yes /No - In Ecuador there is reluctance to contracting out services that in the perception of the population should be provided by the public sector. Contracting of services is by the public sector is perceived as a privatisation of the health services.
Participation of parliament, civil society, stakeholders and local communities ensured
Yes - The existing legislation on participation and decentralisation is not implemented in the whole country. The existing committees need to consolidate their operation and functioning.
Cultural norms and values, local priorities and patient rights are respected Yes - There is a large indian population in Ecuador, still highly marginalised.
Clients sensitised to health behaviour issues Yes - A lot more work needs to be done in this area. Issues high on the agenda are related to tobacco, alcoholism, physical activity, etc.
Evidence-based information used for improving service provision Yes - Insufficient capacity to analyse and use data for decision making. Existing health information incomplete.
Health financing is efficient Yes/No - The Belgian projects have not addressed this issue. There is a weak capacity of the MoH to use all the budget allocated funds, develop criteria for allocation of funds, securing proper financial-management.
Health financing is fair and equitable Yes - Issues of health financing need to be looked at in a more
comprehensive way. For example, it seems that now two competing approaches are being implemented/explored: the law of free maternity and child care and the AUS. Both aiming at securing access to health services to vulnerable or prioritised population groups. The complementarity, overlapping nature of both is an issue to analyse in depth.
Table 5
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 32
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Other supported sectors Project All Belgian Projects
Other Development
Partners
Comments
Population policy and strategies established No No
Nutrition policy and strategies established Yes No - The Goitre project supported the promotion of consumption of iodised salt.
Water and sanitation policy and strategies established
No No - One of the new projects under discussion includes activities related to access to water and sanitation services at municipal level.
Policies and strategies for education established
Yes No -
Environmental policy and strategies established including domestic environment , workplace and the ambient environment
(x) No - The GEPADEIB project includes activities related to the establishment of a decentralised environment management system at the municipal level. Some of the activities to be supported include: recycling of solid waste, participatory elaboration of an environmental municipal plan.
Road safety policy established No No
Enabling environment for health behaviour in place
(x) No - The E Adolescent project has the potential to sensitise a wider audience on issues of sexual and reproductive health rights.
- In great part due to the activities supported by the Goitre project the Ecuadorian population has now access to iodised salt for human consumption and is actually consuming it.
Table 6
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 33
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Other sectors linked to health which are weak or not performing
Yes / no Comments
Population policy and strategies established
The evaluation did not look into these issues
Nutrition policy and strategies established The evaluation did not look into these issues
Water and sanitation policy and strategies established The evaluation did not look into these issues
Policies and strategies for education established The evaluation did not look into these issues
Environmental policy and strategies established including domestic environment , workplace and the ambient environment
The evaluation did not look into these issues
Road safety policy established
The evaluation did not look into these issues
Enabling environment for health behaviour in place The evaluation did not look into these issues
Table 7
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 34
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annex 2. List of persons met Name Organisation Function E-mail
Ronny Dynoodt Belgian Embassy Cooperation Attaché [email protected]
Guy Castadot Belgian Technical Cooperation
Resident Representative [email protected]
Dr. Ramiro Echeverria Ministry of Health Director General for Health
Carlos Espinoza INECI Ruth Palacios Ministry of Economy and
Finances Health Sector Analyst
Nelson Estrella Ministry of Economy and Finances
Economist, Coordinator Support to Sectional Government
Dr. Paco Canelos Ministry of Health National Executive Director, National Control Programme for Iodine Deficiency Disorders
Dr. Luis Paredes Ministry of Health Técnico de Normatización del MSP
022972900
Dra. Alba Romero Ministry of Health Técnica de Normatización del MSP
022972900
Miltón Vega DMQ Director de la Corporación metropolitana de Salud
022220830 022223598
Freddy Escobar DMQ Técnico de la Corporación metropolitana de Salud
022220830 022223598
Alan Carrier Ecuador Adolescente Project Coordinator (belgian)
Miriam Moya Ecuador Adolescente Project Coordinator (local)
Dr. Marlo Perlaza INNFA Director encargado del INNFA
098125445
Dr. Nelson Zambrano INNFA Responsable de Ecuador Adolescente en Ecuador (INNFA)
Lic. Yolanda Martínez DPS Esmeraldas
Delegado al Proyecto Ecuador adolescente
Dra. Rosario Trujillo Ilustre Municipio de San Miguel de Ibarra
Directora Nacional del proyecto
099194067
Dra. Salomé Gordillo Ilustre Municipio de San Miguel de Ibarra
Técnica de Salud y medio ambiente del municipio
062950691
Dr. José Castro MSP Técnico de Servicios de Salud
022972900
Dr. Luis Abad Area de salud de Azoguez Jefe de área 07 2240192 Lic. Silvia Angulo
Area de salud de Azoguez Coordinadora de enfermería del Area
07 2240192
Dr. Manuel Flores DPS de Azoguez
Técnico de Servicios de Salud
072422329 072240087
Economista Eulalia Ávila,
Fundación de Salud comunitaria Familiar de Azoguez
Presidenta 07 2240192
Dr Edison Becera
Comité de Salud de Azoguez
Ex Presidente de Comité del Salud
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 35
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Dr. Edgar Rojas ISP Responsable de tutorías de campo (Antes director de 1 área del proyecto APS)
098013747 022232230 099828961 0229911700 Ext. 1192
Juan Vasconez UNICEF Health and Nutrition Officer
Dr. Jorge Alban CONASA Executive Director [email protected]
Dr. Victor Arauz Ortega PAHO Technician, Universal Access to health services
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 36
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annex 3. List of documents consulted
1. Plan Estratégico Operativo, Ministerio de Salud Pública, 2005-2007, 14 de mayo 2005. 2. History of Micro-Nutrients (translation) 3. Muñoz Eduardo, Canelos Paco, El Bocio y el Cretinismo Endémicos en el Ecuador,
Historia de un Proyecto, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Sección de Cooperación del Gobierno de Bélgica, Quito, Ecuador, Enero 2000.3.
4. Documento síntesis de análisis de informe de análisis del proyecto “Fortalecimiento de los servicios públicos de atención de salud en el Distrito Metropolitano de Quito”
5. Seguro Metropolitano de Salud. Manual del Usuario. Planes Fundador y Fundador Dos. Quito Corporación Metropolitana de Salud.
6. Fortalecimiento de los servicios públicos de atención de salud en el Distrito Metropolitano de Quito, DOCUMENTO DE FORMULACIÓN, Cooperación belga ecuatoriana, Febrero 2003.
7. Documento de formulación del Proyecto de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las Adolescentes en el Ecuador. Dic 2002
8. Informe de ejecución del Proyecto de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las Adolescentes en el Ecuador.
9. Informe de seguimiento y evaluación del Proyecto de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las Adolescentes en el Ecuador.
10. Documento Técnico Financiero del Proyecto de Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las Adolescentes en el Ecuador
11. Políticas nacionales de derechos sexuales y derechos reproductivos. Republica del Ecuador
12. Revista del observatorio de los derechos de la niñez y la adolescencia. Nº. 7. Junio 2005
13. Documento de Formulación de l Proyecto de Gestión participativa, descentralización y desarrollo ambiental, salud y turismo para el Municipio de San Miguel de Ibarra - GEPADEIB. 2005
14. Evaluación Final del Proyecto Ecuatoriano Belga de Atención Primaria de Salud. Feb 1993
15. Auto Evaluación Proyecto APS 1993- 2002 16. Evaluación externa del Proyecto Ecuatoriano Belga de Atención Primaria de Salud Nov
1997 17. Evaluación Expost del Proyecto Ecuatoriano Belga de Atención Primaria de Salud Post
Proyecto Dic. 2004 18. Yañez Barnuevo, Carlos, Zurita, Alfredo Gustavo, Evaluacion del Proyecto “Instituto de
Salud Pública” de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (ISP/PUCE), Informe final, Escuela Andaluza de Salud Pública, 4 de abril de 2003.
19. Country Profiles: Ecuador. Epidemiological Bulletin, Vol. 25 No. 2, June 2004. 20. Health Services Modernisation Project, MODERSA, Project Details, The World Bank. 21. El Gasto Social en Ecuador 2003-2004. Secretaría Técnica del Frente Social, Quito,
Ecuador, Mayo 2004.
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 37
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 0
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 4. Rapport Niger
HERA / Évaluation thématique/ Décembre 2005 Annexe 3 - 1
HERA HEALTH RESEARCH FOR ACTION .
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Rapport pays
NIGER
Laarstraat 43 tel. +32-3-8445930 B-2840 Reet Belgium fax. *32-3-8448221 Bank No 401-2025551-15 e-mail [email protected]
www.herabelgium.com
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Table des matières
1. FICHE SIGNALETIQUE ............................................................................................................ 6
2. FOCUS DE L’APPUI BELGE ET POLITIQUE DE SANTE NATIONALE ......................... 7
1.1. FOCUS DE L’APPUI BELGE...................................................................................................... 7 1.2. RESUME DE LA POLITIQUE NATIONALE DE SANTE............................................................... 7
2. L’UTILISATION DE LA NOTE STRATEGIQUE................................................................... 8
3. PERTINENCE DU PROJET D’UN POINT DE VUE SECTORIEL ET DU PARTENARIAT.................................................................................................................................... 9
3.1. IMPACT SUR LE SYSTEME DE SANTE ..................................................................................... 9 3.2. PERTINENCE DU PARTENARIAT INSTITUTIONNEL.............................................................. 10
4. EFFICACITE ET PERTINENCE DU PROJET PAR RAPPORT A LA NOTE STRATEGIQUE.................................................................................................................................. 11
4.1. REFERENCE AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES DECRITS DANS LA NOTE STRATEGIQUE . 11 4.1.1. UTILISATION DES INDICATEURS .................................................................................... 12 4.1.2. RESULTATS.................................................................................................................... 12 4.2. PERTINENCE DES RESSOURCES ........................................................................................... 15 4.3. RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE ........................................................................... 16 4.4. COHERENCE ET COMPLEMENTARITE ................................................................................. 16 4.5. REPONSE AUX BESOINS DE SANTE ....................................................................................... 18 4.6. IMPACT INTERSECTORIEL (POTENTIEL SUR LA SANTE) .................................................... 19
5. PREOCCUPATIONS TRANSVERSALES.............................................................................. 20
5.1. DURABILITE.......................................................................................................................... 20 5.2. L’APPROCHE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES.................................. 21 5.3. PARTENARIATS INTERNATIONAUX ..................................................................................... 21 5.4. PARTENARIATS NATIONAUX................................................................................................ 21 5.5. PARTENARIAT AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES.......................................................... 22 5.6. L’EGALITE DES CHANCES FEMMES / HOMMES ................................................................... 22 5.7. LA LUTTE CONTRE LE SIDA ................................................................................................. 22
6. PREOCCUPATIONS DE DEVELOPPEMENT ISSUES DE LA NOTE STRATEGIQUE 23
6.1. DEVELOPPEMENT DURABLE................................................................................................ 23 6.2. METHODES ET STRATEGIES OPERATIONNELLES ............................................................... 23 6.3. RENFORCEMENT DES CAPACITES ....................................................................................... 24 6.4. STRATEGIES DE FINANCEMENT........................................................................................... 24 6.5. ACTIONS DE PLAIDOYER...................................................................................................... 25 6.6. PLAN D’ACTION PAR PAYS ................................................................................................... 25 6.7. LA RECHERCHE .................................................................................................................... 26
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 3
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
6.8. FONDS GLOBAL..................................................................................................................... 26
7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ....................................................................... 26
7.1. CONCLUSIONS ...................................................................................................................... 26 7.2. RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 28
1. ANNEXE 1. TABLEAUX A REMPLIR CONCERNANT LE DIAGRAMME D’IMPACT29
2. ANNEXE 2. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES ................................................... 36
3. ANNEXE 3. LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES......................................................... 38
4. ANNEXE 4. CALENDRIER ET PROGRAMME DE LA MISSION .................................... 39
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 4
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Liste des abréviations AT Assistant Technique CHR Centre Hospitalier Régional CSI Centre de Santé Intégré CTB Coopération Technique Belge DGCD Direction Générale de la Coopération au Développement DS District Sanitaire DRSP Direction Régionale de la Santé Publique DTF Dossier Technique et Financier ECD Equipe Encadrement du District HD Hôpital de District IEC Information Education Communication IMT Institut de Médecine Tropicale (Anvers) MCD Médecin Chef de District MSP/LCE Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre les Endémies PAA Plan Annuel d’Actions PDS Plan de Développement Sanitaire RC Recouvrement des coûts SIS Système d’Information Sanitaire SG Secrétaire Général UCL Université Catholique de Louvain UE Union Européenne
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 5
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Fiche signalétique Nom du pays Niger Projets évalués
Projet d’appui au district sanitaire urbain de la Commune III de Niamey (CTB) Projet d’appui aux districts sanitaires ruraux de la région de Dosso (CTB) HIV/SIDA : Initiative Jeunes pour la santé sexuelle et Reproductive des jeunes et des Adolescents au Niger (FNUAP)
DS Urbain Commune III phase 3 : 540.800 € Budget belge d’appui
au secteur santé Dosso : 4.108.736 € HIV/SIDA/FNUAP : 185.259 US $ (années 2001 -2004) Enveloppe indicative de l’aide belge (2005 – 2009) : 11, 002 millions d’Euros
Budget national et budget partenaire financier complémentaire (années 2001 - 2004)
DS Urbain Commune III phase 3 : 116.800 € Dosso : 7 652 473 € HIV/SIDA/FNUAP (2004 – 2007) : 701 302 US $ soit contribution par partenaire Danemark : 166 145 US $ UNFPA : 349 898 US $ Gouvernement : 246 154 US $ + 15 707 US$ du Budget d’Investissement de l’Etat Enveloppe indicative par le gouvernement (2005 – 2009) : 9,078millions d’Euros
Acteur belge responsable pour le projet
Mr Théo Bart Mr Michel Lambrechts
Partenaire local responsable du projet
Mr Zouma Salifou Secrétaire Général Ministère de la santé Publique Mme Marlène Lays, Représentante UNFPA
Vincent Litt Nom des évaluateurs M. M. Matamba 29 juin – 9 juillet 2005 Date de l’évaluation de
terrain
(voir annexe 2) Personnes interviewées
(voir annexe 3) Documents consultés
Calendrier et programme de la mission
(voir annexe 4)
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 6
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
2. Focus de l’appui belge et politique de santé nationale
Focus de l’appui belge Les projets CTB (Dosso et Commune III) visent dans une approche « district sanitaire » le développement et le renforcement technique & institutionnel d’un district sanitaire urbain (102.000 habitants), dans la ville de Niamey et de 5 districts sanitaires ruraux dans la région de Dosso (superficie 31 000 km2, soit 2% du territoire national avec une population estimée à 1.500.000 habitants). Le développement de districts sanitaires dans la région de Dosso est articulé après la ré écriture du DTF initial sur l’offre d’un plateau technique complémentaire au niveau du CHR, en respect de la pyramide structurelle et opérationnelle des soins de santé primaires (SSP). Le projet FNUAP s’est focalisé sur la santé des jeunes et des adolescents en privilégiant la disponibilité des services de santé de la reproduction de qualité intégrant l’approche genre améliorée dans trois zones d’intervention (Niamey, Régions d’Agadez et de Dosso) et ciblé sur les jeunes et les adolescents de deux sexes. L’intervention cherche à promouvoir : • Environnement socio -culturel favorable à l’utilisation des services de santé de la
reproduction amélioré • Services et mécanismes pour la santé sexuelle et reproductive de qualité pour les jeunes
renforcés • Disponibilité des préservatifs dans et en dehors des structures de santé accrue • Sensibilisation des groupes vulnérables et à haut risque renforcée • Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) renforcée. Les foci prépondérant des projets belges au Niger dans le secteur de la santé peuvent être résumés comme suit : SSP en général SS reproductive VIH/SIDA Maladies
transmissibles International National Système de soins SSP
XXX X X
Communauté X X X Ainsi l’accent de l’appui belge porte sur l’amélioration de la couverture sanitaire et l’offre d’un paquet des activités de santé minimal et complémentaire avec la participation de la population au niveau financier et dans une moindre mesure au niveau de la gestion. La santé de la reproduction est prise en compte ainsi que de manière ciblée assez originale la problématique des infections VIH chez les jeunes. Résumé de la politique nationale de santé Au moment de la formulation du programme d'"Appui à la Mise en Œuvre du PDS" (septembre 2004), les préoccupations principales portent sur le malade, la croissance démographique, la santé de la mère et de l’enfant (santé de la reproduction) et ont été définies de la manière suivante : 1. « Faire fonctionner l’existant » : rendre plus efficace et plus efficient les structures et
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 7
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
services sanitaires existants (incluant la maintenance). En d’autre terme « réorganiser le système sanitaire » pour une meilleure efficience. 2. Valoriser les potentialités, capitaliser les acquis, positifs et réussis, et tirer parti des leçons du passé, quelles soient positives ou négatives. 3. Gérer efficacement les Ressources Humaines. Développer une « culture d’organisation des ressources humaines». Les ressources humaines (tant qualitatives que quantitatives) constituent le facteur limitant majeur de l’amélioration de la santé au Niger. 4. Définir de manière explicite les dispositifs pouvant garantir la réussite de la décentralisation/déconcentration afin de rapprocher les ressources humaines et financières de la population. Les lois existent, il faut les appliquer tant au niveau central qu’au niveau régional (qui a aussi des obligations). En d’autre terme comment passer de la théorie à la pratique. 5. Redonner au MSP/LCE son rôle de centre d’impulsion de la Politique Sanitaire tout en rendant aux acteurs de santé leur rôle de mise en oeuvre de la politique sanitaire. Préciser la place du MSP/LCE dans la coordination inter- sectorielle, et son rôle dans les grands programmes ayant la santé comme finalité. 6. Assurer une meilleure coordination des bailleurs et de tous les intervenants (O. N. G, privé,..) dans le domaine de la santé. Intégration et participation des programmes à la Politique Sanitaire définie dans le PDS. 7. Développer des mécanismes de pérennisation des actions entreprises à moyen terme (5 ans) et à long terme (15 ans).
L’utilisation de la note stratégique La note stratégique telle que formulée par la DGCD n’est pas formellement connue au niveau des projets même si à titre individuel les attachés de coopération la connaissent. Pour ceux qui la connaissent, la NS est plutôt un document de politique, assez consensuel et peu discutable. Par contre elle est très peu « stratégique », elle ne décrit pas les modalités de mise en œuvre des actions de santé ni comment conduire un projet en regard de l’expérience de la Belgique depuis de nombreuses années dans un nombre important de situations et de pays. A titre d’exemple l’opérationnalisation de l’approche «district de santé » a nécessité une ré-écriture du projet d’Appui à la Région Sanitaire de Dosso afin d’inclure à posteriori le niveau de référence régionale (CHR). Aussi l’absence d’un paquet complet d’activités complémentaires de santé (urgences médico – chirurgicales) au niveau de la Commune III, ne tient pas compte des recommandations de la NS. On peut concevoir que ce DS s’intègre dans les prises en charge médico-chirurgicales de la ville, mais cet aspect ne fait pas l’objet d’une réflexion structurée avec les instances de coordination de la santé urbaine. En fait, c’est plutôt l’expérience de terrain qui a influencé le contenu de la note stratégique’, référence est faite ici par rapport à l’engagement de la coopération médicale belge au Niger depuis 1973 notamment dans le Département de Dosso où l’intervention avait été progressivement transformée pour devenir un appui au développement des soins de santé intégrés basés sur le concept de district, y inclus la participation communautaire et le recouvrement des coûts. Au niveau central, les appuis à la formation et au MSP ont débuté en 1977 (voir historique de la coopération belge au Niger page 11 dans DTF CTB Appui aux DS de Dosso : Nouvelle intervention 1999 – 2003)
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 8
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Le projet de l’UNFPA intègre bien la problématique de la santé des jeunes, évoquée dans la note stratégique. Les PTF ne sont pas informés de l’existence de la NS malgré le rôle prépondérant joué par la Belgique comme chef de file de la coordination des intervenants extérieurs. Les autres notes stratégiques (HIV/SIDA et Genre) sont également méconnues auprès des acteurs et de partenaires belges en santé au Niger.
Pertinence du projet d’un point de vue sectoriel et du partenariat
Impact sur le système de santé En matière de couverture sanitaire, l’impact est indéniable à travers l’expérience belge dans le pays. Le Projet Dosso peut être considéré comme projet pilote particulièrement en ce qui concerne l’intégration d’une structure de référence et l’implication de l’équipe de la Direction régionale dans la gestion des activités de santé. Le fonds social pour la prise en charge des indigents, l’organisation du système d’évacuation motorisé des malades ainsi que l’établissement d’une pharmacie de cession sont également des aspects innovateurs de ce projet dans le contexte du Niger. L’expérience pourra servir de modèle aussi bien pour le Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre les Endémies ainsi que pour les autres partenaires intervenant dans le secteur de la santé. En effet, ces actions ont eu pour résultat de diminuer sensiblement les références hors de la Région de Dosso pour les soins de deuxième niveau, comme les urgences obstétrico – chirurgicales. Le projet d’appui au district de la Commune III de Niamey a un impact visible dans la mesure où il a aidé à désenclaver la zone située sur l’autre rive du Niger grâce à la délivrance de services localement. On peut considérer qu’il a un impact national indirect par l’utilisation des structures comme lieux de stages pour les étudiants de la Faculté de médecine. Quant au projet de l’UNFPA, la contribution belge complémentaire à celle des autres partenaires financiers participe à la couverture en matière de sensibilisation, éducation et information aussi bien dans la problématique HIV/SIDA qu’en santé de la reproduction pour les jeunes. L’aspect culturel en faveur de promouvoir le changement de comportement vis-à-vis des mariages de très jeunes filles est un apport intéressant dans la perspective d’induire un changement de comportement vis-à-vis de la dignité de la femme. Les Actions de l’année 2004 sont articulées de la manière suivante :
- Mise en place de services Amis des Jeunes - Introduction d’un module sur la santé sexuelle et reproductive pour les jeunes dans
les curricula para- médicaux. - Production de supports IEC/CCC de Santé Sexuelle et Reproductive des
Adolescents et genre adaptés et de qualité pour les Centre de Santé Intégrés, Maison des Jeunes et de la Culture, fads ( groupes traditionnels de jeunes), ONG’s et Associations de jeunes
- Utilisation de la stratégie d’éducation par les pairs - Renforcement des activités de sensibilisation et de plaidoyer pour la réduction des
barrières limitant l’accès aux services de la SR et pour l’adoption de mesures de prévention du VIH/SIDA, de protection et de prise en charge des PVVIH (création d’un « numéro vert », appui à des centres de dépistage volontaire)
- Promotion de l’utilisation des préservatifs (installation de distributeurs – 50 F cfa / 3)
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 9
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Sans compter un impact législatif, de communication et d’information, sur la base d’un travail qui vise un environnement socioculturel favorable à l’utilisation des services de santé de la reproduction (focus jeunes). L’organisation et la participation à la formation des chirurgiens de district en cours avec l’aide belge au niveau de l’Hôpital national de Niamey est une contribution essentielle et remarquée. La participation des acteurs belges du projet à l’élaboration du Plan de Développement Sanitaire (PDS) peut être considérée comme un investissement politique à long terme. La contribution belge au PDS – et donc l’impact le plus important - a concerné l’approche district utilisée dans les projets belges conformément à la Politique de Développement national avec comme finalité l’extension de la couverture géographique des soins de santé primaires dans l’espace et le temps. Le cadre institutionnel de planification défini dans le PDS utilise ce modèle pour l’établissement de plans de travail des districts de santé qui constituent les éléments de base pour l’établissement de plan au niveau départemental. Le PDS est un cadre stratégique qui a permis la mise en place des outils et d’un système d’information sanitaire effective et ,une stratégie de financement (recouvrement des coûts) qui a fait l’objet de décrets ministériels fixant les prix des actes de soins. Grâce au PDS, accepté par tous les PTF, la constitution d’un panier commun de ressources pour le développement harmonieux des districts de santé est en cours. Pertinence du partenariat institutionnel La CB directe est engagée dans le secteur santé dans un rapport institutionnel limité à première vue avec le seul MSP/LCE même si la tendance suivant la politique de décentralisation administrative l’amène déjà à s’ouvrir à d’autres acteurs. La démonstration en a été donnée au cours des journées belgo nigériennes de Dosso (4 – 6 juillet) qui ont ouvert une réflexion sur l’approche holistique de développement dans un contexte de décentralisation effective. Les hypothèses et les risques liés à ce partenariat unique avec le MSP / LCE sont bien exprimés dans le DTF des projets CTB, mais plus à titre de constat. C’est un partenariat classique de projet de santé qui concerne le développement des services publics. Ce partenariat est fort centralisé, ne prend pas encore suffisamment en compte la Direction Régionale de la Santé au niveau de Niamey par exemple, mais les choses vont changer avec le nouveau programme. Le projet FNUAP est un modèle de partenariat institutionnel faisant intervenir plusieurs organes :
- Ministère des Sports, de la Culture et des jeux de la Francophonie - Ministère de la Santé publique et de la Lutte contre les Endémies - Ministère de la Communication - Ministère du Développement Social, de la Population, de la Promotion de la Femme,
de la protection de l’Enfant - Ministère de l’Education de Base et de l’Alphabétisation - Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur, de la Recherche et de la
Technologie Soit une équipe technique multidisciplinaire au niveau central, des comités régionaux et sous-régionaux et enfin des structures et organisations locales des jeunes.
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 10
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Le partenariat que la Belgique a développé avec la MSP / LCE depuis de longues années a permis à celle-ci, en tant que chef de file, d’apporter beaucoup à la coordination de l’action des partenaires intervenant dans le secteur santé. La finalisation du plan de développement sanitaire a été rendue possible depuis la désignation (2003) de la Belgique comme chef de file. Plusieurs versions du PDS avaient été proposées auparavant sans qu’un consensus ne soit réuni auprès des PTF. La Belgique a non seulement participé au financement du PDS mais a également mis à contribution des institutions belges pour rendre le PDS plus opérationnel en en définissant les stratégies opérationnelles. Outre les partenariats évoqués, il n’y a pas d’autres dispositifs mis en œuvre ou spécifiquement programmés (nouveau programme d’appui au PDS) avec le secteur privé ou les associations professionnelles. Par ailleurs, ces partenariats font l’objet de préoccupations de la part du MSP / LCE et des actions sont programmées dans le PDS. La latitude existe donc pour la CB de participer à la création progressive et à la formalisation de ces nouveaux partenariats.
Efficacité et pertinence du projet par rapport à la note stratégique
Référence aux soins de santé primaires décrits dans la note
stratégique La politique nationale sectorielle de santé (adoptée en 1995) repose sur une politique sanitaire essentiellement basée sur le développement du district sanitaire, unité opérationnelle gérée par une équipe cadre de district, et composée d’un réseau de cases de santé, de centres de santé intégrés et d’un hôpital de district. Il est rappelé dans le DTF CTB Appui aux DS de Dosso : « Nouvelle intervention (1999 – 2003) » page 11 que le dernier projet ABECIP (1995 – 1998) venait en appui aux districts de (i) Gaya et Dogondoutchi pour les rendre opérationnels, (ii) à la DDS de Dosso essentiellement dans ses activités de supervision et de coordination, (iii) au service de chirurgie du CHD Dosso pour la formation en chirurgie de base et (iv) au MSP dans des activités d’amélioration de la santé dans le Département. Les stratégies pour atteindre ces objectifs ont été définies dans le programme de développement sanitaire (1994 – 2000) comme suit :
- la mise en place des zones ou districts sanitaires opérationnels ; - la formation du personnel adaptée aux besoins réels ; - la mise en place des structures de participation et de prise en charge des soins de
santé de population cible ; - la mise en place d’une structure juridique du district ; - la focalisation des activités et des programmes vers les problèmes médicaux
prioritaires ; - la coordination et l’intégration des programmes médicaux dans le cadre d’une
stratégie multidisciplinaire de développement intégral du district.
Ces orientations ont été confirmées dans la dernière déclaration de politique du MSP/LCE en mai 2002. Les projets de la CB au Niger reflètent donc bien l’esprit de la note stratégique.
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 11
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
En terme d’efficacité, on peut affirmer que l’accessibilité géographique existe au niveau des projets financés par la Belgique. Les autres critères d’appréciation de l’offre des soins sont discutés dans les paragraphes ci après. Utilisation des indicateurs Tous les projets CB ont défini une batterie d’indicateurs et d’outils de suivi des activités menées au niveau de chaque projet en accord avec le Système Nationale d’Information Sanitaire. Ceux-ci sont utilisés dans les cadres logiques, de manière assez similaire dans les projets (Dosso et Commune III) alors que les contextes sont différents. Les indicateurs sont focalisés sur l’impact par rapport à une situation de départ bien connue et renseignée étant donné la présence de la coopération belge particulièrement dans le département de Dosso. L’aspect genre n’est pas mentionné de manière spécifique. La préoccupation de la réduction de la pauvreté comme un axe du développement durable ne ressort pas de manière formelle dans les indicateurs utilisés dans les DTF. Un arrêté ministériel 11 a précisé les tarifs minima et maxima des prestations fournies dans les CSI, selon un système de paiement direct. Il est précisé que les dépenses acceptées sont (i) les achats de médicaments et consommables, (ii) les achats des outils de gestion et (iii) le paiement des salaires des gestionnaires. Au niveau de toutes les formations sanitaires de la région de Dosso, est appliqué le système de la caisse unique, destinée à recevoir les recettes du recouvrement des coûts de l’HD et de tous les CSI du District Sanitaire. La mise à jour et/ou la construction des nouveaux indicateurs et autres outils profite des missions (3) de suivi scientifique conjointement menés par l’IMT et l’École de santé publique de l’UCL. . Dans les documents consultés au niveau du projet HIV/SIDA/FNUAP (folders, matériel didactique et rapport 2004 du projet), les indicateurs ont trait aux connaissances et pratiques des jeunes. Cependant, pour cette thématique, il n’existe pas d’indicateurs spécifiquement construits dans le Système National d’Information sanitaire (PDS p 64).
Résultats Données statistiques (2004) de DS Urbain Commune III Indicateurs du rapport épidémiologique 2004 réalisé par l’équipe- cadre du district :
- Habitants < 5 km d’une structure de santé : 92% - Taux d’utilisation des Centres de santé : 0,2 NC/habitant - 1 médecin / 34.000 habitants - 1 infirmier / 3.000 habitants - 1 sage-femme / 1'120 femmes en âge de maternité - Dépistage TBC : 34% des malades attendus (soit 1°/°° de la population totale) - Taux d’admission des malades à l’hôpital : 1,34 % (avec incertitude sur l’origine
exclusive des patients du district). - Décès à l’hôpital : 1% - Journées d’hospitalisation : 4.305 - Durée moyenne de séjour : 4 jours - Taux d’occupation des lits (50) : 47% - Accouchements assistés à l’hôpital : 2.920 - Accouchements assistés à domicile : 138 - Taux de couverture en accouchements assistés : 55%
11 Arrêté n° 25/MSP/MF/RE/P du 4 février 1999, portant fixation des tarifs minima et maxima des prestations de soins du CSI.
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 12
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
- Décès maternels (enregistrées dans les formations sanitaires) : 0 - Taux de couverture CPN : 78% - Taux de grossesses protégées ( ?) : 66 % - Taux de couverture consultations nourrissons sains : 54% - Taux de dépistage de la malnutrition protéïno- énergétique : 32% - Taux de guérison MPE : 14% - Taux d’acceptantes PF : 11% - Couverture BCG : 84% - Couverture DTC3 : 70% - Couverture vaccin rougeole : 78%
En 2003, 20 interventions chirurgicales par semaine, 3,000 accouchements et 6,000 consultations.
Tableau - Principaux indicateurs de couverture sanitaire dans la Région sanitaire de Dosso en 2003. Comparaison inter-régionale (2003)
Source : SPIS de la DRSP.
Indicateur Boboye Dosso Doutchi Gaya Loga Nouveaux consultants pour 100 habitants 27 19 21 25 23 Nouveaux inscrits à la consultation des nourrissons par rapport à la population cible
? 42 % 57 % 55 % 66 %
Nouvelles inscrites à la consultation prénatale par rapport à la population cible
? 43 % 48 % 73 % 70 %
Taux de couverture de la 3e dose de vaccin diphtérie – tétanos – coqueluche – polio chez les enfants de 0 à 11 mois
54 % 50 % 64 % 58 % 61 %
Taux de couverture du vaccin rougeole chez les enfants de 0 à 11 mois
46 % 65 % 64 % 73 % 52 %
En ce qui concerne la chirurgie dans les districts, les activités dans les blocs opératoires ont été en régression constante à Doutchi et à Gaya de 2000 à 2002, faute de présence sur place de médecin sachant opérer et acceptant d’un prendre les risques en situation isolée. On a enregistré la disparition de la pratique de la césarienne à Loga en 2001 et à Gaya en 2002. Les autres interventions étaient effectuées soit par du personnel auxiliaire (hernies, etc.), soit par le chirurgien de la Commune III lors de ses tournées mensuelles. La présence d’un gynécologue du FNUAP à Loga a commencé à renverser la tendance en 2002. En ce qui concerne le CHR, on a noté l’absence de tout chirurgien de décembre 2001 à avril 2002 inclus. Par la suite, l’activité chirurgicale a dépendu de la présence d’un gynécologue et d’un chirurgien cubains ou libyens. Cette coopération Sud-Sud n’est pas organisée de manière optimale : on passe plusieurs fois de la pénurie à la surabondance de médecins. Les deux situations sont néfastes pour l’organisation du travail. Une étude de vérification de la validité des indicateurs depuis 2000 a été entamée en 2003 avec le Service de programmation et d’information sanitaire (SPIS) de la Région sanitaire de Dosso. Il s’avère qu’il est impossible de garantir pleinement la fiabilité des données recueillies. Une part du problème tient aux déficiences inhérentes au SNIS, soit dans sa conception, soit dans le logiciel qui le sous-tend. L’autre part du problème tient à la fiabilité et à la complétude des données qui transitent depuis les Centres de santé jusqu’à la Région sanitaire, en passant par les districts pour compilation. Trop peu d’attention est accordée à l’échelon des districts à la valeur des données transmises au niveau régional, qui se trouve alors, le plus souvent, dans l’impossibilité de corriger les données brutes ou de compléter les
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 13
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
données manquantes (CTB Rapport d’exécution année 2004, janvier – mi novembre , page 26). Néanmoins la qualité des soins semble faible ce qui expliquerait en partie le faible taux d’utilisation des services toutes activités confondues. La visite de terrain effectuée dans le district urbain Commune III a montré un CSI (Gawayé) qui fonctionne correctement aussi bien au niveau des activités curatives que préventives y compris le suivi de chemin de croissance des enfants ainsi que la prise en charge de traitement DOTS des malades souffrant de tuberculose. Par contre le CSI (Sagiya), magré la présence des ressources matérielles et structurelles normales fonctionne à vide. Rapport d’activités projet HIV/SIDA FNUAP Appui à la stratégie générale des SSP, avec l’intégration des activités dans les centres de santé, les écoles paramédicales. Nous ne sommes pas en possession de rapports quantitatifs détaillés sur l’utilisation des services par les jeunes (existent probablement par ailleurs). Données obtenues lors de notre visite à la Maison des jeunes de Boukoki (centre de référence) : 10 à 12 jeunes par jour pour le counseling et la consultation chez la sage-femme. La fréquentation du centre est réelle d’autant qu’une gamme d’activités passant par les activités sportives avec compétitions, l’apprentissage de la couture pour les jeunes filles, la sensibilisation par la projection de films vidéo suivi de discussion de groupes. D’après les responsables du programme, les besoins pris en considération ont été définis par les adolescents et les jeunes eux-mêmes. Conclusion En conclusion, il n’est pas aisé de déterminer si les résultats des services de santé appuyés par la CB sont plus ou moins performants que d’autres. Certains documents-clés consultés (DTF du nouveau programme d’appui au PDS, évaluation du projet Dosso de juillet 2003) ne comportent pas le « traditionnel» chapitre sur les synergies et les complémentarités entre acteurs du système de santé ; difficile donc de comparer. Le PDS lui-même mentionne que les interventions sont multiples et variées et que chaque PTF développe les choses selon ses propres habitudes et sensibilités. D’où la coordination qui sous-tend le PDS et qui montre ses effets pour sa préparation. Dans l’ensemble du pays, les structures de santé ont des performances faibles. Dans le projet de Dosso, on le remarque également mais vu les énergies consenties pour appuyer les formations, la logistique et les approvisionnements de base, on peut penser que ces efforts sont essentiellement dirigés vers « le maintien de l’existant ». Par ailleurs, pour « situer » le niveau relatif de développement de chacun des différents DS de Dosso, il aurait fallu disposer au départ du projet d’un réel diagnostic de situation, selon des critères définis par le pays ou à défaut par le projet lui-même. Cette manière de procéder n’a, apparemment, pas été celle retenue, ni par les concepteurs du DTF en 1998, ni par les acteurs en charge du document de réécriture du projet (phrase extraite du rapport d’évaluation du projet de Dosso de juillet 2003). Par contre, la CB a pu obtenir des résultats au niveau du projet d’appui au district sanitaire de la Commune III de Niamey, et les résultas se maintiennent actuellement, au début de la phase d’autonomie. En ce qui concerne la région de Dosso, les résultats ont été en « dent de scie », modulés par les facteurs positifs liés aux équipes nationales et des AT, puis à leur départ. Le projet de
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 14
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Dosso est souvent questionné quant à son efficacité et les raisons le plus souvent exprimées sont liées au cadre institutionnel, en particulier en ce qui concerne les personnels de santé et les cadres. Ces constats sont à la base de l’appui institutionnel que donnera le nouveau programme. On peut voir au travers de cet historique de coopération dans une région, combien l’appui aux politiques et aux stratégies nationales est important, pour l’ensemble des partenaires. Nous n’avons pas pu reconstituer les raisons pour lesquelles ce type d’appui est resté faible, notamment du point de vue des capacités institutionnelles pour travailler sur les stratégies, le suivi et l’innovation. Pertinence des ressources Les ressources matérielles, structurelles et financières ont été mobilisées conformément à la politique sanitaire. Dans les DTF les calculs des moyens nécessaires ont été faits en fonction des résultats et activités. Les coûts unitaires sont mentionnés. Certaines ressources en matériel médical se sont révélées peu robustes (spectrophotomètre et appareil RX sujets à des pannes graves). Les ressources dans le projet HIV/SIDA ont été utilisées pour :
- L’Appui aux écoles de formation paramédicales - Etudes (faisabilité de la distribution des préservatifs, évaluation des supports
éducatifs existants, textes juridiques) - Site web et stratégie de communication - Production de matériel didactique - Participation à des évènements nationaux - Formation (pairs et personnels de santé) - Appui à la création de services de santé « amis des jeunes » - Distributeurs automatiques de préservatifs - Prévention SIDA (université, prison, travailleuses du sexe) - Centre de dépistage volontaire - Ligne téléphonique verte
Des lenteurs de procédures et des retards de démarrage ont été relevées, mais pas il n’y a pas eu de critiques majeures concernant la pertinence des ressources. A Dosso, il y a eu des problèmes liés à l’assistance technique, conflits de personnes (ce qui peut arriver) et inadéquation entre le profil d’assistant technique égyptien (par ailleurs excellents lorsqu’ils ont été affectés au niveau central).
Mais au delà de ces questions, il y en a une, plus grave, qui concerne la partie nigérienne des ressources. En effet, les crédits délégués de l’Etat à la région de Dosso sont passés de 275 millions de FCFA en 2002 à 28 millions en 2004 (hors personnel et paiement de l’eau et de l’électricité), l’explication sommaire reçue est la crise financière traversée par l’Etat. Mais il est certain que dans ces conditions les ressources des projets – consacrées en principe et en majorité – à des activités de développement, ne peuvent qu’être, d’une manière ou d’une autre consacrées au fonctionnement courant.
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 15
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Renforcement du système de santé L’approche projet, axée sur le développement du district sanitaire avec la participation communautaire, est en concordance avec la politique de santé du pays. Cette approche renforce structurellement le système localement, mais de manière précaire vu les problèmes que décrit le PDS (insuffisance de ressources de fonctionnement, mobilité des cadres et des personnels paramédicaux, …). Dans la Commune III de Niamey, le projet de la CB a permis un désenclavement de cette commune située sur la rive droite du Niger. Nous avons souligné plus haut le rôle pilote que joue Dosso dans la structuration et l’opérationnalisation de district sanitaire avec l’appui de suivi scientifique régulier externe. Cependant le « Projet Santé Dosso » vérifie le fait bien connu qu’il ne suffit pas d’augmenter l’investissement ou de garantir la fourniture des intrants pour voir changer de manière pérenne les performances d’un système de santé. C’est l’organisation et le fonctionnement qui doivent changer, ce qui prend beaucoup plus de temps, exige l’engagement (motivation professionnelle) du personnel, sa présence suffisante au poste de travail, la sanction des écarts, et le suivi régulier par les équipes cadre des districts. Au niveau du DS urbain Commune III, le projet renforce le système de santé par l’exemple qu’il donne (les AT du projet s’en sont servi pour contribuer à l’élaboration du PDS) et les stages qui y sont organisés (non dénombré mais probablement peu car les lieux sont assez exigus, l’hôpital ne fait que 50 lits). Par sa taille, son organisation et son fonctionnement simples le DS urbain Commune III est bien parti sur une durabilité dans le temps. D’un point de vue général, le renforcement du système de santé et le renforcement des capacités ne sont pas formalisés comme tel (ce serait plutôt un effet induit), « puisque » les projets sont orientés vers les soins à la population et par là, vers le système de santé. Dans les points faibles, on note que le profil de formation ne semble pas toujours équilibré dans la mesure où la formation des médecins de santé publique est privilégiée par rapport à la formation d’autres spécialistes et la formation clinique continue. La santé reproductive et la lutte contre les infections HIV/SIDA du programme FNUAP promeut le renforcement par l’introduction de démarches globales de santé de la reproduction pour les jeunes (accueil, counseling, non-discrimination et contenus techniques) dans les centres de santé. Exemples probablement très positifs d’approches fines et empathiques, mais qui ne sont pas encore connus/promus par les structures du système de santé formel. Cohérence et complémentarité La dynamique instaurée par la Belgique comme chef de file va dans le sens d’une meilleure cohérence des interventions dans un futur proche pour différents partenaires du secteur santé. La plupart des partenaires appuient la mise en place de districts opérationnels dans le pays. Il s’agit notamment de la coopération allemande et du projet santé appuyé par la Banque Mondiale. Il existe une collaboration et participation des médecins brésiliens au niveau de district sanitaire et CHR de Dosso.
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 16
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
La CB, par des approches innovatrices au Niger, a proposé des appuis visant la cohérence des stratégies sanitaires tel qu’en proposant, en parallèle avec le développement des hôpitaux de district, de renforcer le CHR de Dosso. Il ressort de l’évaluation à mi-parcours des DS de Dosso (Juillet 2003, pp 6-7) que l’obtention et la pérennisation des trois résultats attendus du projet (prise en compte de la demande, accessibilité des soins, qualité des soins) dépendent beaucoup d’éléments insuffisamment pris en compte par le DTF de 1998, à savoir : • l’appropriation de la dynamique de l’intervention par les acteurs : en adoptant une approche programme au lieu d’une approche projet en adoptant la technique de l’appui budgétaire décentralisé en prônant le principe de la cogestion intégrale de l’intervention • la prise en compte de la « contrainte » représentée par le fait que les districts sanitaires
ne sont pas encore actuellement suffisamment fonctionnels, étant donné : une décentralisation du pouvoir et des moyens très incomplète
un personnel inadéquat en nombre et en qualification, avec des motivations (pécuniaires et autres) insuffisantes
• l’absence de véritable leadership intégré au niveau de l’équipe cadre et de réelles activités de supervision formatrice de la part de cette dernière
• différents investissements (infrastructures et équipements) encore nécessaires et l’assurance d’un minimum de moyens de fonctionnement
• de capacités de gestion insuffisamment développées au regard de l’autonomie attendue des DS
• la prise en compte du système régional comme un tout, impliquant de facto l’intégration du CHR dans le cadre de l’intervention
Mais les projets CTB ne partagent pas nécessairement entre eux les bonnes expériences comme l’apport en matière de formation de chirurgiens de district qui aurait l’avantage si bien harmonisée avec l’apport belge au niveau du département de chirurgie de l’ Hôpital National de Niamey de combler le problème de carences de spécialistes en chirurgie dans les districts. Il n’y a aucune cohérence et complémentarité avec les autres intervenants au niveau de la couverture sanitaire de la ville or que la Commune III, qui est un district sanitaire excentré par rapport au centre-ville (situé de l’autre côté du pont qui enjambe le fleuve Niger), en aurait besoin pour ses références (secondaires partielles et tertiaires). Dans la phase actuelle (2005), les projets sont devenus un volet d’un programme global d’appui au Plan de Développement Sanitaire national et s’intègrent aussi dans un appui aux Directions régionales de la Santé. L’approche devrait améliorer les choses car actuellement la Direction régionale de la santé urbaine de Niamey ne participe pas réellement au fonctionnement des districts et son appui au district de la Commune III est actuellement marginal. L’approche programme qui a été proposée (on peut concevoir qu’il y a plusieurs « approches programmes » possibles) est réellement conçue pour rendre les actions de la CB cohérentes entre elles, du point de vue thématique (formations par exemple) et géographique. Les liens avec la planification nationale sont structurellement établis. Il s’agit donc bien d’un programme même si celui-ci garde son autonomie financière (comité de suivi par exemple). Par contre, ce programme est silencieux sur les complémentarités à développer avec les autres PTF. Implicitement, on comprend que le PDS est le programme de tous, mais dans la mise en œuvre, il y aura des synergies à développer (sur la ville de Niamey par exemple). Le projet FNUAP comble un vide sur des problématiques qu’il a identifiées (santé reproductive et prévention HIV/SIDA chez les jeunes). (projet orienté vers une thématique).
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 17
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Le FNUAP a promu d’emblée un partenariat institutionnel et avec la société civile qui « force à la complémentarité ». Les actions touchent des domaines différents et complémentaires (législation, formation, sensibilisation, actions sur les services, plaidoyer, …). Réponse aux besoins de santé Cette réponse est élaborée autour de quatre mécanismes :
1- Les Comité de santé des Centres de Santé Intégrés 2- Le Comité de santé du district 3- Le Comité technique de l’hôpital 4- Des études socio- anthropologiques sur le terrain
Les Comité de santé des centres de Santé ont été promus après les phases de construction (impératif de couverture), mais des formations délivrées à ces comités ont un peu pallié ce problème. Les comités de santé de district nécessitent une formation conséquente au processus de décentralisation qui est en marche. Les membres ne sont pas préparés à penser en terme de pérennisation dans l’après projet. Afin d’assurer le suivi de la réponse des projets aux besoins de santé, des études socio- anthropologiques ont mis en évidence des problèmes d’accueil. D’autres études de suivi externe par l’IMT/UCL (régulières) assurent une sorte de monitoring des problèmes d’utilisation, de la rationalisation du fonctionnement des formations sanitaires, le développement du niveau de soins, la perception des services par la population. Une étude en recherche action sur la Tuberculose est conduite en collaboration avec l’ULB. L’intégration du CHR de Dosso comme hôpital de référence régionale a permis de repositionner la pyramide sanitaire dans son architecture opérationnelle. En parallèle, on peut juger de l’accessibilité par les taux d’utilisation (faibles) tant au niveau des structures rurales qu’urbaines CSI, de l’hôpital (moyen) et par le nombre d’interventions chirurgicales qui, du moins au niveau du DS urbain sont en constante progression en 2004 (520, soit un peu plus de 2 par jour ouvrable). A noter que ces interventions au niveau du district urbain Commune III sont quasi toutes des interventions « à froid » (hernies, hydrocèles, kystes, …) et que les urgences, entre autre chirurgicales, ne sont pas prises en charge. Le système de prise en charge des urgences médico-chirurgicales n’est pas encore fonctionnel, que celles-ci soient prises en charge dans l’hôpital de district (Commune) ou à l’hôpital national, moyennant un système structuré de références et d’accès. Il n’y a pas de mécanisme durable de prise en charge des soins pour les indigents (une partie très importante des « besoins ») même avec l’instauration d’un fonds social au niveau du CHR de Dosso dont l’utilisation reste faible. Au niveau du projet HIV/SIDA des études CAP ont été menées auprès des jeunes en matière de santé de la reproduction, de prévention du SIDA et au sujet des maladies sexuellement transmissibles. Il ressort une participation active des jeunes dans les organes de décisions des centres locaux (excepté centres de santé). Dans l’ensemble donc, les projets belges se préoccupent de répondre aux besoins de santé, mais il semble que l’ampleur de la tâche soit importante. En fait, il ressort de l’historique des
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 18
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
projets que les efforts consentis pour répondre aux besoins doivent être maintenus en l’absence, jusqu’il y a peu, d’un plan national de développement sanitaire (le PDS) qui prennent en compte les acquis des interventions. Plus fondamentalement, il y a au Niger un problème ancien de continuité et de suivi des actions. Un programme plus cohérent, enraciné au niveau central et régional devrait pouvoir y répondre. Impact intersectoriel (potentiel sur la santé) Il n’y a en général pas, dans les projets de l’aide directe de la CB, d’approche multisectorielle concertée et inscrite dans les DTF (un volet est consacré à l’adduction d’eau à Birni N’Gaouré dans la région de Dosso). La prise en compte de problèmes horizontaux comme la malnutrition dans les CSI se fait lors de consultations post natales de manière classique. L’initiative Jeunes pour la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents est un montage du projet avec effet original sur l’intersectorialité. Le projet est pilote dans la sous région (Côte d’Ivoire, Mali, Niger) La dynamique de ce projet de l’UNFPA et le mode d’utilisation de ses ressources (porte d’entrée par le biais des activités sportives) renforcent le système de santé pour cette composante. Devrait être vérifié sur le terrain dans les services de santé
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 19
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Préoccupations transversales
Durabilité
Durabilité technique & managériale La maîtrise de la gestion des ressources humaines en qualité et en quantité couplée à la performance managériale sont les aspects critiques de la durabilité actuellement au Niger. En fait il est déroutant de constater que plus de 30 ans de présence de l’apport de l’assistance belge à Dosso n’ait pratiquement pas généré de culture de gestion pérenne ni d’autonomie durable. L’arrêt de l’assistance externe entraîne sans coup férir le ralentissement des activités à court terme. Dans le DS de la Commune III de Niamey, l’hôpital et la gestion du district semblent assez autonomes. Peut-être faut-il y voir un facteur « Capitale ». Durabilité financière La durabilité financière est pensée comme une contrainte dont la solution dépend de l’extérieur comme cela est stipulé par exemple dans le DTF de DS Commune III. En effet le DTF annonce clairement qu’il faut compter sur la solidarité internationale (DTF C III p 71 , paragraphe 6.3, dernière page du document …). Malgré les problèmes financiers que connaissent les services de santé, les fonds de recouvrement, gérés par les comités de santé, s’accumulent sans être utilisés. Durabilité institutionnelle Institutionnellement, la durabilité des développements des soins de santé est problématique au Niger. Ceci est lié à l’instabilité des cadres dans leur poste et à la faiblesse des instructions et du suivi de la part du niveau central. Il semble cependant que la structuration des districts sanitaires a induit, au sein de l’équipe régionale, une dynamique de développement dans la Région Sanitaire de Dosso ; le travail en équipe des médecins de district avec la Direction Régionale est soutenu, interactif et une garantie institutionnelle de coordination. Ce type d’approche concertée (de management participatif) n’est cependant pas explicitement formalisée dans les projets.. Dans les projets, il y a une importante perte de mémoire et d’habitude de travailler dans un système. Le projet HIV/SIDA du FNUAP a pris une approche qui favoriserait plus la pérennisation de l’action ; c’est peut-être aussi le fait d’un projet qui s’intéresse à une problématique et un public cible nouveaux, répondant à une demande importante. Ce projet a comme atouts :
- D’être en ligne avec la politique nationale - L’implication de nombreux acteurs institutionnels, religieux et associatifs. - Approche globale de promotion de la santé chez les jeunes.
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 20
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
L’approche de lutte contre les maladies transmissibles A part le volet HIV/SIDA centré sur les jeunes et les adolescents, les autres maladies transmissibles sont prises en compte dans le paquet des activités de santé minimal. Le traitement DOTS des malades tuberculeux est conduit dans des centres bien définis. L’utilisation des moustiquaires imprégnées est conseillée particulièrement aux mères attendant famille. La sensibilisation à la problématique des infections VIH et donnée, les affiches placardées, le conseil au dépistage volontaire délivré systématiquement. L’appui belge au programme tuberculose de l’OMS au niveau local a été souligné par le représentant de cette organisation. Partenariats internationaux La Belgique est reconnue dans son rôle de chef de file de la coordination des PTF depuis 2003. Tous les partenaires s’accordent à reconnaître son input essentiel dans la redynamisation de la coordination de l’aide externe. Avec l’approche programme et l’appui institutionnel renforcé au MSP dans la mise en place d’un panier d’intervention commun, l’action dans le secteur pourra gagner en efficience si cette tâche est conduite à terme. L’approche sectorielle bénéficie sans aucun doute du dynamisme belge. Partenariats nationaux Les relations entre la Belgique et le Niger revêtent un caractère particulier dans la mesure où du point de vue de la partie nigérienne la présence de la Belgique n’a jamais fait défaut même pendant des périodes difficiles qu’ils soient politiques (la coopération belge a été la seule restée sur place après le coup d’État) ou fournir des appuis substantiels pour soulager le budget de l’État (paiement de salaires des fonctionnaires à deux reprises). Dans la nouvelle approche, une cellule d’appui institutionnel est mise en place avec pour principales fonctions l’appui à la planification, à la coordination des PTF, à la formation et à l’encadrement des équipes centrales, régionales et de district et à la recherche. La Belgique est très présente dans la formation des cadres de santé nigériens aussi bien au Niger (participation à la rédaction de curricula de formation en tandem avec l’OMS) qu’en Belgique en octroyant des bourses pour des formations dans les universités belges. Les cadres nigériens du secteur santé reconnaissent être associés au cycle de développement de projets. Pendant notre séjour, nous avons pu observer le travail de sélection des candidats pour les postes disponibles dans les projets CTB, travail mené conjointement par les experts de la CTB et les responsables nationaux. Le partenariat avec la Belgique est effectif dans le processus des mutations institutionnelles, sans compter l’expérience unique de contrat signé sur base de négociation entre les projets belges et certaines ressources nationales médicales pour pallier le manque de personnels de santé de qualité au niveau des districts de santé financés par la Belgique. La cogestion est réelle au niveau de projet. Il n’a pas été porté à notre connaissance d’expérience de contractualisation des activités de la santé avec le secteur privé lucratif, confessionnel ou associatif. Les projets et le nouveau programme n’ont pas d’actions prévues avec les associations de professionnels de santé. Dans le PDS, ces aspects ne sont pas abordés. La « problématique des ressources humaines » y est assez fort réifiée, ce qui ne laisse pas de place aux personnels de santé et aux cadres en tant qu’acteurs de leur avenir.
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 21
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
La force du projet HIV/SIDA du FNUAP réside en son large ancrage institutionnel (multipartenariats nationaux). Partenariat avec les communautés locales L’interface est constituée par l’existence de différents comités à chaque niveau structurel. Avec l’avènement d’une décentralisation entrant dans une phase active, le rôle des membres de ces comités gagnera à être ré définis dans la perspective de leur permettre de jouer en connaissance de cause et pleinement leur rôle. Les comités de santé présents dans les CSI sont peu fonctionnels en général. Il n’y a pas d’information (du moins portée à notre connaissance lors de la rencontre) sur le partenariat local pour l’élaboration du projet HIV/SIDA. Cela semble être une idée FNUAP dont les aspects concrets ont été affinés par des enquêtes CAP. (Connaissances, Attitudes, Pratiques). Cependant un partenariat local lors de la mise en œuvre avec, par exemple, les leaders religieux et les associations de jeunes existe. De même par la suite la mise en place des Comités régionaux et sous Régionaux de l’Initiative jeunes. Ceci a débouché sur l’élaboration de matériels didactiques en langue locale et sur des ateliers de développement de ces outils.
- 3000 bandes dessinées sur les dangers du multi partenariat - 3000 dépliants « Guide de poche du Jeune responsable » sur la prévention des
IST/VIH/SIDA - 1500 affiches sur les dangers des mariages précoces - 1500 affiches sur la promotion de la scolarisation des filles
L’égalité des chances femmes / hommes Les projets bilatéraux tentent de garantir une répartition des personnels de santé qui prennent en compte les préoccupations des femmes. C’est d’ailleurs un impératif important dans les sociétés nigériennes. Au Niger, on observe une féminisation des professions de santé et une concentration urbaine des personnels féminins, par l’effet de rapprochement de conjoints (à Niamey surtout). Ces contraintes rendent difficiles une approche genre pro-active pour la répartition des personnels de santé. L’approche genre est pro- active dans les concepts du projet HIV/SIDA du FNUAP à l’adresse des jeunes et des adolescents. Les services de santé sexuelle pour les jeunes prévoient des sages femmes dans les centres de santé « amis des jeunes » et jusque dans les maisons des jeunes pour la prise en charge des jeunes filles. Le plaidoyer est mené auprès des partenaires institutionnels (Ministère de la Jeunesse et Ministère de la Santé) pour que ces postes soient pourvus. Les actions, essentiellement urbaines, sont facilitées par la disponibilité en personnels féminins dans ces zones. La lutte contre le Sida C’est le focus majeur du projet de l’UNFPA (VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles) qui utilise différents canaux (maisons des jeunes, structures de santé), avec soit du personnel de santé spécifique (sage-femme de la maison des jeunes de Boukoki par exemple) et/ou le personnel des centres de santé.
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 22
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Dans les districts de santé, les activités de sensibilisation, counseling et de la sécurité transfusionnelle sont menés dans le cadre du paquet minimal des activités de santé. Il n’y a pas d’actions de la CB concernant le traitement des malades souffrant du SIDA (ARV).
Préoccupations de développement issues de la note stratégique
Développement durable Comme dit précédemment au paragraphe 6.3, la durabilité ne se résume seulement à la disponibilisation des services mais encore plus à leur utilité et utilisation. Malgré la présence au Niger de la CB depuis 3 décades, les services de santé appuyés dans la région de Dosso restent peut utilisés. L’hôpital de district de la Commune III de Niamey l’est plus, mais les centres de santé intégrés de ce district sont eux aussi peu utilisés. On peut donc évoquer une durabilité fragile. Dans notre analyse, il apparaît que la durabilité institutionnelle est particulièrement questionnable, alors que c’est plutôt la durabilité financière qui est généralement mise en avant. En effet, la faible institutionnalisation des fonctions globales et détaillées d’un district dans la mesure ou la faible participation de l’échelon intermédiaire voire un appui conséquent au niveau normatif et de suivi national n’a pas été jusqu’à présent très conséquent, est le signe d’une faible appropriation des projets par les instances nationales Dans les perspectives de la CB, l’adoption d’une approche d’appui institutionnel au lieu d’une approche par projets isolés, pourra certainement améliorer les aspects institutionnels de la durabilité. Sur le terrain (Dosso) l’appui budgétaire décentralisé au niveau périphérique donne de bons résultats et montre sa faisabilité. Quant au projet HIV/SIDA, sa démarche originale et son focus novateur devraient contribuer à sa durabilité. Ce projet est en ligne avec la politique nationale, implique de nombreux acteurs institutionnels, religieux et associatifs, et est focalisé sur les « effets » et « produits » du projet dans une approche globale de promotion de la santé chez les jeunes. Il comporte des aspects législatifs et de plaidoyer et a une importante composante de formation pensée en termes d’acquisition de compétences nouvelles. Cependant, ses intrants sont relativement importants, ce qui peut mettre en péril la durabilité financière. Méthodes et stratégies opérationnelles L’idée de l’approche sectorielle de développement avec un appui budgétaire au niveau central dans une perspective d’intervention multi partenaire concertée semble faire son chemin. Le processus de décentralisation entre également dans sa phase active. L’approche de type district sanitaire a la faveur des autorités nationales. Le niveau des compétences en ce qui concerne la prise en charge des malades par le personnel infirmier nous a été rapporté assez faible étant donné l’absence de formation clinique continue eu égard à la qualité de l’enseignement qui, de l’avis également des AT, est en régression. L’approche dans le projet HIV/SIDA du programme FNUAP est limpide : services, information, plaidoyer ainsi que les ajustements nécessaires révélés par des enquêtes, le recensement des matériels et initiatives existantes.
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 23
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Les projets de la CB au Niger, et le nouveau programme, sont techniquement bien pensés. Ils bénéficient de suivis réguliers (IMT, ULB), d’évaluations et se ménagent un œil socio anthropologique pertinent (avec la LASDEL). On ne peut cependant pas se détacher de cette impression de roue à chaque fois réinventée, mais ce sentiment n’est pas lié aux techniques opérationnelles proposées mais plutôt à l’organisation de leur mémoire et à leur pérennité institutionnelle. Renforcement des capacités Cet aspect ne s’arrête pas seulement à la quantité des ressources humaines formées, mais devrait interpeller la qualité des formations dispensées en fonction de leur utilisation de manière directe sur le terrain. La gestion des RH est mal maîtrisée par le MSP/LCE qui a décidé de mettre en place une direction générale des ressources humaines pour établir une stratégie d’utilisation efficiente des ressources humaines dans le secteur santé. La Belgique a contribué à la formation des ressources médicales nigériennes. Mais la mobilité des RH dans le secteur santé reste préoccupante. Plusieurs raisons ont été évoquées allant du manque de motivation à la faiblesse de salaire, du manque d’attrait de l’environnement socioprofessionnel : éloignement, isolement, carence en matériel de travail, « politisation » des affectations et aussi le manque de suivi du personnel affecté en zone rurale. Quelques expériences d’utilisation de personnel médical privé sont en cours à l’Hôpital National de Niamey où des chirurgiens du privé peuvent intervenir selon modalités définies par la direction de l’hôpital. De l’avis des personnes rencontrées la qualité de la formation magistrale diminuerait d’année en année tandis que la formation continue sur terrain n’a pas cours. Les leçons tirées des expériences passées ne semblent pas prises en compte. Mais le plus important reste la gestion politique transparente, équilibrée et équitable des ressources humaines. Devant la carence en RH l’assistance belge a introduit la notion d’utilisation sur base contractuelle de personnel médical nigérien après séances de libre négociation quant aux conditions sociale de travail. Le projet Dosso qui venait de se terminer aura été précurseur à ce point de vue. Cette piste de solution ne peut être envisagée que de manière temporaire en attendant la mise sur pied d’une politique concrète de définition de plan de carrière pour le personnel de santé Au terme de plusieurs années de coopération, le renforcement des capacités des cadres, des personnels de santé et des institutions centrales et périphériques est fragile. La raison principale de cette fragilité est à rechercher au niveau du dispositif de soins de santé qui fonctionne selon des modalités et des critères à la fois bureaucratiques et arbitraires (voir analyse faite sur les ressources humaines dans l’annexe du DTF du nouveau programme d’appui au PDS), mais peu orienté vers une mission de fourniture de soins, et leur organisation quelque peu rationnelle. Le nouveau PDS et le programme d’appui belge devraient progressivement remédier à cette situation. Stratégies de financement Dans les services de santé appuyés par la CB au Niger, le financement des soins est « classique », partagé entre les usagers, le gouvernement et la coopération : (Rapport évaluation 2003 p. 12) :
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 24
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
• « la mise en place d’un recouvrement des coûts avec facturation séparée et gestion séparée des recettes liées aux actes médicaux et techniques et celles liées à la vente des médicaments. Ceci permet d’utiliser les recettes des actes médicaux pour couvrir certains frais (voir ci-dessous) et de consacrer l’entièreté des recettes de médicaments à l’achat de médicaments. Ce principe est en contradiction avec les recommandations du Ministère de la Santé mais nous paraît sain dans son esprit et simple dans sa mise en œuvre. Il permet en gros d’éviter la fuite des recettes destinées au rachat de médicaments vers des postes comme les primes ou le carburant. »
• « Le principe a été adopté d’utiliser les ressources pour le financement des
activités en consommant d’abord celles venant de l’Etat, puis celles provenant du recouvrement des coûts et enfin celles disponibles dans le cadre du projet. Il ne devrait pas être trop compliqué de mesurer les flux financiers et d’apprécier ainsi la dépendance réelle du district vis-à-vis du projet. »
• « La centralisation des recettes, comme expliquée ci-dessus, permet un bon
contrôle de la redistribution de celles-ci. La répartition est de 40 – 40 – 20 : soit 40 % pour le personnel, 40 % pour le fonctionnement et 20 % pour le maintien des investissements. »
Les projets de mutualisation des soins de santé, voire de contractualisation des services n’ont pas encore formellement cours au Niger. La continuité de l’assistance extérieure est évoquée de manière permanente comme axe important de la stratégie de financement du secteur.. La CB n’a pas d’action spécifique sur le système de financement des soins de santé. Le nouveau programme d’appui au PDS n’a pas de volet spécifique sur ce point. Dans les services de santé on se trouve dans une situation de pénurie intense de ressources financières, ce qui induit, peut-être à tort, un esprit et des stratégies minimalistes pour dégager au cas par cas des ressources de base pour le fonctionnement d’un service ou d’un centre de santé. Actions de plaidoyer La Belgique mène un plaidoyer constant pour une approche coordonnée des interventions d’appui au secteur santé et pour l’élaboration progressive et cohérente d’un politique de santé qui serve de cadre unique pour les instances nationales et de coopération. La Belgique a su trouver une place juste dans le « dispositif PTF ». C’est aussi une question de personnes. Il n’y a pas, au niveau de la CB en tant qu’institution, de code de conduite ou d’instructions politiques précises dans ce domaine. Le projet VIH//SIDA du FNUAP mène un plaidoyer très suivi sur les aspects de mise en œuvre du projet en tandem avec le plaidoyer du Ministre de la jeunesse et de l’Insertion professionnelle dans les zones du projet. Plan d’action par pays Non disponible
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 25
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
La recherche Recherche action sur la prise en charge de la TBC avec l’ULB – CTB. Recherche action sur la Qualité des soins et sur les capacités des services de répondre à la demande avec le Laboratoire d’études de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL) de Niamey. Les résultats et/ou propositions découlant de cette recherche ne semblent pas utilisés à bon escient, comme l’atteste la faible utilisation du fonds de social mis au niveau de DS de Dosso. Etudes « CAP » citées précédemment dans le projet VIH/SIDA du FNUAP
La CB contribue donc à des études et à des recherches opérationnelles centrées sur des problématiques locales mais ne contribue pas véritablement à des recherches cliniques ou de santé publique à portée plus générale. Si cette attitude peut être vue comme probablement la plus raisonnable au niveau local, les incertitudes pour mettre en œuvre les éléments de base d’un système de santé (financement, références, prestations de soins, …) nécessiteraient des actions de recherche plus larges. Fonds global La CB au Niger n’a pas d’actions ni de synergies développées avec le Fond Global.
Conclusions et recommandations Conclusions L’accent de la CB bilatérale directe porte sur l’amélioration de la couverture sanitaire et l’offre d’un paquet d’activités de santé minimal et complémentaire avec la participation de la population au niveau financier et de la gestion. La santé de la reproduction et la lutte contre le VIH/SIDA sont pris en compte dans le projet multilatéral de l’UNFPA qui cible les jeunes. Les projets de la CB au Niger reflètent donc bien l’esprit de la note stratégique, bien que celle-ci ne soit pas formellement connue au niveau des projets. Elle serait plutôt un document de politique, assez consensuel et peu discutable. Par contre elle est très peu « stratégique », elle ne décrit pas les modalités de mise en œuvre des actions de santé ni comment conduire un projet. En fait, ce serait plutôt l’expérience de terrain qui a influencé le contenu de la note stratégique. Le partenariat Niger/Belgique est effectif et le rôle de la Belgique apprécié comme chef de file de la coordination entre les partenaires. La CB, qui n’avait pas jusqu’ici d’appui au niveau politique et stratégique propose maintenant un programme intégrant les différents projets. La CB réoriente donc son processus de coopération en santé dans une perspective sectorielle et institutionnelle. La CB bilatérale agit en partenariat avec le MSP / LCE. Il n’y a pas d’autres partenariats développés avec le secteur privé, d’autres ministères ou les associations professionnelles. Le projet de l’UNFPA, par contre, est un modèle de partenariat institutionnel faisant intervenir
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 26
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
plusieurs ministères, une équipe technique multidisciplinaire au niveau central, des comités régionaux et sous-régionaux et enfin des structures et organisations locales des jeunes. L’expérience de ce projet pourrait être utile pour les projets bilatéraux, car un partenariat élargi permet certainement de mieux prendre en compte les contraintes structurelles que connaît un partenaire unique (financement, ressources humaine, par exemple). La CB a un impact important sur la couverture sanitaire. Plus particulièrement, elle a réalisé des approches innovantes. Dans la Commune III de Niamey, un district urbain est à présent fonctionnel, malgré les difficultés reconnues des approches urbaines de développement de services de santé. Ce district est à taille raisonnable, simple et efficace. Son ancrage institutionnel local est effectif même s’il est encore fragilisé par l’implication faible des niveaux supérieurs, en particulier de la région sanitaire. A Dosso également, le projet a mis l’accent sur le renforcement du CHR, tout en poursuivant le développement des hôpitaux de districts, mais en considérant la référence clinique régionale essentielle pour la population en attendant que la périphérie soit autonome pour ses références. Le fonds social pour la prise en charge des indigents, l’organisation du système d’évacuation motorisé des malades ainsi que l’établissement d’une pharmacie de cession sont également des aspects innovateurs de ce projet dans le contexte du Niger. Ces approches ont renforcé structurellement le système localement, mais sans relais institutionnels solides, ils gardent un caractère précaire. Le projet de l’UNFPA a un impact important en matière de sensibilisation, éducation et information sur les thématiques de la santé reproductive et du HIV/SIDA chez les jeunes. Du point de vue du système de santé, la CB a eu un impact sur la structuration de ce système (PDS), mais les aspects complémentaires essentiels à cette structuration (ressources humaines, financement par exemple) n’ont pas fait l’objet d’appuis structurants. C’est à cette conclusion que la CB est arrivée par elle-même et le nouveau programme élargit son champ d’action au niveau central. Ainsi la Belgique pourra aider le gouvernement dans un réel processus de décentralisation et de valorisation judicieuse de ses personnels de santé, un grand facteur limitant dans la fonctionnalité surtout des districts ruraux. La CB a pu obtenir des résultats au niveau du projet d’appui au district sanitaire de la Commune III de Niamey. En ce qui concerne la région de Dosso, les résultats ont été en « dent de scie », modulés par les facteurs positifs liés aux équipes nationales et des AT, puis à leur départ. On peut voir au travers de cet historique de coopération dans une région, combien l’appui aux politiques et aux stratégies nationales est important, pour la Belgique, en coordination avec l’ensemble des partenaires. Du point de vue des ressources, les projets de la CB ont en général été efficaces et cohérents. Du côté du Gouvernement, les crédits de fonctionnement octroyés par l’Etat ont connu une réduction allant jusque 90% entre 2002 et 2004. Il est certain que dans ces conditions les ressources des projets, consacrées en principe et en majorité à des activités de développement, ne peuvent qu’être, d’une manière ou d’une autre réorientées vers le fonctionnement courant. Dans des conditions si précaires, le processus de coopération devrait pouvoir réagir, entre autres par un recentrage des projets. Les synergies et la complémentarité entre les projets de la CB et avec les autres PTF sont assez faibles au Niger. Le nouveau programme contient les éléments de complémentarité entre projets mais reste silencieux sur celles à développer avec les autres PTF. Dans l’ensemble, les projets belges se préoccupent de répondre aux besoins de santé, mais il semble que l’ampleur de la tâche soit importante. En fait, il ressort de l’historique des projets que les efforts consentis pour répondre aux besoins doivent être maintenus en l’absence,
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 27
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
jusqu’il y a peu, d’un plan national de développement sanitaire (le PDS) qui prennent en compte les acquis des interventions. Plus fondamentalement, il y a au Niger un problème ancien de continuité et de suivi des actions. Le nouveau programme plus cohérent, enraciné au niveau central et régional devrait pouvoir y répondre. En fait il est déroutant de constater que plus de 30 ans de présence de l’apport de l’assistance belge à Dosso n’ait pratiquement pas généré de culture de gestion pérenne ni d’autonomie durable. L’arrêt de l’assistance externe entraîne de manière récurrente le ralentissement des activités à court terme. La question de la durabilité des interventions est donc cruciale. La durabilité financière a elle-seule est pensée comme une contrainte dont la solution dépend de l’extérieur. Au terme de plusieurs années de coopération, le renforcement institutionnel et le renforcement des capacités restent fragiles. La durabilité ne devrait pas être considérée comme une hypothèse et/ou contrainte mais comme un véritable objectif à atteindre. Recommandations Sur la base des expériences échangées et des constats faits au Niger, pris comme une « étude de cas » pour l’évaluation transversale des projets santé de la CB, la mission propose ci-après des recommandations à caractère général, utiles aux autorités belges de la coopération au développement.
- La CB devrait élargir son champ d’action à l’appui aux politiques et aux stratégies de santé des pays partenaires et formaliser ce champ d’action dans la NS,
- La NS devrait s’étoffer sur les aspects de stratégies de mise en œuvre de projets ou programmes de santé,
- Le processus de gestion de projet devrait mieux permettre d’adapter les interventions aux changements de situations, en particulier lorsque les ressources de l’Etat ne sont pas à la hauteur des engagements pris lors de l’élaboration d’un DTF.
- Les partenariats de coopération bilatérale devraient être élargis aux ministères chargés des ressources et du personnel de santé
- Les partenariats devraient aussi être élargis aux associations professionnelles pour permettre aux personnels de santé de s’engager activement dans les réformes nécessaires à leur propre bien-être et à celui des populations.
- La question de la durabilité des interventions devrait être prise en compte comme une problématique à part entière et les projets /programmes devraient être conçus pour y répondre.
- Les synergies et les complémentarités entre les projets de la CB et avec les autres PTF devraient être mieux anticipées et faire l’objet d’activités déterminées.
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 28
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
ANNEXES
1. Annexe 1. Tableaux à remplir concernant le diagramme d’impact
Fonctions essentielles du secteur public appuyées
Projet Tous projets belges
Autres intervenants
Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
X Approche district de santé
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
X Participation belge à l’opérationnalisation du PDS
Législation et fonctionrégulatrices établies
s X Plaidoyer du projet FNUAP
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Allocation des ressources améliorée
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
X Chef de file des PTF
Politique d’information et système d’information établis
Stratégies de financement de la santé établies
X Recouvrement des coûts
Tableau 10
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 29
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Impact sur les fonctions essentielles du secteur
public
Projet Projets belges Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
X Approche développement district de santé
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
X Participation active au PDS
Législation et fonctions régulatrices établies
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Allocation des ressources améliorée
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
Leader de la coordination PTF
Politique d’information et système d’information établis
Stratégies de financement de la santé établies
Recouvrement des coûts
Tableau 11
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 30
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Fonctions essentielles du secteur public faiblement prises en
charge dans le secteur santé Oui / non Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
Non PDS opérationnel
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie Non
Législation et fonctions régulatrices établies Oui
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé Oui
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé Oui
Allocation des ressources améliorée Non Au niveau de fonctionnement des districts
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi Non
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
?
Politique d’information et système d’information établis Non
Stratégies de financement de la santé établies
Oui
Tableau 12
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 31
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Résultats sectoriels : focus principal de l’appui
du projet Projet Projets belges Commentaires
Soins de santé essentiels définis et disponibles X Développement des districts de santé Approche dynamique et originale au travers de projet HIV/SIDA
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre le secteur public et les secteurs privés
Ressources humaines compétentes et motivées en place
Pouvoir de décision et de gestion, décentralisé au niveau approprié X Niveau de co gestion
Système d’encouragement à la performance en place
Accès aux médicaments essentiels et approvisionnement assurés X
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins
Participation du parlement, de la société civile, des partenaires et des communautés locales assurée
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés X Préoccupations sociales et apport de suivis scientifiques pour la
qualité des services et des soins
Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services
Le financement de la santé est efficace
Le financement de la santé est équitable et juste
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 32
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Tableau 4
Résultats sectoriels faibles ou problématiques Oui / non Commentaires
Soins de santé essentiels définis et disponibles Non PDS
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre le secteur public et les secteurs privés oui
Ressources humaines compétentes et motivées en place oui Grande mobilité, pas de motivation, préférence pour les centres urbains
Pouvoir de décision et de gestion, décentralisé au niveau approprié non En cours et récent
Système d’encouragement à la performance en place oui
Accès aux médicaments essentiels et approvisionnement assurés non
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins oui
Participation du parlement, de la société civile, des partenaires et des communautés locales assurée
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés non
Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services non Cependant problèmes de fiabilité
Le financement de la santé est efficace Oui
Le financement de la santé est équitable et juste oui L’ exclusion des indigents
Tableau 5
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 33
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Autres secteurs appuyés Projet Tous projets belges
Autres intervenants
Commentaires
Politique et stratégies de population établies X Spécificité FNUAP
Politique et stratégies de nutrition établies _
Politique et stratégies d’eau et hygiène établies _
Politique et stratégies de l’éducation établies _
Politique et stratégies environnementales établies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
_
Politique et stratégies de sécurité routière établies _
Environnement favorisant un comportement sain en place _
Tableau 6
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 34
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Autres secteurs faibles concernant les actions liées à la santé Oui /non Commentaires
Politique et stratégies de population établies ? Politique et stratégies de nutrition établies ? Politique et stratégies d’eau et hygiène établies ? Politique et stratégies de l’éducation établies ? Politique et stratégies environnementales établies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
?
Politique et stratégies de sécurité routière établies ? Environnement favorisant un comportement sain en place ?
Tableau 7
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 35
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
2. Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Nom Organisation Fonction E-mail M Michel Lambrechts Ambassade de
Belgique Attaché [email protected]
M Theo Bart Ambassade de Belgique
Attaché [email protected]
M Zouma Salifou MSP/LCE Secrétaire Général
Dr Luc Geysels Commission Européenne
Conseiller technique MSP/LCE
M Shone Nebeyu CTB Représentant résident
Dr Touré Mohamed Lamine
CTB Expert santé publique
Dr Papa Ernesto CTB Expert santé publique
Dr Martine Hennaux CTB Expert chirurgie [email protected] Dr Patrick Hoekman CTB Expert orthopédie [email protected] M Tidjani Youssouf Ahmadou
CTB Chargé de programme
M Djibrilla Karamoko Banque Mondiale Expert senior santé
Mme Marlène LAYS UNFPA représentante [email protected] Dr Diallo Sanata UNFPA Chargée de
programme [email protected]
M Diadé Boureima UNFPA Assistant Représentante
Dr René Zitsamele CODDY
OMS Représentant Résident
Dr Gagara Magagi OMS Conseiller Planification
Dr Habi Gado OMS Chargé de programme lutte contre le paludisme
Dr Saade Souleye Ousseini Mariama
MSP/LCE DRSP/Niamey [email protected]
Dr Alfonso Franco Ambassade de Cuba
Responsable Santé
Dr Pacco Alessandro Ambassade de Cuba
Chirurgien urgentiste
Mme Diallo Mariama MSP/LCE/UNFPA Directrice CS Boukoki
M Boureima Hamidou MSP/LCE politique sanitaire
Directeur
M Ali Djibo MSP/LCE Directeur Général MSP
M Abdramane Salifou Maïnassara
MSP/LCE Ressources Humaines
Directeur Général
M Abdou Sayo Farmo MSP/LCE DAF Directeur M Sabou Ibrahim MSP/LCE Directeur HNN Dr Issa Moussa Hama MSP/LCE Responsable
Projet Dosso [email protected]
M Alsou Abdou MAE/C/IA DEUR Mme Laurie Barnier AFD Chargée de [email protected]
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 36
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
mission M Hervé Kahane AFD Directeur Adjoint [email protected] M Julien Gavagnou AFD [email protected] Dr Mariana Ousseini MSP/LCE MCD Commune III M Mounkaïla Hamidou MSP/LCE Epidémiologiste
DS Commune III
Mme Gado Fatima Ali MSP/LCE Gestionnaire DS Commune III
Dr Hamidou Yaya MSP/LCE Médecin Hôpital Commune III
Mme Zeinabou MSP/LCE IDE Responsable CSI Gaweyé
Mme Adamou Ouma MSP/LCE IDE Responsable CSI Sagiya
Dr Moudi OMS/AFRO Retraité M Moumouni Adamou LASDEL Chercheur M Sambo Oumarou Mairie Commune III Secrétaire
général, membre comité de santé
Mme Carine Coudert UNICEF Santé et Nutrition Direction et Equipe régionale Médecins de district
DRSP et MCD, Région Sanitaire de Dosso
Directrice Régionale et Médecins Chefs de Districts
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 37
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
3. Annexe 3. Liste des documents consultés
Plan de Développement Sanitaire 2005 – 2009 , Ministère de la santé Publique et de la Lutte Contre les Endémies, 18 février 2005. Plan de Développement Sanitaire 2005 – 2009 : Programme de travail quinquennal / Draft, Ministère de la santé Publique et de la Lutte Contre les Endémies, juillet 2005. Rapport de la mission d’évaluation à mi-parcours du Projet d’appui au district sanitaire urbain de la Commune III à Niamey, Dr Denis Porignon, Dr Idrissa Maïga, février 2003. Suivi scientifique du Projet d’Appui au développement des districts sanitaires de la Région de Dosso, Niger, Rapport de la deuxième mission de suivi scientifique, Dr Sylvie Dugas et Dr Remo Meloni, IMT-Anvers, juin 2003.
Aide-mémoire de la troisième mission de suivi scientifique du Projet d’Appui au développement des districts sanitaires de la Région de Dosso, Dr Remo Meloni, IMT-Anvers, octobre 2003.
Formulation Dossier Technique et Financier du programme d’Appui pour la mise en œuvre du PDS, Document préparé pour la CTB, septembre 2004. Dossier d’instruction technique et financier du projet d’Appui au développement du District sanitaire urbain de la Commune III de Niamey, Phase III, Coopération nigério-belge, Ministère de la Santé Publique, 1999. Dossier d’instruction, technique et financier du projet d’Appui au développement des Districts sanitaires du Département de Dosso, Coopération nigério-belge, Ministère de la Santé Publique, 1999. Rapport de la mission d’évaluation à mi-parcours du projet d’Appui au développement des districts sanitaires de la région de Dosso, Coopération Technique Belge Niamey, Dr Paul De Calluwé, Dr Jeremias Inrombe, Mr Amadou Sambo, juillet 2003 Rapport d’exécution année 2004, Projet d’Appui au développement des districts sanitaires de Dosso, CTB. Rapport Final, Projet d’Appui au développement des districts sanitaires de Dosso, CTB 22 Novembre 2004.
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 38
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
4. Annexe 4. Calendrier et programme de la mission Mardi 28 juin arrivée AF 17 h Installation à l'hôtel Homeland Mercredi 29 juin 9h Comité de Pilotage élargi (OMS,UNFPA,UNFPA, BM, AFD, CB, CTB, CUBA, MSP/aval SG 11 h Briefing Ambassade de la Belgique
M.Theo Baert, Dr Ernesto Papa, Dr Martine Hennaux, M. Michel Lambrechts, M. Shone Nebeyu
16 h 30 Réunion MSP/PTF Manuel d'exécution du PDS Jeudi 30 juin 10 h DRSP de Niamey 11h30 Visite District Sanitaire Commune III 15 h 30 Rencontre avec DRH M. Abdramane Salifou Maïnassara 16 h 30 Rencontre avec DAF M. Abdou Sayo Farmo Vendredi 1 juillet 9 h Banque Mondiale M. Djibrilla Karamoko (Rencontre PTF) 11 h Ambassade de Cuba Dr Alexandro Paccho 12 h UNFPA M. Diadié Boureima, Dr Diallo Sanata 15 h OMS Drs Coddy, Gagara Magagi, Habi Gado 17 h UNICEF Mme Carine Coudert Samedi 2 juillet 9 h Rencontre avec experts CTB + Attachés
à l'Ambassade
M.Theo Baert, Dr Ernesto Papa, Dr Martine Hennaux, M. Michel Lambrechts, M. Shone Nebeyu
Lundi 4 juillet 9 h Rencontre responsable projet Dosso Dr Hama (rencontre PTF) 10h 30 Responsables AFD Mme Laurie Barnier, M. Hervé Kahane
15 h 30 Visite Hôptial National Niamey Dr Sabou Ibrahim, Dr Patrick Hoekman
17h 30 Rencontre CT / MSP Dr Luc Geysels Mardi 5 juillet 9 h Journée de la Santé à Dosso :accès et qualité Mercredi 6 juillet 9 h Visite DS Dosso Visite District Sanitaire Commune III Jeudi 7 juillet 10 h CTB Ms. Shone Nebeyu, Tidjani Ahmadou
16 h Visite CS de Boukoki (proj UNFPA) Dr Diallo Sanata, Mme Diallo Mariana et équipe
Vendredi 8 juillet 9 h Comité de Pilotage Débriefing: résultats mission
CB,CTB,OMS,UNICEF, AFD,MSP/LCE,UNFPA, Banque Mondiale, MAE
HERA / Rapport pays NIGER / Décembre 2005 Annexe 4 - 39
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 5 - 0
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 5. Rapport Rwanda
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 5 - 1
HERA HEALTH RESEARCH FOR ACTION .
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Rapport Rwanda
Laarstraat 43 tel. +32-3-8445930 B-2840 Reet Belgium fax. *32-3-8448221 Bank No 401-2025551-15 e-mail [email protected]
www.herabelgium.com
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Table des Matières
ABREVIATIONS .................................................................................................................................. 5
1. FICHE SIGNALETIQUE ............................................................................................................ 7
2. INTRODUCTION......................................................................................................................... 9
3. FOCUS DE L’APPUI BELGE ET LA POLITIQUE DE SANTE NATIONALE................. 10
3.1. FOCUS DE L’APPUI BELGE.................................................................................................... 10 3.2. RESUME DE LA POLITIQUE NATIONALE DE SANTE............................................................. 12
4. L’UTILISATION DE LA NOTE STRATEGIQUE................................................................. 13
5. PERTINENCE DES INTERVENTIONS D’UN POINT DE VUE SECTORIEL ET DU PARTENARIAT.................................................................................................................................. 14
5.1. IMPACT SUR LE SYSTEME DE SANTE ................................................................................... 14 5.2. PERTINENCE DU PARTENARIAT INSTITUTIONNEL.............................................................. 15
6. EFFICACITE ET PERTINENCE DES INTERVENTIONS PAR RAPPORT A LA POLITIQUE NATIONALE ET LA NOTE STRATEGIQUE BELGE ............................................. 16
6.1. REFERENCE AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES .................................................................. 16 6.2. PERTINENCE DES RESSOURCES............................................................................................ 19 6.3. RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE............................................................................ 20 6.4. COHERENCE ET COMPLEMENTARITE.................................................................................... 21 6.5. REPONSE AUX BESOINS DE SANTE....................................................................................... 22 6.6. IMPACT (POTENTIEL SUR LA SANTE) INTERSECTORIEL........................................................ 22
7. PREOCCUPATIONS TRANSVERSALES.............................................................................. 22
7.1. DURABILITE.......................................................................................................................... 22 7.2. L’APPROCHE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES.................................... 25 7.3. PARTENARIATS INTERNATIONAUX ....................................................................................... 26 7.4. PARTENARIATS NATIONAUX................................................................................................. 26 7.5. PARTENARIATS AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES ......................................................... 26 7.6. L’EGALITE DES CHANCES FEMMES / HOMMES .................................................................... 26 7.7. LA LUTTE CONTRE LE SIDA ................................................................................................. 27
8. PREOCCUPATIONS DE DEVELOPPEMENT ISSUES DE LA NOTE STRATEGIQUE 27
8.1. DEVELOPPEMENT DURABLE................................................................................................ 27 8.2. METHODES ET STRATEGIES OPERATIONNELLES ................................................................ 28
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 3
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
8.3. RENFORCEMENT DES CAPACITES ....................................................................................... 28 8.4. STRATEGIES DE FINANCEMENT ............................................................................................ 29 8.5. ACTIONS DE PLAIDOYER....................................................................................................... 29 8.6. PLAN D’ACTION PAR PAYS .................................................................................................... 30 8.7. LA RECHERCHE .................................................................................................................... 30 8.8. LES FONDS GLOBAUX ........................................................................................................... 30
9. CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS, DEFIS ET OPPORTUNITES ........................ 31
10. ANNEXES................................................................................................................................ 32
10.1. ANNEXE 1 : TABLEAUX CONCERNANT LE DIAGRAMME D’IMPACT............................... 33 10.2. ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES ....................................................... 39 10.3. ANNEXE 3 : LISTE DE DOCUMENTS CONSULTES............................................................. 41 10.4. ANNEXE 4 : PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA MISSION D’EVALUATION ...........ERREUR ! SIGNET NON DEFINI. 10.5. ANNEXE 5 : LISTE DES INTERVENTIONS APPUYEES PAR LA COOPERATION BELGE DANS LE SECTEUR SANTE AU RWANDA ............................................................................................... 43 10.6. ANNEXE 6 : CROISEMENT DES INTERVENTIONS APPUYEES PAR LA COOPERATION BELGE ET LA STRATEGIE NATIONAL DE SANTE (HSSP).................................................................... 45 10.7. ANNEXE 7 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SECTEUR DE LA SANTE RETENUS DANS LE PLAN STRATEGIQUE 2005-2009 (HSSP) .............................................................................. 46
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 4
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Abréviations AC Approche contractuelle APEFE Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à
l’Etranger (ONG belge) ARV Médicaments Anti-rétroviraux AS Approche Sectorielle AT Assistant technique / Assistance technique BM Banque Mondiale BTC Belgian Technical Cooperation CB Coopération Belge CdC Comités de concertation CDC Comités de développement communautaire CDMT Cadre des Dépenses à Moyen Terme (MTEF) CHK / CHUK Centre Hospitalier de Kigali / Centre Hospitalier Universitaire de Kigali CNLS Commission Nationale de la Lutte contre le SIDA COSA Comités de Santé CTB Coopération Technique Belge DPCG Development Partners Coordination Group DS Districts Sanitaires DTF Dossier technique et financier ECD Elus de la Communauté de base pour le Développement EDS Enquête Démographique de Santé EPR Eglise Presbytérienne au Rwanda ESI Ecoles des Sciences Infirmières ESP Ecole de Santé Publique FD Fondation Damien (ONG belge) FOSA Formations sanitaires FRW Francs Rwandais GFATM Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria GTZ Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (Coopération technique
allemande) HSCG Health Sector Coordination Group HSSP Health Sector Strategic Plan ; Plan Stratégique national du secteur de
la santé KHI Kigali Health Institute MAP Multi-country AIDS Programme (de la Banque Mondiale) MDG Millennium Development Goals MEG Médicaments Essentiels Génériques MFPE Ministère des Finances et de la Planification Economique (l’ancien
MINECOFIN) MS Ministère de la Santé MSF-B Médecins sans Frontières – Belgique MSV Médecins sans Vacances NS Note Stratégique NSP Note Stratégique Pays ODM Objectifs de Développement du Millénaire (MDG) ONG Organisation non gouvernementale ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA PEPFAR President’s Emergency Plan for AIDS Relief (US) PNILP Programme National Intégré de Lutte contre le Paludisme
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 5
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
PNILT Programme National Intégré de Lutte contre la Lèpre et la Tuberculose
PNS Politique Nationale de Santé PNSM Programme National de Santé Mentale PTME Prévention de la Transmission Mère-Enfant PTF Partenaires techniques et financiers SCPS Service de Consultations Psychosociales SG Secrétaire Général SolProt Solidarité Protestante (ONG belge) SRP Stratégie de Réduction de la Pauvreté SSP Soins de Santé Primaires TWG Technical Working Groups UE Union Européenne UNFPA United Nations Population Fund USAID United States Agency for International Development VCT Voluntary Counselling and Testing
Taux d’échange: € 1 = FRW 670 environ (2005)
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 6
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Fiche signalétique Nom du pays Rwanda
Projets évalués 1. Appui au Centre Hospitalier de Kigali ; CTB avec IMT
2. Appui Institutionnel au Ministère de la Santé ; CTB 3. Programme d’appui aux districts de santé (Kigali Ngali, Kigali
ville, Kabgayi) ; CTB 4. Appui au Programme National de Santé Mentale ; CTB 5. Appui au Programme National Intégré de Lutte contre le
Paludisme ; CTB 6. Appui aux Ecoles de Sciences Infirmières ; CTB et APEFE 7. Appui au Programme National de lutte contre la Lèpre et la
Tuberculose ; Fondation Damien 8. Appui à l’Hôpital Neuropsychiatrique de Ndera ; et appui au
Centre de Formation ; CARAES 9. Projet SIDA à Kigali ; MSF-B 10. Projet de lutte contre le SIDA en milieu rural ; EPR et Solidarité
Protestante Pour plus de détail : voir annexe 5
Budget annuel belge d’appui au secteur santé pour les années 2003, 2004, 2005
Dépenses 2003 : € 3 052 000 (soit 48% de l’appui recensé des partenaires bilatéraux) Dépenses 2004 : € 4 050 000 (46% de l’appui des part. bilat.) Prévisions 2005 : € 8 341 000 (65%) Engagements 2006 : € 7 047 000 (73%) Engagements 2007+ : € 6 692 000 (74%) Répartition du budget Santé de la Coopération belgo-rwandaise bilatérale sur 8 programmes (2005) : voir diagramme, section 2.1. Dépenses santé pour la période 2003-2004 : € 0.36 à 0.48 par habitant par an. Prévisions pour la période 2005-2006 : € 0.83 à 0.98 par habitant par an.
Budget annuel national du secteur santé pour les années 2003, 2004, 2005
Budget 2003 : € 16 012 507 Budget 2004 : € 23 410 898 Budget 2005 : € 40 964 419 Budget annuel moyen 2003-2005 : € 26 795 941 (Il s’agit de prévisions budgétaires)
Nom de l’attaché
M. Dirk Heuts, Ministre Conseiller M. Dirk Brems, Attaché Coopération Dr. Dick De Clercq, Attaché Santé (depuis juin 2005)
Partenaires locales responsables
Ministère de la Santé (MS) Hôpital Neuropsychiatrique de Ndera (projet # 8) Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR ; projet # 10)
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 7
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Nom des évaluateurs
M. Leon Bijlmakers M. Saïdou Souleymane
Date de l’évaluation de terrain
Du 16 au 28 juin 2005. Le programme de travail de la mission est joint en annexe 4
Documents consultés Voir liste en annexe 3
Personnes interviewées
Voir liste en annexe 2
Autres sources -
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 8
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Introduction L’aide publique belge au développement est présente au Rwanda depuis 1962, année d’accession à l’indépendance du Rwanda auparavant sous tutelle de la Belgique. Le génocide de 1994 ayant détruit des moyens humains énormes et la plupart des infrastructures matérielles dont disposait le pays, la coopération belge a redémarré ses activités fin 1994 en reprenant les projets initiés avant le génocide sur la base des anciens dossiers ; elle a initié aussi de nouvelles interventions, particulièrement dans les domaines de la santé et de la sécurité alimentaire. Dans la période d’urgence et de réhabilitation (de fin 1994 à 1999), les lignes de force de la politique belge de coopération avec le Rwanda sont restées relativement stables, avec un focus sur l’aide directe à la population, des projets à caractère national ou situés dans une zone géographique déterminée et une concentration sur plusieurs secteurs, parmi lesquels le secteur de la santé. La co-gestion était le mode privilégié de mise en œuvre de la coopération. A partir de mi-2000, les nouvelles identifications d’intervention one été réalisée en tenant compte des nouvelles directives inclues dans la Note Politique de Coopération du 5 avril 2000 et en référence au document Poverty Reduction Strategy Paper, présenté aux bailleurs de fonds par le gouvernement rwandais en novembre 2000 et en mettant l’accent sur une approche programme. A partir de fin juin 2000 la CTB s’est installée à Kigali et les interventions de coopération lui ont été progressivement transférées. En juillet 2001, le gouvernement belge a lancé un plan d’action intitulé « Construction de la Paix dans la Région des Grands Lacs » dont les grands axes étaient la création d’un partenariat vers la paix, suivi d’un partenariat dans la paix, visant la stabilité structurelle dans la région des grands lacs. La coopération belgo-rwandaise bilatérale directe à moyen terme (telle que formulée dans la Note Stratégique pour le Rwanda de la Coopération Belge) repose principalement sur deux secteurs prioritaires : la santé publique et le rétablissement de l’Etat de droit ; ceci sans pour autant exclure des actions ponctuelles en faveur de l’éducation, du développement agricole et de l’environnement. Avec la tenue de la Commission Mixte en mai 2004, un accent plus fort est mis sur le développement rural, secteur nécessitant un appui plus accru vu son importance pour la majorité de la population et son impact sur l’économie nationale. Dans la phase de recherche de stabilité structurelle, la Belgique privilégie une approche où les instruments de financement d’une ou plusieurs activités viennent en appui d’un programme sectoriel cohérent, avant d’envisager d’autres modalités de coopération dans le cadre d’une paix durable. Un des éléments centraux de différenciation entre les partenaires au développement est la question de la fongibilité des fonds et de leur diversion possible à des fins militaires. La Belgique était réservée quant au recours à l’aide budgétaire directe, approche à laquelle l’Union Européenne, la Grande Bretagne et al Banque Mondiale ont recours.
Dans le cadre d’une stratégie de coopération vers la paix, la Belgique souhaite à court terme contribuer à l’amélioration de la situation socio-économique par le biais d’une combinaison de mesures axées sur les domaines suivants : - Consolidation de la société, droits de la personne et droits fondamentaux - Soins de santé - Développement rural, agriculture et environnement - Éducation. Les élections législatives et présidentielles ont installé une stabilité politique pour les années à venir. Ceci devrait permettre un dialogue structuré entre les différents partenaires au développement et le Gouvernement rwandais. La tenue de la conférence des partenaires au
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 9
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
mois de décembre 2004, a été un moment important dans ce dialogue de politique de développement ainsi que l’élaboration continue des plans sectoriels. La Belgique comme un des bailleurs principaux participe activement dans les différents fora de discussions, de coordination et d’harmonisation. Lors de la tenue de la première conférence des bailleurs en 2002, un système de clusters sectoriel a été initié, avec des « institutions leads » pour chaque cluster de la part du Gouvernement et des bailleurs. La Belgique a pris le lead dans le secteur santé et organise également la coordination pour les bailleurs dans le domaine de la Gacaca. L’évaluation de ce système lors de la conférence de décembre 2004, montrait que certains clusters marchent mieux que d’autres et une évaluation et réorganisation éventuelle est prévue pour 2005. Focus de l’appui belge et la politique de santé nationale Focus de l’appui belge La stratégie de la Coopération Belge dans le domaine de la santé est d’appuyer la politique national du Rwanda qui est de promouvoir l’amélioration de la santé de la population en fournissant des soins de qualité continues, intégrés et globaux et ce à travers un système de santé doté de services décentralisés, permanents et polyvalents avec la participation des communautés. La coopération belgo-rwandaise s’articule sur 12: - le maintien de l’appui octroyé depuis le début de la coopération au Centre Hospitalier de
Kigali, qui est devenu un centre de formation clinique pour les futurs médecins et infirmiers jugé indispensable aux districts sanitaires (DS);
- l’appui aux structures de santé décentralisées (DS) avec un accent sur les districts ruraux et urbains de la région sanitaire de Kigali ;
- l’appui à une politique de soins de santé primaires ; - la participation de la population à la prise en charge de sa santé et un appui visant à
améliorer l’accès (géographique et financier) aux soins de santé primaires ; - l’approche transversale et plus particulièrement la santé reproductive et la nutrition ; - l’appui central et intégré à la lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et la
lèpre ; - le développement des ressources humaines et le renforcement des capacités ; - la recherche opérationnelle au niveau des soins de santé primaires ; et - les renforcements des fonctions de planification et de gestion. La coopération favorise le recours par la population aux soins de santé à des centres locaux. Cette stratégie est motivée par un souci de pérennité des efforts effectués dans le secteur de la santé que la coopération déploie depuis de très longues années. Le tableau 1 visualise le focus des interventions belges dans le secteur de la santé au Rwanda.
12 Selon la Note Stratégique Pays pour le Rwanda, de la Coopération Belge (déc 2002).
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 10
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Tableau 1 : Focus de l’appui belge au secteur de la santé au Rwanda Soins de santé
primaires (soins de santé en général
Soins de santé reproductive
VIH/SIDA Maladies transmissibles
International
UNFPA ONUSIDA
National - CHK ; - Appui Institutionnel au MS; - Ecoles Sciences Infirmières ; - Labo de Réf.
- PNILP ; - PNSM ; - Hôpital neuropsych. ; - PNILT
Districts et centres de santé
- Appui aux DS ; - Développement des infrastructures
- SIDA-MSF ; - SIDA en milieu rural
Communautés
* Appui indirect en italique Il convient de signaler que la mission d’évaluation n’a pas pris en considération certains appuis tels que les bourses et stages et ceux fournis par le biais de l’ONG Médecins sans Vacances (MSV). En termes de ressources financières, les soins de santé en général reçoivent 85% de l’aide directe bilatérale, tous niveaux confondus ; 64% des ressources financières pour les SSP vont au niveau national et 36% aux Districts. Tableau 2 : Focus de l’appui belge Soins de santé
en général (SSP)
Soins de santé reproductive
VIH/SIDA Maladies transmissibles
Total
International
National
49% 15% 64%
Districts et centres de santé
36% 36%
Communautés
Total
85% 15% 100%
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 11
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Répartition du budget santé de la Coopération belgo-rwandaise bilatérale (2005)
Appui Inst. MS 313%
Appui DS23%
Santé Mentale 27%
PNILP18%
Labo. Réf. SP5%
Ecoles Sc. Inf. *4%
Dév. Infrastr.13%
CHK27%
L’annexe 4 présente la liste détaillée des interventions appuyées par la Coopération Belge. Résumé de la politique nationale de santé Le génocide de 1994 et la pandémie du SIDA, ajoutés aux autres contraintes structurelles que sont l’enclavement, l’étroitesse du marché intérieur et la faiblesse des ressources naturelles, handicapent fortement le développement du pays et soumettent le secteur de la santé à une forte pression (ressources humaines et infrastructures). Le Gouvernement essaie d’y faire face en s’engageant dans la planification du développement du pays en élaborant deux documents de référence en matière de planification du développement, à savoir la Vision 2020 et la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP). La Politique Nationale de Santé (PNS) s’inscrit dans le cadre de ces deux documents de référence. « La vision à long terme du Rwanda (Vision 2020) met l’accent sur la réconciliation nationale et la sécurité, la démocratisation, la bonne gouvernance et la stabilité politique, le développement des ressources humaines, une administration décentralisée et efficace et l’intégration régionale comme éléments clés pour maintenir la paix et créer la prospérité. … Ses objectifs consistent à faire croître le PIB par habitant d’environ 200 dollars en 2002 à 900 dollars en 2020, à réduire le pourcentage des foyers en dessous du seuil de pauvreté de 65% à 25%, d’augmenter l’espérance de vie de 49 ans à 65 ans et de réduire l’analphabétisme de 52% à 10% ».13
La SRP, élaborée en 2001 selon un processus participatif, a retenu six domaines prioritaires d’action dont celui du développement des ressources humaines et d’amélioration de la qualité de vie, notamment grâce à de meilleures infrastructures sanitaires et éducatives, au planning familial, au meilleur accès à l’eau et aux conditions de logement améliorées. Les
13 Note Stratégique Pays pour le Rwanda de la CB (déc. 2002).
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 12
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
priorités suivantes ont été retenues : malaria, HIV, tuberculose, nutrition, santé reproductive, maladies infantiles, hygiène publique et accès amélioré aux soins de santé primaires. S’inspirant de la Vision 2020 et de la SRP, la PNS s’est donnée pour objectif de promouvoir l’amélioration de la santé de la population en fournissant des soins de qualité continus, intégrés et globaux et ce, à travers un système de santé doté de services décentralisés, permanents et polyvalents avec la participation des communautés. Le Plan Stratégique du secteur de la santé (Health Sector Strategic Plan, HSSP) a prolongé les orientations définies par la PNS en retenant les objectifs suivants pour la période 2005-2009, ces objectifs correspondant aux sept programmes prioritaires14 :
1) L’amélioration de la disponibilité en ressources humaines, 2) L’amélioration de la disponibilité en médicaments, vaccins et consommables, 3) L’amélioration de l’accessibilité géographique, 4) L’amélioration de l’accessibilité financière des populations aux soins, 5) L’amélioration de la qualité et la promotion de la demande de soins, 6) Le renforcement des hôpitaux nationaux de référence et des centres de traitement et
de recherche, 7) Le renforcement des capacités institutionnelles du secteur.
La SRP, la PNS et le Plan Stratégique 2005-2009 ont été élaborés en partenariat avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Ils offrent une vision stratégique commune et servent de support pour la coordination et la concertation des interventions dans le secteur. Cependant, les objectifs de la vision 2020 semblent ambitieux eu égard aux ressources propres du pays et aux ressources extérieures mobilisables. L’utilisation de la note stratégique La note stratégique santé (NS) n’est connue que par quelques assistants techniques belges (dont deux ont participé à son élaboration en 2001 quant ils travaillaient dans l’administration en Belgique). Les acteurs nationaux ne la connaissent pas. Cependant, la note stratégique est utilisée pour l’identification des projets, mais les acteurs belges n’en font pas référence pour la formulation des projets. Ils mettent plutôt en avant le Plan Stratégique national en matière de santé (HSSP 2005-2009) dont les orientations et les priorités sont cependant conformes à celles de la NS. Un débat, souvent passionné, a d’ailleurs eu lieu pendant la mission sur l’opportunité de la NS et de la Note Stratégique Pays (NSP pour le Rwanda) lorsqu’il existe une politique nationale et un plan stratégique en matière de santé conçus de manière consensuelle entre le Gouvernement et ses partenaires. Il en est ressorti la reconnaissance de la pertinence de la NS, qui permet à la CB d’avoir une vision stratégique de ce qu’elle entend entreprendre en matière de santé, fixe les conditions de son engagement, assure la cohérence interne de ses intervention et maximise l’impact sur les systèmes de santé des pays appuyés. Par contre, l’utilité de la Note Stratégique Pays reste encore à démontrer pour les acteurs locaux de la coopération belge, nonobstant le fait que cette note offre la possibilité d’adapter la note stratégique aux spécificités du pays. Il faut rappeler que la NSP pour le Rwanda propose une démarche en deux phases pour le développement de la coopération belgo-rwandaise : d’abord une coopération vers la paix, tenant compte du contexte régional des 14 Plan Stratégique 2005-2009 pour le secteur de la santé, du Gouvernement du Rwanda.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 13
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
grands lacs, puis une coopération dans la paix, permettant de déployer d’autres mécanismes de coopération, notamment l’aide budgétaire. Le contexte d’instabilité dans la région des grands lacs a donc été le fil conducteur de la stratégie belge. Pertinence des interventions d’un point de vue sectoriel et
du partenariat Impact sur le système de santé Are we doing the right thing? Tous les projets/programmes ont potentiellement un impact positif sur plusieurs fonctions du système de santé. Les fonctions essentielles suivantes sont particulièrement appuyées :
• Développement de la politique nationale de santé et la traduction en stratégies nationales de santé,
• Établissement du cadre institutionnel pour la planification stratégique (Appui Institutionnelle au MS, Appui au DS, PNILP),
• Régulation et organisation des ressources humaines en santé, • Amélioration de l’allocation des ressources, • Établissement d’un environnement favorable pour communiquer avec la société
civile, les partenaires (HSCG) et organisations locales. Les fonctions essentielles ci-après sont les moins appuyées :
• Établissement de la législation et fonctions régulatrices. Cependant, le nouveau projet d’Appui Institutionnel au MS consacrera des moyens importants pour appuyer cette fonction ;
• Régulation et organisation du secteur pharmaceutique ; ceci malgré le statut d’actionnaire de la CB dans la CAMERWA et l’appui des formations sanitaires en MEG fourni par divers projets ;
• Établissement d’un environnement favorable à l’utilisation efficiente des ressources ; • Stratégie de financement de la santé, en dépit des efforts fournis pour développer la
mutualisation et la contribution de l’Etat. Les résultats sectoriels suivants sont les mieux appuyés :
• Soins de santé essentiels définis et disponibles • Soins de santé essentiels accessibles • Ressources humaines compétentes et motivées en place • Pouvoir de décision et de gestion décentralisé • Système d’encouragement à la performance en place • Accès aux médicaments essentiels.
NB : Le Ministère de la Santé a initié, avec l’appui de la Coopération Belge, une réflexion sur une stratégie de renforcement des ressources humaines. A cette fin, la CB a déjà réservé dans sa programmation à partir de l’année 2006 une somme de € 8 millions destinée à un « panier Ressources Humaines » ouvert au partenaires qui souhaitent y participer, et qui sera mis en place dans le cadre du plan stratégique de développement des ressources humaines.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 14
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Les résultats suivants ne sont pas suffisamment appuyés :
• Information basée sur l’évidence pour l’amélioration de l’offre de soins • Financement du secteur • Les stratégies établies liées à la santé dans les autres secteurs.
Toutefois, les efforts du Ministère de la Santé, en particulier ceux du Programme National de Santé Mentale en vue de mobiliser les autorités politiques et administratives pour appuyer la santé mentale, notamment au moment où s’est enclenché le processus des juridictions Gacaca, sont à saluer. Toutefois, les problèmes psychosociaux sont énormes et l’extension des services psychosociaux vers les hôpitaux de districts reste un défi. La décentralisation administrative nécessiterait une implication plus intensive du secteur de santé à temps, comme c’est ce dernier qui a déjà une grande expérience avec le transfert des responsabilités du centre vers la périphérie et l’implication des communautés locales dans la prise de décisions. L’opportunité de rapprocher les interventions belges dans le domaine de la santé – notamment les projets Appui Institutionnel au Ministère de la Santé (Santé 3) et Appui aux Districts de Santé d’une part, et le projet Appui à la Décentralisation, appuyé par la CB d’autre part - reste posée15. Si plusieurs groupes de travail technique (Technical Working Groups – TWG) ont été formés (en 2004) sous la tutelle du HSCG autour de différents thèmes transversaux (l’approche contractuelle, ressources humaines, les mutuelles, mapping, planification familiale, contrôle des maladies, intégration des fonds VIH/SIDA dans le système de santé), le financement du secteur de la santé ne fait pas suffisamment l’objet de réflexions conjointes du Ministère de la Santé et ses partenaires. Ici se pose l’opportunité d’un rapprochement au processus de planification stratégique du Ministère des Finances et de la Planification Économique (MFPE), où la CB intervient avec un projet de renforcement institutionnel. L’environnement actuel avec l’arrivée de fonds massifs destinés à la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme, qui vont augmenter énormément les ressources financières pour le secteur de la santé, l’élaboration d’une stratégie globale de financement du secteur 16 basé, entre autres, sur une analyse coût-efficacité des différentes interventions s’impose. Pertinence du partenariat institutionnel Are we doing it the right way? La plupart des projets sont bilatéraux, impliquant un partenariat avec le Ministère de la Santé et une cohérence avec la politique nationale. Le projet Appui aux Écoles de Sciences Infirmières a démarré comme un projet indirect, initié et exécuté par l’APEFE en collaboration avec la Direction de l’Unité de la Promotion de la Profession Infirmière (l’ancienne Division Nursing) du MS ; la CTB a été associée fin 2004. Parmi les quatre projets indirects, deux sont en partenariat avec le Ministère de la Santé : le projet Appui au PNILT (à travers la Fondation Damien) et l’Appui à l’hôpital neuropsychiatrique de Ndera (à travers CARAES). Cette dernière intervention est complémentaire au projet d’Appui au PNSM. Les deux intervenants impliqués dans les autres projets indirects appuient des acteurs locaux dans le domaine du VIH/SIDA, à savoir deux centres de santé dans le district sanitaire de Muhima dans la ville de Kigali (pour le 15 Le lien entre le découpage du territoire et les interventions belges n’est pas évident. 16 La mission n’a pas pu obtenir une copie du document Strategic Issues Paper pour le secteur de la santé, qui va alimenter le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT ; medium-term expenditure framework, MTEF).
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 15
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
MSF-B) 17 et l’Eglise Presbytérienne du Rwanda (pour l’ONG Solidarité Protestante). Ces projets, bien que répondant à un besoin réel des populations concernées (surtout l’IEC et la prise en charge par le VCT, la chimioprophylaxie, PTME, le traitement des infections opportunistes, le traitement par les ARV, l’hospitalisation et la référence des cas graves, l’appui psychologique a certains patients) figurent au rang des nombreux projets avec financement externe dont les relations institutionnelles avec les structures locales et la coordination avec des interventions similaires dans les mêmes zones géographiques sont peu évidentes. Dans le cas du Projet SIDA en milieu rural exécuté par l’EPR, les activités font partie d’un paquet d’activités plus large (la scolarisation, développement rural, etc.) axés sur plusieurs paroisses (point fort) mais elles sont dispersées sur presque l’ensemble du pays, ce qui complique le partenariat avec les structures locales. La cogestion des projets bilatéraux à travers le dispositif des comités de concertation est appréciée par le Ministère de la Santé et la Coopération Belge. Selon certains acteurs, elle constitue un véritable partenariat. Toutefois, le dispositif des Comités de Concertation est lourd en termes de charge de travail (cf. section 7.2). Certains projets/programmes ne font pas de distinction entre les formations sanitaires étatiques et agréées. Pourtant la différence de statuts et de situations financières semble avoir une incidence sur leurs capacités à intégrer les appuis fournis par le MS et ses partenaires et à absorber les ressources mises à disposition. Conséquemment, il existe un écart sur les niveaux de performance des formations sanitaires étatiques et agréées, en faveur de ces dernières. En ce qui concerne l’implication du secteur privé à but lucratif dans l’offre de soins, les expériences sont encore très limitées. En dépit du plaidoyer officiel, le partenariat public/privé reste à construire, même dans le Projet d’Appui au DS de Kigali ville, qui reconnaît son importance mais qui n’a pas pour le moment développé de stratégies à ce propos. Enfin, une des stratégies à poursuivre dans le cadre du développement du partenariat serait de renforcer la capacité des associations professionnelles, notamment à travers l’élaboration de normes et standards, la mise en place des procédures d’agrément, de certification et d’accréditation. A cet effet, le projet de Renforcement Institutionnel pourrait apporter un appui utile. Efficacité et pertinence des interventions par rapport à la
politique nationale et la note stratégique belge Référence aux soins de santé primaires Dans leur ensemble, les projets/programmes qui appuient la production de soins de santé sont cohérents avec la notion d’un système intégré axé sur les districts sanitaires. Toutefois, les programmes nationaux ont des difficultés à s’intégrer harmonieusement dans les systèmes périphériques. Ils sollicitent les mêmes structures qui sont généralement confrontées à des déficits en personnel, ce qui a pour effet d’induire une compétition où généralement ceux qui disposent des moyens financiers et techniques les plus conséquents sortent gagnants. Conscient de ce phénomène, le PNILP essaie d’intégrer ses appuis en collaborant avec d’autres programmes nationaux et en renforçant des compétences (telle
17 A peu près 2/3 des activités de MSF-B au Rwanda sont réalisées dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA. D’autres projets interviennent dans le domaine de la prévention du choléra (dans la province de Cyangugu), la santé reproductive (à Ruhengeri) et la santé mentale (Kigali ville).
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 16
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
que la planification d’activités) qui sont aussi pertinentes pour d’autres programmes nationaux et pour une meilleure offre de soins de santé primaire en général. Cependant, il convient de signaler qu’à part un projet indirect18, aucune des interventions bilatérales ne focalise explicitement sur l’amélioration de la qualité des soins de santé reproductive. En raison de la forte mortalité maternelle (plus de 1,000 cas par 100,000), ce domaine mérite une attention plus marquée. Ceci dit, il faut signaler que plusieurs interventions soutiennent des activités rentrant dans le cadre de la santé de la reproduction (p.ex. Appui au CHK, construction d’une maternité à Kigali, appui aux ESI, appui aux DS) notamment en matière de maternité sans risque et de planification familiale dans le cadre d’un réseau qui est en train de se mettre en place avec la participation de plusieurs acteurs. Par ailleurs, la CB soutient également ce sous-secteur par le biais du UNFPA. Il faut également noter le cas particulier du CHK. Sans être principalement orienté vers les soins de santé primaires, l’appui au CHK renforce le système de santé dans son ensemble. Ceci n’est pas forcément pris en compte par la Note Stratégique. Les SSP faisant partie du système de santé, les interventions de renforcement des autres niveaux du système de santé mais prévoyant un renforcement du niveau opérationnel de ce système, et celles ayant un impact positif sur les SSP, méritent d’être considérées. La note gagnerait à traiter le système de santé comme un tout et à veiller à ce qu’un équilibre soit trouvé pour l’appui aux différents niveaux des soins. Plusieurs indicateurs de la santé se sont améliorées depuis 1995 mais n’ont pas encore atteint les niveaux avant le génocide. Le Tableau 3 présente les indicateurs de performance du secteur retenus dans le Plan Stratégique National pour l’année 2001 et les objectifs de la vision 2020.19 Tableau 3 : Objectifs de la « Vision 2020 » dans le domaine de la santé
Indicateurs Situation 2001 Objectif 2020 Espérance de vie à la naissance (ans) 49 55
Taux de fécondité des femmes 6,5 4,5 Taux de mortalité infantile (pour mille) 110 30 Taux de mortalité maternelle (pour 100 000) 810 200 Malnutrition infantile (insuffisance pondérale en %) 30 10 Taux de prévalence du sida (%) 14 5 Mortalité due au paludisme (%) 51 25 Médecins (pour 100 000 habitants) 1,5 10 Population en bon état d’hygiène (%) 20 60 Infirmiers (pour 100 000 habitants) 16 20 Laborantins (pour 100 000 habitants) 2 5
La baisse dans la mortalité infantile a été modeste depuis la crise, en raison des mauvaises conditions socio-économiques des ménages. La mortalité maternelle a baissé mais avec 1071 cas de morts sur 100 000 naissances vivantes pendant la période 1995-2000, elle demeure plus élevée que celle de la période 1985-1990 (666 sur 100 000) et reste l’une des plus fortes au monde. Les indicateurs liés à la santé reproductive restent très faibles, notamment le taux d’accouchements ayant lieu dans les formations sanitaires (26%) et le taux d’utilisation de planification familiale (moins de 5%). La couverture vaccinale s’est
18 Depuis fin 2003, une équipe de MSF-B met en oeuvre un projet de santé reproductive au niveau de six centres de santé dans le district sanitaire de Gitare, province de Ruhengeri. 19 La liste comprend 23 indicateurs dont 5 relatifs aux ressources (‘inputs’), 4 à la production (‘outputs’), 10 aux résultats (‘outcome’) et 4 á l’impact.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 17
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
rétablie à plus de 85% (DPT3), ce qui reflète la bonne performance du programme de vaccination. Le profil épidémiologique du Rwanda est dominé par les maladies transmissibles qui constituent 90% des motifs de consultation dans les formations sanitaires. Le paludisme est cité comme la première cause de morbidité et de mortalité. A lui seul, il totalise plus de la moitié de toutes les consultations dans les formations sanitaires (entre 1995 et 2003 dont 46% de cas de paludisme confirmé) et 50 à 60% des décès notifiés en milieu hospitalier (dont 36% parmi les enfants de moins de cinq ans). On observe une augmentation des cas de paludisme depuis 1995, qui est liée à plusieurs facteurs : la pluviométrie importante, la densité de la population, la dégradation de l’environnement liée au manque d’assainissement, l’exploitation agricole des marais, et la résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludiques classiquement utilisés. Conscient de ces multiples problèmes, le PNILP se veut un programme véritablement intégré, axé sur deux principales stratégies (la prise en charge des cas de paludisme et la prévention), et qui privilégie toujours des valeurs d’ouverture, de partenariat, de partage, d’échange d’expérience pour un maximum d’impact. L’incidence de la tuberculose (toutes formes) s’étant stabilisée depuis 1999 à environ 7000 cas par an, le programme national (PNILT) est caractérisé par un faible taux de détection surtout parmi les femmes (45 à 50% sur la période 2002-2004, bien au-dessous de l’objectif de 70%) et un taux de guérison insuffisant (9 à 11% de taux de guérison pour un objectif de 85%, 48 à 58% de traitements terminés sur la période 2001-2003. Cette contre-performance est attribuée à plusieurs facteurs : diagnostic payant, faible implication des districts sanitaires (supervision, IEC), problème de suivi des transferts, faible implication de la communauté, de la société civile et du secteur privé, faible lien entres les programmes TB et VIH, système de contrôle de qualité de la bacilloscopie pas assez performant. Le Rwanda est l’un des pays les plus touchés du monde par la pandémie du SIDA : la prévalence du VIH dans la population générale adulte (15 à 49 ans) est estimée à 13,5%. On note un accroissement de la prévalence en milieu rural et une stabilisation en milieu urbain. Le tableau 4 démontre les écarts entre les plus pauvres et les plus riches en termes de couverture et de résultat, signalant l’importance de cibler les interventions destinées aux couches les démunies dans la société. Tableau 4 : Key health sector indicators by poorest and richest quintile in 2000 (HSSP, 2005-2009) INDICATOR Poorest Quintile Richest Quintile Total
A. Mortality Rates
Under five mortality rate (per 1,000) 225 120 196
Maternal mortality ratio (per 100,000) n/a n/a 1071
Infant mortality rate (per 1,000) 121 70 107
B. Reproductive Health
Proportion of pregnant women who receive at least two antenatal visits 66.1 77.3 68.4
Proportion of assisted deliveries by qualified staff 12.1 57.7 31.3
Proportion of deliveries taken place in health facility 20.0 65.2 26.5
Modern contraception prevalence rate (amongst women) 1.2 8.1 4.3
C. Child Health
Proportion of children (12-23 months) immunised against measles 73.2 79.0 77.7
Proportion of children under 5 sleeping under an impregnated mosquito net 0.5 17.9 6.0
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 18
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Prevalence of underweight children (malnutrition) 31.5 13.7 24.3
Utilisation of health services by children under 5 (fever or cough in last 2 weeks) 6.6 26.6 13.4
D. Utilisation of Health Services
% Utilisation of modern health services in the event of illness 10.7 31.1 17.5
% Utilisation of traditional healers 4.2 2.5 3.9
E. Access to Drinking Water
Proportion of households with access to drinking water from a water fountain 37.7 43.7 39.6
Proportion of households within 30 minutes of water source 37.2 50.9 39.9
Proportion of households who have a latrine 56.5 86.7 64.4
Le génocide a eu un effet néfaste sur l’état mental de la population rwandaise, notamment les femmes et les enfants. La fréquentation du Service de Consultation Psychosociales (SCPS) à Kigali s’est triplée en cinq ans (de 3 271 consultations en 2000 à 9 573 en 2004). Les pathologies sont liées à l’épilepsie (40%), des troubles psychiatriques (23%), des troubles psychosomatiques (17%), des troubles post-traumatiques (7%) et autres (13%). En outre, si les différents programmes nationaux et certains projets font de leur mieux pour améliorer la collecte et l’analyse des statistiques sanitaires à fin de suivre leur performance, le système national d’information sanitaire (SIS) reste un talon d’Achille au niveau du Ministère de la Santé. Malgré les efforts déjà consentis pour mettre en place ce SIS, il conviendra d’accélérer l’assistance au Ministère de la Santé 20 pour finaliser les différentes étapes non encore réalisées. La nouvelle phase du projet d’Appui Institutionnelle au MS prévoit un appui dans ce sens, sous l’axe stratégique visant à renforcer les différentes directions du Ministère dans leur effort de développer des outils de gestion pour l’ensemble du système sanitaire. Pertinence des ressources Les premières années qui ont suivi la crise humanitaire engendrée par le génocide ont été marquées par l’urgence de remettre sur pied un pays réduit à néant, tant sur le plan des institutions que des infrastructures physiques et des ressources humaines. Dans le secteur de la santé, la Coopération Belge vient de terminer un programme de développement des infrastructures sanitaires à un coût total € 5 million sur cinq ans. Aujourd’hui les infrastructures sanitaires au Rwanda sont généralement adéquates, avec 385 centres de santé, 34 hôpitaux de district et quatre centres nationaux de référence. Une expansion est en cours dans le secteur privé dans les centres urbains. L’accessibilité géographique est comparable à celle des autres pays dans la sous-région, avec 60% de la population résident à moins de 5 km d’un centre de santé et 85% à moins de 10 km. En général, les ressources financières mises à disposition par la Coopération Belge sont suffisantes pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre des différentes interventions. Elles sont complémentaires à celles des autres partenaires et de l’Etat, même si la faiblesse du
20 Le SIS devrait être appuyé (par la CTB d’ailleurs) dans le cadre d’un projet financé par l’UE qui a commencé en juillet 2004 et qui durera au maximum 18 mois. Au moment de la mission d’évaluation l’état de choses n’était pas clair : il est beaucoup à faire et le temps qui reste semble trop peu. Toutes les directions et programmes nationaux sont concernés et doivent être impliqués dans la sélection et la définition d’une liste restreinte d’indicateurs, le développement des outils performants pour la mise en œuvre du HSPS et des plans sanitaires opérationnels à chaque niveau de la pyramide sanitaire, et le développement d’une base d’analyse croisée avec d’autres outils de gestion qui permettent de suivre et affiner la stratégie national du secteur de la santé.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 19
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
financement étatique du secteur crée une dépendance vis-à-vis des bailleurs en général, et de la coopération belge en particulier. Dans le cadre des projets, les contreparties nationales exigées se limitent souvent à l’apport des ressources déjà disponibles, surtout les salaires des personnels et les infrastructures. Dans de cas rares (approche contractuelle), une contrepartie financière de l’Etat est prévue. Dans d’autres contextes, la contrepartie est confondue avec le budget normal de la structure appuyée (structures de référence, centres spécialisés, programmes nationaux). Renforcement du système de santé Toutes les interventions supportées par la coopération belge contribuent au renforcement du système de santé, notamment le dispositif d’appui pour la coordination, la planification, la gestion, la formation, les soins de référence, et l’encadrement technique disponible au niveau central. Des efforts remarquables et louables ont été fournis par les structures existantes pour apporter l’appui nécessaire aux districts. De même, toutes les interventions s’inscrivent dans une logique historique qui retrace les efforts d’intégration accomplis au cours des différentes phases de mise en œuvre. Cependant, l’absence d’un cadre unique d’intervention ne permet pas de maximiser l’impact de ce renforcement qui, de fait, se fait de manière isolée par chaque projet. Il est donc souhaitable de placer l’ensemble des interventions dans un programme d’appui au système de santé qui assurerait plus de cohérence interne, s’adresserait au système de santé de manière intégrée tout en permettant aux différents projets de développer au besoin des stratégies spécifiques adaptées au contexte de l’intervention. C’est ici que la nouvelle phase du projet de Renforcement Institutionnelle au MS pourrait avoir une valeur ajoutée. Ce programme serait centré sur les SSP, notamment sur le renforcement du district comme entité opérationnelle chargée de la mise en œuvre, de l’appui aux centres de santé et de l’animation de la participation communautaire. C’est aujourd’hui le niveau d’intervention qui a le plus besoin d’appui, où les besoins des populations sont le mieux pris en compte et où l’impact des interventions sur l’état de santé des populations est le plus important. Par ailleurs, l’intégration effective des programmes nationaux dépend du renforcement de la capacité opérationnelle des districts. Un « steering committee » sera mis en place pour débattre des questions importantes relevant de la mise en œuvre du programme et des réorientations souhaitées. Les questions les moins importantes, notamment celles d’ordre opérationnel, seront débattues dans les comités de concertation. Les autres niveaux du système de santé pourront et devront également être renforcés pour un meilleur fonctionnement de l’ensemble du système. En particulier, les fonctions du système de santé aux niveaux intermédiaire et national qui apportent un appui technique aux districts devraient être soutenues (hôpitaux de référence, programmes nationaux). La décision d’appuyer les différentes fonctions pourrait être prise en tenant compte des appuis disponibles de la part des autres partenaires. La position actuelle de la CB comme chef de file des partenaires lui confère des responsabilités supplémentaires, notamment pour s’assurer que les fonctions non suffisamment appuyées soient soutenues par les partenaires. C’est un point fort que la CB appuie des fonctions qui intéressent peu les autres partenaires (le cas du CHK, du programme national de santé mentale et de l’hôpital psychiatrique de Ndera notamment). Une nouvelle stratégie d’appui nécessiterait l’adaptation de la note stratégique. Le schéma suivant démontre le nouveau dispositif d’appui.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 20
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Schéma simplifié du dispositif d’appui
Appui institutionnel au
MiniSanté
Appui aux SSP : DS ruraux et urbains ; CS ruraux et urbains ;
communautés
Centres et hôpitaux de référence
Faculté et écoles de santé
Programmes Nationaux
Appui au niveau intermédiaire
Politique nationale ; Plan Stratégique ; Approches transversales (AC, mutuelles, décentralisation)
Cohérence et complémentarité Depuis 2004 un mécanisme de coordination et de concertation des partenaires a été mis en place sous l’égide du Ministère de la Santé avec deux clusters groups (Santé et VIH/SIDA) et la facilitation de la Coopération Belge comme chef de file pour le secteur santé. Ce mécanisme est bien apprécié par le Ministère de la Santé et par l’ensemble des partenaires. Il a permis de faire des avancées en matière d’échanges d’information et de coordination des interventions des partenaires. Un pas supplémentaire sera fait avec la mise en œuvre
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 21
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
programmée de l’approche sectorielle globale et du panier Ressources Humaines, ce qui devrait permettre de renforcer le cadre de planification et de suivi de la mise en œuvre des interventions, y compris celles de la CB. Cependant, les nombreux groupes de travail (Technical Working Groupes – TWG) qui ont
ous les projets essaient tant bien que mal d’organiser ou de participer sous l’égide du MS à
éponse aux besoins de santé
e pays est couvert par le réseau des Elus de la Communauté de base pour le
e réseau est utilisé par tous les projets et programmes pour l’adaptation de leurs offres de
pact (potentiel sur la santé) intersectoriel
a prise en compte de la multisectorialité est effective au niveau central avec la fédération des
’équipe d’évaluation n’a pas noté au niveau des projets la prise en compte des interventions
urabilité
urabilité technique
été formés sous la tutelle du HSCG et dont deux sont présidés par la CB, bien qu’utiles pour améliorer la coordination de l’aide, sollicitent beaucoup des partenaires et acteurs surtout ceux ayant une faible capacité en ressources humaines. C’est du moins le sentiment exprimé par ces derniers. Un espacement et une meilleure programmation des réunions devraient permettre de surmonter cette contrainte. Tune concertation des différents acteurs intervenant dans leur domaine. Ces acteurs comprennent des partenaires techniques et financiers, des ONG et associations. Toutefois certains acteurs sont de l’opinion qu’ils sont très peu appelés pour alimenter la discussion sur des thèmes transversaux. L’arrivée des fonds supplémentaires dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme, bien qu’elle ait permis de renforcer la capacité des systèmes de santé existants, exige une meilleure coordination pour éviter la distorsion voire le bouleversement de ces systèmes. Le renforcement et la systématisation des cadres de concertation sont donc nécessaires pour améliorer leur efficacité à tous les niveaux (central, provinces et districts). R LDéveloppement (ECD). Des subdivisions sectorielles des ECD existent également : les comités de développement communautaire (CDC) pour les questions liées au développement économique, les comités de santé (COSA) pour la gestion des formations sanitaires, etc. La représentation est également assurée au niveau du district. Csoins aux besoins des populations. Im Lclusters sectoriels (qui répondent tous au Development Partners Coordination Group – DPCG) et avec l’échange entre le cluster santé (HSCG) et le cluster VIH/SIDA ; et au niveau communautaire avec les ECD. Leffectuées dans d’autres secteurs, y compris sur financement de la CB. Tout juste pourrait-on noter l’effort timide de quelques ONG pour développer des activités génératrices de revenues dans d’autres secteurs dans le cadre de la réinsertion des malades guéris ou chroniques. Préoccupations transversales D D
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 22
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Les efforts en cours, dont les résultats sont déjà perceptibles par rapport à certains projets, vont dans le sens de la construction d’une durabilité technique des interventions. L’amélioration de la compétence des personnels par les différentes formations organisées, l’institutionnalisation de l’approche district, la mise en œuvre expérimentale et le début de généralisation de l’approche contractuelle, plus généralement toutes les actions concourant à l’amélioration de la qualité des soins sont des éléments positifs de la mise en place de la durabilité technique. Cependant, certaines interventions, notamment l’appui au CHK, doivent encore fournir des efforts pour améliorer leur durabilité technique, en tenant compte naturellement de la contrainte ressources humaines. A cet effet, « la substitution » ayant cours au CHK devrait progressivement être abandonnée au profit d’une relève programmée par des mises en formation judicieuses et la désignation systématique d’homologues aux assistants techniques. Il y a nécessité de trouver une ligne médiane entre « le piège » d’une perpétuation d’une opération de substitution (pour laquelle les partenaires ne se bousculent pas et de laquelle il faut savoir sortir avec intelligence) et la volonté d’un désengagement progressif pour permettre l’appropriation complète de l’intervention et la capitalisation des acquis par les autorités nationales. L’appui aux ESI gagnerait à s’inscrire dans le cadre d’une réflexion globale sur les ressources humaines, notamment dans celui du Plan Stratégique des Ressources Humaines en cours d’élaboration. Ce plan analysera les besoins en personnels de santé et fixera les orientations en matière pour la dotation du secteur selon des normes à tous les niveaux (centres de santé, hôpitaux de district, hôpitaux de référence, centres spécialisés). Il donnera également les grandes lignes d’un plan de formation global associant les capacités disponibles aux niveaux national, régional et international. Le projet d’appui aux ESI devrait intégrer ce schéma, en s’adaptant aux conclusions du Plan Stratégique national lorsqu’il sera élaboré. La motivation du personnel devrait également occuper une place de choix pour améliorer l’attractivité du secteur et arrêter « l’hémorragie » de ses meilleurs cadres. La CB a permis de créer ou de renforcer des hôpitaux, pôles d’excellence et nouvelles approches dans certains domaines (VIH/SIDA, paludisme, santé mentale, approche DS et approche contractuelle). Ces structures et approches peuvent servir de modèle aux autres structures du secteur. Encore faut-il que ce modèle soit « exportable » à des structures ne bénéficiant pas d’un appui financier et humain conséquent. Durabilité institutionnelle Le renforcement des districts a déjà un impact positif sur la création d’une durabilité institutionnelle au niveau opérationnel et sur l’appropriation de la démarche et des stratégies et approches mises en place par les différentes interventions. La décision du gouvernement, prise dans le cadre du processus de décentralisation, de renforcer le niveau district, qui recevra désormais directement les ressources budgétaires, devrait conforter cette durabilité institutionnelle au niveau opérationnel. D’ailleurs, le nouveau découpage des districts administratifs s’inspirera du ‘modèle’ des districts sanitaires. Il en est de même de la séparation des postes de médecin chef de district et de directeurs de l’hôpital de district dont les attributions viennent d’être définies. Cependant, la suppression récente du niveau intermédiaire, clairement confirmée par le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, risque d’affaiblir l’encadrement technique apporté aux districts, le niveau central ne disposant probablement pas de la capacité nécessaire pour apporter un appui direct à la quarantaine de districts existants. L’appui prévu pour ce niveau devrait être orienté prioritairement vers les structures centrales en charge de l’appui technique aux districts.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 23
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Au niveau central, l’appui aux structures nationales de référence a permis de renforcer la durabilité institutionnelle. L’appui aux structures centrales est sur le point de démarrer dans le cadre du projet d’Appui Institutionnel au MS, Phase III. Il devrait être utilisé pour renforcer non seulement les fonctions essentielles définies au point 5, mais également les structures centrales chargées d’apporter l’appui technique aux districts afin de pallier la suppression du niveau intermédiaire. Cependant, la constitution d’une capacité institutionnelle durable se heurte à une contrainte majeure représentée par la faible disponibilité et la mobilité des personnels. Durabilité financière Comme le montre le tableau 5 ci-dessous, le Gouvernement du Rwanda déploie des efforts importants pour améliorer l’allocation budgétaire au secteur de la santé. Les inscriptions budgétaires en faveur du secteur (non compris les allocations éventuelles du secteur au niveau provincial) ont progressé de 30% par an entre 2003 et 2005. Il semble que le budget de la santé, et plus généralement le budget de l’État s’exécute, bien que la mission ne dispose pas de données y relatives. Par ailleurs, le gouvernement a fait montre de volontarisme pour la mise en œuvre de l’approche contractuelle en inscrivant dans le budget 2005 une contrepartie de FRW 450 millions. Ces actions vont assurément dans le sens de la fondation d’une durabilité financière. Cependant, le chemin à parcourir reste encore long. En effet : (i) La part de la santé dans le budget de fonctionnement de l’État hors provinces reste
encore très faible. Elle est de 3,8% en moyenne annuelle sur la période 2003-2005, bien loin de l’objectif de 12% retenu par le Plan Stratégique de développement 2005-2009 ; par rapport au budget total de l’État, cette part remonte à 5,6% sous l’effet d’une meilleure allocation du budget d’investissement dont la proportion s’établit à 10,7% sur la même période, mais elle demeure éloignée de l’objectif affiché.
(ii) Le secteur est financé à 55% par les ressources extérieures sur la même période. Des efforts importants sont encore nécessaires pour améliorer l’allocation des ressources en faveur du secteur et réduire sa dépendance vis-à-vis du financement extérieur.
Tableau 5 : Quelques indicateurs du financement étatique du secteur de la santé
2003 2004 2005 Moyenne 2003-05
Budget total Minisanté (en €) 16 012 507 23 410 898 40 964 419 26 795 941 Budget total Minisanté (en FRW) 10 728 379 596 15 685 301 464 27 446 160 872 17 953 280 644 Budget total Etat 252 027 871 901 334 545 198 298 368 283 894 924 318 285 655 041 % Minisanté dans budget Etat 4,26 4,69 7,45 5,64 Budget Fonct. Minisanté 7 615 723 408 8 212 688 740 10 536 430 871 8 788 281 006 Budget Fonct. Etat * 186 912 874 671 247 773 518 298 262 463 443 055 232 383 278 675
% Minisanté dans budget Fonct. Etat 4,07 3,31
4,01 3,78 Budget Invest. Minisanté 3 112 656 188 7 472 612 724 16 909 730 001 9 164 999 638 Budget Invest. Etat 65 114 997 230 86 771 680 000 105 820 451 869 85 902 376 366
% Minisanté dans budget Invest Etat 4,78 8,61
15,98 10,67 Masse salariale Minisanté 265 053 485 1 036 572 943 1 240 789 470 847 471 966
Masse salariale totale 42 122 816 030 47 960 741 388 55 042 600 000 48 375 385 806
% Minisanté dans masse salariale Etat 0,63 2,16
2,25 1,75 Biens et services Minisanté 1 118 970 601 3 137 133 895 5 164 667 135 3 140 257 210
Biens et services Etat 35 600 474 069 49 953 829 764 604 499 855 224 230 018 053 019
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 24
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
% Minisanté dans biens et services 3,14 6,28
0,85 1,37 Dépenses exceptionnelles Minisanté 3 015 000 000 1 005 000 000
Dépenses exceptionnelles Etat 41 796 836 407 29 767 966 497 49 625 012 111 40 396 605 005 % Minisanté dans dépenses except. 7,21 - - 2,49
Ressources intérieures 134 922 871 399 138 732 038 298 157 978 367 924 143 877 759 207 Recettes fiscales 110 899 000 000 124 482 038 298 142 483 100 000 125 954 712 766
% masse salariale Etat/recettes fiscales 37,98 38,53
38,63 38,41 Ressources extérieures 117 105 000 502 195 813 160 000 210 305 527 000 174 407 895 834
% budget total financé par Etat 53,53 41,47
42,90 45,20
% budget total financé ressources ext. 46,47 58,53
57,10 54,80 Source : Lois de Finances 2003 à 2005 * Y compris le "net lending" (remboursement à Rwandatel et recapitalisation BCR) et le paiement des arriérés NB : Les prévisions budgétaires du Minisanté ne sont probablement pas exhaustives, une partie des crédits budgétaires pouvant se trouver dans les budgets des provinces Taux de croissance annuel du budget de la santé : environ 30% par an Par ailleurs, une réflexion globale sur le financement durable des soins de santé fait défaut, nonobstant les diverses initiatives développées en la matière, qui semblent d’ailleurs donner de bons résultats (recouvrement partiel des coûts, mutuelles, approche contractuelle notamment). Cette réflexion sur une stratégie globale de financement du secteur en tenant compte du potentiel des trois différentes sources de financement (communautés locales, gouvernement, bailleurs) est de nature à assurer un financement durable tout en cherchant à réduire la dépendance extrême du pays par rapport à l’aide extérieure. De même, l’intégration des notions de coût-efficacité dans les prises de décision et la référence au cadre macro-économique convenu avec l’ensemble des partenaires, notamment pour toutes les décisions à incidence financière, est fortement souhaitable pour éviter d’accroître encore plus la dépendance du pays et préparer « l’après-intervention ». L’approche de lutte contre les maladies transmissibles La lutte contre la maladie est organisée à travers des programmes nationaux placés au sein des directions Centrales du Ministère de la Santé. Quatre de ces programmes nationaux sont soutenus par la CB : SIDA, Paludisme, Lèpre/Tuberculose et Santé Mentale. Ils sont entièrement intégrés aux structures de coordination des programmes et aux directions centrales. Au niveau opérationnel, les programmes sont intégrés aux structures de soins, en dépit de la compétition notée pour l’utilisation des ressources humaines limitées. Les aspects préventifs et curatifs sont intégrés dans les paquets minimum et complémentaire d’activités.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 25
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Partenariats internationaux Dans le cadre du partenariat avec ONUSIDA, l’équipe de la mission résidente ONUSIDA au Rwanda est prise en charge par la CB. Il s’agit du Représentant Résident, du Coordonnateur et du Responsable de la Mobilisation Sociale. Partenariats nationaux Tous les projets essaient tant bien que mal d’organiser ou de participer sous l’égide du Ministère de la Santé à une concertation des différents acteurs intervenant dans leur domaine. Ces acteurs comprennent des partenaires techniques et financiers, des ONG et associations. Néanmoins, le renforcement et la systématisation de ces cadres de concertation sont nécessaires pour améliorer son efficacité à tous les niveaux (central, provinces et districts). Partenariats avec les communautés locales Diverses initiatives sont développées par les différents projets avec des ONG, associations et communautés. Des partenariats entre les ONG internationales et nationales sont également développés avec succès, notamment pour les projets de coopération indirecte (tuberculose/lèpre, VIH/SIDA et santé mentale). Des partenariats ont aussi été relevés entre structures bénéficiaires de l’appui de la CB. Mais c’est surtout au niveau communautaire que les initiatives les plus hardies et les plus structurées ont été relevées, profitant de la disponibilité d’un réseau d’animateurs, de volontaires, relais, ECD et CDC. Cependant, les nombreuses sollicitations de ce réseau de la part des différents programmes nationaux et services ne sont pas de nature à en optimiser l’utilisation. Une approche systémique des besoins en santé communautaire est plus que souhaitable pour rationaliser son utilisation. De même, la systématisation de l’intéressement des membres du réseau (c-à-d. par rapport au bénévolat) pourrait aider à les fidéliser. L’élargissement de l’approche contractuelle (AC) étant en cours, la capitalisation des expériences AC est également souhaitable au niveau de tous les projets de la CB et des autres partenaires intéressés. L’implication des familles, des associations des familles de patients et des ONG est déjà effective au niveau des structures existantes, mais s’agissant d’un domaine où la société civile a une valeur ajoutée certaine à apporter en complément de l’action des pouvoirs publics, une approche plus systématique et structurée est nécessaire pour renforcer le cadre d’intervention mis en place par le MS en concertation avec la Commission Nationale de la Lutte contre le SIDA (CNLS). L’égalité des chances femmes / hommes La prise en compte de la dimension genre n’est pas systématique. Lorsque celle-ci est effectuée, elle ne découle pas généralement d’une analyse rigoureuse et compréhensive. Elle se limite souvent aux indicateurs de couverture. L’implication organisée des femmes dans la conception des programmes n’est souvent pas envisagée mais cette faiblesse est compensée par la présence massive et le dévouement de ces dernières dans les réseaux d’animateurs, de volontaires et dans les structures d’encadrement communautaire.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 26
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
La lutte contre le SIDA La stratégie de lutte contre le SIDA a été intégrée aux SSP : elle vise une prise en charge globale et gratuite du patient. La pandémie du SIDA a des effets déstabilisateurs sur le système de santé, effets qui se traduisent au niveau des formations sanitaires notamment par une sur-occupation des lits d’hôpitaux par les patients VIH/SIDA (p.ex. 80% des lits au Centre de Santé de Kimironko sont occupés par les patients VIH) et une pression sur les personnels de santé. Cependant, l’intervention de la CB, comme celles des autres partenaires intervenant dans la lutte contre le SIDA, a servi au renforcement des capacités des centres bénéficiaires et à l’amélioration de la qualité de l’ensemble des services offerts : extension des capacités d’accueil, renforcement du plateau technique, amélioration de la disponibilité d’un personnel plus qualifié (médecins dans certains cas), amélioration des compétences des agents par la formation et la supervision. Ces centres sont devenus des centres d’excellence qui peuvent servir de modèle aux autres centres de santé dans la prise en charge du VIH/SIDA. Encore faut-il que ce modèle soit « exportable » aux centres de santé ne bénéficiant pas d’un appui financier et humain conséquent. Cependant, il importe de ne pas baisser la garde pour éviter que les fonds colossaux mobilisés dans le cadre de la lutte contre le SIDA et leur utilisation au niveau des formations sanitaires ne conduisent à un délaissement des autres soins de santé de base. La volonté affichée au départ de profiter des ressources mobilisées dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA pour faire bénéficier l’ensemble du système de santé doit être maintenue et même renforcée. Il est souhaitable, en attendant que les mutuelles arrivent à maturité, d’aider les ONG en charge des projets de la CB à assurer la gratuité de la prise en charge des maladies opportunistes, ce d’autant que l’admission aux ARV intervient à un stade avancé (cf. section 7.4). Préoccupations de développement issues de la note
stratégique Développement durable Sans exception tous les projets/programmes s’inscrivent dans la politique nationale de santé, le HSSP et la note stratégique santé de la CB. Le croisement des appuis au secteur de santé par la Coopération Belge et le HSSP démontre clairement l’envergure des interventions de la CB et leur complémentarité à la stratégie nationale (voire Tableau de croisement en Annexe 6). Certains projets appuient d’ailleurs de manière directe l’élaboration et la mise en œuvre des programmes nationaux : les projets d’appui au PNILP, PNSM, PNILT. Cette cohérence avec la politique nationale est de nature à favoriser l’appropriation des interventions et la capitalisation des acquis par les acteurs nationaux. Toutefois, la durabilité technique et financière n’est pas suffisamment assurée. Il se pose la nécessité de renforcer les mesures d’accompagnement et multisectoriels pour appuyer l’appropriation et le financement durable des interventions aux niveaux opérationnels. Les interventions appuyées par la CB ont le potentiel d’appuyer d’avantage la décentralisation
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 27
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
pour une meilleure prise en compte des besoins locaux, la dimension genre et la collaboration intersectorielle. Au niveau national la CB se distingue comme un des partenaires les plus fiables, qui appuie le Gouvernent du Rwanda à renforcer sa capacité de planification stratégique et qui milite pour la transparence et des engagements à long terme du coté du Gouvernement ainsi que des partenaires. Certaines interventions accordent une attention particulière aux aspects environnementaux, notamment du point de vue du traitement des déchets liquides et solides (p.ex. au niveau du Projet Appui au CHK) et de la lutte anti-vectorielle (PNILP). Méthodes et stratégies opérationnelles Les interventions appuyées par la CB utilisent des approches et des méthodes ayant fait leurs preuves et qui sont reconnues au niveau international. C’est le cas, par exemple, pour les protocoles et techniques médicales au niveau du CHK, les protocoles de traitement de paludisme (PNILP), de la tuberculose (PNILT) et des maladies mentales (PNSM), et les activités de lutte contre le SIDA. Un cas remarquable est l’hôpital neuro-psychiatrique de Ndera qui utilise des méthodes modernes – tels que la psychothérapie, l’ergothérapie, la médication – basée sur des critères de qualité de soins et d’organisation bien développés, pour aider leurs clients à surmonter leurs traumas et à regagner leur confiance en soi. En outre, la CB continue à perfectionner les modèles de gestion (gestion de district sanitaire, gestion hospitalière) et des stratégies de financement communautaire, qui attire l’intérêt d’autres intervenants même hors du Rwanda. Le mécanisme de co-gestion et de suivi des projets par les comités de concertation est très apprécié par les différents acteurs pour la responsabilisation des nationaux et la flexibilité autorisée qui permet de prendre des décisions concertées avec diligence sur les ajustements nécessaires par rapport à la programmation initiale. Les membres de l’équipe d’évaluation ont pu constater l’efficacité des comités de concertation en assistant à plusieurs réunions en tant qu’observateurs. Il s’agit clairement d’un point fort qu’il faudrait renforcer. Toutefois, la charge de travail est trop lourde pour les responsables des deux parties participant actuellement à ce mécanisme de concertation. Les procédures administratives limitent l’utilisation effective des capacités techniques des assistants techniques (AT) aussi bien que celles de leurs homologues nationaux. Il convient de redéfinir le dispositif de la cogestion au niveau opérationnel : (i) en limitant la participation aux comités de concertation aux AT de la CTB, à leurs homologues nationaux et aux services compétents de l’administration rwandaise ; et (ii) par la mise en place de régies pour l’exécution par la partie rwandaise de certaines dépenses de fonctionnement. Renforcement des capacités Le Ministère de la Santé accorde une grande importance à l’amélioration de la disponibilité des ressources humaines et au renforcement de la capacité institutionnelle du secteur, qui sont parmi les sept objectifs principaux du HSSP (objectifs 1 et 7, respectivement). Tous les projets appuyés par la CB visent à renforcer les ressources humaines et affectent des ressources importantes à cette fin (voir le tableau en Annexe 7). Le projet Appui aux ESI met son accent principal sur la formation. Toutefois, la compétition signalée pour l’utilisation des ressources humaines, induite par les déficits en personnel, n’est pas suffisamment reconnue par tous les projets. Cette défaillance a inévitablement une incidence négative sur l’impact de l’ensemble des activités de formation. Conscient de ce phénomène, le Ministère de la Santé avec l’appui de la CB est en voie d’élaborer une stratégie de renforcement des ressources
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 28
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
humaines (cf. section 4.1). Cette stratégie prendra en compte les besoins réels du secteur, les mouvements des personnels, la dimension de la motivation et les perspectives de carrière dans un contexte national, sans pour autant dénier le fait que certains facteurs sont liés à la globalisation. Ces facteurs sont hors du contrôle des décideurs nationaux et demande donc une solution au niveau mondial. Deux des projets concernent principalement le renforcement institutionnel : la nouvelle Phase III du projet d’Appui Institutionnelle au MS et le Projet d’Appui aux Districts Sanitaires. C’est cette première intervention qui peut avoir une valeur ajoutée par rapport à l’harmonisation des interventions à des différents niveaux pour le renforcement des capacités du secteur de la santé. Stratégies de financement Plusieurs projets visent à accroître les différentes ressources financières pour la santé, notamment les ressources communautaires (p.ex. les projets Appui aux DS, PNILP) et les ressources extérieures pour le co-financement des programmes nationaux (PNILP, PNSM, PNILT) et les centres de référence (CHK). A l’initiative du MS et de la CB, le HSCG essaie de faire l’inventaire et de suivre les dépenses et les engagements financiers des partenaires, ce qui apparaît une tâche assez difficile. Cependant, il n’y a pas de stratégie de financement globale. La pertinence d’une telle stratégie s’impose avec l’arrivée des différents fonds globaux destinés à la lutte contre la maladie qui méritent de trouver leur place dans le financement du secteur. Il est proposé déjà que le Fonds Mondial (GFATM) vienne appuyer le « panier Ressources Humaines » qui est en voie de construction. La stratégie servira aussi davantage pour protéger les populations les plus pauvres contre des exigences financières inopportunes. Par ailleurs, il est souhaitable, en attendant que les mutuelles arrivent à maturité, de mettre en place un dispositif spécifique pour assurer l’accessibilité financière des patients par un appui conséquent en médicaments pour aider les ONG en charge des projets de la CB à assurer la gratuité de la prise en charge des maladies opportunistes, ce d’autant que l’admission aux ARV intervient à un stade avancé. Il en est de même pour les familles des patients les plus pauvres et ceux souffrant de certaines pathologies lourdes, neurologiques notamment. Actions de plaidoyer En tant que chef de file des partenaires dans le secteur de la santé et un des acteurs principaux ayant appuyé l’élaboration du HSSP, la CB milite très activement pour un échange d’expériences, la transparence des interventions et des engagements de la part des différents acteurs, la réflexion sur des thèmes transversaux et les futures orientations, la coordination des interventions dans le secteur, et l’harmonisation des procédures. Au niveau national, la CB mène ses activités à travers le HSCG (dont elle occupe la co-présidence, conjointement avec le MS) et les TWG (elle assure la coordination de deux de ces groupes de travail). Un des objectifs du HSCG est précisément est de mieux faire cadrer les partenaires avec le HSSP sur le principe de « mutual accountability ». Les travaux du HSCG et des différents TWG se mènent sur la base de Termes de Référence, adoptés vers la fin de l’année 2004. Il est estimé qu’ultérieurement le Gouvernement du Rwanda produira, avec l’appui du DPCG, un document officiel sur la coordination de l’aide extérieure.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 29
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Si le HSCG et les TWG, en principe, offrent à tous les acteurs l’opportunité de participer et de proposer des thèmes qui les préoccupent, il convient de signaler que la plupart des ONG (y inclus MSF-B, APEFE, CARAES) pour le moment ne participent pas encore ou très peu. Par ailleurs, certains thèmes sont aptes à être discutés au niveau des ONG elles-mêmes, notamment entre l’équipe de terrain et leur siège. C’est le cas de la gratuité de soins, provocateur de débats souvent passionnés, que le Gouvernement du Rwanda ne peut pas se permettre. Plan d’action par pays La politique nationale de santé et le Plan Stratégique du secteur de la santé (HSSP 2005-2009) étant adoptés et les appuis de la Coopération Belge s’inscrivant entièrement dans ces orientations nationales, il n’est pas opportun d’élaborer un plan d’action relatif aux interventions de la CB. L’élaboration d’un tel plan serait contraire au principe de l’approche sectorielle. Les autorités nationales aussi bien que les responsables de la CB et les autres partenaires sont unanimes qu’il n’aurait pas de valeur ajoutée. La recherche Plusieurs interventions ont appuyé des activités de recherche dites opérationnelles (Appui au CHK, Appui aux DS, PNILP). Cependant, la pertinence de cette recherche pour la mise en oeuvre d’interventions efficaces/efficientes et pour l’identification et le développement de nouvelles pistes d’intervention n’est généralement pas évidente. Il n‘existe pas de stratégie clairement définie pour l’utilisation de la recherche-action pour soutenir les efforts des projets pour atteindre les résultats qui leur ont été assignés. La plupart des projets de recherche sont conduits par des acteurs externes, souvent belges. L’implication des structures/acteurs locaux dans la conception et dans la mise en œuvre de ces études est nécessaire. Il convient de s’inspirer du ‘modèle’ de la GTZ. Les fonds globaux Le Fonds Mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et la malaria (Global Fund, GFATM) intervient dans le pays avec une enveloppe de US$ 99 millions pour la période 2003-2007 dans les domaines suivants :
• La coordination et le leadership • Le renforcement du partenariat entre la société civile, le gouvernement et le secteur
privé • La dissémination de l’information stratégique • Le monitoring et l’évaluation • La mobilisation des ressources.
D’autres fonds importants interviennent dans le même cadre, notamment l’USAID pour US$ 150 millions (surtout à travers le PEPFAR) et la Banque Mondiale pour $ 30,5 millions (à travers le MAP, Multi-country AIDS Programme). Au total, ce sont donc plus de US$ 280 millions qui sont disponibles sur la période 2003-2008 pour la lutte contre les trois maladies ciblées, à savoir le paludisme, la tuberculose et le SIDA. Les fonds sont essentiellement fournis à travers des ONG et les acteurs impliqués dans les deux projets indirects SIDA appuyés par la CB en profitent (MSF-B pour le Projet SIDA à Kigali ; l’EPR pour le Projet SIDA en milieu rural). Ces fonds constituent une grande
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 30
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
opportunité pour le pays. Cependant, le défi qui reste à relever est de les utiliser pour renforcer, entre autres, le système de santé dans son ensemble, ce d’autant que la pandémie du SIDA a fait naître des besoins énormes en termes d’accroissement de la capacité des structures en charge des soins. Conclusions, recommandations, défis et opportunités La Note Stratégique de la Coopération Belge gagnerait à traiter le système de santé comme un tout et à veiller à ce qu’un équilibre soit trouvé pour l’appui aux différents niveaux des soins. La nécessité d’un cadre unique d’intervention, qui placerait l’ensemble des interventions dans un programme intégré d’appui au système de santé pour plus de cohérence interne et plus d’impact (au-delà du programme indicatif pays), s’impose. La nécessité de créer un lien entre les coopérations technique et indirecte s’impose ; il est notamment souhaitable de lever la contrainte institutionnelle qui semble être à la base de l’absence de coordination. La note stratégique doit s’interroger sur les modalités d’établissement de ces liens, qui sont nécessaires pour assurer la synergie avec les autres interventions dans le domaine. L’opportunité de la création du « desk pays » à Bruxelles pour la coopération indirecte doit être exploitée à cet effet. L’élaboration d’une stratégie globale de financement du secteur de la santé est un défi majeur au Rwanda ; cette stratégie doit prendre en compte l’analyse coût-efficacité des interventions. La canalisation des fonds colossaux mobilisés dans le cadre de la lutte contre le SIDA (et autres maladies) pour renforcer l’ensemble du système de santé constitue également un défi qui doit être relevé. La mission recommande la redéfinition du dispositif de concertation et de cogestion des interventions de la CB directe à deux niveaux :
- Le niveau de projet, qui (i) impliquera les services de l’administration nationale, les AT de la CTB et leurs homologues nationaux, et (ii) inclura la mise en place de régies pour les dépenses de fonctionnement ; et
- Le niveau du programme, qui regroupera les responsables à un niveau supérieur (du Ministère de la Santé, de la CTB et de l’Ambassade) pour discuter et prendre les décisions importantes qui s’imposent pour la bonne marche du programme.
Une souplesse dans l’élaboration des termes de référence de l’AT est souhaitable, notamment celle mise en place au Ministère des Finances et de la Planification Économique (MFPE), et un rapprochement avec les autres interventions de la CB de manière à créer plus de synergie dans les interventions, sont nécessaires. Il est recommandé de veiller à l’implication des structures/acteurs locaux dans la conception, la mise en œuvre et la vulgarisation des recherches/études. Toujours par rapport à la recherche, il y a lieu d’entreprendre des activités de recherche programmées au niveau du district et dans le cadre de l’appui institutionnel en collaboration avec l’École de Santé Publique ou autres acteurs locaux. La coopération entre la GTZ et l’ESP en la matière pourrait constituer un modèle pour la Coopération Belge.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 31
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexes
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 32
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 1 : Tableaux concernant le diagramme d’impact
Fonctions essentielles du secteur public appuyées
Tous projets belges
Autres intervenants
Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
XXX Missions de consultation ponctuelles ; les projets d’appui aux programmes nationaux.
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
Renf.Inst. MS Cycle de programmation à améliorer (tous les niveaux); procédures d’appropriation des plans d’action de district à clarifier
Législation et fonctions régulatrices établies
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Renf.Inst. MS
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Allocation des ressources améliorée
Appui aux DS
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
XXX La GTZ, l’OMS, l’USAID y participent
Pour le parlement : non. La société civile : appui aux structures communautaires. Les partenaires : la CB est le ‘leader’ parmi les partenaires de développement dans le secteur santé. Dans cette capacité elle assume la présidence conjointement avec le Secrétaire Générale du MiniSanté du Health Sector Cluster Group – HSCG. La CB préside aussi deux des groupes de travail (Technical Working Groupes – TWG) qui ont été formés sous la tutelle du HSCG : le groupe Approche Contractuelle et celui des Ressources Humaines.
Politique d’information et système d’information établis
Néant La CB devrait jouer un rôle dans un projet financé par l’UE !
Le Système d’Information Sanitaire (SIS) n’est pas un système intégré et ne répond pas aux besoins des différents acteurs. Plusieurs programmes nationaux opèrent leurs propres systèmes de collecte et d’analyse d’informations sanitaires de manière parallèle.
Stratégies de financement de la santé établies
Plusieurs projets visent à accroître le financement
Absence d’une vision sur le financement du secteur, sous différents modèles et hypothèses.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 33
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Tableau 13
Fonctions essentielles du secteur public faiblement prises en
charge dans le secteur santé Oui / non Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
Oui HSSP et divers plans stratégiques
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie Oui CB : Projet d’Appui Institutionnelle au MS, Appui au DS, PNILP
Législation et fonctions régulatrices établies Non CB : la nouvelle phase du Projet d’Appui Instit consacrera des moyens importants
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé Oui Le MS a initié, avec l’appui de la CB, une réflexion sur une stratégie de renforcement des ressources humaines. A cette fin, la CB a réservé dans sa programmation à partir de l’année 2006 une somme de € 8 millions destinée à un « panier RH » ouvert au partenaires qui souhaitent y participer, et qui sera mis en place dans le cadre du plan stratégique de développement des RH.
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé + / - Pas suffisamment, malgré le statut d’actionnaire de la CB dans la CAMERWA et l’appui des formations sanitaires en MEG fourni par divers projets
Allocation des ressources améliorée Oui
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi Non
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
+ / - Parlement ? Société civile : non structuré (?) Partenaires : HSCG et divers groupes de travail (TWG)
Politique d’information et système d’information établis Non Divers efforts déjà consentis pour mettre en place le SIS ; plusieurs étapes non réalisées
Stratégies de financement de la santé établies
Non Efforts pour développer la mutualisation et augmenter la contribution de l’Etat.
Tableau 14
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 34
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Résultats sectoriels : focus principal de l’appui
du projet Projets belges Commentaires
Soins de santé essentiels définis et disponibles X
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre le secteur public et les secteurs privés
(X) Faible En dépit du plaidoyer officiel, le partenariat public/privé reste à construire, même dans le Projet d’Appui au DS de Kigali ville, qui reconnaît son importance mais qui n’a pas pour le moment développé de stratégies à ce propos.
Ressources humaines compétentes et motivées en place X La conception d’un programme de soutien à un plan stratégique de
développement des ressources humaines et une étude de faisabilité de financement de ce plan à travers un panier commun (basket fund) auquel d’autres partenaires peuvent participer, sont prévues.
Pouvoir de décision et de gestion, décentralisé au niveau approprié X Projet d’appui au DS, notamment
Système d’encouragement à la performance en place X Approche contractuelle, dans le Projet d’Appui au DS
Accès aux médicaments essentiels et approvisionnement assurés X
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins X
Participation du parlement, de la société civile, des partenaires et des communautés locales assurée
X La CB a été désignée le rôle du leader des partenaires dans le secteur de la santé. Création et coordination du HSCG, participation à divers groups de travail technique (TWG).
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés (X)
Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain (X)
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services (X)
Le financement de la santé est efficace (X) A l’initiative du MS et de la CB, le HSCG essaie de faire l’inventaire et de suivre les dépenses et les engagements financiers des partenaires, ce qui apparaît une tâche assez difficile. Cependant, il n’y
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 35
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
a pas de stratégie de financement globale. Le financement de la santé est équitable et juste (X)
Tableau 4
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 36
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Résultats sectoriels faibles ou problématiques Oui / non Commentaires
Soins de santé essentiels définis et disponibles Fort Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre le secteur public et les secteurs privés
Faible Soins pas accessibles à tous. Le partenariat public/privé reste à construire
Ressources humaines compétentes et motivées en place Partielle-ment
Problèmes de motivation reconnus.
Pouvoir de décision et de gestion, décentralisé au niveau approprié Partielle-ment
Système d’encouragement à la performance en place Fort Approche contractuelle adoptée et appuyée au niveau du MS
Accès aux médicaments essentiels et approvisionnement assurés Partielle-ment
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins Partielle-ment
Participation du parlement, de la société civile, des partenaires et des communautés locales assurée
Partielle-ment
Parlement ? Société civile ?
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés
Fort Plusieurs Centre de Santé ont affiché les ‘règles du jeux’
Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain Partielle-ment
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services
Faible Défis
Le financement de la santé est efficace Faible Défis
Le financement de la santé est équitable et juste Partielle-ment
Tableau 5
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 37
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Autres secteurs appuyés Tous projets belges Autres intervenants
Commentaires
Politique et stratégies de population établies Non ?
Politique et stratégies de nutrition établies Non ?
Politique et stratégies d’eau et hygiène établies Non ?
Politique et stratégies de l’éducation établies Oui
Politique et stratégies environnementales établies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
Non ?
Politique et stratégies de sécurité routière établies Non ?
Environnement favorisant un comportement sain en place Non ?
Tableau 6
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 38
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées Coopération Belge M. Dirk Heuts Ministre Conseiller M. Dirk Brems Attaché de Coopération Dr. Dick De Clercq Attaché Santé M. Marc Gedopt Ambassadeur Ministère de la Santé Dr Eliphaz Ben Karenzi Secrétaire Générale Dr Vianney Nizeyimana Direction Planification Directeur de programme Dr Kambanda Direction DRHSA Dr Emilien Nkusi Direction Planification Responsable SIS / HMIS Mme Mary Murebwayire Direction de l’Unité de la Promotion
de la Profession Infirmière (UPPI) Directeur (Chief Nursing Officer)
Dr Louis Rusa Cellule d’Appui à l’Approche Contractuelle
Coordonnateur national
M. Eugène Ingabire Cellule d’Appui à l’AC Superviseur AC M. Michel Matungina
Cellule d’Appui à l’AC Superviseur AC
M. Thomas Budurege Cellule d’Appui à l’AC Superviseur AC M. Emanuel Kamanga Cellule d’Appui à l’AC Superviseur AC Dr Daniel Ngamije PNILP Coordinateur M. François Niyitegeka PNILP Responsable Prise en charge
du paludisme dans la communauté
Mme Yvette Mugurikazi PNILP Chargé de promotion de moustiquaires
M. Donatien Bajyanama PNILP Responsable de l’administration et gestion
M. Francone Murumunawe PNILP Secrétaire de direction Dr Michel Gasana PNILT Directeur de programme M. Gaspard Kabanda PNILT Responsable M&E M. Innocent Habiyambère PNILT Responsable IEC Mme Yvonne Kayiteshonga Desk Santé Mentale Directrice M. Jean-Baptiste Harerimana Desk Santé Mentale Gestionnaire de Projet appui
au PNSM M. Jean-Damascène Iyamuremye
Service de Consultations Psychosociales
Responsable Technique et Administratif
Dr Emmanuel Kayibanda Centre Hospitalier Universitaire de Kigali
Directeur, chirurgien
M. Innocent Gashugi Ville de Kigali Chargé de Santé a.i. Dr Dominique Rwakunda Hôpital de Kabgayi Directeur Dr Georges Ntabashwa District sanitaire de Muhima Médecin Chef M. François Mbonigaba Centre de Santé de Gahanga Titulaire Dr Jean de Dieu Ngirabega District Sanitaire de Ruli Médecin Chef … Centre de Santé de Bilyogo, Kigali
ville
CTB-BTC Dr. Yves Cordier CTB Représentant résident M. Dirk Deprez CTB Adjoint au représentant ;
délégué à la cogestion du projet d’Appui aux ESI
Dr. Jean-Marie Tromme Renforcement institutionnel (Projet Santé 3)
AT, délégué à la cogestion
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 39
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Dr. Marie-Claire Minne Appui au DS AT, Kigali ville Dr. Willy Janssen Appui au DS AT, Kigali Ngali Dr. Werner Vandenbulcke Appui au DS AT, coordinateur approche
contractuelle Dr. Stefaan van Bastelaere Appui au CHK AT, délégué à la cogestion Dr Joseph Vyankandondera Appui au CHK Gynéco-obstétricien M. Alain Vandenbrande Appui au CHK AT M. Johan de Ceuster Appui au CHK AT Dr Bart Troubleyn Appui au CHK Urgentiste Dr. Walli van Doren PNILP AT M. Karel Schuermans PNSM AT, délégué à la cogestion M. Paul Lambers Projet Renforcement Institutionnel
de Processus de Planification Stratégique ; Ministère des Finances et de la Planification Economique
Co-directeur
Projets/programmes et partenaires Mme Martine Toussaint Fondation Damien Coordinatrice du projet
d’Appui au PNILT M. André Tourneur APEFE Coordonnateur au Rwanda Mme Godelieve Kok APEFE (VVOB / Kigali Health
Institute) AT pour le projet Appui aux Ecoles de Sciences Infirmières
Dr Jean-Pascal René MSF-B Coordinateur médical Dr Ludwig de Naeyer MSF-B Médecin au Centre de Santé
de Kimironko Dr Félix Kayihura Eglise Presbytérienne au Rwanda Coordinateur médical Dr …. EPR M. Frank Verhoeven CARAES Coordonnateur régional Dr … Hôpital neuropsychiatrique de
Ndera Directeur
Autres partenaires intervenant dans le secteur santé Dr Dirk van Hove ONUSIDA Représentant résident Dr Diosdado Vicente Nsue Milang
OMS Représentant résident
Dr Mamadou Malifa Baldé OMS Conseiller ICP/EPI Dr Jean Bosco Ahoranayew OMS Conseiller Malaria Dr Celse Rugambwa OMS Conseiller PEV Dr Andreas Kalk
GTZ Conseiller technique principal projets de Santé
Mme Caroline Connolly USAID Responsable santé M. Gianluca Rampolla UN Resident Coordinator’s Office –
UNDP Head of the Aid Coordination Unit
Mme Danila Boneva UN Resident Coordinator’s Office – UNDP
Programme specialist
Autres participants à la restitution du 27 juin 2005 Dr Lazare Agbahoungba Coopération française Conseiller Technique, affecté
à la Dir Épid et Hyg Publique du MiniSanté
David Kamugundu GTZ Conseiller Technique Santé Jean Olivier Schmidt GTZ Conseiller Technique Santé Marie Deblaise MSF-B Chef de Mission Anne Marie Kayitesie CHUK Administrateur
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 40
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 3 : Liste de documents consultés Gouvernement du Rwanda * Government of Rwanda: Vision 2020. * Government of Rwanda (June 2002): Poverty Reduction Strategy Paper. Ministry of Finance
and Economic Planning, National Poverty Reduction Programme. 160 pp * Republic of Rwanda (June 2003): Poverty Reduction Strategy Paper progress report. Ministry
of Finance and Economic Planning, Directorate of Strategic Planning and Poverty Reduction Monitoring. 74 pp
GdR – Ministère de la Santé * Government of Rwanda (Sept 2004): Health sector policy. 18 pp. * Government of Rwanda: Health Sector Strategic Plan 2005-2009. 77 pp. * Enquête Démographique de Santé, 2001. * Plan Stratégique « Faire reculer le Paludisme au Rwanda » 2005-2010 (Janvier 2005). * PNILP : Rapport annuel 2004. * Centre Hospitalier Universitaire de Kigali : Rapports annuels de 2003 et 2004. Coopération Belge – général * DGCI (août 2002) : Note Stratégique Soins de Santé Primaires, 80 pp * CFDD : Avis sur la note stratégique sectorielle sur les soins de santé de base de la DGCI * La Belgique et la lutte contre le sida – Projet de note stratégique, version octobre 2004. 27
pp. * DGCI : Note stratégique genre * Institute of Tropical Medicine (Aug 2003): Mainstreaming HIV/AIDS for an expanded multi-
sectoral approach for the Belgian Development Co-operation. Coopération Belge – Rwanda * DGCD/DGOS (déc 2002) : Note stratégique Rwanda. 44 pp * Coopération belgo-rwandaise (janvier 2005) – Note actualisée. 11 pp. * Plusieurs Conventions Spécifiques entre le Royaume de Belgique et la République
Rwandaise relative à la prestation de coopération des différentes interventions CTB * Plusieurs dossiers d’’ identification et de formulation * Plusieurs dossiers techniques et financiers (DTF) * Plusieurs rapports d’exécution des interventions * PV des rencontres des comités de concertation * Plusieurs rapports d’évaluation et de suivi des interventions Acteurs belges impliqués dans les projets indirects * CARAES, Frères de la Charité : Descriptions des actions 05, 06 et 13 au Rwanda. * Solidarité Protestante : Document de projet « Lutte contre le SIDA en milieu rural au
Rwanda » (6 pp. avec cadre logique). Plans d’action 2003, 2004 et 2005. * MSF-B : Projets MSF-Belgique au Rwanda (décembre 2004). 9 pp. * Fondation Damien : Ondersteuning van het Nationaal Geïntegreerd Lepra en Tuberculose
Programma in Rwanda – Actieplannen 2003 en 2005.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 41
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
* APEFE : Document d’identification (juillet-août 2002), Dossier de formulation (DTF, janvier-février 2003), Rapport complémentaire au DTF (oct. 2004) et Rapport de mission de suivi (mai-juin 2005) du projet « Appui aux Ecoles de Sciences Infirmières au Rwanda ; tous par Dr Florence Parent.
OMS * Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (2005) : Stratégie de coopération de l’OMS avec les
pays – Rwanda, 2004-2007. GTZ * Programme Santé de la Coopération Allemande au Rwanda (janvier 2005) : Rapport Annuel
2004.
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 42
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 4 : Liste des interventions appuyées par la Coopération Belge dans le secteur santé au Rwanda No
Désignation Type de projet Acteur Belge Focus Début – Phase actuelle – Durée
Financement total et par an (phase actuelle)
1
« Appui au Centre Hospitalier de Kigali »
Projet bilatéral CTB / IMT Appui institutionnel / Services de santé
Depuis 1965 ; 2002-2005 4 ans
€ 10.2 m € 2.6 m/an
2
« Appui institutionnel au MS » Projet bilatéral CTB Appui institutionnel Depuis 1995 ; III : 2005-2009 4 ans
€ 4.8 m € 1.2 m/an
3
« Programme d’appui aux districts de santé » - Kigali Ngali, Kigali ville, Kabgayi
Projet bilatéral CTB Services de santé
Depuis 1992 ; mi 2004-2008 4 ans (effectif)
€ 8.5 m € 2.1 m/an
4
« Appui au Programme National de Santé Mentale »
Projet bilatéral CTB Programme de santé Depuis 5/2002 (démarrage effectif) ; II : 7/2005-2008 5 ans
€ 2.7 m € 540,000 /an
5 « Appui au Programme National Intégré de Lutte contre le Paludisme »
Projet bilatéral CTB Programme de santé Depuis 1995 II : fin 2002-2005 3 ans
€ 2.8 m € 930,000 /an
6
« Appui aux Ecoles de Sciences Infirmières »
Projet bilatéral (avec acteur indirect)
CTB en association avec l’APEFE
Formation Depuis ?? 2005-2009 4 ans
2x € 700,000 2x € 175,000 /an
7 * « Appui au Laboratoire de Référence en Santé Publique »
Projet bilatéral CTB Services de santé
Depuis 2003 2003-2007
€ 1,760,000
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 43
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
4 ans
€ 440,000 /an
8 * Projets de Développement des Infrastructures (maternité CHK, hôpital Remera)
Projets bilatéraux
Infrastructure 2000-2005 5 ans
€ 5.0 m € 1,0 m /an
9
« Appui au Programme National Intégré de lutte contra la Lèpre et la Tuberculose »
Appui indirect Fondation Damien
Programme de santé (FD depuis 1960 ; 1 Coopérant depuis 1990 ; 2005-2010, 5 ans)
? (€ 200,000 /an sur fonds propres FD)
10
Projets Santé Mentale : « Appui à l’hôpital neuropsychiatrique de Ndera » ; et « Appui au Centre de Formation »
Appui indirect CARAES – Frères de la Charité
Services de santé / Formation
Depuis 1965 par CARAES ; depuis1998 par la DGCD (??) + Fonds propres
11
« Projet SIDA à Kigali » Appui indirect MSF-B Services de santé Depuis 2002 ; (??)
12
Projet de « Lutte contre le SIDA en milieu rural au Rwanda » (de l’Eglise Presbytérienne au Rwanda, EPR)
Appui indirect Solidarité Protestante
Services de santé (Depuis 2002 ; 2003-2007 ; 5 ans) + Fonds propres
Total : 12 interventions, dont 10 évaluées. No 7 et 9 non évaluées. Evaluations thématiques : Santé mentale (regroupant # 4 et 10) et VIH/SIDA (regroupant # 11 et 12) ‘Fiches projets’ préparées: 8
HERA / Rapport pays Rwanda / Décembre 2005 Annexe 5 - 44
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 5 : Croisement des interventions appuyées par la Coopération Belge et la stratégie national de santé (HSSP)
Tableau X: Croisement des appuis au secteur de santé par la Coopération belge et la Stratégie Nationale de Santé (HSSP)
Coopération bilatérale (direct) Projets indirects
Health sector programme objectives and programme components
CHK
Appui Inst.
MS
Appui DS
PNILPEco
les Sc I
nf.
PNILT
SIDA - M
SFSID
A - EPRHealth sector programme objectives
and programme components
1 Improve availability of human resources1,1 HRD x x x x x N x x x x x
2 Improve availablity of quality drugs, vaccines and consumables2,1 Drugs, vaccines, consumables x x x x x x x x
3 Expand geographical access to health services3,1 Infrastructure, equipment, lab network x x x x x N N,D x x
4 Improve financial access to health services4,1 Health sector financing x x x x
5 Improve quality of & demand for services in the control of diseases5,1 IMCI x x5,2 Reproductive health x5,3 EPI x5,4 Nutrition x5,5 Malaria x N,D,C5,6 HIV/AIDS/STI x x D D,C5,7 TB x N,D x5,8 Epidemics and disaster response x5,9 Mental health prévue N,D N
5,10 Blindness & physical handicap x5,12 Environmental health x x5,13 IEC/BCC x x x x x x
6 Strengthen national referral hospitals and TRC 6,1 National referral hospitals N,D x x6,2 Treatment and research centres x
7 Strengthen the sector's institutional capacity7,1 Institutional capacity N N, D D, C N N N N N N
Les 3 niveaux d'intervention: National (N), Districts sanitaires (D), Communautaire (C )Composante du HSSP sur laquelle le projet met l'accent principalLe projet d'Appui Inst MS prévoit une incidence dans tous les domaines ; autres projets concernent toutes les composantes de l'objectif 5
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 5 - 45
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 7 : Indicateurs de performance du secteur de la santé retenus dans le Plan Stratégique 2005-2009 (HSSP)
INDICATOR WHAT DOES IT MEASURE MEANS OF VERIFICATION FREQUENCY BASELINE 2010 TARGET
NATIONAL LEVEL
INPUT INDICATORS
% of GoR budget allocated to health sector (MoH and provinces)
Government commitment to the health sector
Finance Law Annual 6.1% 12%
Total allocation to health per capita $USD
Effectiveness of financing mechanisms in health sector
National Health Accounts; Public Expenditure Review
2 years $8.25 $16
Health budget execution as a proportion of total budget executed
Efficiency in Government expenditure and capacity absorption
Ministry of Finance annual budget execution report
Annual 6.2% 12%
% of MoH budget transferred to provinces as conditional block grants
Decentralisation in the public health system
Finance Law Annual 0%
Ratio of health professionals (doctor and nurse) to population by province
Availability of health professionals in the public health system
Ministry of Health Annual Report
Annual 1 / 50,000 1 / 3,900
1 / 37,000 1 / 3,900
OUTPUT INDICATORS
Average outpatient attendance per capita per year
Utilisation of public health services HMIS Annual Report Annual 0.33 0.50
% of estimated smear-positive TB cases that are detected and registered under DOTS each year
Efficacy of detection measures PNILT annual report Annual 45% 70%
% of children 6 to 59 months who received one dose of vitamin A in past six months
The coverage achieved through national vitamin A supplementation program effort
Household Surveys (DHS); Expanded Programme of Immunisation
Annual 69 % 85 %
% of health facilities with at least minimum staffing norms by level
Human capacity in health facilities GESPER system Annual 30% 50%
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 5 - 46
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
INDICATOR WHAT DOES IT MEASURE MEANS OF VERIFICATION FREQUENCY BASELINE 2010 TARGET
OUTCOME INDICATORS
Proportion of TB cases registered under DOTS in a given period (e.g. one year) that are successfully treated (cured by confirmation of a final negative smear exam result)
Success of DOTS against TB PNILT annual report Annual 58 % 85 %
Proportion of births attended by skilled health personnel
Extent of women’s use of delivery care services
HMIS; Household Surveys (DHS)
Annual 31% 60%
Proportion of pregnant women who received at least three antenatal care (ANC) visits
Women’s use of antenatal care services
HMIS; Household Surveys (DHS, MICS)
Annual 43.5% 65%
Proportion of youth (15-19) reporting use of condoms in most recent premarital sex
Utilisation of contraception methods Household Surveys (DHS) 4 years 0.3% 10%
Proportion of the population covered by mutuelles (community based insurance schemes)
Measure of financial protection of the population
Mutuelle Executive Secretary Annual 12% 50%
Proportion of children under-five sleeping under insecticide impregnated mosquito net
Measure of malaria prevention Sentinel site surveys; Household Surveys (DHSMICS)
, Annual 18% 70%
Proportion of pregnant women receiving intermittent preventive treatment or malaria prophylaxis, according to national policy
Coverage of IPT among pregnant women
Sentinel site surveys; Household Surveys (DHSMICS); HMIS
, Annual 0% 65%
Proportion of children who have received three doses of DTP under age one
The ability of the health system to deliver a series of vaccinations. It indicates continuity of use of immunization services by caretakers
HMIS Annual 86 % 90 %
Proportion of children fully immunised Success of the immunization program in delivering all recommended vaccines
HMIS; Household Surveys (DHS, MICS)
Annual 78% > 85 %
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 5 - 47
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
INDICATOR WHAT DOES IT MEASURE MEANS OF VERIFICATION FREQUENCY BASELINE 2010 TARGET
HIV prevalence rate 15-49 years Extent of HIV epidemic in the population
Sentinel Site Survey; Household Surveys (DHS)
Annual 5.2% < 5.2%
IMPACT INDICATORS
Infant mortality rate Deaths that are a result of genetic and structural malformations, birth delivery complications and those that are associated with external conditions
Household Surveys (DHS) 4 years 107 / 1000 61 / 1000
Under-five mortality rate The risk of dying in infancy and early childhood and reflects the social, economic and environmental conditions in which children live
Household Surveys (DHS) 4 years 196 / 1000 110 / 1000
Maternal mortality ratio Overall health of the population, the status of women in society, and the functioning of the health system
Household Surveys (DHS) 4 years 1071 / 100,000
600 / 100,000
Prevalence of underweight (weight for age < 2 Z-scores) in children under five years
Malnutrition and more generally the health and nutritional risk in the population
Household Surveys (DHS, MICS)
4 years 24.3% 18%
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 5 - 48
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 6. Rapport République démocratique du Congo
HERA / Évaluation thématique / Décembre 2005 Annexe 6 - 0
HERA HEALTH RESEARCH FOR ACTION .
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Rapport de la mission en
République Démocratique du Congo
Laarstraat 43 tel. +32-3-8445930 B-2840 Reet Belgium fax. *32-3-8448221 Bank No 401-2025551-15 e-mail [email protected]
www.herabelgium.com
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Sommaire
ABREVIATIONS ET ACRONYMES................................................................................................. 4
1 FICHE SIGNALETIQUE.............................................................................................................. 6
2 FOCUS DE L’APPUI BELGE ET POLITIQUE DE SANTE NATIONALE .......................... 7
2.1 FOCUS DE L’APPUI BELGE........................................................................................................ 7 2.2 RESUME DE LA POLITIQUE NATIONALE DE SANTE................................................................. 7
3 L’UTILISATION DE LA NOTE STRATEGIQUE .................................................................... 9
4 PERTINENCE DE L’APPUI BELGE D’UN POINT DE VUE SECTORIEL ET DU PARTENARIAT.................................................................................................................................. 10
4.1 IMPACT SUR LE SYSTEME DE SANTE...................................................................................... 10 4.2 PERTINENCE DU PARTENARIAT INSTITUTIONNEL................................................................ 11
5 EFFICACITE ET PERTINENCE DE L’APPUI DE LA BELGIQUE PAR RAPPORT A LA NOTE STRATEGIQUE...................................................................................................................... 15
5.1 REFERENCE AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES DECRITS DANS LA NOTE STRATEGIQUE .... 15 5.2 PERTINENCE DES RESSOURCES ............................................................................................. 17 5.3 RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE ............................................................................. 19 5.4 COHERENCE ET COMPLEMENTARITE .................................................................................... 20 5.5 REPONSE AUX BESOINS DE SANTE .......................................................................................... 21 5.6 IMPACT POTENTIEL SUR LA SANTE – ASPECTS MULTISECTORIELS ...................................... 22
6 PREOCCUPATIONS TRANSVERSALES ............................................................................... 22
6.1 DURABILITE............................................................................................................................ 22 6.2 L’APPROCHE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES...................................... 25 6.3 PARTENARIATS INTERNATIONAUX ........................................................................................ 26 6.4 PARTENARIATS NATIONAUX .................................................................................................. 26 6.5 PARTENARIATS AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES ........................................................... 27 6.6 L’EGALITE DES CHANCES FEMMES / HOMMES ...................................................................... 28 6.7 LA LUTTE CONTRE LE SIDA................................................................................................... 29
7 PREOCCUPATIONS DE DEVELOPPEMENT ISSUES DE LA NOTE STRATEGIQUE. 29
7.1 DEVELOPPEMENT DURABLE.................................................................................................. 30 7.2 METHODES ET STRATEGIES OPERATIONNELLES .................................................................. 31 7.3 RENFORCEMENT DES CAPACITES .......................................................................................... 32 7.4 STRATEGIES DE FINANCEMENT.............................................................................................. 33 7.5 ACTIONS DE PLAIDOYER ........................................................................................................ 34 7.6 PLAN D’ACTION PAR PAYS ...................................................................................................... 35
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 2
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
7.7 LA RECHERCHE ...................................................................................................................... 35 7.8 FONDS GLOBAL....................................................................................................................... 35
8 CONCLUSIONS ........................................................................................................................... 36
9 ANNEXE 1. TABLEAUX A REMPLIR CONCERNANT LE DIAGRAMME D’IMPACT 39
10 ANNEXE 2. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES .................................................. 50
11 ANNEXE 3. LISTE DE DOCUMENTS CONSULTES.......................................................... 57
12 ANNEXE 4. AUTRES ANNEXES CONSIDEREES PERTINENTESERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 3
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Abréviations et acronymes ASBL Association Sans But Lucratif BCT Bureau central trypanosomiase BCZS Bureau central de la zone de santé BDF Bailleurs de fonds BDOM Bureau diocésain des œuvres médicales CAME Centrale d’approvisionnement en Médicaments essentiels CDR Centrale de Distribution Régionale CE Commission européenne CB Coopération Belge CTB Coopération Technique Belge DEP Direction des Etudes et de la Planification FED Fonds européen de développement FoSa Formation sanitaire GDF Global drug facility (Facilité globale d’approvisionnement en antituberculeux) GTZ Coopération technique allemande HGR Hôpital Général de Référence IEC Information Education Communication IPS Inspection Provinciale de la Santé IST Infections sexuellement transmissibles ITEM Institut technique d’enseignement médical MCZ Médecin-chef de Zone MEG Médicaments Essentiels Génériques MIP Médecin Inspecteur provincial MMN Medicus Mundi Navara MSF Médecins sans frontières MSP Ministère de la santé publique OMS Organisation Mondiale de la Santé ONG Organisation non gouvernementale PATS Programme d'appui transitoire au secteur de la santé PCA Paquet Complémentaire d’Activités PEV Programme élargi de vaccination PMA Paquet Minimum d’Activités PMURR Programme Multi sectoriel d’Urgences de Réhabilitation et de Reconstruction PMPTR Programme Minimum de Partenariat pour la Transition et la Relance en RDC PNAM Programme National d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels PNLP Programme national de lutte contre le paludisme PNLS Programme national de lutte contre le sida PNLT Programme national lèpre - tuberculose PNT Programme National Tuberculose PVVIH Personnes vivant avec le VIH RDC République Démocratique du Congo SANRU Projet de soins de santé primaires en milieu rural SIDA Syndrome de l'immunodéficience acquise SNIS Système national d'information sanitaire SR Santé de la Reproduction SSP Soins de Santé Primaires
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 4
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
TB Tuberculose THA Trypanosomiase humaine africaine UE Union européenne UG Unité de Gestion UM Unité mobile (lutte contre la THA) UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance US$ Dollar américain VIH Virus de l'immunodéficience humaine ZS Zone de Santé
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 5
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Fiche signalétique Nom du pays
République Démocratique du Congo
Projets évalués • Appui à la Direction d’études et de planification (bilatéral / CTB) • Appui au Secteur Santé du Bas Congo (compris au sens large
incluant l’appui bilatéral via la CTB (Inspection provinciale, Centrale de médicaments, District bas fleuve, ZS de Boma et Lukula), l’appui Fometro ex-Solidarité protestante à la ZS Kangu, l’appui à la ZS Kisantu (SLCD / ACORD)
• Appui à la lutte contre la tuberculose (Fondation Damien, APEFE)
• Appui à la lutte contre le SIDA (PNLS / IMT, Projet prostituées MSF)
• Appui à la lutte contre la Trypanosomiase (IMT/INRB, Fometro) • Formation au financement mutualiste (Wereld solidariteit) • Appui à école de santé publique de Kinshasa (VLIR/UCL) • Appui régional à la lutte contre la trypanosomiase (OMS Afro) • Support to reproductive health and gender needs of displaced
populations with special attention to adolescents (FNUAP)
Budget annuel belge d’appui au secteur santé (+) pour les années 2003, 2004, 2005
Aucun tableau de bord ne permet d’apprécier l’investissement annuel consolidé de la Belgique. L’analyse sommaire des engagements suggère des investissements bilatéraux de l’ordre de 10 M€. Aucune donnée n’est disponible sur l’investissement à travers les ONG.
Budget annuel national du secteur santé (+) pour les années 2003, 2004, 2005
Pour l’année fiscale 2004, l’Etat Congolais a budgétisé 55,5 M € dans la santé, soit approximativement 1,1 € par habitant et 15% de son budget. La programmation 2005 est de 68,3 M €, soit 1,4 € par habitant. 80 % du budget de la santé est programmé sur des dépenses de niveau central ; le niveau d’exécution du budget n’est pas connu.
Nom de l’attaché
Dr Martinus DESMET Dr Urbain MENASE (Adjoint)
Partenaire local responsable
Ministère de la santé
(+) En Euro; à spécifier par phase, si nécessaire Nom des évaluateurs
François BOILLOT et Saidou SOULEYMANE
Date de l’évaluation de terrain
5 au 22 Juillet 2005
Documents consultés Liste en Annexe 1
Personnes interviewées
Liste en Annexe 2
Autres sources Néant
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 6
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Focus de l’appui belge et politique de santé nationale Focus de l’appui belge Sur base des liens créés par une riche histoire commune, l’appui de la Belgique depuis le début de l’année 200321 s’inscrit dans une stratégie de coopération vers la paix où la santé est l’une des composantes d’une contribution à l’amélioration de la situation socio-économique. En référence directe avec la Note stratégique sectorielle, la composante santé de cette stratégie se décline en trois axes :
• Renforcement de la politique nationale de mise en œuvre des SSP par un appui au niveau opérationnel (zones de santé – ZS) et d’encadrement
• Renforcement de la lutte contre les grandes pandémies et plus particulièrement le VIH-SIDA, la tuberculose et la trypanosomiase humaine africaine (THA)
• Appui à la recherche médicale (diagnostics, résistance aux anti-infectieux).
Les constats réalisés au cours de l’évaluation permettent de synthétiser l’appui de la Belgique dans la matrice ci-dessous. SSP en général SS reproductive VIH/SIDA Maladies
transmissibles International + (Régional) National ++ ++ +++ Système de soins SSP +++ + (Via
multilatéral) + +++
Communauté + + ++ L’ensemble des projets appuyés s’inscrit dans la matrice stratégique de l’évaluation ; l’appui à la fonction d’études et de planification du ministère de la santé est considéré comme un appui aux SSP au niveau national dans la mesure où ces derniers constituent la pierre angulaire de la politique de santé. Résumé de la politique nationale de santé Aucun progrès socio-économique ne saurait être obtenu au Congo sans une paix durable et l’amélioration significative de la gouvernance. Une stabilisation de la croissance et son orientation en faveur des pauvres d’une part, et un appui aux initiatives de base, complètent le dispositif stratégique du DSRP intérimaire. Selon ce dernier, la période 2002-05 constitue la phase de reconstruction d’un continuum stabilisation-reconstruction-développement. Si les réformes prévues ont été engagées par le Gouvernement de transition, des difficultés dans la mobilisation des moyens tant humains que financiers sont à l’origine de retards dans de nombreux secteurs22. Dans ce contexte, les retards pris dans le secteur de la santé seraient parmi les moindres. Le but de la politique nationale de santé énoncée en 200123 est de promouvoir l’état de santé de toute la population, en fournissant des soins de santé de qualité, globaux, intégrés et continus avec la participation communautaire, dans le contexte global de la lutte contre la
21 Note stratégique République Démocratique du Congo. DGCD, Kinshasa, Décembre 2002 22 Ministère du plan. Second Progress Report on the I-PRSP Implementation and the Formulation of the Full PRSP June 2003-June 2004 23 Politique Nationale de Santé, Décembre 2001
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 7
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
pauvreté. Elle réaffirme la stratégie des soins de santé primaires (SSP) comme option fondamentale ; elle repose sur la zone de santé comme unité opérationnelle offrant un paquet minimum d’activités selon les classiques principes de qualité des soins et des services, efficience et efficacité des projets et programmes de développement sanitaire, coordination intra et intersectorielle des prestations des services de santé, participation communautaire, décentralisation des centres de prise de décisions, déconcentration des services de production des soins, et intégration des services spécialisés au sein des services de Santé de base. Deux options définies pour cette politique annoncent clairement les intentions nationales sur le découpage des Zones de santé (ZS) et la création d’un nombre substantiel de programmes de soins prenant en compte les besoins de groupes identifiés comme vulnérables. Le décret loi-cadre de Juillet 2001 portant sur la santé publique affiche également les intentions de faire correspondre le découpage sanitaire au découpage administratif24. Largement appuyée par des consultants OMS en l’absence de dialogue bilatéral, la formulation de la politique de santé reflète le désarroi des systèmes nationaux devant les grosses tendances multilatérales. La possibilité d’un dialogue politique bilatéral solide et coordonné avec le multilatéral au moment de la formulation de ces orientations aurait probablement contribué à prévenir les vives réactions qu’ont suscité ces éléments de son application. L’appui de la Belgique à l’OMS au niveau international n’a pas permis de pallier cette carence. Le document de politique de santé se limite à formuler des ambitions en matière d’approche et d’organisation administrative du système, ce sur quoi elle est en harmonie avec la Note stratégique. Elle ne propose cependant pas d’orientations en matière de ressources pour réaliser ces ambitions, que ce soit financières ou humaines, ni de rôle pour les différents segments du secteur (paramédical, pharmaceutique, et privé, public, ONG et parapublic). Nulle considération n’est donnée au fossé qui sépare les ambitions des maigres ressources disponibles, de la signification de leur origine (usagers / communauté, APD, ONG, etc.) et ainsi, la politique n’est d’aucun recours pour ce qui concerne les inévitables arbitrages dans un tel environnement. L’approche contractuelle introduite en septembre 2001 jette les bases des relations entre les différentes composantes du secteur, mais n’a pas été plus approfondie que la production d’orientations générales ; le secteur reste donc dépourvu d’un important instrument de coordination interne et externe. Cette approche, initiée par la Commission Européenne a contribué à redéfinir le rôle des ONG puisque dans les programmes de la Banque Mondiale, elles sont passées d’un rôle de maîtrise d’ouvrage délégué à celui de maître d’œuvre au même titre que d’autres acteurs non-étatiques lorsqu’il s’agit de délivrer les services à une Zone de santé. La politique pharmaceutique25 promulguée en juillet 2002 comble en partie cette lacune. Partie intégrante de la politique de santé, elle a pour but d'assurer l’approvisionnement suffisant et l’usage rationnel des médicaments essentiels génériques à des prix accessibles à la majorité de la population. Elle fait toutefois abstraction du contrôle des médicaments, du médicament non générique et du rôle du secteur pharmaceutique privé, et du rôle du médicament dans le secteur de la santé. À travers l’approche de l’Initiative de Bamako, elle établit le rôle du médicament comme vecteur du financement de la santé, permettant ainsi la confusion de la prescription et de la dispensation26. 24 L’engagement d’un dialogue précoce aurait pu par exemple permettre à la Belgique de valoriser son expérience de décentalisation par l’introduction du principe d’intercommunalité pour permettre une gestion territoriale rationelle de biens collectifs. 25 Politique pharmaceutique nationale, Juillet 2002 26 Conflit d’intérêts dont l’analogie la plus proche est en termes de finances publiques celle des rôles d’ordonnateur et de comptable.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 8
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
La formulation d’une politique de financement de la santé27 constitue un résultat direct de l’appui bilatéral de la Belgique (Appui à la DEP). La programmation sectorielle du 9ème FED (env. 100 M€ pour les 4 années à venir) a fourni une analyse critique de sa première version et posé clairement le problème de l’écart entre les ambitions de production de services et les ressources disponibles au niveau des différents tiers, et celui des rôles de ces derniers dans le système. Elle discute également la rationalité de faire reposer sur les usagers – que les enquêtes pauvreté jugent insolvables à près des trois quarts – le financement direct ou indirect (mutuelles) des services de santé. Le 9ème FED appuiera le développement et l’opérationnalisation de la politique de financement en exonérant le médicament de rôle de financement, en institutionnalisant le principe de tiers payant public et en jetant les bases d’un programme sectoriel. Les gains d’efficience à l’intérieur du système de santé que permet d’obtenir l’intégration de programmes y fera l’objet d’une attention particulière. Ces derniers points constituent des orientations fortes de la Note stratégique qui jusqu’ici n’ont pas été portées par l’action de la Belgique. A ce jour, une politique de ressources humaines fait d’autant plus cruellement défaut que le financement du personnel de santé incombe, dans sa quasi totalité, à l’aide externe et aux usagers des services. L’utilisation de la note stratégique Peu connue donc peu utilisée même si référence explicite y est faite dans la Note stratégique Pays (NSP) de 200228, la Note stratégique Santé (NSS) n’apparaît aujourd’hui connue qu’au niveau du Bureau des Attachés de l’Ambassade29. La grande majorité des projets et la politique de santé y fait cependant une référence empirique, dans la mesure où la note traduit la pensée de l’ « école belge » en matière de coopération sanitaire, qui s’est largement développée au Congo et dont un nombre important d’acteurs sont imprégnés. Un certain nombre de points ressortent des discussions individuelles ou de groupe avec les acteurs des différents niveaux en ce qui concerne le contenu de la NSS :
• Sur le principe, la finalité d’une NSS n’est pas évidente : Est-il cohérent de produire une note sectorielle quand les appuis à un secteur doivent suivre les politiques nationales ? Une NSS est-elle un instrument permettant de guider l’investissement dans le cadre du développement d’une NSP (L’investissement dans un secteur serait autorisé si les orientations de développement de ce secteur sont globalement conformes aux principes de la NSS) ? Une NSS est-elle un instrument d’aide à la formulation de stratégies par un dispositif de coopération sectorielle ? Dans ce cas, s’agit-il d’un document stratégique ou plutôt d’un référentiel de « bonnes » stratégies (par analogie avec un guide de bonnes pratiques) applicables à différents contextes ?
• Sur le contenu, la NSS apparaît de peu de recours pour ce qui concerne les enjeux de développement sanitaire en RDC qui se situent :
o Au niveau de la transition entre urgence, réhabilitation et développement, comme développé dans le DSRP-I, ainsi que de coopération avec un « Etat fragile »30 31
27 Politique et stratégies de financement du secteur de la santé (Septembre 2004) 28 Note stratégique République Démocratique du Congo, DGCD, Décembre 2002 29 L’un des attachés étant lui-même un des auteurs de la note 30 Selon les termes du discours prononcé par le Ministre De Decker au Sénat à l'occasion du colloque sur les OMD le 7 mars 2005. 31 OECD : PRINCIPLES FOR GOOD INTERNATIONAL ENGAGEMENT IN FRAGILE STATES - Learning and Advisory Process on Difficult Partnerships (LAP) DRAFT, 04-07-2005
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 9
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
o Au niveau des politiques de ressources (ressources financières, humaines, techniques / technologiques, partenariales…), dans un contexte de grande pauvreté de la population,
Pertinence de l’appui belge d’un point de vue sectoriel et
du partenariat Impact sur le système de santé La qualification de l’impact global de l’appui de la Belgique au secteur santé découle de l’analyse sur le type d’appui sur chaque point du Diagramme d’impact sectoriel, proposée à l’annexe 1. Elle peut être résumée comme suit :
• Disponibilité et accessibilité des services de base dans les aires couvertes par les projets belges (ex. projets visités de CTB, SLCD/ACOR-D, Fondation Damien, Solidarité mondiale, Fometro, Solidarité protestante)
• Début de traduction de la Politique de santé en stratégies (actions directe de l’Ambassade, projets CTB) et de développement d’un cadre stratégique de planification (projets CTB)
• Disponibilité de personnel de santé et de gestion compétent et motivé – Formation de base et continue, primes de performance, en complément pour mémoire d’un appui à la réforme de la fonction publique, mais pas d’approche globale de développement des ressources humaines (VLIR/UCL, APEFE, tous appuis aux ZS, IMT)
L’impact constaté aujourd’hui est essentiellement de type humanitaire (financement et encadrement de la production de services de base) et relativement peu structurel. Des raisons d’ordre conjoncturel (transition) expliquent pour une large part cette situation et la Belgique est le seul partenaire bilatéral à avoir repris un appui institutionnel suivi au niveau central32. Tous les appuis sont aujourd’hui confrontés à trois problèmes majeurs qui seront examinaés plus en détail au chapitre consacré au développement durable :
• Faible légitimité de la tutelle de l’Etat • Fortes tensions sur les ressources humaines • Viabilité financière limitée du secteur
De manière plus générale, l’impact de l’aide belge peut se résumer comme suit : Cadre légal et juridique : Il a peu évolué depuis l’indépendance, conséquence des années de déficit d’Etat de droit et constitue donc un héritage belge. Il s’agit d’une faiblesse mais non d’une priorité tant que le régulateur reste largement financé par le régulé (système de l’ « ascenseur33 »). Planification stratégique : Des aspects fondamentaux de planification stratégique déjà anciens comme le concept de Zone de santé, le Paquet minimum d’activités (PMA) de premier niveau et le Paquet complémentaire de ddeuxième niveau doivent beaucoup à l’appui belge sur un plan historique. Dans un passé récent, la Belgique a fourni des appuis considérables à la fonction d’études et de planification du ministère, dont l’efficacité en
32 Les conséquences d’un appui multilatéral ponctuel (OMS) sur le développement de la politique de santé ont été évoquées plus haut. 33 Financement des pyramides prestataire et gestionnaire par des quotes part prélevées sur les paiements des usagers.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 10
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
matière de production de plan de développement sanitaire a été sapée par une politique de santé porteuse d’une structure trop complexe et qu’il n’a pas été possible de modifier, et par la difficulté d’en stabiliser les cadres de direction. Ressources humaines : La Belgique est un des partenaires le plus engagé dans le domaine à travers sa coopération directe et indirecte, et l’impact de l’aide belge au niveau de la formation est unanimement reconnu. « L’école belge » marque de manière sensible nombre de cadres nationaux impliqués dans différents dispositifs de coopération. Du fait de son implication dans la planification sanitaire et la réforme de la fonction publique, un engagement accru de la Belgique dans le développement des RH aurait une forte cohérence interne pour l’aide belge ; les partenaires locaux et internationaux lui verraient par ailleurs un indéniable pertinence au niveau sectoriel et il serait complémentaire de l’appui de la CE au financement de la santé Pharmacie et médicament : L’engagement de la Belgique dans ce domaine est récent et n’est pas porteur d’une valeur ajoutée majeure en termes de développement sectoriel. L’organisation du secteur est à ses débuts et fait ressortir d’importants problèmes de gouvernance créant conflit des bailleurs avec le Ministère (« Affaire SAFARCO »). L’implication aux niveaux politique et central sont nécessaires en complément de l’action sur la disponibilité du médicament. Environnement pour communiquer entre partenaires : Si les bailleurs saluent les efforts belges en matière de coordination de l‘aide externe en particulier à travers la réactivation du Groupe thématique santé, c’est l’appui à la Table ronde sectorielle de 2004 qui constitue pour les partenaires nationaux la principale réalisation belge dans ce domaine. Il est important que la Belgique puisse également aider le Ministère de la santé à en effectuer le suivi des recommandations Stratégies de financement : L’appui à la DEP a jeté les bases de la politique de financement de la santé et a fait admettre le principe de sa nécessité. Les projets belges évalués manquent de vision d’ensemble de la problématique du financement en se concentrant sur des points précis mais sans réelle cohérence économique d’ensemble. Le problème de solvabilité est constamment cité comme aigu, au niveau de la demande de soins mais aussi au niveau de la contribution à une assurance/mutuelle. La réponse à ces derniers points propose la création d’activités génératrices de revenu. L’intégration de tels objectifs dans les programmes de santé est pertinent d’un point de vue social, mais peu cohérent d’un point de vue de développement durable car déliée de l’action dans les secteurs responsables du développement socio-économique. Systèmes d’information : Le SIS fonctionne au niveau des provinces et des zones appuyées, en particulier par la Belgique, mais reste en cours de standardisation. Pour mémoire, c’est une ONG belge qui appuie le développement du SIS au niveau central (CEMUBAC, financement FED). Le développement d’un système d’information gestionnaire est à un stade préliminaire. La construction de tableaux de bord rapprochant ressources et production de soins est inscrite au programme santé du 9ème FED, comme composante de l’amélioraiton de l’allocation et de l’utilisation efficiente des ressources. Pertinence du partenariat institutionnel « De tous les partenaires du Congo, la Belgique est le partenaire qui possède l’histoire commune la plus riche avec cette grande nation. Comme telle, la Belgique a un devoir de lecture scrupuleux des vœux de son partenaire. Cette lecture doit inciter le partenaire Belge à être rigoureux dans l’interprétation des sollicitations de développement durable du Congo
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 11
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
et donc de répondre favorablement à certaines demandes d’appui où d’autres partenaires manifesteraient davantage de prudence.34 » Depuis l’avènement du Gouvernement de transition, le Ministère de la santé est le principal partenaire de l’aide directe Belge dans le domaine de la santé. Auparavant, le ministère était déjà le partenaire principal de l’aide indirecte, la majorité des projets relevant de la prestation de services de santé dans le cadre des ZS ou de programmes de lutte contre la maladie. Si ce partenariat est logique, son fonctionnement s’est heurté jusqu’ici à une double contrainte. Du côté du partenaire Congolais, les limitations à l’exercice de la tutelle et à la maîtrise d’ouvrage sectorielle et l’instabilité du portefeuille de la santé ont sans aucun doute gêné le développement d’un dialogue politique soutenu et efficace. Du côté du partenaire Belge comme du reste de l’ensemble des partenaires, le développement d’un dialogue politique sectoriel (développement d’une bonne gouvernance) a cédé le pas à l’organisation des élections (stabilisation). Les différents partenaires interviewés reconnaissent la valeur ajoutée pour construire le dialogue politique d’une double compétence technique (développement sanitaire) et diplomatique au niveau de l’Ambassade. L’Université de Kinshasa est le partenaire logique des programmes de formation en santé ne relevant pas du ministère de la santé. Dans un pays comme le Congo où sont déployés d’importants projets multilatéraux l’impact de l’aide belge est affectée par son montage institutionnel. Au sein du dispositif Belge la CTB opère selon les modalités de coopération directe selon un statut de maîtrise d’œuvre (liberté de choix restreinte de l’objectif spécifique, financement à 100% des projets), alors que les ONG belges interviennent en maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la coopération indirecte (importante liberté de choix de l’OS, cofinancement des projets). Dans le cadre des programmes de la BM ou de la CE, CTB et ONGs sont confondus dans la catégorie d’acteurs non-étatiques et se voient confiés des missions identiques en seule maîtrise d’œuvre. Certaines missions communes aux deux types de dispositifs (ex. appui aux ZS, mise en œuvre de centrales de médicament, etc.) ne justifient pas que des contraintes distinctes pèsent sur les différents types d’opérateurs, quand aucun élément objectif lié à la performance ne justifie par ailleurs cette différence. On peut s’interroger sur l’équité au niveau belge d’accepter de facto une concurrence des acteurs non-étatiques sur des mêmes missions quand les opportunités d’accès aux mêmes financements sont inégales. La justification de projets bilatéraux d’appui aux ZS par la production de coûts paramétriques permettant d’améliorer la planification est limitée car ces derniers peuvent être obtenus à moindre coût par l’analyse économique de ZS déjà fonctionnelles, y compris mises en œuvre par la coopération indirecte. Quand les interventions sont géographiquement voisines, cela peut être perçu comme inéquitable par les bénéficiaires (ex. ZS de Lukula et Kangu au Bas Congo). L’intervention en maîtrise d’ouvrage de la coopération indirecte laisse en pratique à la DGCD/ Ambassade un choix limité sur les sites et l’objectif, exposant au risque de « saupoudrage » de l’aide et affectant la cohérence du dispositif de coopération. Cette dispersion affecte également le développement de la coopération puisque des nouvelles interventions sont identifiées en appui à certaines zones
Appui par les opérateurs belges au développement des ZS :
1 mission, 3 types de montages institutionnels: ASS BC (CTB) : Financement direct à 100% ZS Kisantu / BDOM (Caritas) : Impératif de cofinancement accentuant la contrainte gestionnaire pour le partenaire local Caritas-B Kasai Occ. : Impératif de cofinancement compliqué par la seule possibilité de réunir un bailleur généraliste (PATS, CB) avec un bailleur thématique (Unicef).
34 Coopération Belgo-Congolaise : Etat des lieux de la coopération dasn le secteur de la santé au Congo et indications de coopération bilatérale directe future. DGCD, Kinshasa, Octobre 2002. p.11
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 12
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
d’appui historique (ex. développement de centrales de distribution régionales de médicaments en Equateur / CTB) alors que le ministère souhaiterait regrouper géographiquement l’investissement des bailleurs pour en améliorer la cohérence. Dans d’autres cas, la combinaison sur une même action d’une aide directe et indirecte fait peser sur le bénéficiaire direct une contrainte inutile et affecte l’efficacité même de l’aide (ex. appui à la lutte contre la tuberculose). Il est donc important que la DGCD clarifie ses modalités d’intervention. Se rajoute à ces contraintes le fait que les agences des Nations Unies au financement desquelles contribue la Belgique, développent de par leur vocation (enfance, population, maladies) où l’opportunité des actions qui, au delà de l’éparpillement commun des interventions, ne peuvent statutairement couvrir l’ensemble des besoins et sapent donc les efforts d’intégration par des appuis verticaux sur leurs thèmes. Une contrainte similaire s’observe lorsque ces agences sont utilisées par les ONG pour le montage de leurs cofinancements. Tableau 15: Evolution du partenariat autour du Programme tuberculose à travers les financements entre 2001 et 2004 (montants en US$). Les partenaires Belges sont en italique
Sources Financement 2001 2002 2003 2004 2005 Gouvernement 125 106 297 288 318 792 1 930 000 1 500 000 Oms 62 000 39 500 23 000 30 000 25 800 Global Drug Facility 1 400 000 1 400 000 1 400 000 Fonds MONDIAL 4 502 226 1 904 569 1 566 209 Banque Mondiale 300 000 Fondation Damien (FP,UE, C.Belge)
3 055 560 2 982 533 3 354 767 3 279 825 3 443 816
TLMI / Sol Prot (Coop Belg)
230 000 340 000 197 800 135 000 135 000
American Leprosy Mission
125 000 125 000 125 000 125 000 125 000
Alti (Ituri) 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 Sanru (Usaid,Ecc) 662 750 1 321 500 876 000 1 046 500 Usaid (Tbcta) 475 000 777 000 500 000 Lnac (UE) 125 000 125 000 200 000 Cooperation Belge (Bilaterale)
1 398 500 837 000
APEFE 15 000 TOTAL 3 822 666 6 847 071 12 285 085 11 628 894 8 729 325 Certaines ONG locales (ex. BDOM) ont développé une capacité propre à formuler et présenter des projets. Dans ces cas, la valeur ajoutée d’un partenariat avec une ONG belge repose largement pour ce qui concerne le domaine sanitaire stricto sensu sur la possibilité de mobiliser la contrepartie exigée par les règles de financement indirect, ce qui est vu davantage comme une contrainte car l’appui sert au financement de services dans le cadre de la politique nationale. La valeur ajoutée perçue se situe davantage sur des appuis à la marge du domaine sanitaire tels que la solvabilisation de la demande de soins directe ou indirecte (mutuelles), ou l’accès à des programmes d’enseignement. Le partenariat local est mis à l’épreuve par le principe de primes versées dans le cadre des projets. On peut en effet discuter l’autonomie de partenaires institutionnels qui perçoivent une rémunération de la part de projets belges, a fortiori si, dans le cadre d’encouragements à la performance cette rémunération est liée à l’observance de prescrits du maître d’ouvrage…
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 13
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Cette distorsion commence à se rencontrer dans les partenariat avec des communautés locales, où des représentant jusqu’ici bénévoles demandent à bénéficier de « primes ». Compte tenu des difficultés de financement des salaires de la fonction publique, il n’est pas exclu dans un tel contexte que le partenaire Congolais subisse des tiraillements internes entre des groupes bénéficiant de primes de l’aide externe et appuyant le partenariat international, et d’autres bénéficiant de partenariats privés locaux et les encourageant par conséquent (cf. le contentieux SAFARCO35). En marge des partenariats locaux, l’OMS est partenaire pour un projet régional (lutte contre la THA) et le FNUAP est partenaire pour un projet local (santé génésique chez des déplacés adolescents). Sur ces deux projets, les agences des Nations unies sont et maître d’ouvrage et maître d’œuvre, et la Belgique financeur. La mise en œuvre d’un projet régional OMS sur un thème où la Belgique offre une compétence indéniable ne pose pas de problème. On peut s’interroger sur la pertinence d’une mise en œuvre par le FNUAP d’un projet de santé génésique dans la mesure où des opérateurs belges disposent de ce type de savoir faire et où une mise en œuvre directe par une agence des Nations unies ne présente pas de valeur ajoutée évidente. Paradoxalement, la Belgique n’a que marginalement développé un partenariat formel avec le dispositif de l’Union Européenne qui devrait constituer un partenariat naturel pour un Etat membre, en particulier dans le cadre de la transition Urgence-Réhabilitation-Développement36. Seul l’appui à l’Ecole de santé publique / Université de Kinshasa a pu utiliser ce partenariat de manière stratégique. Le dialogue entre Etats membres et services de la Commission vient d’être revitalisé par le bureau des Attachés. Le développement de la tutelle et de la maîtrise d’ouvrage sur le secteur constitue un axe fort de la programmation Santé du 9ème FED et des synergies pourraient être développées à ce niveau.
35 La concession par le ministère de l’approvisionnement public en médicaments au groupe privé SAFARCO alors qu’il s’engageait parallèlement avec les bailleurs à développer le système FEDECAME/CDR (fédération de centrales publiques de médicaments) crée un contentieux qui perturbe fortement le dialogue politique. 36 Resolution du conseil UE N° 10641/93, section D.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 14
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Efficacité et pertinence de l’appui de la Belgique par rapport
à la note stratégique Référence aux soins de santé primaires décrits dans la note
stratégique Comme cela a été discuté plus haut, la connaissance implicite des grandes orientations de la NSS et par les acteurs belges et par le grand nombre d’acteurs congolais formés à l’école Belge a pour conséquence une bonne cohérence globale des projets avec cette dernière et la politique de santé, avec une bonne prise en compte des contraintes de l’environnement local. L’ensemble du dispositif de coopération reflète bien la priorité donnée aux SSP par la NSS et les projets intègrent non seulement la prestation au niveau des ZS (ZS Lukula, Boma, Kangu, etc. ) mais aussi leur encadrement ou l’approvisionnement en médicaments (ASSBC / CTB). De la même manière, un accent important est mis sur la lutte contre le VIH/SIDA (Appuis au PNLS CTB et IMT, Projet prostituées MSF) et sur la lutte contre les maladies transmissibles (lèpre et tuberculose) et négligées (THA) (Appuis au PNLT Fondation Damien, Solidarité protestante, APEFE, CTB), Appui au PNTHA (Fometro et CTB). Les tableaux ci-dessous illustrent de manière synthétique les progrès réalisés au Bas Congo, province où l’aide belge est relativement concentrée. Des résultats spectaculaires sont obtenus en matière de lutte contre la lèpre et la tuberculose non seulement au niveau des services mais également de l’équité de la distribution des bénéfices et de l’intégration des programmes. L’importance de cette expérience apparaît mésestimée dans la dynamique de développement sectoriel. L’absence d’appui institutionnel belge au niveau de cette valorisation en porte une part de responsabilité importante quand l’accent est mis sur la fourniture de services intégrés. L’appui à la prise en charge du SIDA n’intègre pas le lien avec la tuberculose qui en est la principale infection opportuniste. A l’exception du projet de prise en charge de la santé génésique chez les adolescents réfugiés (FNUAP) qui est spécifique, la prise en charge de la santé de la reproduction apparaît intégrée et ne fait pas l’objet d’un accent ou d’une priorité particulière. Les aspects IST sont pris encharge par le programme SIDA et la santé de la reproduction dans le cadre des SSP. Au Congo, le problème démographique est moins criant que dans des pays voisins comme le Rwanda. La faiblesse du SIS au niveau national ne permet pas d’évaluation du secteur selon critères des OMD. La production et la standardisation d’un tableau de bord sectoriel sont au programme du volet santé du 9ème FED.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 15
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Tableau 16: Sélection de quelques résultats significatifs de l’Inspection sanitaire du Bas Congo entre 2000 et 2004
2000 2001 2002 2003 2004 Utilisation soins curatifs (Nr contact /Pop.an) 0,21 0,12 0,31 0,49 0,63 Utilisation Consult Prénat. 46% 40% 74% 75% 78% Utilisation Consult Préscol. 17% 22% 30% 35% 21% Inscription Consult 0-11 mois) 68% 12% 106% 80% 88% Tx Décès Maternel Hospitalier (/100000) - 500 275 320 289 % Faible poids à la naissance - 12% 11% 9% 7,9%
Couverture DTC3 54% 38% 66% 75% 87,0%
Tx de détection BK + (/100000) 94 137 135 155 192 Tx de guerison BK+ 68% 69% 78% 80% 85%
Nouv Cas Trypano et taux d’infection
816 (TI 0,42)
736 ( TI 0,42 )
760 ( TI 0,52 )
522 ( TI 0,29)
279 (TI 0,16)
Prop. Nouvelles acceptantes PF 0,03% 0,50% 7,5% Source SIS Inspection sanitaire Bas Congo Tableau 17: Comparaison de quelques indicateurs de couverture sanitaire entre le Bas Congo et certaines provinces de l’Est en 2004
Taux Consultation curative
Taux Consultation prénatale
Taux Consultation < 1 an
Couverture DTC3
Nord Kivu 0,40 73% 72% 65% Orientale est* 0,38 76% 101% 42% Orientale centre* 0,38 55% 73% 31% Kasai Or.* 0,01 58% 74% 65% Bas Congo 0,63** 78% 88% 87%
ZS Kisantu 0,43 88% 153% 104% Sources : IPS Bas Congo et Etude de faisabilité 9ème FED * Données consolidées de projets du PATSII, le SIS provincial n’étant pas fonctionnel ** Il existe au Bas Congo entre les ZS une confusion entre l’indicateur brut (Nbre de consultations par an et par habitant) et le degré de réalisation de l’objectif provincial de 0,5. Dans ce dernier cas, un taux de 40% correspond à une réalisation de 75%. Cette confusion explique que l’indicateur soit élevé. La réalité est probablement inférieure ou égale aux valeurs observées à Kisantu qui est une zone pilote fonctionnelle depuis déjà un certain temps.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 16
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Pertinence des ressources Comme cela a été vu plus haut, les usagers qui ont longtemps assuré le financement de la prestation et de la gestion du système ne peuvent plus assumer ce rôle. La dépense publique est engagée à 80% au niveau central de manière opaque par le Cabinet et son niveau d’exécution n’est pas connu précisément37. Dans ces conditions, le financement du système est très dépendant de l’aide externe. Une approche générale de type Reconstruction manque de pertinence car les processus n’ont jamais existé de manière homogène et performante sur ensemble du territoire, essentiellement déjà par manque de ressources. Les infrastructures datent souvent de l’époque coloniale ou juste post et ne sont pas forcément dimensionnées à l’organisation actuelle du système. Ce patrimoine appartient à des missions religieuses elles mêmes confrontées à des problèmes de financement et peu à même de le réhabiliter ou de la maintenir, d’autant qu’il est souvent mis gratuitement à la disposition des ZS38. Réhabiliter se comprend aujourd’hui comme réhabiliter des infrastructures et développer des processus alors que besoin est de réhabiliter le processus correspondant au niveau de ressources disponibles. Les ressources d’origine belge sont raisonnables au regard des besoins locaux, mais complètement disporportionnées au regard des ressources locales. Ce problème n’est pas spécifique à la Belgique. Une difficulté inhérente à l’approche projet est le terme incertain de la disponibilité de ressources destinées essentiellement à financer des services dans le cadre de l’appui aux ZS. Par exemple, la ZS de Kangu (Bas Congo) est passée par un appui de la Solidarité protestante, relayée par un appui du Fometro, la première n’ayant pu réaliser le montage financier lui permettant de poursuivre son appui. Le personnel a donc à s’adapter rapidement à des visions et méthodes de gestion différentes.
Le financement de la ZS de Kisantu
La ZS a réalisé en 2004 76% de sa prévision de recettes de 216 000$ et 75% de sa prévision de dépenses de 212 000$, dégageant un solde positif de 7 500$. Elle prévoit pour 2005 un budget de129 842 $ pour une population de 34000 hab., soit 3,82 $/hab. Le budget prévoit un financement de 40% par l’appui SLCD (Consortium ACORD), 32% par Medicus Mundi Navarre, et 28% par la contribution des usagers.
Les ressources consacrées à la lutte contre la lèpre et la tuberculose (Fondation Damien, Solidarité protestante) sont probablement fortement pertinentes car permettant à la fois la fourniture de services de qualité et le développement d’un programme d’envergure nationale. La capacité des partenaires belges du PNT à réaliser leurs montages financier permet un appui dans la durée (plus de 20 ans) qui seul est compatible avec le financement du développement d’un programme national d’envergure. Le modèle développé par le PNT est fortement apprécié par les partenaires congolais aux différents niveaux. L’intervention dans le cadre de l’ILEP (Fédération internationale des associations de lutte contre la lèpre) dont la Fondation Damien est le membre coordinateur au Congo a permis le développement d’un modèle d’intégration de programme basé sur l’efficience insuffisamment valorisé à ce jour par la Coopération Belge. L’ILEP offre par ailleurs un modèle intéressant de coordination de l’aide de ses différents membres à un même programme qui a permit au PNT d’accomoder différents financements. A ce titre, le financement par la CTB apparaît comme une contrainte
37 DSRP provisoire, 2004 « les services fonctionnels du Ministère se désintéressent très largement du processus budgétaire, pour se concentrer sur l’aide extérieure. Les services ne connaissant pas les crédits qui leur sont alloués, n’essaient pas de poursuivre leur exécution et ne se sont pas intéressés à la préparation des prévisions budgétaires d’une année à l’autre. Cette situation mène à une fragmentation des efforts du secteur et encourage la pratique de non-exécution ». 38 On estime que 60-70% des infrastructures sanitaires appartiennent à des missions ou des privés.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 17
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
superflue car il aurait pu être véhiculé par la Fondation Damien qui canalise déjà l’aide belge, épargnant au PNT une contrainte administrative superflue. Le PNT a également été au Congo le premier bénéficiaire du Fonds mondial. Les entretiens révèlent que si le volume de financement est pertinent à la nature des opérations dans le contexte actuel, les modalités de sa mise en œuvre n’apportent aucune valeur ajoutée par rapport aux appuis existants, l’efficacité du dispositif d’engagement et d’exécution des plans étant moindre que celle de la Fondation Damien. La pertinence des financements de la Belgique doit être analysée en regard de la finalité des projets. Ainsi, il est peu pertinent que l’appui à l’opérationnalisation des ZS soit financé par des mécanismes de cofinancement, comme c’est le cas avec la coopération indirecte belge. La réalisation de ‘mixes’ de financement perennes requiert une compétence en ingénierie de financement qui ne fait a priori pas partie des ressources dont dispose un système public de santé. Longtemps l’apanage de l’approche projet, l’apparition du Fonds mondial a consacré sa nécessité au niveau des dispositifs publics, en tous cas pour les trois maladies concernées. L’encadré ci-dessus sur le financement de la ZS de Kisantu en est un exemple, qui s’est développé comme le fruit d’une nécessité historique. Malgré un discours consensuel auquel s’est joint la Belgique sur l’intérêt d’approches sectorielles et de fonds communs, force est de constater sur le terrain la difficulté à remplacer l’approche projet. La pertinence limitée du montage de cofinancements pour les ZS a déjà été discutée. Compte tenu de la dimension stratégique de l’appui aux ZS, si l’approche de coopération indirecte devait perdurer dans ce domaine, il serait utile de rendre accessible aux acteurs la ressource technique en ingénierie de financement. Il n’était pas possible dans le cadre de la mission de terrain d’analyser en détail les budgets des différents projets, et aucun instrument analytique consolidé n’existe au niveau de l’Ambassade. Une base de données lui est fournie par la DGCD/Bruxelles pour la coopération indirecte, et une autre est développée à l’ambassade pour la coopération directe. Les données n’en sont pas toujours désagrégées par unité appuyée ni détaillées pour les gros postes de dépenses. Les discussions avec les parties prenantes font ressortir les points suivants :
• Le versement de primes de performance seulement à certains cadres ne permet pas de répondre de manière adéquate au problème de rémunération du personnel. Il est par ailleurs perçu comme inéquitable car la performance dépend souvent de l’ensemble d’une équipe. Des stratégies d’adaptation ont dans certains cas été développées, où les primes sont partagées entre les différents personnels de façon plus ou moins officielle.
• L’importance des investissements consentis sur certains projets interpelle certains acteurs. Par exemple dans la ZS de Kangu on s’interroge sur l’importance des investissements belges dans l’appui CTB à la ZS voisine de Lukula quand eux même à travers les appuis indirects belges dont ils bénéficient n’ont pas accès à tant de ressources pour des besoins du même ordre.
• La norme de ZS n’est pas discutée dans les études de faisabilité des projets et la réhabilitation d’hôpitaux ou d’instituts de formation du personnel (ITEM) est envisagée sans poser le problème de leur adéquation aux besoins.
• Les SSP sont de plus en plus focalisés sur les soins curatifs, perdant de vue l’importance des activités de prévention ou non médicales dans la production de santé (ex. eau et assainissement)
La visite des projets fait ressortir que l’investissement tient inégalement compte du principe de technologie appropriée, que ce soit au niveau de la prise en compte des coûts
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 18
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
d’opération39 ou des possibilités d’assurer la maintenance (ex. appareils de radiologie). De même, la rentabilité de certains investissements est peu examinée. Une centrale d’achats de médicaments essentiels a été créée à Matadi (CTB / ASS BC) sur base seulement de 800000 usagers desservis, et alors qu’existait déjà une centrale à Kisantu. Si le projet prévoit de subventionner le médicament pour en améliorer l’accessibilité, les subventions sont en pratique largement utilisées pour aligner le prix des médicaments sur le prix du marché privé Compte tenu de la difficulté à obtenir les budgets exacts de l’ensemble des projets, il n’a pas été possible d’estimer un coût moyen par an et par habitant. L’investissement bilatéral ASS BC représente environ 2€ par an et par habitant, y compris le fonctionnement des ITEMS, et fait l’hypothèse d’une contribution de l’Etat et des usagers de 1€. Le budget annuel de la ZS de Kisantu représente 3,2 par an et par habitant et le financement DGCD y représente environ un tiers (part DGCD du cofinancement ACORD). Renforcement du système de santé La plupart des interventions supportées par la Belgique contribue au renforcement du système de soins dans la mesure où elles sont fournies à travers des éléments du système national. Les projets d’appui aux zones de santé constituent le « modèle » à suivre et l’aide belge prend progressivement en charge le niveau d’encadrement (ex. ASS BC). Dans un contexte encore fortement marqué par l’aide sous forme de projets, la concentration géographique semble offrir davantage d’opportunités de renforcement du système en offrant la possibilité de travailler simultanément sur les fonctions de prestation, d’encadrement et d’appui. L’intégration des programmes nationaux est effective au niveau des formations sanitaires et ZS. Des résultats appréciables sont atteints par certains d’entre eux (PNT, par exemple). Cependant, la désintégration du système de santé, et par conséquent l’absence de répondants au niveau de la régulation du système de santé, a obligé les programmes nationaux à mettre en place des réseaux spécifiques en amont des ZS qui ont permis d’atteindre les résultats sus – mentionnés. Pour l’essentiel, les structures des programmes nationaux ont été reproduites au niveau des provinces (Programmes nationaux au niveau central, coordinations au niveau Provinces). Ces structures cohabitent avec celles plus classiques de l’administration sanitaire : directions centrales, bureaux des Inspections Provinciales, Cellules des Districts. Les projets belges prennent généralement bien en compte le secteur privé, en particulier le secteur privé confessionnel. Dans certains cas, le niveau technique des partenaires locaux est tel que la valeur ajoutée du partenariat belges e limite à une contribution à un cofinancement où la création de lien avec des universités Belges (ex. Bureau Diocésain Œuvres Médicales – BDOM de Kisantu). Le secteur privé paraétatique apparaît moins systématiquement pris en compte à la lumière des processus des projets visités. Chaque Programme National dispose, à travers ces représentations déconcentrées, de superviseurs propres, les supervisions n’étant intégrées qu’au niveau des ZS, bien que des initiatives aient été notées ici et là. Dans le système, le principe de supervision en cascade est peu appliqué, avec des courts circuits notables liées au système de primes (par ex, dans le cadre de l’ASS BC, le Médecin inspecteur provincial MIP Bas Congo supervise lui même le niveau ZS, shuntant ainsi la supervision par le district) La Coopération belge n’a pas tiré les leçons de l’intégration des programmes de lutte contre la lèpre et la tuberculose, pourtant portée depuis plus d’une décennie par un de ses acteurs,
39 Par exemple, l’installation d’un appareil de radiologie par le projet FSU à Kinshasa a nécessité de changer le générateur du centre de santé car ce dernier n’était pas assez puissant, sans que ne soit évidente la capacité des patients à payer ne serait ce que le cout du carburant du générateur…
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 19
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
la Fondation Damien. Cette approche de l’intégration fondée sur des principes d’opportunité (2 maladies ‘techniquement’ proches) et d’efficience (2 maladies, 1 soignant) est saluée par les partenaires congolais comme un modèle. Jusqu’au développement du dernier projet d’appui bilatéral au PNT, la Belgique ne s’était impliquée dans l’intégration de la prise en charge de la tuberculose et du SIDA à l’initiative de l’OMS et de l’Union (Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires). Au niveau central, l’appui à la DEP (CTB) à permis la réalisation d’un Plan de développement sanitaire 2004-200640 qui constitue une ébauche de cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). Ce cadre, développé sur base des normes actuelles d’organisation et de prestation du système et avec la participation des provinces requerrait une dépense moyenne de 5 $ par an et par habitant, soit en moyenne 2 $ de plus que le niveau de financement le plus élevé des projets appuyés par la Belgique et probablement les autres bailleurs. L’adéquation du cadre normatif à la situation du pays a été discutée plus haut. Le développement d’un cadre de financement n’a pas été conduit en parallèle à la préparation du cadre de dépenses et ce premier Plan de développement n’a pas eu l’effet d’entraînement escompté sur le développement sanitaire. L’effet d’entraînement a également été affecté par la modification concomitante et non concertée de la structure du système de santé (multiplication des ZS et des programmes). Dans ces conditions, l’utilisation de projets pilotes comme l’ASS BC pour estimer des coûts paramétriques d’appui à la mise en place des ZS apparaît moins pertinent que la recherche de solutions permettant d’améliorer l’efficience des normes. La réflexion sur l’intégration apparaît à ce niveau comme une opportunité manquée qui pourrait être rattrapée par le développement de synergies avec le programme santé du 9ème FED auquel elle est inscrite, ou la réflexion sur l’intégration TB/SIDA menée par le PNT et le PNLS avec l’appui de l’Union. La réunion des actions belges en matière de formation initiale et continue, de planification, d’appui à la performance dans cadre d’une intervention globale d’appui aux ressources humaines cohérente avec la réforme de la fonction publique ne semble pas à l’ordre du jour. Il pourrait s’agir d’une opportunité manquée de produire un impact significatif sur le développement du secteur car la plupart des bailleurs reconnaissent à la Belgique une valeur ajoutée certaine à ce niveau. Cohérence et complémentarité Comme cela a été vu plus haut, la stratégie belge dans le secteur de la santé est cohérente avec les axes du DSRP-I. Les appuis belges aux SSP sont fortement cohérents avec la politique nationale pour ce qui concerne l’appui au fonctionnement des ZS. Au Bas Congo, l’appui à l’Inspection provinciale fourni par l’ASS BC est parfaitement cohérent avec la politique nationale, et il est complémentaire des appuis de la BM (PMURR), de l’USAID (SANRU 3) ; il était également complémentaire des appuis de la Commission Européenne (PATS II). L’appui au secteur du médicament est globalement cohérent avec le Programme national d’approvisionnement en médicaments essentiels (PNAM) aussi bien pour ce qui concerne la mise en place de Centrales de Distribution Régionales (CDR) (Matadi / ASS BC et mise en place de centrales dans l’Equateur et le Bandundu / CTB) que du fonctionnement de l’organe fédérateur de ces centrales au niveau national, la FEDECAME. Cette cohérence risque cependant de ne rester qu’à un niveau superficiel si les procédures de passation de marché de médicaments restent au niveau de projets car, comme on l’a vu plus haut, les volumes des 40 Ministère de la santé : Plan national de développement sanitaire 2004-2006, Septembre 2004
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 20
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
marchés ne permettent pas encore d’obtenir des prix réellement compétitifs par rapport à un secteur privé local qui n’est pas soumis cette contrainte. L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de la réelle efficacité du subventionnement des médicaments pour améliorer l’accessibilité économique aux soins. L’examen du fonctionnement de la CAME de Matadi (CAAMEBO) soulève un certain nombre de préoccupations :
o Missions : l’assignation à la centrale de missions (supervision) qui relèvent normalement d’autres services du Ministère de la Santé grèvent inutilement le coût de la centrale, donc le prix des produits, même si le coût en est aujourd’hui supporté par le projet ;
o Fonctionnement : aujourd’hui, les centrales fonctionnement comme un service étatique sur un marché captif. Elles ne disposent pas d’une comptabilité privée propre et leur mode de fonctionnement ne les prépare pas à « voler de leurs propres ailes ».
Si comme on l’a vu l’appui à la lutte antituberculeuse selon une approche projet selon à la fois des modalités indirectes et directes est d’une pertinence limitée du point de vue des mécanismes de financement, la cohérence entre ces financements est préservée par une bonne capacité de planification du PNT, qu’appuie par ailleurs la Fondation Damien dans le cadre d’un plan stratégique national TB. De cette manière, l’appui global de la Belgique est également cohérent avec celui de l’USAID, celui du Fonds Mondial et celui de la Global Drug Facility (Initiative StopTB). Il n’a pas été possible de déterminer avec précision dans quelle mesure l’appui belge à la lutte contre le SIDA était réellement cohérent et complémentaire avec les appuis du Fonds mondial et du MAP/BM qui n’ont pas encore réellement pris effet, mais leurs programmations ont été réalisées dans le cadre du plan national VIH/SIDA. Réponse aux besoins de santé L’ensemble des projets d’appui aux ZS permet la fourniture des paquets de services essentiels. L’appui au PNLS envisage à la fois la fourniture de services préventifs et la prise en charge des patients. L’appui aux PNTHA et PNTL permettent et la prise en charge des malades et le contrôle de la transmission de ces maladies. Les projets belges permettent par ailleurs la réponse aux besoins de certains groupes vulnérables comme les professionnels du sexe (Projet prostituées MSF à Matonge) ou les anciens lépreux handicapés (Solidarité protestante, Fondation Damien). L’ensemble des acteurs belges interviewés souligne que la difficulté de répondre aux besoins de santé n’est pas tant dans le fait de rendre des services disponibles que dans celui de les rendre financièrement accessibles aux pauvres qui constituent une part importante des usagers. Dans le meilleur des cas, les taux d’utilisation de la consultation primaire curative plafonnent autour de 0,4 contact par an et par habitant, seuil que n’a permis de franchir que la gratuité des médicaments fournis dans le cadre d’interventions humanitaires. Les acteurs belges ont développé plusieurs stratégies pour pallier cette difficulté. Le développement de mutuelles de santé (ACORD, Solidarité mondiale, FSU) se heurte à la capacité même de cotiser des mutualistes potentiels, au point que certains projets ONG s’engagent sur la voie de l’amélioration du revenu de la population, revenant à des approches de type ‘projet intégré de développement’, qui avaient disparu des modalités de coopération bilatérale. La coopération bilatérale a choisi la voie du subventionnement du médicament et les limites de l’efficacité de cette approche ont été discutées plus haut. Cette stratégie n’étant pas partagée par d’autres bailleurs, sa viabilité dépassera t’elle l’engagement belge quand le FED a pris l’option de dissocier le médicament du financement de la santé en subventionnant l’acte et assurant la gratuité du médicament41 ? 41 Commission Européenne : Etude de faisabilité du Programme Santé 9ème FED, Kinshasa, 2005.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 21
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Impact potentiel sur la santé – aspects multisectoriels Les discussions menées avec des groupes d’acteurs Belges et Congolais suggèrent que l’emphase sur les soins de santé serait trop importante, tout en rappelant la dimension multisectorielle des SSP. Force est de constater que, dans la situation socio-économique Congolaise, la fourniture des soins relève encore pour une large part de la population d’une logique humanitaire, même si les situations de crise aiguë ont pratiquement disparu. Dans ces conditions, les projets de santé empiètent progressivement sur les autres secteurs (par exemple l’ASS BC réalise des captages de source ou des latrines pour lutter contre les maladies diarrhéiques, l’appui à la ZS de Kisantu s’engage dans des activités génératrices de revenu pour améliorer la capacité de cotisation des mutualistes, etc.). D’un autre côté, les projets de construction de routes mis en œuvre par la CTB ne sont pas tous réalisés dans des zones où les formations sanitaires sont à même de faire face à la prise en charge d’accidentés. Le secteur privé confessionnel est largement impliqué dans les multiples aspects des différents programmes de santé, mais la contribution du secteur des entreprises paraétatiques est plus problématique. Il n’a pas été observé de liens avec le secteur privé libéral. Celui-ci est relativement peu développé en comparaison des autres segments du secteur privé. Par contre, dans le contexte de financement par les usagers de nombreuses formations sanitaires, il est difficile de déterminer la limite entre recouvrement des coûts et pratique privée officieuse. Le secteur privé du médicament est bien développé et détient la part la plus importante du marché, sans qu’il soit possible de la chiffrer avec précision. Il s’appuie sur un large réseau de revendeurs praticiens ou commerçants et se comporte à ce niveau comme un leader en défense de position (cf. contentieux SAFARCO évoqué plus haut). Les prix sur les produits relevant d’une prescription de base ou de l’automédication (aspirine, paracétamol, amoxicilline, antipaludéens de base, etc.) sont largement compétitifs. Les axes de développement du secteur du médicament ne prennent aujourd’hui que marginalement en compte les principes de ‘Private-public mix’. Préoccupations transversales Durabilité Dans le contexte actuel d’après guerre, de désintégration persistante du système de santé et d’incapacité de l’Etat à assumer efficacement son rôle, la durabilité de l’appui belge est un vœu pieux au même titre que celui des autres coopérations. Durabilité financière : Tous les acteurs s’accordent sur le fait que la viabilité financière du système n’est pas envisageable même à moyen terme. L’Etat contribue très faiblement au financement de la santé42, et la capacité des ménages à financer la santé s’est effondrée. Le Plan de développement sanitaire 2004-2006 table pour la période sur un budget de 941 M US$. Produit en septembre 2004, il envisage pour cette même année 247,6 M US$, soit environ 4,8 US$ par habitant, alors que cette même année, l’investissement par l’aide externe dépassait difficilement les 100 M US$ y compris aide humanitaire). Si l’écart entre ressources et ambitions est de 1,5 - 2 US$/an/habitant dans des zones de projet pilote (ex ASS BC, Kisantu), il peut être estimé à 4 US$ dans les zones ne bénéficiant pas d’un appui conséquent,
42 Les 780 M€ de budget annuel de l’Etat Congolais correspondent au budget d’une capitale régionale européenne de 350 000 habitants (Montpellier ou Anvers), hors services de santé et éducation.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 22
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
où le financement repose sur des seules populations dont la situation économique a été fortement affectée par les guerres. Le système Congolais de santé risque de dépendre encore un certain temps de l’aide externe mais ses montants ne parviendront en tout état de cause pas à combler le déficit. Durabilité technologique: Certains choix technologiques faits dans le cadre des projets ont un impact direct sur les coûts récurrents du système de soins. Les problèmes des sources d’énergie et des coûts et possibilités de maintenance d’équipements ont été discutés plus haut et des illustrations figurent à l’annexe photographique. Durabilité institutionnelle : Le Congo pose avec acuité le problème du développement de normes sanitaires et de leur lien avec le financement du secteur, et la durabilité des institutions sanitaires reste à construire. Le problème de l’adéquation des normes sanitaires au contexte d’Etat fragile a été abordé. La multiplication des zones de santé pour faire correspondre la décentralisation sanitaire avec la décentralisation administrative est logique, mais leur multiplication administrative s’est faite sans réflexion parallèles sur leur financement et la faiblesse du dialogue politique n’a pas permis de contrôler ce problème. Les outils de la décentralisation sanitaire ne prévoient pas de mécanismes d’adaptation équivalent au principe d’intercommunalité, pourtant développé au début du XXème siècle dans des pays comme la France ou la Belgique pour faire face au même type de contraintes. La Coopération Belge aurait pu engager une réflexion à ce niveau sur base de l’expérience belge des Intercommunales43, comme moyen d’améliorer l’efficience du système. Les difficultés à financer les services de santé de base selon les normes ont déjà été évoquées. Elles sont accentuées par le plaidoyer actif réalisé par les interventions de certaines organisations (Agences thématiques des Nations Unies, MSF…). Les ONG Belges expriment leurs difficultés à monter des projets d’appui aux SSP dans les ZS quand une partie du cofinancement est par exemple assuré par l’Unicef, du fait de la focalisation thématique des financements par cette organisation. La prise en charge des malades du SIDA obéit à un modèle au développement duquel MSF à largement contribué au Congo, où l’agent primaire est médical et non paramédical. Ce modèle n’a pas été discuté dans la construction du projet d’appui au PNLS. Il l’est actuellement dans une perspective d’amélioration de l‘efficience dans le cadre de l’intégration TB-SIDA, mais la Belgique n’est pas partie prenante de ce débat. La qualité des formations données par la Belgique dans le cadre des projets ou des programmes de coopération universitaires est saluée par les différentes coopérations comme un élément important de la durabilité du système de santé pour peu que ces ressources restent au Congo. Un certain nombre de cadres locaux est tout à fait autonome en matière de développement et gestion de projets. Les compétences sont cependant faibles en matière de gestion administrative publique, et les projets ne savent pas transmettre ces compétences. Le problème du financement du personnel constitue un problème clé auquel la Belgique s’est attaquée par le biais de la réforme de la fonction publique. Le ministère n’avait jusqu’ici pas à se soucier des disponibilités budgétaires pour payer les fonctionnaires de santé (un salaire dérisoire de l’ordre de 20 US$ par mois pour les cadres) car « l’ascenseur » assurait une rémunération modeste mais significative des prestataires et des gestionnaires. Ainsi, près de 30% des fonctionnaires ne sont pas inscrits au rôle de paie de la fonction publique (« mécanisés »). La budgétisation du salaire de ces personnels va fortement grever le budget de fonctionnement hors salaires du secteur. Si le versement de primes correspond à la tendance actuelle de rémunérer la performance, la disproportion entre le niveau de ces primes 43 Une réflexion de ce type avait été engagée par l’AGCD et la Commission Européenne en Haiti en 1997-98.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 23
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
(plafonnées à 1200 US$/mois pour les plus élevées) et le salaire des mêmes personnels (20 US$/mois) crée un fossé difficile à combler. Le rôle des ONG dans le système de santé n’apparaît pas suffisamment clarifié du côté Belge pour ce qui concerne le financement, l’assistance technique, l’appui gestionnaire, l’innovation. Le niveau d’intervention maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre a été abordé plus haut. La proposition de « clarification des rôles » de l’annexe 2 du document sur la Coopération Belgo-Congolaise en matière de santé44 est à cet égard restée lettre morte. Notre analyse confirme a posteriori sa pertinence. Viabilité culturelle : Pendant les trois décennies passées, le système de santé, a fonctionné selon un principe de financement de l’administration par le bas. Le système de l’ « ascenseur », développé dans le cadre de la culture de « l’article 1545 » a longtemps permis de faire vivre un important dispositif qui ne bénéficiait pas de projets et d’une certaine manière, c’est cette base de ressources qui a permis de doubler le nombre de zones sanitaires. A un certain niveau du système, il est vraisemblable que la rémunération des personnels soit en relation directe avec le commerce pharmaceutique, la contribution étant alors payée non plus par le patient mais par le grossiste. On peut analyser un tel système sous l’angle de la corruption en comparaison à un référentiel d’Etat de droit. Il est peu probable cependant que l’ensemble des personnels qui y adhèrent soient corrompus, et une analyse de type « nécessité fait loi » s’avère plus opératoire. Elle permet entre autres d’expliquer le comportement du Ministère dans l’affaire de la concession du système public de médicaments à une société pharmaceutique de la place qui s’est engagée à verser des salaires au personnel (contentieux SAFARCO). Ces stratégies ont fonctionné bon an mal an tant qu’une grande partie de la population était solvable mais l’appauvrissement de la base expose ce système à de fortes tensions. Ce système était accepté par les communautés tant que le niveau de vie des personnels qui en bénéficiaient était cohérent pour leur niveau social avec celui de la communauté, et le principe de participation communautaire était admis aussi bien sur le plan financier direct que du bénévolat sur certaines actions. Le système de primes versées par les projets n’assure pas la rémunération de l’ensemble du personnel et crée des frustrations chez les « non primés » mais aussi dans la communauté qui joue de plus en plus difficilement le jeu de la participation bénévole. Dans un tel contexte, opter pour des mécanismes de durabilité fondés sur le principe d’Etat de droit implique une réforme en profondeur qui doit prendre en compte les attentes d’appui à tous les niveaux et être soutenue suffisamment longtemps pour permettre un changement de la culture en place. Il faut s’attendre à de fortes réactions des segments du système qui en profitaient le plus et être prêt à consentir d’importants investissements dans la réforme à côté de la production même de services. A ce titre, le dialogue sur le thème du développement sanitaire ne peut se limiter à de simples enjeux techniques comme celui du développement des soins de santé primaires selon le modèle de la zone de santé. Ce dernier doit s’accompagner d’un dialogue politique de haut niveau sur la mobilisation des ressources, dont l’importance sur l’agenda ne devrait pas être dissociée. Il doit également être appuyé par des stratégies économiques agressives visant à prendre de la part de marché de manière durable aux segments pervertis du système. L’accent que met la Note stratégique pays sur la « mise sur pied d’un appareil d’Etat performant, transparent et responsable » dans le cadre de la phase de coopération vers la paix du programme de coopération va dans ce sens. La Belgique est le seul bailleur qui a pris en compte dès le début de la phase de transition la problématique institutionnelle sectorielle (appui à la DEP) en parallèle à une coopération indirecte.
44 Coopération Belgo-Congolaise : Etat des lieux de la coopération dans le secteur de la santé au Congo. Rapport de mission de délégués du gouvernement belge auprès du Ministère de la santé 14-24/10/02 45 Expression populaire, le fictif article 15 de la constitution peut se résumer à « Débrouillez-vous et n’attendez rien de l’Etat ». Sa large application par les fonctionnaires n’est pas le moindre des paradoxes du Congo.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 24
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Un apport important de l’appui de la Belgique à la DEP a été la formulation d’une ébauche de Politique de financement de la santé46 qui a le mérite de poser la nécessité de clarification de la stratégie de financement du secteur et d’annoncer le besoin de réforme à ce niveau. Ce document a servi de base pour la formulation du programme santé du 9ème FED qui a pour objectif le développement ultérieur et la mise en œuvre de cette politique en tentant de répondre aux défis de financement du secteur discutés plus haut. Le développement des ressources humaines au sens large reste un point critique du développement du secteur. L’approche de lutte contre les maladies transmissibles En accord avec la NSS, la Belgique appuie la lutte contre la tuberculose et la lèpre (PNTL), la trypanosomiase (PNTHA) et le SIDA (PNLS) au niveau des programmes nationaux. Pour tous ces programmes, les stratégies mises en œuvre correspondent aux standards internationaux et tous ces programmes disposent d’un plan stratégique qui en décline l’expansion. La prestation des services en est intégrée dans les services généraux de santé, à l’exception de la THA pour laquelle des cliniques mobiles se justifient encore. La contribution technique et financière de la Belgique aux PNTHA (Fometro puis CTB) et PNTL (Fondation Damien, APEFE, Solidarité protestante, Fonds mondial pour mémoire, en complément de l’Union / USAID) est substantielle ; indépendamment de financements belges, l’IMT assure la fonction de laboratoire de référence supranational pour le laboratoire du PNTL (financement par l’Union / USAID). Les contraintes que soulèvent l’existence de plusieurs financements belges obéissant à des règles différentes sur un même programme ont déjà été discutées au chapitre sur le partenariat. Au niveau du PNLS, la contribution de la Belgique est technique (l’IMT assure la fonction de laboratoire de référence supranational pour le laboratoire du PNLS, la CTB fournit une assistance technique permanente au PNLS) et financière, en complément des financements du Fonds mondial et du MAP / BM. Tous les assistants techniques belges ont des homologues nationaux au sein des programmes. Les appuis belges aux programmes de lutte contre la lèpre, la tuberculose et la THA sont fournis de manière soutenue depuis de longues années et ont permis l’obtention de résultats notables, puisque les objectifs OMS sont atteints ou en passe de l‘être pour ces maladies. Ces différents appuis ne sont pas exploités pour contribuer à la réflexion sur l’intégration souhaitée par la NSS. Le PNTHA évolue vers une intégration de ses services dans les formations sanitaires fixes sans que ne soit soulevé l’éventuel intérêt d’un dispositif mobile en complément des cliniques fixes pour d’autres programmes, alors qu’une recommandation en ce sens avait été faite47. De même, la Belgique ne paraît pas mettre a profit son appui à la lutte contre la TB et la lèpre en matière d’intégration de programmes fondée non sur des types de bénéficiaires mais sur des savoirs faire (Lutte contre les maladies transmissibles et prise en charge de patients chroniques stigmatisés) au niveau d’un prestataire unique, l’agent de santé primaire. L’organisation du PNLT (coordinations relevant de l’inspection provinciale mais déployées au niveau du district48) constitue également une approche originale à l’extension de couverture dans un contexte de ressources limitées. L’intégration de la prise en charge du SIDA et de la tuberculose fait actuellement l’objet d’un débat à l’initiative de l’OMS mais auquel les acteurs belges ne prennent pas une part active. Ce débat oppose l’approche 2 maladies – 1 patient (TB-SIDA) à l’approche 2 maladies – 1 soignant (TB – lèpre) menace d’une certaine
46 Ministère de la santé : Politique de financement de la santé, Draft Octobre 2004 47 DGCD : Evaluation finale de l’Action Lèpre et Tuberculose au Bas-Congo. Solidarité protestante / Alter, Mars 2002, chapitre 4 rec. N°2. 48 Le district est au congo l’entité administrative entre le niveau provincial et la Zone de santé. Lee découpage actuel correspond approximativement au découpage des nouvelles provinces prévu pour être soumis à référendum.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 25
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
manière les acquis de l’intégration lèpre-tuberculose que seule a défendu l’ILEP qui en supportait les coûts, entre autres sur fonds publics belges via la Fondation Damien. La Belgique n’est partie prenante ni financière ni technique à la réflexion nationale, alors qu’une recommandation en ce sens avait été faite dans l’évaluation de l’appui au PNTL au Bas-Congo en 2002. Cette approche est originale car elle se fonde sur un principe de co-financement par les bailleurs de fonds pour en favoriser la viabilité stratégique, d’une recherche opérationnelle sur l’intégration des soins au niveau primaire aux malades co-infectés par la tuberculose et le VIH. Le montage institutionnel se fait à travers une maîtrise d’ouvrage de l’Union, dont le PNT est membre. L’ouverture de la participation au cofinancement de cette initiative aux bailleurs intéressés peut offrir à la Belgique une opportunité de s’impliquer dans la réflexion sur l’intégration des services TB et SIDA dans les SSP. Au-delà des stratégies internes à chaque programme, l’intégration se heurte au fait que les appuis sont fournis directement au niveau des programmes et que leur direction de tutelle au sein du ministère (Direction de la lutte contre les maladies transmissibles) ne dispose d’aucun moyen pour assurer la coordination. Cet affaiblissement lié à la logique projet est accentué d’un côté par les mécanismes du Fonds mondial qui ont tendance à faire de leurs programmes bénéficiaires de véritables agences, et par l’existence pour le SIDA d’un Programme National Multisectoriel (PNMLS) qui bénéficie de financements substantiels. Partenariats internationaux Des deux partenariats internationaux mis en œuvre au Congo (OMS et FNUAP), seul celui avec l’OMS a une réelle vocation internationale puisqu’il consiste en un appui régional à la lutte contre la THA. Il n’a pas été possible d’avoir d’informations sur ce projet car il est géré depuis le bureau régional de l’OMS à Harare et aucun document n’est disponible auprès du Bureau des attachés ou de la Représentation OMS, et que l’assistant technique Belge qui le met en œuvre était en congé au moment de la mission. Partenariats nationaux Dans la situation actuelle du pays (post-conflit, transition politique, transition entre la phase d’urgence et celle du développement, désintégration du système de santé et ses conséquences sur la gouvernance), l’utilisation des mécanismes classiques de coopération (cogestion et création de régies nationales) n’est pas encore effective. En attendant l’utilisation optimale de ces mécanismes, il est important que des mesures soient prises pour améliorer la mise en œuvre des interventions en général, et le déboursement des fonds de en particulier, de façon à réduire les retards actuellement constatés entre les prévisions et les réalisations. Les partenaires Congolais apprécieraient que la Belgique puisse adopter des mécanismes externes de suivi des projets comme cela se met en place pour d’autres partenaires (FED). La plupart des partenaires se plaignent des retards liés à l’exécution des procédures belges. Le financement par des fonds publics de projets de développement selon des procédures administratives classiques constitue en lui-même un obstacle à la production d’impact si l’horizon des projets n’est pas suffisamment lointain pour que l’inertie qu’impose le contrôle administratif sur l’exécution de la dépense puisse être amorti dans le temps. Souvent familiers avec des procédures administratives et financières rapides dans le cadre de l ‘aide d’urgence, les partenaires Belges ou Congolais ont du mal à prendre en compte cette dimension de la gestion publique. Il n’en demeure pas moins vrai que la charge administrative des projets empiète également largement sur le travail technique et est susceptible d’en limiter l’efficacité. Les entretiens avec les attachés indiquent que tout en
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 26
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
satisfaisant aux contraintes de la gestion publique, les procédures pourraient être sensiblement allégées, dans un souci d’efficience accrue. Des efforts sont fournis par les Partenaires au développement, au premier rang desquels la Belgique, pour permettre l’émergence d’un mécanisme de concertation et de coordination des interventions en santé. La Belgique s’est engagée dans cette voie avec à l’appui, l’intention de partager sa vision sur le développement de la zone de santé. Les résultats mitigés en matière de coordination/concertation obtenus par le Groupe thématique santé sont également liés au contexte politique actuel et à l’approche projet car les programmations pluri-annuelles sont difficilement modifiables une fois adoptées par les administrations centrales des bailleurs. Les efforts se heurtent également à l’absence de représentation locale décisionnaire des banques de développement (BM et BAD). Les différents mécanismes de coordinations ne permettront cependant pas de surmonter les contraintes de l’approche projet que seul un pas vers la construction d’un programme sectoriel pourrait surmonter. L’expérience du Mozambique montre qu’une telle évolution est possible dès la phase de recontruction post crise49. Dans la mesure où ce type d’évolution est souhaité par la NSS, il est nécessaire que les procédures administratives belges soient adaptées à une telle éventualité, en particulier en permettant à la Belgique d’héberger dans un premier temps des fonds communs alimentés par plusieurs bailleurs50. Le Bureau des Attachés a récemment mis en place une plateforme des partenaires ONG Belges permettant d’améliorer la concertation, le partage d’expériences et la coordination. Cette initiative est saluée par l’ensemble et son mécanisme a grandement facilité la réalisation de la mission. Il ne semble pas prévu que la CTB participe à ce type de forum pour améliorer la cohérence entre coopération directe et indirecte, mais aussi le cas échéant pour améliorer cohérence et complémentarité des appuis des acteurs non-étatiques belges hors financement public belge. Partenariats avec les communautés locales L’implication des populations est au centre des préoccupations des projets intervenant sur le terrain visités lors de la mission. Cependant, le besoin est exprimé d’une approche plus systématique (i) d’évaluation et de prise en compte des besoins communautaires, (ii) de responsabilisation des communautés dans la prise en charge de leurs problèmes de santé et dans la gestion des FOSA, et (iii) de systématisation de leur participation dans la mobilisation sociale en faveur de la santé, y compris en entretenant leur engouement par des mesures incitatives (mise en place et pérennisation du réseau des volontaires) 51. La clarification du rôle des représentants de la population par une formation et une sensibilisation appropriées est nécessaire. L’implication de la population dans la fixation des tarifs des soins, et de manière plus générale dans la gestion du volet accessibilité financière doit être de mise, ce d’autant que c’est elle qui supporte la grosse part du financement du système, y compris le paiement partiel des salaires des personnels. 49 Un tel développement est conditionné par l’existence (i) d’un Plan Stratégique fixant les orientations, les stratégies et les priorités de développement du secteur assorties d’un mécanisme d’arbitrage en cas de tension sur les ressources (ii) d’un Cadre de Dépenses à Moyen Terme et (iii) d’un protocole d’accord fixant les obligations et engagements du gouvernement et des partenaires au développement. 50 comme cela a pu être assuré par la Suisse au Mozambique 51 ces mesures incitatives sont celles déjà mises en œuvre par certains partenaires (par exemple achat de vélos, prise en charge gratuite des soins des volontaires et de leurs familles, formation). Il peut également être envisagé, au niveau de la ZS, sans que cela soit formalisé, de rétrocéder une petite partie des primes variables de performance aux volontaires performants ; les critères de performance des volontaires doivent être explicités et portés à la connaissance des volontaires. L’on pourra toujours arguer à juste titre des risques liés à l’extension des primes de performance aux volontaires, mais le risque déjà pris en servant les primes aux personnels est encore plus grand. Par ailleurs, l’engagement des membres de l’encadrement ne peut demeurer éternellement intact sans contrepartie.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 27
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
La représentation des communautés doit également être envisagée sur la durée, dans le cadre d’un partenariat entre la population et les services de santé. Les représentants de la communauté ayant participé à l’identification de l’appui à la ZS de Lukula (ASS BC) ont été remis en cause par les représentants rencontrés lors de la mission car bombardés représentants que par accès à une opportunité et non légitimité populaire. A terme, la mise en place de représentants élus démocratiquement devrait permettre d’améliorer la légitimité des représentants. L’égalité des chances femmes / hommes La prise en compte de la dimension genre n’est pas systématique ; elle n’est pas faite de manière structurée. Certes, certains indicateurs de couverture spécifiques aux femmes sont produits mais aucune analyse préalable n’est réalisée et aucun objectif n’est fixé au démarrage de l’intervention. La vaste majorité des acteurs Congolais rencontrés sont des hommes. Cette différence s’explique par une disparité d’accès aux études qui subsiste aujourd’hui encore pour les populations rurales puisque trois fois plus de garçons que de filles étudient. D’importants efforts restent nécessaire en matière d’égalité des chances très en amont du système de santé. Le genre ne semble pas empêcher cependant les femmes d’accéder à des positions de responsabilité, en proportion cependant du déséquilibre numérique. Ainsi, le médecin responsable du programme de lutte contre le SIDA au Bas Congo est une femme. La faible féminisation des effectifs est également mentionnée par les responsables des Instituts de formation (ITEM) dans les promotions. Il n’a pas été possible de vérifier si à Kinshasa ou une pllus grande parité au niveau de l’enseignement existe, cette différence se retrouve. Davantage de partité a été rencontrée lors des rencontres avec des représentants communautaires ; les femmes étaient plus représentées dans les associations ou comités SIDA. La prédominance masculine se retrouve au niveau du dispositif Belge puisque la seule femme impliquée dans les projets bilatéraux est l’assistante technique au PNLS. Davantage de femmes ont été rencontrée sur des projets ONG (BDOM Kisantu, MSF, APEFE…). Si les documents de projets consultés prévoient la prise en compte du genre, il n’a pas été retrouvé de politique génésique à proprement parler au niveau des projets. Comme cela a été vu plus haut, la santé de la reproduction est intégrée dans les services généraux de santé. Les entretiens au niveau des projets visités indiquent au Bas Congo les difficultés qu’éprouvent les femmes lorsque suivi de la grossesse et accouchement sont réalisés par du personnel masculin. La décision prise il y a quelques années de modifier les filières de formation des accoucheuses en porte la responsabilité. L’absence d’intervention structurée de la Belgique au niveau du développement des RH ne lui permet pas un impact significatif à ce niveau. Le projet MSF d’appui au Centre de santé de Matonge à Kinshasa cible spécifiquement les professionnels du sexe dont la majorité sont des femmes. Des résultats significatifs sont obtenus en matière de stabilisation des parcours de soins des clientes, parmi lesquelles l’appropriation de la structure est importante et fortement revendiquée. Il ne semble pas exister d’obstacle génésique particulier dans l’accès aux programmes de lutte contre la maladie. Ainsi les indicateurs de la lutte antituberculeuse qui prennent en compte le sexe sont cohérents avec l’épidémiologie génésiquee de la tuberculose. Le projet de prise en charge TB/VIH qui débute porte une attention particulière à l’accessibilité et à côté de l’accessibilité économique, il permettra de vérifier si son approche de services intégrés au niveau primaire permet un accès égal au test et aux services de prise en charge des hommes et des femmes. En matière de prévention du SIDA, le préservatif féminin n’est encore rendu disponible et accessible que par un nombre limité de projets.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 28
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
La lutte contre le SIDA L’épidémie de SIDA a largement profité des récentes guerres et l’infection par le VIH est davantage une conséquence de ce type de conflit et en particulier des violences faites aux femmes que les pertes directes dans le cadre de combats. Ainsi, les récentes enquêtes de séroprévalence révèlent des niveaux de 7% dans certaines populations rurales situées derrière l’ancienne ligne de front et à Lubumbashi, quand la prévalence reste contenue autour de 4% à Kinshasa. La réponse à l’épidémie a longtemps été le fait de seules ONG intervenant dans le cadre de projets visant la fourniture directe de services (prévention et prise en charge de patients) et financées par l’USAID ou la CE. Contrairement à la lutte contre la tuberculose, il n’existe dans la lutte contre le SIDA aucune initiative comparable à celle de l’ILEP pour la lèpre et la tuberculose d’action à travers un programme national, comme l’assure la Fondation Damien. Le projet CTB d’appui au PNLS marque la reprise des appuis institutionnels et la lutte contre le SIDA a bénéficié par la suite d’importants appuis par le programme multi-pays de la BM (MAP) et de l’accord du Fonds mondial sur une demande de financements. Le PNLS bénéficie également de l’appui technique de l’OMS et de l’ONUSIDA. La lutte contre le SIDA reste également un axe important de l’appui de l’USAID. L’importance de l’appui de l’IMT a été mentionnée plus haut. La création du PNMLS a permis de soulager le Ministère de la santé de l’écrasante responsabilité de l’ensemble de la réponse à l’épidémie. Les besoins financiers de la lutte contre le SIDA sont évidemment considérables en RDC. Les estimations réalisées dans le cadre du Programme Minimum pour la Transition et la Reconstruction (PMPTR) font état d’un besoin annuel de 90 M US$ (un tiers pour les besoins sanitaires et deux pour les besoins psycho-sociaux). Parallèlement, les besoins estimés pour le secteur santé hors SIDA sont de 170 M US$. Les financement du Fonds mondial (113 M US$) et du MAP (130 M US$) sont proportionnellement plus importants que ceux aujourd’hui disponibles pour le reste du secteur et le risque est grand de verticaliser la prise en charge du SIDA compte tenu des difficultés que rencontre le système de santé et qui ont été abordées dans les chapitres précédents.. Les stratégies de prévention se heurtent à divers obstacles parmi lesquels figure les difficultés de coordonner l’approvisionnement en préservatifs. La stratégie de prise en charge des patients est largement inspirée de projets tels que le projet pilote de MSF au CS Kabinda, où les soins reposent principalement sur du personnel médical. C’est sur cette base que repose le plan d’extension de la prise en charge, avec les risques inhérents au niveau du système. La recherche action lancée par le programme tuberculose en partenariat avec le PNLS est à cet égard intéressante car elle a pour objectifs de réaliser des études de coût-efficacité d’un modèle alternatif basé sur les soins de santé primaires par rapport à cette approche, et d’en déterminer les facteurs de viabilité, en particulier pour ce qui concerne la charge de travail et la rémunération des personnels. Intégration avec la lutte antituberculeuse et réflexion sur le financement sont les seuls thèmes développés dans le projet de Note stratégique SIDA52 qui ne se retrouvent pas dans le dispositif Belge aujourd’hui en RDC. Préoccupations de développement issues de la note
stratégique
52 DGCD : La Belgique et la lutte contre le SIDA. Projet de note stratégique ; Bruxelles, Octobre 2004
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 29
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Développement durable Tous les appuis sont aujourd’hui confrontés à d’importants défis en matière de développement durable: • Faible légitimité de la tutelle de l’Etat : Après les guerres et des décennies de
mauvaise gouvernance où le système public était financé par des projets et/ou le système dit de « l’ascenseur », la légitimité de l’administration sanitaire est limitée. Ainsi, visitant la ZS de Lukula, les évaluateurs ont reçu l’injonction d’un membre de la communauté d’« aller dire au Roi que le peuple n’a pas encore accès aux soins de santé primaires ». Le principe de tutelle et la maîtrise d’ouvrage du Ministère de la santé sont affectés par la visibilité du dispositif de projet et la distance (souvent en Belgique) de la prise de décision administrative (ce qui ne signifie pas qu’une prise de décision à Kinshasa aurait des effets plus rapides…). Axe clé du DSRP-I, ce problème n’est pas spécifique à la santé. La restauration du gouvernement dans ses fonctions régaliennes est indispensable pour la pérennisation des actions en santé. Aujourd’hui, l’incapacité de l’Etat à honorer ses obligations (notamment le paiement des salaires et la prise en charge ne serait-ce que partielle des dépenses de fonctionnement du système) fait reposer tout le poids des dépenses en santé sur les ménages et les partenaires. Deux conséquences majeures émergent de ce constat : la première est l’application par les formations sanitaires, même si la situation diffère selon que celles-ci reçoivent ou pas d’appuis, de tarifs sans commune mesure avec les revenus des populations53, la seconde est la persistance du caractère de « substitution » de l’aide créant une « culture de dépendance » qui sape toute initiative. La seule façon de sortir de ce cercle vicieux est de renforcer la maîtrise d’ouvrage de l’Etat en général. Le Ministère de la Santé doit être à même de jouer son rôle vis à vis des ministères des finances et du budget (en assurant la programmation et l’exécution d’un budget pro-pauvres, les dépenses de souveraineté et apportant sa contrepartie au financement) et de partenaire fiable pour les bailleurs.
• Fortes tensions sur les ressources humaines : La gestion du personnel constitue le
talon d’Achille du développement du système. Le principe de primes à la performance, s’il sacrifie à la tendance du moment, réalise de facto un dispositif précaire de rémunération par l’aide externe du personnel de santé des projets, qui de surcroît semble avoir un impact négatif sur le bénévolat communautaire. Le salaire que ne perçoit qu’un tiers de la fonction publique étant au mieux symbolique, les usagers restent une grande source de financement du personnel. Aucun bailleur ne s’est encore engagé dans ce domaine, déjà exclu des programmations de la BM (aucun appui système) et de la CE (focus sur financement). Comme on l’a vu, un appui à ce niveau de la Belgique aurait une forte valeur ajoutée sectorielle et une grande cohérence avec ses autres appuis à la reconstruction de l’Etat.
• Viabilité financière limitée : Le financement du système qui a longtemps reposé pour
une large part sur les usagers est aujourd’hui défaillant, la plupart d’entre eux vivant sous le seuil de pauvreté. Sa viabilité repose aujourd’hui essentiellement sur l’aide externe, mais la prise en compte par les partenaires nationaux et internationaux des tensions majeures sur les ressources et de l’écart entre leur disponibilité et les ambitions reste limitée. Le Congo pose également de manière aiguë la question du développement des normes d’infrastructure et de service dans un contexte d’Etat fragile. Si les normes du système en place aujourd’hui satisfont à une certaine vision de norme internationale, les moyens pour le faire fonctionner ne permettent pas de répondre au double besoin d’efficacité et d’équité de distribution des bénéfices de santé. L’aide de la Belgique a permis une prise de conscience du besoin de réforme du
53 des tarifs de $ 150 hors mutuelle et de $ 30 avec ont été relevés à Kisenso (Projet FSU) en périphérie de Kinshasa pour une césarienne
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 30
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
financement de la santé, que le développement de synergies avec le Programme santé du 9ème FED devrait permettre de concrétiser.
• Faiblesse du cadre conceptuel : Le cadre normatif des Soins de santé primaires (SSP)
définit un « résultat minimum » (Paquet minimum de services, District sanitaire OMS…) à atteindre, qui sans cesse s’élargit sous l’influence des plaidoyers internationaux (ex. vaccinations, prise en charge du SIDA). La façon d’y parvenir dans des situations d’Etat fragile, en particulier quant l’assiette locale de financement s’est délitée n’est pas évidente, comme en témoigne le silence évoqué plus haut de la NSS à ce propos. Le cadre conceptuel est également de peu de secours au niveau de l’articulation de la décentralisation sanitaire avec la décentralisation administrative
Par ailleurs, le champ sanitaire est tel que pour obtenir des résultats à court terme, il est facile d’intervenir sur des déterminants de la santé dont la responsabilité incombe à d’autres secteurs dont les contraintes au Congo limitent l’action pour le moment. La mission a retrouvé des exemples en matière d’eau et d’assainissement, d’assistance sociale ou de développement socio-économique. Il importe que ces interventions puissent rapidement impliquer leurs acteurs « naturels ». L’élément le plus important au chapitre du développement durable est sans doute la temporalité des projets de développement. La dégradation des conditions sanitaires au Congo crée un contexte d’urgence qui relègue au second plan la structuration pourtant essentielle du système de santé. Cette situation est accentuée par les différents plaidoyers développés soit par les acteurs de l’aide humanitaire, soit par des organisations à vocation plus thématique (enfance, maladies, etc.). L’approche projet et l’horizon de financements qui lui est propre donne à l’action de développement un rythme saccadé peu compatible avec le développement de dynamiques organisationnelles et sociales. Les expériences réussies de développement sanitaire apparaîssent à cet égard liés à des capacités locales d’ingénierie financière permettant d’atténuer ces saccades, mais égalemment à des capacités sociales et techniques permettant de résister aux plaidoyers (ex. Bwamenda, Kisantu…). Méthodes et stratégies opérationnelles La Belgique utilise donc plusieurs mécanismes pour appuyer la RDC en matière de développement sanitaire : coopération directe, coopération indirecte (via ONG et institutions universitaires), coopération internationale, Fonds mondial. Tout se passe aujourd’hui comme si chaque mécanisme obéissait à une logique propre, sans grand lien entre les programmes relevant de chacun. Il est nécessaire de créer ce lien dans le cadre d’une logique d’intervention harmonisée. La mise en place du « desk – pays» à Bruxelles pour la coopération indirecte est un pas dans cette direction, mais subsiste le problème de la maîtrise d’ouvrage de la DGCD sur la coopération Belge au sens large introduite au chapitre de la discussion sur le partenariat. Il nous paraît important que l’inscription de certains objectifs du plan de développement sanitaire au programme de coopération (ex. développement des ZS) soit faite selon les mêmes modalités de coopération directe ou indirecte, ne serait ce que pour en faciliter la comptabilisation dans le compte congolais de la santé, et le suivi par les services du Ministère et / ou l’Ambassade Dire que la DGCD détient la maîtrise d’ouvrage de la coopération de la Belgique en matière sanitaire dans la mesure où elle est comptable des deniers publics belges engagés sur des actions de coopération et ou elle participe au dialogue politique bilatéral peut sembler un truisme. Ce point nous paraît important à préciser car ce rôle n’est pas évident aujourd’hui au Congo. Sans préjuger de la cohérence de l’ensemble du programme, le Bureau des attachés,
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 31
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
et donc l’Ambassadeur, ne dispose pas d’une vue d’ensemble de son portfolio. Sa faiblesse logistique nuit à sa claire visibilité par les partenaires. Dans le cadre de l’aide belge, la CTB n’entre pas en concurrence avec les ONG Belges54, mais comme on l’a vu elle entre en concurrence avec d’autres acteurs non étatiques belges (ONG et universités) sur des appels d’offres ou à proposition de projets financés par d’autres bailleurs55. Le dispositif belge ne prévoit pas de maîtrise d’ouvrage déléguée dans lequel la CTB jouerait le rôle de gestionnaire d’un fonds (par exemple d’appui aux ZS). Un tel montage aurait l’avantage d’éviter la compétition précédemment décrite sur la thématique du Fonds56 en maintenant l’implication de la CTB, et de faciliter le montage financier des acteurs Belges et la comptabilisation des opérations au niveau sectoriel. S’il recentre le rôle des ONG sur la maîtrise d’œuvre de certaines actions, il n’empêcherait pas une intervention en maîtrise d’ouvrage classique de la coopération indirecte à la marge du plan sectoriel. Une maîtrise d’ouvrage affirmée et renforcée de l’Ambassade sur le dispositif de coopération permettrait que puisse sous son égide être discuté entre acteurs de la coopération directe et indirecte (par exemple dans le cadre d’une plateforme ONG élargie à la CTB) l’engagement de la CTB en maîtrise d’œuvre sur financements ou maîtrise d’ouvrage non Belges. La fin prochaine de la transition et l’engagement du pays vers des actions de développement structurel nécessite que soit engagée dès maintenant une réflexion sur les conditions de rétablissement des mécanismes de coopération normale, notamment la reprise des commissions mixtes de coopération dans le cadre desquelles un programme unique d’appui au secteur sanitaire sera négocié, la mise en place d’un Comité Mixte de Suivi et les modalités de facilitation de la mise en œuvre, en particulier la création de régies nationales ; ces conditions pourraient être intégrées au dialogue qui devrait être initié avec le nouveau gouvernement ; La mise en œuvre des projets requiert une charge administrative importante et dans le cadre indirect et dans le cadre direct. Compte tenu de son lien avec le déblocage des fonds, cette charge administrative est souvent assumée au détriment de l’appui technique proprement dit. La concentration à Bruxelles d’un certain nombre d’opérations administratives est également à l’origine de lenteurs. Si la déconcentration n’est pas possible, un montage en maîtrise d’ouvrage déléguée comme décrit plus haut pourrait alléger et accélerer la gestion. Le développement d’une approche sectorielle requiert que le dialogue politique soit doublé d’un dialogue technique entre un groupe de bailleurs et le ministère, mais également et parallèlement au sein même du groupe de bailleurs. Dans la mesure où seule l’ambassade dispose de la légitimité politique, il est nécessaire que la double compétence y soit développée et maintenue de manière durable. Un engagement dans la voie d’un programme sectoriel impose également une clarification des rôles de maître d’ouvrage, maître d’ouvrage délégué et maître d’œuvre des opérateurs belges dans cette nouvelle configuration. Renforcement des capacités Le renforcement des capacités est un des piliers traditionnels de l’appui de la Belgique. Non seulement l’appui au Congo mais le fait que le système universitaire Belge permette encore un large accès à des Congolais en garantissant leur retour au pays et maintienne des liens 54 Encore qu’au Bas Congo, et la CTB à Matadi et le consortium ACOR-D à Kisantu appuient le développement de centrales de médicaments sous financement de la Belgique… 55 Par exemple dans le cadre du programme de la BM sur lequel opère également la CTB, le CEMUBAC fournit un appui au développement de zones de santé, à la mise en place de Centrales de médicaments, et un appui institutionnel à des Inspections provinciales. 56 Pour peu bien sûr que la CTB ne mette pas directement en œuvre des interventions sur le Fonds qu’elle administre.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 32
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
académiques forts avec l’Unikin est fortement appréciée. La Belgique est avec les Etats Unis et la Commission Européenne le principal partenaire de l’enseignement supérieur en santé au Congo. Une particularité de l’aide indirecte belge réside dans les liens étroits qu’ont tissé certaines ONG Belges avec l’université (FOMETRO, CEMUBAC). L’implication de ces ONG permet aux projets à la fois de bénéficier du capital intellectuel de l’université Belge, et de garantir une formation et un encadrement des professionnels congolais impliqués. Ce type de système apparaît particulièrement pertinent. L’appui aux écoles de formation (ITEM / Formation A2) ressemble à une « navigation à vue » en l’absence d’un plan stratégique de développement des ressources humaines et d’une planification des besoins quantitatifs et qualitatifs en formation initiale et continue. La réforme envisagée prévoit la révision des curricula de formation pour assurer notamment la prise en charge des dimensions « gestionnaires » et « stratégies de lutte contre la maladie», ce qui contribue à une meilleure adéquation de la formation aux besoins, mais elle ne s’attaque pas à la planification des besoins ; Stratégies de financement Le développement d’une politique de financement réalisé par un groupe de travail réuni autour de la 7ème Direction (DEP) s’appuie largement sur l’expérience belge en matière de stratéiges de financement. Le document d’octobre 2004 reconnaît que la mise en œuvre de la politique de financement « appelle une série de réformes dans l’organisation des structures des soins […], la révision du système de tarification des soins et la catégorisation des actes médicaux par niveau. Quatre axes stratégiques sont ainsi envisagés :
• Une mobilisation des ressources complémentaires en faveur du secteur de la santé, reposant essentiellement sur l’augmentation de la part du budget de l’Etat allouée à la santé, la diversification du financement intérieur et la mobilisation des ressources extérieures.
• L’amélioration de la décentralisation, de la gestion et de l’utilisation des ressources du secteur.
• L’amélioration de la participation communautaire y compris la promotion des mutuelles de santé, le renforcement du partenariat Public-Privé et le renforcement des cadres de concertation et de coordination.
• L’amélioration de l‘accessibilité financière de la population aux soins de santé avec une attention particulière accordée aux plus pauvres, aux indigents ainsi qu’aux personnes vulnérables.
Si la vision se révèle claire et pertinente sur une grande partie des stratégies, elle appelle cependant certains commentaires :
• Il est paradoxal qu’une politique de financement de la santé n’ait comme partie prenante que le seul secteur de la santé quand la lutte contre la pauvreté constitue un axe clé de la politique du Gouvernement. En visant l’accroissement des revenus des plus pauvres par des activités génératrices de revenus, le Ministère de la santé se substitue à d’autres ministères dont relèverait plus la solvabilisation de la demande ou le développement socio-économique. Il serait par ailleurs opportun de faire entrer dans une telle perspective la prise en compte du risque santé dans les approches coopératives (production, microcrédit, etc.).
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 33
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
• La participation de la communauté est envisagée dans la continuité des tentatives de mobilisation communautaire sur la santé des années passées. La politique de financement n’intègre pas la perspective de décentralisation administrative où la légitimité reposera sur l’élection démocratique des organes de gestion des collectivités territoriales. Le recours au financement mutualiste est très optimiste compte tenu des difficultés de cotisation rencontré dans les tentatives communautaires et le faible développement d’un emploi salarié pouvant cotiser.
• Une diversification des financements est envisagée dans un contexte où le Ministère de la santé reste à la fois le principal prestataire de services et l’exécuteur des financements publics pour la santé. Si des principes de fonds sociaux et de sécurité sociale sont introduits, il n’est pas explicitement prévu que ces systèmes interviennent sous la forme de tiers payant, ni quels seront leurs rapports avec les financements publics.
• Une part importante du financement de la santé va reposer pendant encore de nombreuses années sur l’aide externe, mais ne sont envisagées ni les modalités dont celle-ci va compléter les engagements de l’Etat Congolais, ni la façon dont les appuis pourraient être coordonnés pour en maximiser l’impact.
• Bien que l’organisation soit reconnue comme un élément clé, il n’est pas spécifié comment des instruments permettant de réaliser de substantiels gains d’efficience (coordination, économies d’échelle, intégration, etc.) seront appliqués au secteur. Il est nécessaire de s’interroger sur l’opportunité de continuer à faire fonctionner 320 écoles de formation, 31 centrales d’achat de MEG, la transfusion sanguine au niveau des structures de premier contact, 515 zones de santé, etc.
• Le médicament reste, à travers le recouvrement de coûts, chargé d’une mission de financement de la santé qui nous paraît en contradiction avec le désir d’évoluer vers une tarification à l’acte que porte le développement d’une codification.
• La politique élude un aspect important du financement du secteur qu’est celui des programmes à caractère social pour lesquels la gratuité est nécessaire (ex. PEV, lutte contre la tuberculose, la lèpre, etc.)
La discussion de cette politique constitue un point central de la programmation du 9ème FED qui pose le développement d’une politique de financement comme un processus qui constitue l’objectif spécifique du programme. Ce programme fait l’hypothèse que la Belgique continuera à être une partie prenante clé du dialogue sur le financement. Il est par ailleurs souhaitable que l’audit organisationnel qui va être réalisé avec l’appui dela Belgique examine la possibilité de séparer les fonctions de production et de dispensation de soins de celles de régulation (administration, gestion, législation, supervision, contrôle et inspection).
Actions de plaidoyer La Belgique est un partenaire clé du développement sanitaire au Congo, dont le plaidoyer en faveur des soins de santé primaire et du développement des zones de santé est connu et reconnu par l’ensemble des partenaires. Le plaidoyer en faveur de l’intégration est affaibli par la cohérence de certains appuis et l’absence d’engagement dans la recherche sur l’amélioration de l’intégration des programmes dans le cadre des services de santé. Au niveau de la coopération directe, il existe une confusion entre l’Ambassade et la CTB, que la faiblesse logistique du Bureau des Attachés contribue à entretenir et qui doit être . Au niveau de la Coopération indirecte, les acteurs belges sont également bien connus et reconnus.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 34
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Plan d’action par pays Il n’existe pas de plan d’action qui décline la mise en œuvre de la NSP pour la santé et cette carence affecte la pertinence et l’impact de l’aide Belge. Il n’existait jusqu’à une période récente pas de tableau de bord permettant facilement à l’Ambassade de connaître les progrès réalisés sur le portfolio de projets directs et indirects, ne serait-ce qu’à travers le progrès des décaissements. Le bureau des attachés s’est engagé dans son développement. Les difficultés à connaître l’ensemble du portfolio sont déplorées par la DEP, dont la fonction de mappage des interventions est ainsi affaiblie. La difficulté à fournir des éléments sur l’ensemble de son aide affecte également la crédibilité de la Belgique quand elle prône la coordination vis-à-vis des partenaires Congolais ou au développement et souligne l’importance de pouvoir disposer rapidement d’un tableau de bord. La recherche Si la recherche constitue un des axes de coopération de la NSP, l’implication de la Belgique dans la recherche au Congo se limite à l’appui que fournit l’IMT au Laboratoire national de référence du SIDA. Le type de recherche qui y est réalisé est peu opérationnelle, en particulier sur les modalités de fournir les services à moindre coût. La recherche opérationnelle reçoit une attention limitée dans les projets visités. Une exception rencontrée lors des visites est la recherche-action réalisée sur le financement de la santé dans la ZS de Kisantu (ACOR-D) qui a largement été discuté plus haut. Ce projet fait l’objet d’une thèse à l’ULB. Dans le contexte du Congo et vu l’implication de la Belgique dans le financement de la santé, le faible investissement en matière de recherche sur le financement ou les gains d’efficience nous paraît constituer une opportunité manquée. Fonds global Au niveau global, les engagements de la Belgique au niveau du Fonds mondial s’élèvent à 47,8 M US$, soit 0,6% des engagements totaux. Ses décaissements s’élèvent à 29,7 M US$, soit 7,1% des décaissements totaux57. Les financements belges aujourd’hui contribuent donc de manière substantielle aux opérations du Fonds. Le Congo a soumis avec succès une proposition pour la tuberculose au 2ème appel du Fonds mondial et pour le SIDA et le paludisme au 3ème appel. Une soumission vient d’etre réalisée à l’appel de 2005.
Millions US$
Appel To ta l progra m m ̌
D ̌c ai s sˇ
Total 2 et 3 17 5 18,5 SIDA 3 113,6 6 Paludisme 3 53,9 5,8 Tuberculose 2 7,6 6,4
Le mécanisme de coordination national (CCM) est présidé par le Ministre de la santé et rassemble largement les bailleurs. Les entretiens indiquent d’importantes difficultés de fonctionnement de cette instance liées pour partie à une faiblesse administrative malgré le financement adéquat d’un support administratif, et d’autre part à une disponibilité et un engagement insuffisants des exécutifs congolais. Dans ces conditions, l’examen des propositions soumises au dernier appel a été très limité et le rôle de coordination du CCM a juqu’ici été essentiellement symbolique. Les représentants d’agences qui y participent
57 http//www.theglobalfund.org
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 35
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
portent sur le fonctionnement de cette instance un jugement sévère. La représentation belge au niveau du CCM souffre de la confusion entre ambassade et CTB discutée plus haut. Cette représentation doit être clarifiée car la CTB est récipiendaire secondaire, et sa participation au CCM créerait un conflit d’intérêts. Le Principal récipiendaire (PR) désigné pour les trois programmes est la représentation du PNUD en RDC. Seul pour le moment le porgramme Tuberculose dispose d’un recul suffisant pour permettre de porter un jugement. Sur le plan administratif, les délais de traitement des réquisitions sont longs pour une administration décentralisée, et l’exécution en régie des dépenses n’est pas prévue. Sur le plan logistique, l’efficacité nee semble pas meilleure que celle de la Fondation Damien en termes de qualité et délai de livraison. Des équipements livrés sont identifiés du logo du PNUD au lieu du Fonds mondial. Si le principe d’un liquidateur de la dépense différent de l’ordonnateur est conforme à un environnement public, le choix du PNUD pose le problème d’une procédure de liquidation qui n’est pas celle du maître d’ouvrage. Pour ce qui est des récipiendaires secondaires (SR) privés (ONG), le système fonctionne commme une échelle de projets, des garanties financières étant requises, que nombre de partenaires locaux (ex. BDOM) ne peuvent fournir. Si les moyens supplémentaires mobiliisés sont bienvenus, les mécanismes du FM confrontent le développement sectoriel à un important défi structurel. La préparation des propositions est essentiellement le fait des programmes eux-mêmes avec une assistance technique fournie par des bailleurs thématiques. Elle n’implique que marginalement les autres instances du Ministère comme la direction de tutelle des programmes (4ème Direction) ou la DEP. De même, l’exécution des programmes requiert le développement au sein même des bureaux centraux de cellules de gestion autonomes. On n’est pas loin dans les faits d’un système de gouvernance distribuée, les programmes fonctionnant comme des agences parapubliques. Conclusions Il ressort de la discussion qui précède que la Coopération de la Belgique au Congo est globalement en accord avec les termes de la Note stratégique santé, du point de vue de la production de soins de santé globaux (SSP et programmes spécifiques). Le mode de coopération, directe ou indirecte, n’apparaît pas être un facteur clé de l’efficacité des actions. L’efficience de certains projets peut être affectée par des choix d’investissement ou de technologie, ou par le temps d’assistance technique requis par la gestion administrative au détriment de la mission spécifiquement technique. Les initiatives en matière d’accessibilité se heurtent à des contraintes structurelles majeures :
• Il existe aujourd’hui un « abyme » entre les ambitions du système (normes de service et d’organisation) et les ressources (Humaines et financières). Une vision figée de l’organisation la fait considérer comme une norme qu’il faut atteindre, plus que comme une ressource plus malléable que l’on peut ajuster pour atteindre des objectifs. Une telle approche prive par exemple la Belgique de mettre à profit certaines de ses expériences comme l’application de l’intercommunalité à la décentralisation.
• Au cours de la phase de transition il a été difficile d’établir un dialogue politique constructif sur les enjeux sectoriels, pour des raisons relevant autant des Partenaires internationaux que de la Partie Congolaise.
L’impact réel de la coopération reste encore difficile à apprécier. Sur le plan des résultats, les systèmes d’information restent faibles et parcellaires, mais les observations indiquent que sur les zones couvertes la production de services de santé s’améliore. Peu d’information est disponible de manière globale sur l’utilisation des ressources et leur relation à la production
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 36
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
de résultats. Il est présomptueux en l’état actuel de parler d’un impact sur la santé proprement dite. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble des partenaires reconnaît à la Belgique un rôle clé dans le développement et la production de soins de santé primaires et le développement des Zones de santé, et la qualité des cadres du système formés à « l’école Belge ». La pertinence de la NSS est par ailleurs affectée par un niveau de détail qui, pris au pied de la lettre peut constituer une contrainte pour le développement des Stratégies Pays dans la mesure où aucune flexibilité n’est définie. Il nous paraît important de préciser le niveau stratégique des documents : Orientation stratégique pour la NSS qui permet de construire des stratégies, Application stratégique pour la NSP qui débouche sur des budgets. Le niveau de détail de la NSS peut constituer un obstacle à l’appréhension par les acteurs de coopération du système de santé comme un tout, et partant à la réalisation de l’ambition de soins de santé globaux. Si le souhait d’intégration des axes spécifiques (santé de la reproduction, maladies transmissibles) est bien affirmé, la NSS ne propose aucune stratégie à cette fin alors que sur le terrain des acteurs belges ont depuis longtemps développé des expériences dont l’étude permettrait de tirer d’utiles enseignements à ce niveau. La NSS n’est d’aucun secours pour le contexte d’Etat fragile et les situations de transition dans les deux sens entre situations de crise et de développement. Bien que notre mission n’ait pas englobé le champ de l’action humanitaire, ce vide nous paraît important à combler dans la mesure où souvent les mêmes acteurs de coopération indirecte engagent des deniers publics au bénéfice des mêmes populations pendant toutes ces périodes. La NSS est fortement centrée sur des aspects techniques de coopération sanitaire, mais est de peu de secours pour ce qui concerne les liens entre action technique et action politique. A la clé se trouve la réponse à deux questions clés pour le dispositif de coopération en RDC : Doit on pallier ou doit on réformer ? Peut-on réformer ? Sous l’impulsion de l’Ambassade, le dispositif de coopération semble évoluer de réactif à proactif. Le rôle de l’Ambassade se précise dans la coordination et la cohérence du dispositif de coopération, mais les moyens pour lui permettre de pleinement assumer la maîtrise d’ouvrage de la coopération sont à renforcer. Le rôle de l’Ambassade dans l’identification des projets est nécessaire pour équilibrer les actions du portfolio stratégique, puisque aujourd’hui, la recherche qui constitue un des trois axes de la NSP est en fait le parent pauvre du dispositif. Dans une perspective de révision de la NSS, la DGCD pourrait investir dans une recherche en matière de systèmes de santé, plus particulièrement pour tirer les leçons de l’expérience belge en matière d’intégration ou de place du secteur privé dans les SSP. L’approfondissement de la réflexion sur la place de la coopération sanitaire dans les dispositifs d’aide aux Etats fragiles et la transition entre crise et développement nous paraît également primordial. Les observations de la mission montrent que le développement d’une approche sectorielle (SWAP) pour la santé en RDC constituent une réponse pertinente à nombre de défis sectoriels actuels. Cette option est compatible avec la NSS et au Congo où un tel modèle est souhaité, la Belgique pourrait jouer un rôle promoteur pour peu que son dispositif administratif lui permette de proposer l’hébergement de fonds communs thématiques. Pour améliorer la cohérence de ses appuis entre eux et avec la NSS et les politiques locales, la DGCD pourrait inscrire les interventions appuyées dans le cadre d’un programme unique aux objectifs définis par rapport à la problématique spécifique du pays et visant un meilleur impact sur le développement du secteur. Un tel programme définit en fait la composante santé de la NSP. Dans ces conditions, le rôle de l’Ambassade dans la décision de financement des projets est primordial car elle est l’interlocuteur direct de la tutelle sectorielle. Une harmonisation des modalités directe et indirecte de mise en œuvre des actions de coopération est nécessaire pour celles qui occupent une place centrale dans la
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 37
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
politique nationale de santé. Une délégation de maîtrise d’ouvrage à travers la création d’un fonds d’intervention pourrait être envisagée à cette fin ; la CTB apparaît indiquée pour jouer le rôle de maître d’ouvrage délégué. Au-delà des structures mixtes de suivi, il serait également utile que les projets puissent bénéficier d’un accompagnement technique externe sur la durée de leur mise en œuvre. Une meilleure coordination des partenaires est incontournable pour produire un impact sectoriel. Il est à ce titre essentiel que des thèmes comme l’écart entre ressources et ambitions, accessibilité financière des plus pauvres, et possibilité de mobiliser des ressources par des gains d’efficience à côté de l’obtention de financements supplémentaires, puisse occuper une place centrale dans les discussions entre les partenaires nationaux et internationaux. Une meilleure lisibiliité de l’action de la Belgique par une meilleure diffusion de ses stratégies sectorielle et de coopération est nécessaire. Une coopération accrue entre bailleurs est bien évidemment nécessaire et la poursuite de la promotion d’un dialogue accru entre bailleurs majeurs est souhaitable. A ce titre, l’opportunité de coordination qu’offre l’Union Européenne doit être davantage exploitée, d’autant qu’au Congo existe une convergence majeure entre les orientations de la Belgique et celles de la Commission. L’expérience mozambicaine montre aux bailleurs qu’un SWAp peut faciliter la coordination de l’aide par rapport à des projets négociés de façon indépendante même dans un contexte de reconstruction. L’option exprimée dans la phase préparatoire de la NSP incitant « le partenaire Belge à être rigoureux dans l’interprétation des sollicitations de développement durable du Congo et donc à répondre favorablement à certaines demandes d’appui où d’autres partenaires manifesteraient davantage de prudence » pourrait permettre à la Belgique de jouer en RDC le rôle de catalyseur de l’approche sectorielle qu’a joué la Suisse au Mozambique.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 38
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 1. Tableaux à remplir concernant le diagramme d’impact
Fonctions essentielles du secteur public
appuyées
Projet Tous projets belges Autres intervenants Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
Appui à la Direction Etudes et planification Volet appui IP de ASSBC Tous projets appui aux ZS et aux programmes nationaux Appui aux mutuelles et à la génération de revenus pour la santé
Commission Européenne (Approche contractuelle et discussion / opérationnalisation de la politique de financement) Banque mondiale (stratégie des ZS et médicament)
Politique de santé et du médicament formulées par le Ministère. Draft de politique de financement préparé avec l’appui de la Belgique, qui ne répond que partiellement aux enjeux majeurs de financement de la santé dans un contexte d’extrême pauvreté. Importantes corrections et innovations apportées par 9ème FED, en ligne avec les orientations de la Note stratégique. Appui de tous les partenaires à la mise en œuvre de la stratégie des ZS
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
Appui à la Direction Etudes et planification
Aucune synergie Large diffusion de l‘approche du Cadre logique due essentiel-lement au PATS (CE). Appui au SIS national (CE via ONG Belge)
Organisation (processus et responsabilités) insuffisante Absence de définition des coûts paramétriques du PMA au premier niveau. Flou sur le Paquet de 2ème niveau et absence de coûts paramétriques. Absence de consensus sur stratégies d’implantation du PMA dans les ZS entre bailleurs. Interventions déstabilisantes des bailleurs à plaidoyer thématique (agences UN) car pas de possibilité structurelle de financer des paquets. Pas de plan sanitaire consolidé consensuel et de ce fait, pas de Cadre de dépenses à moyen terme. La CE a contourné le problème des coûts paramétriques en introduisant le tiers payant sur le paquet payant avec accessibilité nécessaire (SMI, curatif) et en finançant la gratuité des programmes où elle est déjà acquise (LTB, PEV). Elle appuiera la définition du CDMT.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 39
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Fonctions essentielles du secteur public appuyées
Projet Tous projets belges Autres intervenants Commentaires
Législation et fonctions régulatrices établies
Législation : Aucun Fonctions régulatrices :
Législation : Aucun Législation : Aucun Aucun projet n’a soutenu cette fonction. Contrainte majeure au niveau des fonctions de régulation par le fait que le régulateur est financé par le régulé (système de l’ « ascenseur »), qui en fait une priorité secondaire par rapport à la résolution Il s’agit là d’une faiblesse mais non d’une priorité compte tenu des difficultés déjà rencontrées dans les fonctions de production de soins et les contraintes sur les ressources. Il est encore prématuré pour parler d’une régulation par Minsanté
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Appui à l’Ecole de santé publique (ind.) et Appui Secteur Santé Bas Congo (bilat)
Appui aux ITEM inclus dans plusieurs projets d’appui aux Zones ou indépendants (APEFE). Primes au personnel
Financement du revenu (« Primes ») des personnels de santé (production et gestion), de manière hétérogène malgré grille réalisée avec la DEP
Il s’agit aujourd’hui de la principale faiblesse du secteur, sur laquelle aucun bailleur ne s’est encore engagé, et dont la prise en compte est d’ores et déjà exclu des programmations de la BM (aucun appui système) et de la CE (focus sur financement). La Belgique est un des partenaires le plus engagé dans le domaine à travers sa coopération directe et indirecte (formation et rémunération). Le problème des « primes » affecte en profondeur tous ses projets. Du fait de son implication dans la planification et la réforme de la fonction publique, un engagement de la Belgique à ce niveau aurait une forte cohérence interne, en plus de son indéniable pertinence au niveau sectoriel. Il serait également très complémentaire de l’appui de la CE au financement de la santé
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 40
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Appui Secteur Santé Bas Congo (bilat)
Aucun Appui CE et BM aux centrales de distribution régionales. Appui CE à leur organe national qui sera renforcé et complété d’un appui à la régulation du médicament (9ème FED)
L’organisation du secteur est à ses débuts et fait ressortir d’importants problèmes de gouvernance créant conflit des bailleurs avec le Ministère (« Affaire SAFARCO »). La Belgique s’est impliquée par le niveau régional sur la disponibilité et la dissociation du médicament de la fonction de vecteur du financement. L’appui futur va renforcer cette composante. La coordination et la complémentarité avec l’action de la CE apparaît indispensable sur le plan du développement pharmaceutique stricto sensu, mais aussi au niveau de la viabilité économique des centrales appuyées ou créées.
Allocation des ressources améliorée
Tous projets évalués
Tous projets à l’exception (au bénéfice du doute) des projets relevant d’une logique humanitaire
Tous projets jusqu’ici. La programmation 9ème FED introduit le principe d’équité allocative sur des services pro-pauvres.
L’allocation des ressources est effectivement améliorée, puisque de presque rien, les projets permettent un certain niveau allocation de ressources
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
Appui à la Direction Etudes et planification
Aucun La programmation 9ème FED introduit le principe d’une recherche d’efficience
L’appui à la DEP n’envisage d’améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources seulement à travers la coordination des bailleurs. Le principe d’efficience n’a jusqu’ici pas été au centre des interventions et des programmations des bailleurs / ONG. La faiblesse inhérente à l’approche projet atteint des niveaux élevés car peu d’efforts au sein même des dispositifs des bailleurs sont couronnés de succès pour rationaliser l’allocation des ressources (absence de cadre de planification et de budgétisation), résultant en une iniquité de l’allocation des moyens et des bénéfices puisque seuls ces moyens sont à même de les produire. Une première raison en est le « saupoudrage » des projets de différents bailleurs au niveau d’une province. Une deuxième raison est la compétition à un même niveau de programmation de l’aide directe et indirecte, la première ayant moins de contraintes d’enveloppe. Une troisième raison la confusion maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre d’ONG internationale que les règles de cofinancement contraignent à intégrer les conditions parfois contradictoires des bailleurs qui les financent sur un même projet d’appui. Se rajoute à ces contraintes le fait que les agences des Nations Unies développent (de par leur vocation où l’opportunité) des actions de plaidoyer (enfance, population, maladies) qui, au delà de l’éparpillement commun des interventions, ne
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 41
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
peuvent statutairement couvrir l’ensemble des besoins et sapent donc les efforts d’intégration par des appuis verticaux sur leurs thèmes. Paradoxalement, les financements de ces interventions sont parfois issus de coopérations bilatérales à travers les dispositifs bi-multi.
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 42
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Fonctions essentielles du secteur public appuyées
Projet Tous projets belges Autres intervenants Commentaires
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
Bureau des attachés, Appui à la DEP, Appui SS Bas Congo,
Initiaitves ad hoc sur certains thèmes seuls
Politique d’information et système d’information établis
Appui au Secteur Santé au Bas Congo
Tous projets d’appui aux zones de santé (au bénéfice du doute)
Projet d’appui à la gestion de l’information sanitaire (PAGIS) CEMUBAC sous financement CE, Appui aux Inspections provinciales (CEMUBAC/CE, Medicus Mundi/BM)
Le SIS reste faible au niveau national. Il fonctionne au niveau des provinces et des zones appuyées, en particulier par la Belgique, mais n’est pas standardisé. Les systèmes d’information gestionnaire sont embryonnaires
Stratégies de financement de la santé établies
Appui à la DEP, Appui au Secteur santé au Bas Congo
??? C’est réellement le 9ème FED qui s’attaque à définir des stratégies de financement saines
L’appui à la DEP a jeté les bases de la politique de financement de la santé et a fait admettre le principe de sa nécessité. Les projets belges évalués manquent de vision d’ensemble de la problématique de financement en se concentrant sur des points précis mais sans réelle cohérence économique d’ensemble. Le problème de solvabilité est constamment cité comme aigu, au niveau de la demande de soins mais aussi au niveau de la contribution à une assurance. La réponse à ces derniers points propose la création d’activités génératrices de revenu. L’intégration de tels objectifs dans les programmes de santé est pertinent d’un point de vue social, mais très incohérent d’un point de vue de développement durable car déliés de l’action dans ces autres secteurs.
Tableau 18
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 43
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Impact sur les fonctions essentielles du secteur
public
Projet Projets belges Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
Législation et fonctions régulatrices établies
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Allocation des ressources améliorée
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
Politique d’information et système d’information établis
Stratégies de financement de la santé établies
Tableau 19
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 44
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Fonctions essentielles du secteur public
faiblement prises en charge dans le secteur santé Oui / non Commentaires
Politique de santé développée et traduite en stratégies nationales de santé
Oui
Cadre Institutionnel pour la planification stratégique établie
Législation et fonctions régulatrices établies
Secteur des ressources humaines en santé régulé et organisé
Secteur Pharmaceutique régulé et organisé
Allocation des ressources améliorée
Environnement pour l’utilisation efficiente des ressources établi
Environnement favorable pour communiquer avec le Parlement, la société civile, les partenaires et les organisations locales établi
Politique d’information et système d’information établis
Stratégies de financement de la santé établies
Tableau 20
Résultats sectoriels : focus principal de l’appui du projet
Projet Projets belges Commentaires
Soins de santé essentiels définis et disponibles
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre le secteur public et les secteurs privés
Oui pour ce qui concerne le privé confessionnel, non pour ce qui concerne le privé lucratif
Ressources humaines compétentes et motivées en place Si des RH compétentes sont souvent en place, leur motivation est
hétérogène et liée à des projets à tous les niveaux
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 45
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Pouvoir de décision et de gestion, décentralisé au niveau approprié Vrai sur nombre de projets (ASS BC, PNT), pas vrai sur appui PNLS
Système d’encouragement à la performance en place Primes en place, mais représentent essentiel de rémunération
Accès aux médicaments essentiels et approvisionnement assurés Disponibilité assurée par les projets, mais accessibilité économique
incertaine. Politique de subvention différente selon les projets
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins Oui
Participation du parlement, de la société civile, des partenaires et des communautés locales assurée
Parlement non, société civile comme maître d’œuvre, partenaires. Communaités impliquées sur la plupart des avec vigilance sur récupération de l’implication
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés Oui
Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain Oui
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services Oui
Le financement de la santé est efficace Non
Le financement de la santé est équitable et juste Non
Tableau 4
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 46
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Résultats sectoriels faibles ou problématiques Oui / non Commentaires
Soins de santé essentiels définis et disponibles Oui Paquet d’activités primaire établi, secondaire moins net
Soins de santé essentiels accessibles par une collaboration effective entre le secteur public et les secteurs privés Oui Oui pour ce qui concerne le privé confessionnel, non pour ce
qui concerne le privé lucratif. Apporche contractuelle en place (CE)
Ressources humaines compétentes et motivées en place Si des RH compétentes sont souvent en place, leur motivation est hétérogène et liée à des projets à tous les niveaux
Pouvoir de décision et de gestion, décentralisé au niveau approprié Oui Vrai sur nombre de projets (ASS BC, PNT), pas vrai sur appui PNLS
Système d’encouragement à la performance en place Oui Primes en place, mais représentent essentiel de rémunération
Accès aux médicaments essentiels et approvisionnement assurés Non Disponibilité assurée par les projets, mais accessibilité économique incertaine. Politique de subvention différente selon les projets. Approvisionnement encore peu compétitif. Couverture limitée
Soins de santé essentiels offerts ou contractés en fonction des besoins Oui Oui, mais couverture limitée aux zones de projet
Participation du parlement, de la société civile, des partenaires et des communautés locales assurée Oui Parlement non, société civile comme maître d’œuvre, partenaires.
Communaités impliquées sur la plupart des avec vigilance sur récupération de l’implication
Normes et valeurs culturelles, priorités locales et droits des patients respectés Oui Oui
Usagers sensibilisés aux aspects de comportement sain Oui Oui, mais couverture limitée aux zones de projet
Information basée sur l’évidence utilisée pour l’amélioration de l’offre des services Oui Oui
Le financement de la santé est efficace Non Non, le PMA est délivré mais uniquement en zone de projet. Le financement par les usagers est largement insuffisant
Le financement de la santé est équitable et juste Non Non, les plus pauvres ont insuffisamment accès aux soins ainsi qu’aux programmes, sauf PNTL
Tableau 5
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 47
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Autres secteurs appuyés Projet Tous projets belges
Autres intervenants
Commentaires
Politique et stratégies de population établies
Politique et stratégies de nutrition établies
Politique et stratégies d’eau et hygiène établies
Politique et stratégies de l’éducation établies
Politique et stratégies environnementales établies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
Politique et stratégies de sécurité routière établies Non
Environnement favorisant un comportement sain en place Non. Expas de prévention de l’alcoolisme ou du tabagisme
Tableau 6
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 48
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Autres secteurs faibles concernant les actions liées à la santé Oui /non Commentaires
Politique et stratégies de population établies
NON D’une manière générale, le développement des politiques et stratégies souffre de la crise institutionnelle et de la faiblesse des administrations de tutelle
Politique et stratégies de nutrition établies NON Idem Politique et stratégies d’eau et hygiène établies
NON Idem
Politique et stratégies de l’éducation établies
Idem
Politique et stratégies environnementales établies, y inclus l’environnement du domicile, sur le lieu de travail et l’environnement ambiant
NON Idem
Politique et stratégies de sécurité routière établies
NON Fort délabrement de l’infrastructure routière et de transport
Environnement favorisant un comportement sain en place
NON Les antécédents politiques, les guerres, les difficultés de la période de transition, et la modicité des moytens aujourd’hui disponibles quelles que soient les sources, constituent des obstacles majeurs au développement d’un tel environnement.
Tableau 7
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 49
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 2. Liste des personnes rencontrées
Date Nom Organisation Fonction E-mail Tel 6/07/05 Dr M DESMET Ambassade de
Belgique Attaché santé [email protected] 8989885
Briefing Dr U MENASE Ambassade de Belgique
Attaché santé adjoint 8931903
Visite de courtoisie
SE M. E. BONGELI Ministère de la santé Ministre [email protected] 0810 825 155
M. Elonga-Kelon KASONGO
Ministère de la santé Dir. Cabinet adj. [email protected] 9904448
Réunion du Comité de suivi
Dr C MIAKA Ministère de la santé SG 9904294
Dr H KALAMBAY Ministère de la santé Directeur DEP [email protected] 0815 2033096 M. D BOUCART CTB [email protected] 08100632000 Dr JB KAHINDO CEMUBAC Coordinateur en RDC [email protected] 98165779 M. KATSANINGU
KABENGA Ministère des Affaires Etrangères, Dir Coop. Intle
Directeur [email protected] 98543870
M. MAYELE EBOKWOC
Ministère des Affaires Etrangères, DiEurope
r Directeur 9912565
M. P. LIHAU MOLELI
Ministère des Affaires Etrangères, DiEurope,
r Asst Directeur 0815252110
M. BOKOTA LIKANGAU
Ministère des Affaires Etrangères, Dir Coop. Intle
SG 0815 5011230
7/07/05 Réunion CTB M. D BOUCART Visite au projet Fonds social urbain
Prof. F. LELO NZUZI
Projet Fonds Social Urbain
Coordinateur [email protected] 99 18 816
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 50
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Equipe de la ZS Kisenso
DEP Dr R MELONI DEP AT [email protected] 081 3497304 08/07/05 Réunion ONG Belges
Armand BASANGA LOFOKA
Plateforme ONG Belges
Solidarité Protestante [email protected] 9904046 0819904046
Dr jean BOSSO KAHINDO
Plateforme ONG Belges
CEMUBAC [email protected] 98165779
Barbara DECOSTER
Plateforme ONG Belges
APEFE/PNT [email protected] 0818400003
M. F. SPRIMONT Plateforme ONG Belges
Coordination APEFE [email protected] 9914741
Clara DUCHENNE Plateforme ONG Belges
Malta Belgium International Représentant MSV
[email protected] [email protected]
8951959 0815150980
Dr Pamphile LUBAMBA
Plateforme ONG Belges
Fondation DAMIEN [email protected] 0810595164
Dr SONDJI Plateforme ONG Belges
MPLTM/APRODI [email protected] 9939441
Dr MUTOMBO Plateforme ONG Belges
ARCB-CD [email protected] 98564858
Hugues BONTE Plateforme ONG Belges
CARITAS INTERNATIONAL
[email protected] 0819860601
Andrianne PIERRE Plateforme ONG Belges
FOMETRO [email protected] 0818149000 8923900
Bruno CLAESSENS Plateforme ONG Belges
MEMISA Belgique [email protected] 98339844
Catherine VASSEUR
Plateforme ONG Belges
Handicap International
[email protected] 0815160149
Réunion PNT Dr Gérard KABOTO Ligue antituberculeuse Directeur Dr JN MPUTU PNEL Directeur Dr Fidèle ANAKEKA Solidarité portestante Responsable TB Mlle Barbara
DECOSTER APEFE AT PNT
Dr Pamphile Fondation Damien Coordinateur Congo
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 51
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
LUBAMBA Dr Etienne BAHATI PNT Directeur Réunion Groupe Thématique santé
Dr Marie Jeanne BOKOKO
Coop. Canadienne Conseiller santé [email protected]
Dr Michel MULOHWE
Commission Européenne
Chargé de projet santé
Mme Nancy VANHAVEBEKE
Commission Européenne
Chef section secteurs sociaux
M. Victor WOMITSO PNUD / Fonds mondial
Coordinateur de projets
M. Bouasvan BOUASY
PNUD / Fonds mondial
Chargé suivi évaluation
9/07/05 Récupération passeport et Voyage vers Matadi 10/07/05 Réunion MIP Dr Daniel MUANDA
KIANDIA IPS Bas Congo MIP 98520735
Dr NUMBI Justin Projet ASSBC Expert national Réunion CAMEBO
Ph J NLENDA MATEPO
CAMEBO Directeur
Ph Julien MVEMBA CAMEBO Adjoint M A LUKIE DUAMA CAMEBO Gestionanire stock 11/7/05 Visite clinique trypano mobile et PNTHA Boma
Dr LOKO LUTETE PNTHA Boma Coordinateur
M. MATONDO PNTHA Boma Superviseur M WANGANA PNTHA Boma superviseur equipe
mobile
M BUKA LUMFILA PNTHA Boma Responsable CDTC Boma
Visite ZS Boma ASSBC
Jules TSITA NZAU
ZS Boma Médecin chef de Zone
[email protected] 98406820
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 52
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Flavien MAKIADI ZS Boma Administrateur – Gestionnaire
[email protected] 98522009
KIPA LUAKA ZS Boma Infirmier Superviseur / Lèpre et Tuberculose
[email protected] 98939600
MVIBUDULU NGANA
ZS Boma Infirmière Superviseur / Santé de la Reproduction
[email protected] 98357811
Gabriel MATUKEBA
ZS Boma Infirmier Superviseur / Programme Elargi de vaccination
0819048001
LUKUMU KIOM ZS Boma Nutritionniste 0819048950 André MBAMBI ZS Boma Infirmier
Superviseur / SNIS 0816883626
Claude MAYELA ZS Boma Secrétaire [email protected] 0819042670 BUKAKA
BUSAMBA ZS Boma Chauffeur 0810727030
KHUMBA KUMBU
ZS Boma Préposé à la pharmacie
97556013
12/07/05 Visite PNTL Bas Congo
Dr Richard MBUMBA
Coordination PNTL Boma
Médecin Coordinateur
0819047293 [email protected]
Nicolas BIZEME Coordination PNTL Boma
Ass. En Réhabilitation
0819054481 -
TENDA BAVANGILA
Coordination PNTL Boma
Tech-Laborantin 98441321 -
KHUMBA NDOKI Coordination PNTL Boma
Superviseur Prov. 98440039 [email protected]
Mme DIMASI Coordination PNTL Boma
Secrétaire-Caissière
98441378 -
NKOKO Jacques Coordination PNTL Boma
Chauffeur 98441327 -
SABA MAKASI Coordination PNTL Sentinelles 0819048956 -
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 53
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Boma Réunion ZS LUKULA
Dr A UMBA PHUATI ZS Lukula MCZ
Dr Omer NZITA HGR Lukula directeur M Didier Mbaya HGR Lukula AG M A
SANGOPAMBA ZS Lukula AG
Dr H MBOTU Disctrict bas fleuve MCDS M. LUZEYIMOKO ZS Lukula Superviseur EMA M. F DIANZENZA ITEM Lukula Prefet des études M M MBUNGU ZS Lukula Superviseur TBL M S TSASA ZS Lukula Superviseur PEV Mme D NGOLE ZS Lukula Superviseur SR M M BAKULU Disctrict bas fleuve Chef 1ère cellule M V MABIALA Disctrict bas fleuve Chef 2ème cellule M T MAYINA Disctrict bas fleuve Chef 3ème cellule M M NZAU Disctrict bas fleuve Chef 4ème cellule Réunion société civile ZS Lukula
M. JP DIBANDI Club stop sida Coordinateur
Mme H MALONDA FOMAT LUKULA Animatrice M. O MABIALA CEEPAL Coordinateur Mme M MAVUNGU APROFEL Responsable M. N UMBA CODESA Banginza Président Mme J. KHONDE RCL membre Mme B LEVO
KHONDE Club stop sida membre
M G MUANDA CODESA Lukula Président M A
WEMBANDIATE DGM Lukula Administrateur
M. JD KIAKULANDA
Administration territoriale
Administrateur adjoint
13/07/05 Zone de santé de Kangu
Dr Max NGOMA ZS Kangu MCZ
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 54
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
M. R LANDU-MUAKA
ZS Kangu Superviseur principal
M. S MBOZI HGR Kangu AG Hopital M. J NGOMA-PAKA HGR Kangu Infirmier Mme C TSIMBA
MAKOSSO HGR Kangu Resp Pharmacie
M. JB LAVUNDA HGR Kangu Chef Laboraotire Dr MBUNGU HGR Kangu Directeur AI M. W NIEMBO ZS KAngu AG Retour vers Matadi 14/07/05 Discussion mutuelles avec équipe IPS Matadi Voyage vers Kisantu 15/07/05 ZS Kisantu M. Jean Claude
DEKA CAMEKI Directeur [email protected] 081 080 5311
Dr Emily MULLEN CDS Kisantu Coordinatrice [email protected] 98246684 Michel NSOMBI HGR Kisantu AG [email protected] 98368510 Dr Jacques
KIMFUTA ZS Kisantuy MCZ [email protected] 081 9010482
Narcisse Kimbondo ZS Kisantu Superviseur [email protected] 0819048212 16/07/05 Retour vers Kinshasa 17/07/05 Réunion DFID – Mme R Cooper 18/07/05 Analyse des données de terrain 19/07/05 Réunion DEP Dr Kalambay DEP Directeur Dr Meloni DEP AT CTB
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 55
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Réunion CTB M Boucart Directeur AI CTB M Fraipont Resp. acquisitions CTB Réunion Ecole santé
Pr Directeur Ecole de santé publique
Pr Malengreau Pr visitant Universités Wallones 20/07/05 1ere restititution aux parties prenantes 21/07/05 Restitution au Comité de pilotage - Retour vers l’Europe
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 56
Évaluation du secteur de la santé de la coopération belge
Annexe 3. Liste de documents consultés Commission Européenne : Etude de faisabilité du Programme Santé 9ème FED, Kinshasa, 2005 Coopération Belgo-Congolaise : Etat des lieux de la coopération dasn le secteur de la santé au Congo et indications de coopération bilatérale directe future. DGCD, Kinshasa, Octobre 2002. DGCD : La Belgique et la lutte contre le SIDA. Projet de note stratégique ; Bruxelles, Octobre 2004 DGCD: Note stratégique République Démocratique du Congo. DGCD, Kinshasa, Décembre 2002 Discours prononcé par le Ministre De Decker au Sénat à l'occasion du colloque sur les OMD le 7 mars 2005: http://www.dgcd.be/fr/le_ministre/discours/20050307.html
Ministère de la santé : Décret loi cadre portant sur la santé publique. Juillet 2001 Ministère de la santé : Documents de la Table ronde de la santé, Juin 2005 Solidarité protestante : Evaluation finale de l’appui de la Coopération Belge à la lutte contre la lèpre et la tuberculose au Bas Congo. Alter – Santé Internationale & Développement, Mars 2002, Unikin, 2005 Ministère de la santé : Plan directeur de développement sanitaire 2000-2009, Février 2001 Ministère de la santé : Plan national de développement sanitaire 2004-2006, Septembre 2004 Ministère de la santé : Vade mecum du partenariat dans le secteur de la santé – Septembre 2001 Ministère de la santé, Politique Pharmaceutique Nationale, 2002 Ministère de la santé: Politique Nationale de Santé, Décembre 2001 Ministère du plan. Second Progress Report on the I-PRSP Implementation and the Formulation of the Full PRSP June 2003-June 2004 OECD : PRINCIPLES FOR GOOD INTERNATIONAL ENGAGEMENT IN FRAGILE STATES - Learning and Advisory Process on Difficult Partnerships (LAP) DRAFT, 04-07-2005 Documentation technique des projets sélectionnés communiqués par l’AGCD, la CTB et les ONG
HERA / Évaluation RDC / Décembre 2005 Annexe 6 - 57