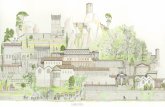2007. L’auxiliaire di ‘dire’ dans les composés descriptifs en bedja
Transcript of 2007. L’auxiliaire di ‘dire’ dans les composés descriptifs en bedja
2007. XII Incontro Italiano di Linguistica Camito-Semitica (Afroasiatica). Atti. M. Moriggi (ed.). Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino: 221-231.
L’auxiliaire di ‘dire’ dans les composés descriptifs en bedja
Martine Vanhove (LLACAN - CNRS, INALCO, Université Paris 7)
INTRODUCTION
Depuis Marcel Cohen (1936 et 1939), on désigne traditionnellement par le
terme de ‘composé descriptif’, une construction qui fait appel à un lexème
suivi d’un verbe ‘dire’ pour former un prédicat complexe, et non pour
introduire un discours rapporté ou pour préciser des valeurs aspectuelles,
temporelles ou modales. Cette formation est particulièrement fréquente en
Afrique du nord-est, quels que soient les groupes linguistiques, à tel point
qu’elle est considérée comme un trait aréal. Elle a été relevée, avec
d’autres appellations, dès les travaux d’Isenberg (1842) pour l’amharique,
de Reinisch (1878) pour le couchitique et de Praetorius (1894) pour le
chamito-sémitique, et décrite depuis par de nombreux linguistes1, en tant
que phénomène expressif en synchronie et pour son rôle dans le
renouvellement des systèmes verbaux dans les langues couchitiques.
En ce qui concerne le bedja, seule langue de la branche nord du
couchitique et parlée dans l’est du Soudan, au nord de l’Erythrée et au sud
de l’Egypte, Roper (1928 : 84) signale brièvement la possibilité de former
des composés descriptifs avec la forme de base du verbe ‘dire’ di. A la
suite des travaux typologiques que nous avons menés conjointement avec
D. Cohen et M.-Cl. Simeone-Senelle (Cohen et al., 2002) sur la morpho-
syntaxe, le fonctionnement discursif et l’évolution diachronique de ces
constructions, j’ai été amenée à approfondir la recherche plus spécifique-
ment pour le bedja. Pour ce faire, je me suis servie du corpus de littérature
orale et de récits divers que j’ai enregistrés au Soudan au cours de 5
missions sur le terrain depuis l’an 2000, soit un total de 184 textes sur une
durée totale d’environ huit heures.
Cette présentation s’articule autour de trois points : le problème de la
fréquence de ces constructions dans le discours, une analyse morpho-
syntaxique, et enfin, une étude de la valence et de la sémantique de ces
prédicats complexes.
FREQUENCE
D’emblée, une première constatation s’impose : sur les milliers de
prédicats verbaux du corpus, seules 55 occurrences de ces prédicats
1 Pour une revue bibliographique détaillée, voir Cohen et al. (2002).
2
complexes ont été relevées, soit une très faible proportion. On est loin, par
exemple, de leur extrême profusion en afar (cf. Cohen et al., 2002), une
langue couchitique d’une autre branche, mais proche géographiquement et
dont on connaît les anciens contacts avec le bedja (Morin, 2001), ou
encore en amharique, dans le domaine afro-sémitique.
La question peut se poser de savoir s’il existe un lien entre cette
faible vitalité en bedja et la forte proportion (60% selon Cohen, 1988 :
256) de conjugaisons préfixales par rapport aux conjugaisons suffixales
dans cette langue. Ces dernières, forme innovante de la conjugaison
verbale en bedja comme en couchitique, sont elles-mêmes issues d’une
grammaticalisation d’anciens composés avec le verbe ‘dire’. Dans l’état
actuel de la documentation pour le couchitique, il semble difficile de
répondre, car il faudrait être sûr que leur degré de vitalité actuel, dont on
sait d’ailleurs peu de choses, est lié d’une manière ou d’une autre à
l’extension de la conjugaison suffixale à l’ensemble des verbes dans les
langues couchitiques. En tout état de cause, il ne semble pas que le
témoignage de l’afar vienne appuyer cette hypothèse, puisque dans cette
langue la proportion des anciennes conjugaisons préfixales est encore de
33% environ (Cohen, 1988 : 256).
Etant donné qu’il s’agit d’un trait aréal, bien d’autres facteurs
peuvent entrer en ligne de compte, dont vraisemblablement la nature des
langues en contact avec le bedja. Au Soudan, la plus importante d’entre
elles est actuellement l’arabe, une langue qui justement ignore ce type de
construction. Il serait intéressant de savoir si le bedja parlé en Erythrée, en
contact essentiellement avec le tigré2, en fait un usage plus important que
le bedja du Soudan. Il y aurait peut-être d’importants enseignements à en
tirer pour la diffusion aréale du phénomène en Afrique du nord-est. Mais,
pour ce qui est du bedja, le tableau risque d’être complexe étant donné les
contacts, bien réels mais encore mal connus, de cette langue avec le
nubien, une langue nilo-saharienne qui utilise aussi, et abondamment, des
composés descriptifs (cf. Armbruster, 1960).
Enfin, sur le plan sociolinguistique, il ne semble pas y avoir de
différence significative entre l’utilisation qu’en font les hommes et les
femmes, comme on en rencontre dans d’autres domaines de la morpho-
syntaxe du bedja, ni de différence entre les tranches d’âge, ni même de
différence dialectale. Dans tous les cas, l’utilisation des composés
descriptifs demeure parcimonieuse.
2 Pour les composés descriptifs dans cette langue, voir Raz (1983).
3
MORPHO-SYNTAXE
Dans notre article (Cohen et al., 2002), sur la foi de la brève mention de
Roper (1929 : 84), nous avions classé le bedja parmi les langues qui n’ont
qu’une seule construction pour la formation des composés descriptifs, celle
qui utilise la forme de base du verbe ‘dire’. Il convient désormais de revoir
cette classification typologique, car mon corpus montre qu’il est possible
d’utiliser aussi la forme dérivée causative de ce verbe.
En bedja, di est le radical du verbe ‘dire’ et il a pour dérivé causatif
sisiyood ou soosid, selon les dialectes. Il s’agit d’un verbe irrégulier à base
consonantique d ou n, selon les conjugaisons. Un exemple de composé
descriptif avec chacune des deux formes, simple et dérivée, est donné ci-
dessous en (1) et (2)3 :
1. gaal door i-karaay dha oo-gnÝa sirir
un fois ART.M.SG-hyène vers ART.M.SG.A-cœur se souvenir iid-heeb /
dire.NAR3M.SG-PR1SG
Soudain, je me suis souvenu de l’hyène.
2. too-lew bak ¯ibib a-sisiyoo-d-eeb
ART.F.SG.A-estomac ainsi regarder ACC1SG-CAUS-dire-REL oo-door / batuu ¯aat-u / ¯aat Ýataab-t-u /
ART.M.SG.A-fois / elle.N viande-PRÉD3SG viande plein-F-PRED3SG
Quand j’ai regardé l’estomac, c’était de la viande, il était plein de viande.
La proportion de composés descriptifs avec le verbe di à la forme de
base par rapport à ceux avec la forme dérivée causative sisiyood ou soosid
est d’environ deux tiers - un tiers, en faveur de la forme de base.
Le bedja appartient donc, comme un certain nombre d’autres langues
chamito-sémitiques, au type où ‘dire’ peut être utilisé à une forme dérivée
dans les composés descriptifs.
Un autre critère de classement typologique que nous avions retenu
(Cohen et al., 2002), concerne la catégorie grammaticale de la base
lexicale susceptible d’être associée au verbe auxiliaire ‘dire’ ou à son
3 Abréviations : / pause, A accusatif, ACC accompli, ART article, CAUS causatif,
CONV.A converbe d’antériorité, CONV.S converbe de simultanéité, COOR
coordination, DEM démonstratif, DIM diminutif, DISTR distributif, F féminin, FUT
futur, G génitif, INAC inaccompli, INDF indéfini, M masculin, N nominatif, NAR
narratif, NEG négation, ONOM onomatopée, PL pluriel, POS possessif, PR pronom
objet, PRED prédicatif nominal, REL relateur, SG singulier.
4
dérivé. Sur ce point aussi, il convient de rectifier notre article, car le corpus
ne fait apparaître que des bases d’origine verbale ou onomatopéique. Au
vu du corpus, il ne semble en effet pas possible, comme nous l’avions écrit
à l’époque, d’utiliser un large éventail de catégories grammaticales,
comme le font l’afar et beaucoup de langues afro-sémitiques. En ce qui
concerne les deux premiers énoncés ci-dessus, il existe des verbes
correspondants, couramment employés. Il s’agit, pour le premier, d’un
verbe à conjugaison suffixale sirir ‘se souvenir’, et, pour le second, d’un
verbe à conjugaison préfixale ¯ibib ‘regarder’. A l’inverse, l’exemple (3)
ci-dessous, est un énoncé avec une onomatopée sans forme verbale
correspondante :
3. ÿuuÿ tendi / ti-takat /
prout dire.INAC3F.SG / ART.F.SG-femme
Elle fait « prout », la femme. (nifik ‘péter’)
Un autre critère typologique concerne la morphologie des lexèmes
verbaux associés à ‘dire’ et ses dérivés. En bedja, il semble bien que seules
les formes de base non dérivées soient utilisables, à l’inverse de l’afar, par
exemple, qui a aussi recours aux thèmes dérivés. Mon corpus ne contient
en tout cas aucune forme dérivée et quand une correspondance peut être
établie entre un composé descriptif et un verbe à une forme dérivée, le
composé descriptif contient un radical dépourvu des morphèmes dérivatifs,
comme dans l’exemple (4) ci-dessous. Cette limitation est probablement
un corollaire de la rareté de ces prédicats complexes et un indice de leur
faible vitalité.
4. mil-oot ÿakw-is-tiini een oon
larme-INDF.F s’égoutter-CAUS-INAC3F.SG dire-ACC3PL DEM i-tak-i da / tuu-mili ÿakw dhaay
ART.M.SG.G-homme-G vers / ART.F.SG.N-larme s’égoutter vers tendi-hoob / haal-ooki naan
dire.INAC3F.SG-quand / état-POS2M.SG quoi waw-is-tin-hook endi /
pleurer-CAUS-INAC3F.SG-POS2M.SG dire.INAC3M.SG
Une larme goutte, dit-on, sur cet homme. Quand la larme s’égoutte sur lui, il
dit : « Qu’est-ce qui te fait pleurer ? »
Il est malgré tout possible d’utiliser une forme diminutive, mais
seulement pour une classe phonétique de verbes : ceux qui comportent une
5
consonne vibrante r construisent leur diminutif au moyen d’une alternance
avec la latérale l. Ainsi dans l’exemple (5) ci-dessous, fal est la forme
diminutive de far ‘sauter’ :
5. fal fal fal diy-ee ¯uumi
sauter.DIM sauter.DIM sauter.DIM dire-CONV.S entrer.NAR3M.SG Ýeen /
dire.INAC3PL
Il est entré en sautillant, dit-on.
Outre cette restriction phonétique particulière, il faut ajouter que ce
type de diminutif n’appartient pas en propre au système verbal (les noms,
par exemple, le connaissent aussi) et qu’il n’existe pas de dérivation
verbale diminutive potentiellement applicable aux autres verbes de la
langue. Cette dérivation marginale ne remet donc pas en cause la limitation
des composés descriptifs aux formes verbales de base.
Par ailleurs, sur le plan morpho-syntaxique, l’énoncé (4) montre que
des postpositions peuvent s’insérer entre le radical et l’auxiliaire, comme
en afar qui, lui, présente un degré supérieur de fusion prosodique et
phonétique entre les deux éléments du syntagme par rapport à celui du
bedja.
Quant à la structure du thème lexical associé à ‘dire’, il s’agit
toujours d’une base invariable qui correspond au radical dépouillé de tout
élément flexionnel, seul cas où une telle forme peut être actualisée dans le
discours.
Il faut toutefois préciser qu’il existe deux autres cas marginaux
d’emploi du radical nu. Le premier concerne un adverbe qui a été formé à
partir de la composition de deux radicaux verbaux : yak-far (lit. ‘se lever’
+ ‘sauter’). Il s’est grammaticalisé avec une fonction purement adverbiale
et a pris le sens de ‘brusquement’. Son degré de grammaticalisation n’est
cependant peut-être pas encore très élevé puisque je ne l’ai rencontré
qu’avec le verbe di ‘dire’ justement, comme dans l’ex. (6) :
6. w-hattaabi yak-far dii-ti-it
ART.M.SG.N-bûcheron se lever-sauter dire-CONV.A-COOR
Après que le bûcheron eut dit brusquement …
6
Il convient de s’attarder un peu plus longuement sur les quelques
autres occurrences (onze au total) où le radical nu n’est pas suivi du verbe
‘dire’, car cela est, à ma connaissance, unique dans le domaine
couchitique4 ou afro-sémitique. L’ex. (7) est extrait d’un conte très bref où
la conteuse décrit une série d’actions en alternant verbes conjugués et
composés descriptifs, mais la seconde action, qui est une répétition sous
une autre forme de la première, est mentionnée sans le verbe ‘dire’:
7. kilay-oo harid-ti-it / harid harid harid
poulet-POS3SG égorger-CONV.A-COOR / égorger égorger égorger tanhoor tidrig-aat / y-haïí ÿÝa
four allumer.ACC3F.SG-COOR / ART.M.SG- pain frapper ÿÝa ÿÝa tisisiyood-aat-ka
frapper frapper dire.CAUS.ACC.3F.SG-COOR-DISTR i-tanhoor-iib / rifit rifit rifit
ART.M.SG-four-dans / couper couper couper tisisiyood-aat-ka / oo-øík / milit
dire.CAUS.ACC.3F.SG-COOR-DISTR / ART.M.SG.A-coq / plumer milit milit tisisiyood-aat-ka /
plumer plumer dire.CAUS.ACC.3F.SG-COOR-DISTR / y-haïiy-ee-wa i-øiik-oos-wa
ART.M.SG-pains-POS3PL-COOR ART.M.SG-coq-POS3SG-COOR aam-eeti
dévorer-CONV.A
Elle a égorgé son poulet et l’a égorgé, égorgé, égorgé, elle a allumé le four,
et à chaque fois elle aplatissait le pain, tac, tac, tac, dans le four, et à chaque
fois elle coupait menu, menu, menu, et à chaque fois elle plumait, plumait,
plumait le coq, et elle a dévoré ses pains et son coq et …
Dans l’ex. 8, la même scène, qui précède juste la clôture du conte,
est ensuite rapportée au discours direct par le héros qui fait ainsi savoir à
sa femme qu’il a découvert son stratagème pour ne pas le nourrir. Il n’y a
alors plus un seul verbe ‘dire’ :
8. y-haïi ÿÝa ÿÝa / w-harri huug
ART.M.SG-pain frapper frapper / ART.M.SG-sorgho moudre
4 Mais cela est possible dans au moins deux langues omotiques, ainsi que me l’ont
signalé Christian Rapold pour le benchnon et Azeb Amha pour le zargulla. Merci
à tous deux.
7
huug y-haïi ÿÝa ÿÝa / tanhoor dirig
moudre ART.M.SG-pain frapper frapper / four allumer dirig / oo-øik milit milit / tam tam
allumer / ART.M.SG.A-coq plumer plumer / manger manger tam / ikwbisn-iit bÝeyan
manger / se couvrir.ACC3PL-COOR s’allonger.ACC3PL iidi
dire.ACC3M.SG
‘Le pain aplati, aplati, le millet moulu, moulu, le pain aplati, aplati, le four
allumé, allumé, le coq plumé, plumé. Mangé, mangé, mangé. Elles se sont
couvertes et se sont allongées’, a-t-il dit.
Il me semble possible de considérer dans ce cas l’absence du verbe
‘dire’ comme une ellipse et ceci, en raison d’un fait structurel du bedja : le
caractère facultatif de l’utilisation du verbe quotatif ‘dire’ dans le discours
rapporté (toujours direct en bedja), dont un exemple est fourni en (9) :
9. oo-mhiin karaay eefi een-hoob /
ART.M.SG.A-endroit hyène être.ACC3M.SG dire.ACC3PL-quand ani ¯uum-i ande
je.N entrer-FUT dire.INAC1SG
Quand ils ont dit : ‘il y a une hyène à cet endroit’, (il leur a dit) : ‘Moi, je
vais entrer’.
Le bedja ayant la possibilité d’actualiser un discours sans verbe
quotatif ‘dire’, il n’y a rien d’étonnant à ce que cette omission s’étende aux
composés descriptifs.
Sur les plans aspectuel, temporel et modal, les composés descriptifs
sont compatibles avec toutes les conjugaisons et converbes de la langue.
Des exemples en ont été fournis ci-dessus au narratif en (1), à l’accompli
en (2) et (7), à l’inaccompli en (3) et (4), avec le converbe de simultanéité
en (5) et celui d’antériorité en (6). Mes informateurs n’ont par ailleurs
aucun mal pour en fabriquer avec un futur, un optatif ou un impératif.
Les composés descriptifs sont également compatibles avec la
modalité négative, comme en (10) :
10. i-ragad-uu ÿiw endiy-eek /
ART.M.SG-jambe-POS3SG craquer dire.INAC3M.SG-si / ti-øanna eedÝana / i-ragad-uu ÿiw
ART.F.SG-jardin faire.INAC3PL / ART.M.SG-jambe-POS3SG craquer
8
bi-diy-eek too-nÝi eedÝana /
NEG-dire.INAC3M.SG-si / ART.F.SG-feu faire.INAC3PL
Si sa jambe craque, ils le mettent au jardin, si sa jambe ne craque pas, ils le
mettent au feu.
Enfin, pour exprimer l’intensivité, le bedja fait, comme l’afar (M.
Houmed-Gabba et M.-Cl. Simeone-Senelle, c.p.), usage du procédé de
répétition de la base radicale. Des exemples en ont été fourni en (7) et (8).
Cependant, contrairement à l’afar, il n’est pas possible en bedja de mettre
l’auxiliaire ‘dire’ ou son dérivé causatif en facteur commun à plusieurs
radicaux différents dans une série de composés descriptifs.
VALENCE ET SEMANTIQUE
Dans les langues à composés descriptifs, nous avions constaté (Cohen et
al., 2002) qu’il existe très souvent (mais pas systématiquement) une
opposition lexicale entre constructions transitives et intransitives qui se
manifeste par l’utilisation d’auxiliaires différents : soit ‘dire’ pour les
intransitifs et ‘faire’ pour les transitifs, comme en afar, soit ‘dire’ et le
causatif de ‘dire’, comme dans beaucoup de langues afro-sémitiques. Il est
intéressant de constater pour la comparaison que, malgré les contacts
anciens avec l’afar, le bedja utilise une stratégie différente de celui-ci,
puisqu’il a recours au causatif de ‘dire’. Par ailleurs, en bedja5, la
répartition des auxiliaires entre les deux valences n’est pas toujours
nettement tranchée et des considérations d’ordre sémantique sont aussi à
prendre en compte.
Il convient d’abord de signaler que les composés descriptifs ne
semblent compatibles qu’avec un nombre réduit de champs sémantiques.
Ils peuvent être regroupés en cinq catégories, dont l’exemplification ci-
après constitue la liste exhaustive pour mon corpus :
(i) des mouvements : ‘remuer’, ‘se pencher’, ‘faire le tour, tourner’,
‘monter’, ‘descendre’, ‘entrer’, ‘tomber’, ‘s’égoutter’, ‘avancer sans bruit’,
‘sauter’, ‘agiter’, ‘traverser, passer’, ‘emporter au loin’, ‘ouvrir,
découvrir’ ;
(ii) des perceptions sensorielles et intellectuelles : ‘regarder’, ‘sentir
(exhaler une odeur)’, ‘se souvenir’ ;
5 Comme dans quelques autres langues de la région, dont l’afar, voir Cohen et al.
(2002 : 244-5).
9
(iii) des bruits et des onomatopées imitant des bruits et cris divers :
‘craquer’, ‘péter’, ‘s’entrechoquer, faire du bruit’, ‘souffler’ ; cris
d’animaux, cris pour chasser les animaux, pets ;
(iv) des manières d’ingérer des aliments : ‘picorer’, ‘lécher’, ‘manger’ ;
(v) des actions (souvent violentes) : ‘frapper’, ‘égorger’, ‘déchirer’,
‘couper en morceaux’, ‘couper au couteau’, ‘plumer’, ‘gratter’, ‘allumer le
feu’, ‘s’emparer (brusquement)’.
Les différents champs sémantiques sont croisés avec leur valence
dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Champs sémantiques et valence
champs sémantiques di ‘dire’ causatif sisiyood
mouvements intransitif (transitif) ø
perceptions intransitif ø
ingestion et actions ø transitif
bruits (*verbes)
bruits (*onomatopées)
intransitif ø
intransitif (intransitif)
Pour ce qui est des catégories des mouvements et des perceptions,
tous les composés se construisent avec la forme de base du verbe ‘dire’.
Presque tous sont intransitifs, à l’exception de quelques verbes de
mouvement transitifs : ‘monter’, ‘emporter au loin’ et ‘entrer’. Ceci
rappelle la situation décrite par Leslau (1956 : 145-6) qui distinguait, en
gafat, une langue afro-sémitique, non pas des classes sémantiques mais des
actions intransitives principalement exprimées par le verbe balä ‘dire’ et
des actions transitives toujours exprimées par le dérivé causatif a-balä. En
bedja, l’utilisation de la forme de base di ‘dire’ pour former des transitifs
semble encore plus limitée qu’en gafat.
Les catégories de l’ingestion et des actions, par contre, semblent plus
homogènes quant à la valence puisque tous les composés sont construits,
sans exception, avec le verbe dérivé causatif et transitif sisiyood (en
contexte, tous ne sont pas nécessairement accompagnés d’un second
actant).
Quant aux bruits, ils entrent tous dans des constructions intransitives
et sont suivis de la forme de base de ‘dire’. Un seul terme fait exception,
une onomatopée (ex. 12) :
12. ÿik soos-id-ti-it t-hawat-too
ONOM CAUS-dire-CONV.A-COOR ART.F.SG-outre à lait-POS3F.SG
10
bak dÝii-ti-it
ainsi faire-CONV.A-COOR
(La boule) fait tik et son outre à lait fait comme ça, et …
Pour les onomatopées, on peut rapprocher la situation du bedja de
celle d’autres langues de la région. M. Cohen (1936 : 262-275) signalait
que l’amharique avait recours soit à ‘dire’ soit à ‘faire’ et nous l’avions
également constaté pour l’afar, avec une nette préférence pour ‘dire’
(Cohen et al., 2002 : 229). Le bedja présente donc le même schéma que
l’afar.
CONCLUSION
Notre étude de l’afar (Cohen et al., 2002) avait confirmé l’analyse
discursive de Longacre (1990 : 18-19), qui suivait Bliese (1976) : il
montrait que les composés descriptifs marquent dans l’organisation
textuelle des “pivotal storyline actions/events”. Nous avions pu y ajouter
que, dans l’instance du discours, c’est aussi un moyen pour le locuteur
d’exprimer des modalités qui relèvent de la relation entre l’énonciateur et
l’énoncé et de faire ainsi passer des émotions comme la surprise,
l’admiration, la désapprobation, etc. Raz (1983 : 67) signalait aussi pour le
tigré que l’apport du composé descriptif au sens du verbe correspondant
“can be specified in terms of intensity or manner of the activity, such as:
augmentative, attenuative or iterative.”
On a vu que l’intensité de l’action, par la répétition du radical, est
une des valeurs associées à l’utilisation des composés descriptifs en bedja.
Elle n’est pas la seule, mais cela sera l’objet d’une autre étude. Il me
semble important cependant d’insister pour que se développent, pour les
langues couchitiques, des descriptions fines qui prennent en compte aussi
bien les rôles discursifs et pragmatiques, les contacts linguistiques et les
possibles diffusions aréales, que les liens inter-systémiques avec le
système verbal et les processus de grammaticalisation, afin de mieux saisir
leur intérêt pour l’évolution des systèmes verbaux et la linguistique
générale. Le phénomène déborde largement cette région de l’Afrique (cf.
Cohen et al., 2002), il convient maintenant d’en comprendre pleinement
les mécanismes.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
C. H. Armbruster, Dongolese Nubian, a Grammar, Cambridge University Press,
Cambridge 1960.
L. Bliese, Afar, in The Non-Semitic Languages of Ethiopia, ed by L. Bender,
11
African Studies Center, Southern Illinois University, East Leasing, Michigan
1976, pp. 133-65.
D. Cohen, Couchitique – Omotique, in Les langues dans le monde ancien et
moderne. Langues chamito-sémitiques, éd. par D. Cohen et J. Perrot, Editions
du CNRS, Paris 1988, pp. 243-95.
D. Cohen, M.-Cl. Simeone-Senelle, and M. Vanhove, The Grammaticalization of
"Say" and "Do": An Areal Phenomenon in the Horn of Africa, in Reported
Speech: A Meeting Ground for Different Linguistic Domains ed. by T.
Güldemann and M. von Roncador, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia
2002, pp. 227-51.
M. Cohen, Nouvelles études d'éthiopien méridional, Champion, Paris 1939.
M. Cohen, Traité de langue amharique (Abyssinie), Institut d'Ethnologie, Paris
(1936) 1970.
C. W. Isenberg, Grammar of the Amharic Language, Christian Mission Society,
London 1842.
W. Leslau, Etude descriptive et comparative du Gafat (Ethiopien méridional),
Klincksieck, Paris 1956.
R. E. Longacre, Storyline concerns and word order typology in East and West
Africa, Department of Linguistics, University of California, Los Angeles
1990.
D. Morin, Bridging the gap between Northern and Eastern Cushitic. in New data
and new methods in Afroasiatic linguistics. Robert Hetzron in memoriam, ed.
by A. Zaborski, Harrassowitz, Wiesbaden 2001, pp. 117-124.
F. Praetorius, Über die hamitischen Sprachen Ostafrika’s, in «Beiträge zur
Assyriologie und Vergleichenden semitischen Sprachwissenschaft» 2, 1894,
pp. 312-341.
S. Raz, Tigre Grammar and Texts, Undena Publications, Malibu 1983.
E. M. Roper, "Tu BeÆawi¢". An Elementary Handbook for the Use of Sudan
Government Officials, Stephen Austin, London 1928.
L. Reinisch, Die Sprache der Irob-Saho in Abessinien, Karl Gerolds Sohn, Wien
1878.