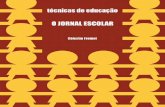« La formation d’une identité intellectuelle et son cadre scolaire : Eusèbe de Césarée à...
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of « La formation d’une identité intellectuelle et son cadre scolaire : Eusèbe de Césarée à...
212
La formation d’une identité intellectuelle et son cadre scolaire:
Eusèbe de Césarée à l’ «école» de Pamphile di
Sébastien Morlet
Si l’on définit d’abord l’intellectuel par une fonction particulière, liée à la défense d’une cause ou à la production et à la transmission du savoir, Eusèbe de Césarée est un bon exemple d’intellectuel chrétien. Né vers 265 et mort vers 339/340, il fut le témoin de modifications profondes dans les relations entre le christianisme et les autorités romaines. En l’espace de quelques années, il connut successivement «la petite paix de l’Église», la «Grande Persécution» (303-313), puis la reconnaissance officielle du christianisme à partir du règne de Licinius et de Constantin et, à partir de 324, du seul Constantin. Eusèbe était à la fois un érudit et un apologiste de premier plan. Il consacra sa vie à la production du savoir en composant des œuvres telles que la Chronique, l’Histoire ecclésiastique, des commentaires exégétiques (sur Isaïe et sur les Psaumes) et des ouvrages d’érudition biblique comme les Canons des évangiles (la première véritable concordance des évangiles) ou l’Onomasticon (un lexique des toponymes mentionnés dans l’Ancien Testament). Par ailleurs, Eusèbe apparaît également comme une personnalité engagée dans la défense de l’Église et de l’orthodoxie, auteur d’ouvrages contre les païens, contre les juifs et contre ses adversaires théologiques. L’un des aspects les plus importants de son identité intellectuelle réside cependant dans son attachement à l’œuvre d’Origène (mort en 254), à une époque où celle-ci faisait déjà l’objet de plusieurs critiques1. Suite à un conflit qui l’avait opposé à son évêque Démétrios, Origène avait quitté Alexandrie pour Césarée, où il s’était installé définitivement à partir de 2332 et où il avait ouvert une école3. Césarée était alors un centre important d’enseignement rabbinique4. Avec la venue d’Origène, elle devint également un foyer intellectuel chrétien de premier plan. Eusèbe reconnaissait en Origène un maître spirituel. Le livre VI de l’Histoire ecclésiastique, presque entièrement consacré au récit de sa vie, ainsi que les écrits exégétiques et apologétiques d’Eusèbe, fortement influencés Ce texte est la version modifiée d’une communication donnée en mai 2006 lors du colloque organisé à l’Université de Rouen «Les intellectuels et la cité». En 2010, E.C. Penland a soutenu une thèse sur le sujet (Martyrs as Philosophers: The School of Pamphilus and Ascetic Tradition in Eusebius’s «Martyrs of Palestine», Yale University), que nous n’avons pas pu consulter. 1 Ces critiques sont rapportées au livre I de l’Apologie pour Origène composée par Pamphile de Césarée (§ 87). On reprochait notamment à Origène de professer des doctrines comme celles de la préexistence des âmes ou de la restauration finale de la création, et de nier le sens littéral des Écritures au profit du seul sens spirituel. 2 Voir P. NAUTIN, Origène: sa vie et son œuvre, Paris 1977, 372. 3 Sur l’école d’Origène à Césarée, voir A. KNAUBER, Das Anliegen der Schule des Origenes zu Cäsarea, Münchener Theologische Zeitschrift 19 (1968) 182-203; H. CROUZEL, L’école d’Origène à Césarée. Postscriptum à une édition de Grégoire le Thaumaturge, Bulletin de littérature ecclésiastique 71 (1970) 15-27; Origène, Paris-Namur, 1985, 47-51; et maintenant (avec un examen de la survie des activités didactiques jusqu’à Eusèbe) A. LE BOULLUEC, D’Origène à Eusèbe: bibliothèque et enseignement à Césarée de Palestine?, dans H. HUGONNARD-ROCHE (dir.), L’enseignement supérieur dans les mondes anciens et médiévaux, Actes du Colloque des 6-7-8 octobre 2005, Paris 2008, 241-262. 4 Voir H. LAPIN, Jewish and Christian Academies in Roman Palestine: Some Preliminary Observations, dans K.G. HOLUM – A. RABAN (éd.), Caesarea Maritima: a Retrospective After Two Millenia, Leiden 1996, 496-512.
SÉBASTIEN MORLET – Eusèbe de Césarée à l’ ‘école’ de Pamphile
213
par Origène, portent témoignage de l’admiration de l’évêque de Césarée pour son illustre prédécesseur. Eusèbe est né trop tard pour avoir pu connaître personnellement Origène, mais il se familiarisa avec sa pensée au contact du prêtre Pamphile, grand admirateur de l’Alexandrin, quoiqu’il ne l’ait pas non plus connu personnellement. Dans un itinéraire intellectuel, les rencontres jouent souvent un rôle capital. Nous ne savons pas précisément quand Eusèbe rencontra Pamphile, mais ce dut être vers la fin du IIIe s, à l’époque où ce dernier ouvrit une école à Césarée, peut-être à l’imitation d’Origène5. De tous les disciples de Pamphile, Eusèbe est à la fois le plus illustre et le plus connu. Il reste à savoir quel fut l’impact de la formation reçue auprès de Pamphile sur l’identité intellectuelle de l’évêque de Césarée. Pour mener cette enquête, les documents sont rares mais non inexistants. Si nous avons perdu la Vie d’Eusèbe composée par son successeur Acace6 et la Vie de Pamphile écrite par Eusèbe7, différents témoignages sur Pamphile et son cercle nous sont transmis par Jérôme, Photius, et surtout les Martyrs de Palestine d’Eusèbe lui-même8. Cet écrit hagiographique, qui fait l’éloge des martyrs palestiniens morts entre 303 et 311, ne fournit pas de description directe de l’école et des disciples de Pamphile. Eusèbe ne les évoque qu’au détour des notices qu’il consacre aux différents martyrs palestiniens. Le témoignage des Martyrs de Palestine est donc non seulement indirect, mais encore sélectif, puisque l’œuvre se concentre exclusivement sur ceux des disciples de Pamphile qui subirent le martyre. Elle n’en contient pas moins de précieux indices sur la nature de l’enseignement dispensé par Pamphile et permet ainsi d’émettre des hypothèses sur le rôle qu’il a pu jouer dans la formation intellectuelle d’Eusèbe.
Pamphile et son école
Pamphile était issu d’une bonne famille de Bérytos9. Il suivit peut-être des études de droit10 avant de s’attacher à Piérios, un prêtre d’Alexandrie qui dirigeait l’école catéchétique sous l’épiscopat de Théonas (v. 281-300)11. Eusèbe écrit que Piérios «était estimé au plus haut point pour sa vie pauvre et pour ses connaissances philosophiques, et [qu’] il était extraordinairement exercé dans les spéculations et les explications relatives aux choses divines comme dans les exposés qu’il faisait
5 Sur l’école de Pamphile, voir EUS., Histoire ecclésiastique (= HE) VII,32,25 et Martyrs de Palestine (recension longue), 5,2, où l’écrivain parle d’une διατριβή. Pour exprimer l’institution de cette école, il utilise la tournure τὴν διατριβὴν συστήσασθαι (HE VII,32,25) employée également en HE VII,32,6 pour évoquer l’institution d’un enseignement aristotélicien à Alexandrie par le philosophe Anatolius. 6 Cf. SOCR., Histoire ecclésiastique, II, 4. 7 Cf. EUS. HE VI,32,3; VII,32,25; Martyrs de Palestine (recension courte), 11,3; HIER., De uiris inlustribus, 81. 8 L’œuvre est conservée en deux recensions: une recension longue (= MP. L.), transmises par une version syriaque et quelques fragments grecs, et une recension courte (= MP. C.), qui forme l’appendice de l’Histoire ecclésiastique. Pour chacune des recensions grecques, nous suivrons le texte fourni par G. BARDY, SC 55, Paris 1967. 9 Voir MP. L., XI, 2. 10 Eusèbe dit simplement qu’il avait été éduqué dans les écoles de Bérytos (loc. cit.: τοῖς αὐτόθι τέθραπτο παιδευτηρίοις). P. Collinet considère qu’Eusèbe fait référence, «selon toute vraisemblance», à des études juridiques (Histoire de l’école de droit de Beyrouth, Paris 1925, 28). C’est aussi l’avis de G. Bardy (SC 55, 129 n. 3). J. Sirinelli note plus prudemment que Pamphile avait fait «de très fortes études à Béryte» (Les vues historiques d’Eusèbe de Césarée durant la période prénicéenne, Paris 1961, 17). 11 Parmi les témoignages anciens sur Piérios, voir EUS. HE VII,32,27; HIER., De uiris inlustribus, 76; PHOT., Bibliothèque, cod. 118-119.
ADAMANTIUS 17 (2011)
214
à l’assemblée de l’Église»12. L’œuvre de Piérios n’est connue qu’à l’état de fragments et nous ignorons la date de sa mort13. Jérôme rapporte qu’on appelait Piérios «Origène le Jeune»14, sobriquet qui peut signifier qu’il épousait les idées d’Origène15. C’est donc probablement à son contact que Pamphile conçut l’admiration pour Origène qu’il devait transmettre à son tour à Eusèbe16. Pamphile fut ordonné prêtre à Césarée sous l’évêque Agapios et y ouvrit une école, comme l’avait fait Origène plusieurs dizaines d’années auparavant17. Arrêté en 307, il fut finalement exécuté en février 31018. Eusèbe présente Pamphile comme une personnalité charismatique. Il écrit qu’au milieu de ses compagnons de prison, il se distinguait «tel un météore qui paraît en plein jour parmi les astres éclatants»19. «Il avait […] atteint à un degré exceptionnel l’éducation admirée chez les Grecs, et en celle qui concerne les enseignements divins et les Écritures inspirées, s’il faut dire quelque chose d’un peu audacieux bien que de vrai, il avait acquis, à forces d’exercices, une habileté telle que n’en possédait aucun de ses contemporains. Mais il possédait une prérogative plus grande que tout cela, et qui lui était naturelle ou mieux qui lui avait été donnée par Dieu: l’intelligence et la sagesse20.» «[…] Pendant sa vie entière, (il) s’était distinguée en toute vertu, par la fuite et le mépris du monde, par le partage de sa fortune entre les indigents, par le peu d’estime pour les espérances de ce monde, par la vie philosophique et l’ascèse. Mais surtout, plus que tous ses contemporains, il se distinguait par son zèle très authentique pour les Écritures divines, par son infatigable amour du travail dans ce qu’il entreprenait, par l’assistance qu’il accordait à ses
12 […]Ἄκρως ἀκτήμονι βίῳ καὶ μαθήμασιν φιλοσόφοις δεδοκίμαστο, ταῖς περὶ τὰ θεῖα θεωρίαις καὶ ἐξηγήσεσιν καὶ ταῖς ἐπὶ τοῦ κοινοῦ τῆς ἐκκλησίας διαλέξεσιν ὑπερφυῶς ἐξησκημένος (HE VII,32,27). Dans cette étude, nous suivrons la traduction de l’Histoire ecclésiastique publiée par G. BARDY, SC 31-41-55, Paris 1951-1967. 13 Sur Piérios et son oeuvre, voir M. GEERARD, Clauis Patrum Graecorum, Turnhout 1974, no 1630 et l’étude de L.B. RADFORD, Three Teachers of Alexandria: Theognostus, Pierius and Peter. A Study in the Early History of Origenism and Anti-Origenism, Cambridge 1908. Sur le devenir de l’ ‘origénisme’ après Origène, on consultera maintenant les études d’E. PRINZIVALLI, Per un’indagine sull’esegesi del pensiero origeniano nel IV secolo, Annali di storia dell’esegesi 11 (1994) 433-460; Magister ecclesiae: il dibattito su Origene fra III e IV secolo, Roma 2002. 14 De uiris inlustribus, 76. 15 Jérôme pense que ce surnom fut décerné à Piérios en raison de l’élégance de son style et du grand nombre de ses ouvrages. L.B. Radford a cependant montré que Piérios avait repris à son compte certaines idées contestées d’Origène, comme celle de la préexistence de l’âme (op. cit., 50). 16 C’est également l’hypothèse de L.B. RADFORD, ibid., 49. 17 Voir la note 5. 18 Sur la vie de Pamphile, voir E. SCHWARTZ, Eusebios von Caesarea, Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft VII (1907) 1371-1372; E. HOFFMANN-ALEITH, Pamphilos, 27, ibid., XVIII,3 (1949) 349-350. 19 Οἷα δέ τις ἐν ἀποστίλβουσιν ἄστροις ἡμεροφανὴς φωστὴρ (MP. L. 11,1 d). 20 Παιδείας […] οὗτος τῆς παρ’ Ἕλλησι θαυμαζομένης οὐ μετρίως ἧπτο τῇ τε κατὰ τὰ θεῖα δόγματα καὶ τὰς θεοπνεύστους γραφάς, εἰ χρή τι θρασύτερον, πλὴν ἀληθὲς εἰπεῖν, ὡς οὐδ" ἕτερον ἔχει τις φάναι τῶν κατ’ αὐτόν, ἤσκητο. Μεῖζον δὲ τούτων ἐκέκτητο πλεονέκτημα τὴν οἴκοθεν, μᾶλλον δὲ θεόθεν αὐτῷ δεδωρημένην σύνεσίν τε καὶ σοφίαν (ibid. 11,1 d).
SÉBASTIEN MORLET – Eusèbe de Césarée à l’ ‘école’ de Pamphile
215
parents et à tous ceux qui l’approchaient21.» «[…] Il était réellement divin et participait à une inspiration divine […]22». Eusèbe concevait une admiration sans borne pour Pamphile: dans ses écrits, il l’appelle «mon maître»23, «le divin et vraiment bienheureux Pamphile»24, celui dont le nom, dit-il, lui est «trois fois cher»25. Il l’appelle encore «la grande gloire de la chrétienté de Césarée […], le plus admirable de nos contemporains»26, l’homme «le plus admirable de notre ville»27. Il se fit appeler Eusèbe «de Pamphile», pour exprimer, comme le suggèrent plusieurs sources28, la relation filiale qui le liait à son maître. Jérôme, de son côté, écrit qu’Eusèbe était pour Pamphile un «ami» (amator), un «héraut» (praeco), un «compagnon» (contubernalis)29 et un «familier» (necessarius)30. Eusèbe est le disciple de Pamphile le plus illustre, mais, grâce aux Martyrs de Palestine, nous connaissons au moins trois de ses condisciples: Apphianos, Aidésios et Porphyre. Apphianos et Aidésios était deux frères issus d’une bonne famille de Gagae en Lycie. Ils avaient suivi le cycle des études profanes (la παιδεία) avant de s’attacher à Pamphile31. Les Martyrs de Palestine précisent qu’Apphianos avait étudié à Bérytos, probablement le droit32. Eusèbe affirme qu’Aidésios était doué d’une culture excellente, tant grecque que romaine, ce qui tendrait à indiquer qu’il avait lui aussi suivi des études de droit à Bérytos33. Porphyre, en revanche, était de condition plus humble: il était le serviteur de Pamphile, ce qui ne l’empêchait pas, selon Eusèbe, d’être en esprit son frère et son fils34. Porphyre était un disciple plein de zèle «qui n’omettait rien pour imiter son maître»35. La cohabitation de fils de bonne famille avec un disciple plus humble montre que la composition sociale du cercle réuni autour de Pamphile n’était pas uniforme. La même variété s’observe dans l’âge des disciples: Porphyre n’avait pas 18 ans lorsqu’il subit le martyre36. Apphianos avait dépassé sa vingtième année37. Quant à Eusèbe, s’il est bien né vers 265 comme on le croit, il devait avoir une quarantaine d’années pendant la Grande Persécution.
21 […] Παρ" ὅλον αὐτοῦ τὸν βίον πάσῃ διαπρέψας ἀρετῇ, ἀποτάξει καὶ καταφρονήσει βίου, τῆς οὐσίας εἰς ἐνδεεῖς κοινωνίᾳ, κοσμικῶν ἐλπίδων ὀλιγωρίᾳ, φιλοσόφῳ πολιτείᾳ καὶ ἀσκήσει· μάλιστα δὲ παρὰ τοὺς καθ’ ἡμᾶς πάντας διέπρεπεν τῇ περὶ τὰ θεῖα λόγια γνησιωτάτῃ σπουδῇ ἀτρύτῳ τε περὶ ἃ προύθετο φιλοπονίᾳ καὶ τῇ περὶ τοὺς προσήκοντας καὶ πάντας τοὺς αὐτῷ πλησιάζοντας ὠφελείᾳ (MP. C. 11,2). 22 […] Θεῖος ἦν ὄντως καὶ θείας μετέχων ἐμπνεύσεως […] (MP. L. 11,2). 23 ̔Ο ἐμὸς δεσπότης (MP. L., 11, 1, d). 24 Τὸν θεσπέσιον καὶ μακάριον ὡς ἀληθῶς Παμφίλον (ibid. 11,1 d). 25 Τρισπόθητον (MP. C. 11,1). 26 Τὸ μέγα δὲ κλέος τῆς Καισαρέων παροικίας […] τῶν καθ’ ἡμᾶς θαυμασιώτατος (HE VIII,13,6). 27 Τῶν τῇδε θαυμασιώτατος (ibid. VII,32,27). 28 Voir HIER. De uiris inlustribus 81; PHOT. Bibliothèque, cod. 13. 29 Pour ces trois adjectifs, voir Contra Rufinum I,9. 30 De uiris inlustribus 75. 31 Sur ces deux personnages, voir MP. C. 4,3-5; MP. L. 4,3-5; MP. C. 5,2; MP. L. 5, 2. 32 Voir ibid. 4,3-5. Voir P. COLLINET, op. cit., 28-29. 33 Voir MP. L. 5,2. Voir P. COLLINET, loc. cit. Apphianos devait subir le martyre en avril 306 à Césarée (voir MP. C. 4,15; MP. L. 4,15). La date du martyre d’Aidésios est moins sûre, mais on doit la situer peu de temps après celui d’Apphianos, à Alexandrie (voir G. BARDY, SC 55, 136 n. 1). 34 Voir MP. C., 11, 15; MP. L., 11, 15. 35 Voir MP. C. 11,1 e. Porphyre devait subir le martyre en même temps que Pamphile, soit en février 310. 36 Voir MP. L. 11,15. 37 Voir MP. C. 4,3; MP. L. 4,3.
ADAMANTIUS 17 (2011)
216
Apphianos, Aidésios et Porphyre sont les seuls disciples de Pamphile que les Martyrs de Palestine désignent explicitement comme tels. D’autres y sont peut-être mentionnés, mais Eusèbe ne les présente pas comme des disciples de Pamphile. C’est probablement le cas de cet Antoninos qui subit le martyre aux côtés de Zebinas et de Germanos38, et dont le nom correspond à celui d’un des assistants de Pamphile, connu grâce à deux souscriptions manuscrites39. Ses deux compagnons, Zebinas et Germanos, comptaient-ils eux aussi parmi les étudiants de Pamphile ? Cette question conduit immanquablement à s’interroger sur la nature de l’école fondée par le prêtre. Si l’on a pu comparer cette dernière au Musée d’Alexandrie40, elle présente également plusieurs traits caractéristiques des écoles de l’Antiquité tardive, tant du côté juif que du côté païen41. Contrairement à ce que le mot «école» pourrait laisser entendre, l’école de Pamphile n’était pas une institution, mais seulement un cercle réuni autour d’un maître42. Pas davantage que celle d’Origène, l’école de Pamphile ne semble avoir survécu à la mort du maître43. Elle ne bénéficiait probablement pas d’un local spécifique. Selon la pratique la plus courante de l’Antiquité, l’enseignement devait être délivré dans une maison privée, peut-être celle de Pamphile lui-même ou celle d’un riche protecteur44. De plus, Eusèbe affirme à deux reprises qu’il vivait dans la même maison qu’Apphianos45. Un certain nombre de disciples au moins vivaient donc en commun, comme dans d’autres écoles de l’Antiquité46. Il est même probable que le lieu de vie se confondait avec le lieu d’enseignement. Par ailleurs, le cercle de Pamphile n’était ni sectaire ni marginal. Les Martyrs de Palestine montrent au contraire qu’il était en relation avec de nombreuses personnes qui ne faisaient certainement pas partie de l’école, dans les couches les plus variées de la société47. On ne peut donc pas exclure qu’une partie de ces personnes ait pu
38 Voir MP. C. 9,5. 39 Voir la note de G. Bardy, SC, 55, 149 n. 5. Sur les souscriptions de Césarée, voir la note 94. 40 Voir E. SCHWARTZ, art. cit., col. 1372. 41 Sur les écoles rabbiniques palestiniennes dans l’Antiquité tardive, voir H. LAPIN, art. cit. En domaine païen, voir par exemple l’étude consacrée par M.-O. GOULET-CAZÉ à l’école de Plotin (L’arrière-plan scolaire de la Vie de Plotin, dans L. BRISSON – M.-O. GOULET-CAZÉ – R. GOULET – D. O’BRIEN, Porphyre. La vie de Plotin, I, Travaux préliminaires et index grec complet, Paris 1982, 231-327). 42 La plupart des écoles, rabbiniques ou païennes, n’étaient pas des structures institutionnelles (voir H. LAPIN, art. cit., 500; M.-O. GOULET- CAZÉ, art. cit., 242). 43 F. Winkelmann pense qu’ Eusèbe a pu succéder à Pamphile à la tête de l’école, car (1) l’historien Socrate décrit Acace comme l’«élève» d’Eusèbe (Histoire ecclésiastique II,4); (2) les successeurs d’Eusèbe, Acace et Euzoios, ont augmenté le fonds de la bibliothèque, ce qui pourrait impliquer une continuation des activités associées à l’école de Pamphile; (3) la requête de Constantin, demandant à Eusèbe de lui adresser cinquante manuscrits de la Bible (voir Vie de Constantin IV,36), supposerait, elle aussi, une perpétuation des activités philologiques liées à l’école de Pamphile (Euseb von Kaisareia. Der Vater der Kirchengeschichte, Berlin 1991, 34). Le même auteur admet cependant qu’il n’existe aucun indice d’une survie de l’école après la mort du maître. 44 On a supposé que Plotin avait pu dispenser ses cours chez sa protectrice, Gémina (voir M.-O. GOULET-
CAZÉ, art. cit., 241-242). 45 La maison est évoquée en MP. C. 4,8 (= MP. L. 4,8). Le texte de MP. C. 4,6 (= MP. L. 4,6) est moins précis et évoque seulement une vie commune. 46 La vie commune semble avoir été de règle dans l’école d’Origène (cf. H. CROUZEL [éd.], Grégoire le Thaumaturge. Remerciement à Origène. Lettre d’Origène à Grégoire, SC 148, Paris 1969, 18-19). 47 Outre les confesseurs des mines de Phæno (MP. C. 13), qui semblent bien connus du cercle de Pamphile (voir la note 78), Eusèbe mentionne un soldat, Séleucos, qui vint annoncer à Pamphile, alors
SÉBASTIEN MORLET – Eusèbe de Césarée à l’ ‘école’ de Pamphile
217
s’agréger, pour un temps plus ou moins court et avec une assiduité plus ou moins grande, au cercle de Pamphile. L’école du prêtre, comme c’était le cas dans d’autres écoles de l’Antiquité48, comptait peut-être, à côté du noyau dur formé par les étudiants les plus assidus, des étudiants plus occasionnels, plus engagés dans la vie active, et dont l’attachement à Pamphile ne se doublait pas nécessairement d’un renoncement au monde. La même souplesse devait exister au niveau de la formation dispensée par Pamphile. Son école ne s’adressait pas aux débutants: il ne s’agissait donc pas d’une école catéchétique. Il ne s’agissait pas non plus d’une école de perfectionnement. Les textes conservés ne permettent pas même de supposer l’existence d’un cursus clairement défini. Lorsqu’il évoque l’enseignement de Pamphile, Eusèbe reste très vague: il n’en détaille pas les modalités concrètes49. Il ne précise que deux volets de son contenu: les «doctrines divines»50, c’est-à-dire la théologie, et les «paroles sacrées»51, c’est-à-dire l’Écriture. L’enseignement théorique était donc tourné principalement vers l’acquisition et l’approfondissement d’un savoir supérieur, d’ordre théologique et exégétique. Les disciples bénéficiaient aussi d’une formation morale, mais il est difficile de savoir si cette formation prenait l’allure d’un cours théorique. La vie des disciples, du moins des plus assidus, était tournée vers l’acquisition de la vertu52 et de la perfection morale53. Cette recherche de perfection pouvait aller jusqu’à la préparation au martyre: Eusèbe explique ainsi comment Apphianos se préparait de tout son cœur (ἐκθυμότατα), par des exercices appropriés (ἀσκήσεσί τε προσηκούσαις), à subir le martyre54. Il est vrai que le récit d’Eusèbe est rétrospectif et laudatif: pour cette raison, il est difficile d’y démêler a priori la part de la vérité historique et du mensonge romanesque. Il reste à savoir si la philosophie profane occupait une place dans la formation dispensée par Pamphile. A.J. Carriker tient ce fait pour possible, parce qu’Eusèbe prête à Pamphile des connaissances philosophiques et parce qu’il décrit deux de ses disciples, Aidésios et Porphyre, comme des philosophes55. Ces deux arguments nous paraissent cependant fragiles. Eusèbe parle en effet une fois des «connaissances philosophiques» de Pamphile56, mais il reste très vague et il est permis de se demander si ce portrait de Pamphile en philosophe ne participe pas avant tout d’une présentation élogieuse du personnage, visant à le parer d’un savoir éminent. Même à supposer que ce portrait soit conforme à la réalité, il ne signifie pas nécessairement que Pamphile enseignait la philosophie. Ailleurs, Eusèbe dit encore que Pamphile menait une «vie que celui-ci était en prison, le martyre de Porphyre (MP. C. 11,20). Il ne faut donc pas imaginer un cercle fermé sur lui-même. Faut-il aller jusqu’à supposer qu’il ait pu exister des liens institutionnels entre le groupe de Pamphile et l’Église de Césarée? 48 Voir M.-O. GOULET- CAZÉ, art. cit., 233 n. 2. 49 Il évoque seulement Apphianos, «formé aux doctrines divines et exercé aux paroles sacrées sous la conduite de Pamphile le grand martyr» (τοῖς θείοις συγκροθεὶς μαθήμασιν λόγοις τε ἱεροῖς ὑπὸ Παμφίλῳ τῷ μεγάλῳ μάρτυρι συνασκηθείς, MP. L. 4,6) et Porphyre «exercé par une instruction et une éducation digne d’un tel homme» (γνησίᾳ ἀνατροφῇ καὶ παιδείᾳ τοῦ τηλικούτου συνησκημένον ἀνδρός) ou, comme le propose la recension longue du texte, «exercé par un tel homme» (ὑπὸ τηλικῷδε ἀνδρὶ συνησκημένος, MP. L. 4,6). 50 Τοῖς θείοις […] μαθήμασιν (ibid., 4, 6). 51 Λόγοις […] ἱεροῖς (loc. cit.). 52 Voir l’évocation de la tempérance de Porphyre en MP. L. 11,15. 53 Le texte de MP. C. 4,6 évoque la «disposition parfaite» (ἕξιν τελείαν) d’Apphianos. 54 MP. C. 4,6. 55 The Library of Eusebius of Caesarea, Leiden-Boston 2003, 13. 56 Φιλοσόφοις τε μαθήμασιν (MP. C. 7,5).
ADAMANTIUS 17 (2011)
218
philosophique»57 ou qu’il était «un véritable philosophe par sa vie même»58; or ces expressions désignent avant tout un genre de vie et non un attachement à un ensemble de disciplines théoriques59. D’autre part, Eusèbe décrit bien Porphyre portant le manteau de philosophe au moment de subir le martyre60. Mais ne s’agit-il pas avant tout d’un motif littéraire ? Le cas d’Aidésios est différent. Eusèbe le décrit également portant le manteau de philosophe, mais il affirme, cette fois explicitement, qu’Aidésios avait étudié la philosophie61. Mais cela n’implique nullement, une fois encore, que la philosophie ait été enseignée dans l’école de Pamphile; au contraire, la façon dont Eusèbe précise qu’Aidésios «était issu des disciplines philosophiques» (ἀπὸ μαθημάτων φιλοσόφων ὡρμᾶτο)62 tendrait à montrer que ces dernières ne faisaient pas partie de l’enseignement dispensé par Pamphile, ou du moins qu’elles n’y jouaient pas un rôle de premier plan. On est bien sûr obligé de se demander d’où viennent les connaissances philosophiques dont Eusèbe témoigne dans toute son œuvre, et notamment la Préparation évangélique. Faut-il imaginer que c’est à l’école de Pamphile qu’il s’est formé ? Il paraît impossible de répondre à une telle question. On ignore d’abord si les ouvrages philosophiques dont disposaient Eusèbe figuraient déjà dans la bibliothèque de Pamphile. Il est possible que certains d’entre eux remontent au fonds personnel d’Origène – quoique l’histoire des ouvrages d’Origène, après sa mort, soit totalement inconnue, mais c’est impossible pour les plus récents (ceux de Plotin ou ceux de Porphyre, par exemple). Eusèbe a pu se former tout seul, ou au contact d’un ou de plusieurs autres maîtres que nous ne connaissons pas. La solution la plus économique consisterait à supposer que ce maître fut Pamphile, mais le silence des sources doit nous rendre prudents. La question d’un enseignement philosophique à l’école de Pamphile doit donc rester ouverte, mais ce que l’on peut dire, en revanche, c’est qu’il n’existe aucune preuve d’un tel enseignement. Si la philosophie n’était pas, ou même peu enseignée par Pamphile, son enseignement devait donc différer sensiblement de celui d’Origène à Césarée, qui impliquait au contraire une formation philosophique poussée63. Que les disciplines philosophiques aient fait ou non partie de l’enseignement de Pamphile, celui-ci dispensait bien une formation «philosophique» au sens large, c’est-à-dire une formation à un genre de vie particulier, fondé sur l’ascèse et sur le renoncement. Eusèbe insiste volontiers sur les études brillantes de ses condisciples pour mettre d’autant mieux en relief la carrière à laquelle ils
57 Φιλοσόφῳ πολιτείᾳ (MP. C. 11,2). 58 Αὐτῷ τε βίῳ φιλόσοφον ἀληθῆ (HE VII, 32,25). 59 Sur cette question, voir les réflexions de P. HADOT, Exercices spirituels et philosophie antique, Paris 1981, 27-28. Dans la littérature chrétienne, le mot «philosophie» ne désigne d’ailleurs pas nécessairement la philosophie profane, mais peut également faire référence au christianisme considéré comme «vraie philosophie» (voir A.-M. MALINGREY, «Philosophia». Étude d’un groupe de mots dans la littérature grecque, des Présocratiques au IVe siècle après J.-C., Paris 1961). 60 MP. C. 11,19 (= MP. L. 11,19). 61 MP. C. V,2. 62 Loc. cit. 63 Sur la présence de la philosophie dans le programme scolaire d’Origène, voir H. CROUZEL (éd.), Grégoire le Thaumaturge. Remerciement à Origène…, op. cit., 68 sqq. A.J. Carriker, parce qu’il pense que Pamphile enseignait la philosophie, considère qu’il dispensait un enseignement analogue à celui d’Origène (op. cit., 13). L’auteur pense également que des ouvrages philosophiques utilisés par Eusèbe, comme ceux de Plotin et de Porphyre, ont pu entrer à cette époque dans la bibliothèque de Césarée (loc. cit.). Mais si la philosophie ne faisait pas partie de l’enseignement de Pamphile, cette hypothèse, tout en restant possible, perd de sa validité.
SÉBASTIEN MORLET – Eusèbe de Césarée à l’ ‘école’ de Pamphile
219
ont renoncé64. Par ailleurs, il affirme que lorsqu’Apphianos rejoignit Pamphile, il avait préalablement méprisé la gloire de ce monde et les plaisirs du corps65. Pamphile lui-même avait abandonné ses biens66. L’école de Pamphile était donc avant tout une communauté de vie. Y entrer, c’était renoncer au monde et faire le choix de la vie contemplative. Les disciples et leur maître reconstituaient ainsi une petite société originale, à mi-chemin entre la vie active et la vie monastique. L’école de Plotin offre, là encore, un point de comparaison intéressant. En effet, les disciples du philosophe suivaient une règle de vie particulière, fondée sur le végétarisme, la frugalité et le célibat67; l’un des disciples de Plotin, Rogatianus, avait, comme Pamphile, abandonné ses biens68. Par ailleurs, les membres de l’école de Pamphile étaient unis par des liens d’amitié et de fraternité spirituelle69, comme dans certaines écoles philosophiques de l’Antiquité70. Avant d’être un centre d’enseignement, l’école de Pamphile était donc une communauté d’amis et de frères voués à la mise en pratique de la vie spirituelle. Il ne faudrait pas pour autant négliger la dimension théorique de l’enseignement de Pamphile, qui incluait une formation à la théologie et à l’exégèse. L’école de Pamphile n’était cependant pas seulement un lieu de vie et d’enseignement; comme dans certaines écoles philosophiques de l’Antiquité, les disciples pouvaient être appelés à collaborer aux travaux du maître.
Les activités annexes pratiquées dans l’école de Pamphile
Dans l’école de Plotin, les disciples participaient parfois activement aux activités du maître71. Certains ont peut-être assumé des charges d’enseignement72. Amélius et Porphyre s’étaient vu confier la tâche de rédiger des ouvrages73. Le second avait été, par ailleurs, chargé d’éditer les travaux du maître74. De telles activités annexes sont-elles attestées dans l’école de Pamphile ? Il n’existe aucune raison de supposer que les disciples aient pu avoir été chargés de relayer l’enseignement de Pamphile. L’hypothèse de certains chercheurs, qui considèrent l’Introduction générale élémentaire d’Eusèbe comme le manuel d’un enseignement délivré à Césarée75, pourrait laisser penser le contraire. Or cette hypothèse est doublement conjecturale. En effet, la date de
64 Sur les études brillantes d’Apphianos et d’Aidésios, voir les notes 31-33. Eusèbe affirme qu’avant d’ouvrir son école, Pamphile s’était illustré dans les affaires publiques de sa patrie (MP. L. 11,1 e). 65 MP. C. 4,5. 66 MP. L. 11,2. 67 Voir M.-O. GOULET- CAZÉ, art. cit., 254. 68 Vie de Plotin 7. 69 Eusèbe reconnaît en Porphyre à la fois le fils et le frère de Pamphile (MP. L. 11,1 e). 70 Voir M.-O. GOULET-CAZÉ, art. cit., 256. En MP. C. 7,4, Eusèbe compte Pamphile au nombre de ses «compagnons» (ἑταίρων), un terme qui définit également sous la plume de Porphyre la relation existant entre les disciples de Plotin (cf. M.-O. GOULET- CAZÉ, art. cit., 235 n. 1). 71 Voir M.-O. GOULET- CAZÉ, ibid., 237 n. 1. 72 Voir M.-O. GOULET- CAZÉ, ibid., 237-238. 73 Porphyre écrivit une réponse au rhéteur Diophane (Vie de Plotin 15), un rapport sur des questions platoniciennes envoyées par le philosophe Eubule (loc. cit.) et une réfutation du livre de Zoroastre (ibid. 16). Amélius, quant à lui, écrivit un ouvrage contre le livre de Zostrien (loc. cit.). 74 Voir Vie de Plotin 7; 24. 75 Voir E. SCHWARTZ, art. cit., col. 1386; T. D. BARNES, Constantine and Eusebius, Cambridge Mass. 1981, 169.
ADAMANTIUS 17 (2011)
220
rédaction de l’Introduction générale élémentaire n’est pas connue avec précision et elle peut être postérieure à la mort de Pamphile76. Ensuite, rien ne prouve que cette œuvre ait servi de support à un enseignement concret. Il n’existe donc, à notre connaissance, aucun indice d’un enseignement assumé par les disciples de Pamphile. Le cercle s’était-il consacré à la rédaction d’ouvrages? L’Apologie pour Origène, dont Pamphile rédigea les cinq premiers livres en prison, entre 307 et 310, et dont Eusèbe composa le sixième livre après la mort du maître77, pourrait le laisser penser. L’ouvrage répondait aux accusations lancées contre la théologie et l’exégèse d’Origène. Photius affirme qu’il avait été envoyé aux confesseurs des mines de Phæno, avec lesquels le groupe de Pamphile semble avoir eu des liens particuliers78. Cet ouvrage est intéressant à plusieurs titres: il démontre l’implication du groupe dans une polémique contemporaine; il atteste l’existence d’un travail collaboratif entre Pamphile et Eusèbe, et peut-être d’autres de leurs amis; A. Grafton et M. Williams ont montré récemment l’originalité de la méthode déployée dans cet ouvrage, centré sur l’usage d’extraits d’Origène censés illustrer son orthodoxie79. La collecte et la copie de ces extraits supposent sans doute, eux aussi, un travail collectif en amont. Mais qu’en est-il des œuvres personnelles d’Eusèbe ? Certaines d’entre elles ont-elles été rédigées dans le cadre des activités de l’école ? Un certain nombre d’ouvrages d’Eusèbe sont parfois datés d’une époque antérieure à la mort de Pamphile, si bien qu’il peut paraître tentant de les considérer comme les émanations des activités du groupe80. G.F. Chesnut suppose par exemple que l’Histoire ecclésiastique, dont il postule, dans le sillage de R. Laqueur, une première édition en sept livres élaborée avant 303, était originellement une œuvre de documentation sur les premiers auteurs de l’Église s’inscrivant directement dans les activités bibliophiliques du groupe de Pamphile (sur ces dernières, voir infra)81. F. Winkelmann, qui date de cette époque le Contre Hiéroclès et le Contre Porphyre, en vient à supposer qu’Eusèbe était le polémiste du groupe, chargé de répondre aux attaques lancées contre le christianisme82. Ces deux hypothèses formulées par deux spécialistes d’Eusèbe concourent à donner de l’école de Pamphile l’image d’un groupe particulièrement attaché à la production du savoir et fortement engagé dans les controverses contemporaines. Elles restent pourtant conjecturales. L’hypothèse de T. D. Barnes, qui situait une première édition de l’Histoire ecclésiastique dans les années 29083, a été remise en question par certains chercheurs qui pensent que cette première édition ne peut
76 C’est ce que pensait d’ailleurs E. SCHWARTZ, art. cit., col. 1386-1387 (il croyait reconnaître une allusion à la mort de Pamphile dans les Extraits prophétiques, IV, 31). 77 Voir R. AMACKER – É. JUNOD (éd.), Apologie pour Origène, I, SC 464, Paris 2002, 12-13. 78 Photius, Bibliothèque, cod. 118. Voir la discussion de R. AMACKER et d’É. JUNOD (éd.), Apologie pour Origène, II, SC 465, Paris 2002, 81-85. 79 Christianity and the Transformation of the Book. Origen, Eusebius, and the Library of Caesarea, Cambridge Mass.-London 2006, 205. 80 Il s’agit de la Chronique, de l’Histoire ecclésiastique, du Contre Hiéroclès, du Contre Porphyre, de l’Onomasticon et des Canons des évangiles (voir par exemple la chronologie proposée par F. Winkelmann, op. cit., 189). 81 Eusebius: From Youthful Defender of Religious Liberty to Spokesman for the Constantinan Imperial Church, dans The First Christian Histories, 2e éd., Macon GA 1986, 111-140 (notamment 120). 82 Op. cit., 33. 83 The Editions of Eusebius’ Ecclesiastical History, Greek Roman and Byzantine Studies 21 (1980) 191-201.
SÉBASTIEN MORLET – Eusèbe de Césarée à l’ ‘école’ de Pamphile
221
avoir été rédigée qu’à partir de 313/314, soit, après la mort de Pamphile84. Le Contre Hiéroclès, longtemps situé avant 311, est aujourd’hui daté plus volontiers entre 311 et 313, soit, de nouveau, après la mort de Pamphile85. La rédaction de l’Onomasticon est parfois située à la fin du IIIe s. ou au tout début du IVe s.86, mais cette datation ne fait pas non plus l’unanimité87. Il est donc difficile de reconstituer autour du groupe de Pamphile une activité intense de rédaction d’ouvrages et d’engagement réel dans les polémiques de l’époque. Il est possible qu’une partie des œuvres d’Eusèbe émane directement des activités du groupe, mais ce n’est qu’une hypothèse. En revanche, il est possible que certaines de ses œuvres, comme la Chronique ou l’Histoire ecclésiastique, aient été sinon publiées, du moins mûries à cette époque. De plus, quelle que soit la date de leur rédaction, elles s’inscrivent indéniablement dans le prolongement des activités philologiques du groupe, qui sont, quant à elles, bien attestées. Pamphile est en effet le fondateur de l’une des bibliothèques les plus importantes de l’Antiquité88. Cette bibliothèque fut constituée avant tout pour rassembler les œuvres complètes d’Origène et en assurer la conservation. Pamphile avait entrepris de rechercher les opera omnia d’Origène, ce qui lui valut d’être comparé par Jérôme à Démétrios de Phalère et à Pisistrate, l’illustre éditeur des poèmes homériques89. Cependant, le fonds de la bibliothèque incluait aussi des auteurs ecclésiastiques, des auteurs juifs et peut-être aussi des auteurs païens90. Nous savons qu’Eusèbe fut chargé de rédiger le catalogue des œuvres d’Origène présents dans la bibliothèque91. Ce catalogue, qui était reporté dans la Vie de Pamphile, est aujourd’hui perdu, mais Jérôme l’a reproduit dans sa Lettre XXXIII. Pamphile ne s’appliqua pas seulement à rassembler les œuvres d’Origène. Il entreprit également d’en assurer l’édition et la transmission, et associa ses disciples à ses travaux de copie. Ceux-ci nous sont connus par des sources diverses. Jérôme affirme ainsi détenir une copie, écrite de la main de Pamphile, du commentaire d’Origène sur les Douze Prophètes92. Photius mentionne encore les copies, effectuées par Pamphile, des commentaires exégétiques de l’Alexandrin93. Mais
84 A. LOUTH, The Date of Eusebius’ Historia Ecclesiastica, Journal of Theological Studies 41 (1990) 111-123; R.W. BURGESS, The Dates and Editions of Eusebius’ Chronici Canones and Historia Ecclesiastica, Journal of Theological Studies 48 (1997) 471-504. 85 Voir la datation proposée par M. FORRAT (éd.), Eusèbe de Césarée. Contre Hiéroclès, SC 333, Paris 1986, 25-26. Elle a été défendue récemment par S. BORZÌ, Sulla datazione del Contra Hieroclem di Eusebio di Cesarea, Salesianum 65 (2003) 149-160. 86 Voir T. D. BARNES, The Composition of Eusebius’ Onomasticon, Journal of Theological Studies 26 (1975) 412-415. 87 Voir E. SCHWARTZ, art. cit., 1434. 88 Sur cette bibliothèque, outre le livre d’A.J. Carriker déjà cité, voir G. CAVALLO, Scuola, scriptorium, biblioteca a Cesarea, dans G. CAVALLO (éd.), Le biblioteche nel mondo antico e medievale, Roma-Bari 1988, 65-78; D. T. RUNIA, Caesarea Maritima and the Survival of Hellenistic-Jewish Literature, dans K.G. HOLUM – A. RABAN (éd.), op. cit., Leiden 1996, 476-495. 89 Ep. XXXIV, 1. 90 Sur le contenu possible de la bibliothèque de Césarée, voir A. J. Carriker, op. cit. Nous disons «peut-être», car si Eusèbe cite de nombreux auteurs païens, il n’existe aucune preuve, à notre connaissance, que Pamphile ait pu chercher à réunir des ouvrages païens.Ce problème est lié en partie à la question de savoir si Pamphile enseignait la philosophie (voir supra). 91 Voir HE VI,32,3. 92 De uiris inlustribus, 75. 93 Bibliothèque, cod. 118.
ADAMANTIUS 17 (2011)
222
ces activités de copie nous sont surtout connues par plusieurs souscriptions manuscrites qui décrivent en détail le travail de Pamphile et de son groupe94. La plupart de ces souscriptions se trouvent dans des manuscrits du Nouveau Testament et surtout de l’Ancien Testament. Elles nous informent que le cercle de Pamphile s’était appliqué à copier le texte de la Septante dans sa recension hexaplaire, issu du travail de collation et de correction d’Origène consigné dans les Hexaples95. En copiant cette recension de la Septante qu’ils devaient tenir pour le texte «correct» de la Bible, Pamphile et son groupe jouèrent un rôle décisif dans sa préservation et dans sa diffusion. Aux dires de Jérôme, cette recension du texte biblique s’imposa en Palestine96. Des leçons qui en sont tirées se retrouvent dans presque tous les manuscrits de la Septante97. L’existence même des souscriptions, reproduites avec scrupule par les copistes, témoigne de l’autorité dont bénéficiaient les copies effectuées par le cercle de Pamphile. Les manuscrits de Césarée étaient recherchés pour la valeur qu’on leur reconnaissait. Ils étaient utilisés pour vérifier l’exactitude d’une édition. Ces souscriptions présentent également un autre intérêt: elles portent les noms de plusieurs copistes (Pamphile, Eusèbe, Antoninos) et distinguent généralement le travail de collation et le travail de correction. Cette distinction des tâches correspond parfois à une division du travail. Ainsi, dans une souscription de la Syrohexaplaire (une traduction syriaque de la recension hexaplaire achevée par Paul de Tella en 616-617), on trouve écrit: «Moi, Eusèbe, j’ai effectué la correction, tandis que Pamphile s’occupait de la collation98.» Dans deux souscriptions du codex Sinaiticus, nous apprenons que la collation fut effectuée par Antoninos et que Pamphile se chargea de la correction99. Il est tentant de mettre ces témoignages en relation avec un texte des Martyrs de Palestine qui précise que Porphyre était un expert en calligraphie100. Tous ces textes supposent donc une division des tâches au sein de la communauté et reflètent l’importance qu’y occupait le travail de copie. Parmi les différentes activités auxquelles Pamphile et ses amis ont pu se livrer, les activités bibliophiliques occupaient donc une place prépondérante. Les différents témoignages concourent à donner l’image d’un cercle voué à la sauvegarde, à la transmission et à la défense de l’œuvre intégrale d’Origène, c’est-à-dire de son œuvre théologique et exégétique comme de son édition de la Septante. Mais quel était la nature de l’«origénisme» du cercle ? Les amis de Pamphile vénéraient les œuvres d’Origène, mais étaient-ils également perméables aux idées des successeurs du Maître ? On pense en particulier aux maîtres que furent Théognoste et Piérios qui, sur certains points, avaient précisé ou modifié la pensée d’Origène101. C’est tout à fait possible, puisque Pamphile avait été l’élève de Piérios. Dans son cercle, on lisait donc peut être aussi les 94 Sur ces souscriptions, voir G. MERCATI, Di varie antichissime sottoscrizioni a codici esaplari, dans Nuove note di letteratura biblica e cristiana antica, Città del Vaticano 1941, 1-48; R. DEVREESSE, Introduction à l’étude des manuscrits grecs, Paris 1954, 123-124. 95 Il est possible aussi que le groupe ait produit une nouvelle édition du Nouveau Testament (voir R. DEVREESSE, op. cit., 159-164). 96 Voir Contra Rufinum, II, 27. 97 Voir G. DORIVAL – M. HARL – O. MUNNICH, La Bible grecque des Septante, Paris 1988, 166. 98 Dans la traduction de G. Mercati: Eusebius emendaui, Pamphilo collationem instituente (art. cit., 39). 99 Ibid., 14-15; 18-19. 100 MP. L. 11,15. G. Bardy note: «Comme calligraphe, il devait être employé à la transcription des manuscrits» (SC 55, 161 n. 3). De même, J. Sirinelli met le témoignage d’Eusèbe en rapport avec l’existence d’un «scriptorium» à Césarée (op. cit., 18). 101 Voir la note 13.
SÉBASTIEN MORLET – Eusèbe de Césarée à l’ ‘école’ de Pamphile
223
ouvrages de Théognoste et de Piérios. Dans sa propre production exégétique et théologique, Eusèbe, tout en étant constamment inspiré par Origène, prend aussi plusieurs fois ses distances102. Faut-il imaginer que ces divergences remontent à l’époque de Pamphile et aux possibles lectures qu’il fit alors, ou bien plutôt qu’elles se sont imposées à Eusèbe plus tard au cours de sa vie ? Ce que l’on peut dire en tout cas, c’est que, sur la base très maigre de ce qui nous reste des successeurs d’Origène, un ouvrage comme la Démonstration évangélique paraît parfois s’inspirer des Hypotyposes de Théognoste ou des idées de Piérios103.
Conclusion
L’école de Pamphile était un lieu d’enseignement théologique et exégétique. Mais le cercle réuni autour du Martyr était avant tout un groupe d’amis et de frères qui avaient fait le choix de se consacrer ensemble à la vie ‘philosophique’, impliquant un rejet de la vie active et une recherche de la perfection morale. Le groupe nourrissait une admiration particulière pour l’œuvre d’Origène, qu’il avait l’ambition d’éditer, de copier et de défendre. Malgré plusieurs traits qui font de l’école de Pamphile une école caractéristique de l’Antiquité, cette place prépondérante occupée par la recherche, la copie et le catalogage des manuscrits lui donne une allure originale. L’autre conclusion de cette étude est qu’en dépit de quelques points communs, l’école de Pamphile devait être assez différente de l’école d’Origène, dans laquelle la philosophie païenne occupait un rôle important. Une telle étude peut contribuer à montrer dans quelle mesure un centre de formation et un réseau de sociabilités ont pu influencer une identité intellectuelle. L’école de Pamphile a marqué la formation d’Eusèbe à au moins trois niveaux: on peut supposer que c’est dans ce cadre qu’Eusèbe s’est converti à la vie de l’esprit; c’est encore dans ce cadre qu’il a appris à connaître et à admirer l’œuvre d’Origène, dont l’impact fut décisif sur la genèse de sa théologie et de son exégèse; c’est dans ce cadre, enfin, qu’il s’est formé aux méthodes de l’érudition et de la philologie, qu’il mit en pratique dans toute sa production littéraire.
Sébastien Morlet Université de Paris IV – Sorbonne
UMR 8167 «Orient et Méditerranée» Centre Lenain de Tillemont
102 Voir, sur ces deux domaines, les travaux de M.J. HOLLERICH, Origen’s Exegetical Heritage in the Early Fourth Century: the Evidence of Eusebius, dans R. DALY (éd.), Origeniana quinta, Leuven 1992, 542-547; C. KANNENGIESSER, Eusebius of Caesarea, Origenist, dans H.W. ATTRIDGE – G. HATA (éd.), Eusebius, Christianity and Judaism, Leiden 1992, 435-466; J. ULRICH, Euseb und die Juden: der origineische Hintergrund, dans W.A. BIENERT – U. KÜHNEWEG (éd.), Origeniana septima, Leuven 1999, 135-140; S. MORLET, Le commentaire d’Eusèbe de Césarée sur Is 8,4 dans la Démonstration évangélique (VII,1,95-113): ses sources et son originalité, Adamantius 13 (2007) 52-63; La Démonstration évangélique d’Eusèbe de Césarée. Étude sur l’apologétique chrétienne à l’époque de Constantin, Paris 2009, 585-622. 103 Voir S. MORLET, La Démonstration évangélique…, 290 sqq.