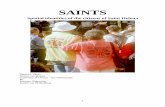SaineS pratiqueS d'intervention en forêt privée - Fédération ...
Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre”
Transcript of Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre”
ARTICLE65
6
Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre” Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
Au Liban, le culte des saints draine de nos jours, comme depuis des siècles, l’essentiel des dévotions aussi bien chrétiennes que musulmanes. Oratoires, chapelles, monastères, mosquées, maqâms*, mazars* témoignent de l’importance de ce culte dans la culture libanaise. Cette géographie sacrée ne cesse de se développer et d’évoluer en créant un réseau où s’établissent des hiérarchies et se dessinent des itinéraires de pèlerinages.
Nous nous intéresserons particulièrement aux pèlerinages votifs individuels appelés aussi communément « ziyârât* » (les visites), le plus souvent partagés par différentes communautés. Le croyant cherche à y rencontrer le saint « en personne » pour s’entretenir avec lui et lui manifester un attachement amical.
Les pèlerinages populaires se sont répandus en dehors des formes de l’orthodoxie chrétienne et musulmane, exprimant la piété des gens et leur besoin de mettre leur existence et leurs problèmes quotidiens en rapport avec l’éternité et l’infini. Musulmans, chrétiens, druzes* et bouddhistes se retrouvent en ces lieux de culte. À la religiosité codifiée de la mosquée et de l’église, les croyants ont répondu par une pratique moins contraignante que certains qualifient de « populaire ».
Pour Chiffoleau et Madoeuf, « quelle que soit l’importance du vœu, ce besoin de rencontre et d’intercession qui émane de toutes les confessions, tisse dans la région (du Maghreb au Moyen Orient) un intense réseau de pèlerinage »1. Les pèlerins se côtoient et échangent dans une atmosphère cordiale et pacifique, sans artifice, souvent loin des tensions de la réalité libanaise, même s’il n’est pas dit/même si rien ne prouve que ce dialogue se maintient toujours dans la vie quotidienne, en dehors des pèlerinages.
Au Liban, le culte des saints et les pèlerinages semblent avoir contribué à maintenir un dialogue entre les fidèles autour de figures de sainteté partagées, même durant les moments les plus durs de la guerre. Marlène Kanaan parle du culte de saint Georges*/Al Khodr* comme d’un « ferment d’unité » en dépit de la diversité confessionnelle et précise que la dévotion des fidèles à ce saint dépasse souvent les communautés dont ils sont issus2. Pour Aïda Kanafani-Zahar3, c’est la « sublimation du religieux » qui vise à garantir la coexistence au sein des groupes bi-confessionnels4.
Cet article propose un survol rapide du phénomène des pèlerinages partagés en suggérant différentes typologies et réflexions autour des figures de sainteté et des lieux de culte partagés ainsi que des pratiques dévotionnelles.
1 CHIFFOLEAU S. ; MADOEUF A. (Dir.), Les pèlerinages aux Ma-ghreb et au Moyen Orient : Espaces publics, espaces du public, Beyrouth, IFPO, 2005.2 KANAAN M., « Contribution à l’étude du culte du Saint et Glorieux Mégalo-Martyr Georges le Théophore au Liban », Les Cahiers de Saint-Michel de Cuixa, XXIX, Paris, 1998, p.106.3 Aida Kanafani Zahar traite le rite du sacrifice du mouton partagé par les chrétiens de la montagne et les musulmans chiites.4 KANAFANI ZAHAR A., Le mouton et le mûrier : rituel du sacrifice dans la montagne libanaise, Paris, PUF, 1999.
Les figures de sainteté partagées A.
« Chaque religion a apporté ses définitions et ses strates dans l’histoire complexe de la sainteté au Moyen-Orient. »5.
Ce propos se limitera à classer les figures partagées de la sainteté chez les chrétiens et les musulmans, sans toutefois s’étendre sur les détails hagiographiques et sur les types de dévotions relatives à chacune de ces figures. L’origine de certains saints remonte à très loin dans l’histoire alors que d’autres naissent encore aujourd’hui.
Deux grandes catégories de saints partagés peuvent être présentées : d’une part les saints « reconnus » et vénérés par les deux communautés, d’autre part les saints exclusivement chrétiens ou musulmans mais qui sont vénérés par les fidèles des deux communautés. Ces catégories principales révèlent aussi de nombreux sous-types.
Figures saintes « reconnues » et vénérées par les deux 1- communautés
La Vierge Marie, a- Saydeh MaryamDans la première catégorie des saints « reconnus » et vénérés par les deux communautés, la Sainte Vierge occupe indiscutablement une place prépondérante, une place unique aussi bien dans la religion chrétienne que dans la religion musulmane. Fille de Sion pourr les juifs, mère de Jésus, fils de Dieu, pour les chrétiens, mère du prophète Issa pour les musulmans et figure admirable devant laquelle viennent se recueillir les fidèles de diverses religions, on lui réserve une dévotion très importante en Orient et particulièrement au Liban. Pour les chrétiens, Marie était une fille de la tribu de Juda et sa famille, bien que déchue, descendait de la race royale de David.
En matière de sainteté, Dieu est le seul point de référence pour les Musulmans. Mais ce sont tout d’abord le Prophète Mohammad et ensuite Marie qui reflètent la sainteté de Dieu. Marie peut donc être considérée comme une excellente source de dialogue entre chrétiens et musulmans. Sa foi radicale et sa parfaite soumission à la volonté de Dieu en font le grand modèle du croyant. Elle est vénérée dans l’Islam essentiellement pour ses vertus ; sa pureté virginale, son humilité, sa piété envers Dieu en font un exemple pour la foi des croyants. Marie est la seule femme dont le nom figure 34 fois dans le Coran, notamment dans la sourate 19, comme vierge et mère - par intervention divine - du prophète Jésus - Issa.
Les prophètes et les saints bibliques b- Un deuxième sous-type regroupe les prophètes bibliques. Ils ont pour mission de recevoir la parole de Dieu et de transmettre ses messages aux hommes. Juifs, chrétiens et musulmans partagent cet héritage prophétique. Dans le christianisme, le lien entre Dieu et les hommes, c’est Jésus-Christ, à la fois Dieu et Homme. Dans l’Islam, c’est le prophétisme : Dieu parle aux hommes par ses prophètes (les nabis, anbiya) et par ses envoyés (les rasoûl, beaucoup moins nombreux mais ayant une mission d’instruction et une autorité plus importante). Si le Coran ignore certains des principaux prophètes bibliques (Isaïe, 5 MAYEUR-JAOUEN C. (Dir.), Saints et héros du Moyen-Orient contemporain, Paris, Maisonneuve et Larose, 2002, p.9.
Nour Farra-Haddad Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre”
Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
657
In Lebanon today, the worshipping of saints captures the essence of Christian as well as Muslim devotion, as it has for centuries. Oratories, chapels, monasteries, mosques, maqâms* and mazars* testify to the importance of this worship in Lebanese culture. This sacred geography has not ceased to develop and evolve, creating networks where hierarchies are established and itineraries for pilgrimages are designed.
This article is particularly interested in individual votive pilgrimages, also commonly called ziyârât* (visits), which are most often shared by different communities. The believer seeks to meet the saint “in person” in order to discuss with and demonstrate a friendly attachment.
Popular pilgrimages have spread beyond their orthodox Christian and Muslim forms, expressing people’s piety and their need to create a relationship between their daily existence and their problems, between eternity and infinity. Muslims, Christians, Druze* and Buddhists are found at these worship sites. In contrast with the codified religiosity of the mosque and church, believers have developed a less constraining religiosity, which some characterize as “popular.”
For Chiffoleau and Madoeuf, “whatsoever the importance of the vow, this need for meeting and intercession that emanates from all denominations, weaves an intense network of pilgrimage in the region (from the Maghreb to the Middle East).”1
In Lebanon, saint worship and shared pilgrimages seem to have contributed to maintaining a dialogue amongst the faithful around shared figures of sainthood, even during some of the most difficult moments of the war. Marlène Kanaan speaks of the worship of St. George/Al Khodr as a “ferment of unity” in spite of denominational diversity, and specifies that the devotion of the faithful to this saint often goes beyond the community from which they come2. For Aïda Kanafani-Zahar,3 it’s the “sublimation of the religious” which aims to guarantee the coexistence at the heart of these bi-sectarian groups.4
This article provides a quick synopsis of the phenomenon of shared pilgrimages, suggesting different typologies and reflections around figures of shared sainthood and shared worship sites as well as devotional practices.
Shared figures of sainthood A.
“Each religion brought its definitions and its strata to the complex history
1 CHIFFOLEAU S. ; MADOEUF A. (Dir.), Les pèlerinages aux Ma-ghreb et au Moyen Orient : Espaces publics, espaces du public, (Pilgrimages in the Mahgreb and the Middle East : Public spaces, spaced for the public) Beirut, IFPO, 2005.2 KANAAN M., « Contribution à l’étude du culte du Saint et Glorieux Mégalo-Martyr Georges le Théophore au Liban », (A contribution to the study of the worship of the holy and glorious megalo-martyr George the Theophoric in Lebanon) Les Cahiers de Saint-Michel de Cuixa, XXIX, Paris, 1998, p.106.3 Aida Kanafani Zahar talks about the ritual of the sacrifice of sheep shared by Christians from the mountains and Shiia Muslims.4 KANAFANI ZAHAR A., Le mouton et le mûrier : rituel du sacrifice dans la montagne libanaise, (The sheep and the mulberry tree : the ritual of sac-rifice in the Lebanese mountains) Paris, PUF, 1999.
of sainthood in the Middle East”5
This article classifies shared figures of sainthood among Christians and Muslims, without elaborating on hagiographic details or the types of devotion related to each of these figures. The origin of some saints goes back very far in history while others are still being born today.
Two large categories of shared saints can be discerned: on the one hand, “recognized” saints who are venerated by both communities, and on the other hand, saints who are exclusively Christian or Muslim, but are venerated by the faithful of both communities. These main categories also reveal numerous sub-types.
Saints “recognized” and venerated by both communities1-
The Virgin Mary (a- Saydeh Maryam)
In this first category the Virgin Mary indisputably occupies a predominant and unique place within the Christian, Judaic, and Muslim religions. Recognized as a daughter of Zion by Jews, as the mother of Jesus, Son of God by Christians, as the mother of the prophet Issa by Muslims and as an admirable figure before whom the faithful of many diverse religions gather, a very important devotion is reserved for her in the Middle East, particularly in Lebanon. For Christians, Mary was a daughter of the Juda tribe, her family, though fallen, descended from the royal race of David.
In terms of sainthood, God is the only point of reference for Muslims. But first and foremost are the Prophet Mohammed and then Mary, both of whom reflect the sainthood of God. Mary can thus be considered an excellent source of dialogue between Christians and Muslims. Her radical faith and her perfect submission to God’s will make her a great model believer. She is essentially venerated in Islam for her virtues: her virginal purity, humility, and piety towards God all make her an example for the faith of believers. Mary is the only woman whose name appears 34 times in the Koran, notably in sura 19, as virgin and mother - by divine intervention - of the prophet Jesus, or Issa.
The biblical prophets and saintsb-
A second sub-group of saints brings together Biblical prophets. Their mission is to receive the word of God and transmit, come what may, his messages - all different in form and content - to men. Jews, Christians and Muslims share this prophetic heritage. In Christianity, the link between God and men is Jesus Christ, who is both God and Man. In Islam, it is prophecy: God speaks to men through his prophets, the nabi* and anbiya (plural of nabi), and by his messengers, the rasoûl, who are much fewer in number, but follow a mission of teaching and a more important authority. If the Koran ignores certain major biblical prophets (Isaiah, Jeremiah), it mentions numerous others unknown to Christians (Sâlih, Chaïb).
Saints claimed by both communitiesc-
In this category, saints are “recognized” and venerated by both
5 MAYEUR-JAOUEN C. (Dir.), Saints et héros du Moyen-Orient con-temporain, (Saints and heroes of the contemporary Middle East) Paris, Maison-neuve et Larose, 2002, p.9
ARTICLE65
8
Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre” Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
Jérémie), il mentionne d’autres, inconnus des chrétiens (Sâlih, Chaïb).
c- Les saints revendiqués par les deux communautésDans cette catégorie sont classés des saints « reconnus » et vénérés par les deux communautés mais sous des noms différents et plus spécifiquement des saints chrétiens dont on retrouve les correspondances dans la tradition islamique.
Saint Georges* (Mar Jiryes*), Al Khodr* est un de ces saints. Il compte parmi les saints les plus vénérés au Liban par les chrétiens, les musulmans et les druzes1*. Saint Georges est un saint de renommée universelle. Les églises d’Orient et en particulier l’église maronite en ont fait un grand martyre. De merveilleuses légendes, transportées jusqu’en Occident, relatent ses actions héroïques et sa passion. La légende de Saint Georges avec le dragon a été rapportée de génération en génération selon des versions très variées. L’église le classe dans la catégorie des saints militaires et il est presque toujours représenté en costume guerrier, monté sur son cheval. St Georges est le « mégalo martyr », patron de Beyrouth, dont le nom en arabe varie et a subi diverses déformations : Al Qedis Jirjis, Jerios, Jourios, Jawarjios, Jorjos, Djirjis, Jirjis, Kevork chez les Arméniens et Korkis chez les syriaques..
Saint Pierre (Mar Boutros), Sham’oun, Sem’an est un autre saint qui pourrait être mentionné dans cette catégorie. C’est un apôtre martyr que l’on retrouve dans plusieurs épisodes de l’évangile. Il parcourt avec quelques disciples les provinces d’Orient, de Syrie et d’Asie Mineure, et les évangélise. Dans les villes de la côte libanaise, il prêche, convertit, guérit des malades et nomme des évêques2.
Saints exclusivement chrétiens ou musulmans1- Il s’agit des saints exclusivement chrétiens ou musulmans auxquels des croyants de toutes confessions consacrent une dévotion particulière.
Les saints chrétiens libanais contemporains a-
La dévotion réservée aux saints chrétiens libanais maronites, saint Charbel*, sainte Rafqa et saint Hardini a pris une telle ampleur qu’ils semblent être devenus les patrons de tout le pays. L’adoration et la ferveur que les foules innombrables leurs manifestaient n’ont pas attendu les canonisations officielles, voire même les béatifications. Ces saints ont été canonisés successivement en 1977, 2001 et 2004 ; Depuis ils sont devenus les intercesseurs et les défenseurs de toutes les communautés libanaises et des symboles nationaux. Ils sont considérés comme des saints guérisseurs «généralistes», accomplissant des miracles et remédiant à toutes sortes de situations. Leurs lieux de culte sont les plus fréquentés au Liban et on vient de loin pour les implorer.
Les saints thaumaturges « spécialisés »b- Les saints à vertus thérapeutiques, qu’on appelle saints guérisseurs ou thaumaturges et auxquels sont attribués des pouvoirs et des vertus spécifiques, sont très nombreux dans toutes les communautés. Bien des livres et des références évoquent les différentes spécialisations des saints, notamment pour les « saints guérisseurs ». La Bretagne
1 KANAAN M., 1998, op.cit, p.106.2 SAUMA V., Sur les pas des saints au Liban, Beyrouth, F.M.A., 1994, tome 1, p. 171-174.
par exemple, en France, détient des records en la matière. Ces spécialisations existent dans toutes les communautés religieuses. Un même saint peut accumuler plusieurs spécialisations et caractéristiques, vertus thérapeutiques, patrons de métiers, protecteurs, etc.
Au Liban, il existe toute une série de saints que l’on peut qualifier de saints guérisseurs « spécialisés », chez les chrétiens comme chez les musulmans. Ils sont les plus sollicités pour des grâces et des miracles. Il y a parmi eux les « ophtalmologues » comme sainte Barbe et Mar Nohra (St Lumière), les « orthopédistes » comme Mar Doumit ; les oto-rhino-laryngologistes comme Mar Adna «l’esclave à l’oreille percée ». Cheikh Zaber est un saint musulman spécialiste des verrues vénéré à Minieh comme Nabi Barri à Haytlé ; et Cheikh Issa, au Aakkar, est réputé pour guérir les rhumatismes et les problèmes de dos. Il existe aussi plusieurs niveaux de spécialisation. Dans le cas des « gynécologues », il y a ceux qui sont spécialisés dans les accouchements et qui protègent les femmes enceintes, comme Al-Chahidé Margharita et Mar Lionardo (St Léonard), ceux qui favorisent les montées de lait chez les jeunes mères qui n’arrivent pas à nourrir leur enfant, comme Mar Matta (St Mathieu), Al-Qaddisé Marina* (sainte Marina*), Saydet Al Bzaz (Notre-Dame des Mamelles), et enfin, les saints et saintes qui favorisent la naissance de filles ou de garçons.
Les figures saintes aux légendes similairesa- Vauchez, dans la préface des actes du colloque organisé par Denise Aigle sur les saints orientaux, indique à quel point les saints orientaux, chrétiens ou musulmans, ont eu des cheminements similaires. Le rapprochement entre leurs parcours est souvent troublant, même si leur statut diffère en fonction des religions. Les similitudes sont frappantes, tant au niveau de l’expression littéraire que de la thématique spirituelle3. Au Liban, une approche comparative de la vie des saints révèle des convergences insoupçonnées très significatives. Les cas de sainte Marina* (sainte chrétienne maronite ayant vécu dans la vallée de la Qadisha) et de Sitt Sha‘wana* (sainte druze* de la région de ‘Ammiq-Bekaa) témoignant de ce rapprochement ont été particulièrement retenus. Chrétiens et musulmans se tournent vers ces figures sans toujours faire un rapprochement entre elles, l’essentiel pour eux étant la baraka (les grâces) liée à ces figures. B-Les lieux de culte partagés
Les lieux de culte communs correspondent pour la plupart aux figures de sainteté partagées. Nous retrouvons chez les communautés orientales, et plus particulièrement au Liban, une dévotion mariale très importante. Sur un petit territoire de 10452 Km2, la densité des lieux de culte est impressionnante et leur fréquentation intense. Dans les maisons, une place d’honneur est consacrée à l’image ou à la statue de la Vierge. Chaque village chrétien lui consacre des autels, des églises, des chapelles, des oratoires. Beaucoup de filles portent le nom de Marie Myriam, Maria, etc.
Bien que les deux communautés vénèrent la Sainte Vierge, la quasi-totalité de ces lieux de culte sont chrétiens. Plus de 900 lieux de culte lui sont dédiés, dont beaucoup (environ 50%) sont partagés. Le degré
3 AIGLE D., Saints orientaux, Paris, De Boccard, 1995, p.11-14.
Nour Farra-Haddad Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre”
Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
659
communities, but under different names; more specifically, these are Christian saints for who exist counterparts in the Islamic tradition.
St. George (Mar Jiryes), or Al Khodr, is venerated most by Christians, Muslims and the Druze,1 though he is universally renowned. The churches of the Middle East, especially the Maronite one, made a great martyr out of him. Marvellous legends, transported all the way to Europe, tell of his heroic actions and his passion. The legend of St. George and the dragon has been recounted from generation to generation in a great variety of versions.
The church classifies him in the category of military saints, and he is almost always represented in a warrior outfit on his horse. St. George is the “mega-martyr,” patron saint of Beirut, whose name varies in Arabic: Al Qedis Jirjis, Jerios, Jourios, Jawarjios, Jorjos, Djirjis, Jirjis, Kevork among Armenians, and Korkis among the Syriacs.
St. Peter (Mar Boutros), or Shamooun, Semaan, is another saint who could be placed in this category. He is a martyr prophet mentioned in several parts of the Gospel. With a few disciples, he covers the provinces of the Middle East - from Syria to Asia Minor - and evangelizes them. In some cities on the Lebanese coast, he preaches, converts, heals the sick and assigns bishops.2
Exclusively Christian or Muslim saints1- In this category are those classified exclusively as Christian or Muslim saints, towards whom believers of all religious background share a particular devotion.
Contemporary Lebanese Christian saintsa-
The devotion reserved for Lebanese Christian Maronite saints - St. Charbel, St. Rafqa and St. Hardini - has become so intense that they appear to have become patron saints of the entire country. The devotion and fervor that countless crowds have expressed towards them have preceded official canonizations and even beatifications. These saints were successively canonized in 1977, 2001 and 2004; since then, they have become intercessors and defenders of all Lebanese communities and its national symbols. They are considered healing “generalist” saints, accomplishing all kinds of miracles and remedying all sorts of situations. Their worship sites are the most visited in Lebanon and people come from far to beseech them.
« Specialized » thaumaturge saintsb-
Saints with therapeutic virtues, known as healing saints or thaumaturges to which specific powers and virtues have been attributed, are numerous in all of the communities. Many books and references recall the specialties of different saints, notably “healing saints”; Brittany, for example, houses records on this matter. These specialties exist in all religious communities. One saint can accumulate several specialties on his or her own, including therapeutic virtues, trade, protection, and so on.
1 KANAAN M., 1998, op.cit, p.106.2 SAUMA V., Sur les pas des saints au Liban, (In the saints’ footsteps) Beirut, F.M.A., 1994, tome 1, p. 171-174.
In Lebanon, there are a whole series of saints who qualify as “specialized” healing saints, as much among Christians as among Muslims. They are solicited the most for favors and miracles. Among them are “ophthalmologists” such as St. Barbe and Mar Nohra (St. Light); “orthopedic specialists” such as Mar Doumit; and oto-rhino-laryngologists such as Mar Adna (the slave with the pierced ear). Sheikh Zaber is a Muslim saint specializing in warts in Minieh, just like Nabi Barri in Haytla; and Sheikh Issa in Aakkar is reputed for healing rheumatisms and back problems. There are also several levels of specialization. In the case of “gynecologists,” there are those who specialize in births and who protect pregnant women, such as Al-Chahidé Margharita and Mar Lionardo (St. Leonard); those who facilitate an increase in milk production for young mothers who are unable to feed their child, such as Mar Matta (St. Matthew), Al-Qaddisé Marina (St. Marina*), and Saydet Al Bzaz (Our Lady of the Breasts); and finally, saints favoring the births of either girls or boys.
Saints with similar legendsa-
Vauchez, in the preface of the notes of the colloquium organized by Denise Aigle on Middle Eastern saints, indicated to what point such saints, both Christian and Muslim, have had similar life paths. The connection between the lives of these saints is often troubling, even if their status is different according to the two religions. The similarities are striking, as much at the level of literary expression as in the spiritual theme.
In Lebanon, a comparative approach to analyzing the lives of saints reveals very significant and unsuspected convergences. The cases of St. Marina (a Maronite Christian saint who lived in the Qadisha valley) and Sitt Shaawana (a Druze saint who lived in the Aammiq-Bekaa region), which testify to this rapprochement, have been particularly retained in memory.
Christians and Muslims alike turn to these figures without always making a connection between them; for them what is essential is the Baraka* around these figures.
B- Shared worship sites
Shared worship sites correspond mostly with figures of shared sainthood. We find among Middle Eastern communities, and more particularly in Lebanon, a very important form of Marian devotion. On a small territory of 10452 km2, the density of these worship sites is impressive and activity here is intense.
In homes, a place of honor is dedicated to the image or statue of the Virgin. Each Christian village dedicates shrines, churches, chapels and oratories to her, and many girls are named Marie, Myriam, Maria, and other variations on the Virgin’s moniker.
Even though both communities venerate the Virgin Mary, most of these worship sites are Christian. There are more than 900 worship sites dedicated to her, many of which (around 50%) are shared. The degree of sharing varies according to the intensity of visits by non-Christian pilgrims to these sites. Mazar Al Saydeh seems to be the only Muslim site dedicated to the Virgin in Saaydeh (beside Beshouat).
ARTICLE66
0
Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre” Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
de partage varie selon l’intensité de fréquentation des pèlerins non chrétiens en ces lieux. Mazar Al Saydeh semble être le seul lieu de culte musulman dédié à la Vierge à Sa’aydeh (à côté de Beshouat).
Ainsi, il devient évident que la dévotion mariale au Liban dépasse celle vouée aux saints.
Certains lieux de culte voués à la Sainte Vierge ne peuvent être attribués ni aux chrétiens ni aux musulmans. Nous en citons deux exemples :
Dans le temple de Vénus à Afka, village chiite de la montagne libanaise, une dévotion à « Saydet El Zahra » (Notre Dame de la fleur) a survécu au culte païen. Entre Sour et Saïda, le mystérieux rocher d’Adloun avec ses deux cents grottes taillées, n’est autre qu’une ancienne nécropole païenne qui servit ensuite de refuge à quelques ermites. C’est dans une de ces cavités, la «grotte des mamelles», qu’a survécu le culte d’Astarté converti en culte à la Vierge1.
Le nom d’Elie est très courant au Liban. Beaucoup de villages, de rues et de quartiers le portent aussi. Ses statues et ses images où il apparait brandissant une épée existent un peu partout dans des oratoires, des grottes, des niches, etc. Saint Elie* est l’un des grands prophètes de l’Ancien Testament, thaumaturge du IXe siècle avant Jésus-Christ. Le nombre important de lieux de culte chrétiens dédiés à saint Elie* élève singulièrement la moyenne des sanctuaires chrétiens voués aux saints bibliques. Sur 262 lieux de culte chrétiens dédiés à saint Elie*, une dizaine peuvent être vraiment considérés comme des lieux partagés tels le couvent de St Elie à Jiita, l’oratoire de saint Elie* à ‘Ain Sa‘adé, ex-voto construit par un « vouant » se considérant le messager du saint, Adib Abdel Massih. A côté des lieux de culte chrétiens, une dizaine de lieux musulmans sont consacrés à Nabi Ayla* ou Nabi Yassine (saint Elie dans le Coran), dont la petite mosquée de Ablah, le maqâm de Nabi Elias à Qabb Elias, etc.
Le nombre de lieux de culte chrétiens affectés aux autres saints bibliques est presque insignifiant par rapport à ceux dédiés à saint Elie*. Victor Sauma attribue un seul et unique lieu de culte chrétien à saint Isaïe (Mar Cha’aya), Prophète de Juda au VIIIe siècle av. J.C., à Broumana. Pour saint Daniel, le prophète hébreu (604-534 av. J.C), on répertorie environ 4 lieux de culte chrétiens. Pour saint Elisée (Mar Elicha’), cité dans les dix premiers chapitres du deuxième livre des rois de l’Ancien Testament, on dénombre environ 5 lieux de culte chrétiens dont le plus important est le vieux couvent de la Vallée Sainte, Wadi Qadisha. Pour saint Abraham (Mar Ibrahim), 21ème patriarche dans la chronologie biblique, on compte uniquement deux lieux de culte chrétiens. Seuls le couvent de saint Elisée, dans la vallée de Qadisha, et le monastère de N.D. de Qannoubine situé un peu plus loin, peuvent être classés parmi les lieux de culte partagés. Le culte des prophètes bibliques chez les musulmans est plus important que chez les chrétiens et de nombreux lieux de culte leur sont dédiés. Souvent ces dévotions portent à confusion, les correspondances établies entre les prophètes n’étant pas toujours justifiées.
1 GOUDARD J. (R.P.)., La sainte Vierge au Liban, Beyrouth, 3ème édition refondue par JALABERT H. (R.P)., Dar El Machreq, 1993, p. 25.
Au Liban, on recense une dizaine de lieux de culte musulmans consacrés à Nabi Ayla* ou Nabi Yassine. Nabi Nouh, Noé (Mar Nouh) pour les chrétiens, est la figure légendaire du patriarche biblique participant au récit du déluge. Le sanctuaire et le mausolée du Prophète Nouh* à Karak, au nord de Zahlé dans la plaine de la Békaa, sont particulièrement intéressants. Il existe, dans ce village et aux alentours, de nombreuses légendes et croyances populaires liées au déluge. Un maqâm construit sur des vestiges antiques abrite une tombe de plus de 25 mètres attribuée à Noé ou à un de ses fils. Des fidèles de toutes confessions viennent ici le prier.
Moïse, Nabi Moussa, est un grand prophète biblique vénéré au Liban. Pour les religions monothéistes, il est à la fois l’auteur et le principal personnage de la Bible. Il est mentionné dans le judaïsme, le christianisme et l’islam. C’est lui qui, sous la dictée divine, aurait écrit les cinq premiers livres de l’Ancien Testament (Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome). Prophète et guide, il conduit les Enfants d’Israël hors d’Égypte où ils étaient réduits en esclavage. Il reçoit de Dieu les Dix Commandements et tout un ensemble de lois religieuses, sociales et alimentaires. Il est le personnage central de la naissance et de la formulation de la religion juive. Fils d’Imrân, il est le prophète le plus cité dans le Coran sous le nom de Moussa, prophète et messager d’Allah. La sourate 3 du Coran est intitulée La famille d’Imrân. .
On lui doit plusieurs lieux de culte au Liban. Un petit maqâm lui est dédié à Komatieh. Kheir Eldeen évoquent plusieurs autres maqâms dans la plaine de la Békaa comme celui de Mar‘aboun, au Hermel, à Qasr, Mansoura, à Al Houayek, à la frontière syro-libanaise où les croyants allument des cierges et brûlent des bougies. Les Skeels, dans leur guide sur le Liban connu et méconnu, parlent d’une tombe de Nabi Moussa à Qarhaiya, dans la région du Nahr el Bared, et mentionnent la vallée de Nahr Abou Moussa2. « La tombe de En Nabi Moussa était restée intacte pendant des siècles – un monticule entouré de pierres taillées prés du centre du village, sous un bosquet de chênes centenaires – mais elle a été rénovée récemment et les vieilles pierres remplacées par un bloc de ciment monolithique »3. Aucun culte ne semble se perpétuer sur les lieux et cette tombe ne fait plus l’objet de pèlerinages. Dans les hauteurs du Keserouan se dresse le « Jabal Moussa », une montagne où un petit village aujourd’hui abandonné avait été construit. Dans les récits populaires, Moïse aurait traversé cette montagne avant de retrouver la terre promise. À Qadas, au sud-Liban, une dévotion existe autour d’un puits où Moussa serait passé. L’eau de ce puits attire les croyants de différentes confessions. Un Maqâm lui est aussi dédié dans le village Al-Safina à 5 km de Kfayr au caza de Rashaya, riche en vestiges païens.
Job, patriarche de l’Ancien Testament, n’est autre que le héros du Livre de Job. L’équivalent arabe est Ayoub (’ayyûb), la variante turque, Eyüp. Le maqâm* druze* de Niha est un très haut-lieu de pèlerinage partagé, perché à 1400 m d’altitude. Jonas est l’un des principaux prophètes hébreux de l’Ancien Testament, appelé Yunus en arabe, Younès en dialectal. Dans un village du Chouf portant son nom et abritant son tombeau, dans une mosquée, on croit fortement que le prophète a été rejeté par la baleine. La dixième
2 SKEELS F. ; SKEELS L., Le Liban connu et méconnu, Beyrouth, Garnet Publishing, 2001, p. 279-281.3 Ibid. p. 281.
Nour Farra-Haddad Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre”
Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
661
It becomes clear, then, that Marian devotion in Lebanon exceeds that which is given to the saints.
There are also worship sites dedicated to her that cannot necessarily be attributed to either Christians or Muslims. Here we cite two examples:
In the Venus temple in Afka, a Shiia village in the Lebanese mountain, devotion to Saydet* El Zahra (Our Lady of the Flower) has survived pagan worship of Venus.
Between Sour and Saïda, the mysterious Aadloun rock, with its two hundred carved grottos, is an ancient pagan necropolis that later served as a refuge for several hermits. It is in one of these cavities, “the grotto of the breasts,” where the worship of Astarte survived, which then converted into Virgin worship.1
The name Elie is very common in Lebanon. Many villages, streets and neighborhoods also bear it. Indeed, statues and images of St. Elie* brandishing a sword exist everywhere—in oratories, caves, and so on. This saint is one of the great prophets from the Ancient Testament, a thaumaturge dating back to 900 B.C. The number of Christian worship sites dedicated to St Elie is what raises the average number of Christian sanctuaries devoted to Biblical saints. In fact, there are almost 262 Christian worship sites dedicated to St. Elie, a dozen of which can truly be considered shared sites, such as the St. Elie convent in Jiita as well as the St. Elie oratory in Ain Saadé, which is an ex-voto built by Adib Abdel Massih, a devotee who considered himself the saint’s messenger. Aside from these Christian worship sites, a dozen Muslim sites are devoted to Nabi Ayla or Nabi Yassine (St. Elie in the Koran), such as the little mosque of Ablah, the maqâm of Nabi Elias in Qabb Elias, and so on.
The number of Christian worship sites devoted to other Biblical saints is almost insignificant when compared to those dedicated to St. Elie. Victor Sauma lists a single site of worship in Broumana to St. Isaiah (Mar Chaaya), Prophet of Juda in the 8th century. With respect to St. Daniel, the Hebrew prophet (604-534 BC), we can count about four Christian worship sites. For St. Elisée (Mar Elichaa), whom we find in the first ten chapters of the second book of the Old Testament, we can count about five Christian worship sites, the most important of which is the old convent in the Holy Valley, Wadi Qadisha. As for St. Abraham (Mar Ibrahim), 21st patriarch in the Biblical chronology, we can count only two Christian worship sites in his honor. Of all of these worship sites, only St. Elisée in the Qadisha valley can be classified among the shared worship sites. An asphalt road allows access to the St. Elisée convent at the bottom of the valley, and this convent is situated at the beginning of a walking path that leads to the Our Lady of Quannoubine monastery. This valley attracts many pilgrims from many different religions; thus, different types of contemporary votive rites have been developed in the monastery.
The worship of Biblical prophets among Muslims is more important than among Christians, with numerous worship sites dedicated to such prophets. These devotions can often be confusing, as links established
1 GOUDARD J. (R.P.)., La sainte Vierge au Liban, (The Holy Virgin in Lebanon) Beirut, 3rd edition reprinted by JALABERT H. (R.P)., Dar El Mach-req, 1993, p. 25.
between prophets are not always justified.
A dozen Muslim worship sites devoted to Nabi Ayla* or Nabi Yassine can be counted in Lebanon. Nabi Nouh* - Noah (Mar Nouh) for Christians - is the Biblical patriarch whom God saved from the flood. Prophet Noah’s sanctuary and mausoleum in Karak, is particularly interesting. In this village and its surroundings, there are a number of legends and popular beliefs linked to the flood. A maqâm built on antique remains shelters a tomb of more than 25 meters said to contain the body of Noah or of one of his sons’. The faithful of all religions come here to pray to him.
Moses (Nabi Moussa*) is a Biblical prophet venerated in Lebanon. To monotheistic religions, he is at the same time, author and principle character of the Bible. He is mentioned in Judaism, Christianity and Islam. It was he who, with the help of divine dictation, wrote the five first books of the Old Testament (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy). As both Prophet and guide, he led the Children of Israel out of Egypt, where they had been reduced to slavery. He received from God the Ten Commandments as well as a plethora of religious, social and food laws. He is the central character in the birth and formulation of the Jewish religion. The son of Iimrân, he is the most cited prophet in the Koran - by the name Moussa - as both a prophet and Allah’s messenger. Sura 3 of the Koran is called Imrân’s Family.
We can count several worship sites dedicated to him in Lebanon. A little maqâm is devoted to him in Qmatiye. Kheir Eldeen mentions several other maqâms in his name in the Bekaa plain, such as the ones in Maraaboun, Hermel, Qasr, Mansoura, Al Houayek, and at the Syrian-Lebanese border where believers light and burn candles. In his guide Known and Unknown Lebanon, Skeels speak of Nabi Moussa’s tomb in the village of Qarhaiya in the Nahr El Bared region, where they refer to the Valley of Nahr Abou Moussa2: “En Nabi Moussa’s tomb stayed intact for centuries - a mound surrounded by sharpened stones near the centre of the village, under a grove of hundred year-old oak trees - but it was recently renovated and the old stones were replaced by a monolithic block of cement.”3 No worship takes place on this site, and so this tomb is not the object of pilgrimages. In the heights of Keserouan stands “Jabal Moussa,” a mountain where a now-abandoned little village had been built. In popular tales, Moses passed through here before finding the Promised Land. In Qadas, in South Lebanon, devotion exists around a well that Moses would have passed. The well’s water attracts believers from different religions. A maqâm is dedicated to him in the village of Al-Safina, five kilometres from Kfayr in the Rashaya caza*, which is rich with the remains of paganism.
Job, the Old Testament patriarch, is of course the hero of the Book of Job. His Arabic equivalent is Ayoub (‘ayyûb), while the Turkish variation is Eyüp. The Druze maqâm of Niha, perched high at 1400 meters above sea level, is a mecca for shared pilgrimage. Jonah is one of the main Hebrew prophets in the Old Testament. The Arabic equivalent is Yunus (yûnus), or in dialect Younès. In a Chouf
2 SKEELS F.; SKEELS L., Le Liban connu et méconnu, (Known and Unknown Lebanon) Beirut, Garnet Publishing, 2001, p. 279-281.3 Ibid. p. 281.
ARTICLE66
2
Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre” Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
sourate du Coran lui est dédiée. À Jiyeh, un maqâm portant son nom est situé à quelques mètres de la mer, au milieu d’un quartier résidentiel musulman, à proximité d’une école. Des pierres de construction antiques et des chapiteaux byzantins témoignent de l’histoire du site. Une petite chambre aux parois recouvertes d’ex-voto, annexe à la salle principale, y abrite une tombe. A l’entrée du maqâm se trouve un puits dont l’eau, aujourd’hui tarie, était réputée pour être bénite et miraculeuse.
Nabi Yousha‘ (Josué fils de Moïse ou Josué fils de Noun, successeur de Moïse) est vénéré à Minieh, au pied de la montagne de Terbol. Une mosquée-mausolée cache une grotte où repose une tombe de 12 pieds de long, visitée par des fidèles de toutes les religions monothéistes. Josué n’est pas mentionné dans le Coran mais la tradition en fait le successeur de Moïse et un prophète. Les exégètes le décrivent comme le compagnon de Moïse. Plusieurs lieux de culte lui sont dédiés. Dans la plaine de la Békaa, à Rasem Al Hadeth, un maqâm a été érigé pour honorer Nabi Moussa Yousha‘ Bin Noun, qui a pris la relève après la mort de Moïse en menant le peuple d’Israël. Il semblerait qu’il se soit installé au pays des cananéens1. Kheir Eldeen mentionne aussi un maqâm dans la région de Beni Mounir, à côté de la ville de Nadrouma. Chrétiens, musulmans et juifs lui font des vœux en accédant à pied au lieu de culte.
A Nabi Micha‘, dans la montagne à côté de Jezzine des croyants de divers religions révèrent Mishah, compagnon de Daniel dans la fournaise babylonienne.
Le Prophète Shit (Seth) est le benjamin et successeur d’Adam. Selon une tradition populaire, il fut enterré à la sortie du village de Sar’in, dans la plaine de la Békaa, à proximité de Baalbek, où une grande agglomération devait naître portant son nom. Un maqâm y accueille de nombreux pèlerins. Le mausolée est un lieu de pèlerinage pour les croyants des différentes communautés qui viennent prier et célébrer des fêtes religieuses.
Dans la catégorie des saints « revendiqués » par les deux communautés, c’est saint Georges*/Al Khodr* qui détient, après la Sainte Vierge/Saydeh Marayam, le plus important nombre de lieux de culte au Liban, avec environ 350 lieux chrétiens (églises, cathédrales, couvents, écoles, chapelles, grottes, etc.) et une vingtaine de sites musulmans. C’est l’un des saints les plus présents dans différentes régions et villages du Liban et il est très populaire aussi bien auprès des musulmans que des chrétiens2. De nombreux lieux de culte, chrétiens comme musulmans, portent les deux noms, chrétien et musulman, comme Mar Jiryes* Al Khodr* Batiyeh à Sarba ou Mar Jiryes Al Khodr de Baalbek, etc. Sicking s’attarde longuement sur la figure de saint Georges*, vénérée par les musulmans sous le nom de Khodr, qui fait l’objet de nombreuses pratiques populaires3. Victor Sauma a recensé 276 églises, 27 couvents,
1 KHEIR ELDEEN H., “Al Mazarat oual makamat al islamiah fi al Bikaa” (Les mazars et les maqâms islamiques dans la Békaa), Thèse de doctorat de 3ème cycle en archéologie et histoire de l’art (faculté de lettres), Université Saint-Esprit de Kaslik, 2004, p.143-147.2 KHEIR ELDEEN H., 2004, op.cit, p.83-84.3 SICKING T. (R.P.), « Le culte des saints comme forme de théologie populaire», Actes du 3e symposium interdisciplinaire, Institut St Paul de philo-sophie et de théologie, Editions St Paul, Beyrouth, Harissa, 26-28 Mars 1992, p.159.
26 écoles, 2 hôpitaux, 2 mosquées, 1 localité et une grotte4 portant son nom. C’est un patron et un guérisseur auquel on fait appel en cas de difficultés. Il peut être considéré comme un saint « généraliste » et peut aussi avoir dans certains lieux une spécialité. À Safra, dans le Keserouan, une ancienne église lui est dédiée sous le vocable de Mar Jirjis al Mouzare‘ (saint Georges* le cultivateur), protecteur des cultures. A Tabarja, comme à Qlay’a au sud du pays il est le patron des marins. A ce titre, des festivités en mer et sur terre sont organisées et de la « Hrissé* » est distribuée devant l’église le jour de sa fête, après la bénédiction du prêtre. On dénombre à travers le pays une vingtaine de lieux de cultes musulmans dédiés à Al Khodr*.
Dans un quartier à l’Est de Beyrouth, l’ancienne chapelle de saint Georges* convertie en mosquée Al Khodr* de la Quarantaine, est un lieu de pèlerinage important. À Sarepta, Sarafand, au sud de Saïda, un lieu de culte porte le nom de Wali Nabi Khodr Al Hay. Dans le casa de Marjayoun, dans la région de Houlé, près de Deir Mimas, Mazar El Khodr est un sanctuaire dans une grotte5. Dans le Metn, à Deir El Harf, l’église et le couvent grec-orthodoxes de saint Georges* cohabitent avec un oratoire dédié à Khodr.6 Dans la plaine de la Bekaa, une dizaine de lieux de culte sont consacrés à Khodr comme à Baalbek, dans le village appelé Nabi Khodr* ou encore à Fakheh. Le maqâm* Al Khodr* situé à 3 km du village de Majdloun et isolé au milieu d’un champ agricole est surtout connu des bergers.
Parmi la vingtaine de lieux de culte chrétiens affectés à saint Pierre (Mar Boutros), Sham’oun, Sem’an , l’apôtre martyr; un peut être considéré comme un sanctuaire partagé. Il s’agit de la chapelle rupestre de ‘Akoura. Quelques lieux de culte musulmans lui sont aussi dédiés comme le Mazar* de Sam’oun El Safa dans le village de Sham’a. Mais ils ne peuvent être considérés comme des lieux de culte partagés.
Pour les saints exclusivement chrétiens ou musulmans, il y a bien évidemment tous les lieux de culte voués aux saints libanais nationaux : saint Charbel, St Hardini ou Ste Rafqa (moines/moniales de l’Ordre Libanais Maronite, Mar Charbel*, Mar Hardini, El Qeddisseh Rafqa). Le couvent de saint Maron à ‘Annaya où vécut saint Charbel, le monastère de SS Cyprien et Justine à Kfifane où l’on observe une dévotion spéciale à saint Hardini, le couvent de saint Joseph à Jrebta où est vénérée sainte Rafqa, attirent un flux important de pèlerins des communautés chrétiennes et musulmanes ainsi que des pèlerins venus de partout à travers le monde.
Les lieux de culte partagés affectés aux saints thaumaturges sont répandus à travers tout le Liban. Ce type de dévotion envers un saint aux vertus thérapeutiques et miraculeuses est perceptible surtout quand des éléments naturels sont en jeu. Les saints semblent favoriser ces rituels partagés et servir de catalyseur pour leur développement. C’est l’eau, symbole sacré, qui sert le plus souvent ainsi que les grottes. L’eau miraculeuse du puits de saint Lumière, Mar Nohra, à Smar Jbeil, celle de la grotte de saint Georges à Sarba ou du maqâm Nabi Najjoum, la source à proximité du Maqâm de Nabi Sulayman, à Younine, Nabi Za’ouar, Z’our Ouzair à Anjar et l’eau du maqâm de Nabi Yousha‘, en constituent quelques exemples. 4 SAUMA V., « Des saints héroïques vénérés au Liban », Proche Orient Chrétien, Tome XLI, Fasc III-IV, 1991, Jérusalem, p.258-2885 « Il s’agit de ruines d’une construction ancienne devant laquelle on fait des vœux et où les habitants trouvent souvent des morceaux de mosaïque et de poterie ancienne » (Sauma, 1991, p. 263).6 SAUMA V., 1994, op.cit, tome 1, p.418-419.
Nour Farra-Haddad Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre”
Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
663
village that bears his name, his tomb is sheltered in a local mosque. It is strongly believed that the prophet was rejected by a whale. The tenth sura of the Koran focuses on him. In Jiyeh, a maqâm bearing his name is situated a few meters from the sea, near a school in the middle of a Muslim residential neighborhood. Antique masonry and Byzantine symbols and inscriptions testify to the site’s history. A little room annexing the main room, with walls covered in ex-votos, houses his tomb. At the entrance of the maqâm, a well can be found in which the water, dried up today, was known for being blessed and for bestowing miracles.
Nabi Youshaa* (or Joshua, son of Moses or Joshua, son of Noun, Moses’ successor) is venerated in Minyeh at the foot of Terbol mountain. A mosque-mausoleum conceals a cave where a 12-foot long tomb is visited by believers of all of the monotheistic religions. Joshua is not mentioned in the Koran, but over time tradition has made him Moses’ successor and a prophet. Exegetes have described him as Moses’ companion, as well. Several sites of worship are dedicated to him. In the Bekaa plain in Rasem Al Hadeth, a maqâm devoted to Nabi Moussa Yousha‘ Bin Noun, who took over leading the people of Israel following Moses’ death, has been built outside of the village. It is said that they settled in the land of the Canaanites.1 Kheir Eldeen also mentions a maqâm that is dedicated to him in the Beni Mounir region, beside the city of Nadrouma. Christians, Muslims and Jews make wishes to him after reaching the worship site on foot.
In Nabi Micha’, in the mountain beside Jezzine, believers of diverse religions worship Mishah, Daniel’s companion during the Babylonian blaze.
The prophet Shit* (Seth) is Adam’s youngest child and successor. According to a popular legend, he was buried at the exit of the village of Sariin in the Bekaa plain near Baalbeck, where a large town was to be built bearing his name. A maqâm there welcomes many pilgrims. The mausoleum is a pilgrimage site for believers from different communities who come to pray and celebrate in the religious festivities.
In the category of saints “claimed” by both communities, it is St. George’s name, after that of the Holy Virgin, which is associated with the most number of important sites of worship in Lebanon, with approximately 350 Christian sites (churches, cathedrals, convents, schools, chapels, grottos, and so forth) and about twenty Muslim sites. He is one of the most ubiquitous saints in the different regions and villages of Lebanon and is as popular among Muslims as he is among Christians.2
A number of Christian and Muslim sites of worship bear two names, such as Mar Jiryes Al Khodr of Batiyeh in Sarba or Mar Jiryes Al Khodr of Baalbek, and so on. Sicking dwells at length on the figure of St. George, known to Muslims by the name of Khodr*, who is the object of a number
1 KHEIR ELDEEN H., “Al Mazarat oual makamat al islamiah fi al Bi-kaa” (Les mazars et les maqâms islamiques dans la Békaa), (Islamic mazars and maqams in Bekka) Thèse de doctorat de 3ème cycle en archéologie et histoire de l’art (faculté de lettres), Doctoral thesis in archeology and art history (Arts faculty) Université Saint-Esprit de Kaslik, 2004, p.143-147.2 KHEIR ELDEEN H., 2004, op.cit, p.83-84.
of practices in popular religion.3 Victor Sauma found 276 churches, 27 convents, 26 schools, 2 hospitals, 2 mosques, 1 town and 1 grotto4 named after him. He is a patron and a healer to whom one appeals in times of hardship. He can be considered a “generalist” saint, though he also is associated with a particular skill, talent, or duty in some places. In Safra in the Keserwan, an ancient church is dedicated to him under the title Mar Jirjis al Mouzare‘(St. George the farmer), protector of crops. In Tabarja as well as Qlayaa in the south of the country, he is considered the patron saint of sailors and, as such, festivities at sea and on land are organized in his honor, with Hrissé* handed out on the day of his celebration following the priests’ blessing. Throughout the country, about twenty Muslim worship sites have been noted as being dedicated to Al Khodr.
An ancient chapel dedicated to St. George and reconverted to Islam, the Al Khodr mosque in the Quarantaine, a neighborhood in East Beirut, is an important site of pilgrimage. In Sarepta (Sarafand) in the South of Saïda, a worshipping site bears the name “Wali Nabi Khodr Al Hay.” In the case of Marjayoun in the Houlé region near Deir Mimas, we find a “Mazar El Khodr,” which is a sanctuary in a grotto.5 In Metn, at Deir El Harf, the Greek Orthodox Church and convent bearing St. George’s name share space with an oratory devoted to Khodr.6 In the Bekaa plain, ten worshipping sites are dedicated to Khodr, including in a village in Baalbek called Nabi Khodr as well as in Fahkeh. The Al Khodr maqâm, situated three kilometers from the village of Majdloun and isolated in the middle of an agricultural field, is mostly known to shepherds.
About twenty Christian worship sites are dedicated to St. Peter (Mar Boutros), or Shamooun, Semaan, the martyr apostle, and only one of these sites can be considered a shared sanctuary: the rock chapel of Aakoura. In addition, a few Muslim worship sites are dedicated to him, such as the Mazar of Samooun El Safa in the village of Shamaa. But these sites cannot be considered shared worship sites.
For those saints considered exclusively Christian or Muslim, there are, of course, all of the sites of worship dedicated to the national Lebanese saints, including: St. Charbel, St. Hardini, and St. Rafqa (monks/secluded nuns from the Lebanese Maronite Order, Mar Charbel, Mar Hardini, El Qeddisseh Rafqa). The pilgrimage meccas that are dedicated to them are the most visited in Lebanon: the convent of St. Maron in Aannaya where St. Charbel lived; the Saints Cyprien and Justine monastery in Kfifane, where a special devotion to St. Hardini can be observed; and the St. Joseph convent in Jrebta, where St. Rafqa is venerated. All of these attract a large number of pilgrims from Christian and Muslim communities, as well as pilgrims from all over the world.
3 SICKING T. (R.P.), « Le culte des saints comme forme de théologie populaire», (The worship of saints as a form of popular theology) Acts from the 3rd interdisciplinary symposium, St Paul Institute of philosophy and theology, St Paul editions, Beirut, Harissa, March 26-28 1992, p 159. 4 SAUMA V., « Des saints héroïques vénérés au Liban »,(Heroic saints venerated in Lebanon) Christian Near East, Tome XLI, Fasc III-IV, 1991, Jeru-salem, p.258-2885 « Il s’agit de ruines d’une construction ancienne devant laquelle on fait des vœux et où les habitants trouvent souvent des morceaux de mosaïque et de poterie ancienne » (We are speaking of the ruins of an ancient construction in front of which wishes are made and where inhabitants often find pieces of ancient mosaic and pottery) (Sauma, 1991, p. 263).6 SAUMA V., 1994, op.cit, tome 1, p.418-419.
ARTICLE66
4
Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre” Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
Les pratiques dévotionnelles partagéesB- Chaque sanctuaire propose aux fidèles une série d’initiatives « priantes », de rites qui, selon leur efficacité potentielle, vont être classés par les pèlerins par ordre d’importance. Plusieurs démarches peuvent s’imbriquer, s’enchaîner et s’agencer pour former une seule démarche votive ou la trame d’un même pèlerinage. Souvent, un rite principal est entouré d’autres pratiques rituelles qui se cristallisent afin de créer une ambiance propice à la réalisation du vœu. Les démarches rituelles intègrent souvent de nombreux sous-types qui seront décrits dans ce propos.1
Dans la grotte rupestre du maqâm de Nabi Yousha’* (le prophète Josué) à Minieh, au nord de Tripoli, les fidèles tournent autour du Darih* trois ou sept fois en priant et procèdent à des ablutions avec l’eau qui suinte des parois de la grotte. En marge de ces pratiques, les pèlerins prélèvent de la terre sacrée de la grotte pour la « baraka* », déposent des morceaux de tissus sur la tombe, brûlent de l’encens et allument des cierges. À Mar Jiryes* (saint Georges*) à Sarba, les ablutions avec l’eau de la grotte sacrée constituent le rite principal. Les pèlerins allument également des cierges, s’agenouillent, brûlent de l’encens, ramènent de l’eau chez eux pour en boire ou continuer les ablutions selon un rythme bien précis. À Saydet Hammatoura (Notre Dame de Hammatoura) le rite principal veut que la femme tourne autour de la stalagmite de la grotte sacrée puis y enroule ses habits. À Mar Jiryes, à ‘Amshit, il s’agit de se frotter le ventre avec la pierre sacrée ; à Mar Sassine (saint à Beit Mery)le rite veut que la femme passe trois fois sous la racine du chêne, sur la place de l’église. Prier, brûler un cierge ou de l’encens, s’agenouiller sont des rituels souvent parallèles au rite principal. L’ambiance que les pèlerins essaient de créer vise les sens de l’être humain comme le toucher, l’odorat, l’ouïe, la vue.
Des lieux de culte offrent aussi aux pèlerins différents rituels de même importance, comme à Mar Elias* (saint Elie*) à ‘Ain Sa‘adé, où la femme a le choix entre avaler un morceau de pain imbibé d’huile ou porter une ceinture de coton, à Mar Antonios* (saint Antoine*) à Hadeth où la femme peut accrocher une pierre aux oliviers, porter la ceinture de coton, avaler un coton imbibé d’huile ou se frotter le ventre avec une pierre sacrée. Au moment même de la formulation du vœu, les pèlerins adoptent un ou plusieurs rituels selon le lieu de culte, exigeant souvent la « mise en jeu du corps » qui va, comme l’esprit, se mobiliser pour le saint ou la sainte. Les démarches votives sont avant tout des démarches personnelles mais il arrive souvent que d’autres personnes interviennent (mère, sœurs, voisines, amis, etc.) significativement dans le processus des pèlerins en leur suggérant d’avoir recours aux vœux, en les orientant vers tel rite, en les initiant à tel autre, en les accompagnant, en priant avec eux, etc. Ces rites visent à établir, maintenir et sceller la communication entre les hommes et les saints et le fidèle va profiter de tous les moyens mis à sa disposition pour maximiser ses chances réussite.2
La première pratique rituelle n’est autre que la marche vers le lieu de culte, constituée par différents éléments : la distance parcourue à pied, le niveau de difficulté du circuit (sentier, route, escalier, etc.) et les
1 La typologie proposée se base sur l’acte du « vouant » et non sur les objets et les éléments qu’il va utiliser éventuellement2 FARRA N., Pèlerinages votifs partages entre chrétiens et musulmans au Liban: Démarches rituelles et sphères d’interaction, Thèse de doctorat de 3ème cycle en anthropologie religieuse, Université Libanaise, 2003.
modalités de déplacement : pieds nus, à genoux, en chaise roulante, sur béquille, etc. Au Liban, la majorité des pèlerins accèdent aux lieux de culte en voiture ou en bus mais à proximité du site, un circuit à pied peut être adopté. Au monastère de saint Maron* à Annaya (sanctuaire de saint Charbel*), les pèlerins marchent vers l’ermitage de saints Pierre et Paul (où le saint a vécu en ermite) ou inversement. À Ammiq, les « vouants » marchent vers la grotte sacrée à partir du maqâm de Sitt Sha‘wana. La distance parcourue est variable et peut se compter en kilomètres, à l’exemple des pèlerins qui, au mois de mai, marchent vers le sanctuaire de Notre Dame du Liban, Harissa à partir de Jounieh.
Les prières accompagnant la formulation du vœu sont très variées. La grande majorité des saints chrétiens ou musulmans ont des prières spéciales (des salat* ou des ziyârat*) qui leur sont attribuées. Les fidèles récitent donc ces prières avant la formulation du vœu. Ils récitent aussi des prières particulières pour des personnes malades. De nombreux pèlerins ajoutent à leur propre prière votive, les prières destinées au saint et proposées sur place. Certains chrétiens récitent longuement des « Notre Père », des « Je vous salue Marie », des rosaires, des chapelets, des neuvaines, des prières spéciales, etc. D’autres pèlerins intensifient leur demande en invoquant d’autres saints que celui du lieu visité, comme la Vierge Marie, saint Charbel, sainte Rafqa et d’autres.
Les offrandes ou les ex-voto sont offerts au moment de la formulation du vœu ou en remerciement pour sa réalisation. De nombreuses typologies ont été proposées pour décrire les offrandes. Mis à part les donations financières, les offrandes peuvent avoir un lien direct avec la situation ayant provoqué l’intervention ou la protection divine (un stylo utilisé pour un examen, une plaquette d’argent symbolique – croissant, main, pied, etc.-, un pansement, etc.). Ces dons peuvent être des objets réalisés par le « vouant » ou sur sa commande personnelle, spécialement pour l’embellissement des lieux (tableaux, lustres, icônes, tapis, etc.). L’ex-voto peut aussi être la construction même d’un lieu de culte, d’une chapelle, d’un mazar, etc. Ces offrandes peuvent servir à l’entretien des lieux (cierges, huile, savon, détergent, balai, etc.), ou être des objets personnels de valeur (collier, chaîne en or, etc.). Des objets pieux peuvent être donnés en ex-voto (chapelets, évangiles, corans, icônes, statuettes de saints, etc.). D’autres offrandes servent de témoignage sous la forme de plaquettes commémoratives en marbre.
Dans des milliers de pèlerinages à travers le monde et depuis des millénaires, les rituels de l’eau occupent une place très importante. L’eau guérit, rajeunit, assure la vie, purifie et régénère parce qu’elle dissout et abolit ce qui est impur. Par les ablutions on semble s’approprier les propriétés diverses des eaux (purificatrice, curative, fécondante, etc.)3
Le rite de la circumambulation (taouaf, toufan, tatouaf), caractéristique de certains pèlerinages votifs, consiste à tourner un certain nombre de fois (en général une, trois ou sept fois) autour d’un lieu de culte, d’une tombe, d’un darih, d’une stalagmite ou d’un arbre. On peut relever de multiples exemples de cette circumambulation, chez les chrétiens comme chez les musulmans. A Mar Bandilèymoun à Bijdarfil, le rite suivi par les femmesstériles, consiste à tourner trois fois autour de l’église avec une femme encore célibataire et vierge et une autre
3 CHEVALIER J. ; GHEERBRANT A., Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont, 1982, p.3.
Nour Farra-Haddad Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre”
Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
665
The shared worship sites dedicated to thaumaturge saints are spread throughout Lebanon. This type of devotion towards saints with therapeutic and miraculous virtues is especially perceptible when natural elements are at stake. The saints seem to be in favor of and serve as catalysts for the development of shared rituals. It is water, that most sacred of symbols, which most often serves a purpose in shared votive rituals, as well as the grottos. Some examples include: the miraculous water of the wells of St. Light (Mar Nohra) in Smar Jbeil; the miraculous water of the grotto of St. George in Sarba; the miraculous water of the maqâm of Nabi Najjoum; the water from the source near the maqâm of Sulayman in Younine, Nabi Zaaouar, Zoour Ouzair in Anjar; and that of the maqâm of Nabi Youshaa.
Shared devotional practicesB-
Each sanctuary proposes a series of praying initiatives to the faithful, rites which, depending on their potential effectiveness, will be classified in their order of importance by pilgrims. Several approaches may overlap, follow, and be organized to make up a single votive approach or the framework for the same pilgrimage. Often, a main rite will be surrounded by other ritual practices which crystallize in order to create an ambiance favorable to the fulfillment of the wish. Ritual approaches that also demonstrate numerous sub-types will be described.1
In the rocky grotto of the maqâm of Nabi Yousha (the prophet Joshua) in Minyeh, North of Tripoli, the faithful turn around the Darih* three or seven times while praying and proceeding to ablutions with water that seeps out of the grotto’s walls. In addition to these practices, pilgrims gather sacred soil from the grotto for “baraka*,” lay pieces of fabric on the tomb, burn incense and light candles. In Mar Jiryes (St. George) in Sarba, ablutions with sacred water from the grotto make up the main rite; in addition to this practice, pilgrims light candles, kneel, burn incense and bring water back home either to drink or to continue with ablutions according to a precise rhythm. In Saydet Hamatoura (Our Lady of Hamatoura), the main rite asks that a woman turn around the sacred grotto’s stalagmite and then wrap her clothes around it. In Mar Jiryes in Aamshit, it is a case of rubbing one’s stomach with a sacred stone; in Mar Sassine (St. Sisinus in Beit Mery), the rite asks that a woman pass three times under the oak’s roots in the church square, and so on. Praying, burning a candle, kneeling… these are often the rituals parallel to the main rite. The ambiance that these pilgrims are trying to create aims for the human senses, such as touch, smell, hearing, sight.
The worship sites also offer pilgrims different rituals of the same importance, as in Mar Elias (St. Elie) in ‘Ain Sa‘adé, where a woman has a choice between swallowing a piece of bread soaked in oil or wearing a cotton belt; in Mar Antonios (St. Anthony) in Hadeth, where a woman can choose between hanging a stone on the olive trees, wearing a cotton belt, swallowing a piece of cotton soaked in oil, rubbing her stomach with a sacred stone, and so forth. At the very moment of wish-making, pilgrims adopt one or several rituals according to the worship site, often demanding the “bringing into play of the body,” which will, like the spirit, mobilize itself for the saint. Votive approaches are first
1 The typology proposed is based on the “devotee’s” action and not on the objects or elements that he or she will eventually use.
and foremost personal steps taken by pilgrims expressing their wishes, but it often happens that other people (mother, sister, neighbor, friend, etc.) intervene in the process in a significant way by suggesting resorting to wishes, directing them towards such a rite, initiating them to another, accompanying them, praying with them, and so on. These rites aim to establish, maintain and seal communication between people and saints, and the faithful will take advantage of any means available to them in order to maximize their chances of success for their wish.2
The first ritual practice is simply the walk towards the worship site, which is made up of different elements: the distance walked, the level of difficulty of the circuit, (path, route, stairs, etc.) and the means of movement: bare feet, on knees, in a wheelchair, on crutches, and so on. In Lebanon, the majority of pilgrims reach worship sites by car or by bus, but once near the worship site, an on-foot circuit may be adopted. At the St. Maron monastery in Aannaya (St. Charbel sanctuary), pilgrims walk towards the Saints Peter and Paul hermitages (where the saints lived as hermits) or vice versa. In Aammiq, devotees walk towards the sacred grotto by starting from the Sitt Shaawana maqâm. The distance taken varies and can be counted in kilometers, such as the example of pilgrims who walk towards the Our Lady of Lebanon, Harissa in the month of May, starting from Jounieh. The prayers accompanying the uttering of the vow vary greatly. The great majority of Christian or Muslim saints have special prayers (salat* or ziyârat*) attributed to them. The faithful thus recite these prayers before formulating their personal wish. They also recite special prayers for sick people. Numerous pilgrims add their own votive prayers to prayers dedicated to the saint proposed on site. Some Christians will recite “Our Father” or “Hail Mary” for a long time, as well as rosaries, novenas, special prayers, and more. Other pilgrims intensify their requests by invoking saints other than the patron saint of the visited worship site, such as the Virgin Mary, St. Charbel, St. Rafqa and others.
Offerings or “ex-votos” are offered at the moment of the wish-making. Apart from financial donations, offerings can take other forms that have a direct link with the situation - an object, perhaps, that has provoked divine intervention or protection (i.e., a pen used for an exam, a silver faceplate, a crescent, a hand, a foot, a bandage, etc). These can be objects made by the devotee or by someone else at the devotee’s personal request, especially for the maintenance and/or beautification of the place (candles, oil, soap, detergent, broom, etc.)
In thousands of pilgrimages across the world going back millennia, water rituals have had a very important place. Water heals, rejuvenates youth, ensures life, purifies and regenerates because it dissolves and eliminates impurities. With ablutions one seems to assimilate oneself into the diverse properties of water (purification, healing, insemination, etc.).3
2 FARRA N., Pèlerinages votifs partagés entre chrétiens et musulmans au Liban: Démarches rituelles et sphères d’interaction (Votive pilgrimages between Christians and Muslims in Lebanon : Ritual actions and spheres of in-teraction), Doctoral thesis of the 3rd cycle in religious anthropology, Lebanese University, 2003.3 CHEVALIER J. ; GHEERBRANT A., Dictionnaire des symboles, (Dictionary of symbols), Robert Laffont, 1982, p.3.
ARTICLE66
6
Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre” Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
femme qui a eu plusieurs enfants. Dans la majorité des lieux de culte musulmans visités au Liban, les pèlerins processionnent presque systématiquement autour de la tombe du saint ou de la sainte, du « darîh », une, trois ou sept fois en récitant des prières dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Ils reproduisent ainsi le « tawâf » mecquois.
Le rite de l’incubation ou « laylat El Istikhara », pratique très courante, consiste à dormir, parfois pour plusieurs nuits et dans des conditions très précaires, sur le parvis même du lieu de culte, devant la porte du sanctuaire, dans l’enceinte sacrée, etc. pour s’imprégner de la « baraka », de la bénédiction du saint. Des témoignages de ce rite existent pratiquement partout. Jusque dans les années cinquante, ce ne sont pas uniquement des fidèles qui dormaient dans les lieux de culte mais aussi le bétail malade. Allumer un ou des cierges et brûler de l’encens (bakhour) sont des pratiques communes aux chrétiens et aux musulmans mais répandre du parfum (‘itr) est une pratique beaucoup plus courante chez les musulmans.
Le dépôt d’objet sur de nombreux lieux de culte témoigne du besoin de prolonger la présence du pèlerin auprès du saint, pour s’assurer que ce dernier n’oublie pas sa requête et lui vienne en aide. La modalité du dépôt de ces objets varie selon les lieux de culte et les pèlerins : des fragments de vêtements ou de tissu attachés à un arbre sacré (le figuier de la Saydeh à Afka) ou flottant dans les eaux sacrées d’une grotte (la grotte de Mar Jiryes*, Sarba), des pierres dans des sacs en nylon accrochés aux arbres (les oliviers de l’église Mar Antonios*, Hadath) à la paroi d’une grotte (l’ermitage rupestre de Mar Antonios*, Sakiet El Kheit) ou à la grille d’une tombe ou d’un Darih (la grille de la tombe de St Charbel à Annaya, la grille du Darih du Nabi Ayoub* ou du Nabi Moussa*, Komatieh).
Souvent, les pèlerins tentent de coller une ou des pièces de monnaie sur les parois d’un sanctuaire, les murs d’une église ou sur des icônes. Le pèlerin se concentre et formule son vœu en appuyant fort la pièce sur la surface visée. Si la pièce se colle, c’est un signe de bon augure. Ainsi, des « vouants » visitent régulièrement l’église de la Saydet à Achrafieh où ils tentent de coller des pièces sur la vitre de l’icône miraculeuse de la Vierge.
L’absorption d’un « remède » peut prendre différentes formes : avaler un coton ou un morceau de pain de communion imbibés d’huile bénite, avaler de la terre du lieu de culte directement ou dissoute dans l’eau, boire de l’eau où une pierre « sacrée », une image de saint ont été trempées, faire bouillir de l’eau bénite avec de la terre du lieu de culte ou des feuilles d’arbre récupérées sur place.
Dans de nombreux lieux de culte au Liban, chrétiens et musulmans (Saydet Beschouat, Mar Jiryes* à ‘Amshit, Mar Boutros à Akoura, Mar Antonios* à Qoshaya, Mar Doumit, maqâm Nabi Nouh* à Karak, maqâm Nabi Youssef à Haytlé ‘Akkar’ etc.), on remarque la présence de pierres sacrées, appelées par certains « Mahdaleh » ou tout simplement « El Hajar » (la pierre), ayant des vertus thérapeutiques . Ainsi les « vouants » procèdent à des « ablutions sèches »1 c’est-à-dire des frottements corporels sur la ou les parties malades du corps avec une pierre sacrée ou un objet sacré.
1 DERMENGHEM E., Le culte des saints dans l’islam maghrébin, Pa-ris, Gallimard, 1954, p.122 ; p.141-142
L’onction avec de l’huile est une tradition millénaire. L’huile bénite est surtout distribuée dans des lieux de culte chrétiens mais il arrive aussi qu’on en retrouve dans des lieux de culte musulmans, souvent offerte par les fidèles eux-mêmes. Dans la majorité des cas, elle est présentée aux fidèles sur du coton dans de petits sachets ou de petits flacons.
Le port d’une ceinture en tissu est une pratique commune aux chrétiens et aux musulmans mais seuls les lieux de culte chrétiens (Mar Elias à ‘Ain Sa‘adé, Mar Charbel à ‘Annaya, Mar Antonios à Hadeth, etc.) proposent aux pèlerins des ceintures en coton préalablement bénies par des prêtres. Les musulmans se servent chez les chrétiens ou les fabriquent eux-mêmes, chez eux ou sur les lieux de culte, avec le sitar* (tissu vert recouvrant la tombe du saint) par exemple.
Le rite du port de l’habit du saint est, à priori, une tradition chrétienne. Rares sont les musulmans qui s’y prêtent. dans la mesure où ce rite impose au pèlerin d’afficher ses intentions votives et par conséquent, de s’exposer au regard « critique » de l’autre. Ce rituel concerne aussi bien les adultes que les enfants, les femmes que les hommes et des personnes de classes sociales très variées, originaires de différentes régions libanaises, rurales comme urbaines. Toutefois les hommes adultes et les « vouants » issus de classes économiques supérieures qui portent l’habit sont une minorité.
Le sacrifice est un rituel antique, attesté depuis très longtemps chez les chrétiens comme chez les musulmans. Dans tous les cas de sacrifices répertoriés, il s’agit d’un animal domestique et plus spécialement le mouton. Deux cas de figure sacrificiels ont été observés : le sacrifice à domicile ou dans l’entourage du domicile du pèlerin et le sacrifice sur le lieu de pèlerinage. La tradition veut que le sacrifice se fasse sur le parvis, à la porte du sanctuaire (‘ala el bab). Cependant dans la plupart des sanctuaires il n’est plus possible de respecter cette tradition.
Quasiment tous les pèlerins ramènent du lieu de culte quelque chose porteur de « baraka », de « grâces », de « sacralité » (terre, eau, morceau de tissu, feuilles d’arbres ou de plantes, morceaux d’écorce ou de racine…). Ils veulent entretenir et faire durer leur relation avec le saint. Les amulettes que les fidèles portent sur leurs habits, gardent dans leur maison, sur leur oreiller ou dans leur voiture ont le même objectif. Ces amulettes sont confectionnées par les « vouants » ou par des hommes de religion à partir d’éléments « sacrés » : des morceaux de tissus dans lesquels sont insérés une relique, un morceau de coton imbibé d’huile bénite, de la terre ou une feuille d’arbre du monastère, etc. Dans les milieux chrétiens, on appelle souvent ces amulettes « dkhireh » et dans les milieux musulmans, « hijab », « hjab». Ces amulettes peuvent être portées pour une période symbolique et limitée ou à vie.
Il faut aussi remarquer que, pour maximiser les chances de réalisation du vœu, de nombreux fidèles font appel à plusieurs saints à la fois, de différentes manières. Deux cas de figure se présentent. Dans le premier, les « vouants » se tournent vers deux saints et effectuent deux pélérinages différents pour une même demande. Dans le seconde, les fidèles procèdent à une seule visite qui implique plusieurs saints dans la même démarche. Au cours des pèlerinages, les « vouants » vont agencer toute une série de rites selon des recommandations ou une logique qui leur est propre (toucher, baisers, baisement, recueillement, prières…). C’est souvent le contact physique qui sert à s’investir de la puissance du
Nour Farra-Haddad Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre”
Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
667
The circumambulation rite (taouaf, toufan, tatouaf ), which is characteristic of certain places in the context of votive pilgrimages, consists of circling a certain number of times (generally one, three or seven times) around a worship site, a tomb, a darih, a stalagmite or a tree. Multiple examples of this circumambulation are noted among Christians as well as Muslims. In Mar Bandilèymoun in Bijdarfil, the rite followed by childless women consists of circling three times around the church accompanied by a still single and virginal woman and with another woman who has several children. At the majority of Muslim worship sites visited in Lebanon, pilgrims make an almost systematic procession around the saint’s tomb (the darîh), once, thrice or seven times counter-clockwise while reciting, thereby reenacting the meccan “tawâf.”
The incubation rite (“laylat El Istikhara”), a practice that still exists, consists of sleeping -sometimes for several nights and in very precarious conditions - in such places as the actual square of the worship site, in front of the sanctuary’s door, on the ground, in the sacred interior, and other unusual spots in order to soak up the “baraka” from the saint’s blessing. Accounts of this rite exist in practically all of the sites of worship we visited. Up until the 1950s, it was not only the faithful who slept at these sites, but also sick livestock. Lighting one or several candles and burning incense (bakhour) are other common practices among Christians and Muslims, though spreading perfume (iitr) is a practice much more typical of Muslims.
The deposits of objects on numerous worship sites testifies to the need to immortalize the pilgrim’s presence next to a saint, with the goal being to assure oneself that the latter will not forget the former’s request for help. The modality of the deposits of these objects varies according to the worship sites and the pilgrims. Hence, this practice is found in different forms: fragments of clothing or fabric tied to a sacred tree (Saydeh’s fig tree in Afka) or floating in the sacred waters of a grotto (Mar Jiryes’ grotto in Sarba); or stones placed in a plastic bag, which is then attached to trees (Mar Antonios church’s olive trees in Hadath) or the grotto’s wall (Sakiet El Kheit’s rocky hermitage), or tied to a tomb’s railing or to a Darih (the railing of St. Charbel’s tomb in Aannaya, the railing of a Darih in Nabi Ayoub or of Nabi Moussa in Qmatieh).
At numerous sites of worship, pilgrims try to glue one or more pieces of currency on the walls of the sanctuary or church, or on icons. The pilgrim concentrates and expresses his or her wish by pressing hard on the piece aimed at the surface. If the piece sticks, it is a good omen. Thus, “wishers” often visit Saydeh’s church in Achrafieh, or they try to glue the pieces on the glass of the miraculous icon of the Virgin.
The consumption of a “remedy” can take several different forms: swallowing a piece of cotton soaked in blessed oil, or a piece of communion bread soaked in blessed oil, or soil - either as is or dissolved in water - from the worship site, or a “sacred” stone that has been soaked, or an image of a saint which has been soaked, or drinking boiled water that has been blessed, along with eating soil or tree leaves from the worship site.
In numerous Christian or Muslim worship sites in Lebanon, (Saydet Beschouat, Mar Jiryes in Aamshit, Mar Boutros in Aakoura, Mar Antonios in Qoshaya, Mar Doumit, maqâm Nabi Nouh in Karak, maqâm Nabi
Youssef in Haytla, etc.), the existence of sacred stones is noted. These are called “Mahdaleh” by some or simply “El Hajar” (the stone), and are considered to have therapeutic virtues if rubbed on the injured part of the body. With this belief in mind, the devotees proceed to perform “dry ablutions”1 - that is, rubbing the body with a sacred stone or object.
Anointing one with oil is an age-old tradition. Blessed oil is mostly distributed at Christian worship sites, but it is sometimes found at Muslim worship sites, often offered by the faithful themselves. In the majority of cases, it is presented to the faithful on pieces of cotton in little sachets or little flasks.
Wearing a cloth belt is as common a practice for Christians as it is for Muslims, but it is only the Christian sites of worship (Mar Elias in Aain Saadé, Mar Charbel in Aannaya, Mar Antonios in Hadeth, etc.) that offer pilgrims cotton belts blessed beforehand by priests. Muslims either use the Christian ones or make their own at home or the worship site, using, for example, sitar* (green cloth covering a saint’s tomb).
The rite of wearing a saint’s clothing is a priori a Christian rite. It is rare that Muslims take part in it, fearing the “critical” gaze of “the other,” as this rite forces the pilgrim to openly display his votive intentions. This is a ritual that can involve adults as well as children, women as well as men and people of every social class, originating from different Lebanese regions, rural or urban. However, adult men and devotees coming from higher economic classes and who also wear the clothing are few.
Sacrifice is an ancient ritual that has been employed by Christians and Muslims for a very long time. All documented cases of sacrifice involve a domestic animal, most specially a sheep. Two cases of figures being sacrificed have been observed: sacrifice at home or in the surroundings of the pilgrim’s home; and sacrifice at the site of worship. Tradition requires that the sacrifice be done in the square or at the sanctuary’s door (aala el bab). However, in most of the sanctuaries it is no longer possible to respect this tradition.
Almost all pilgrims bring back something from the worship site with them, something having Baraka* or “sacredness” - from the site (soil, water, a piece of cloth, tree or plant leaves, pieces of bark or roots, etc.). They want to maintain their relationship with the saint and make it last. This also seems possible thanks to the fabrication of amulets that the faithful wear on their clothing, keep in their home, on their pillow or in their car. These amulets are created by devotees or by religious men with the aid of different “sacred” elements: pieces of cloth into which pieces of a relic are inserted; a piece of cotton soaked in blessed oil; soil from the monastery; a tree leaf from the monastery; and so forth. Among Christians, these amulets are often called “dkhireh” and among Muslims, “hijab” or “hjab.” These amulets can be worn for a symbolic and limited period or for life.
Also of note is that, to maximize the chances of a wish’s success, many of the faithful call upon several saints at the same time in different ways. Two figures of cases exist in regards to this fact. In the first,
1 DERMENGHEM E., Le culte des saints dans l’islam maghrébin (Saint worship in the Islam of the Mahgreb) Paris, Gallimard, 1954, p.122 ; p.141-142
ARTICLE66
8
Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre” Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
Au cours des pèlerinages, les « vouants » vont agencer toute une série de rites selon des recommandations ou une logique qui leur est propre (toucher, baisers, baisement, recueillement, prières…). C’est souvent le contact physique qui sert à s’investir de la puissance du saint. Les rituels déjà énumérés constituent des options de démarches que les « vouants » pourront imbriquer à leur guise ou selon les recommandations d’une référence (un parent, un voisin, un proche, un prêtre, etc.). D’autres petits gestes, pratiques et attitudes jouent aussi un rôle dans l’agencement final de la démarche.
Nombreux sont les fidèles qui font une ou des promesses au saint quand ils formulent leur vœu ou une fois celui-ci exaucé sentant le poids d’une « dette » qu’ils sont obligés d’acquitter pour remercier le saint. Ces promesses peuvent concerner la période qui précède la réalisation du vœu, pour maximaliser les chances de sa réussite. Dans tous les cas de figure, le « vouant » doit payer sa dette. On parle alors de « Fakk el neder » (délier le vœu).
Le déroulement des pèlerinages varie peu entre chrétiens et musulmans. La grande majorité des pratiques dévotionnelles mentionnées concerne des rituels pratiqués par des chrétiens comme par des musulmans et rares sont les démarches qui sont exclusivement chrétiennes ou musulmanes (le port de l’habit du saint chez les chrétiens ou l’offrande de sel chez les musulmans).
Etant donné la densité des lieux de culte au Liban ainsi que leur fréquentation par des fidèles de différentes communautés, se jouent autour des pèlerinages des enjeux qui dépassent le seul registre du religieux. En ces lieux de culte se vit une convivialité interconfessionnelle propice à la construction d’identités, locale et nationale, auxquels tant de libanais ont du mal à croire.
Le pèlerinage est un cheminement vers un lieu sacré qui aboutit à une « rencontre » avec le saint, vécue à travers une série de rituels et de pratiques dévotionnelles. Même si ce n’est pas l’objectif initial de la démarche, c’est aussi une « rencontre » avec « l’autre », pour le chrétien avec le musulman et pour le musulman avec le chrétien.
Ayha, Rachaya
Nour Farra-Haddad Ziyârât : visites de saints, pratiques dévotionnelles partagées et dialogue avec “l’autre”
Ziyârât: visits to saints, shared devotional practices and dialogue with “the other”
669
devotees proceed to votive pilgrimages at the same time and make the same request by turning to two different saints at the same time; in the second case, the faithful proceeds to a single visit, involving several saints in the same action.
During the course of these pilgrimages, devotees will organize a whole series of rites according to recommendations or their own logic (touching, ritual kissing of the tomb, or a sacred object…, contemplation, prayers, etc.). It is often physical contact that is used to invest power in the saint. The rituals listed above comprise the options that devotees can mix together as they please according to a referee’s recommendations (a parent, neighbor, a close friend, a priest, etc.) Other little gestures, practices and attitudes play a role in the final organization of the action.
It is also important to remember that there are many devotees who make one or more promises to the saint when saying their vows or once these are granted because they feel the weight of the debt they have to re-pay to thank the saint. These promises can be made during the period preceding the fulfillment of the vow in order to maximize the chances of its success. Whatever the case, the devotee must pay his or her debt; it is “Fakk El neder” (releasing the vow).
How pilgrimages are conducted varies slightly between Christians and Muslims. The large majority of devotional practices mentioned above involve rituals performed by both Christians and Muslims and rare are those that are exclusively the domain of either religion. Exceptions would be the wearing of the saint’s clothes by Christians or the offering of salt by Muslims.
Given the density of the number of worship sites in Lebanon as well as the volume of visits by the faithful of different communities, many pilgrimages go beyond that which can be classified as monolithically religious. At these worship sites, an intersectarian conviviality is experienced that is favorable to the construction of local and national identities, in which so many Lebanese have trouble investing themselves.
A pilgrimage is a path towards a sacred place that leads to an encounter with a saint, experienced through a series of rituals and devotional practices. Even if it is not the initial objective of the actions performed, it is still an encounter with “the other” - for the Christian with the Muslim, and for the Muslim with the Christian.