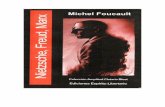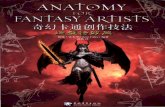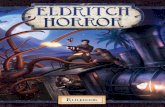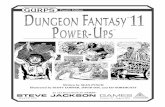Vérité et fantaisie chez Freud (Truth and fantasy in Freud)
Transcript of Vérité et fantaisie chez Freud (Truth and fantasy in Freud)
VERITE ET FANTAISIE CHEZ FREUD
MARCOS CHEDID ABEL
Publié sous le titre de Verdade e fantasia em Freud dans la revue Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica, vol. 14, nº. 1, Rio de Janeiro, Jan./June 2011. À partir d'essai présenté à Pr Sophie de Mijolla-Mellor, Centre d’Études Psychopathologie et Psychanalyse (CEPP), U.F.R Sciences Humaines et Clinique, Université Paris 7, au 25/06/2009. Révisé au 02/07/2009. Travail réalisé avec l’appui financier du Centre Universitaire de Brasília – UniCEUB. Docteur en Psychologie, Master en Psychologie Clinique, Psychologue. Professeur au Centre Universitaire de Brasília (UniCEUB). Psychologue clinicien au Centre d’Attention à la Santé Mentale Anankê. Adresse résidentiel : SQN 402, Bloco G, AP. 110. Brasília, DF. Brésil. 70834-070. Téléphone : (+5561) 8126-9886. E-mail: [email protected].
RÉSUMÉ
Cet essai a comme sujet les relations entre vérité et fantaisie dans la pensée de Sigmund Freud et ses implications dans les objectifs du travail psychanalytique. Il présente l'approche progressive qui s'opère entre vérité et fantaisie dans ses élaborations théoriques. Il démontre que la fantaisie, initialement considérée seulement comme obstacle à la vérité, passe à intégrer la vérité cherchée dans le traitement. Il argumente que la vérité historique dans la psychanalyse est composée par la vérité matérielle et la fantaisie de désir. Il conclut que Freud, en sa pratique, passe à viser, surtout, à la reconstruction ou à la construction avec analysant de son vérité historique, comme poète, que proprement découvrir la vérité matérielle, comme archéologue. Mots-clés: Freud. Psychanalyse. Vérité historique. Vérité matérielle. Fantaisie.
TRUTH AND FANTASY IN FREUD
ABSTRACT
This essay has as subject the relations between truth and fantasy in the thought of Sigmund Freud and its implications in the objectives of the psychoanalytical work. It presents the gradual approach that is operated between truth and fantasy in his theoretical elaborations. It demonstrates that the fantasy, initially considered only as obstacle to the truth, becomes component of the truth searched in the treatment. It argues that the historical truth in psychoanalysis is composed by the material truth and the fantasy of desire. It concludes that Freud, in his practice, starts to aim at, over all, the reconstruction or the construction with the analysand of his historical truth, as poet, than to discover his material truth, as archaeologist.
Keywords: Freud. Psychoanalysis. Historical truth. Material truth. Fantasy.
VERITE ET FANTAISIE CHEZ FREUD
Et enfin, il ne faut pas oublier que la relation analytique est fondée sur l’amour de la vérité, c’est-à-dire sur la reconnaissance de la réalité, et qu’elle exclut tout faux-semblant et tout leurre. (Freud, 1937a/1985, p. 263).
Ce travail porte sur la vérité chez Sigmund Freud (1856-1939) avec l’objectif général
d'enquêter sur les relations entre vérité (Warheit) et fantaisie1 (Phantasie). Vérité comprise
comme ce que Freud cherche à atteindre dans le traitement psychanalytique, dont
l’assentiment et l'intégration, par l’analysant, sont conditions nécessaires aux modifications de
son fonctionnement psychique, c’est-à-dire, de sa façon d’être.
Les objectifs spécifiques sont, à partir de la théorie de la séduction, accompagner les
modifications du rôle de la fantaisie concernant à la vérité, jusqu'à la différenciation
ultérieure, présentée seulement dans deux textes, à partir de 1935, entre vérité historique et
vérité matérielle, aussi que les conséquences de ces modifications quant aux objectifs du
traitement psychanalytique.
Chez Freud, la vérité est d'importance fondamentale, comme il est indiqué par
l'épigraphe ci-dessus, comprise dans sa définition traditionnelle de correspondance à une
réalité, tel que manifesté quand il réaffirme sa filiation à la vision du monde de la science
(1933 [1932]/1995). Mais la question est de savoir à quelle réalité correspond la vérité en
psychanalyse.
La vérité se présente comme problème à Freud par deux voies : la vérité de la
psychanalyse, de la théorie en sa validité épistémologique ; et la vérité dans la
psychanalyse, dans la pratique en son efficacité. Quant à la théorie, il persévère à maintenir la
1 J’utilise le nom fantaisie au lieu de fantasme ou phantasme, ainsi que le verbe fantasier en guise de fantasmer, en suivant la nouvelle traduction des œuvres de Freud édité par les P.U.F. Néanmoins, je maintiens ces outres termes dans les citations de textes où ils sont utilisés, introduisant entre crochets le terme allemand.
2
psychanalyse dans le champ de la science naturelle, en ayant comme point d'appui la source
biologique de la pulsion en la surdétermination étiologique. Dans la pratique, à partir d'une
conception de causalité matérialiste, il arrive, involontairement, à une perspective idéaliste,
avec une proéminence ascendante, pendant son parcours, de la réalité psychique sur la réalité
matérielle.
Dans cet essai, je traite, principalement, de la vérité dans la psychanalyse en ses
relations avec la fantaisie. Premièrement, de la fantaisie comme obstacle à la vérité ;
postérieurement, de la fantaisie en composant la vérité ; finalement, de la différence entre
vérité historique et vérité matérielle.
Ce travail a été impulsé par l’affirmation de Sophie de Mijolla-Mellor selon laquelle
Freud considère toujours essentiel, dans le traitement psychanalytique, d’atteindre
l’événement matériel.2
Je remercie à collègue Dr Vassiliki-Piyi Christopoulou pour les entretiens sur la vérité
et la psychanalyse pendant l’élaboration de ce travail.
Fantaisie comme barrière à la vérité
La vérité est le matériau avec lequel Freud cherche à susciter la conviction de
l’analysant pour produire des effets de transformation du fonctionnement psychique.
Néanmoins, dans le chemin en direction à la vérité, Freud rencontre l'obstacle de la fantaisie.
La conception de la fantaisie comme défense est présente depuis la période de la
théorie de la séduction, qui précède la célèbre lettre à Fliess, du 21/09/1897, où il déclare que
« je ne crois plus à ma neurotica » (FREUD, 1887-1902/2005, p. 190). Car, quand Freud
2 Séminaire de recherches de l’Équipe Interactions de la psychanalyse, Centre d’Études Psychopathologie et Psychanalyse – CEPP, U.F.R Sciences Humaines et Clinique, Université Paris 7, au 31/03/2009.
3
croyait encore en ses névrosées, la fantaisie était déjà conçue comme obstacle à l’attente de la
supposée scène réelle de séduction, comme exposé dans lettre de 02/05/1897 :
[...] j’ai acquis de la structure de l’hystérie une notion exacte. Tout montre qu’il s’agit
de la reproduction de certaines scènes auxquelles il est parfois possible d’accéder
directement et d’autre fois seulement en passant par les fantasmes [Phantasien]
interposés. Ces derniers émanent de choses entendues mais comprises bien plus tard
seulement. Tous les matériaux sont naturellement réels. Ils représentent des
constructions protectrices, des sublimations, des enjolivements de faits servant, em
même temps, de justification. (FREUD, 1887-1902/2005, P. 173).
Conception aussi présente dans le manuscrit, annexe à cette lettre, intitulée Structure
de l'hystérie :
Le but semble être de revenir aux scènes primitives. On y parvient quelquefois
directement mais, em certain cas, il faut emprunter des voies détournées, en passant
par les fantasmes [Phantasien]. Ces derniers édifient, em effet, des défenses
psychiques contre le retour de ces souvenirs qu’ils ont aussi la mission d’épurer et de
sublimer. Élaborés à l’aide de choses entendues qui ne sont utilisées qu’après coup, ils
combinent les incidents vécus, les récits de faits passés (concernant l’histoire des
parents ou des aïeux) et les choses vus par le sujet lui-même. Ils se rapportent aux
choses entendues comme les rêves se rapportent aux choses vues. Car, dans les rêves
nous voyons mais nous n’entendons pas. (FREUD, 1887-1902/2005, p. 174-175).
4
Nous voyons que, déjà dans cette phase de la théorie, les fantaisies se constituent
comme quelque chose à être traversé, pour arriver aux souvenirs traumatiques. La fantaisie se
place entre l'analyse et les scènes réelles de séduction qui sont cherchées. Question qui est
reprise dans la lettre du 25/05/1897, dans le manuscrit annexe, intitulé aussi Structure de
l’hystérie : « Quelques-unes des scènes sont directement accessibles, d’autres seulement par
l’intermédiaire de fantasmes [Phantasien] superposés » (FREUD, 1887-1902/2005, p. 179).
« Les fantasmes [Phantasien] se produisent par une combinaison inconsciente de choses
vécues et de choses entendues, suivant certaines tendances. Ces tendances visent à rendre
inaccessibles les souvenirs qui ont pu ou pourraient donner naissance aux symptômes »
(FREUD, 1887-1902/2005, p. 180). Dans ce même texte, les fantaisies sont considérées
comme des fabulations inconscientes, formées par « fusion et déformation », en clair, les
souvenirs des scènes originales sont falsifiés par fragmentation, principalement dans les
rapports chronologiques : « Un fragment de la scène vue se trouve ainsi relié à un fragment de
la scène entendue pour former un fantasme [Phantasie] ». (FREUD, 1887-1902/2005, p. 181).
Dans cette perspective, la fantaisie est une formation psychique défensive, comme
l'amnésie et les souvenirs-couverture, abordés dans des travails comme Sur le mécanisme
psychique de l’oubliance (1898/1989) et Des souvenirs-couverture (1899/1989). Dans le
premier texte, il présente l'exemple dont les noms de Botticelli et de Boltraffio émergent à la
place de Signorelli, qui est associé à la mort et à la sexualité. Dans le second texte, il aborde
les souvenirs des fleurs jaunes, des pissenlits, associées à la jupe jaune de sa première passion,
sa cousine, et aux fantaisies de mariage avec elle, qui dissimulaient le désir de la déflorer ;
comme aussi le souvenir du pain exagérément savoureux en représentant des fantaisies liées à
une vie professionnelle plus prosaïque, plus « bread-and-butter ».
Après Freud baser l'étiologie des structures psychiques sur la théorie de la libido et les
mécanismes de défense du moi, la perspective de la fantaisie comme défense continue
5
présent. Dans le travail avec l'Homme aux Loups (1918 [1914]/1988), dernière des grandes
analyses publiées, il considère que les souvenirs de vouloir voir sa sœur dénudée étaient, en
vérité, fantaisies qui « devaient effacer le souvenir d’un incident qui plus tard apparut
choquant pour l’amour-propre masculin du patient, et elles atteignirent ce but en mettant un
opposé-conforme-au-souhait à la place de la vérité historique » (p. 17). Dans la reconstruction
que Freud réalise de l'histoire, il présente la raison de la déformation de la réalité. « D‘après
ces fantaisies, ce n’était lui qui avait joué le rôle passif envers sa sœur, tout au contraire il
avait été agressif, avait voulu voir sa sœur dénudée, avait été repoussé et puni et était entré de
ce fait dans une des ces fureurs dont parlait tant la tradition domestique ». (p. 17).
Freud compare ces fantaisies avec la « formation légendaire par laquelle une nation
devenue grande et fière à voiler la petitesse de ses débuts » (p. 17). Dans cette perspective, les
fantaisies sont des légendes personnelles, au moyen desquelles le sujet modifie son passé, son
histoire. La fantaisie est une barrière qui s'interpose entre l'analyse et la vérité cherchée par
Freud.
Nous voyons, donc, qu’à partir de la période de la théorie de la séduction, aussi que
dans les développements théoriques ultérieurs, Freud considère la fantaisie comme barrière se
plaçant devant les expériences et motifs réellement importants étiologiquement, occultés alors
par un déguisement fictif. La fantaisie a le statut d'obstacle, en s'interposant entre l'analyse et
l'objectif de Freud : arriver à la vérité des souvenirs traumatiques.
Fantaisie comme composante de la vérité
Dans la théorie de la séduction, la fantaisie était déjà conçue, dans sa fonction de
défense, comme pouvant produire des symptômes. Puisque, comme indiqué dans la lettre à
Fliess, du 25/05/1897 : « Dans le cas où un pareil fantasme [Phantasie] s’intensifie au point
6
de devoir forcer l’accès au conscient, il est refoulé et un symptôme se forme par
rétrogradation de l’idée fantasmatique vers les souvenirs qui la constituent » (FREUD, 1887-
1902/2005, p. 181). Aspect quantitatif, référant à l'intensité d'investissement dans la
représentation, dont l'importance restera dans la théorie étiologique comme condition
nécessaire au déchaînement de la défense.
Néanmoins, après 1897, la fantaisie gagne aussi en importance dans la composition du
symptôme, comme fantaisie de désir. Par exemple, en analysant la toux nerveuse de Dora
(1905 [1901]/2006), Freud affirme que :
D’après une règle que j’ai toujours confirmé, mais que je n’ai pas encore eu le courage
de généraliser, un symptôme constitue la présentation — la réalisation — d’une
fantaisie à contenu sexuel, donc, une situation sexuelle. Pour mieux dire: au moins
l’une des significations d’un symptôme correspond à la présentation d’une fantaisie
sexuelle, alors que pour les autres significations il n’existe pas une telle limitation de
contenu (p. 226).
Les symptômes hystériques sont « l’expression de leurs souhaits refoulés les plus
secrets » (1905 [1901]/2006, p. 187), ils sont « l’act ivité sexuelle des malades » (p.
294), et, les psychonévroses, « le négatif des perversions » (p. 230).
Nous avons, donc, la fantaisie capable d'un double rôle : comme empêchement fictif à
l'accès à la vérité insupportable, contre laquelle la défense a été érigée ; et comme vérité
imaginaire rejetée, dont le retour compose le symptôme.
À partir du cas de l'Homme aux Loups (1918 [1914]/1988), la fantaisie commence à
avoir un troisième rôle, dans la modalité de protofantaisie (Urphantasie), en fonctionnant
aussi comme protoscène (Urszene), dans l'étiologie, en provoquant le protorefoulement
7
(Urverdrängung) et la fixation. Jusqu'alors, Freud ne considère pas que la fantaisie ait ce rôle,
qui était restreint à la défense et à la formation du symptôme. Cette position de Freud
concernant la fantaisie est claire en sa correspondance avec Carl Jung (1875-1961), qui, en
1911, est impliqué dans la recherche des fantaisies inconscientes dans l'étiologie à tel point
qu’il dit, dans la lettre du 08/05, que « les ‘formes de manifestation des fantasmes
[Phantasien] inconscients’ me démangent violemment » (McGUIRE, 1975/1992, p. 533).
Pendant que Freud, de sa partie, considère, en 15/06, que « là où je l’ai trouvé [système de
fantaisies inconscientes], il n’était pas plus important pour la constitution que n’étaient
l’étiologie et les motifs et les primes réelles de la vie » (McGUIRE, 1975/1992, p. 543). C'est-
à-dire, la fantaisie ne serait pas plus importante que la fixation de la libido, l'événement — la
frustration (Versagung) initiée par l'installation ou la suspension d'une privation (Entbehrung)
— en emmenant à la régression de l'investissement libidinal, à la génération de conflit, au
déclanchement de la défense et à la solution de compromis manifeste par le symptôme,
maintenu par le bénéfice primaire interne économique et le bénéfice secondaire extérieur.
En fait, on constate que, jusqu'au cas de l'Homme aux Loups (1918 [1914]/1988), dans
l’investigation étiologique, dont l’équation est constituée par la condition, la cause spécifique
et les causes adjuvantes (FREUD, 1895, p. 76), la recherche par la scène réelle traumatique,
base de la théorie de la séduction, continue dans la théorie de la sexualité infantile.
Néanmoins la scène en n'introduisant plus la sexualité, mais en réveillant et en intensifiant
traumatiquement l'excitation sexuelle, telle que cela avait été supposé dans les analyses de
Dora et de Hans. Scène qui devient celle du coït parental et qui a de l'importance pour Freud,
parce que « être aux écoutes du coït parental dans une enfance très précoce peut installer la
première excitation sexuelle et devenir par ses effets après coup le point de départ de tout
développement sexuel » (FREUD, 1925b/1992, p. 194).
8
Dans le cas de Dora (1905 [1901]/2006), la scène est supposée avoir été entendue et
avoir participé à la révulsion de sa sexualité, à l’âge de huit ans, par le passage de la
masturbation à la dyspnée :
J’eus alors de bonnes raisons de supposer, grâce à des actions symptomatiques et
d’autres indices, que l’enfant, dont la chambre à coucher était située à côté de celle des
parents, avait épié une visite nocturne du père à son épouse et entendu pendant le coït
la respiration haletante de l’homme qui par ailleurs avait le souffle court. En de tels
cas les enfants pressentent le sexuel dans le bruit inquiétant. C’est que les mouvements
exprimant l’excitation sexuelle sont déjà tout prêts en eux en tant que mécanismes
innés. J’ai déjà exposé il y des années que la dyspnée et les palpitations cardiaques
dans l’hystérie et la névrose d’angoisse ne sont que des éléments détachés de l’action
du coït, et dans beaucoup de cas, comme dans celui de Dora, j’ai pu ramener le
symptôme de la dyspnée, de l’asthme nerveux, au même facteur occasionnant, épier le
commerce sexuel des adultes. Sous l’influence de la co-excitation établie à ce
moment-là, il a très bien pu se produire dans la sexualité de la petite fille ce revirement
qui a remplacé le penchant à la masturbation par le penchant à l’angoisse. (p. 258).
Dans Hans (1909/1998), la scène du coït parental est aussi conjecturée d’avoir été
entendue et avoir participé à la transition du désir ardent libidinal par sa mère vers l'angoisse,
à l’âge de quatre ans et neuf mois. Freud suppose que « s’est mise en mouvement chez
l’enfant une réminiscence d’un commerce sexuel des parents observé3 par lui dans la chambre
3 Dans l’originel, beobachteten (FREUD, 1906/1941, p. 367), verbe beobachten, « observer, (Patient) mettre en observation, (überwachen, verdächtige Person) surveiller, (bemerken) remarquer » (Collins allemand-français).
9
à coucher » (p. 119). Quoique que le père de Hans ait affirmé que « je n’ai aucune preuve
directe qu’il ait, comme vous le pensez, épié4 un coït des parents » (p. 89).
Dans l'analyse de l'Homme aux Loups (1918 [1914] /1998), Freud cherchera à vérifier
la réalité matérielle de la scène du coït parental, supposée en Dora et Hans, mais,
différemment, la scène aurait été vue et non entendue, ce qui peut-être indique l’avidité de
Freud à obtenir une évidence dans ce cas. Scène qui aurait fait accélérer chez Pankejeff, avec
un an et demi, “les procès de maturation sexuelle” par une « co-excitation sexuelle » qui « se
manifesta par une évacuation de selles » (1918 [1914]/1998, p. 104-105). Néanmoins, à la fin
de l'analyse, Freud met en discussion la réalité de la scène, son statut de vérité.
Les questions centrales tournent autour des deux temps du traumatisme. Quant à la
réalité de la scène dans le premier temps, Freud propose deux solutions : a) la scène a été vue
et réellement il s'agissait d'une scène de copulation parentale ; ou b) la scène n'a pas été vue et
il s'agissait de traces de mémoire originalement sans aucun sens sexuelle. Quant au second
temps, de la signification sexuelle de la scène, Freud postule deux hypothèses : a) la
signification a été due à connaissance obtenue à travers l'expérience ; b) la signification a été
due à un schéma imaginaire congénital d’origine phylogénétique.
En ce qui concerne au premier temps, il arrive à la décision que si la scène s'est
produite réellement ou si elle a été imaginée ultérieurement, n’a pas d’importance. Il insère
une note où il dit qu’ “il est indifférent de lui conférer la valeur de scène originaire ou de
fantaisie originaire” (FREUD, 1918 [1914]/1998, p. 116). Pour ce qui est du second temps, il
n'est aussi pas important si la signification a été produite à partir de connaissance obtenue à
travers l'expérience, ou originaire d'un schéma imaginaire phylogénétique.
4 Dans l’originel, belauscht (FREUD, 1906/1941, p. 335), verbe belauschen, « écouter, épier » (Collins allemand-français).
10
Il conclut que toute combinaison de ces quatre variables est possible et que le résultat
sera le même, ainsi que le mode de traitement. Ainsi l'objectif de la psychanalyse continue à
être de rendre conscientes les réminiscences sexuelles infantiles.
À partir de cette psychanalyse, Freud propose que l'attitude à prendre est de « mettre
sur le même plan fantaisie et réalité effective et de ne pas se préoccuper de savoir tout d’abord
si les expériences d’enfance qu’il s’agit de tirer au clair sont l’une ou l’autre » (1916-
1917/2000, p. 382). Pourtant la fantaisie est non seulement égalée à la réalité matérielle, mais
lui devient proéminente, puisque « ces fantaisies possèdent une réalité psychique, en
opposition à la réalité matérielle, et nous apprenons peu à peu à comprendre que dans le
monde des névrosés la réalité psychique est la réa lité dominante » (p. 382).
Néanmoins tandis que, dans le traitement, il y a valorisation de la réalité psychique,
dans la théorie, l'importance de la réalité matérielle continue à être présente dans la pensée de
Freud, dans sa proposition quant à l'origine phylogénétique des protofantaisies, de
« observation du commerce parental, la séduction par une personne adulte et la menace de
castration proféré » (1916-1917/2000, p. 382). Pour Freud, ces fantaisies ont leurs sources
dans les pulsions et se constituent comme « un fonds phylogénétique » (p. 384). Par ces
fantaisies « l’individu va puiser, par-delà sa propre expérience de vie, dans l’expérience de vie
de l’époque préhistorique, là où sa propre expérience de vie est devenu par trop
rudimentaire » (p. 384). C'est-à-dire, si ce n'est pas une vérité ontogénétique, c'est une vérité
phylogénétique.
Il me semble fort possible que tout ce qui nous est raconté aujourd’hui dans l’analyse
en tant que fantaisie, la séduction enfantine, l’embrasement de l’excitation sexuelle par
l’observation du commerce parental, la menace de castration — ou bien plutôt la
castration — furent un jour réalité dans les temps originaires de la famille humaine et
11
que l’enfant qui fantasie a simplement comblé les lacunes de la vérité individuelle
avec une vérité préhistorique. Nous en sommes venus à plusieurs reprises à
soupçonner que la psychologie des névroses nous a conservé une plus grande part des
antiquités de l’évolution humaine que toutes les autres sources. (p. 384-385).
Il est important de souligner que, en 1911, Jung défendait déjà la thèse de l'héritage
phylogénétique. Comme dans la lettre à Freud du 17/10, quand il dit que s’impose à lui le
soupçon du fait que « les prétendus ‘souvenirs précoces d’enfance’ ne sont pas du tout des
réminiscences individuelles, mais phylogénétiques » (McGUIRE, 1975/1992, p. 567). À ce
moment, en restreignant celles-ci à la naissance et à la succion, néanmoins, en ajoutant que
« je crois qu’on verra plus tard qu’un nombre incroyablement plus grand de choses que nous
ne croyons maintenant sont des réminiscences phylogénétiques » (p. 567).
Proposition de Jung, que Freud semble finalement intégrer, car chez l'Homme des
Loups, sur la détermination des effets immédiats à la scène, en affirmant que:
Si l’on prend en considération le comportement de l’enfant de quatre ans à l’égard de
la scène originaire réactivée, si même on ne fait que penser aux réactions
considérablement plus simples de l’enfant de 1 an 1/2 em train de vivre cette scène, on
peut difficilement écarter la conception selon laquelle une sorte de savoir difficilement
déterminable, quelque chose comme une préparation à comprendre exerce ici chez
l’enfant une action concomitante. En quoi ceci peut bien consister, c’est ce qui
échappe à toute représentation; nous ne disposons que de la seule, excellente, analogie
avec le vaste savoir inst inctuel de animaux. [...] Cet instinctuel serait le noyau de
l’inconscient, une activité d’esprit primitive qui ultérieurement est détrônée et
recouverte par la raison humaine qu’il s’agit d’acquérir, mais qui si souvent, peut-être
12
chez nous, conserve la force de faire descendre jusqu’à elle des processus animiques
supérieurs. (FREUD, 1918 [1914]/1998, p. 116-117).
En faisant appel à l’instinct, pour expliquer les réactions concomitantes à la
protoscène, Freud semble renvoyer la question dans le champ de l'éthologie, à des
phénomènes tels que ceux mentionnés par Jacques Lacan (1901-1981), en 1946, de imagos à
provoquer l’ovulation chez pigeons. Effet précoce de l'imago, qui apparaît également dans la
proposition de Lacan du stade du miroir (1949 [1936]/1999).
Freud soulève aussi l'hypothèse de la vision de coït d'animaux pour l'élaboration de la
fantaisie et la signification sexuelle, en ayant déjà la possibilité de la connaissance de la
sexualité par « l’observation des animaux, qui dissimulent si peu leur vie sexuelle » (1908, p.
232).
Hypothèses qui sont critiquées par Laplanche et Pontalis (1985) au niveau de la
dérision. Néanmoins, il faut non simplement ridiculiser Freud, comme font ces auteurs, mais
interroger quant aux raisons de ces propositions.
Je pense que la difficulté de Freud à expliquer les effets immédiats de la scène, aussi
comme le rêve d'angoisse, est basé sur la considération, d'une part, que « l’enfant ne peut, tout
comme l’adulte, produire des fantaisies qu’avec un matériel acquis » (Freud, 1918 [1914], p.
53). Alors que, d'autre part, dans le cas de Pankejeff, le « laps de temps disponible pour
l’acquisition est court » (p. 53). Dans le cas de Hans (1909/[200-]), Freud avait déjà
expérimenté des difficultés à localiser l'origine du « pressentiment de quelque chose qu’il
pourrait faire avec la mère » (p. 108), des « pressentiments de coït » (p. 121), représentés dans
leurs « fantaisies de coït symboliques » (p. 108).
13
Ainsi je considère que c’est en raison de juger le temps de vie court, que Freud ne
suppose pas la possibilité d'approcher la protofantasia au symbolisme onirique, notamment
dans les rêves typiques, dont le matériel est la langue et la culture (FREUD, 1900).
Enfin, après l'analyse de l'Homme des Loups, dans la pratique psychanalytique, la
réalité psychique est mise au même niveau que la réalité matérielle, pouvant même lui être
proéminente. Avec la conception de l'Urphantasien pouvant se substituer à l'Urszenen, à
partir de l'introduction du traumatisme narcissique, la fantaisie, outre d’être conçue comme
obstacle, passe à composer aussi la vérité de l'étiologie, avec participation non restreinte à la
formation du symptôme. Néanmoins, dans la théorie, il continue d’être nécessaire, à la pensée
de Freud, l'expérience d'événements objectifs, même que préhistorique et transmise par la
phylogénie.
Vérité historique, vérité matérielle et fantaisie
La première occurrence du terme « vérité historique » (historische Wahrheit), se
trouve dans l'analyse que Freud entreprend de Leonardo da Vinci (1910/1993), à partir d'un de
ses premiers souvenirs d'enfance. Il procède à analogies, auxquelles il fera, à plusieurs
reprises, référence dans son œuvre, entre vérité historique avec réalité vécue et histoire
individuelle avec histoire d'un peuple. Il fait remarquer l'importance des histoires de l'enfance,
parce que si celles-ci étaient méprisées « on commettrait la même injustice qu’en rejetant à la
légère, dans la préhistoire d’un peuple, le matériel des légendes, traditions et interprétations »
(p. 109).
Em dépit de toutes les déformations et de tous les contresens, c’est cependant par elles
que la réalité du passé est représentée; elles sont ce que le peuple a formé à partir des
14
expériences vécues de ses temps originaires, sous la domination de motifs autrefois
puissants et aujourd’hui encore à l’œuvre, et si l’on pouvait seulement, par la
connaissance de toutes les forces en action, annuler ces déformations, on devrait être
en mesure de mettre à découvert la vérité historique derrière ce matériel légendaire. (p.
109).
En défaisant les déformations légendaires, on arriverait à la vérité historique composée
par l'expérience et les motifs du passé encore présentes. Objectif que Freud cherche à
atteindre, tant dans la dimension historique collective, dans de textes comme Totem et tabou
(1912-13/1998) et L’homme Moïse et la religion monothéiste (1939 [1934-1938]/1986), que
sur le plan individuel, dans la pratique psychanalytique, au cours de son investigation des
« souvenirs d'enfance » ou des « fantaisies des individus » (1910/1993, p. 109). Il faut traiter
de ce que l’analysant croit se rappeler de l'enfance, puisqu’ « en général sont cachés, derrière
les restes mnésiques non compris de lui-même, d’inestimables témoignages sur les traits les
plus significatifs de son développement animique » (1910/1993, p. 109). Nous avons ici, la
relation entre vérité historique et la trace (Züge). Ce sont les traces, les marques dans l'histoire
par l'expérience et les motifs, ce qui se cherche.
Dans Constructions dans l’analyse (1937b/1985), Freud réaffirme sa conception dont
l'objectif du travail analytique est « d’amener le patient à lever les refoulements des débuts de
son développement […], pour les remplacer par des réactions qui correspondent à un état de
maturité psychique » (p. 270). Pour que cet objectif soit atteint, « il doit se souvenir de
certaines expériences et des motions affectives suscitées par elles, les unes et les autres se
trouvant oubliées à présent (p. 270). L'analyste aurait la fonction de reconstruire, ou
construire, la vérité historique du sujet, à travers des combinaisons du matériel présenté à
partir des rêves, des idées incidentes dans l'association libre et par « des motions affectives
15
réprimées et des réactions contre elles » (p. 270), ainsi que par la répétition des affects
appartenant au refoulé en et dehors de la situation analytique.
Donc, voici ce que Freud conçoit comme la vérité historique : l'ensemble formé par
l'expérience et les pulsions réveillées originalement — ce qui est en accord avec sa conception
de série complémentaire formée par la disposition constitutionnelle héréditaire et la
disposition acquise par l'expérience (FREUD, 1916-1917/2000).
Ainsi, je considère que dans la différenciation faite par Freud entre vérité historique et
vérité matérielle, cette dernière se restreint aux expériences d'événements en la réalité
matérielle, en excluant les motions affectives originales (fantaisies de désir) et les défenses
quant à ces motions (fantaisies de défense, souvenirs-couverture, amnésies etc.). Alors que la
vérité historique se compose des expériences dans la réalité matérielle et les fantaisies de
désir.
Nous aurions trois facteurs : 1. Événements de la réalité matérielle, c'est-à-dire, la
vérité matérielle ; 2. Représentations (fantaisies) des pulsions, qui, avec des événements de la
réalité matérielle, forment la vérité historique ; et 3. Défenses, qui distordent la vérité
historique.
Par conséquent, la vérité historique que Freud cherche trouver dans le traitement est
l'ensemble formé par les événements vécus dans la réalité matérielle et les fantaisies de désir
de la réalité psychique (avec prévalence de celle-ci), par la traversée des défenses, qui aussi
participent de la réalité psychique.
En appui à cette différenciation entre la vérité historique et la vérité matérielle, je me
reporte au seul texte où cette distinction est présentée sous une forme plus explicite, pour la
première et dernière fois, L’homme Moïse et la religion monothéiste (1939 [1934-
1938]/1986), à l’exception de la brève référence qui y est faite dans le Post-scriptum, de 1935,
à son Autoprésentation (1925a/1992), où il écrit:
16
Dans l’« Avenir d’une illusion », j’avais apprécié la religion de façon principalement
négative ; je trouvai plus tard la formule qui lui rend mieux justice : son pouvoir
repose à vrai dire sur son contenu de vérité, cette vérité n’est pas une vérité matérielle,
mais historique. (p. 121).
Dans L'avenir d'une illusion (1927/1994), en analysant le rôle de Dieu dans
l'interdiction de l'homicide, Freud considère que la doctrine religieuse est vraie, porte la vérité
historique, parce que le père primordial a été « l’image originaire de Dieu, le modèle d’après
lequel les générations ultérieures ont formé la figure de Dieu. Par conséquent, la religion a
raison dans sa présentation » (p. 183). Les faits contenus dans les doctrines religieuses sont
des vérités sous un « déguisement symbolique » (p. 186), puisque la religion « nous fait donc
part de la vérité historique en la transformant et en la travestissant quelque peu, il est vrai » (p.
183). Ainsi, « le trésor des représentations religieuses contient non seulement des
accomplissements de souhait, mais aussi des réminiscences historiques significatives » (p.
183).
Basé sur l'affirmation du Post-scriptum, de 1935, selon laquelle l'explication religieuse
porte la vérité historique et non la vérité matérielle, je conclus que, si l'explication des
croyants contenait la vérité matérielle, ce l’aurait été réellement Dieu qui a effectué
l'interdiction. Ainsi la vérité historique se compose de l'expérience dans la réalité matérielle
du père primordial et le meurtre de celui-ci (vérité matérielle) ajouté aux motions affectives
mobilisées par cette expérience — vérité historique qui aurait été modifiée ultérieurement.
Dans le texte sur Moïse (1939 [1934-1938]/1986), la différence entre vérité historique
et matérielle est présentée au cours de l'analyse de l'idée d'un dieu unique, accepté par les
« croyants pieux » comme « part de la vérité éternelle » (p. 233). Freud considère, tel que
17
dans le Post-scriptum de 1935, que l'explication des croyants contient la vérité, « non pas
cependant la vérité matérielle mais la vérité historique » (p. 233). Vérité historique qui, en
suivant une ligne de raisonnement semblable à la précédente, a été déformée en son retour. En
corrigeant cette déformation, la vérité historique est que, réellement, il y a eu, non pas un
grand dieu unique, mais “une personne unique, qui doit alors apparaître comme géante et qui,
élevée ensuite au rang de divinité, est revenue dans le souvenir des humains” (p. 234).
Ainsi, la vérité historique est qu'une personne (réalité matérielle) qui semblait
immense à l'époque (fantaisie originale) a ultérieurement été élevée à la divinité (fantaisie
deformante).
Donc, je comprends que dans ces deux textes : a) vérité matérielle coïncide avec
réalité matérielle. Mais vérité historique ne se restreint pas à la réalité psychique, c'est-à-dire,
la vérité historique englobe la réalité matérielle (ou vérité matérielle) et la réalité psychique
(fantaisie) ; b) réalité psychique est composée de la fantaisie pulsionnel, aussi que de la
formation psychique déformante ; c) pour arriver à la vérité historique, il faut se défaire de la
formation adultérante postérieure pour atteindre la fantaisie originale et l'événement réel.
Ce partant, en transposant ces conclusions dans le champ de la clinique
psychanalytique, il se confirme que la vérité historique vient s'établir dans la pensée de Freud
comme l'événement dans la réalité matérielle (vérité matérielle) en addition aux fantaisies de
désir, en se soustrayant les défenses. Ainsi la vérité matérielle est la vérité historique dénudée
des fantaisies de désir et de la défense :
Vérité Historique = (Vérité Matérielle + Fantaisie de Désir) − Défense
Vérité Matérielle = Vérité Historique − (Fantaisie de Désir + Défense)
18
Ainsi, dans la pratique psychanalytique, la vérité historique cherchée ne se réduit pas à
la réalité matérielle, puisque les fantaisies de désir possèdent valeur exponentielle en relation
aux événements réels.
Conclusion
Il n'est pas possible quantifier combien des attaques à la psychanalyse sont motivés par
la peur à Freud, fantasié comme Croquemitaine qui remue, tel Orcus, les enfers des passions
infantiles, encore pulsatives sous la peau de l'adulte. Néanmoins, dans le développement de sa
pensée, Freud ressemble plus à Janus, en travaillant avec des paires antithétiques de concepts.
Cependant, il a été confondu par la fantaisie, deux fois, entre le réel et l'imaginaire.
Premièrement, de façon naïve, ensuite, plus prudente, jusqu'à la formulation des notions de
réalité matérielle et de réalité psychique, et, ultérieurement, l'élaboration des conceptions de
vérité matérielle et de vérité historique.
Dans la théorie, la fantaisie cesse d’avoir seulement une fonction de défense quant à la
vérité, en gagnant progressivement un rôle dans la constitution de la vérité, et une
participation croissante dans l'étiologie. Dans la pratique, la construction est mise en relief en
relation à l'interprétation, c'est-à-dire, la création se ressort à la découverte. Il devient moins
important, pour le traitement, d’établir le contexte objectif de l'expérience, que de localiser le
début du conflit, à savoir, le « pourquoi », les motifs du conflit pulsional, et le « pour que », la
finalité de la défense
Néanmoins Freud a été lent à assentir l'amplitude du rôle étiologique de la fantaisie.
Son penchant par l'archéologie est manifeste — la profession de Norbert Hanold, dans
Gradiva — qu'on peut le constater dans ses analogies entre le travail de l'archéologue et du
psychanalyste, aussi qu’au travers de sa passion par statuettes ancestrales et son intérêt pour
19
l’histoire de l’humanité. Pourtant il a su se laisser guider par les caractéristiques de son objet
d'étude, en cherchant moins à découvrir la vérité matérielle, comme archéologue, qu’à rendre
possible la reconstruction ou la construction par l’analysant de sa vérité historique, comme
poète, en arrivant à la conclusion que, dans une extension plus grande qu’il aurait imaginée,
nous sommes, en fait, faits de la même substance que celle des rêves.
Dans la pratique, le désir de travailler avec le matériel concret du scientifique positif
est revu, en passant à inclure progressivement le matériel diaphane de la Psyché, qui, avec
Eros et Thanatos à ses côtés, au ouvrir et fermer ses ailes de papillon, se montre et se cache,
comme un mirage. Ce qui semble être un destin auquel Freud cherche à être exempté depuis
le temps du traitement du cathartique, dont les histoires de cas lui semblaient plus des récits
romanesques.
Cependant, avec la fantaisie phylogénétique, l'objectif d'avoir une base matérielle pour
sa théorie fluctuat nec mergitur. Puisque, dans cette conception, il continue à rendre présente
la réalité matérielle de l’événement, supposée dès la théorie de la séduction, mais maintenant
apportée par la biologie. Néanmoins reste en suspens la question de savoir pourquoi Freud,
pour l’explication de la protofantaisie, a considéré court le temps de vie de Pankejeff, en ne
faisant pas recours, par conséquence, à la matérialité de la langue et de la culture, comme déjà
proposé pour le symbolisme du rêve, au lieu de faire appel à la biologie.
Des trois protoscènes — coït parental, séduction et castration — seulement pour cette
dernière se perpétue, comme condition nécessaire, une réalité matérielle ontogénétique, la
différence sexuelle, quand le réel de l'anatomie va intervenir au jugement d'existence du
phallus imaginaire. Alors que, en les autres deux, l'imaginaire des scènes va opérer sur le
jugement d'attribution sexuelle au corps réel.
En considérant l'importance de la vérité chez Freud, il est notable que, concernant la
différenciation entre vérité historique et vérité matérielle, seules soient fait deux brèves et
20
tardives références dans toute son œuvre, à partir de 1935, et il est tout aussi remarquable que
cette différence soit abordée dans des textes sociologiques et non cliniques. Il est possible que
cela soit dû au fait d’avoir constaté que cette distinction, pour importante qu’elle soit en ce
que concerne l'histoire collective, a moins d’implications dans le contexte de l'histoire
individuelle. Ou, peut-être, attribuable à la réticence à conclure que la vérité historique dans la
psychanalyse n'est pas une vérité matérielle.
BIBLIOGRAPHIE
COLLINS ALLEMAND-FRANÇAIS. http://dictionnaire.reverso.net. Accès au 29/05/2009.
FREUD, S. (1887-1902). La naissance de la psychanalyse : lettres à Wilhelm Fliess, notes et
plans. Paris : PUF, 2005.
FREUD, S. (1895). Sur la critique de la « névrose d’angoisse ». In Œuvres complètes
Psychanalyse 1894-1899 (Vol. 3). Paris : PUF. (1989).
FREUD, S. (1898). Sur le mécanisme psychique de l’oubliance. In Œuvres complètes
Psychanalyse 1894-1899 (Vol. 3). Paris : PUF. (1989).
FREUD, S. (1899). Des souvenirs-couverture. In Œuvres complètes Psychanalyse 1894-1899
(Vol. 3). Paris : PUF. (1989).
FREUD, S. (1900). L’interprétation du rêve. In Œuvres complètes Psychanalyse 1899-1900
(Vol. 4). Paris : PUF. (2004).
FREUD, S. (1905 [1901]). Fragment d’une analyse d’hystérie. In Œuvres complètes
Psychanalyse 1901-1905 (Vol. 6). Paris : PUF. (2006).
FREUD, S. (1908). Des théories sexuelles infantiles. In Œuvres complètes Psychanalyse
1906-1908 (Vol. 8). Paris : PUF. (2007).
21
FREUD, S. (1909). Analyse de la phobie d’un garçon de cinq ans. In Œuvres complètes
Psychanalyse 1908-1909 (Vol. 9). Paris : PUF. (1998).
FREUD, S. (1909). Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben. In Gesammelte Werke –
Werke aus den Jähren 1906-1909. (Vol. 7). London : Imago. (1941).
FREUD, S. (1910). Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci. In Œuvres complètes
Psychanalyse 1909-1910 (Vol. 10). Paris : PUF. (1993).
FREUD, S. (1912-13). Totem et tabou. In Œuvres complètes Psychanalyse 1911-1913 (Vol.
11). Paris : PUF. (1998).
FREUD, S. (1914). Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique. In Œuvres
complètes Psychanalyse 1913-1914 (Vol. 12). Paris : PUF. (2005).
FREUD, S. (1916-1917). Leçons d’introductions à la psychanalyse. In Œuvres complètes
Psychanalyse 1915-1917 (Vol. 14). Paris : PUF. (2000).
FREUD, S. (1918 [1914]). A partir de l’histoire d’une névrose infantile. In Œuvres complètes
Psychanalyse 1914-1915 (Vol. 13). Paris : PUF. (1988).
FREUD, S. (1925a). Autoprésentation. In Œuvres complètes Psychanalyse 1923-1925 (Vol.
17). Paris : PUF. (1992).
FREUD, S. (1925b). Quelques conséquences psychiques de la différence des sexes au niveau
anatomique. In Œuvres complètes Psychanalyse 1923-1925 (Vol. 17). Paris : PUF.
(1992).
FREUD, S. (1927). L’avenir d’une illusion. In Œuvres complètes Psychanalyse 1926-1930
(Vol. 18). Paris : PUF. (1994).
FREUD, S. (1933 [1932]). Nouvelle suite de des leçons d’introduction à la psychanalyse. In
Œuvres complètes Psychanalyse 1931-1936 (Vol. 19). (1995).
FREUD, S. (1937a). L’analyse avec fin et l’analyse sans fin. In Résultats, idées, problèmes
(Vol. 2). Paris : PUF. (1985).
22
FREUD, S. (1937b). Constructions dans l’analyse. In Résultats, idées, problèmes (Vol. 2).
Paris : PUF. (1985).
FREUD, S. (1939 [1934-1938]). L’homme Moïse et la religion monothéiste. Paris :
Gallimard. (1986).
LACAN, J. (1946). Propos sur la causalité psychique. In : Écrits I. Paris : Points. (1999).
LACAN, J. (1949 [1936]). Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je : tel
qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique. In : Écrits I. Paris : Points.
(1999).
LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J.-B. (1985). Fantasme originaire Fantasme des origines
Origine du fantasme. Paris : Hachette.
McGUIRE, W. (Org.) (1975). Sigmund Freud - C.G. Jung Correspondance 1906-1914.
Paris : Gallimard. (1992).