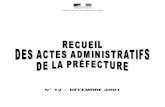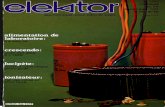Valland: numéro 14 (novembre/ décembre 2014)
-
Upload
paris-sorbonne -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Valland: numéro 14 (novembre/ décembre 2014)
Sommaire
Éditorial, par M. Grégory CattaneoPrésentation de M. Li TangListe des membres du réseauProgramme des conférences de l’année 2014-2015 à l’École Pratique des Hautes Études Entretien avec M. Benoît Eeckeman au sujet de la reconstitution du chariot d’Oseberg, par M. François DontaineSous le vent nordique et l'aurore boréale : A propos du Master en études médiévales islandaises, par M. Li Tang
Comité de rédaction: Mlle Marion Poilvez, MM. Grégory Cattaneo & François DontaineMise en page: M. François Dontaine
Légende de la couverture: détail de reconstitution du chariot d’Oseberg, par M. François DontainePhotos pages 2, p 7, 9 à 15, 17 à 19 : par M. François Dontaine
Page 3:Page 4:Page 4:Page 8:Page 9:
Page 16:
Valland 2Numéro 14
Retrouvez Valland sur internet:
http://paris-sorbonne.academia.edu/VallandR%C3%A9seaufrancophoned%C3%A9tudesnorroiseshttps://www.facebook.com/groups/valland/
https://plus.google.com/u/0/communities/103733138641923727038
Éditorial
Valland 3Numéro 14
Reykjavik, le 1er novembre 2014
Chers collègues,
Pour ce quatorzième numéro, nous accueillons un nouveau membre : M. Li Tang qui, à l’instar de beaucoup de francophones ces dernières années, s’est rendu en Islande afin de poursuivre son étude de la matière norroise dans le cadre du Master en études médiévales islandaises offert par l’université d’Islande. Comme d’autres étudiants de ce programme avant lui, M. Li Tang nous donne son point de vue sur le programme offert à l’université d’Islande.
Dans ce numéro, notre collègue François Dontaine a conduit un entretien avec M. Benoît Eeckeman, ébéniste et sculpteur de profession, qui est très connu des milieux de la reconstitution historique pour diverses répliques d’objets en bois. Il nous parlera ici du processus à l’œuvre dans sa dernière contribution : la reconstitution du chariot d’Oseberg.
Nous faisons suite à la requête du professeur François-Xavier Dillmann, en transmettant le programme des conférences de l’année 2014-2015 qui reprendront à l’École Pratique des Hautes Études à partir du 21 novembre 2014. M. François-Xavier Dillmann entend poursuivre tout d’abord le premier point des conférences de l’année 2013-2014 intitulé « I. Recherche sur la guerre dans la Scandinavie ancienne et médiévale » puis introduire un nouveau point : « II. Les sources de la bataille de Stiklestad : lecture et explication de textes ». Le thème guerrier sera ainsi abordé à travers l’étude approfondie de l’épisode de la bataille de Stiklestad qui se déroula l’été 10301.
Rappelons également que les deux colloques d’histoire médiévale ayant attrait à la Scandinavie et à l’Europe et présentés dans le numéro XIII, auront lieu ce mois-ci2.
En vous remerciant de votre fidélité, le comité de rédaction de Valland vous souhaite une bonne lecture.
Mlle Marion Poilvez, M. François Dontaine et M. Grégory Cattaneo
1 Au sujet de cet épisode, on se reportera à l’article du professeur François-Xavier Dillmann intitulé : «Remarques sur la chute du roi de Norvège Olaf Haraldsson (1028-1030) », dans Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Séances de l’année 2012, janvier-mars, Paris, 2012 [impr. 2013], pp. 109-155. Au sujet du programme de l’année 2013-2014, on consultera le compte-rendu de la conférence inaugurale du professeur François-Xavier Dillmann à l’EPHE, rédigé par les soins de M. Grégory Cat-taneo, dans Valland, IX, janvier/février 2014, pp. 8-10. Notons que l’hommage rendu par M. François-Xavier Dillmann à l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, le 21 décembre 2012, au sujet de l’ouvrage d’August Strindberg, Kulturhistoriska studier. Texten redi-gerad av Per Stam och kommenterad av Bo Bennich-Björkman, Stockholm, Norstedts (August Strindbergs Samlade Verk, VII), 2009 (impr. 2010), 447 p., a fait l’objet d’une publication récente dans les Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Séances de l’année 2012, octobre-décembre, Paris, 2012 [impr. juillet 2014], pp. 1895-1898.2 Le premier, qui se déroulera à Paris du 3 au 5 novembre, s’intitule : « Les guerres civiles : un phénomène européen au Moyen Âge ? » et le second, qui se déroulera à Nancy du 6 au 8 novembre, s’intitule : « Communitas regni : la “communauté du royaume” (Angleterre, Écosse, France, Empire, Scandinavie), de la fin du Xe siècle au début du XIVe siècle, théories et pratiques ». Des historiens venus de Scandinavie et des historiens français échangeront autour des notions de « guerres civiles » et de « communauté du royaume » au Moyen Âge.
Présentation des membres du réseau
Valland 4Numéro 14
Nouveaux membres
M. Li Tang, ancien élève de l’École normale supérieure, est actuellement étudiant en Master d’Études médiévales islandaises à l’Université d’Islande. Il est titulaire d’un MA au sein du programme Études médiévales cohabilité Paris-Sorbonne, Sorbonne Nouvelle, ENC et ENS. Il s’intéresse surtout à l’analyse philologique et littéraire pour explorer les liens entre l’Islande et l’Europe continentale.
Contact: [email protected]
Liste des membres (pour le descriptif complet, voir les bulletins précédents)
M. Malo Adeux, étudiant en première année de master au sein du programme Viking and Medieval Norse Studies, titulaire d’un master en littérature comparée et médiévale, rédacteur de la revue littéraire en langue bretonne Nidiad.Contacts: [email protected]
M. Florent Audy est actuellement doctorant en archéologie à l’université de Stockholm. Il y prépare, sous la direction d’Anders Andrén et de Nanouschka Myrberg, une thèse intitulée : « Coin-pendants in Viking Age Scandinavia ». Titulaire d’une Maîtrise d’histoire médiévale (Université de Poitiers), d’un Master d’histoire de l’art et d’archéologie (Ecole Pratique des Hautes Etudes) et d’un Master de civilisation scandinave (Paris IV Sorbonne). Contact : [email protected]
M. Santiago Barreiro est titulaire d’un MA d’études médiévales islandaises (Háskóli Íslands) et d’une Licence d’histoire (Buenos Aires). Il est actuellement doctorant en histoire médiévale à l’Université de Buenos Aires. Ses thèmes de recherche portent principalement sur l’économie islandaise du XIIIe siècle, et plus particulièrement sur la représentation des formes de circulation des biens dans La Saga d’Egil. Contact : [email protected]
Mlle Karyn Bellamy-Dagneau a complété une licence d’histoire à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et a étudié à Lund en Suède. Elle poursuit actuellement ses études au sein du master Viking and Medieval Norse Studies (VMN) à l’Université d’Islande. Ses intérêts académiques se portent entre autres sur les sagas légendaires, les religions, les coutumes norroises, la pratique de la magie, les figures mythologiques, le fonctionnement de la société selon les genres ou encore la culture matérielle textile. Depuis 2009, elle s’investie dans la reconstitution historique scandinave et plus particulièrement dans la reconstruction artisanale textile. Elle fait partie du groupe de reconstitution norroise “L’Équipage”.Contact: [email protected]
M. Christophe Bord, docteur en études scandinaves de l’Université de Paris-IV-Sorbonne, est maître de conférences (études anglaises & scandinaves) à l’Université de Toulouse-II Le Mirail. Il est l’auteur d’ouvrages et d’articles dans le domaine de la linguistique, nordique en particulier, diachronique et synchronique.Contact : [email protected]
M. Jesse Byock est professeur de norrois et d’études scandinaves médiévales à l’université de Californie Los Angeles (UCLA), professeur d’archéologie à l’Institut Cotsen et dirige le projet archéologique de Mosfell (MAP). Il est spécialiste en études d’anthropologie historique et se consacre dernièrement à la publication de manuels pédagogiques sur la langue norroise.
Valland 5Numéro 14
Contact : [email protected]
M. Grégory Cattaneo, doctorant en histoire médiévale sous la direction de Dominique Barthélemy (Université de Paris IV Sorbonne) et de Helgi Þórlaksson (Université d’Islande), thèse intitulée : Des chefferies aux seigneuries : pouvoir et société dans l’Islande médiévale.Contact: [email protected]
Mme Dominique Casanova est ergothérapeute diplômée et herboriste. Au cours de sa vie, elle a exercé plusieurs activités, comme documentaliste, aide-costumière dans le théâtre ou encore étudiante en histoire de l’art. En autodidacte, elle a poursuivi en parallèle à ses activités professionnelles une activité de tisserande, notamment dans le cadre de la reconstitution historique (période celte et médiévale) qu’elle pratiqua durant dix années. Elle fut membre des métiers d’Arts du Brabant wallon, spécialiste du tissage et de la peinture sur soie.Contact: [email protected]
M. Pablo Gomes de Miranda est étudiant en Master d’histoire sous la direction des professeurs M. Johnni Langer et Mme Maria Emília Monteiro Porto. Il est actuellement dans la dernière phase de rédaction de son mémoire intitulé : « Guerre et identité : étude du concept de martialité dans la Heimskringla. » Ses centres d’intérêt gravitent autour de l’identité et la perception de l’espace dans les sagas, et plus particulièrement dans les « Histoires des rois [de Norvège, voire de Danemark] » (konungasögur). Il est l’éditeur des Notícias Asgardianas, un bulletin d’information brésilien qui traite des avancées de la recherche consacrée aux études scandinaves et à la période des Vikings. Contact: [email protected]
M. Cyril de Pins, professeur agrégé de philosophie, titulaire d’une maîtrise de philosophie et d’un maîtrise d’Etudes scandinaves (Paris IV), ainsi que d’un DEA en linguistique (Paris 7), docteur sur la pensée linguistique dans l’Islande médiévale, centrée sur Snorra-Edda et les quatre Traités Grammaticaux, à l’Université Paris 7-Denis Diderot.Contact : [email protected]
M. Laurent Di Filippo, doctorant en sciences de l’information et de la communication sous la di rection de Jacques Walter (Université de Lorraine), et en cotutelle en études nordiques sous la direction de Jürg Glauser (Université de Bâle). Il s’intéresse principalement à l’utilisation de mythes traditionnels dans des productions culturelles contemporaines: Contact: [email protected]
M. François Dontaine a commencé la reconstitution historique en 1985 et a débuté ses travaux d’archéologie expérimentale à l’Archéosite d’Aubechies en 2000. Il a ouvert la voie à des associations francophones et il a géré le seul forum francophone de reconstitution scandinave médiévale. Dans la vie civile, il occupe un poste d’ingénieur système en informatique.Contact : [email protected]
Mme Val Dufeu, docteur en histoire médiévale-environnementale de l’Université de Stirling (Écosse), est consultante en recherche historique, étude des sols, et géo-archéologie. Après des études multidisciplinaires intégrant histoire médiévale-environnementale, sciences sociales et sciences environnementales, elle fut soutenue pour sa recherche doctorale par le AHRC (Arts & Humanities Research Council). Son expertise porte sur la colonisation Scandinave de l’Atlantique Nord, les reconstructions économico-environnementales et l’organisation économique et sociale des communautés liées à la pêche. En parallèle, elle travaille sur des fouilles archéologiques et développe un projet d’archéologie expérimentale.
M. Romain Dupont est titulaire d’une maîtrise en histoire ancienne de l’université de Limoges. Il s’est orienté par la suite vers l’étude du patrimoine et les enjeux du développement des territoires ruraux. S’intéressant
Valland 6Numéro 14
également à la reconstitution historique, il a fait partie d’une association « Les Gaulois d’Esse » qui tente de reconstruire un village de la fin de l’âge du fer près de Confolens (16). Il porte un grand intérêt à la période laténienne et gallo-romaine. Le monde scandinave des périodes Vendel et viking font également partie de ses principaux centres d’intérêt au même titre que les sagas islandaises.
Mme Christelle Fairise, titulaire d’une Maîtrise de Scandinave (Paris IV Sorbonne), doctorante sous la direction de Daniel Lacroix (Université Toulouse 2 Le Mirail) et de Régis Burnet (Université catholique de Louvain), thèse intitulée : « Les Vies de la Vierge en langue d’oïl et en norrois (XIIe - XIVe siècles).Contact : [email protected]
Mlle Véronique Favéro, titulaire d’un MA d’études médiévales islandaises de l’Université d’Islande, traduction et analyse d’Erex saga, la version norroise d’Erec et Enide, actuellement en cours de MA de Littérature, Média et Culture du Département d’Anglais de l’Université d’Islande. Ses thèmes de recherche englobent le monde de la réécriture et de la traduction, et plus particulièrement la circulation du cycle arthurien.Contact: [email protected]
M. Alexis Finet est étudiant dans le Masters of Arts in the Teaching of Languages à l’Université d’Hattiesburg, Mississippi (avec double spécialisation dans l’enseignement de l’anglais et du français). Linguiste partiellement autodidacte et flûtiste, Il porte un intérêt grandissant pour les liens entre l’acquisition des langues et des diverses composantes de l’art musical, questions sur lesquelles il projette une éventuelle recherche doctorale. Après avoir visité deux fois l’Islande, il a co-traduit l’Oddaverja Þáttr avec Grégory Cattaneo et s’intéresse aux sagas du pays.Contact: [email protected]
Mme Hélène Fossey est professeur des collèges et lycées en Histoire-géographie et titulaire d’un Master en Histoire médiévale de l’université de Caen, plus spécifiquement sur la Scandinavie ancienne. Le premier volume de Master s’est intéressé à la figure symbolique du corbeau, sur le plan mythologique et magico-religieux, ainsi que dans une dimension sociale, en tant que insigne des guerriers et des puissants. Elle s’intéresse particulièrement à l’histoire des symboles et des représentations. De par ses fonctions actuelles, elle est animée par le souci de partager cette passion et ses connaissances avec un large public, scolaire, mais plus large également, par le biais notamment d’une reconstitution qui se veut proche de l’archéologie expérimentale. Contact: [email protected]
M. Frédéric Hanocque est éleveur de fjordhest et reconstituteur professionel en Normandie. Il a participé à des évenements médiatiques tels que plusieurs passages à des journaux télévisés de TF1, des émissions culturelles sur France 3, M6 et dans une vidéo sur l’exposition internationale de Daoulas en 2004. Il a, entre autres, participé à la traversée de la Manche avec un drekki reconstitué pour la commémoration de l’expédition de Guillaume le Conquérant et participé à l’exposition à la médiathèque de Vernon en mars 2012 avec M. Jean Renaud et M. Régis Boyer.
Mme Ásdís Rósa Magnúsdóttir, professeur de langue et de littérature françaises à l’Université d’Islande. Elle ensei gne également la littérature médiévale et la traduction et est titulaire d’un doctorat en Littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance du centre de recherche sur l’imaginaire de l’Université Stendhal – Grenoble 3Contact: [email protected]
M. Nicolas Meylan, maître assistant à l’université de Lausanne et chargé de cours à l’université de Genève en histoire des religions. Outre des problèmes plus généraux en histoire des religions, il s’intéresse à la Scandinavie médiévale.Contact: [email protected]
M. Sebastian Mortensen Mariné est étudiant en deuxième année de Master de philologie nordique à l’Université de Copenhague et titulaire d’une licence en linguistique comparative. Il s’intéresse à la littérature
Valland 7Numéro 14
comparée (domaines nordique et continental) ainsi qu’à l’importance des sources matérielles et culturelles des manuscrits médiévaux. Il a développé le site www.haandskrift.ku.dk (en danois – version en anglais en cours) qui fournit des outils essentiels quant à la culture écrite du Moyen Âge en Scandinavie.Contact: [email protected]
M. Lyonel Perabo, étudiant en première année de maîtrise au sein du programme Old Nordic Religion sous la direction du professeur Terry Gunnell. Titulaire d’une Licence d’Histoire de l’Université Montpellier III Paul Valery, il a également effectué une année d’échange à l’Universite de Tromsø où il a étudié notamment l’anthropologie de la Norvège du Nord. Il se concentre actuellement sur la rédaction de son mémoire se focalisant sur les pratiques païennes des habitants de la Norvège du Nord à l’époque préchrétienne.Contact: [email protected]
Mlle Marion Poilvez, doctorante en littérature médiévale islandaise à l’Université d’Islande, sous la direction de Torfi H. Tulinius, étudie le phénomène de la proscription en Islande médiévale et la figure du hors-la-loi dans les sagas islandaises.Contact: [email protected]
M. Pierre-Brice Stahl est doctorant et enseignant vacataire à l’Université de Strasbourg. Il est titulaire d’un master en sciences religieuses et en histoire. Il a étudié aux universités de Strasbourg, Édimbourg, Bamberg et Copenhague. Sa thèse porte sur le poème Vafþrúðnismál où il analyse le genre de la joute oratoire dans le Nord.Contact : [email protected]
Mme Hélène Tétrel, maître de conférences en langue et littérature médiévales à l’Université de Bretagne Occiden tale à Brest. Elle est titulaire d’un doctorat en études médiévales de l’Université de Paris IV-Sorbonne, pour lequel elle a analysé la réception norroise de la Chanson des Saxons.Contact: [email protected]
M. Torfi H. Tulinius, professeur de littérature islandaise médiévale à l’Université d’Islande et directeur du pro gramme de MA Medieval Icelandic Studies à l’Université d’Islande. Il y a également enseigné la littérature française. Il a effectué son doctorat à l’Université de Paris Sorbonne sous la direction de Régis Boyer et a conceptualisé « La Matière du Nord ».Contact: [email protected]
École pratique des Hautes Études
Section des Sciences historiques et philologiques
Direction d’études d’Histoire et philologie de la Scandinavie ancienne et médiévale
Directeur d’études : M. François-Xavier DILLMANN, correspondant de l’Institut.
Conférences de l’année 2014-2015 :
I. Recherches sur la guerre dans la Scandinavie ancienne et médiévale (suite).
II. Les sources de la bataille de Stiklestad : lecture et explication de textes.
*
Les conférences ont lieu (à partir du 21 novembre 2014) les vendredis de10h à 12h, en Sorbonne (salle D052).
*
Les inscriptions se prennent auprès du secrétariat de l’École pratique des hautes études(on consultera le site : www.ephe. sorbonne.fr <http://www.ephe.sorbonne.fr/>).
Entretien avec M. Benoît Eeckeman au sujet de la reconstitution du chariot d’Osebergpar M. François Dontaine
Valland 9Numéro 14
Pourriez-vous vous présenter ?
Je me nomme Benoît Eeckeman et je réside dans le nord de la France. Après des études d’ébénisterie / sculpture à l’école St Luc de Tournai, j’ai monté l’entreprise « L’homme du chêne » il y a maintenant 4 ans.J’ai commencé la reconstitution historique en 2003 et avec le temps j’ai pu créer un atelier pédagogique sur le thème du travail du bois. Mon entreprise présente donc une double facette, la production d’objets d’une part et la prestation de services lors de manifestations culturelles de l’autre.L’essentiel de mon métier est évidemment tourné vers l’histoire ou son inspiration bien qu’il m’arrive de participer à des projets plus contemporains. D’une certaine manière j’ai allié passion et métier ! Quels sont les objets que vous avez déjà répliqués ? J’ai fabriqué divers objets pour la période du Haut Moyen Âge (période qui nous intéresse ici) comme des jouets pour enfants, des coffres comme les modèles d’Oseberg ou Mastermyr, des instruments de musique comme les lyres de trossinger et Sutton Hoo, etcMais il y a certains projets qui m’ont tenu particulièrement à cœur:*La canne de Lund avec sa tête sculptée et son manche gravé d’entrelacs*Le siège d’Oseberg qui après une recherche plus poussée et le travail de Saving Oseberg demande quelques modifications. Une version 2.0 est en préparation et sortira bientôt. Il sera donc le fruit des dernières recherches et on parlera plus de trône que de fauteuil.
* En parlant de siège, j’ai commencé une réplique du trône (dit) de Dagobert avec l’aide du fondeur Alexandre Jeanjean et bien évidemment la conservatrice du cabinet des médailles de la BNF. Il reste encore quelques retouches et surtout la patine mais il devrait être entièrement fini pour la saison prochaine si tout va bien.
*Et enfin un des derniers à être sorti de l’atelier, le chariot d’OsebergIl est à noter que j’achète mon bois en scierie, c’est donc du bois scié et non pas fendu comme on le travaillait à la période viking (comme à d’autres). J’utilise cette « technique » de bois fendu lors de certains de mes ateliers pédagogiques afin que le public se rende compte du travail que cela représentait de réaliser une planche. Réaliser un coffre en bois fendu est un projet que je ferai dès que le temps me le permettra.
Avant de nous parler plus longuement de ce chariot, peux-tu nous en dire d’avantage sur la technique de bois
Valland 10Numéro 14
fendu ?
Cette technique consiste à fendre le bois avec des haches et des coins jusqu’à obtenir des rayons d’arbres. Ensuite on vient dresser les plats avec l’aide d’une hache particulière que l’on appelle une doloire. C’est un outil à un seul tranchant (biseau), légèrement désaxé afin de sécuriser la main. Il existe déjà sous l’Antiquité et on le retrouvera jusqu’au XIXe siècle (on l’utilise d’ailleurs toujours dans l’Est de l’Europe et probablement ailleurs). Si jamais vous visitez le port de Roskilde au Danemark, vous verrez qu’ils réalisent toujours les planches de leur bateau de cette manière.
Quelles ont été les recherches préalables pour faire la réplique du chariot d’Oseberg ?
On peut remonter l’historique de ces travaux de recherche à l’été 2008 lors de mon passage à l’archéosite de Leije au Danemark. L’archéologue du parc, Laurent Mazet, nous a ouvert les portes de sa bibliothèque et c’est là que j’ai trouvé les 4 livres des fouilles d’Oseberg avec le plan du chariot.
Une fois le projet lancé avec l’association commanditaire du chariot, « Le clan du Vestfold », j’ai contacté la conservatrice du musée des bateaux vikings d’Oslo et un rendez-vous fut fixé quelques mois plus tard (décembre 2012) dans ce musée où est toujours conservé l’original de ce chariot. J’ai pu ainsi m’entretenir avec Mme Naess et prendre toutes les photos dont j’allai avoir besoin. Elle m’a également donné les contacts de « Saving Oseberg », dont les travaux peuvent être suivis sur Facebook, ainsi que de Monsieur (pour ne pas dire maître) Aarseth Bjornson le sculpteur du musée des bateaux vikings d’Oslo. Ce dernier a d’ailleurs déjà réalisé une réplique de ce chariot qui se trouve dans le musée d’histoire d’Oslo.
S.O m’a fourni une base de données sur de vieilles photos et des recherches sur le chariot et M. Bjornson m’a surtout dit de ne pas modifier le plan du livre de fouille en m’envoyant un plan détaillé des roues et essieux qui m’ont aidé pour la compréhension du système de rotation du chariot.
Avec ces données, j’ai essayé de trouver un charron encore en vie dans ma région et les régions voisines mais sans succès.
Tout ceci combiné avec bien des discussions à droite à gauche a permis de rassembler suffisamment de matière pour aborder plus « sereinement » ce projet !
A quoi avez-vous été confronté lors de la réalisation et comment avez-vous solutionné ?
Dans ce métier on dit souvent qu’il n’y a pas de problème, que des solutions à trouver. C’est une manière de positiver et de prendre les problèmes les uns après les autres en restant serein ! Evidemment ce projet a regorgé d’embuches et de difficultés de toutes sortes qu’il serait trop long de détailler ici. En voici quelques exemples, accrochez-vous:
Les côtés du chariot sont composés de 9 planches (d’où les 9 tenons traversant la face et le dos) de chacune environ 35mm. Cependant si on assemble dans l’état, on se retrouve avec un chariot qui est loin de ressembler à un joli demi-tonneau, on a des arêtes vives qui tranchent et dénaturent l’ensemble. A l’époque, ils ont dû
Répliques de doloires utilisées au vikingeskibs museet de Rosklide
Valland 11Numéro 14
partir sur des sections beaucoup plus épaisses et affiner jusqu’à réaliser cet arrondi esthétique. Pour ma part j’ai dédoublé les largeurs des planches de côtés. Au lieu des 4 planches des côtés, j’en ai mis 8 et avec un rabot j’ai pu casser les arêtes et avoir l’arrondi souhaité.
La fourche de dessous a également été source de difficultés. Historiquement il est probable qu’ils aient utilisé une fourche naturelle spécialement coupée à cet effet comme on le voit beaucoup dans la charpenterie de marine. Il a donc fallu que je fasse un assemblage avec les 3 poutres consolidées par des chevilles.
2 autres fourches se trouvent à l’avant et à l’arrière du chariot. Elles épousent l’arrondi de la cuve et se terminent avec 4 têtes sculptées. Elles sont probablement d’un seul morceau à l’instar de la grosse du dessous. J’ai également du faire des assemblages.
Une autre difficulté fut les axes de fixation et rotation qui traversent le demi-tonneau jusqu’aux essieux. A l’arrière, il s’agit d’axes de fixation. Il « suffisait » de percer de part en part, un système de clavettes empêchant le retour.
L’avant est plus coton dans le sens où l’essieu devait être dépendant par rapport à la fourche, afin d’assurer la rotation du véhicule, et que les timons devaient aussi être dépendants par rapport à l’essieu afin d’assurer la direction (les timons étant les longs morceaux de bois à l’avant).
Un axe central traverse l’ensemble et assure la rotation. Cependant les axes qui allaient servir à la direction ne pouvaient pas tout traverser, sans quoi ils auraient fixé l’ensemble comme réalisé pour l’arrière du chariot. J’ai donc mis 4 axes au lieu de 2. Les 1ers s’arrêtent juste avant les timons, ils servent donc d’axes de fixation. Les 2 autres attachent ensemble les timons et l’essieu et sont ainsi dépendants du reste.
Je pourrais également parler des roues qui demandaient un tour à bois « hors norme » au vu de la taille des
moyeux (pièces centrales de la roue recevant les rayons). Un sous-traitant est donc intervenu et comme le temps me manquait, j’ai également fait appel à Franck Delbarre, un ébéniste de Lille, afin de réaliser l’assemblage des roues.
Mais l’important dans cette démarche d’expérimentation archéologique était de conserver les mêmes dimensions et les mêmes assemblages afin de comprendre les capacités d’un tel transport et afin de se rapprocher le plus possible du « geste » de l’époque.
Valland 12Numéro 14
Pourriez-vous nous donner quelques chiffres ? (quantité de bois, temps de travail,...)
C’est toujours difficile de donner de tels chiffres puisqu’on ne compte pas vraiment ces heures dans ce genre de projet mais j’ai estimé à environ 800 heures d’atelier pour cette réalisation. A cela on peut ajouter toutes les recherches, etc. Il a aussi fallu environ 90h pour la réalisation des roues.
Pour ce qui est du bois, il serait trop long et fastidieux de tout répertorier mais il doit y avoir entre 1000 et 1500 euros de bois pour la réalisation.
Avez-vous encore des questions sur le chariot ?
Les questions auxquelles l’expérimentation ne peut pas répondre sont plus d’ordre symbolique. Mes connaissances m’ont conduit vers certaines réponses qu’il serait bon de voir éclaircies ou complétées à la vue de notre méconnaissance actuelle des croyances et théologies anciennes.
Tout d’abord sur la symbolique du chariot à l’époque, élément psychopompe permettant, à l’instar du bateau, traineau, etc., l’accompagnement du défunt dans son dernier voyage. J’aimerais pouvoir approfondir le sujet.
Ensuite ma recherche se porte sur l’imagerie développée dans les parties sculptées du chariot.
L’homme dans les serpents semble être une référence à la légende de Gunnar dans la fosse aux serpents. Scène bien connue dans les mythes nordiques puisqu’on la retrouvera après la christianisation sur les montants sculptés de l’église d’Hylestad. Faut-il y voir, comme je le pense, une vision d’un rite initiatique, une épreuve obligatoire symbolisant le passage à l’âge adulte. A l’instar d’Hercules, héro grec de l’antiquité traversant toutes ces difficultés pour atteindre le stade suprême qui est la reconnaissance divine, Gunnar serait son équivalent pour le monde nordique.
Sur l’église norvégienne la légende de Gunnar se mêle avec celle de Siegfried. 2 noms pour une même personne ?
Valland 13Numéro 14
Comme on vient de le voir dans cette scène se développant sur l’avant du chariot (on le retrouve aussi ailleurs), le serpent tient une position centrale mais à quoi renvoie le serpent dans la mythologie germano-scandinave ?
Autres animaux tenant une position dominante dans les diverses compositions, ce sont des « monstres » apparentés aux familles des félidés et des canidés. On sait que le chat est un symbole de la déesse Freyja comme le loup est un symbole d’Odin, voire aussi le rapport entre Loki et Fenrir. Faut-il voir en ces attributs une explication à cette multitude (un affrontement de divinités)?
Dans certaines civilisations anciennes, comme la culture amérindienne, le félidé est un symbole féminin alors que le canidé est un symbole masculin. L’affrontement sur cette œuvre rappelle-elle nos différences hommes femmes ?
Une scène sur le latéral gauche nous montre un cavalier attaqué par un monstre et en face un homme le menaçant d’un couteau, une femme retenant son bras, probablement afin d’éviter que le sang ne coule.
A brûle pourpoint on y voit forcément une scène de ménage avec un cocu. Mais en prenant un peu de recul on peut très bien s’imaginer qu’il s’agit d’une scène de la vie de la défunte. Un acte qui a fait d’elle une personne
sage ou tout du moins reconnue.
On peut aussi penser à une vision plus symbolique en montrant les vertus de la féminité dans ce monde à dominante masculine (la Valhalle en étant le meilleur exemple), ou peut-être est-ce une nouvelle fois une référence à un mythe…
Autre sujet de questionnement : la présence de ces « gargouilles », ces têtes d’hommes aux 4 coins du chariot. On ne peut les considérer comme des divinités car leurs attributs en sont absents. Je pense qu’il s’agit là de la représentation des Scandinaves tel qu’ils se voyaient eux-mêmes au IXe siècle. Ce qui serait très intéressant et montrerait, si besoin est, que tous les Scandinaves n’étaient pas tous chevelus et barbus mais que certains avaient les cheveux courts et la moustache (voire les pattes, la classe !)
A moins qu’il ne s’agisse là d’un symbolisme qui me dépasse…
Un dossier est en préparation sur le chariot et cette partie est trop subjective à mon goût. Peut-être pouvez-vous y mettre un avis afin d’éclairer les zones d’ombre éventuelles.
Avez-vous procédé à des tests de fonctionnement et quels en sont les résultats ?
C’est effectivement la suite du projet. La finalité serait qu’il soit tiré par 2 chevaux « fjord ». Dans ce sens Frédéric Hanocque avait été contacté par Josquin Flusher, président de l’association du « Clan du Vestfold ». Un premier test a ainsi pu être effectué à l’archéosite de Marles lors des journées vikings de juin dernier.
Après avoir placé le joug, maintenant les 2 timons ensemble, le chariot a pu être facilement déplacé par 2
Valland 14Numéro 14
hommes. Le virage qu’il a pris dépassait de loin les suppositions de la conservatrice du musée d’Oslo assez sceptique à ce propos. Dans la foulée, on a harnaché un cheval de la ferme Gröning sur un côté du chariot avec un homme de l’autre côté pour contre balancer les forces car c’est assez important, j’y reviendrai. Cet attelage a avancé sur une vingtaine de mètres en ligne droite.
Une 2e expérimentation a été testée le mois dernier à la plate taille en Belgique. Comme pour le 1er volée de la précédente, l’attelage se composait de 2 hommes tirant le chariot. Il a ainsi parcouru plus de 200 m en terrain accidenté, manœuvrant aisément entre les piquets, coffres et divers obstacles.
Une 3e expérimentation fut faite à Valenciennes lors de la clôture de l’exposition sur les vikings au musée des beaux arts. Le chariot a été tracté, toujours par 2 hommes, sur environ 1 km de bitume.
Chaque expérience était positive et beaucoup d’autres doivent être lancées avant de bien comprendre les possibilités et les limites de ce véhicule.
Ces essais ont mis en lumière l’importance du joug car un joug mal adapté empêche la bonne manœuvrabilité laissant trop d’aisance pour l’essieu qui peut mal réagir.
Comme précisé plus haut, les virages se font sans difficulté, l’essieu réagit bien quand les timons exercent une pression ensemble dans un sens ou l’autre.
La fourche de dessous dépasse entre les timons, limitant ainsi l’amplitude possible en virage. Cependant dans certaines manœuvres elle ne suffit pas et les roues peuvent toucher les parties sculptées des timons. C’est quelque chose qu’il faudra voir en détail afin d’éviter les usures.
Mais une chose est également à prendre en compte : ce qui est réalisable avec des hommes, ne le sera pas forcément avec des chevaux. Le seul essai avec un cheval nous a montré que l’harnachement, avec traction au poitrail proposé, convenait et que l’élévation des timons, afin que le joug soit à hauteur du dorsal de l’animal, se
Valland 15Numéro 14
faisait bien. Egalement important, les pattes arrière du cheval n’ont pas touché les roues.
D’un point de vue esthétique, la présentation des chevaux cachera certains éléments des sculptures en comparaison avec des hommes, mais l’allure de l’ensemble n’est évidemment pas la même.
Le choix d’un harnachement de chevaux s’est également fait par rapport au morceau de tapisserie retrouvé dans la tombe d’Oseberg et qui montre, dans ce qui semble être une procession, un attelage de chariot tiré par des chevaux.
Sous le vent nordique et l’aurore boréale :A propos du Master en études médiévales islandaises
par Li Tang
Valland 16Numéro 14
Faire un Master sur cette île boréale est une expérience originale : l’Islande est réputée pour sa littérature narrative, mystérieuse de par sa langue, attirante pour sa musique et belle avec ses paysages naturels. L’expérience en est d’autant plus enrichissante si ce Master porte sur sa langue et littérature. Nous ne pouvons peut-être pas composer la même musique que les scaldes, mais cela n’empêche que nous pouvons apprécier ses paysages merveilleux. Je me rappelle la parole d’une professeur quand je l’ai croisée à Paris avant mon départ : « Dès que vous serez arrivé dans ce pays, vous découvrirez sa beauté et comprendrez sa culture. »
Vivre dans un pays afin de l’étudier s’avère être un bon choix. En effet, il y a deux Masters dans ce programme à l’université d’Islande : Medieval Icelandic Studies et Viking and Medieval Norse Studies. Les étudiants font le cursus universitaire et choisissent leur directeur avec une grande liberté à la fin des études pour la rédaction du mémoire. Ils peuvent opter pour les professeurs dans notre programme spécialisés dans l’archéologie, l’histoire, la littérature, la mythologie, la paléographie, la philologie, la religion, etc. De surcroît, chaque vendredi une chercheuse/un chercheur présente son centre d’intérêt pendant la pause-café (kaffitími), et nous pouvons également faire notre mémoire du Master sous sa direction.
Cette année, la promotion de ces deux Masters comprend trente-cinq étudiants venus d’Amérique, d’Asie, d’Europe et d’Océanie. Nous apprenons pourtant une même langue : le vieil islandais. Le cours consacré à cette langue ancienne commence par les paradigmes et se dirige peu à peu vers l’étude du texte. Pour « célébrer » notre connaissance de ces mots fabuleux, notre professeur, M. Haralður Bernharðsson, débute chaque séance par un contrôle. Il est nécessaire de savoir que l’étude de cette langue ancienne est la base de notre recherche future: certains d’entre nous copient ces paradigmes sur le papier pour les maîtriser, d’autres préfèrent les apprendre d’une façon mélodique – ils les chantent comme si l’âme de l’ancien poète chanteur était réveillée et que cette langue n’avait jamais cessé de vivre. Le charme du vieil islandais est sûr. Après avoir côtoyé ces paradigmes pendant un mois et demi, nous sommes capables de lire un chapitre d’Edda de Snorri Sturluson et de déchiffrer les mots de l’islandais moderne en les triant selon leurs caractéristiques. L’héritage du vieil islandais est la passerelle entre cette langue et l’islandais moderne.
La lecture se fait pourtant aussi dans d’autres langues. Le cours de M. Torfi H. Tulinius nous amène dans le monde littéraire : l’Edda, les sagas, la poésie scaldique, etc. Nous devons de notre côté lire à l’avance certains ouvrages ou articles (dont la plupart sont écrits ou traduits en anglais) que le professeur indique sur Ugla, le site internet de l’université, pour mieux assimiler son enseignement. De la mythologie nordique aux sagas royales (jusqu’à la mi-octobre où notre semaine de la lecture commence) en passant par la littérature encyclopédique, il nous initie à l’imposant corpus du trésor scandinave.
La recherche interdisciplinaire et le contexte culturel différent des jeunes médiévistes alimentent chaque mercredi des discussions intéressantes dans le cours d’histoire de M. Viðar Pálsson. Nous avons discuté le terme « Viking Age » durant la première séance. Un étudiant italien l’a attaqué violemment, disant que ce terme a davantage un intérêt commercial qu’un intérêt pour la recherche. Après qu’un Américain ait justifié le fait que ce terme est généralement accepté en anglais pour désigner une période allant des environs de 793 à 1066 et faciliter ainsi la recherche ; un Allemand l’a défendu déclarant : « L’utilisation de ce terme peut attirer plus de lecteurs et sûrement plus d’argent. » L’ardeur italienne ne s’est pas éteinte pour autant : « Doit-on étudier pour l’argent ? » « Non, » répondit notre ami allemand, « mais on a besoin d’argent pour étudier. » Je considère cette conversation comme une rencontre du romantisme italien avec le pragmatisme allemand.
Le cursus ne se borne pas à l’étude nordique. Deux autres cours peuvent aussi être choisis pour ce semestre : le cours sur Chrétien de Troyes et son héritage qui réveille la légende arthurienne, et celui sur la psychanalyse qui offre une autre lecture des sagas et des romans modernes.
Valland 17Numéro 14
N’oublions pas des discours donnés par des savants qui éclairent les jeunes esprits. M. Jesse Byock nous a parlé de son projet archéologique de Mosfell. Certaines conférences sont organisées dans le cadre du programme « Landnám Íslands » au Centre d’études médiévales (« Miðaldastofa Háskóla Íslands »). Cette année, M. Michel Zink, maître incontournable de la littérature médiévale française et professeur au Collège de France, est aussi invité à l’Université d’Islande pour donner deux conférences. Sa première conférence, en anglais, portait sur Érec et Énide et s’intitulait : « Sex and Sensuality » et se déroula dans la salle de conférence de l’Aðalbygging, le bâtiment principal de l’université d’Islande. Il a présenté ce premier roman de Chrétien de Troyes au grand public et discuté le sens du roman sans dédaigner de détailler les phrases magnifiques du trouvère champenois. Pour sa deuxième conférence sur Chrétien de Troyes, cette fois-ci en français, il est venu dans notre classe. Celle-ci, interprétée fidèlement par M. Torfi H. Tulinius en anglais, portait sur les manuscrits des troubadours. La corrélation entre la poésie occitane et la prose (vida et razo) dans ces manuscrits mit en valeur la lecture des troubadours faite par les scribes occitans postérieurs et fit naître une autre forme littéraire dans leurs manuscrits.
La vie en Master est aussi composée d’autres activités. Au début du semestre, les trois professeurs et nous-mêmes avons fait une première excursion et visité le parc national de Þingvellir et le site de Reykholt. Cette visite culturelle est liée à la naissance de cette nation et au personnage très important de l’histoire de l’Islande qu’est Snorri Sturluson. Trois groupes étudiants sont créés pour étudier l’ancien anglais, l’écriture runique et le latin. Dans un café, Stofan, plusieurs de nos étudiants se rassemblent et révisent leur vieil islandais ou lisent les livres tout en échangeant leurs opinions. Leur discussion continue parfois à la piscine, à la manière islandaise...
De Paris à Reykjavik, de l’étude du roman à la recherche sur les sagas, je me suis rendu compte qu’il reste beaucoup à faire pour une étude comparative de ces deux littératures. Pour ma future thèse j’ai eu des contacts ici ou là avec des professeurs excellents tels que Mmes Ásdís Rosa Magnúsdóttir et Hélène Tétrel, et MM. François-Xavier Dillmann et Torfi H. Tulinius. Dans le domaine de la recherche norroise, M. Viðar Pálsson souligne la qualité de ces professeurs : « Nous nous aidons réciproquement, car nous savons que nous ne sommes pas nombreux dans cette recherche. » Je pense que c’est aussi le but de nos deux Masters à l’université d’Islande.
AggersborgThe Viking-Age Settlement & Fortress20% discount plus free postage for lecturers & students
Edited by Else Roesdahl, Søren Michael Sindbæk, Anne Pedersen, David M. Wilson
Aggersborg is the largest of the Danish circular fortresses of the Viking Age. Built by the king, Harald Bluetooth, in the second half of the tenth century, it was strategically placed on the shore of the Limfjord. Together with other Danish fortifications it was intended to play a major role in the politics of northern Europe.
The fortress overlaid an extensive Viking-Age rural settlement which was destroyed when the fortress was constructed. The well-preserved remains of buildings and the many artefacts excavated here provided a unique view of the physical and social structure of such a settlement and of its material culture.
The book gives a comprehensive account of the major excavations by the National Museum of Denmark of both the fortress and the rural settlement and places their structures and the objects found within the wider context of the Viking Age. It also sheds important new light on Denmark’s history at a time of major cultural and political challenges.
Table of contentsAggersborg’s location and historyTerminology and general plans. Excavation. DocumentationThe Viking-Age settlementThe fortressThe findsZoological findsThe purpose of the fortress
HB 9788788415872 £47.00 May 2014 475 pagesAarhus University Press
Click on the above link or image for a full book descriptionenter the code GZACAD14 at checkout for 20% discount from RRP plus free post-age.