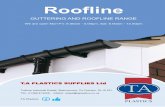Ta P Bienne
-
Upload
lamaisondilona -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Ta P Bienne
477
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer. Actes du xxixe colloque international de l’AFEAF ; Bienne, 5-8 mai 2005, volume 2. Barral Ph., Daubigney A., Dunning C., Kaenel G., Roulière-Lambert M.-J. (éds.), Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2007, 477-492 (Annales Littéraires ; Série « Environnement, sociétés et archéologie »)
Les dépôts à caractère cuLtueL en miLieux humides et dans Les cavités natureLLes du centre-Ouest de La France à L’âge du Fer
sébastien Ducongé*, JOsé gomez De Soto**
Résumé
Les découvertes de l’âge du Fer en milieux humides et dans les cavités naturelles sont assez nombreuses dans le centre-ouest de la France, mais souvent assez mal documentées. Quelques-uns de ces sites présentent des assemblages de mobiliers ou des modes de dépôt particuliers pour lesquels une fonction cultuelle est supposée. Cas exceptionnel par l’importance des dépôts et la qualité de l’information, la grotte des Perrats à Agris (Charente) est présentée de façon plus complète.
Abstract
There are many iron Age discoveries from wetlands and natural cavities in west-central France, but they are often rather poorly documented. At some of these sites, particular assemblages of objects or ways of depositing them are found, for which a religious function can be supposed. One exceptional case in terms of the importance of the deposits it contained and the quality of informa-tion available about them is the Perrats cave at Agris (Charente), which is presented in more detail.
Dans le centre-ouest de la France, les découvertes archéologiques de l’âge du Fer en milieux humi-des tels que les sources, les marécages ou les cours d’eau sont moins fréquentes que celles effectuées dans les nombreuses cavités naturelles. Mais quel que soit le milieu, nombre de ces découvertes sont anciennes ou fort mal documentées. Ainsi, au XIXe et au début du XXe siècle, de nombreuses cavités de l’Angoumois et du Périgord ont été vidées de leurs sédiments par les premiers archéologues dans le but d’atteindre les niveaux du Paléolithique moyen et supérieur, rejetant sans ménagements les restes des occupations postérieures et faisant ainsi dispa-
raître toute information. De plus, il s’agit la plupart du temps de découvertes fortuites, de ramassages de surface, n’ayant que très rarement donné lieu à des fouilles ou au moins des contrôles archéologi-ques.Par conséquent, la fonction de ces sites à l’âge du Fer est difficile à déterminer. La nature de l’utili-sation des cavités naturelles fut diverse : habitat ou annexe d’habitat (cave, réserve, entrepôt…), habi-tat-refuge et lieu de sépulture sont les modalités les plus courantes, ou plutôt les plus couramment admises. La réalité de lieux de culte ou de dépôts d’offrandes est moins aisément perçue ou recon-
IntroductIon
*UMR 6566 « Civilisations atlantiques et Archéosciences », Université de Rennes 1, 1 Lot. La Faye, F-16600 [email protected]**UMR 6566 « Civilisations atlantiques et Archéosciences », Université de Rennes 1 ; HeRMA « Hellénisation et Romanisation des Mondes Antiques », Université de Poitiers, 52 rue du Lizier, F-16000 Angoulême ; [email protected]
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer
478
nue. L’étude récente des poteries du Second âge du Fer de la grotte des Perrats à Agris (Ducongé, 2003), puis de l’ensemble du mobilier (Ducongé et
Gomez de Soto, à paraître) éclaire d’un jour nou-veau les pratiques cultuelles dans cette région.
1. InventaIre des sItes
Dans le cadre du sujet qui nous intéresse ici, nous n’avons retenu que les sites dont la fonction cultuelle semble plausible, probable ou, dans le cas de la grotte d’Agris, indiscutable.
1.1. Les milieux humides
1.1.1. Ouzilly-Vignolles (Vienne)Le chaudron d’Ouzilly-Vignolles, probablement du Premier âge du Fer, a été découvert fortuite-ment dans un milieu de marais. La vérification sur le terrain a montré que cette pièce se trouvait isolée de tout contexte conservé. Ce récipient est constitué de feuilles de bronze rivetées, et pouvait être suspendu au moyen de deux anses en anneau mobiles à l’intérieur d’une attache côtelée mon-tée sur le rebord cerclé de fer (Pautreau et Soyer, 2001-2002).
1.1.2. Le dépôt de la Fontaine de Lucineau à Saint-Jouin-de-Marne (Deux-Sèvres)Découvert dans les années 1850, ce dépôt est consti-tué uniquement d’objets de parure : un torque à tampons, une série de neuf bracelets et anneaux de cheville, dont certains à oves creux et un à qua-tre anneaux sur le jonc, et une applique circulaire (phalère ?), tous en bronze et complets si on en croit les dessins de l’époque (de La Tourette, 1862). Cette réunion de parures, comparable à certains dépôts en pleine terre de la même région, comme celui de Rossay (Tauvel, 1974), date du Ha D. Il a sou-vent été rapproché des ensembles launaciens du Languedoc (Tauvel, 1974 ; Cordier, 1978 a ; Gomez de Soto et Milcent, 2000).
1.1.3. Les armes dans les rivièresPoursuivant une tradition initiée au Bronze final, un nombre appréciable d’armes a été immergé dans les cours d’eau au cours des âges du Fer : épées hallstattiennes dans la Loire à Basse-Indre, Loire-Atlantique (Verger, 1999 ; Santrot et al., 1999a) ou dans la Dordogne à Port-Sainte-Foy, (Chevillot, 1989) ; bouterolle de fourreau d’épée hallstattienne dans la Loire entre Nantes et Paimbœuf (Santrot et al., 1999 b) ; épée à antennes dans la Loire à Donges, Loire-Atlantique (Verger, 1999) ; épées laténien-nes dans la Loire dans la région nantaise (Lejars, 1999 ; Gomez de Soto et al., à paraître) et touran-gelle (Bastien, 2005) et dans la Boutonne à Torxé, Charente-Maritime (Gomez de Soto et al., à paraî-tre) ; pointe de lance laténienne dans la Loire à
Haute-Goulaine (Santrot et al., 1999 a). Doivent par-ticulièrement retenir l’attention quelques armes de types peu communs : les épées à poignées à sphè-res retirées de la Charente au pont de Juac à Saint-Simon, Charente (Gendron et al., 1986) et de la Loire à Haute-Goulaine, Loire-Atlantique (Rapin, 1999), l’épée à poignée anthropomorphe de Saint-André-de-Lidon, Charente-Maritime, présumée venir de la Seudre ou, plus vraisemblablement – selon l’enquête de Guilhem Landreau, que nous remer-cions pour cette information – du marais proche. Quoi qu’il en soit, la patine et l’état de conservation de cette arme, examinée avant sa restauration, ne laissent aucun doute quant à sa provenance d’un milieu humide (Duval et al., 1986).
1.2. Les cavités naturelles
1.2.1. La grotte de La Roche Noire à Mérigny (indre)Fouillée dans les années cinquante, la grotte de la Roche Noire se présente comme un réseau karsti-que dans lequel coule une rivière souterraine, bras de l’Anglin, qui a malheureusement remanié les dépôts (Cordier, 1978 b ; Lorenz et al., 1984).Ces derniers étaient composés de restes humains, ceux de douze adultes et sept enfants au mini-mum, de restes de faune domestique (bovins, por-cins, ovicaprinés, canidés), d’au moins vingt-deux poteries, parfois complètes, dont des formes pro-ches des types à peinture graphitée du Ha D/La Tène A1, de deux anneaux en bronze, d’un demi-bracelet en lignite, d’une fusaïole, d’une défense de sanglier, d’un scaphoïde de bœuf et d’un coquilla-ge méditerranéen, tous trois perforés. Il faut enco-re ajouter une pointe de lance, un couteau en fer associé à un bloc en calcaire poli (aiguisoir ?) et un amas de métal oxydé regroupant une petite sphère creuse en bronze à la fonction indéterminée, deux fragments de bracelets en fer, deux fibules en fer et deux fibules à faux ressort sur le pied en bronze.Le mobilier est homogène et les fibules à faux res-sort sur le pied assurent une datation de la fin des dépôts au tout début de La Tène.La grotte fut présumée sépulcrale lors de sa pré-sentation princeps (Cordier, 1978 b), hypothèse nuancée suite à l’étude anthropologique des restes humains : « Il ne s’agirait pas […] de vraies sépul-tures mais d’un dépôt funéraire… » (Lorenz et al., 1984, p. 123). La composition du mobilier évoque davantage des dépôts de nature religieuse associés à des restes humains que de véritables sépultures.
Ducongé S. et Gomez de Soto J. - Les dépôts à caractère cultuel en milieux humides et dans les cavités naturelles…
479
1.2.2. La grotte de Rouffignac (Dordogne)Cette grotte, célèbre pour ses gravures du Paléo-lithique, a connu diverses fréquentations, notam-ment à l’âge du Bronze final. Les supposées inci-nérations antérieures à La Tène, disséminées dans une très grande partie du réseau, demanderaient vérification (Barrière, 1974).La période de La Tène est connue principalement dans les toutes premières galeries proches de l’en-trée actuelle de la cavité. Malheureusement, les niveaux dans lesquels se trouve le mobilier laté-nien ont été remaniés anciennement par un lac souterrain périodique. À cela il faut ajouter que ces dépôts, mélangés à du mobilier de l’âge du Bronze et gallo-romain, n’ont été fouillés que par trois son-dages ne couvrant que quatre mètres carrés seule-ment. Le reste provient de ramassages de surface ou bien est issu de terriers.Ont ainsi été retrouvés : des ossements humains en quantité importante (treize individus au moins, hommes, femmes, enfants), de la céramique de l’âge du Bronze et laténienne, des ossements de faune (suidés, dont un demi-crâne de porcin scié – le dépôt d’une demi-tête de porc est une pratique connue dans les sépultures même modestes, où il est souvent associé à un couteau, mais aussi dans les lieux cultuels –, moutons, bœufs, cervidés), quel-ques tessons d’amphores, un pied de vase en verre bleu, trois fragments de plaquettes en fer, une poin-te d’épieu en bois entièrement calcinée, une fusaïole faite dans un oursin fossile, cette dernière gallo-romaine ou médiévale… C’est dans la même zone, lors d’aménagements pour les visites touristiques, qu’un ensemble d’ob-jets fut découvert. Il comprenait un fragment d’une perle en verre bleu ocellé de blanc, une perle plate en stéatite, un objet de cuivre indéterminé, deux anneaux de bronze et onze monnaies gauloises en argent dont certains exemplaires (monstre hybride homme-sanglier au revers) sont datés de la premiè-re moitié du Ier siècle av. J.-C. (Boudet, 1987). Le site a pu être fréquenté durant La Tène C2 et La Tène D1.Sans même être discutée, l’hypothèse d’une nécro-pole à inhumations fut retenue lors de la publica-tion des fouilles (Barrière, 1974). Si les ossements humains sont vraisemblablement de La Tène, la désorganisation totale des dépôts et la faible sur-face fouillée doivent tempérer les conclusions hâti-ves. De plus, la présence d’un trésor monétaire au milieu de ces supposées sépultures n’est pas sans poser question.
1.2.3. La grotte de La Fontanguillère à Rouffignac-de-Sigoulès (Dordogne)Cette cavité, connue de longue date, a subi de nom-breuses prospections et fouilles par des acteurs différents durant la première moitié du XXe siècle,
entraînant la dispersion et la disparition d’une très grande partie du mobilier (Chevillot, 2001). Outre l’abondant mobilier du Bronze final présumé associé à des ossements humains, il faut rappeler la présence de trois bracelets ouverts en bronze, ornés d’incisions, du Premier âge du Fer. Ces bra-celets avaient été déposés dans des vases « en sala-dier » (jattes ?), dont la stricte association avec un crâne humain n’est pas assurée puisque, là aussi, le mobilier a subi des remaniements importants à cause du cours d’eau souterrain (Coffyn, 1966).Un petit gobelet presque complet, daté de La Tène D, a également été récupéré dans le cours du ruisseau (Chevillot, 2001).
1.2.4. La grotte du Quéroy à Chazelles (Charente)Connu de longue date, le site fut pillé durant de longues années avant qu’une fouille de sauvetage ne soit entreprise par l’un de nous (Gomez de Soto, 1978). La grotte du Quéroy fut fréquentée à au moins deux reprises au cours de l’âge du Fer.Son utilisation durant le Ha D3/La Tène A1 reste ambiguë, et put être en partie funéraire (restes humains incinérés, mais dont l’association avec les artefacts n’est que probable). Le mobilier de cette période est composé de plusieurs céramiques com-munes, dont un vase situliforme, et de céramiques graphitées, d’un anneau en bronze, de plusieurs armilles en bronze dont une complète, d’un frag-ment de chaînette en bronze, de deux fibules en bronze d’un modèle bien représenté dans le Sud-Ouest et de deux autres, une en bronze et une en fer, de modèles du début de La Tène A, et d’une pointe de javelot en fer se rapprochant de modèles également du Sud-Ouest français et de la pénin-sule ibérique.Durant La Tène, l’ouverture du site était déjà très largement colmatée, rendant l’accessibilité de la grotte particulièrement malaisée. La fréquentation des lieux semble avoir été sporadique et peu encli-ne à laisser des vestiges : au moins quatre vases, dont un possible vase balustre à enduction rouge, à rapprocher des modèles champenois, et un petit gobelet (à boire ?), un marteau et une serpette en fer (Gomez de Soto, 2006). On peut difficilement reconnaître là un habitat, même temporaire.
1.2.5. La grotte de Rancogne (Charente)Dans la publication monographique consacrée à l’âge du Bronze de la grotte de Rancogne (Gruet et al., 1997), les informations concernant les traces d’occupations de l’âge du Fer sont des plus succinc-tes. Outre la céramique laténienne et un fond d’am-phore, furent recueillis une fibule de La Tène D, des bracelets en fer et une pointe de lance, ainsi que des éléments de fer non identifiables, même après radiographie. Une pièce tubulaire en bronze
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer
480
enserrant une barre de fer, qui pourrait éventuel-lement provenir d’un char, n’est pas mentionnée dans la documentation disponible. À diverses époques et lors de la fouille conduite de 1961 à 1970 par C. Burnez puis par M. Gruet, des ossements humains furent recueillis, notamment dans les niveaux contenant des objets de fer, mais aucune organisation des dépôts n’a pu être recon-nue.Il est difficile de se prononcer sur la destination des fréquentations de la grotte de Rancogne à l’âge du Fer, comme il fut impossible de proposer une fonction certaine pour les niveaux même en place de l’âge du Bronze final par les auteurs de la monographie, balançant entre habitat-refuge et lieu cultuel.
1.2.6. L’aven du Trou de la Coupe à Touvre (Charente)Partiellement fouillé par l’un d’entre nous en 1973 dans des conditions très difficiles, l’aven du Trou de la Coupe contenait de nombreux ossements humains, ceux d’au moins huit adultes, dont sept seraient masculins, et quatre sujets immatures (Germain, 2002). Deux vases de La Tène C ou D avaient, semble-t-il, été déposés sur une corniche, un bracelet de fer atypique fut recueilli à l’aplomb de celle-ci.Seuls les ossements humains adultes portent, entre autres, des traces de stries et de fractures. Ces der-nières sont les plus nombreuses. Elles se rencon-trent sur six mandibules, cinq fémurs, deux tibias, quatre fibulas et sont le résultat de coups portés sur os frais par un objet contondant tandis qu’un objet tranchant a été utilisé sur un atlas et deux clavicu-les, le tout vraisemblablement réalisé post-mortem. La décollation de l’un des individus paraît proba-ble. Les stries de découpe, témoins de la décarnisa-tion, sont parfois présentes sur des parties anato-miques difficiles d’accès (sacrum, face interne près de la tête des côtes). Toutes les observations font penser à une action volontaire de désarticulation et de division des corps en plusieurs parties.Les restes de faune découverts (suidés et chevaux entre autres), mélangés aux ossements humains, portent également des stries de découpe.Le traitement des corps observé dans l’aven du Trou de la Coupe est proche de celui rencontré dans la grotte du Trou de l’Ambre à Eprave, en Belgique (Thiol, 1998 a et b). L’hypothèse d’un mas-sacre écartée, il faut plus sûrement voir dans ces deux sites des pratiques cultuelles non funéraires peut-être liées à des sacrifices.
1.2.7. La grotte des Perrats à Agris (Charente)Fouillée de 1981 à 1994 par l’un d’entre nous (Gomez de Soto et Boulestin, 1996) avant de nou-velles recherches dirigées par B. Boulestin depuis
2002, la grotte des Perrats a connu la célébrité dès sa découverte, grâce à la présence en son sein, d’un luxueux casque d’apparat celtique, du IVe siècle av. J.-C. Les études récentes des mobiliers, de la céra-mique en particulier, avec plus de six mille tessons (Ducongé, 2003), permettent aujourd’hui d’appré-hender de façon objective la nature des différentes occupations de la grotte des Perrats au cours de La Tène (Ducongé et Gomez de Soto, à paraître).Largement ouverte vers l’extérieur par un grand porche, la grotte des Perrats se présente comme une vaste salle oblongue d’où partent quelques galeries. Cette salle fut le lieu principal de tou-tes les fréquentations, du Mésolithique au Moyen Âge. Aujourd’hui, trois phases d’occupation sont connues pour l’âge du Fer. Ne seront présentés ici que les éléments pour lesquels l’appartenance à l’âge du Fer est certaine ou presque.
Phase I (Fig. 1)Après la dernière fréquentation du site au Bronze final IIIb, la première occupation de la grotte à l’âge du Fer qui nous soit connue date de La Tène B. Lorsque les hommes y pénétrèrent alors, les derniers artéfacts de l’âge du Bronze n’étaient pas totalement recouverts par les sédiments.De cette première utilisation des lieux, le mobilier métallique qui nous est parvenu comprend, outre le casque : une fibule en bronze du type de Dux, deux fibules en fer incomplètes non attribuables à un type précis, un demi-anneau bivalve en tôle de bronze et un objet pointu en fer avec des restes du bois qui devait former le manche.Les formes reconstituables des poteries présen-tent principalement des écuelles carénées à col sub-cylindrique, dont deux à enduction rouge, que l’on rencontre en Centre-Ouest au moins depuis le début du IVe siècle av. J.-C. et qui connaissent leur apogée à la fin de La Tène B1 et à La Tène B2 (Gomez de Soto et al., à paraître). On rencontre également des écuelles tronconiques à bord droit, un petit et un grand ovoïde décorés au lissoir, un autre vase, à pâte claire, qui est à rapprocher des vases balustres champenois par la forme, décoré de motifs peut-être floraux réalisés au lissoir, plus quelques autres formes. À l’exception des écuelles à bord droit et de quelques autres fragments, tous ces vases sont de facture très soignée. La finesse de certaines parois est parfois surprenante, notam-ment pour le grand ovoïde. Les tessons de poteries se trouvent principalement dans la zone 1, mais de façon assez diffuse, et beaucoup plus concentrée au pied de la paroi rocheuse nord dans la zone 2.Bien qu’à peu près aucun élément du casque n’ait été retrouvé en place, on est en droit de supposer qu’il a été abandonné durant cette première phase
Ducongé S. et Gomez de Soto J. - Les dépôts à caractère cultuel en milieux humides et dans les cavités naturelles…
481
Timbre
Autres éléments
Zone supposée du dépôt originel
1
1
2
2
3
4
5
3
4
5
Four à pierres chauffantes, probablement de la phase I
4114
2106
2107
0 5
4225
1115
2101
2102
2105
4103
4401
2104
Surface entièrement lissée
Lissé
Enduction rouge
1117
Mobilier métallique
Fig. 1 - Grotte des Perrats. Plan synthétique et échantillon de vases sûrs ou probables de la phase I : La Tène B.
D
EFGH
IJKL
CBAAABBCC
121314151617181920212223
Z1 Z2 Z3 Z4
4 3 2 1 '1 '2
567891011
ZONE 6
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 5
ZONE 7
1-5
6-15
16-30
Nombre de tessons par m² :
DD
0 10 m
Limites de zone
Limites de fouille en 1994
N
Fig. 1 : Grotte des Perrats. Plan synthétique et échantillon de vases sûrs ou probables de la phase i : La Tène B.
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer
482
puisque le mobilier découvert coïncide avec sa date de fabrication et probablement d’utilisation. La concentration de la plupart des éléments du casque dans un espace de moins de sept mètres carrés semble nous confirmer la zone d’enfouisse-ment primitive suggérée par les deux fragments qui paraissent trouvés in situ, après le débouché d’une galerie et sensiblement au milieu de la gran-de salle, endroit qui ne fut sûrement pas choisi au hasard. Rappelons également que, préalablement à son dépôt, le casque fut démonté et les éléments déposés dans le timbre, qui lui-même porte la mar-que profonde d’un coup porté par un objet conton-dant.Le seul aménagement réalisé est un four à pierres chauffantes que sa position stratigraphique et la présence de quelques pieds annulaires dans son comblement permettent d’attribuer à cette premiè-re phase, mais sans certitude.Comme il a déjà été dit par ailleurs (entre autres, Gomez de Soto et Verger, 1999), aucune sépulture à inhumation ou incinération n’a été découverte dans les niveaux laténiens du site, excluant des dépôts liés à une tombe. De plus, même dans les tombes connues les plus riches de cette époque, quand celles-ci contiennent des casques, ce sont toujours des modèles simples, en bronze ou en fer.Il paraît difficile de reconnaître ici un quelconque habitat, même temporaire, qui aurait dû laisser des traces d’aménagements plus importantes (fosses dépotoirs, trous de poteaux…).En revanche, les indices en faveur d’un lieu à vocation cultuelle paraissent plus nombreux. La présence du casque d’abord, dont la paragnathide conservée présente un serpent cornu, monstre bien connu, que l’on retrouve entre autres, brandi par le dieu Cernunos sur le chaudron de Gundestrup. Le fait, ensuite, que le casque ait été démonté avant son dépôt, témoin de la pratique du bris rituel des objets consacrés dont nous aurons l’occasion de reparler plus loin. La présence d’or sur le casque est aussi un élément important puisqu’on ne retrouve des objets en or laténiens que dans des dépôts hors des nécropoles et des habitats dans le quart Sud-Ouest de la France (Gomez de Soto, 1999) et que, comme le disent les textes antiques, les dieux gaulois appréciaient les offrandes d’or (Brunaux, 2000). Le reste du mobilier métallique n’apporte pas beaucoup d’éléments si ce n’est le demi-anneau bivalve en tôle de bronze, moitié d’un anneau de suspension d’épée, objets auxquels les dernières découvertes ajoutent aussi une fonction symboli-que (amulette ?) (Lejars et al., 2001). Quant à la céra-mique, la qualité des poteries et le choix manifeste pour ce que l’on appelle communément la vaisselle de présentation, donnent de ce corpus une image
atypique, différente de ce que l’on rencontre sur les quelques habitats connus de la même époque. Les écuelles ont pu contenir des offrandes alimentaires qui n’ont malheureusement laissé aucune trace, ou être utilisés pour la consommation ritualisée d’ali-ments ou de boissons. Les restes de faune de cette phase sont rares et inexploitables.
Phase II (Fig. 2)C’est l’étude céramique qui a permis de dégager cette deuxième phase qui n’avait pas été mise en évidence auparavant, sinon par la stratigraphie, et qui pourrait dater de La Tène C1. Elle n’a été prati-quement reconnue que dans la zone 1 de la grande salle, à peu près sur le même espace que pour la phase I.Le mobilier qui lui est associé est quantitative-ment faible. Le mobilier métallique se compose d’un rasoir, d’une pointe de flèche ou de javeline et d’un possible fragment de bouterolle de fourreau d’épée, tous en fer. Ces trois objets sont regroupés sur un petit espace.La céramique ne présente aucune forme archéo-logiquement complète. Les formes sont variées et hormis les deux écuelles à profil en S, le reste des vases est de facture grossière et peu soignée, en contraste avec ceux de la phase précédente et de la phase suivante. On notera la plus grande concen-tration des tessons près de la paroi sud.La faune (107 restes déterminés) se compose à un peu plus de 92 % de restes d’animaux domestiques (porc, bœuf, caprinés, cheval et chien) et à un peu plus de 7 % de restes de faune sauvage (cerf, che-vreuil, sanglier). Mais on ne peut exclure la pré-sence de restes des occupations antérieures de l’âge du Bronze (Germinet, in : Ducongé et Gomez de Soto, à paraître).
Quant à la nature de l’utilisation de la grotte durant cette deuxième phase, il est difficile de se pronon-cer. Certes la présence d’un rasoir, objet retrouvé d’habitude dans les sépultures masculines, associé à une arme de jet et à un éventuel fourreau d’épée n’est pas sans poser quelques questions. La céra-mique ne nous est ici d’aucune aide et aucun amé-nagement n’est connu pour cette phase. La faune sauvage présente un taux inhabituel pour l’âge du Fer. Une éventuelle fréquentation des lieux comme petit refuge temporaire ou pour une activité occa-sionnelle par un groupe très restreint n’est pas à exclure.
Phase III (Fig. 3)Lors de la troisième phase, que nous datons princi-palement de La Tène C2, avec quelques vases pou-vant appartenir à La Tène D1, la grotte est l’objet
Ducongé S. et Gomez de Soto J. - Les dépôts à caractère cultuel en milieux humides et dans les cavités naturelles…
483
D E F G H IJ K L
CBAAABB
CC
1213
1415
1617
1819
2021
2223
Z1
Z2
Z3
Z4
43
21
'1'2
010
m
56
78
910
11
ZON
E 6
ZON
E 1
ZON
E 2
ZON
E 5
ZON
E 7
Lim
ites
de
zon
e
Lim
ites
de
fou
ille
en 1
994
Fig.
2 -
Gro
tte
des
Per
rats
. Pla
n s
ynth
étiq
ue
et é
chan
tillo
n d
e va
ses
sûrs
ou
pro
bab
les
de
la p
has
e II
: La
Tèn
e C
1 ?
1-5
6-1
5
16-3
0
31-6
0
61-1
00
No
mb
re d
e te
sso
ns
par
m²
:
N
1
2
12
Mo
bili
er m
étal
liqu
e
2217
2216
4132
4139
4122
4501
05
Surf
ace
enti
èrem
ent
lissé
e
Liss
é
Peig
né
Fig.
2 :
Gro
tte d
es P
erra
ts. P
lan
synt
hétiq
ue et
écha
ntill
on d
e vas
es sû
rs o
u pr
obab
les d
e la
phas
e ii :
La
Tène
C1
?
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer
484
d’une nouvelle utilisation qui va laisser des traces matérielles importantes.Le mobilier métallique est varié : armes, outils, parures, ustensiles et quincaillerie. Seules deux flèches sont attribuables à l’armement. Une lan-guette aux extrémités arrondies pourrait être un pontet de fourreau d’épée. Parmi les outils nous pouvons classer deux ciseaux (à bois ?), une houe, la moitié d’une paire de forces, une ou deux haches à douille, un poinçon et une barre circulaire à douille à la fonction indéterminée. Une bague (?), trois à quatre fragments de bracelets dont un en lignite, une possible agrafe de ceinture et une possible boucle de ceinture forment la parure. Plusieurs fragments de cerclage, en bronze ou en fer, témoignent de l’utilisation de seaux ou baquets en bois. Le fragment le mieux conservé possède un de ses anneaux de préhension. Un couteau enfin, complète les ustensiles. Nous rangerons dans la quincaillerie divers anneaux, une agrafe à bois, un objet sans comparaison connue qu’on pourrait rapprocher d’une targette ou d’une clavette, deux clous en fer. On constate une concentration des élé-ments dans le fond de la grande salle, en particu-lier pour les outils.Dans un niveau du Moyen Âge a été retrouvé un dé en os typique de La Tène.Cette phase est caractérisée par la quantité des poteries abandonnées dans la grotte (plus de deux cents). Le corpus est dominé par les formes bas-ses ouvertes : écuelles à bord rentrant et écuelles à profil en S principalement (presque 50 %) ; puis viennent les pots ovoïdes (environ 35 %) et enfin les vases balustres (15 %). Ce corpus est caractérisé par la diversité et la finesse des pâtes utilisées, la fréquence des décors, surtout lissés, sur presque toutes les formes, et tous les modes de cuisson sont représentés. À noter la cuisson céramique en mode A (réductrice-oxydante) avec enfumage, utilisée sur différentes formes de vases, du balustre le plus petit à l’ovoïde le plus grand. Certains vases sont si proches dans la forme, la cuisson et les décors qu’il ne fait aucun doute qu’ils ont été produits par le même atelier. L’utilisation du tour rapide est assurée pour presque tous les vases balustres mais aussi pour des écuelles à profil en S, des ovoïdes, parfois de taille importante, et d’autres formes encore. Les importations ne sont connues que par trois amphores très incomplètes, dont une gréco-italique ou Dressel Ia de Campanie. Les deux autres sont des modèles Dressel Ia ou Ib. Des estampages sur le fond d’une écuelle témoignent de la connaissance de modèles campaniens.C’est durant cette phase que quelques aména-gements sont réalisés dans la cavité. La zone du porche (zone 7) est aplanie et aménagée et on y a découvert des aires de combustion. Un ensemble
de deux petites fosses, d’un petit foyer et de deux trous de piquet se trouvait au centre de la grande salle, le tout réalisé dans un but qui nous échappe (carrés G10-11). Enfin, à l’ouest à partir de la bande 4-3 et jusqu’à la limite atteinte par la fouille, un lit de pierres disposées à plat divisait en deux la couche unique de La Tène. Les tessons étaient dis-posés à plat, au-dessus comme au-dessous de ces pierres. On s’explique mal le but de cet aménage-ment, surtout quand on constate que les tessons se trouvant dessous le lit de pierres recollent avec ceux situés au-dessus : certains vases ont leurs fragments davantage concentrés dessous, d’autres dessus, d’autres sont équitablement répartis. Seule une formation rapide de cet aménagement peut expliquer une telle disposition. Rapide et cepen-dant faite avec précaution puisque tout le mobilier était posé à plat.L’étude spatiale de la céramique montre quatre zones de concentration : la partie aménagée du por-che, le centre de la grande salle, le fond de la gran-de salle (à partir des bandes 4-3) et toute la galerie de liaison vers la salle latérale malheureusement remaniée. Au centre et à l’ouest, les concentrations maximales se trouvent au pied des parois sud. Entre ces différentes zones, on note une absence presque totale de matériel que les seuls terriers des animaux fouisseurs ne peuvent expliquer.Autre constatation, les fragments d’une même poterie peuvent se retrouver répartis entre ces dif-férentes zones. Il n’y a pas de sélection d’une partie des profils (cols, panses, pieds) pour une zone en particulier, ce qui laisse à penser que les vases ont été brisés et leurs tessons mélangés avant d’être déposés. Le bris volontaire peut être envisagé, cer-tains vases portant la trace d’un éclatement dû à un choc. Le dépôt entre les différentes zones concerne la plupart des formes mais plus particulièrement les vases balustres.La répartition des différentes formes de vases montre une concentration des écuelles dans la par-tie centrale de la grotte, de petits ovoïdes dans la galerie de liaison, des balustres au fond de la gran-de salle.Le croisement des données entre l’aménagement du fond de la grande salle et les dépôts entre les différentes zones montre la concordance tempo-relle de celles-ci et leur constitution assez rapide, pour une grande partie du mobilier céramique en tous les cas.Manifestement, les dépôts de certains vases ont été complexes, suivant des modalités que l’on peut appréhender, mais dans un but qui nous échappe. Un autre aspect particulier de ce corpus nous est fourni par la présence de nombreux vases balus-tres (NMI : 24). Ces vases, associés au service à boire ou aux libations, sont très rares en Centre-
Ducongé S. et Gomez de Soto J. - Les dépôts à caractère cultuel en milieux humides et dans les cavités naturelles…
485
D
EFGH
IJKL
CBAAABBCC
121314151617181920212223
Z1 Z2 Z3 Z4
4 3 2 1 '1 '2
0 10 m
567891011
ZONE 6
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 5
ZONE 7
Fig. 3 - Grotte des Perrats. Plan synthétique et échantillon de vases sûrs ou probables de la phase III : La Tène C2.
Limites de zone
Limites de fouille en 1994
1-5
6-15
16-30
31-60
+ 60
Nombre de tessons par m² :
Concentration de mobilier métallique
1206 1203
2203 2221
22262225
2227
4105
41024128
4133
Lissé
4153
4142
1301
2237
4301
Enduction rouge
Surface entièrement lissée
4201
4202
4204
4208
Enduction noire
0 5
N
Fig. 3 : Grotte des Perrats. Plan synthétique et échantillon de vases sûrs ou probables de la phase iii : Tène C2/D1a.
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer
486
Ouest. Ils sont mieux représentés dans le Centre, l’Est ou le Nord de la France, surtout dans des habitats. On les trouve également dans des lieux à vocation cultuelle, comme les puits du Sud-Ouest par exemple.À nouveau, il faut signaler l’importance de la faune sauvage, près de 13 % des restes déterminés (NR dét. : 203), avec la présence du cerf, du chevreuil, du sanglier, du blaireau, du loup, du renard, du lièvre et de la corneille noire. Les restes, provenant uniquement de la tête et des bas de patte de la plu-part de ces espèces, pourraient évoquer la présence de peaux et/ou de fourrures. La faune domestique est constituée surtout de porc dont de très jeunes sujets, mais aussi de bœuf, d’ovicaprinés, de che-val, de chien et de coq.
Il nous est actuellement impossible de comparer la grotte d’Agris au niveau régional. Les sites en grotte sont en revanche plus nombreux et surtout mieux étudiés pour cette période en Gaule méri-dionale (Arcelin, 1992, 2000 ; Vidal et al., 2000). Nous ne pouvons développer ici toutes les comparaisons et toutes les conclusions que l’on peut faire à partir des données relatives à cette troisième phase, mais la fonction cultuelle de la grotte durant La Tène C2 nous semble vraisemblable (Ducongé et Gomez de Soto, à paraître, 2005).On voit donc qu’au cours de La Tène, la grotte des Perrats a été fréquentée à plusieurs reprises, vraisemblablement dans un but cultuel, peut-être réservée à une frange privilégiée de la société (aris-tocratie ?) dans un premier temps, puis accessible à une communauté plus large par la suite.
2. analyse des condItIons de dépôt dans les mIlIeux humIdes
Pour les objets des âges du Fer issus des milieux humides, les occurrences relevées dans la région considérée concernent essentiellement les cours d’eau. L’écrasante domination quantitative de l’équipement militaire est remarquable : un seul récipient métallique. Si les parures sont nombreu-ses, elles ne constituent qu’un ensemble unique. La raison d’être d’éléments métalliques dans les milieux humides fait l’objet de débats. Effectivement, les conditions des trouvailles res-tent sujettes à critiques : on a justement souligné la difficulté de repérer les petits objets en plongée – l’épingle du Ha C et le bracelet du Ha D de Saint-Simon/Vibrac (Charente), la fibule de La Tène ancienne de Surgères (Charente-Maritime), consti-tuent des exceptions (Burnez et al., 2003 ; Giraud et Gomez de Soto, 1996) – ou la sélection de fait, par les mariniers des dragues, des pièces les plus visibles et leur fréquente absence d’intérêt pour les objets de fer lorsqu’ils se trouvent trop défigurés par les gangues. En ce qui concerne l’âge du Bronze, surtout pour le Bronze final, les nombreuses armes recueillies dans les milieux aquatiques ont déjà fait l’objet d’interprétations mettant en exergue des pratiques cultuelles (offrandes aux divinités : Torbrügge, 1971 ; Briard, 1989, 2001 ; Bradley, 1990) ou sociales (« potlach » : Brun, 1986), rejet de tro-phées dans les eaux (Briard, op. cit.). L’hypothèse de sépultures détruites, parfois avancée, qui pour-rait sembler acceptable comme voie de recherche dans des régions comme celle ici considérée, aux sépultures protohistoriques encore trop rares pour autoriser des comparaisons valables, résiste fort mal à l’examen dans des régions aux sépultures nombreuses, et généralement dépourvues d’armes, du moins pendant l’âge du Bronze final. Par exem-ple, en France orientale, les armes, exceptionnelles
dans les tombes, abondent dans les cours d’eau, en particulier en certains points privilégiés de leur cours, comme l’exemple bien connu de la Saône le démontre. Le contraste entre immersions d’armes ou autres biens de prix et pratiques du dépôt de métal d’un côté, rareté des armes dans les tombes de l’autre, pendant le Bronze final, puis, à partir du début du Premier âge du Fer, le contraste opposé, ont déjà été soulignés (Warmenbol, 1996 ; Milcent, 2004). Un tel contraste se lit pour le Bronze final dans le centre-ouest de la France et en Aquitaine comme dans les pays de la basse Loire et l’Armori-que, qui, pour le Bronze final n’ont jusqu’à présent livré armes et biens de luxe que dans les milieux humides et les dépôts. Les rares cas de possibles sépultures à épées recensés par P.-Y. Milcent (1993) n’offrent que peu de garanties. Par exemple, l’épée en langue de carpe qui viendrait d’un tumulus, d’ailleurs néolithique, de Peu Pierroux dans l’île de Ré (Charente-Maritime), est couverte d’une pati-ne… caractéristique d’un milieu humide, ce qui conduit à douter de l’exactitude de la provenance supposée.Il paraît peu discutable que la présence des armes dans les cours d’eau est, ici comme ailleurs, à met-tre en rapport avec des pratiques ne relevant pas du trivial ou du quotidien. On sait aussi, et il n’est pas utile de revenir sur ce point bien connu, que les nombreux récipients métalliques de l’âge du Bronze comme de l’âge du Fer des Îles britanni-ques et de Scandinavie – dont les fameux chau-drons de Brå, Rynkeby et Gundestrup – viennent pour leur grande majorité de milieux palustres ou de rivières.Pour les âges du Fer, les abandons en milieux humides n’offrent pas exactement le même contraste que pour le Bronze final : les sépultures
Ducongé S. et Gomez de Soto J. - Les dépôts à caractère cultuel en milieux humides et dans les cavités naturelles…
487
à armes, sans être bien nombreuses, sont attes-tées, en Centre-Ouest tout au moins, et un cas l’est en Armorique (Milcent, 1993). Les parures de la Fontaine de Lucineau connaissent des homologues dans les sépultures (Tauvel, op. cit.), celle d’Antran par exemple (Pautreau, 1991).Certaines armes des âges du Fer de la région consi-dérée sont exceptionnelles par leur qualité ou leur rareté : c’est le cas des épées à sphères et de l’épée à poignée anthropomorphe de Saint-André-de-Lidon. La lame de cette dernière porte une bar-rette d’or et les traces d’autres incrustations figu-rant des symboles astraux, et la mutilation de ses tranchants n’est pas sans rappeler celle des armes des sanctuaires (Duval et al., 1986 ; Rapin, 1986). Ce choix de l’immersion d’armes de qualité relèverait
à l’évidence de pratiques du même ordre que pour celles du Bronze final. Il est d’ailleurs possible que certaines armes comme les épées à sphères, jus-qu’à présent découvertes presque exclusivement dans des milieux aquatiques, mais jamais dans des sépultures de façon assurée, n’aient été fabriquées que dans un but d’offrande (Wieland, 1996). Quant aux symboles astraux portés par l’épée de Saint-André-de-Lidon, et d’autres épées à poignée pseu-do-anthropomorphe ou anthropomorphe, il est inutile de les commenter à nouveau (Fitzpatrick, 1992).Cette pratique des immersions dans des points privilégiés des cours d’eau, les gués en particulier, connaîtra une longue continuité au-delà des âges du Fer (Bonnamour et Dumont, 1994).
3. analyse des condItIons de dépôt en grotte
3.1. topographie des cavités
La plupart des cavités présentées offrent des conditions d’accès malaisées : entrée malcommo-de comme au Quéroy ou à la Roche Noire, longs cheminements à Rouffignac et à Fontanguillère, descente dans un aven au Trou de la Coupe. Seule, la grotte des Perrats n’oppose aucune difficulté d’accès, mais, comme l’ont montré les sondages dans son environnement immédiat, sa fréquenta-tion paraît limitée à sa seule salle principale sans débordement notable à l’extérieur, contrairement à ce qui se produisit pendant ses phases d’occupa-tion comme habitat ou annexe d’habitat pendant l’âge du Bronze : seule la cavité elle-même intéres-sait les hommes du Second âge du Fer.De telles conditions d’accès ou de circulation excluent une utilisation aisée, et quand ce n’était pas le cas, les hommes négligèrent les facilités offertes par l’environnement immédiat. Que ces cavités fussent utilisées pour un habitat, même temporaire, paraît peu probable ; il faut donc envi-sager une fonction particulière.
3.2. Les restes humains et leur signification
La présence de restes humains en milieu souterrain – comme en bien d’autres d’ailleurs – est encore pres-que systématiquement comprise en termes funérai-res. Les avancées de l’anthropologie funéraire nous ont appris que l’équation restes humains = sépulture n’est pas toujours valable. Les traces d’intervention que portent certains des ossements peuvent indi-quer dans certains cas un traitement funéraire par-ticulier du cadavre, mais aussi, dans bien d’autres, sont conséquence de la manipulation du cadavre à des fins non funéraires (cf. Ribemont-sur-Ancre ou Acy-Romance) ou de pratiques sacrificielles.
Dans la région concernée, ces traces, qui peuvent rester parfois discrètes, ne furent pas toujours sys-tématiquement recherchées, ou les études anthro-pologiques furent réalisées à une époque où on ne savait pas encore bien discerner – ou ne cherchait pas – les moins visibles. Pour beaucoup de res-tes, aucun examen n’a été réalisé à ce jour. Dans les faits, seuls les ossements du Trou de la Coupe ont bénéficié d’une étude complète menée selon les normes actuelles (Germain, 2002). Les corps ont subi des manipulations, qui, pas davantage que leur dépôt dans un aven, ne paraissent relever de pratiques funéraires telles qu’on les connaît dans le monde laténien, mais invitent à chercher des rapprochements avec les corps déposés, complets ou partiels, dans d’autres types de milieux souter-rains, les silos en particulier (Arcelin et Brunaux, 2003). Des exemples sont attestés en Gaule du cen-tre, près de la limite nord-occidentale de la région ici considérée (Gomez de Soto et Milcent, 2003). Par voie de conséquence, il paraît clair que les dépôts accompagnant de tels restes ne peuvent apparaître comme des mobiliers funéraires stricto sensu.Pour la grotte de Rouffignac, la découverte dans l’environnement immédiat des sépultures suppo-sées d’un dépôt monétaire et de quelques menus objets n’est pas sans évoquer la découverte de la grotte de Chenoves en Saône-et-Loire (Fischer, 1982). Dans cette cavité furent mis au jour des squelettes humains et divers objets, dont, là aussi, un dépôt monétaire. Des dépôts non funéraires laténiens de restes humains associés à des dépôts de nature variée, dont de pièces de fer en quantité appréciable, sont attestés dans un certain nombre de cavités souterraines. Un exemple particulière-ment intéressant est celui de la grotte du Trou de l’Ambre à Eprave en Belgique. Il s’y trouvait entre autre un dépôt de currency bars disposées en étoile
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer
488
(Mariën, 1970). Les restes humains associés à des monnaies celtiques récemment découverts dans la grotte Rochefort à Saint-Pierre-sur-Erve dans la Mayenne (Colleter et al., à paraître) relève certai-nement des mêmes pratiques que pour les cas de Chenoves, Eprave et Rouffignac.
3.3. Les assemblages mobiliers
Outre les restes humains que l’on vient d’évoquer, on constate dans les sites que nous avons retenu la présence récurrente des objets vestimentaires (fibules notamment), des parures (surtout des bra-celets), de l’armement et des outils.Le nombre des outils appelle des rapprochements avec les sanctuaires laténiens de Gaule du centre-ouest où, à côté des armes, les outils apparaissent en nombre appréciable (Gomez de Soto et Lejars, 1991 ; Gomez de Soto et Milcent, 2003). Les dépôts à caractère sacré des établissements ruraux privi-légient parfois les armes, mais surtout les outils (Guillaumet et Nilesse, 2000), comme à Barbezieux en Charente (Gomez de Soto, 2000 a). La frag-mentation de beaucoup d’objets de la grotte des Perrats peut probablement être rapprochée du bris et autres processus de destruction des armes des sanctuaires de plein air. Le nombre important des outils témoigne, comme ceux des dépôts des éta-blissements ruraux, de pratiques cultuelles liées à des préoccupations agricoles ou plus généralement de production, et d’une religiosité populaire qui, par ses procédures de destruction, se rapprochait des pratiques plus aristocratiques des sanctuaires de plein air à dépôts d’armes. L’importance numé-
rique des objets en fer rappelle les propos, pour une période postérieure, d’Isidore de Séville, qui constatait qu’on honorait les dieux infernaux par des offrandes de fer.Hormis dans la grotte des Perrats, les poteries sem-blent souvent assez peu abondantes. Là aussi, la pratique du bris rituel des céramiques est connue par ailleurs dans la région. On la rencontre dès le Ha D3/La Tène A1, à Ribérolles à Rivière, en Charente (Gomez de Soto, 2000 b), à Coulon dans les Deux-Sèvres (Pautreau, 1995), ou plus tard, à Barbezieux en Charente par exemple (Gomez de Soto, 2000 a).
3.4. Les cavités et leur environnement
En l’état actuel des connaissances, aucun des sites de l’âge du Fer en grotte connus dans la région ne peut être rattaché à un habitat, à une nécropole ou un sanctuaire de surface situé dans un environne-ment proche de quelques kilomètres. Il faut pré-ciser que ceux-ci n’ont d’ailleurs généralement pas été réellement recherchés.Là encore la grotte des Perrats présente une excep-tion. En effet, à environ quatre kilomètres de la cavité se trouve un site d’habitat de hauteur de type aristocratique (Le Bois du Châtelard à Rivières), aux fortifications surdimensionnées pour une sur-face habitable très faible, et occupé notamment à La Tène B. Lier cet habitat à la fréquentation de la grotte durant la même période est une hypothèse séduisante. Espérons que les recherches entamées et à venir apporteront des éléments de réponses.
conclusIon
Par ses pratiques cultuelles dans les milieux humi-des et les contextes souterrains ou assimilés pen-dant l’âge du Fer, la Gaule du centre-ouest et l’Aqui-taine septentrionale ne diffère pas notablement du reste de l’Europe moyenne contemporaine.Les rejets dans les rivières et milieux palustres de biens sélectionnés pour la plupart à haute charge symbolique poursuivent une tradition ancienne initiée dès l’âge du Bronze. De même, les premiers dépôts dans les grottes remontent eux aussi à l’âge du Bronze, voire à la période des Campaniformes (La Fontanguillière). Ils sont particulièrement élo-quents pendant le Bronze moyen dans l’aire de la culture des Duffaits (Gomez de Soto, 1995), période pendant laquelle des restes humains purent peut-être déjà entrer dans leur constitution. Après une période d’incertitude quant à leur existence pen-dant le Bronze final et le Ha C, ce qui interdit d’af-firmer le maintien d’une tradition, les dépôts dans
les grottes redeviennent relativement nombreux à partir du Ha D et de La Tène ancienne.Les dépôts limités à des artefacts sont à rappro-cher de nombreux autres exemples, tels ceux du Rouergue et de Gaule du sud ou de la Péninsule ibérique (Vidal et al., 2000), sans oublier ceux de l’Hellade et de l’Italie. Il n’est sans doute pas sans intérêt de souligner la pratique de destruction de certains objets, commune aux grottes et aux sanc-tuaires de plein air, et l’ancienneté - voire l’anté-riorité - de cette pratique en Occident : au casque d’Agris répondent au IVe siècle ceux de Saint-Jean-Trolimon en Bretagne, un peu plus tard ceux de Tintignac en Corrèze (Maniquet, 2005).La grotte d’Agris, fouillée à une date récente, a autorisé des analyses détaillées. Souhaitons que des fouilles archéologiques dans les milieux sou-terrains apportent à l’avenir de nouvelles informa-tions aussi riches que celles fournies par cette der-
Ducongé S. et Gomez de Soto J. - Les dépôts à caractère cultuel en milieux humides et dans les cavités naturelles…
489
nière, afin de comprendre davantage les modalités de leur fonctionnement et d’appréhender les buts de leur fréquentation. Celle à finalité religieuse peut en être un, parmi bien d’autres. On devra aussi s’attacher à l’examen de leur environnement
proche et plus lointain, car, en effet, ces cavités ne peuvent totalement se comprendre qu’en tant qu’élément d’un territoire complexe (Treffort, 2005), au sein duquel elles tiennent un rôle, qui put varier au cours du temps.
BIBlIographIe
Arcelin, 1992 : ARCELIN (P.) dir. – Espaces et Monuments publics protohistoriques de Gaule méridionale. Lattes, 1992. (Les dossiers des DAM, 15).
Arcelin, 2000 : ARCELIN (P.). – Expressions cultuelles dans la Gaule méridionale du Premier âge du Fer. in : Mailhac et le Premier âge du Fer en Europe occidentale, Hommages à O. et J. Taffanel. Actes du colloque international de Carcassonne, 17-20 septembre 1997. Lattes, 2000, p. 271-290. (MAM, 7).
Arcelin et Brunaux, 2003 : ARCELIN (P.) et BRUNAUX (J.-L.) dir. – Cultes et sanctuaires en France à l’âge du Fer. Gallia, 60, 2003, 1-268.
Barrière, 1974 : BARRIèRE (C.). – Rouffignac. Toulouse, Publication de l’Institut d’Art préhistorique de l’Université de Toulouse-Le Mirail, 1974. (Mémoires de l’Institut d’Art Préhistorique, II, 3 fasc.).
Bastien, 2005 : BASTIEN (G.). – Objets inédits provenant de la Loire tourangelle. Bull. des amis du Musée de Préhist. du Grand Pressigny, 56, 2005, p. 73-75.
Bonnamour et Dumont, 1994 : BONNAMOUR (L.) et DUMONT (A.). – Les armes romaines de la Saône : état des découvertes et données récentes de fouilles. in : VAN DRIEL-MURRAY (C.) éd. – Military Equipment in Context. Proceedings of the Ninth International Roman Military Equipment Conference, Leiden, 1994. Journal of Roman Military Equipment Studies, vol. 5, 1994, p. 141-154.
Boudet, 1987 : BOUDET (R.). – L’âge du Fer récent dans la partie méridionale de l’estuaire girondin (du Ve au ier siècle avant notre ère). Périgueux, Vesuna, 1987. (Archéologies, 2).
Bradley, 1990 : BRADLEY (R.). – The Passage of Arms. An archaeological analysis of prehistoric hoards and votive deposits. Cambridge, Cambridge University Press, 1990.
Briard, 1989 : BRIARD (J.). – Le culte des eaux à l’âge du Bronze. 117e Congrès national des Sociétés savantes, Pré-Protohistoire, Lyon, 1987, Paris, CTHS, 1989, p. 53-66.
Briard, 2001 : BRIARD (J.). – Le culte des eaux en Armorique à l’âge du Bronze. Synthèse et actualisation. in : L’HELGOUAC’H (J.), BRIARD (J.) dir. – Systèmes fluviaux, estuaires et implantations humaines de la Préhistoire aux grandes invasions. Actes du 124e congrès national des Sociétés savantes, Nantes, 1999. Paris, CTHS, 2001, p. 91-101.
Brun, 1986 : BRUN (P.). – L’entité « Rhin-Suisse-France orientale » : nature et évolution. in : Le groupe Rhin-Suisse-France orientale et la notion de civilisation des Champs d’Urnes, Nemours, Musée de Préhistoire d’Ile de France, 1986, p. 599-620.
Brunaux, 2000 : BRUNAUX (J.-L.). – Les religions gauloises (Ve-ier siècle av. J.-C.). Nouvelles approches sur les rituels celtiques de la Gaule indépendante. Paris, Errance, 2000.
Burnez et al., 2003 : BURNEz (C.), GAILLEDREAU (J.-P.), GOMEz de SOTO (J.), et coll. – Nouvelles trouvailles suba-quatiques néolithiques et protohistoriques dans la Charente à Saint-Simon et à Vibrac (Charente). Bulletin de la Société Préhistorique Française, 100, 3, 2003, p. 575-587.
chevillot, 1989 : CHEVILLOT (C.). – Sites et cultures de l’âge du Bronze en Périgord. Périgueux, Vesuna, 1989. (Archéologies, 3).
chevillot, 2001 : CHEVILLOT (C.). – La grotte à ruisseau souterrain actif de La Fontanguillère (Rouffignac-de-Sigoulès - Dordogne) : quelques réflexions sur les rites funéraires liés aux cultes des eaux et chtoniens au cours de la Protohistoire. Documents d’Archéologie et d’Histoire Périgourdines, 16, 2001, p. 23-48.
coffyn, 1966 : COFFYN (A.). – Musée de la Société Historique et Archéologique de Libourne. Revue Historique et Archéologique du Libournais, XXXIV, 120, 1966, p. 33-72.
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer
490
cordier, 1978a : CORDIER (G.). – À propos du dépôt de la Fontaine de Lucineau (Saint-Jouin-de-Marnes, D.-S.) et ses influences launaciennes dans le centre-ouest. Sciences, Lettres, Arts, 26, 1978, p. 66-72.
colleter et al. à paraître : COLLETER (R.), AUBIN (G.), CHEREL (A.-F.), HINGUANT (S.), PEUzIAT (J.), SELLAMI (F.). – La grotte de Rochefort (Saint-Pierre-sur-Erve, Mayenne), Revue archéologique de l’Ouest, à paraître.
cordier, 1978b : CORDIER (G.). – La grotte funéraire hallstattienne de La Roche Noire à Mérigny (Indre). I. Étude archéologique. L’Anthropologie, 82, 2, 1978, p. 199-220.
Ducongé, 2003 : DUCONGÉ (S.). - Les poteries du iie âge du Fer de la grotte des Perrats à Agris (Charente). Apport à l’inter-prétation des occupations du site au cours de La Tène. Mémoire de maîtrise, Tours : Université François-Rabelais, 2003, 2 vol.
Ducongé et gomez de Soto, à paraître : DUCONGÉ (S.), GOMEz de SOTO (J.) dir. – Grotte des Perrats à Agris (Charente) – 1981-1994. Une grotte-sanctuaire du Second âge du Fer, à paraître.
Duval et al., 1986 : DUVAL (A.), GAILLARD (J.), GOMEz de SOTO (J.). – L’épée anthropoïde de Saint-André-de-Lidon (Charente-Maritime). in : Actes du Viiie colloque sur les âges du Fer en France non méditerranéenne, Angoulême, 1984. 1986, p. 233-238. (Aquitania, suppl. 1).
Fischer, 1982 : FISCHER (B.). – Le trésor de Chenoves (Saône-et-Loire). Revue Archéologique de l’Est, 33, 1982, p. 99-109.
Fitzpatrick, 1992 : FITzPATRICK (A. P.). – Night and Day: the Symbolism of Astral Signs on Later Iron Age Anthro-pomorphic Short Swords. Proceedings of the Prehistoric Society, 62, p. 373-398.
gendron et al., 1986 : GENDRON (C.), GOMEz de SOTO (J.), LEJARS (T.), PAUTREAU (J.-P.), URAN (L.). – Deux épées à sphères du centre-ouest de la France. Aquitania, 4, 1986, p. 39-54.
germain, 2002 : GERMAIN (E.). - Étude des restes humains du Second âge du Fer de l’aven du Trou de la Coupe à Touvre (Charente). Mémoire de DEA. Paris : Université de Paris I, 2002.
giraud et gomez, 1996 : GIRAUD (T.) et GOMEz de SOTO (J.). – Deux fibules du début du Second âge du Fer en Saintonge. Recherches archéologiques en Saintonge et en Aunis, 1, 1996, p. 59-60.
gomez de Soto 1978 : GOMEz de SOTO (J.). – La stratigraphie chalcolithique et protohistorique de la grotte du Quéroy à Chazelles, Charente. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 75, 1978, p. 394-421.
gomez de Soto 1995 : GOMEz de SOTO (J.). – Le Bronze moyen en Occident. La culture des Duffaits et la civilisation des Tumulus. Paris, Picard, 1995. (L’âge du Bronze en France, 5).
gomez de Soto 1999 : GOMEz de SOTO (J.). – Habitats et nécropoles des âges des métaux en centre-ouest et en Aquitaine. La question de l’or absent. in : CAUUET (B.) dir. – L’or de l’Antiquité, de la mine à l’objet. 1999, p. 337-346. (Aquitania, suppl. 9).
gomez de Soto 2000a : GOMEz de SOTO (J.). – Commentaires sur le mobilier céramique et interprétation de la fosse 3038 du site laténien des Petits Clairons à Barbezieux. Aquitania, 17, 2000, p. 55-57.
gomez de Soto 2000b : GOMEz de SOTO (J.). – Rivières, Ribérolles. Rapport de fouille programmée. SRA Poitou-Charentes, 2000.
gomez de Soto et Boulestin, 1996 : GOMEz de SOTO (J.), avec coll. BOULESTIN (B.). – Grotte des Perrats à Agris (Charente). 1981-1994. Étude préliminaire. Chauvigny, Association des Publications Chauvinoises, 1996. (Dossier n° 4).
gomez de Soto et Lejars, 1991 : GOMEz de SOTO (J.) et LEJARS (T.). – Sanctuaires préromains en Extrême Occident. in : BRUNAUX (J.-L.) dir. – Les sanctuaires celtiques et leurs rapports avec le monde méditerranéen. Actes du colloque de Saint-Riquier, novembre 1990. Paris, Errance, 1991, p. 126-132.
gomez de Soto et milcent, 2000 : GOMEz de SOTO (J.) et MILCENT (P.-Y.). – De la Méditerranée à l’Atlantique : échanges et affinités culturelles entre le nord-ouest et le sud-ouest de la France de la fin du Xe au Ve siècle av. J.-C. in : JANIN (T.) éd. – Mailhac et le Premier âge du Fer en Europe occidentale. Hommages à O. et J. Taffanel. Actes du colloque de Carcassonne, 17-20 septembre 1997. Lattes, 2000, p. 350-371, (Monographies d’Archéologie médi-terranéenne, 7).
gomez de Soto et milcent, 2003 : GOMEz de SOTO (J.) et MILCENT (P.-Y.) et coll. – La France du Centre aux Pyrénées (Aquitaine, Centre, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes). in : ARCELIN (P.) et BRUNAUX (J.-L.) dir. – Cultes et sanctuaires en France à l’âge du Fer. Gallia, 60, 2003, p. 107-138.
Ducongé S. et Gomez de Soto J. - Les dépôts à caractère cultuel en milieux humides et dans les cavités naturelles…
491
gomez de Soto et Verger, 1999 : GOMEz de SOTO (J.) et VERGER (S.). – Le casque celtique de la grotte d’Agris (iVe siècle avant J.-C.). Angoulême, GERMA, 1999.
gomez de Soto et al., à paraître : GOMEz de SOTO (J.), LEJARS (T.), DUCONGÉ (S.), ROBIN (K.), SIREIX (C.), zÉLIE (B.). - Du milieu du Ve siècle au IIIe siècle avant notre ère en centre-ouest, Aquitaine septentrionale et ouest du Massif Central. in : Actes du xxViie colloque de l’AFEAF, Clermont-Ferrand, 29 mai-1er juin 2003. à paraître.
gomez de Soto, 2006 : GOMEz de SOTO (J.). – Dépôts métalliques du second âge du Fer dans les grottes du centre-ouest de la France. in : BATAILLE (G.), GUILLAUMET (J.-P.) dir. – Les dépôts métalliques au Second âge du Fer en Europe tempérée. Actes de la table ronde de Glux-en-Glenne, 13-14 octobre 2004. Glux-en-Glenne, Centre archéologi-que européen, 2006, p. 75-81. (Bibracte, 11).
gruet et al., 1997 : GRUET (M.), ROUSSOT-LARROQUE (J.), BURNEz (C.). – L’âge du Bronze dans la grotte de Rancogne (Charente). Saint-Germain-en-Laye, RMN, 1997. (Antiquités nationales, 3).
guillaumet et nilesse, 2000 : GUILLAUMET (J.-P.) et NILESSE (O.). – Les petits objets des fermes gauloises : approche méthodologique. in : MARION (S.), BLANCQUAERT (G.). – Les installations agricoles de l’âge du Fer en France septentrionale. Paris, ENS, 2000, p. 251-276. (Études d’histoire et d’archéologie, 6).
de La tourette, 1862 : DE LA TOURETTE (G.). – Note de M. de la Tourette sur le dolmen de Poncé près Loudun. Congrès Archéologique de France, Saumur 1862. 1862, p. 154-157, 387-390.
Lejars, 1999 : LEJARS (T.). – Épée à fourreau décoré ; épée et fourreau (fragmentaire) à décor incisé. Nos ancêtres les Gaulois aux marges de l’Armorique. Catalogue d’exposition, Nantes, Musée Dobrée, 1999, p. 117.
Lejars et al., 2001 : LEJARS (T.), VERGER (S.), VITALI (D.). – Monterenzio (province de Bologne). La nécropole celto-étrusque de Monterenzio Vecchio. Mémoires de l’École française de Rome, 113, 1, 2001, p. 524-529.
Lorenz et al., 1984 : LORENz (J.), LORENz (C.), POULAIN (T.), CORDIER (G.), GALLET (H.), RIQUET (R.). – La grotte hallstattienne de la Roche Noire. Mérigny (indre). Mérigny, Association des amis de Mérigny et ses environs, 1984.
maniquet, 2005 : MANIQUET (C.). – Découverte d’un formidable dépôt gaulois. Les carnix de Tintignac. Archéologia, 419, 2005, p. 16-23.
mariën, 1970 : MARIËN (M.-E.). – Le Trou de l’Ambre au Bois de Wérimot. Eprave. Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire, 1970. (Monographies d’Archéologie Nationale, 4).
milcent, 1993 : MILCENT (P.-Y.). – L’âge du Fer en Armorique à travers les ensembles funéraires (IXe-IIIe siècles avant J.-C.). Antiquités nationales, 25, 1993, p. 17-50.
milcent, 2004 : MILCENT (P.-Y.). – Le Premier âge du Fer en France centrale. Paris, Société Préhistorique Française, 2004. (Mémoires, XXXIV).
Pautreau, 1991 : PAUTREAU (J.-P.). – Inhumation du Premier âge du Fer à Antran (Vienne). Bulletin de la Société Préhistorique Française, 88, 7, 1991, p. 210-220.
Pautreau, 1995 : PAUTREAU (J.-P.). – 1036 avant J.-C… Coulon. Niort, Parc naturel régional du Marais Poitevin, 1995.
Pautreau et Soyer, 2001-2002 : PAUTREAU (J.-P.) et SOYER (C.). – Chaudron en bronze de l’âge du Fer découvert à Ouzilly-Vignolles, Vienne (France). Aquitania, 18, 2001-2002, p. 403-410.
Rapin, 1986 : RAPIN (A.). – Note complémentaire. in : Actes du Viiie colloque sur les âges du Fer en France non méditerra-néenne, Angoulême, 1984. 1986, p. 290-291. (Aquitania, suppl. 1).
Rapin, 1999 : RAPIN (A.). – Épée à rognon ou à sphères du Pont de l’Ouen, à Haute-Goulaine (L.-A.). in : Nos ancêtres les Gaulois aux marges de l’Armorique. Catalogue d’exposition. Nantes, Musée Dobrée, 1999, p. 115-116.
Santrot et al., 1999a : SANTROT (M.-H.), SANTROT (J.), RAPIN (A.). – Fer de lance à douille courte du Pont de l’Ouen à Haute-Goulaine (L.-A.). in : Nos ancêtres les Gaulois aux marges de l’Armorique. Catalogue d’exposition. Nantes, Musée Dobrée, 1999, p. 116.
Santrot et al., 1999b : SANTROT (M.-H.), SANTROT (J.), VERGER (A.). – Bouterolle à ailettes. in : Nos ancêtres les Gaulois aux marges de l’Armorique. Catalogue d’exposition. Nantes, Musée Dobrée, 1999, p. 113.
tauvel, 1974 : TAUVEL (D.). – Le Premier âge du Fer dans la Vienne. III - Les dépôts. Revue Archéologique du Centre de la France, XIII, 49-50, fasc. 1-2, 1974, p. 3-24.
L’âge du Fer dans l’arc jurassien et ses marges. Dépôts, lieux sacrés et territorialité à l’âge du Fer
492
thiol, 1998 a : THIOL (S.). – Étude des traces anthropiques observées sur les individus de l’âge du Fer à Eprave, Belgique. Revue Archéologique de Picardie, 1-2, 1998, p. 253-256.
thiol, 1998 b : THIOL (S.). – Première approche des traces anthropiques observées sur les individus du gisement de l’âge du Fer à Eprave (Namur). in : Les Celtes. Rites funéraires en Gaule du Nord entre le Ve et le ier siècle avant J.-C. Direction de l’Archéologie, Division du Patrimoine, Recherches récentes en Wallonie, 1998, p. 105-107. (Études et documents de fouilles, 4).
torbrügge, 1971 : TORBRüGGE (W.). Vor- und frühgeschichtliche Flussfunde. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 51-52, p. 1-146.
treffort, 2005 : TREFFORT (J.-M.). – La fréquentation des cavités naturelles du Jura méridional au Bronze final : état de la question, nouvelles données et perspectives. Bulletin de la Société Préhistorique Française, 102, 2, 2005, p. 401-416.
Verger, 1999 : Épée à languette tripartite ; Épée à antennes. in : Nos ancêtres les Gaulois aux marges de l’Armorique. Catalogue d’exposition. Nantes, Musée Dobrée, 1999, p. 113-114.
Vidal et al., 2000 : VIDAL (M.), VERNHET (A.), PUJOL (J.). – Les grottes sanctuaires. À propos des exemples avey-ronnais, première approche d’une étude comparative étendue au Sud de la France et à la péninsule ibérique. in : Aspects de l’âge du Fer dans le Sud du Massif Central. Actes du xxie Colloque international de l’AFEAF, Conques-Montrozier, 8-11 mai 1997. Lattes, 2000, p. 65-80. (MAM, 6).
Warmenbol, 1996 : WARMENBOL (E.). Le neuf chez les Anciens. Une autre approche des dépôts de l’âge du Bronze final. in : La Préhistoire au quotidien. Mélanges offerts à Pierre Bonenfant, Grenoble, p. 237-274.
Wieland, 1996 : WIELAND (G.). – Die Spätlatènezeit in Württemberg. Stuttgart, Konrad Theiss Verlag.