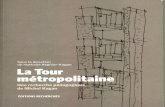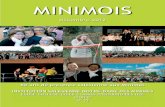Recueil de données Statistiques - Agence de régulation des ...
Sommeil et schizophrénie : une revue des données expérimentales
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Sommeil et schizophrénie : une revue des données expérimentales
MEDECINE DU SOMMEIL - Année 5 - Juillet - Aôut - Septembre 2008 © 2008 – Elsevier Masson SAS – Tous droits réservés. 25
F. Guénoléa, P. Domenechb,c,L. Garmad, A. Nicolasb
a Service hospitalo-universitaire depsychiatrie, Centre Esquirol, Caen.b Unité d’exploration hypnologique,Service hospitalo-universitaire depsychiatrie, Centre hospitalier LeVinatier, Bron.c Centre de neuroscience cognitive,Bron.d Fédération des pathologies dusommeil et Service du Pr J.-C. Willer,Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris.
Correspondance :Fabian GuénoléService hospitalo-universitaire depsychiatrie Centre EsquirolAvenue de la Côte-de-Nacre 14033 Caen [email protected]
Sommeil et schizophrénie :une revue des données expérimentales
Résumé
Le tableau clinique de la schizophrénie, la plusinvalidante des pathologies psychiatriques,comporte très fréquemment des troubles dusommeil, dont la nature et l’intensité varientselon la forme clinique de la maladie et saphase évolutive. Expérimentalement, lesommeil des schizophrènes se caractériseavant tout par un retard d’endormissement,une réduction du temps total de sommeil, uneaugmentation de l’éveil intrasommeil et dunombre de réveils nocturnes. Ce trouble del’initiation et de la continuité du sommeil estmaximal en phase de décompensation aiguë,mais peut aussi exister à la phase chronique dela maladie. Sur le plan architectural, plusieursanomalies peuvent être retrouvées. Chez lesschizophrènes présentant des symptômesnégatifs, on observe une diminution de ladurée et du pourcentage de sommeil lentprofond. Les anomalies touchant le sommeilparadoxal (diminution de la durée, du taux etde la latence de sommeil paradoxal, absencede rebond de sommeil paradoxal aprèsprivation spécifique) ne concerneraient quedes patients atteints de symptômes positifssévères, en période de décompensation aiguë.Hormis le déficit de sommeil lent profond quipersiste au long cours, toutes les altérationspolysomnographiques tendent à se corrigersous l’effet des médicaments antipsychotiques.Enfin, les études disponibles ne permettentpas de retenir l’existence d’un troubleendogène de la régulation du cycleveille/sommeil dans la schizophrénie, lesperturbations chronobiologiques observéesrelevant plus probablement d’une désaf-férentation comportementale et de l’effetsédatif des traitements médicamenteux. Denouvelles études sont nécessaires afin depréciser les caractéristiques fondamentales del’organisation du sommeil et de l’éveil chez lesmalades schizophrènes.
Mots-clés
Antipsychotiques, insomnie, polysomno-graphie, psychiatrie, schizophrénie, sommeil.
SLEEP AND SCHIZOPHRENIA :A REVIEW OF EXPERIMENTAL DATA
Summary
Schizophrenia, the most disabling ofpsychiatric diseases, is frequently associatedwith sleep disorders which nature and severitydepend on the active/chronic phase andsubtype of the disease. Experimentallyschizophrenic patient’s sleep is characterizedby an increased latency and fragmentationleading to decrease of total sleep time andsleep efficiency, which are maximal duringactive phases of the disease and may persistduring chronic phases. Several sleeparchitectural abnormalities have beenreported. Schizophrenic patients with negativesymptoms may have a decrease in durationand proportion of slow wave sleep. REM sleepdisturbances (decrease in REM sleep duration,proportion and latency and lack of reboundafter REM sleep deprivation) seem to berestricted to patients presenting severe positivesymptoms, during acute phases. Thesepolysomnographic changes tend to normalizeunder antipsychotic medication with theexception of the deficit in slow wave sleep.Finally, we found no evidence favoring anendogenous perturbation of the wake-sleepregulation in the literature. Indeed, most of thechronobiological changes previously reportedwere attributable to a disruption of wake-sleepbehavioral patterns and to sedative side effectsof medications. Further studies are necessary tocharacterize more precisely the hypnologicpatterns of schizophrenics.
Keywords
Antipsychotics, insomnia, polysomnography,psychiatry, schizophrenia, sleep
m i s e a u p o i n t
m i s e a u p o i n t
MEDECINE DU SOMMEIL - Année 5 - Juillet - Aôut - Septembre 200826
INTRODUCTION
De nombreux patients atteints de troubles psychiatriques seplaignent de leur sommeil. La Classification internationale destroubles du sommeil [1] et le Manuel diagnostique et statistiquedes troubles mentaux [2] reconnaissent de fait le diagnosticd’« insomnie liée à un trouble mental », ainsi que le caractèreétiologique du lien en question. En effet, les troubles du sommeil rencontrés dans certaines pathologies psychiatriques(schizophrénie, dépression, troubles anxieux) ne sont pas desimples phénomènes comorbides : ils font partie intégrante de lapathologie principale, les perturbations neurophysiologiques quiles sous-tendent s’intégrant dans la physiopathologie du troublemental. Dans cet article, nous proposons une synthèse desdonnées expérimentales sur le sommeil dans la schizophrénie.
LA SCHIZOPHRÉNIE
La schizophrénie, dont la prévalence avoisine 1 % partout dans lemonde, est sans conteste le plus sévère des troubles psychiatriques[3]. Il s’agit d’une pathologie hétérogène dont la définition,syndromique, permet d’individualiser plusieurs formes cliniquesselon les dimensions symptomatiques dominantes. Chaquedimension regroupe plusieurs symptômes dont l’association estfréquente. On distingue ainsi : les symptômes « positifs », répartisen trois dimensions (délire, hallucinations et troubles formels de la pensée) ; et les symptômes « négatifs » (comprenantprincipalement l’émoussement affectif, l’apragmatisme, l’alogie etl’avolition) que l’on regroupe en une quatrième dimension. Ondéfinit sur cette base [2] : les formes « paranoïdes », où lesdimensions « délire » et « hallucinations » sont prédominantes(mais pas nécessairement exclusives) ; les formes « désorganisées »,où les troubles formels de la pensée sont au premier plan ; et lesformes « résiduelles », où les symptômes négatifs prévalent.Lorsqu’aucune dimension n’est prédominante, on parle parélimination de forme « indifférenciée ». Enfin, en marge de laclassification dimensionnelle, la forme « catatonique » rendcompte de l’association entre schizophrénie et un syndromemoteur spécifique s’accompagnant d’un repli sur soi extrême.
La maladie se déclare le plus souvent à la fin de l’adolescence. Ondécrit deux modes de début : brutal, sous la forme d’un étatpsychotique aigu (« bouffée délirante aiguë ») ; et insidieux, oùles symptômes se mettent en place sur plusieurs mois ets’accompagnent souvent d’une rupture progressive avecl’environnement social. L’évolution longitudinale est caractériséepar la succession de phases d’exacerbation aiguë dessymptômes, entrecoupées de phases chroniques où, selon lasévérité de la maladie, le patient peut être totalementasymptomatique ou continuer à présenter certains symptômes aminima.
Les causes de la schizophrénie sont encore mal connues. Lesdonnées scientifiques convergent en faveur d’une origineneurodéveloppementale. Il existerait une susceptibilité génétiquecomplexe à la maladie avec laquelle viendraient interagir unensemble de facteurs pathogènes environnementaux [3].
Le traitement, longtemps basé sur les antipsychotiques classiques(ou « neuroleptiques »), repose actuellement en premier lieu sur
les antipsychotiques de nouvelle génération (antipsychotiques« atypiques »), qui provoquent moins d’effets indésirables. Il estnéanmoins fréquemment nécessaire de recourir à desprescriptions adjuvantes lorsque le traitement antipsychotiqueseul ne permet pas d’améliorer certains symptômes de façonsatisfaisante.
CLINIQUE DES TROUBLES DU SOMMEIL CHEZ LES SCHIZOPHRÈNES
Les troubles du sommeil dans la schizophrénie présentent unegrande variabilité selon la forme de la maladie, sa phase évolutive,les syndromes associés (anxiété, dépression) et, bien sûr, la prised’un traitement psychotrope et son impact sur la vigilance.
En phase aiguë, on constate d’importantes difficultésd’endormissement et des éveils nocturnes accompagnésd’anxiété et d’angoisse [4]. Il peut en résulter une somnolencediurne, voire une inversion du rythme veille/sommeil. Cetteinsomnie aiguë survient précocement lors des décompensationspour lesquelles elle a donc valeur de prodrome [5].
Les perturbations sont moins marquées à la phase chronique dela maladie, mais la plainte d’insomnie est commune, même chezles patients stabilisés [6]. Dans les formes où prédominent lessymptômes négatifs, les patients sont peu actifs et n’accumulentdonc pas suffisamment de pression de sommeil au cours de lajournée. Il s’ensuit d’importants retards de phase pouvant aller làaussi jusqu’à l’inversion du rythme veille/sommeil, surtout si lessynchroniseurs sociaux sont défaillants [7]. Ce décalage de phasepeut constituer un signe révélateur lors des débuts insidieux de lamaladie.
Malgré la très grande fréquence et la sévérité des troubles dusommeil chez les patients schizophrènes, ces derniersreprésentent moins de 5 % de la file active des consultationsd’hypnologie [8]. En effet, cette prise en charge revient le plussouvent aux psychiatres, ce qui rend nécessaire une bonnediffusion des principes de la médecine du sommeil auprès de cespraticiens.
DONNÉES POLYSOMNOGRAPHIQUES
Des difficultés méthodologiques
Comme souvent lorsqu’il s’agit de la schizophrénie, denombreuses difficultés méthodologiques compliquent le recueildes données expérimentales et limitent parfois la portée desrésultats obtenus.
Le premier obstacle méthodologique est pratique. En effet, il estsouvent difficile – voire impossible – de réaliser desenregistrements polysomnographiques de qualité chez lespatients schizophrènes. C’est surtout le cas pour les maladesinstables. Par exemple, le port d’électrodes céphaliques peut êtreinsupportable pour un patient délirant qui est convaincuqu’autrui « lui vole sa pensée » ou se révéler impossible lorsque letableau clinique comporte un état d’agitation. Les échantillonssur lesquels sont basées les études sont donc souvent de tailleinsuffisante et souffrent probablement de biais de sélection.
MEDECINE DU SOMMEIL - Année 5 - Juillet - Aôut - Septembre 2008 27
Le deuxième obstacle est lié à l’hétérogénéité symptomatique dela schizophrénie que la plupart des études ne prennent pasexplicitement en compte, que ce soit dans leur recrutement ouleur analyse.
Le dernier et principal obstacle méthodologique reste l’effetconfondant des médicaments psychotropes – antipsychotiquesprincipalement, mais aussi les médications associées – qui toussont susceptibles de modifier la structure du sommeil despatients. De nombreux auteurs insistent donc sur la nécessitéd’étudier des patients sevrés depuis plusieurs mois ou, mieuxencore, n’ayant jamais reçu de traitement antipsychotique [9-11].
Dans cette revue, nous nous basons essentiellement sur huitétudes dans lesquelles ces principaux biais ont été pris en compte[9-16]. Dans l’article de Caldwell et Domino [12], les maladesétaient sevrés de tout traitement médicamenteux depuis auminimum deux ans ; dans les sept autres études les patientsinclus n’avaient jamais reçu de traitement antipsychotique. Lesrésultats de ces travaux sont résumés dans le tableau I.
Initiation et continuité du sommeil
L’initiation du sommeil est difficile chez le schizophrène, commeen témoigne l’augmentation de la latence d’endormissement(LE), présente dans sept des huit travaux (donnée non préciséedans celui de Jus et al. [13]). Cette difficulté est nettement plusmarquée durant les périodes de décompensation aiguë où la LEdépasse une heure en moyenne [10, 11], que chez les patients
stables où elle est modérément allongée [12]. Le maintien dusommeil est lui aussi perturbé, ce qui est illustré par un nombreaccru de réveils nocturnes [10, 12, 16], un temps d’éveilintrasommeil élevé [9, 10, 15, 16] et un index d’efficacité dusommeil (IES) diminué [9, 10, 16]. Le temps total de sommeil (TTS)est inférieur à celui des sujets sains dans les huit études. Sur les sixpatients enregistrés en phase aiguë par Kupfer et al., deuxdorment moins de 150 min par nuit en moyenne et ont plusieursnuits d’insomnie complète [15].
Ces résultats, corroborés par l’actimétrie [17], établissentl’existence d’anomalies de l’initiation, de la continuité et de ladurée du sommeil chez les schizophrènes, celles-ci atteignant undegré maximal en période de décompensation aiguë. Cesanomalies, si elles sont très sensibles, sont en revanche peuspécifiques. En effet, on retrouve des perturbations comparableschez les sujets déprimés [4] – la comorbidité dépressive étant quiplus est fréquente dans la schizophrénie [18] – et chez lesanxieux [4]. Néanmoins, le biais de la dépression est écarté dansles quatre plus récentes des études que nous avons citées [9-11,16]. Concernant l’anxiété, certains auteurs en font un facteurexplicatif important [15] : il va de soi que le vécu délirant duschizophrène, dont la thématique habituelle est la persécution,s’accompagne d’une anxiété massive, qui cède en même tempsque les symptômes positifs régressent avec le traitement.
Sur le plan neurobiologique, plusieurs arguments plaident enfaveur d’une origine dopaminergique de l’insomnie duschizophrène : celle-ci est maximale en période de
Tableau I : Résumé des huit études polysomnographiques de schizophrènes non traités chimiquement.
F. Guénolé, P. Domenech, L. Garma, A. Nicolas Sommeil et schizophrénie : une revue des données expérimentales
m i s e a u p o i n t
MEDECINE DU SOMMEIL - Année 5 - Juillet - Aôut - Septembre 200828
décompensation aiguë ; la prise prolongée de L-dopa estpourvoyeuse d’insomnie [19] ; les antipsychotiques, qui sontinhibiteurs des récepteurs de la dopamine, améliorent lestroubles de la continuité du sommeil chez les schizophrènes (voirinfra « Effet des antipsychotiques »).
Sommeil lent
L’existence d’anomalies du sommeil lent (SL) chez lesschizophrènes reste discutée. Lorsqu’elles sont retrouvées, celles-ci concernent le sommeil lent profond (SLP). Sur les 25 patientschroniques institutionnalisés (bénéficiant de synchroniseurssociaux et d’une bonne hygiène du sommeil) enregistrés parCaldwell et Domino [12], dix n’ont pas de stade 4 et peu de stade 3,ces mesures se maintenant durant cinq nuits consécutives.D’autres études confirment la diminution du stade 4 (10,4 versus14,6 % [13] et 3,6 versus 6,9 % [11]) ou du SLP dans sonensemble (4,7 versus 10,3 % [15] et 21,8 versus 34,5 % [16]), maisceci n’est pas retrouvé par certains [9, 10, 14].
Nous voyons plusieurs explications à ces disparités. La premièreest le manque de fiabilité de la cotation visuelle du sommeil àondes lentes : Ganguli et al. [9], en pratiquant un comptageautomatisé des ondes delta, constatent bien une diminution decelles-ci chez leurs patients. Ensuite, un tel déficit de SLP étant,comme on l’a déjà dit, fréquemment retrouvé dans la dépression,il pourrait exister un biais de sélection dans les études que nouscommentons - biais cependant peu probable comme nousl’avons déjà vu (voir supra « Initiation et continuité dusommeil »).
Les articles de Vincent et al. [14] et de Lauer et al. [10] apportentune donnée supplémentaire : la grande variabilitéinterindividuelle des mesures du SLP chez les schizophrènes.Dans ces deux études, bien que le taux de SLP soit en moyennesimilaire entre les patients et les sujets témoins, plusieurs maladesont un pourcentage de stade 4 très faible (stade 4 < 1,5 % dans9/15 cas, nul dans 7/15 cas [14], absence de stade 4 dans 10/22 cas[10]). La variabilité de ces résultats suggère une hétérogénéitébioclinique au sein des échantillons de patients étudiés.
La diminution de la proportion de SLP ne concerne donc qu’unepartie des malades schizophrènes. Selon plusieurs études, ilexisterait une corrélation négative entre la durée de SLP et lessymptômes négatifs de la maladie [9, 20, 21] ; le déficit de SLPconcernerait ainsi principalement les formes comportant unedimension déficitaire. Plusieurs travaux montrent également unecorrélation négative entre la quantité de stade 4 et la taille desventricules cérébraux latéraux chez les patients [20, 22]. De fait, lesformes déficitaires de la schizophrénie sont classiquementassociées à une augmentation des espaces liquidiens cérébraux,ce qui définit un type bioclinique péjoratif de la maladie du faitd’altérations cognitives plus marquées [21].
Si les études citées comportaient toutes une éviction du reposdiurne, il est malgré tout probable que les patients schizophrènesaient présenté une activité physique globalement inférieure àcelle des sujets témoins. Un manque de pression homéostatiquede sommeil serait donc la première cause à évoquer pourexpliquer la diminution du SLP chez les schizophrènesdéficitaires. Mais il est également tentant d’attribuer ce déficit à la
perte neuronale corticale dont témoignent les élargissementsventriculaires. Les ondes delta correspondant à la déchargesynchrone et généralisée des cellules pyramidales du cortexcérébral, une dépopulation neuronale à ce niveau induit leurréduction en nombre et en amplitude, comme on le voit dans lesdémences dégénératives et plus généralement au cours duvieillissement normal [23]. Étant donnée sa stabilité dans le temps– et sa présence récemment retrouvée chez les apparentés dupremier degré [24] – ce déficit de SLP pourrait ainsi être unmarqueur de trait biologique de la dimension négative de laschizophrénie.
Chez les schizophrènes, la puissance du sommeil à ondes lentesest corrélée à certaines capacités cognitives de l’éveil : attention[25, 26], mémoire déclarative [21, 25] et apprentissagesprocéduraux [25]. On peut donc raisonnablement fairel’hypothèse que le déficit de SLP dans la schizophrénie reflète oucontribue même, au moins en partie, aux troubles cognitifsretrouvés. De fait, Manoach et al. ont récemment mis en évidencechez des schizophrènes traités une absence de consolidationd’apprentissages procéduraux après une nuit de sommeil [27].
Durée de sommeil paradoxal
Parmi les huit études considérées, seule celle qui inclue lespatients en phase aiguë les plus symptomatiques [15] rapporteune différence de proportion de sommeil paradoxal [SP] entrepatients et sujets témoins (8,9 % versus 19,2 %). Mais on sait quele pourcentage de SP ne varie pas proportionnellement avec leTTS : il diminue chez les « petits dormeurs » et, à l’inverse,s’accroît chez les « grands dormeurs » [28]. Or, les malades deKupfer et al. sont ceux qui dorment le moins (253 minutes parnuit en moyenne) ; au cours de l’évolution de leur épisodeschizophrénique – et sous l’effet d’un traitement neuroleptiquepour certains – leur taux de SP se normalise en même temps quele TTS – sans rebond compensatoire (voir infra « Privation desommeil paradoxal »).
Au sein de l’échantillon de patients de Vincent et al. [14], lesschizophrènes souffrant d’hallucinations ont un SPsignificativement plus bref que les autres (12,2 versus 22,6 %) ;Jus et al. ne retrouvent pas cette distinction [13]. Chez despatients traités par neuroleptique, une diminution de laproportion de SP a également été rapportée en période dedécompensation aiguë [29, 30].
D’après ces données, il semblerait que la durée relative du SP soitdiminuée lors des épisodes aigus comportant des symptômespositifs intenses. Néanmoins, les résultats rapportés suggèrentque la diminution de durée et la discontinuité du sommeil durantces phases peuvent expliquer tout ou partie de ce phénomène.
Latence de sommeil paradoxal
L’hypothèse d’une réduction de la latence de sommeil paradoxal(LSP) chez le schizophrène a fait l’objet d’une vaste littérature quirapporte des résultats contradictoires [31] et souffre des biaisméthodologiques propre à l’étude du sommeil chez leschizophrène.
Parmi les huit travaux auxquels on se réfère, trois rapportent unraccourcissement de la LSP (66 versus 124 min [14] ; 65 versus 97
MEDECINE DU SOMMEIL - Année 5 - Juillet - Aôut - Septembre 2008 29
min [16] ; 58 versus 90 min [11]), deux concluent à une LSPnormale [9, 12] ; elle est allongée pour Kupfer et al. (toujours chezsix schizophrènes particulièrement insomniaques [15]) et nonrenseignée dans une étude [13]. Lauer et al. [10] concluent quantà eux à une absence de différence entre la LSP des patients et dessujets témoins (62 versus 72 min). Néanmoins, la LSP mesuréedans le groupe témoin apparaît basse : si l’on se réfère auxnormes habituelles [32], on peut considérer la LSP des patientscomme modérément diminuée dans cette étude.
Là encore, les résultats de Lauer et al. [10] mettent en évidenceune grande variabilité des données dans le groupe desschizophrènes : sur 22 patients, cinq ont une LSP inférieure à 40 minutes (ce qui n’est le cas pour aucun des sujets témoins) etdeux parmi eux s’endorment directement en SP. A contrario,quatre malades ont une LSP supérieure à 120 minutes (l’article nepermet pas d’en dire plus à leur sujet, mais on peut se demanders’ils n’ont pas présenté préalablement une période de sommeil« intermédiaire » (voir infra « Sommeil intermédiaire »).
Le raccourcissement de la LSP semble donc concerner une sous-population de schizophrènes et, là encore, principalement enpériode de décompensation aiguë. Cette sous-population n’estpas véritablement caractérisée à ce jour, mais dans la plupart desétudes, la longueur de la LSP est inversement corrélée à lasévérité des symptômes positifs [10, 11, 16] et à la sévéritégénérale des symptômes [33].
Pour Howland, toutes les pathologies pouvant s’accompagnerd’une réduction de la LSP [narcolepsie, schizophrénie, dépression,delirium tremens et troubles du comportement en SP]partageraient une même anomalie neurobiologique, à savoir unediminution de l’activité monoaminergique au profit du tonuscholinergique [34]. Pour d’autres, la réduction de la LSP dans laschizophrénie serait la conséquence passive du déficit de SLP,hypothèse vérifiée par Reich et al. [35], mais non confirmée à cejour, y compris par les données longitudinales (voir infra).
Le sommeil intermédiaire
Le concept de sommeil intermédiaire (SI) est né de l’analyse parKoresko et al. du sommeil de nuit de malades schizophrènes [36].Il a ensuite été étudié de manière approfondie par Henri Ey et sonéquipe de Bonneval [29].
Il s’agit de périodes, parfois fort longues, durant lesquelles le tracépolysomnographique réalise un mélange des caractéristiques duSL et du SP, inclassable selon les critères de Rechtschaffen etKales. Typiquement, l’EEG inscrit une activité de fond rapide avecdes ondes en dents de scie, au sein de laquelle on trouve desfuseaux, des complexes K et des bouffées de rythme alpha, sansmouvements oculaires rapides ni activation végétative, mais avecune atonie musculaire. D’autres aspects sont décrits : Vincent etal. signalent par exemple des périodes de SL typique avecmouvements oculaires rapides [14].
Selon les critères employés, cette phase représente 1 à 7 % dusommeil des sujets normaux. Habituellement, les périodes de SIprécèdent, suivent ou remplacent celles de SP, mais elles peuventaussi se répartir de manière plus diffuse et survenir alors au coursdu sommeil lent [29].
Chez les schizophrènes, le groupe de Bonneval constate une
augmentation du SI, qui occupe 15 % du sommeil des patientsen phase de rémission et jusqu’à 40 % lors des décompensationsaiguës [29]. D’autres équipes n’ont pas reproduit ces résultats :Julien et al. [37] obtiennent chez 19 schizophrènes un taux de SIinférieur à 7 % quelle que soit la phase évolutive de la maladie(pourcentage cependant significativement supérieur à celui deleur population témoin) et surtout Vincent et al. trouvent uneproportion de SI de moins de 2 % en étudiant 15 jeunesschizophrènes non traités [14].
La divergence des résultats pourrait être due à l’utilisation decritères électrophysiologiques variables pour définir le SI ; maissurtout, on ne peut éliminer une origine médicamenteuse àl’augmentation constatée par Ey et al.
EFFET DES ANTIPSYCHOTIQUES
Les antipsychotiques classiques, parmi lesquels l’halopéridol a étéla molécule la plus étudiée, permettent une améliorationsignificative de l’initiation et de la continuité du sommeil chez lesschizophrènes : un raccourcissement de la LE et uneaugmentation de l’IES ont été constatés par plusieurs auteurs [38-40]. Du point de vue architectural, aucune modification n’a étérapportée hormis un allongement de la LSP au cours dutraitement [38, 40].
L’action des antipsychotiques « de nouvelle génération » restedifficile à évaluer du fait du peu d’études disponibles, des faibleseffectifs inclus et d’importants problèmes méthodologiques. Lamolécule la mieux étudiée est la clozapine, deux articles rendentcompte d’enregistrements comparatifs réalisés sur un total de 39patients et d’un d’effet identique à celui des molécules classiques[39, 41].
Une intéressante méta-analyse de Chouinard et al. compare lesommeil de patients n’ayant jamais reçu d’antipsychotique à celuide patients non traités au moment de l’enregistrement maisl’ayant été durant l’année en cours (toutes moléculesconfondues) : les troubles de la continuité du sommeil, retrouvésdans le premier groupe, le sont en moindre proportion dans lesecond [42]. Ceci confirme que les antipsychotiques ont des effetsrémanents à long terme sur le sommeil des schizophrènes etjustifie l’étude de sujets pharmacologiquement naïfs pourdéterminer les caractéristiques hypnologiques fondamentalesdans cette maladie.
L’effet bénéfique des antipsychotiques sur les anomalies de ladurée et de la continuité du sommeil des schizophrènes plaidebien en faveur d’une origine dopaminergique de celles-ci.Néanmoins, d’autres effets neuromédiatiques desantipsychotiques pourraient également intervenir dans cerétablissement (antihistaminique, antisérotoninergique ouadrénolytique par exemple).
ÉTUDES LONGITUDINALES
Les travaux permettant l’analyse du sommeil de patientsschizophrènes à différents moments de l’évolution de leurpathologie sont rares et se résument à quelques études de cas.
F. Guénolé, P. Domenech, L. Garma, A. Nicolas Sommeil et schizophrénie : une revue des données expérimentales
m i s e a u p o i n t
MEDECINE DU SOMMEIL - Année 5 - Juillet - Aôut - Septembre 200830
Hartmann et al. ont exploré le sommeil d’un patient de 29 ans,hospitalisé et en dehors de tout traitement psychotrope, pendant30 semaines consécutives à raison d’un enregistrementhebdomadaire [43]. Les auteurs concluent à une grandevariabilité du temps de sommeil, sans lien patent avec l’évolutionclinique. Ils ne se sont malheureusement pas intéressés auxévolutions chronologiques de la latence du SP et du taux de SLP.
L’étude longitudinale de Kupfer et al. [15] est d’interprétationdifficile car elle rapporte six cas pour lesquels le rythme, lespériodes d’enregistrement, ainsi que les traitements prescritsdiffèrent, y compris au cours du temps pour un même patient. Onretient que les anomalies de continuité et d’architecture dusommeil se réduisent progressivement avec l’amendement dessymptômes diurnes. En période de rémission, trois patients –dont un ne recevant pas de neuroleptique – conservent un tauxfaible de SLP. Au cours de ce travail, Kupfer et al. ont observé troiscas de rechute délirante, tous précédés d’un allongement de la LEet d’une recrudescence de l’éveil intrasommeil. Plusieurs étudesde cas qui aboutissent à des conclusions similaires existent dansla littérature [29].
L’ensemble de ces résultats confirme l’action positive destraitements antipsychotiques sur les anomalies de l’initiation etdu maintien du sommeil chez le schizophrène. Ces donnéeslongitudinales suggèrent également que la réduction de la LSP,présente chez certains patients, se normalise à distance desépisodes aigus, contrairement à la diminution du taux de SLP quipersisterait à la phase de rémission chez les malades concernés.
COMORBIDITÉS HYPNOLOGIQUES
D’après quelques études, 15 % des enregistrementspolysomnographiques de schizophrènes retrouveraient unnombre significatif d’épisodes de mouvements périodiquesnocturnes des membres [44, 45]. Même si l’on ne dispose pas dedonnées de base fiables concernant des patients naïfs pour lesantipsychotiques, on peut tout de même supposer que ce type demédicament, de par ses effets antidopaminergiques, est la causeprincipale, comme le corroborent plusieurs rapports de cas [46, 47].
Plusieurs travaux tendent également à démontrer que laprévalence du syndrome d’apnées/hypopnées obstructives dusommeil est plus importante chez les schizophrènes que dans lapopulation générale [48, 49]. Là encore, les médicamentsantipsychotiques seraient responsables du phénomène, par lebiais des importantes prises de poids qu’ils occasionnent [50].
PRIVATIONS DE SOMMEIL
Privation totale de sommeil
Koranyi et Lehmann ont soumis six schizophrènes stabilisés à uneprivation totale de sommeil [51]. Ils ont constaté l’apparitionrapide de troubles attentionnels et, après 78 heures de veille, lasurvenue d’un état psychotique aigu chez cinq des sujetsobservés. Une expérience similaire fut tentée quelques annéesplus tard par Luby et Caldwell chez quatre patients catatoniques
[52]. Après 85 heures d’éveil, ceux-ci présentaient uneamélioration symptomatique modérée. Il est à noter qu’aucunrebond de sommeil lent profond ne fut observé chez ces patientsdéficitaires lors des nuits de récupération, constatation à mettrerelation avec le déficit de sommeil à ondes lentes dont nousavons déjà parlé.
Privation de sommeil paradoxal
Suite à la découverte du sommeil REM et de ses liens avec le rêve[53], certains auteurs ont immédiatement supposé que leshallucinations des schizophrènes pourraient être dues à desanomalies du fonctionnement du SP, notamment à des intrusionsvigiles [54]. C’est initialement guidés par ce type d’hypothèse – àpeu près abandonnées depuis – que les psychiatres se sontintéressés à la privation spécifique de SP chez les sujetsschizophrènes. Les résultats de ces études sont consignés dans letableau II.
La privation instrumentale se pratique en laboratoire de sommeil après une ou plusieurs nuits d’enregistrementpolysomnographique de référence. Elle s’obtient en réveillant lessujets au début de chaque phase de SP, pour les laisser serendormir en SL quelques minutes après. Cette technique permetde réduire le SP de plus de 90 % pendant les nuits de privation,au cours desquelles on constate parallèlement une réductionmodérée du TTS et de l’IES, conséquences de la fragmentationartificielle du sommeil [55]. Durant la période de privation, onobserve chez le sujet sain un accroissement progressif de lafréquence des réveils nécessaires et, lors des nuits suivantes, uneaugmentation du SP par rapport à son pourcentage de référence(rebond du SP). Ces deux phénomènes sont réputés traduirel’existence d’une pression homéostatique de SP [55].
Chez les schizophrènes, l’étude princeps est celle d’Azumi et al.qui constatent une absence de rebond de SP après cinq nuits deprivation, chez deux patients sur les trois testés [56]. Zarcone et al.,qui ont réalisé deux nuits de privation chez neuf schizophrènesen décompensation aiguë, répliquent et étayent statistiquementl’absence de rebond [57]. Ce résultat est confirmé, selon unprotocole identique, par Gillin et al. chez huit patients du mêmetype ne recevant aucun traitement psychotrope [58].
Les résultats préliminaires de Zarcone et al. montraient que seulsles patients présentant une symptomatologie positive activen’avaient pas de rebond de SP. À l’inverse, chez les schizophrènesen rémission, le rebond était augmenté [59]. Ainsi, Vogel et Traub,qui ont exploré cinq malades en période de rémission, ontconstaté un rebond normal après une semaine de privationclassique (aidée par la prise nocturne d’amphétamines) [60].
L’absence de rebond de SP après privation spécifique chez leschizophrène est donc une donnée confirmée. Elle semblen’exister qu’au cours des périodes d’exacerbation dessymptômes, et n’est pas causée par la prise de psychotropes.Zarcone et al. [57] pensent qu’une instabilité du sommeil lors dela seconde partie de nuit aboutirait à une impossibilité àmaintenir de longues périodes de SP durant la phase de
MEDECINE DU SOMMEIL - Année 5 - Juillet - Aôut - Septembre 2008 31
récupération, mais cette hypothèse est contredite par une étudede privation partielle réalisée par Jus et al., où aucun rebondn’existait, ni en deuxième partie de nuit, ni en première [61].
La réponse pourrait bien avoir été approchée dans une étude deBarros-Ferreira et al. [62]. Ces auteurs ont réalisé trois nuits deprivation de SP chez onze femmes schizophrènes ; ils constatentun rebond de SP normal sur l’ensemble de l’échantillon, mais uneabsence de rebond chez les six patientes les plus jeunes. Durantles trois jours de privation, ils mettent aussi en évidence une trèsforte augmentation de la proportion de SI. On peut donc fairel’hypothèse que l’absence de rebond de SP après privation chezcertains schizophrènes est due à la diffusion des phénomènesphasiques du SP vers les autres stades du sommeil au cours de laprivation. Cette diffusion se manifesterait sous la forme depériode de SI et empêcherait l’accumulation de pression de SP,elle pourrait expliquer également la réduction du SP chezcertains patients.
De nombreuses données électrophysiologiques évoquent doncl’existence d’un trouble de la régulation du SP à la phase aiguë dela schizophrénie, régulation dont les principaux centres exécutifs sont localisés dans le tronc cérébral. Ceci incite àexplorer l’anatomie et le fonctionnement de ces zones chez les schizophrènes ; dans une des rares études anatomo-pathologiques existantes, Karson et al. [63] ont retrouvé desanomalies d’origine neurodéveloppementales à ce niveau(augmentation du nombre de neurones des principaux noyauxcholinergiques mésopontiques).
CHRONOBIOLOGIE ET SCHIZOPHRÉNIE Plusieurs études actigraphiques ont objectivé des anomalies ducycle repos/activité chez des schizophrènes : diminution despériodes d’activité, retard ou avance de phase, inversion durythme nycthéméral, ou arythmicité du cycle [17, 64] ;constatations qui posent la question d’un désordrechronobiologique sous-jacent.
Mills et al. ont réalisé une expérience de libre cours chez deuxpatients traités [65]. Cette étude a montré l’existence de rythmescircadiens stables (température corporelle, métabolites urinaires),avec une période infracircadienne (légèrement inférieure à 24heures) et donc une tendance tout à fait modérée à l’avance dephase.
L’exploration de rythmes endocriniens (prolactine, hormone decroissance, cortisol) chez neuf patients, n’ayant pas reçu detraitement antipsychotique depuis au moins six semaines, nemontre pas d’anomalie [66]. Le rythme de la sécrétion demélatonine semble lui aussi préservé chez ces patients [67].Toutes ces constatations plaident en faveur de l’intégrité del’horloge interne hypothalamique chez les schizophrènes.
Selon Anna Wirz-Justice et son équipe de Bâle, l’essentiel de ladésynchronisation serait dû aux traitements sédatifs, enparticulier les antipsychotiques classiques. Ceux-ci abaisseraientle seuil circadien d’endormissement, provoquant des périodes desommeil diurne ayant pour conséquence d’entraîner
Tableau II : Résumé des six études de la privation de sommeil paradoxal chez des schizophrènes.
F. Guénolé, P. Domenech, L. Garma, A. Nicolas Sommeil et schizophrénie : une revue des données expérimentales
MEDECINE DU SOMMEIL - Année 5 - Juillet - Aôut - Septembre 200832
progressivement une périodisation ultradienne, puis unearythmisation du cycle repos/activité. Les molécules plusmodernes ne présenteraient pas cet inconvénient [17]. Pour Wulffet al., l’action des médicaments ne suffit pas à expliquer la totalitédes troubles : ces chercheurs mettent l’accent sur l’inadaptationcomportementale aux rythmes sociaux (désafférentation), quientraînerait secondairement la désynchronisation [64].
CONCLUSION
L’étude expérimentale du sommeil des schizophrènes met enévidence des anomalies de l’initiation et de la continuité dusommeil, maximales en phase de décompensation aiguë, maispouvant persister à la phase chronique. D’autres anomalies,architecturales, sont retrouvées par certains auteurs : un déficitde sommeil lent profond qui semble lié à la dimensionsymptomatique négative de la maladie ; et des anomaliestouchant le sommeil paradoxal (diminution de la durée, du tauxet de la latence de sommeil paradoxal, absence de rebond desommeil paradoxal après privation spécifique), qui neconcerneraient que les patients atteints de symptômes positifssévères, en période de décompensation aiguë. De nouvellesétudes bien contrôlées et prenant en compte l’hétérogénéité dela schizophrénie sont encore nécessaires afin de mieuxcaractériser l’organisation du sommeil et de l’éveil chez cespatients. Les données disponibles pourraient néanmoins inspirerd’ores et déjà un volet hypnologique dans la thérapeutique de laschizophrénie, adapté à chaque cas individuel, comprenant unajustement médicamenteux, l’hygiène du sommeil et desmesures chronobiologiques. n
Références[1] American Sleep Disorders Association. International classification of sleep disorders –II: diagnostic and coding manual. Westchester: American Academy of sleep medicine,2005.[2] American Psychiatric Association. DSM-IV-TR : manuel diagnostique et statistique destroubles mentaux [texte révisé]. Paris:Masson, 2003.[3] Lieberman JA, Stroup TS, Perkins DO, eds. Textbook of schizophrenia. Arlington:American Psychiatric Publishing, 2006.[4] Garma L. Insomnia associated with psychiatric disorders. In: Billiard M, ed. Sleep:physiology, investigation and medicine. New York: Kluwer Academic, 2003. p. 227-255.[5] Chemerinski E, Ho B, Flaum M, et al. Insomnia as a predictor for symptom worseningfollowing antipsychotic withdrawal in schizophrenia. Comp Psychiatry 2002;43:393-6.[6] Haffmans PM, Hoencamp E, Knegtering HJ, et al.Sleep disturbance in schizophrenia.BrJ Psychiatry 1994;165:697-8.[7] Hoffstetter JR, Mayeda AR, Happel CG, et al. Sleep and daily activity preferences inschizophrenia: associations with neurocognition and symptoms. J Nerv Ment Dis2003;191:408-10.[8] Garma L. Consultation des troubles du sommeil : aperçus psychopathologiques.Neuro-Psy 1991;6:345-62.[9] Ganguli R, Reynolds CF, Kupfer DJ. Electroencephalographic sleep in young, nevermedicated schizophrenics. Arch Gen Psychiatry 1987;44:36-44.[10] Lauer CJ, Schreiber W, Pollmächer T, et al.Sleep in schizophrenia: a polysomnographicstudy of drug-naive patients. Neuropsychopharmacology 1997;16:51-60.[11] Poulin J, Daoust AM, Forest G, et al. Sleep architecture and its clinical correlates in firstepisode and neuroleptic-naive patients with schizophrenia. Schizophrenia Res2003;62:147-53.[12] Caldwell DF,Domino EF.Electroencephalographic and eye movement patterns duringsleep in chronic schizophrenic patients. Electroenceph Clin Neurophysiol 1967;22:414-20.[13] Jus K, Kiljan A, Wilczak H. Étude polygraphique du sommeil de nuit dans la
schizophrénie. Ann Med Psychol 1968;1:713-25.[14] Vincent JD,Fararel-Guarrigues B,Bourgeois M,et al.Sommeil de nuit du schizophrèneen début d’évolution. Bordeaux Med 1969;2:2089-109.[15] Kupfer DJ,Wyatt RJ,Scott J,et al.Sleep disturbance in acute schizophrenic patients.AmJ Psychiatry 1970;126:1213-23.[16] Tandon R, Shipley JE, Taylor S, et al. Electroencephalographic sleep abnormalities inschizophrenia: relationship to positive and negative symptoms and prior neuroleptictreatment. Arch Gen Psychiatry 1992;49:185-94.[17] Wirz-Justice A, Haug HJ, Cajochen C. Disturbed circadian rest-activity cycles inschizophrenic patients: an effect of drugs? Schizophr Bull 2001;27:497-502.[18] Van der Heiden W, Konnecke R, Maurer K, et al. Depression in the long-term course ofschizophrenia. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2005;255:174-84.[19] Nausieda PA, Weiner WJ, Kaplan LR, et al. Sleep disruption in the course of chroniclevodopa therapy: an early feature of the levodopa psychosis. Clin Neuropharmacol1982;5:183-94.[20] Van Kammen DP,Van Kammen WB,Peters JL.Decreased slow wave sleep and enlargedlateral ventricles in schizophrenia. Neuropsychopharmacology 1988;1:265-71.[21] Goder R,Boigs M,Braun S,et al. Impairment of visuospatial memory is associated withdecreased slow wave sleep in schizophrenia. J Psychiatry Res 2004;38:591-9.[22] Benson KL, Sullivan EV, Lim KO, et al. Slow wave sleep and CT measures of brainmorphology in schizophrenia. Psychiatry Res 1996;60:125-34.[23] Reynolds CF,Kupfer DJ,Taska LS,et al.Slow wave sleep in elderly depressed,demented,and healthy subjects. Sleep 1985;8:155-9.[24] Keshavan MS, Diwadkar VA, Montrose DM, et al. Premorbid characterisation inschizophrenia: the Pittsburgh high risk study.World Psychiatry 2004;3:163-8.[25] Goder R, Aldenhoff JB, Boigs M, et al. Delta power in sleep in relation toneuropsychological performance in healthy subjects and schizophrenia patients. JNeuropsychiatry Clin Neurosci 2006;18:529-35.[26] Forest G,Poulin J,Daoust AM,et al.Attention and non-REM sleep in neuroleptic-naivepersons with schizophrenia and control participants. Psychiatry Res 2007;149:33-40.[27] Manoach DS, Cain MS, Vangel MG, et al. A failure of sleep-dependent procedurallearning in chronic, medicated schizophrenia. Biol Psychiatry 2004;56:951-6.[28] Monroe LJ. Psychological and physiological differences between good and poorsleepers. J Abnorm Psychol 1967;72:255-64.[29] Ey H, Lairy GC, Barros-Ferreira M, et al, eds. Psychophysiologie du sommeil etpsychiatrie. Paris: Masson, 1973.[30] Keshavan MS, Reynolds CF, Kupfer DJ. Electroencephalographic sleep inschizophrenia: a critical review. Comp Psychiatry 1990;31:34-47.[31] Zarcone VP, Benson KL, Berger PA. Abnormal rapid eye movement latencies inschizophrenia. Arch Gen Psychiatry 1987;44:45-8.[32] Williams RL, Karacan I, Hursch GJ. Electroencephalography [EEG] of human sleep:clinical applications. New York: John Wiley & Sons, 1974.[33] Tandon R, Shipley JE, Eiser AS, et al. Association between abnormal REM sleep andnegative symptoms in schizophrenia. Psychiatry Res 1989;27:359-61.[34] Howland R. Sleep-onset Rapid Eye Movement periods in neuropsychiatric disorders:implications for the pathophysiology of psychosis. J Nerv Ment Dis 1997;185:730-8.[35] Reich L,Weiss BL, Coble P, et al. Sleep disturbance in schizophrenia: a revisit. Arch GenPsychiatry 1975;32:51-5.[36] Koresko RL, Snyder F, Feinberg I. Dream time in hallucinating and non hallucinatingschizophrenic patients. Nature 1963;199:1118-9.[37] Julien R, Balzamo E, Dufour H, et al. Sommeil de nuit des psychoses aiguës etchroniques. Encéphale 1980;6:371-80.[38] Taylor SF, Tandon R, Shipley JE, et al. Effect of neuroleptic treatment onpolysomnographic measures in schizophrenia. Biol Psychiatry 1991;30:904-12.[39] Wetter T, Lauer CJ, Gillich G, et al. The electroencephalographic sleep pattern inschizophrenic patients treated with clozapine or classical antipsychotic drugs. J PsychiatRes 1996;30:411-9.[40] Maixner S, Tandon R, Eiser A, et al. Effects of antipsychotic treatment onpolysomnographic measures in schizophrenia: a replication and extension. Am JPsychiatry 1998;155:1600-2.[41] Hinze-Selch D, Mullington J, Orth A. Effects of clozapine on sleep. Biol Psychiatry1997;42:260-6.[42] Chouinard S, Poulin J, Stip E, et al. Sleep in untreated patients with schizophrenia: ameta-analysis. Schizophr Bull 2004;30:957-67.[43] Hartmann E,Verdone P,Snyder F.Longitudinal studies of sleep and dreaming patternsin psychiatric patients. J Nerv Ment Dis 1966;142:117-26.[44] Benson KL, Zarcone VP. Sleep abnormalities in schizophrenia and other psychoticdisorders. Rev Psychiatry 1994;13:677-705.[45] Ancoli-Israel S,Martin J, Jones DW,et al.Sleep-disordered breathing and periodic limbmovements in sleep in older patients with schizophrenia.Biol Psychiatry 1999;45:1426-32.
m i s e a u p o i n t
MEDECINE DU SOMMEIL - Année 5 - Juillet - Aôut - Septembre 2008 33
[46] Kraus T, Schuld A, Pollmächer T. Periodic leg movements in sleep and restless legssyndrome probably caused by olanzapine. J Clin Psychopharmacol 1999;19:478-79.[47] Wetter TC, Brunner J, Bronisch T. Restless legs syndrome probably induced byrisperidone treatment. Pharmacopsychiatry 2002;35:109-11.[48] Takahashi KI,Shimizu T,Sugita T,et al.Prevalence of sleep-related respiratory disordersin 101 schizophrenic patients. Psychiatry Clin Neurosci 1998;52:229-31.[49] Sharafkhaneh A, Giray N, Richardson P, et al. Association of psychiatric disorders andsleep apnea in a large cohort. Sleep 2005;28:1405-11.[50] Wirshing DA, Pierre JM, Wirshing WC. Sleep apnea associated with antipsychoticinduced obesity. J Clin Psychiatry 2002;63:369-70.[51] Koranyi EK,Lehman HE.Experimental sleep deprivation in schizophrenic patients.ArchGen Psychiatry 1960;2:534-44.[52] Luby ED, Caldwell DF. Sleep deprivation and EEG slow wave activity in chronicschizophrenics. Arch Gen Psychiatry 1967;17:361-4.[53] Aserinski E, Kleitman N. Regularly occurring periods of eye motility, and concomitantphenomena, during sleep. Science 1953;118:273-4.[54] Guénolé F. Rêve et schizophrénie. [Thèse de médecine]. Lyon : Université ClaudeBernard, 2007.[55] Endo T,Roth C,Landolt HP,et al.Selective REM sleep deprivation in humans:effects onsleep and sleep EEG.Am J Physiol Regulatory Integrative Comp Physiol 1998;274:1186-94.[56] Azumi K, Takahashi S, Takahashi K, et al. The effects of dream deprivation on chronicschizophrenics and normal adults: a comparative study. Folia Psychiatr Neurol Jpn1967;21:205-225.[57] Zarcone VP, Azumi K, Dement W, et al. REM phase deprivation and schizophrenia II.Arch Gen Psychiatry 1975;32:1431-36.[58] Gillin JC, Buchsbaum MS, Jacobs LS, et al.Partial REM sleep deprivation, schizophreniaand field articulation. Arch Gen Psychiatry 1974;30:653-62.[59] Zarcone VP,Gulevitch G,Pivik T,et al.Partial REM phase deprivation and schizophrenia.Arch Gen Psychiatry 1968;18:194-202.[60] Vogel GW,Traub AC. REM deprivation: the effect on schizophrenic patients. Arch GenPsychiatry 1968;18:287-300.[61] Jus K, Gagnon-Binette M, Desjardins D. Effets de la déprivation du sommeil rapidependant la première et la seconde partie de la nuit chez les schizophrènes chroniques. LaVie Med Can Fr 1977;6:1234-42.[62] De Barros-Ferreira M, Goldsteinas L, Lairy GC. REM sleep deprivation in chronicschizophenics: effects on the dynamics of fast sleep. Electroenceph Clin Neurophysiol1973;34:561-9.[63] Karson CN, Garcia-Rill E, Biedermann J, et al. The brainstem reticular formation inschizophrenia. Psychiatry Res Neuroimag 1991;40:31-48.[64] Wulff K, Joyce E,Middleton B,et al.The suitability of actigraphy,diary data,and urinarymelatonin profiles for quantitative assessment of sleep disturbances in schizophrenia: acase report. Chronobiol Int 2006;23:485-95.[65] Mills JN, Morgan R, Minors DS, et al. The free-running circadian rhythms of twoschizophrenics. Chronobiologia 1977;4:353-60.[66] Van Cauter E, Linkowski P, Kerkhofs M, et al. Circadian and sleep-related endocrinerhythms in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 1991;49:348-56.[67] Mann K, Rossbach W, Muller MJ, et al. Nocturnal hormone profiles in patients withschizophrenia treated with olanzapine. Psychoneuroendocrinology 2006;31:256-64.
F. Guénolé, P. Domenech, L. Garma, A. Nicolas Sommeil et schizophrénie : une revue des données expérimentales