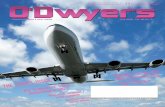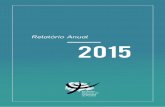Live from the Nebulizer: Annie Lanzillotto and Eviction Survival
Séminaire de la Pr. Annie Fourcaut
-
Upload
univ-paris1 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Séminaire de la Pr. Annie Fourcaut
Aujourd’hui, nous parlerons du bonheur, puisque mon
travail porte sur les représentations et les expériences du
bonheur en France entre 1945 et 1981. Je ne suis pas philosophe
et je ne définirais pas de vrai bonheur. Ceux qui sont venus
pour que je leur révèle le secret du bonheur peuvent encore
sortir…
J’utiliserai donc bonheur au sens du sentiment agréable,
qui peut être expérimenté par un individu, de la sensation
accompagnant la réflexion positive sur soi et sur sa vie (celle
qui accompagne la réponse positive à la question suis-je
heureux ?) et plus généralement, je m’intéresse à la fois à la
manière dont les contemporains l’ont pensé (ce qu’il pourrait
ou devrait être) et éprouvé (leur vécu).
Faire l’histoire du bonheur s’inscrit dans la démarche de
l’histoire sociale et culturelle qui est celle du CHS. C’est
pourquoi la Pr. Annie Fourcaut m’a invité aujourd’hui et je
l’en remercie. C’est également pourquoi il me faut préciser ici
les enjeux de cette recherche : étudiant en master, vous serez
appelé à réaliser des travaux et l’un de objectifs de ce
séminaire et de vous y aider.
L’un des problèmes de l’histoire culturelle, telle qu’elle
peut être pratiqué dans de vénérables institutions, c’est
qu’elle est parfois déconnectée du réel, de la réalité
sociale : les historiens se saisissent des énoncés et les
traitent sans référence à leur influence sociale. L’enjeu,
c’est d’éviter ce défaut et de réaliser une histoire de la
réception de la culture.
1
Par exemple, on peut légitimement étudier les prémisses de
l’écologie dans les années 1945-1975. Mais il ne faut pas se
river à son objet et perdre de vue sa place dans la société de
l’époque, l’importance (ou l’absence d’importance) qu’il avait
pour les contemporains : on ne peut pas prétendre que
l’écologie dominait les préoccupations des Français de cette
époque, à partir de quelques auteurs avants-gardistes, t. q.
Bernard Charbonneau.
Ainsi, l’histoire culturelle ne devrait pas perdre de vue
l’histoire sociale. L’enjeu de l’histoire culturelle, son
objectif un peu utopique, c’est de retrouver le l’esprit du
temps, grâce à l’analyse de la production culturelle de
l’époque, par exemple sur un thème donné. Comme le dit une
heureuse formule d’un éminent historien du CHS, il faut faire
l’histoire sociale du culturel et l’histoire culturelle du
social.
Le problème, dans le monde contemporain foisonnant, c’est
que l’arbre cache la forêt => l’enjeu est donc de partir de la
forêt, pour pouvoir saisir une époque.
Ou alors, on fait le choix inverse, sans doute aussi
légitime, mais qui n’est pas le mien : on analyse les arbres,
un par un. Mais dans ce cas, il sera difficile de dépasser le
niveau biographique ou micro local et de monter en généralité.
A force d’émietter l’histoire, on risque de ne plus parvenir à
rien construire.
Aussi, l’un des enjeux actuels de l’histoire culturelle,
c’est moins celui de la déconstruction, que celui de la
reconstruction. C’est ce que j’ai essayé de faire dans ma
2
recherche, que je vais maintenant vous présenter, en trois
parties : j’évoquerai avec vous l’objet, les sources et leur
traitement.
I le thème : le bonheurLe premier enjeu, c’est de trouver un bon sujet. Je ne me
souviens pas du moment où je me suis décidé à travailler sur le
bonheur. Contrairement aux auteurs de développement personnel
que j’ai étudiés, je ne ferais pas le récit d’une conversion.
Je me souviens en revanche des raisons qui me poussèrent à
choisir ce sujet.
Parmi celles-ci, la plus importante procède certainement
d’une volonté de comprendre la société contemporaine. Je
voulais travailler sur l’histoire récente, et me rapprocher
ainsi de la sociologie. Une chose me frappait : l’omniprésence
du bonheur dans la société contemporaine.
Sur les publicités, au cinéma, partout, le bonheur.
De même, j’avais été frappé par la taille des rayons
« développement personnel » dans les librairies et par le
marronnier du bonheur dans la presse magazine. Mais il n’y a
pas que dans les divers médias que le bonheur est omniprésent.
Dans les discussions, il est également premier, comme le montre
l’économie de l’interaction sociale : lorsque deux personnes se
croisent, ils disent :
_ Bonjour
_ Bonjour
_ ça va ?
3
S’ensuit un embranchement dans cette séquence phatique :
la réponse négative appelle des développements sur ce qui ne va
pas, tandis que la réponse «_bien » permet de passer à la phase
suivante de l’échange social.
Cette scénette quotidienne souligne le constant souci de
vie heureuse qui anime nos contemporains. Chacun essaie d’aller
bien, c’est-à-dire de se sentir heureux, d’éprouver le bonheur.
Je remarquais cela et me demandais s’il en avait toujours été
ainsi. Je désirai donc interroger la genèse de cette hiérarchie
des valeurs. Je voulais également étudier ce que les
contemporains désignent par le terme bonheur : analyser le
contenu du signifiant.
Le second faisceau de raisons qui explique mon choix,
consiste dans mon intérêt pour les subjectivités. Cette
curiosité pour la manière dont chacun perçoit le monde m’a
conduit vers ce sujet : je souhaitais faire une histoire des
sentiments, de la manière dont les perceptions, sensations,
émotions naissent et se développent. Le bonheur me parut un
petit observatoire propice à ce genre d’analyse.
« Idée neuve » selon Saint-Just, le bonheur constituait
également un objet neuf pour l’historien : il fallait
construire une architecture conceptuelle pour le traiter. Je
décidai de porter mes investigations dans trois directions :
les conditions objectives, les représentations et les
expériences. J’estimai que les historiens avaient déjà
largement écrit l’histoire de la réalité objective de ces
années-là : l’histoire matérielle, celle des taux d’équipement
4
par exemple est déjà connue. Je choisissais de m’appuyer sur
ces travaux.
Sur le plan pratique, je décidai donc de lancer mes
investigations en deux directions : les représentations du
bonheur et les expériences. Le premier aspect est désormais
relativement balisé par les historiens, mais le second
constitue certainement un nouveau champ historiographique à
explorer.
J’abordai mon objet avec une série de problématiques :
pour les représentations : quelles sont les diverses
représentations du bonheur en circulation ? Quelle est
l’importance du bonheur ? Quelles ont été ses évolutions de
1945 à 1981 ? Qui a adhéré à quels schèmes et pourquoi ?
En second lieu et à propos des expériences déclarées : qui
a été heureux ? Quels sont les éléments qui conduisent à
l’expérience du bonheur ? Comment les ressentis évoluent-ils et
quels sont les facteurs de ces évolutions ?
Plus généralement, je m’intéresse aux interactions entre
les représentations et les expériences du bonheur : Dans quelle
mesure le sentiment est-il déterminé par la réalité objective ?
Par les croyances préalables ? En d’autres termes, suis-je
heureux lorsque je mange un éclair au chocolat, parce que son
gout objectif est délectable ou parce que le bonheur, c’est de
manger du chocolat…
Enfin, une série de question abordent le problème de la
périodisation :
5
Les subjectivités sont-elles susceptibles d’être
périodisées ? Existe-t-il des phénomènes de synchronisation des
ressentis ?
Et, de manière plus spécifique au champ historiographique
du second XXe siècle, je souhaitais également déconstruire les
« trente glorieuses », locution forgée en 1979, par Jean
Fourastié, économiste chantre du progrès portant un regard
nostalgique teinté par la crise, sur la période précédente.
II les sources : circonscrire un corpus
conséquent et cohérent.Répondre à ces interrogations a soulevé des problèmes
méthodologiques.
Problèmes :
Le foisonnement de l’objet a posé problème :
L’ampleur du sujet nécessitait de mobiliser un corpus
documentaire varié, consistant et cohérent. L’un des principaux
problèmes procédaient du foisonnement de l’objet bonheur :
littérature, sondages, publicités, cinéma, chansons, il s’étale
sur tous les supports. La sélection du corpus devait donc à la
fois permettre la réalisation de cette thèse, c’est-à-dire ne pas
excéder la capacité de travail d’un chercheur isolé, et garantir
la possibilité de saisir des idées et des expériences du bonheur
représentatives de la variété française.
Puisque je ne pouvais pas tout lire, tout voir, tout
étudier, une sélection s’imposait : elle devait être
suffisamment souple pour embrasser, si ce n’est l’exhaustivité
6
des idées du bonheur, tout au moins un large spectre d’entre
elles, présentées par divers supports.
A propos des expériences des acteurs, elles sont souvent
difficiles à dénicher : contrairement au docteur Mengele,
l’historien ne pose pas d’électrodes sur les individus et ne
peux recueillir que des exp déclarées. Or, le temps modifie la
tonalité des expériences et les tentatives d’histoire orale
réalisées se sont révélées peu fructueuses : le processus de
reconstruction mémorielle a remanié les souvenirs et je ne
pouvais atteindre que des récits modelés par les normes et conventions
du XXIe siècle et non par celle de l’époque étudiée.
Pour m’aider, peu d’études sur lesquelles s’inspirer, car
le sujet est neuf : les historiens n’ont pas vraiment étudié
les subjectivités => je devais résoudre ces problèmes seuls.
Les solutions
Pour étudier les représentations, j’ai combiné :
1°) Des énoncés balisant l’ensemble des représentations en
circulation : tous les ouvrages publiés au titre comprenant un
ou des termes appartenant au champ sémantique du bonheur. Pour
ce faire, j’ai utilisé le dépôt légal et sélectionné l’ensemble
des ouvrages publiés en France dont le titre comprend un ou des
termes appartenant au champ sémantique du bonheur, depuis les
philosophiques Propos sur le bonheur d’Alain, publiés dès 1925 mais
constamment réédités dans les années 1960, jusqu’aux romans à
l’eau de rose de Barbara Cartland, en passant par certains
volumes de la série des Brigitte et autres manuels de savoir-
vivre. Au total, j’ai soumis près de 4000 imprimés à un
traitement statistique quantitatif et dépouillé intégralement
7
et de manière qualitative un échantillon d’environ 200
documents.
PP Courbe imprimés bh.
Ce premier massif a permis de baliser le champ des
représentations du bonheur, mais ne permettait pas de mesurer
leur audience.
2°) Pour remédier à ce problème, j’ai eu recours à un
média grand public : le cinéma. Les Français vont massivement
au cinéma dans les années étudiées, j’ai sélectionné des films
à succès : environ 7 films par année étudiée (soit un total de
269 films), en les sélectionnant parmi les 20 films les plus
vus de l’année.
3°) Pour connaître ce que les contemporains avaient retenu
des sagesses passées – depuis l’Antiquité, un grand nombre de
discours sur le bonheur sont parvenus jusqu’à nous – j’ai eu
recours à un type de sources peu utilisé des historiens des
mentalités : les recueils de citations publiés entre 1944 et
1981, qui permettent d’écrire une histoire des traditions du
bonheur actualisées.
4°) Enfin, l’une des spécificités de la période réside
dans le développement d’une riche production à prétention
scientifique portant sur le bonheur : j’ai poussé les
investigations dans cette direction. J’ai pu reconstituer les
linéaments de l’intellection du bonheur : l’histoire de la
pensée sociale sur la vie heureuse projette un nouvel éclairage
sur ses représentations, abordées cette fois-ci par le biais du
savoir théorique et pratique. Dans cette perspective, une
centaine d’ouvrages ont été analysés : des travaux de la pensée
8
critique, tel Eric Fromm, d’économistes, tel Jean Fourastié, de
psychologues, telle Françoise Dolto, de sociologues, tel Edgar
Morin… Les représentations du bonheur ont donc été également
appréhendées par le haut, afin de réaliser une histoire
intellectuelle du bonheur en France entre 1944 et 1981.
Grâce à ce protocole, le corpus documentaire est
consistant et cohérent ; il permet de réaliser une histoire des
représentations du bonheur en France entre 1944 et 1981 : je
n’ai pas tout consulté, mais je n’ai pas présélectionné
l’information ; j’ai pris connaissance de l’essentiel et les
éléments importants n’ont pu m’échapper. Les médias que j’ai
écartés étaient finalement assez redondant par rapport à ceux
que j’ai étudiés. C’est donc l’ensemble des représentations du
bonheur que j’ai abordées.
Pour les expériences, deux massifs ont été isolés, qui
permettent de les retracer, l’un de manière qualitative,
l’autre de manière plus quantitative.
J’avais d’abord fait des essais d’histoire orale et
interrogé quelques individus lambda et quelques spécialistes du
bonheur (psychologues, professeur de yoga, publicitaire). Mais
cette procédure pose de gros problème : exiguité de
l’échantillon ; problème de la reconstruction mémorielle et
fait que les informations les plus intéressantes ne renvoient
qu’au présent de l’interview ; impossibilité d’interroger les
morts, et partant, de travailler sur des périodes anciennes.
Par conséquent, j’ai dû envisager une autre manière de
faire.
9
Je me suis donc saisi des journaux intimes et
autobiographies
Les journaux intimes, autobiographies et albums
photographiques constituent une source documentaire fort riche
en informations sur les processus subjectif.
Différence journaux intimes et autobiographies : les
journaux sont écrits sur le moment ou immédiatement après,
tandis que les autobiographies sont rédigés ex post. Les
secondes subissent donc le biais de la reconstruction
mémorielle. Mais, de la même manière que pour les entretiens,
elles témoignent donc de la configuration subjective de
l’auteur au moment de la rédaction. Si elles sont rédigés au cours
de la période qui intéresse le chercheur, elles sont donc très
utiles.
Ces documents ont d’abord un avantage : contrairement aux
entretiens, ils existent et ne sont pas à inventer. Fort
heureusement l’APA (Association Pour l’Autobiographie) possède
un riche fonds de documents autobiographiques. Cette
association fondée notamment par Ph. Lejeune (elle est évoqué
dans l’article que je vous ai donné) possède une bibliothèque à
Ambérieu-en-Bugey (dans l’Ain, oui, c’est loin, mais bon…)
riche de plusieurs milliers de journaux et autobiographies,
allant de quelques pages à plusieurs milliers. Or ces journaux,
n’en déplaise à Philippe Lejeune, sont utilisables par
l’historien. Pour le justifier, je paraphraserai une phrase
célèbre de Marc Bloch, qui affirme que l’historien est comme
« l’ogre de la légende » : « là où il flaire la chair humaine,
10
il sait que là est son gibier ». Aussi ai-je fait de ces mon
notre gibier. D’ailleurs et depuis une décennie désormais, ils
sont mis à profit par les historiens : les précédents
historiographiques sont désormais nombreux pour justifier un
tel usage.
Toutefois, cette source très riche n’est pas sans poser, à
son tour, une série de problèmes. Face aux archives
personnelles, l’historien est confronté à différents
obstacles, le premier procédant de la problématique
singularité/représentativité : les diaristes sont-ils
représentatifs de la société globale ? Les journaux conservés
sont-ils représentatifs de l’ensemble des diaristes ? Les deux
réponses sont évidemment négatives1. L’ensemble des journaux ne
constitue pas un échantillon représentatif des diaristes ou des
Français, ni un ou deux exemples de journaux tenus par un
enseignant – surreprésentés dans le fonds de l’APA, en raison
de la sociologie des membres de l’association – comme
représentatif de la subjectivité des professeurs. D’ailleurs,
au jeu de la représentativité, je perdais à tout coup, puisque
les diaristes se recrutent plutôt parmi les groupes éduqués et
urbains ; les jeunes femmes y sont surreprésentées, mais le
clivage des genres s’atténue avec l’âge.
Toujours je les ai traité, de ce fait, comme des relations
singulières et les aborderons d’un point de vue micro-
historique, ce qui pose le problème du « régime de
scientificité et notamment [des] procédures d’administration de
1 Lejeune, Philippe et Bogaert, Catherine, Le Journal intime. Histoire et anthologie,Paris, Textuel, 2006, 506 p.
11
la preuve2 ». Mais la pratique microhistorique, désormais
enracinée, s’est révélée féconde : parfois, la singularité
d’une construction personnelle peut atteindre un niveau de
généralité, sans aspirer à la représentativité.
La seconde difficulté procède de la sincérité du diariste
et de sa relation avec son « cher journal », selon l’expression
aux nombreuses occurrences dans le corpus : elles sont
multiples et les pratiques très variables selon les auteurs3.
Certains s’astreignent à une écriture quotidienne, parfois de
style télégraphique ; d’autres y réalisent des relations
régulières mais épisodiques ; d’autres – les plus nombreux –
ont une pratique irrégulière, au gré de leurs désirs d’écriture
intime et des libertés laissées par leur emploi du temps. Par
conséquent, les journaux ne reflètent pas l’intégralité des
sentiments éprouvés par le diariste, qui n’y relate pas tous
les moments de sa vie.
De surcroît, les goûts sont variables dans l’écriture de
soi : tous se construisent réflexivement un roman personnel,
mais certains se servent du processus d’écriture à la manière
de la catharsis analytique et mettent en scène leur malheur et
leur désespoir, parfois de manière manifestement exagérée, ce
qui leur permet de les tenir à distance ; tandis que d’autres
préfèrent au contraire éviter de s’étendre sur leur douleur, et
se remémorer les moments de joie expérimentée dans une forme de
recherche du temps perdu. Par conséquent, les tonalités des
2 Kalifa, Dominique et Artières, Philippe, « L’historien et les archivespersonnelles », Sociétés et représentations, n°13, avril 2002, pp. 7-19, p. 14.3 Lejeune, Philippe, La Pratique du journal personnel : enquête, Nanterre, Publidix,1990, 198 p.
12
journaux ne permettent pas unilatéralement d’apprécier le
bonheur de leur scripteur. Mais ils fournissent un matériel
qualitatif unique pour comprendre les subjectivités
contemporaines et appréhender au plus près les processus de
construction des récits biographiques : dans ma thèse, j’ai
ainsi utilisé 42 journaux et autobiographies.
Parmi eux celui d’Annick, jeune parisienne née en 1967,
appartenant à un milieu social plutôt favorisé, fille de
parents divorcés. Nous possédons ce journal en raison d’un fait
divers tragique : Annick décède d’un accident de moto alors
qu’elle avait 18 ans. Ses parents trient ses affaires,
découvrent les journaux et décident, plus d’une décennie après,
de les confier à l’APA. C’est donc en raison d’un hasard que
nous possédons ce doc : comme souvent en histoire, les
documents nous parviennent de manière fortuite et il est
difficile d’interpréter la présence/l’absence d’un document.
Ce doc est particulièrement beau et riche. Parmi
l’ensemble, non représentatif, des journaux intimes, celui-ci
est particulièrement singulier => toutes les petites filles ne
produisent pas des doc aussi élaboré. Il faut donc faire
attention et le traiter en exemple singulier.
Que trouve-t-on dans ce document qui intéresse l’historien
du bonheur ?
Son journal est parcouru de références explicites aux
sentiments éprouvés lors des activités relatées, mais encore,
les entrées sont surmontées d’un figuré qui synthétise la
tonalité générale du moment4 : Annick a réalisé une échelle
4 Cf. annexe 3, photographies du journal d’Annick.13
graphique inspirée de la météorologie (soleil égale bonheur,
nuage égale malheur) et place en exergue de ses relations le
caractère plus ou moins heureux des moments vécus. De même,
elle réalise parfois une courbe de satisfaction qui indique les
sentiments éprouvés au fur et à mesure de la journée.
L’écriture intime est dominé par la question de son propre
bonheur, et aucune autre norme ne vient s’immiscer dans ses
récits : comme en témoigne la légende, ce qui importe pour
cette jeune fille, ce sont les plaisirs qu’elle a pu éprouver ;
lors du retour sur elle-même, elle les souligne par les
dessins, sans doute pour les revivre ou se les remémorer, plus
simplement parce qu’elle trouve un plaisir réflexif à respecter
la vertu du bonheur. Tout se passe comme si le soleil avait la
fonction du bon point obtenu pour bonne conduite. Or Annick est
une préadolescente : si la création de la taxinomie procède de
son génie individuel, l’attention à soi et à ses joies a été
modelée par les normes adultes, qui ont consacré le bonheur.
Le journal d’Annick témoigne donc en faveur de l’idée du
sacre du bonheur : en 1979, ie l’année de ses douze ans, le
bonheur est devenu, pour cette petite fille imprégnée des
normes parentales, une norme légitime.
TRAns : Les journaux et autobiographies permettent donc
d’écrire, en micro, l’histoire des subjectivités. En les
couplant à un autre type de matériel, macro cette fois ci, ils
permettent de réaliser les « jeux d’échelles », cher à Jacques
Revel et de varier la distance d’analyse. Pour faire l’histoire
14
des subjectivités, il convient en effet d’utiliser un dernier
type de sources.
2°) Pour objectiver grâce à des sources conservées les
sensibilités du second XXe siècle, on dispose d’une masse
documentaire indisponible pour les périodes antérieures : les
sondages et enquêtes d’opinion. Assortis des précautions
méthodologiques habituelles, ils constituent une source
originale susceptible de faire avancer les chantiers de
l’histoire de la réception. Leur analyse offre une alternative
à celle des médias ainsi qu’une perspective nouvelle pour
l’histoire culturelle, trop souvent cantonnée à celle des
discours et des locuteurs. Avec les sondages, on peut envisager
d’apprécier l’adhésion aux récits et la manière dont les
contemporains se les approprient.
Les enquêtes sur le bonheur apparaissent en France au
sortir de la Seconde Guerre mondiale : l’historien a la chance
de posséder pour cette période de vastes collections de
sondages, sérieusement élaborés par des organismes de recherche
publics tels l’INED ou le CEREBE (Centre de Recherche sur le
Bien-Être), ou privés, tels l’IFOP ou la SOFRES. Les enquêtes
subjectives fournissent une masse de données macrosociologiques
particulièrement appréciables. Tout comme aujourd’hui, les
populations sont sondées sur leurs conceptions de la vie
heureuse, sur leur bonheur passé, présent ou à venir, sur leurs
espoirs, sur ce qui leur plaît ou leur déplaît ; en somme sur
de très nombreux aspects de leurs perceptions, expériences et
15
attentes. Rassemblées, ces informations permettent de dessiner
une cartographie de la vie heureuse.
Cependant de nombreux chercheurs dénoncent « l’ivresse des
sondages ». Pour eux « l’opinion publique n’existe pas » :
avant d’être sondés, les individus n’ont pas forcément
d’opinion et n’en produisent une que pour les besoins de la
cause, parce qu’ils étaient tenus de le faire et afin de ne pas « perdre la face »
devant l’enquêteur32. Dès lors, leurs réponses ne sont pas
consistantes et rendent caduque toute tentative
d’interprétation. Certes, les déclarations ne reflètent pas une
opinion publique préalable dont la réalité doit être mise en
doute. Mais les énoncés des questions permettent d’apprécier le
degré de liberté des sondés ; de même, les taux élevés de non-
réponse offrent l’occasion de repérer les questions imposées
par les sondeurs et les réponses vide de sens ou induites. Les
questions ouvertes quant à elles laissent la parole aux sondés,
qui se confient alors plus librement. En outre, force est de
reconnaître que ce problème de la labilité, voire de la vacuité
de l’opinion, se pose moins pour la vie heureuse : la question
du bonheur intéresse les acteurs du second XXe siècle et la
plupart de ces derniers disposent, à cette époque, d’un
outillage mental suffisant pour décrire leurs sentiments.
Les enquêtes sur le bonheur ne nous renseignent cependant
pas sur les humeurs du passé : les réponses résultent d’un
processus cognitif qui dresse le bilan et synthétise le
caractère plus ou moins heureux de la vie du sondé depuis
quelques instants, quelques jours ou quelques mois. Elles ne
signalent donc pas les fluctuations de l’émotion, mais
16
témoignent de la tonalité générale des romans personnels. Sur
ce point, les procédés qui consistent à faire repasser les
questionnaires quelques jours plus tard (test-retest)
démontrent la relative stabilité des mesures du bonheur. Comme
telles, les déclarations témoignent d’un niveau de bonheur
individuel. Agrégées par groupes, elles révèlent des modalités
spécifiques de coloration des récits biographiques.
Plus fondamentale est la question du biais de désirabilité
sociale, selon l’expression sociologique consacrée.
Volontairement ou non, le sondé a tendance à se conformer à sa
représentation des attentes de l’enquêteur. Les réponses
traduisent plutôt l’existence d’une norme sociale de
désirabilité, que la réalité des expériences déclarées. Mais la
mauvaise foi des individus est signifiante : les biais de
désirabilité sociale liés au bonheur sont révélateurs des
normes sociales afférentes à la vie heureuse. Ainsi, se
déclarer plus heureux qu’on ne l’est constitue une forme
d’hypocrisie, qui n’est qu’un hommage que l’homme malheureux
rend à la vertu de la vie heureuse.
Qui plus est, la mise en série de sondages identiques
offre l’occasion de dépasser la première couche de réponses
conventionnelles et convenues, grâce à l’analyse des variations
entre les réponses, plus significatives que celle des valeurs
brutes : avec ce protocole, le biais de désirabilité sociale
peut être circonscrit et l’on obtient des informations sur
l’évolution de l’adhésion aux divers types de récits34. Comme
souvent dans les études sur des sondages, les différences
seront plus instructives que les niveaux absolus, très élevés.
17
Les enquêtes ne permettent pas de savoir ce qu’auraient
répondu la totalité des Français et les réponses concernent
avant tout les sondés. Cependant, les rigoureuses techniques
statistiques de construction des échantillons autorisent à
penser que les réponses, bien qu’elles ne représentent pas
exactement celles qu’aurait données la totalité de la
population française, indiquent les tendances des choix
qu’auraient faits des groupes plus larges. Lorsque les enquêtes
ont été bien réalisées, les choix des sondés signalent, à un
instant t , l’adhésion ou le rejet des représentations proposées
par les sondeurs : ils transmettent donc des informations sur
la prégnance de tel ou tel récit et leur mise en série offre un
nouvel éclairage sur l’évolution de leur influence respective.
Les instituts de sondages n’ont hélas pas daigné me
délivrer les données brutes des enquêtes et les questionnaires
individuels, arguant du caractère privé et marchand des
enquêtes ou de l’inaccessibilité, voire de la destruction des
archives. Impossible dans ces conditions de mener des analyses
factorielles ou de réaliser des tableaux croisés plus
détaillés. Mais les données permettent toutefois de distinguer
diverses catégories sociales, plus ou moins heureuses.
J’ai donc lu la documentation produite par les instituts
de mesure d’opinion, retrouvé les premiers sondages sur le
bonheur, les magazines qui les présentaient… et compulsé
plusieurs centaines d’enquêtes, afin de récolter un matériel
empirique macrosociologique sur les sentiments éprouvés.
18
Malgré les biais dont ils procèdent, ces documents –
sondages et journaux intimes – autorisent un traitement
historien des expériences de la vie heureuse.
Muni de cette architecture théorique, de ces
problématiques et de ses sources, L’enjeu était donc désormais
de parvenir à traiter cet ensemble documentaire : je vais donc
maintenant vous présenter mes résultats.
III les résultats
Ce travail met d’abord en évidence un premier point : le
sacre du bonheur au cours des années étudiées.
Certes, pour Pascal, « tous les hommes recherchent le
bonheur jusqu’à ceux qui vont se pendre » => le bonheur est, de
longue date, reconnu comme quelque chose d’important. Mais les
moralistes des siècles précédents ne portaient pas au pinacle
la valeur du bonheur individuel. Pascal ne faisait ainsi que
constater que les hommes recherchent le bonheur, mais il ne
validait pas forcément cette recherche, qu’il subordonnait à
d’autres valeurs.
Il en est toujours ainsi au XIXe. Flaubert écrit, par
exemple, à sa maitresse, Louise Colet : « le bonheur est comme
la vérole, pris trop tôt, il peut gâter complètement la
constitution. » Mieux encore, Freud montre, dans malaise dans
la civilisation, que « le bonheur n’est pas une valeur
culturelle. ».
19
Contrairement aux prénotions, l’ « idée neuve » l’est
toujours en 1945, et tous les contemporains n’y adhèrent pas :
les groupes catholiques et, dans une certaine mesure,
marxistes, marqués par les traditions doloristes, remettent
encore le bonheur à demain. Redevable à la sociologie de L.
Boltanski pour ses réflexions sur la justification, je souligne
la manière dont le bonheur se déploie dans les systèmes de
valeurs et analyse la constellation normative au sortir de la
Seconde Guerre mondiale : le bonheur n’a qu’une place mineure
au panthéon des valeurs.
Au cours des années 1945-1981, la configuration des
systèmes de valeurs évolue considérablement et le bonheur
devient la norme des normes, une « transcendance dans
l’immanence » qui oriente nos pratiques et les légitiment (ou
les invalident). La « fun morality » (Martha Wolfenstein) se
met en place et les individus se convertissent au bonheur.
Dans les années 1970, plusieurs indices signalent
l’avènement du bonheur et la reconnaissance sociale nouvelle de
cette valeur :
Les magazines grand public lui consacrent de larges
dossiers, qui conduisent à l’apparition du marronnier du
bonheur évoqué tout à l’heure. De même, les milieux économiques
le reconnaissent, à l’instar de l’OCDE, qui tente de construire
des indicateurs sociaux de bien-être, prenant en compte des
aspects subjectifs de la vie sociale. Au niveau politique, le
Bouthan se distingue en créant dès 1972 le BNB le bonheur
national Brut et la France s’inscrit dans ce mouvement, puisque
Giscard crée le Ministère de la qualité de la vie en 1974. Les
20
récentes tentatives de Joseph Stiglitz et Amartya Sen ont donc
un précédent dans les années 1970.
Les années 1945-1981 connaissent donc une « irrésistible
ascension du bonheur ». Le bonheur devient légitime et sa
prégnance s’étend à tous les groupes sociaux, comme je le
montre notamment en m’attardant longuement sur le clivage des
genres : tandis que le bonheur était réservé aux femmes, sous
la forme d’une compensation de leur exclusion publique, il perd
partiellement ce caractère.
Cette « irrésistible ascension » procède à la fois de
raisons négatives – la faillite des autres finalités – et de
raisons positives (on pense désormais que le bonheur est
efficient). Le bonheur subsume désormais sous ces auspices
l’ensemble des autres idées régulatrices. Cette revalorisation
participe de la formation d’une société d’individus réflexifs à
la recherche de la vie heureuse.
Cette norme n’est pas uniquement superficielle et ne reste
pas cantonné dans le ciel des valeurs, mais possède au
contraire des effets concrets et contribue à la formidable
évolution des pratiques repérées par les historiens du
contemporain : les pratiques se modifient « au nom du bonheur »
qu’elles doivent désormais procurer. Le bonheur est donc une
norme effective.
Dans une deuxième partie, portant sur les techniques du
bonheur, terme choisi parce que les contemporains l’utilisent,
je mets en évidence les diverses chemins envisagés et j’analyse
la construction du bonheur.
21
En France et entre 1945 et 1981, les nouveautés en la
matière sont rares, et les évolutions procèdent souvent d’une
réforme cosmétique des sagesses traditionnelles. Mais je
souligne l’essor des recherches empiriques sur le bonheur,
notamment celles issues des disciplines psychologiques.
Les conceptions du bonheur sont souvent négatives : le
bonheur comme absence de malheur. De fait, la voie d’accès la
mieux étoffée consiste à éviter le malheur. Bonheur et malheur
sont asymétriques.
De manière positive, les Français tentent d’abord de
réussir (et je souligne les variations genrées et
générationnels du modèle de la réussite sociale) ; puis, dans
les années 1970, de s’épanouir ; l’accent, placé d’abord sur le
faire, se déplace progressivement vers l’être.
Tous les contemporains n’adhèrent pas avec une intensité
égale aux diverses techniques – leur attractivité dépend
notamment de leur caractère plus ou moins public – et l’analyse
projette un éclairage nouveau sur le changement social : il est
question de l’effet nouveauté, du rôle de la déception et des
mécanismes identitaires et distinctifs à l’œuvre à propos de la
vie heureuse. L’économie du bonheur n’est pas dénuée d’ « effet
de champ » : de grands groupes proposent des modèles sur de
larges échelles, et des avant-gardes audacieuses, explorent des
chemins alternatifs, débouchant, parfois sur des apories,
d’autres fois sur des consécrations sociales. Ainsi, l’idéal de
vie en communauté est un échec mais la revendication d’une
qualité de vie s’impose à la société française. Habitués à leur
salle de bain et à leur machine à laver, certains Français
22
aspirent au bien-être spirituel, au « supplément d’âme » qui
manquerait à la société de consommation : le yoga remplace la
gymnastique.
A ce stade, l’enjeu est de parvenir à saisir les
sentiments éprouvés par les Français et, plus généralement, les
subjectivités, c’est-à-dire la manière dont les acteurs
perçoivent leur vie et leur histoire, les récits qui mettent en
forme leurs expériences, la coloration de leur vécu. Je rends
donc compte des bonheurs des Français.
L’un des objectifs consiste justement à évaluer leur bonheur
entre 1945 et 1981. La notion de bonheur moyen n’est pas sans
poser problème : consiste-t-elle dans le bonheur du plus grand
nombre ? L’extase de quelques-uns compense-t-elle le malheur de
la majorité ? Cette question, qui mérite d’être posée,
n’obtiendra pas de réponse scientifique mais politique ; elle
sera donc laissée à l’appréciation des citoyens…
Nous jugeons que le bonheur moyen augmente lorsque la
proportion de Français qui se disent heureux ou très heureux
croît, et inversement5. Dans cette perspective, nous tentons de
savoir si certaines périodes de l’histoire sont plus propices que
d’autres au bonheur et, le cas échéant, si les années 1944-1981
l’ont été, comme l’indiquent les représentations actuelles des
années 1960-1970. Au travers du petit observatoire du bonheur,
nous reconsidérons la notion d’âge d’or, et tentons de savoir ce5 Pour estimer le bonheur des Français, nous n’avons pas pondéré lesréponses aux questions de satisfactions. De la sorte, nous savons que nouspondérons les réponses (le zéro appartient à l’ensemble de nombres), maisnous distinguons toujours les « plutôt heureux » des « très heureux », afind’éviter l’écueil de la normativité, qui guette toujours derrière despondérations d’apparence neutre.
23
qui permet de qualifier ainsi certaines époques : dans quelle
mesure les événements, individuels et/ou collectifs, peuvent-ils
conduire à une convergence des subjectivités ? Les sentiments,
modelés par le cours de l’histoire privée et publique,
connaissent-ils des phases synchrones ou jaillissent-ils de
manière désordonnée, sans être susceptibles de périodisation
historique ?
A ce stade de la présentation, je me suis dit qu’il était
peut-être utile que je vous emmène faire un tour dans ma cuisine,
comme on dit familièrement. Plutôt que de vous présenter les
résultats, faisons une pause
Pour la France, entre 1944 et 1981, vingt-sept sondages
portent sur le bien-être subjectif des individus, réalisés
auprès d’échantillon de taille supérieure à 1000 personnes.
Tous ne sont pas exactement identiques (l’énoncé varie quelque
peu), mais ils sont assez proches pour pouvoir être mis en
série et former une courbe du niveau de bien-être subjectif des
Français entre 1946 et 1982.
Les vingt-sept sondages ne sont pas réalisés à des
intervalles réguliers. On a plusieurs sondages au sortir de la
Seconde Guerre mondiale ; très peu dans les années 1950 et
1960. Dans les années 1970, le bonheur a gagné une nouvelle
légitimité : à partir de septembre 1973 (et jusqu’à nos jours),
des sondages réguliers sont réalisés ; ils fournissent une
série homogène de données comparables.
Je vous passe la méthode de construction mathématique des
courbes : j’ai essayé d’intervenir le moins possible (ie de ne
pas pondérer les réponses), mais, pour mettre toutes les
24
enquêtes en série, j’ai dû transformer des variables quali
(très heureux, heureux, malheureux, très malheureux) en
variables quanti. Les courbes ci-dessous illustrent la
variation du score moyen de SWB des sondés français entre 1946
et 19826 :
Le bien-être déclarés (ou SWB) connaît donc de fortes
variations entre 1946 et 1982 : Il est au minimum en 1946-48 :
l’effet positif de la Libération ne compense pas les
traumatismes de la guerre ni la tragique situation de la
France : le ravitaillement est mal assuré, le consensus social
de la Libération éclate avec l’éviction des ministres
communistes du gouvernement tripartite (mai 1947) et les
grandes grèves de novembre-décembre 1947, le pays est divisé7.
Sur les plans économique, politique et culturel, les
difficultés sont importantes et le SWB répercute les conditions
de vie délicates. Le SWB fut sans doute minimum au cours de
6 Le tableau des résultats chiffrés se trouvent en annexe 2 tableau 1.7 Mencherini, Robert, Guerre froide, grèves rouges. Parti communiste, stalinisme et luttessociales en France. Les grèves « insurrectionnelles » de 1947/1948, Paris, Syllepse, 1998,308 p.
25
l’hiver 1947-1948. Les graves crises passées, le ravitaillement
s’améliorant8 et la perspective des subsides du plan Marshall
constituent des d’éléments sans doute perçus par la population.
L’été 1948 marque, semble-t-il, une amélioration, puisque le
score remonte en septembre : le ravitaillement est mieux
assuré, la guerre civile semble écartée et les individus sont
plus nombreux à se déclarer heureux. L’année 1948 marque donc
le moment de retournement de la tendance.
Entre 1948 et 1955, il n’y a pas de mesure. En 1955 : 15%
des sondés se déclarent « très heureux », 70% « heureux » ou
« plutôt heureux », 12% « pas très heureux » et 3%
« malheureux » ou « très malheureux »9. L’amélioration est donc
très nette et signale la coloration plus positive des romans
personnels. La tendance à la hausse se poursuit jusqu’au
tournant des années 1960-70.
En 1965, un sondage témoigne d’un bien-être subjectif
élevé : après une décennie de croissance soutenue, les sondés
perçoivent positivement les transformations de leur vie
quotidienne ; le niveau de vie s’est accru, les conditions de
travail se sont améliorées, et la France n’est engagée dans
aucun conflit. Culturellement, les grandes peurs des années
1970 ne se sont pas encore largement propagées. Trois ans avant
les événements de mai 1968, les sondés français voient l’avenir8 Sur la perception du ravitaillement, Cf. Supra, annexes du chapitre 11 :A1_Tableau 3.9 Réalités, décembre 1955, p. 80-88 : Afin d’homogénéiser les données, nousavons transformé ce sondage à six échelons en quatre classes, en maintenantla hiérarchie des significations pour les individus : de la sorte, nousperdons en précision, mais ne modifions pas le sens des réponses. Si nousn’avions pas fait cela, le score moyen aurait été de 13, 67, en raison del’asymétrie des réponses par rapport à la moyenne et de la valeur attribuéeà chaque classe : 18, 33 pour « très heureux » s’il y a six classes contre17,5 s’il n’y en a que quatre, etc...
26
d’un œil plutôt serein. Tout ceci permet de comprendre le haut
niveau de SWB cette année-là.
Entre 1965 et 1973, il a sans doute atteint un maximum :
soit celui-ci a lieu avant mai 1968, qui marque une rupture
pour les contemporains et introduit la France dans une ère
moins sereine ; soit celui-ci a lieu après et, dans ce cas, il
faut comprendre mai 1968 comme le moment où s’ouvre une
alternative. Le chemin du bonheur par le travail et la
consommation reste ouvert, mais de nouveaux idéaux et d’autres
modes de vie heureuse apparaissent. Attractifs, ils sont
empruntés par une part notable de Français qui, dans un premier
temps, sont charmés par la nouveauté. L’ouverture de cette
période permet à un plus grand nombre d’individus de se dire
heureux. Mais l’euphorie des premiers temps passée, la
déception ternit les récits et le sondage de 1973 enregistre
cette évolution négative.
A partir de 1973, tous les pays membres de la Communauté
Européenne sont interrogés, si bien que les points de
comparaison ne manquent pas. Entre 1973 et 1982, les variations
de la satisfaction ne sont pas aussi intenses qu’entre 1948 et
1955 : la proportion de « très » ou « plutôt satisfait » varie
entre 68% et 79% et celle des « très satisfait » entre 10% et
16%. Les écarts existent donc, mais l’amplitude est limitée.
Le niveau général est inférieur à celui de la fin des années
1960, mais supérieur à celui de la Libération.
La tendance générale est à la baisse jusqu’en 1979. En
1976, la courbe plonge assez brusquement et touche un minimum :
c’est le moment où la crise commence véritablement à être
27
perçue en France, où les remises en cause de l’idéal communiste
font florès et conduisent les ex-marxistes à éprouver une
intense déception de leur engagement désenchanté, où le retour
à l’ordre est sensible, à travers les positions des nouveaux
philosophes et les critiques des idéaux soixante-huitards.
Autant de raisons qui permettent de comprendre le déclin de la
satisfaction déclarée en 1976-1977.
Après cette date, la courbe commence une phase de
fluctuation jusqu’en 1979. En avril 1979, elle atteint le
minimum enregistré entre 1973 et 1982 : le second choc
pétrolier, débuté en mars 1979, est immédiatement perçu par des
Français désormais attentifs aux cours, depuis l’expérience du
premier choc de 1973. Sur le plan social, la crise sidérurgique
est perçue par la population10 : elle avive les craintes de
chômage des Français, et leur sentiment de vivre une crise11.
La courbe remonte très doucement après avril 1979, mais les
variations ne sont pas significatives : le bien-être subjectif
des Français stagne jusqu’en avril 1981.
Enfin, entre avril 1981 et avril 1982, le SWB connaît une
brusque remontée : la proportion de satisfaits de 70% à 79% ;
celle des « plutôt pas satisfait » de 22% à 12% ; celle des
« pas du tout satisfait » de 7% à 2%. Les chiffres sont
éloquents : ils signalent une modification importante du SWB
entre ces dates, ce qui justifie notre choix de 1981 comme
borne aval de notre étude. A n’en pas douter, c’est d’abord
l’élection de François Mitterrand à la présidence de la
République qui rend compte de l’abrupte inflexion : les
10 Sur cette question, Cf. Noiriel, Gérard, Longwy…, op. cit…11 Cf. Supra, chapitre 11.
28
individus de droite ne sont pas effrayés par sa victoire,
tandis que ceux de gauche en sont ravis12. C’est la première
fois qu’un socialiste parvient au sommet du pouvoir depuis 1958
et Mitterrand cristallise les espoirs de nombreuses couches
sociales. Aussi le score moyen de SWB s’élève-t-il
considérablement.
Par rapport aux autres pays européens, la France est loin
d’être la championne du SWB, comme le montre le graphique ci-
dessous, qui présente les courbes de l’évolution des notes
moyennes des différents pays de la CEE entre 1973 et 198213 :
PP graph Bh CEE
Au classement des nations dont les habitants se déclarent
les plus heureux, les Français sont donc avant-derniers parmi
les pays de la CEE : seul l’Italie obtient de moins bons scores
que la France. Champions incontestés de la satisfaction, les
Danois. Cette première place des Danois reste d’ailleurs une
constante des sondages de SWB jusqu’à nos jours14. Dans le12 Dès 1977, un sondage de l’IFOP sur « les groupes sociaux favorisés et lagauche » souligne l’absence d’effroi de la part des privilégiés de droite :la majorité d’entre eux estiment que la gauche a de fortes chancesd’accéder sous peu au pouvoir, mais ils ne pensent pas que leur viequotidienne en sera bouleversée. (Sondages, 1978/2, p. 117 sqq. :échantillon de 400 individus représentatifs des cadres supérieurs desentreprises privés et de l’administration, d’industriels, de patrons et deprofessions libérales). A propos des résultats du premier tour del’élection de 1981, J.-J. Becker et S. Berstein notent également que « ladéfaite subie par le candidat communiste a convaincu l’électorat que lecommunisme n’était plus dangereux » (Becker, Jean-Jacques et Berstein,Serge, « L’anticommunisme en France », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 15,juillet-septembre 1987, pp. 17-27, p. 27).13 Tableau chiffré en annexe 2 tableau 3. Graphique réalisé à partir desdonnées de l’Eurobaromètre, 1973-1982.14 Cf. les derniers eurobaromètres parus. De nos jours, les Suédoistalonnent les Danois et parfois les dépassent. Mais dans les années 1970,
29
monde, seuls les habitants du Costa Rica leur dispute la
première place.
L’amplitude des notes moyennes nationales est assez
faible : les Anglais ont le niveau de satisfaction le plus
fluctuant, ce qui correspond aux péripéties des chroniques
anglaises entre 1973 et 1982. De fait, l’indicateur SWB
enregistre avec une certaine fiabilité les soubresauts de
l’histoire. Les Hollandais sont les plus stables. Comme le
remarquent les analystes de l’eurobaromètre, la nationalité est
le plus fort des déterminants du bien-être subjectif 15.
Les différences entre les pays sont en effet assez
importantes, bien que toutes les nationalités semblent plutôt
heureuses. Il convient de distinguer les petites nations,
telles que le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique ou l’Irlande
– à la satisfaction déclarée plus élevée – et les grands pays :
la RFA, la France, l’Italie et dans une moindre mesure la
Grande-Bretagne forment la queue du peloton des pays européens.
Les évolutions des courbes nationales ne procèdent pas
d’un même mouvement, mais doivent être comprises dans les
contextes propres à chaque pays : il est difficile de discerner
une tendance univoque dans l’ensemble de la Communauté
européenne. Toutefois, tous les pays sauf la Grande-Bretagne et
l’Irlande enregistrent une baisse de la satisfaction déclarée
autour de 1976, parfois dès 1975 – au Danemark, aux Pays-Bas et
en RFA – d’autres fois un peu plus tardivement, comme en
France. Ces années là correspondent à la crise économique, qui
touche tous les pays, comme les atteint le désenchantement du
la Suède n’appartient pas à la communauté européenne.15 Eurobaromètre, n° 13, juin 1980, p. 6.
30
monde consécutif à la moindre force des idéaux alternatifs ou
marxistes.
A nouveau, le bien-être subjectif apparaît comme un
indicateur pertinent, qui répercute les fluctuations de
l’histoire : les pays de la CEE traversent un certain nombre de
péripéties communes et leurs satisfactions déclarées en
ressentent les soubresauts, mais leurs propres spécificités les
marquent plus profondément, si bien que les courbes nationales
doivent se comprendre d’abord dans leur contexte particulier.
Le bien-être subjectif, peu répandu au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, se propage dès les années 1950,
atteint un maximum autour de 1970, et reflue quelque peu dans
les années 1970. En 1981, un sursaut indique l’importance de la
composante politique dans cet indicateur.
Après avoir dressé le tableau général de l’évolution du
SWB, J’analyse les facteurs déterminants de la satisfaction
réflexive, et indique que l’argent fait souvent le bonheur.
C’est le premier déterminant du niveau de bien-être subjectif.
Je démontre aussi les liens entre opinion politique et
SWB : les hommes de gauche se déclarent moins souvent heureux
que ceux de droite, mais le sens de la corrélation est
difficile à établir : est-on heureux parce qu’on est de droite
ou bien est-on de droite parce qu’on est heureux ?
Dans la suite, je m’intéresse plus précisément aux divers
composants du bonheur, aux ingrédients du jugement réflexif
31
synthétique : la vie privée et familiale est primordiale,
suivie par le domaine professionnel. Ces deux aspects
déterminent avant tout la couleur du récit biographique.
Mais l’implantation locale est également influente sur le
SWB. Compte tenu du fait que ce seminaire est consacré à
l’histoire urbaine, je vais m’attarder assez longuement sur
cette question et évoquer le bien-être dans les villes, les
campagnes et dans le logement.
Les topiques du bonheur régional : ville-campagne, Paris-
province, équipement
La variable ville-campagne est incorporée au jugement.
Lors d’enquêtes réalisées à la Libération portant sur les
préférences en matière de lieu de vie, les déclarations des
sondés vont à contresens de l’exode rural, qui semble plus subi
que choisi : les réponses signalent la force des thématiques
anti-urbaines valorisant la vie à la campagne. Les femmes y
semblent cependant moins sensibles. Loin de valider les
nombreuses représentations misogynes, l’historien doit
reconnaître l’existence d’un certain tropisme citadin : plus
attachées que les hommes aux plaisirs de la ville (cinémas,
magasins, dancing…), moins sensibles aux loisirs ruraux
(chasse, sports de plein air…), mieux valorisées à la ville
qu’à la campagne où elles sont encore mises à l’écart, les
femmes déclarent moins souvent que les hommes aspirer à vivre à
la campagne.
Au milieu des années 1970, l’attraction des campagnes
semble s’être accentuée : pratiques (mouvements communautaires,
32
néoruraux, périurbanisation) et productions culturelles (Le
Bonheur est dans le pré) ont resserré le lien entre bonheur et vie
rurale. Parallèlement, les récits dénigrant la campagne –
l’affaire Dominici offre l’exemple d’une dévalorisation de la
ruralité – semblent avoir perdu de leur vigueur, tout comme le
mythe du progrès, qui associait ville et technique. Dès lors,
les urbains ne mettent plus en avant leur citadinité, tandis
que les ruraux agrémentent souvent leurs romans personnels de
références à la ruralité, comme L., qui en 1975 rédige une
autobiographie placée sous les auspices de « Tauves, [son]
village ».
L’opposition Paris-Province est également signifiante et
le mythe parisien actif : Dénya., fille de chirurgien née en
1927, débarquée à Paris en 1945, écrit alors dans son journal
que « la moitié de [son] rêve se trouve réalisé ». De nombreux
jeunes Rastignac idéalisent la capitale, qui leur promet monts
et merveilles… En 1951, une « enquête psycho-sociale sur
Paris » suggère que le sentiment de Dénya n’est pas singulier :
le bonheur d’habiter Paris, fréquemment évoqué, procède
largement de l’image féerique de la capitale855. La mythologie
parisienne polarise les provinciaux – elle en aimante certains,
plus jeunes et septentrionaux, et en repousse d’autres, plus
âgés et méridionaux – mais, contrairement au mythe de la
campagne, aucune geste unifiée ne vient structurer l’identité
provinciale, si ce n’est l’opposition à la capitale856.
Les individus intègrent aussi ce qu’ils perçoivent du
développement de l’économie et des infrastructures régionales.
L’état des routes, le maillage scolaire et hospitalier ou
33
encore les offres d’emploi disponibles constituent un ensemble
de paramètres que les acteurs citent volontiers, lorsqu’on leur
demande s’ils sont heureux de vivre dans leur localité. Enfin,
le climat et l’ensoleillement viennent également moduler le
bien-être régional.
Ces paramètres rendent compte des réponses à une question
de 1975 : si 82 % des sondés déclarent que la vie « dans leur
localité » est agréable857, les variations selon la taille de la
commune sont significatives :
- PP diap
Le bon score des communes rurales s’explique à la fois par
la démographie – les grandes vagues d’exode rural passées, ceux
qui sont restés à la campagne avaient sans doute de bonnes
raisons de le faire – et par les supports culturels valorisant
le monde rural.
La satisfaction des Parisiens (banlieusards compris) est
en nette diminution par rapport à 1951, en raison, d’une part,
de la vigueur des critiques à l’égard de la vie en ville ;
d’autre part, de la nouvelle perception des banlieues : le
thème de l’insécurité apparaît au milieu des années 1970 et
plusieurs productions culturelles, à l’instar d’Elle court, elle court,
la banlieue, diffusent l’idée, appelée à un bel avenir, d’une
crise des banlieues858. Depuis le milieu des années 1970, il y
fait donc moins bon vivre, ce qui démarque la France des États-
Unis, où se développent les suburbs.
34
Pour le apprécier le bien-être dans les grandes villes,
deux enquêtes réalisées par la DATAR peuvent être mises à
profit.
Diap PP
S’agissant des régions, seule la Lorraine évolue: entre
1967 et 1974, la satisfaction dans les villes de l’Est diminue,
à mesure que progresse la crise industrielle. Mais les
problèmes économiques peuvent aussi être compensés par d’autres
types d’événements, comme à Saint-Étienne : malgré les débuts
du déclin industriel, il fait encore bon vivre dans cette
ville, au moment où triomphent les Verts. Ainsi la geste
sportive est-elle capable de produire un récit heureux.
Toutefois, la carte souligne que le bien-être citadin dépend de
dynamiques urbaines spécifiques plutôt que du contexte
régional.
L’enquête permet de mieux saisir les ingrédients de ce
bien-être. Ce qui semble séduire dans les cités, ce sont
paradoxalement les moyens d’y échapper : les « environs » ou
les « jardins publics ». Tout se passe comme si les
contemporains voulaient « construire les villes à la campagne
car l'air y est plus pur ». Le seul point positif
intrinsèquement urbain, ce sont « les rues commerçantes »,
appréciées partout. Cet aspect excepté, les réponses variées
correspondent assez bien à la réalité des situations urbaines
particulières : le « climat » est cité « parmi les choses qui
plaisent » par plus de 85 % des Marseillais et des Niçois, mais
par moins de 15 % des Messins et des Rouennais. Il semble
exister, à propos des conditions climatiques, un large
35
consensus des valeurs, les agriculteurs mis à part : le soleil,
sous nos latitudes tempérées, suscite toujours la félicité. De
même, le « calme » n’est guère cité par les habitants de
Marseille, peu réputée pour sa tranquillité. Les « environs »
apparaissent plus souvent dans les choix des habitants des
villes de montagne ou de bord de mer. À l’égard de la ville,
les traductions subjectives correspondent donc assez fidèlement
aux conditions objectives. Toutefois, 69 % des sondés
interrogés lors d’une autre enquête réalisée en 1974 déclarent
« se sentir favorisés par rapport au reste de la France sur le
plan des promenades aux environs », score qui atteint 92 % à
Mulhouse : largement enracinée, cette fierté de clocher vient
modifier les imaginaires locaux et permet, à peu de frais, de
chamarrer les romans personnels.
Trans : Changeant d’échelle, j’en viens ensuite à la
question du logement et du bien-être logement. Alors, « Home
sweet home » ?
À la Libération, les destructions ont aggravé une crise du
logement déjà sensible avant guerre. De nos jours, l’immense
majorité des foyers dispose de logements « tout-confort ».
Cette évolution de l’habitat offre un observatoire propice à
l’étude des liens entre les conditions objectives (les
caractéristiques du foyer) et les jugements subjectifs, et
permet de mesurer l’efficacité des politiques publiques sur le
bien-être.
36
Depuis 1945, toutes les enquêtes mettent en lumière
l’idéal pavillonnaire. Loin de s’atténuer, l’attrait pour la
maison individuelle se renforce, entretenu notamment par les
pouvoirs publics, qui ont mis fin à la construction des grands
ensembles (circulaire Guichard de 1973) et ont promu, entre
autres, les « Chalandonnettes ». Contrairement au nombre et à
la taille des pièces, l’esthétique du logement ou du quartier
n’est pas un paramètre essentiel du bonheur d’habiter.
Très influente sur les jugements, la norme du bon logement
évolue rapidement : en 1945, 32 % des sondés estiment que « la
cuisine peut être utilisée pour se laver », ce qui n’est plus
le cas aujourd’hui. À ce propos, les travaux sur la pauvreté
subjective insistent sur la norme pour mesurer l’impact des
conditions objectives du logement : les sentiments liés à la
possession/privation d’un bien dépendent de sa plus ou moins
grande diffusion dans l’espace social de référence. En 1955, 62
% des ouvriers sondés qui se disent « très bien logés » le font
ainsi sans salle de bains877.
Toutefois, ils sont rares à être satisfaits de leur
logement : 8 % s’estiment « très bien logés », 21 % « plutôt
bien logés », 37 % « moyennement logés », 23 % « plutôt mal
logés » et 11 % « très mal logés ». De même, en 1966, 11 % des
agriculteurs sondés s’estiment « très bien logés », 31 %
« plutôt bien », 43 % « moyennement bien », 11 % « plutôt mal »
et 4 % « très mal ». Ces SWB appartiennent aux plus bas
recensés dans ce travail : le logement est plus souvent mis au
passif et les conventions narratives autorisent, comme pour le
salaire, l’expression de plaintes.
37
La corrélation entre les paramètres objectifs du logement
et les opinions subjectives est toutefois manifeste : ceux qui
s’estiment bien logés ont plus de pièces par personne et plus
souvent une salle de bains ou un jardin. Dans la majorité des
cas, la réalité détermine donc les traductions subjectives, qui
se forment selon des normes consensuelles et largement
partagées. Mais l’opinion de quelques groupes échappe à ce
déterminisme.
Une autre approche du bonheur d’habiter est fournie par
l’enquête logement. Les réponses signalent une légère
amélioration de ce bien-être, témoin la courbe ci-dessous :
- DIap PP
Le sentiment d’être bien logé se construit principalement
à partir de deux paramètres objectifs perçus : la taille de
l’habitat (rapportée au nombre d’habitants) et le confort.
Pourtant, en 1963, « les 3/5 des ménages qui habitent dans un
logement ne disposant apparemment d’aucun confort [pas d’eau
courante] ne s’estiment pas mal logés » et, en 1967, « près
d’un million de satisfaits vivent en état de surpeuplement ». À
l’autre bout de l’échelle, les foyers sous-peuplés sont
satisfaits à plus de 80 % et ceux qui disposent du tout-confort
à 77 %.
« Le sentiment d’être mal logé diminue avec l’âge. »
Pourquoi ? Les jeunes ménages ont moins de revenus et disposent
de logements moins spacieux et moins confortables. Ils sont, en
outre, plus exigeants : habitués au confort, le « tapis roulant
38
des besoins » a élevé leurs aspirations, si bien qu’ils sont
plus difficiles que leurs aînés, lesquels ont vécu dans des
conditions plus dures et ont souvent subi des périodes de
privation qui, par opposition, embellissent à leurs yeux le
moindre confort. Pour cette raison de démographie historique,
liée aux péripéties biographiques différentes selon les
générations, la période paraît heureuse aux yeux des aînés,
mais les cadets bénéficient moins de cet effet de contraste.
Plus généralement, les habitants des communes rurales et des
petites villes se déclarent moins souvent « mal logés », tandis
que les habitants de Paris et des grandes villes, les jeunes et
les ménages à hauts revenus sont plus exigeants que les autres
catégories sociales et sont, à confort et taille de domicile
égaux, moins aisément satisfaits.
Dans les années 1970 et malgré l’apparition de nouveaux
types de nuisances (bruit, insécurité), le SWB logement
s’accroît. Le VIe plan apporte une amélioration objective :
même si les constructions modernes sont loin de faire
l’unanimité, elles constituent un progrès remarqué par leurs
bénéficiaires, qui voient la taille de leur logement et son
confort augmenter. De plus, la médiatisation des problèmes des
bidonvilles et des grands ensembles a modifié la tonalité des
récits à l’égard de son propre logement et vient accroître, en
raison du processus de comparaison sociale, le bonheur éprouvé.
La publicité d’images noires d’autrui – ici sur le logement –
augmente son propre bien-être. Relevons pour conclure que
l’élévation des attentes ne conduit pas à une stagnation du
bien-être au cours du second XXe siècle : les politiques
39
publiques ont eu une efficacité manifeste sur le bonheur des
acteurs.
De même, la manière dont l’histoire est perçue,
influencent également le bien-être déclaré. A l’égard de
l’histoire, je réalise une histoire de l’Histoire subjective
et soulève la question de la satisfaction à l’égard du cours
des choses humaines : comment l’histoire collective influence-
t-elle la satisfaction individuelle ? Quel est son poids par
rapport à l’histoire personnelle ? Quels sont les événements
significatifs pour les divers groupes des Français, ceux qu’ils
retiennent et qui les marquent ? La guerre froide ? La
croissance du PIB, indicateur économique nouvellement médiatisé
dans les années 1960 ? Les jeux olympiques de 1968 ? Qui est
heureux de l’histoire, comment et quand ? Peut-on dégager des
phases plus ou moins propices au contentement face aux
chroniques du temps ? Si oui lesquelles et pourquoi ?
Vous l’avez compris, au cours de ce dernier chapitre, je
réinterroge l’usage de l’expression « trente glorieuses ».
Forgée en 1979 par l’économiste grisonnant Jean Fourastié,
celle-ci s’est imposée de manière quasi immédiate et sans avoir
été objectivé : elle acquiert des majuscules dans les manuels
scolaires dès les années 1980 et aujourd’hui encore, sert de
cadre de référence chronologique à de multiples études
historiques savantes.
Pourtant, elles sont largement infondées. La périodisation
est une opération fondamentale de la profession historienne.
40
C’est un art complexe, dont l’objectif est de constituer une
époque unifiée et qualifiée par un label :
D’une part, l’expression doit résumer à l’extrême ladite
période et permettre une appréhension rapide de ce moment
historique. D’autre part, elle doit d’éviter, autant que
possible, de produire une illusion de vérité : l’aspect du
passé retenu risque de devenir un miroir déformant de la
réalité historique, toujours mouvante et plurielle. Aussi
convient-il de réfléchir longuement avant de retenir telle ou
telle expression. Or ce travail n’a pas été réalisé à propos
des TG.
Deux principes sont en général mobilisés pour périodiser :
Le plus classique est conforme à la tradition scientifique
du chercheur surplombant son objet. On observe une époque, on
la détache des scories non représentatives, on pose des bornes
chronologiques la distinguant des moments précédents et
suivants et on en exprime la quintessence dans une étiquette.
Traditionnellement, la formule qualifie la grandeur de
l’époque, plus ou moins élevée, à la manière du « grand
siècle » ou du « moyen-âge ». Dans ce cas, c’est au chercheur
d’exprimer la vérité du moment, ce qui soulève de nombreux
problèmes : le risque est important d’instrumentaliser le
passé. Par exemple, le XVIIe siècle a été transformé en « Grand
siècle », afin de l’opposer à celui des Lumières.
Désormais, les historiens admettent un autre principe pour
labelliser une période, à rebours des théories positivistes de
41
l’histoire : ils analysent les perceptions contemporaines.
Selon cette perspective, c’est aux contemporains d’avoir saisi
l’esprit de leur temps. Aux historiens d’être capables de
mettre en évidence ces perceptions et de les agglomérer dans
une formule, si possible indigène. Cette méthode explique que
« Renaissance » a été conservée, pour désigner l’époque courant
du milieu du XVe siècle au milieu du XVIe siècle : c’est
notamment parce que G. Vasari popularise la notion de rinascita
que les historiens actuels retiennent ce label.
Ces deux paradigmes s’opposent, mais tous deux ne sont pasdénués de cohérence et de rigueur. Ce sont donc à leur aune quej’ai mesuré la pertinence de l’expression « TrenteGlorieuses ».
Jean Fourastié, idéologues du progrès, nourri d’humanitéschrétiennes et de culture traditionnelle, s’inscrit parmi lestenants du premier principe : son ouvrage tente de montrerqu’ « en vérité, ces années [1945-1975] sont glorieuses. »
les années 1945-1975 ont connu une formidable
reconfiguration des valeurs et des normes. Ce sont celles du
triomphe de l’individu et de son bonheur : l’activité des
hommes est de moins en moins influencée par la recherche de la
gloire. Cette dernière renvoie en effet à une réalisation
publique et a connu un processus de démonétisation. Au
contraire, les bouleversements des pratiques et des éthiques se
réalisent au nom du bonheur. Désormais, l’idéal invite plutôt à
être heureux, qu’à être glorieux.
Partant, le qualificatif « glorieux » n’est pas approprié
pour caractériser la spécificité de cette phase de l’histoire
42
de France : le sacre du bonheur interdit de placer la période
1945-1975 sous les auspices de la valeur gloire.
De surcroit, les propos de Fourastié en 1979 ne sont pas
le résultat d’une analyse scientifique, mais procèdent d’un
regard vieillissant et nostalgique.
Dans les années 1950, il a cru à la société des loisirs.
Pour lui, elle devait donner naissance à un homme civilisé,
féru de plaisir intellectuel, parce que Fourastié estimait que
« le plaisir grossier ne convient pas aux longs loisirs ». En
d’autres termes, à force d’avoir du temps libre, les hommes
auraient dû, pour Fourastié, se cultiver.
Dans les années 1960, il a été déçu par la « la
civilisation de consommation » : contrairement à ses
prévisions, l’augmentation du temps de loisir ne conduit pas
mécaniquement à civiliser l’homme.
Dans les années 1970, il évolue : à plus de soixante dix
ans, sa déception face aux évolutions sociales s’est
transformée en nostalgie et celle-ci a radouci son regard
rétrospectif. Il a oublié le dépit ressenti face à la société
de consommation et propose, a posteriori, l’équation croissance =
gloire, éloignée pourtant de la conception traditionnelle.
D’ailleurs, il est forcé de concéder dans son ouvrage que
ce ne sont ni les hauts faits militaires ou culturels, ni les
arts tout de « dérision et de décomposition » qui mènent à la
gloire, mais l’économie.
43
Aujourd’hui, nos valeurs, nos regards et nos objectifs ne
sont plus ceux de Fourastié. Aussi l’historien du XXIe siècle
ne peut accepter comme tel l’énoncé de la vérité d’une époque :
d’une part, une période ne se réduit pas à son histoire
économique et Fourastié lui-même reconnait que les autres
versions de l’histoire ne doivent pas être qualifiées ainsi.
D’autre part, même l’histoire économique de l’époque a des
zones d’ombres, comme le révèle l’existence des laissés pour
compte de la modernité, de ses exclus ou encore des nombreuses
voix dissonantes. Dès lors, le qualificatif « glorieux » parait
mal choisi.
Quelle que soit la manière dont on les qualifie, ces trois
décennies pourraient en revanche correspondre à une période
unifiée : dans quelle mesure constituent-elles une période
d’histoire totale ?
Pour Fourastié, ce sont les années 1945-1975 qui « ont
résolu des problèmes tragiques et millénaires ». Le célèbre
prélude de l’ouvrage, une analyse micro-historique au cours de
laquelle il compare deux villages – Madère et Cessac, en
réalité la même commune, Douelle dans le Lot, en 1946 puis en
1975 – résume l’ensemble de l’argumentation du volume :
L’écart qui sépare Cessac de Madère, et plus encore, du Douelle de 1830 et de 1750,
l’élévation de l’espérance de vie, la réduction de la morbidité et des souffrances physiques, la
possibilité matérielle pour l’homme moyen d’accéder aux formes naguère inaccessibles de
l’information, de l’art, de la culture, suffit, même si cet homme moyen s’avère souvent
indigne de ces bienfaits, à nous faire penser que la réalisation au XXe siècle du Grand Espoir
de l’humanité est une époque glorieuse dans l’histoire des hommes.
44
Certes. Face à la convocation d’aspects aussi consensuels
de la vie humaine, le lecteur ne peut qu’acquiescer. Toutefois,
l’historien peut s’interroger sur la pertinence de la période
chronologique découpée pour saisir ces évolutions majeures.
L’allongement de l’espérance de vie est ainsi un phénomène
qui s’enracine dans un temps plus long (progrès de l’hygiène au
XIXe, découverte du vaccin et des antibiotiques au cours du
premier XXe siècle) et dure bien au–delà de 1975. De même, la
possibilité d’accéder à la culture est une avancée notable,
bien entendu. Force est toutefois de convenir que le processus
ni ne débute pas en 1945 (la diffusion de la lecture au XIXe
siècle en est le préalable), ni ne s’achève en 1975. Enfin, en
ce qui concerne la « réduction […] des souffrances », la
plupart des appareils ménagers qui s’installent dans les foyers
ont été inventés dès avant 1945 : si « Moulinex libére la
femme » dans les années 1950, c’est donc grâce aux efforts
d’une kyrielle d’inventeurs du XIXe et du premier XXe siècles.
De surcroit, les transformations matérielles, qui
permettent à Fourastié de justifier les « Trente Glorieuses »,
n’envahissent massivement le quotidien des Français qu’au
milieu des années 1960 (les bénéfices de la croissance ont
d’abord été absorbés par la reconstruction et les
investissements productifs, puis par les guerres coloniales) :
les taux d’équipement des ménages en biens durables (TV, auto,
frigo, machine à laver et aspirateur) ne dépassent les 50% qu’à
partir des 1965 (sauf pour le réfrigérateur, dont la moitié des
foyers est équipée dès 1963). A suivre les arguments de
45
Fourastié lui-même, les « Trente Glorieuses » ne seraient
glorieuses que dans leur dernière décennie…
Isoler les années 1945-1975 et estimer qu’elles sont
celles où s’est réalisé « le Grand espoir de l’humanité », c’est
mal rendre grâce aux époques précédentes, qui ont largement
participé aux « glorieux » accomplissements, ainsi qu’aux
années suivantes, au cours desquelles les transformations
sociales n’ont pas cessé. Ce découpage semble donc peu adapté à
la réalité historique : non seulement il ne correspond pas aux
césures de l’histoire traditionnelle, qu’elle soit politique,
religieuse, diplomatique ou militaire, mais encore, il fait fi
des paradigmes historiques plus contemporains, tels l’histoire
des techniques ou des objets, l’histoire culturelle ou
l’histoire sociale.
Les TG ne correspondent donc pas à une période d’histoire
totale. Correspondent-elles, à tout le moins, à une période
unifié de l’histoire économique ? En réalité, les synthèses
d’histoire économique reconnaissent l’existence de plusieurs
phases entre 1945 et 1975 : ces années ne sont pas marquées du
sceau de l’unité.
Désormais prévaut, en histoire économique, un récit
établissant un contraste entre deux périodes : la
« reconstruction », depuis la Libération jusqu’au milieu des
années 1950, voire, jusqu’en 1958 ; « l’ouverture », de la fin
des années 1950 jusqu’au choc pétrolier de 1973.
En outre, les historiens de l’économie révèlent
l’existence de signes avant-coureurs de la crise, dès 1967-
46
1968. Il fallait déjà amputer deux ans aux glorieuses – le choc
pétrolier intervient en 1973 – il faut dès lors leur en retirer
sept. Au total, les « Trente Glorieuses » fondent comme peau de
chagrin
Plutôt que d’élaguer la période pour la faire correspondre
à sa supposée gloire, il conviendrait de reconnaître que la
locution « Trente Glorieuses » ne correspond pas à l’expression
d’une vérité historique, ni à la quintessence des années 1945-
1975 : elle est peu conforme aux évolutions sociales et
culturelles et elle homogénéise indûment une période désunie.
Cependant, les années 1945-1975 pourraient correspondre à
une période ressentie comme glorieuse par les Français et,
partant, les « Trente Glorieuses » acquérir une nouvelle
légitimité historiographique. J’en arrive maintenant à examiner
l’usage des TG à l’aune du second principe de périodisation : Y
a-t-il adéquation entre la formule et les expériences des
contemporains, leurs perceptions de l’histoire en cours ?
A ce propos, Fourastié prédit que « les historiens qui,
tôt ou tard, dépouilleront les journaux de la période 1946-
1975, y trouveront peu de témoignages de l’ardeur et de la joie
du peuple français ». En outre, il reconnait la difficulté de
la tâche : « il faudrait évidemment un gros livre pour étudier
d’une manière tant soit peu sérieuse des phénomènes aussi
complexes, où les statistiques sont muettes, où rien n’est
simple, où tout est nuancé, où toute tendance est toujours
accompagnée de tendances différentes, et parfois opposées».
47
Par une analyse serré d’enquêtes d’opinion et de sondages,
je montre que l’Histoire produit des phénomènes subjectifs
synchrones : les interprétations des péripéties collectives ne
sont ni unilatérales, ni purement subjectives, mais largement
intersubjectives, parce que des groupes plus ou moins larges
lisent à l’identique les événements qu’ils perçoivent, devinent
similairement un futur par nature incertain, et partagent des
sentiments à l’égard du cours des choses humaines.
Encore dois-je préciser que leurs lectures, leurs
prévisions et leurs sentiments sont largement canalisés et mis
en forme par les divers discours dont ils prennent
quotidiennement connaissance. Même si tous les individus n’ont
pas éprouvé l’époque de la même façon, à travers les réponses
aux diverses enquêtes sociales, des phases ont pu être
dessinées au cours desquelles certains types de récits
entraînent une adhésion plus large que d’autres.
Entre 1944 et 1947, les années de Libération constituent
d’abord une époque extraordinaire, au cours de laquelle la
guerre est continuée par d’autres moyens, sur les fronts
économiques et diplomatiques. Entre 1948 et 1962, les récits
sur l’histoire semblent empreints de pessimisme, en raison de
difficultés de la reconstruction et des guerres coloniales.
Malgré les rapatriés, les émigrés, les pauvres, et tous
ceux qu’une évolution historique qu’ils n’ont pas appelée de
leurs vœux a rendu malheureux, les années suivantes – soit la
période 1962-75, que je baptise les Treize Heureuses –
constituent une phase plus sereine de l’histoire subjective :
les récits apologétiques suscitent une adhésion plus large
48
qu’auparavant et l’optimisme semble fleurir auprès des
populations sondées. Les années 1968 marquent une rupture, mais
ouvrent l’éventail des possibles et certains s’y engouffrent.
Cette libération vécue par les uns est décriée par les autres,
mais sur un fond de tolérance réciproque. Dès lors, la
proportion de regards heureux portés sur l’histoire en cours
augmente. Certes aucun âge n’a été d’or et il n’est pas
question ici de fabriquer une nouvelle légende dorée des années
1960. Mais force est de constater, entre 1962 et 1975, la
convergence statistique des déclarations des sondés, qui sont
plus nombreux à estimer vivre une époque heureuse, à dire que
l’année a été bonne et à prévoir que la prochaine la sera.
Après 1975, les expériences déclarées restent globalement
positives mais les indicateurs fléchissent et répercutent la
propagation de grandes anxiétés sociales : l’époque devient
celle de la « crise ». L’année 1981 marque une césure perçue
mais l’embellie n’est que de courte durée : la déception
commence à ternir les récits dès 1983.
Finalement, l’analyse des perceptions contemporaines
permet d’en finir avec les TG : les contemporains n’ont,
semble-t-il, pas vécu les années 1945-75 comme une période
glorieuse : plusieurs moments doivent être distingués,
grossièrement, un premier moment de la Libération à la fin de
la guerre d’Algérie, et un second, de 1962 à 1975, sans doute
plus propice à l’apparition de sentiments positifs, mais guère
vécu comme glorieux.
Au terme de cet essai d’histoire subjective, s’impose donc
l’adieu aux « Trente Glorieuses ». Au début des années 1980,
49
cette expression lénifiante a permis d’apaiser les plaies
ouvertes par la crise et a flatté les consciences nationales en
compensant l’atonie de la geste patriotique. Mais elle fait fi
de l’histoire perçue et néglige le poids des événements
diplomatiques, politiques, culturels ou sociaux dans la
structuration des récits sur l’histoire, en imposant un
économisme infondé. Dès lors, il conviendrait sans doute de les
faire disparaître des manuels scolaires.
Sur le plan des normes, des techniques et des récits, les
évolutions françaises ont été rapportées à celles du des pays
voisins, géographiquement et culturellement : la norme bonheur
triomphe dans l’ensemble du bloc occidental ; la plupart des
techniques déployées en France trouvent leur pendant dans les
autres pays ; les subjectivités se construisent à partir
d’ingrédients comparables et évoluent parallèlement dans le
reste de l’Europe. Dans ce processus, je mets en évidence le
rôle des Etats-Unis, promoteur de l’Americain way of life.
Mais, la spécificité française est souligné à plusieurs
reprises : la norme du bonheur y rencontre de plus fortes
oppositions qu’ailleurs, en raison de la force de l’humanisme –
refusant au bonheur le statut de suprême désirable. De même, la
France connaît un décalage chronologique dans le processus de
diffusion de la consommation et plus largement des techniques
du bonheur : les destructions de la guerre, la brusque
modernisation et l’hysteresis des traditions nationales expliquent
ce retard propre à la France dans ce concert des nations.
50
La couleur des récits porte, enfin, la marque d’une
particularité française : les péripéties de l’histoire
politique française n’ont pas leur pendant à l’étranger.
Influentes sur les subjectivités, elles expliquent
partiellement les décalages dans l’évolution de la tonalité
générale des récits individuels : après avoir été ternis durant
la guerre d’Algérie, les romans personnels des Français ont des
couleurs plus positives dans les années 1960, au moment où le
Viêt-Nam perturbe les consciences américaines. De même, leur
composante politique est plus affirmée en France.
J’ai donc réalisé un tableau du bonheur, en trois temps
successifs – le cadre, les formes et les couleurs – qui répond
à plusieurs interrogations historiques.
Au cours des années étudiées, l’aspiration au bonheur des
individus peut plus librement s’épanouir et constitue un levier
important, moteur de transformations sociales. Mais l’idée du
bonheur est aussi instrumentalisée à des fins conservatrices.
Cette duplicité de l’usage social du bonheur n’a du paradoxe
que l’allure : le bonheur constitue un régulateur social, enjeu
de conflits individuels et collectifs et, désormais, chacun
argumente en mobilisant telle ou telle version du bonheur.
En résulte-t-il que nous soyons plus heureux ? Je ne
pourrais faire qu’une réponse de normand à cette interrogation
légitime. D’une part, on peut penser que pour être heureux, il
faut se poser la question du bonheur. Il est donc nécessaire
que la réflexivité soit canalisée par cette problématique.
51
Sinon, on n’est ni heureux, ni malheureux. D’autre part, cette
focalisation sur le bonheur contribue incontestablement à une
hausse des aspirations, peu propice au bonheur, qui dépend
notamment du bilan entre les aspirations et les réalisations
perçues. Mais et ce sera la synthèse de cette question, il
convient de saisir que le sacre du bonheur, en tant que
phénomène social contraignant, contribue à dynamiser la
capacité humaine d’autopersuasion et, partant, la satisfaction
individuelle déclarée. Et à mon sens, pouvoir se dire heureux,
c’est déjà l’être un peu.
52