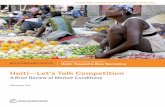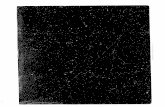Relation Haiti-Rep DOm
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Relation Haiti-Rep DOm
République d’Haïti et République Dominicaine : Une nouvelle forme de
relation (Nord/Sud) entre deux pays du Sud.
Par Sandy R. LAROSE
Quelle est l’importance de la Coopération internationale pour les intellectuels des Sciences
Sociales ? A cet énigme nous répondons catégoriquement qu’il est impossible de comprendre le
développement des pays riches ou pauvres sans comprendre les modes de coopérations qu’ils
entretiennent – et plus encore on ne saurait comprendre le monde de la coopération sans
l’histoire comme outil d’analyse et de soupape à la compréhension des formes de rapports. A tel
enseigne, le Docteur Jean Mary Louis rapporte1 que la colonisation a fait l’usage de la
déconstruction de l’autre pour enfin le reconstruire comme « esclave ». Professeur Jean Fritzner
Etienne quand à lui montre comment les Européens inventent l’ « autre » dans son imaginaire à
travers des actes inimaginables2. Aujourd’hui encore la coopération demeure des rapports de
pouvoir a-t-on remarqué.
Sépulvéda a affirmé que l’Indien est « esclave par nature »3, maintenant les occidentaux ne
parlent plus d’ « esclave » mais de « pauvre », en fait ce qui a changé c’est le vocable, dans le
fait l’image qu’on a de l’autre reste et demeure pareille. Le Pape Alexander VI a insisté sur
l’importance d’humilier les nations barbares pour les convertir à la foi chrétienne4. En ce sens, la
représentation du Noir dans l’imaginaire européen d’alors est celle de l’ « autre » perçu comme
chose postule le professeur Louis dans sa thèse, d’où la non-reconnaissance et l’ignorance
complète de son humanité.
Mais il parait bizarre que nous fassions l’usage de ces arguments tirés de la thèse de Docteur
Jean Mary Louis et de Jean Fritzner Etienne dans le cadre d’un article sur les relations haïtiano-
1 LOUIS Jean Mary, Invention d’Haïti comme société pauvre, Université de Montréal, 2010.
2 ETIENNE Jean Fritzner, Pouvoir, religion et colonisation à l’époque moderne : le cas de l’Empire colonial français
en Amérique, thèse de doctorat soutenue à Paris VII, 2012– et note de cours ENS, UEH, 2013. (P.22)
3 In LOUIS Jean Mary, op cit, p. 210.
4 Ibidem., p.211.
Page | 2
dominicaines. Car, ce sont en fait deux pays du Tiers-monde suivant les caractéristiques5. Mais,
il en demeure un fait que la République Dominicaine se définisse comme une puissance par
rapport à la première République Noire du Monde, Haïti.
Haïti et la République Dominicaine ont des histoires en commun, elles partagent la même île, et
ont toutes deux été occupé par les Etats-Unis d’Amérique. La République Dominicaine se
définisse par rapport à Haïti, ce qui débouche sous une forme de rapport ambigu qui singe sur
les formes de rapports Nord/Sud – République Dominicaine se comporte comme si elle était un
pays du Nord et voit Haïti comme un pays du Sud. Mise à part de cela, les puissances et les
nantis du monde traitent avec la République Dominicaine comme une métropole insulaire.
Nous nous donnons comme objectif dans le cadre de cette recherche de comprendre pourquoi
Haïti et la république Dominicaine, au lieu d’avoir une relation Sud/Sud, les Dominicains se
considèrent comme supérieur et traitent les Haïti comme inférieur.
Pour arriver à nos objectifs fixés, nous utiliserons les notes de cours de Maitrise y compris la
thèse doctorat du professeur Jean Mary Louis. D’autres ouvrages comme l’Indépendance
Haitienne6 , le Barbare imaginaire de Laënnec Hurbon et bien d’autre ouvrages traitant les
thématiques de notre recherche et d’autres articles.
Pourquoi donc les relations haïtiano-dominicaine ? En fait, cet article est le fruit de l’inspiration
de l’avant-dernier cours en classe de Coopération internationale, mais également d’une
conférence organisée par la Fondation Zile en date du 28 Février 2013 sur les relations entre les
deux pays. A travers cette conférence, nous avons pu remarquer malgré la diplomatie était au
rendez-vous dans les débats, les dominicains à notre avis (inconsciemment peut-être) veulent se
montrer supérieur quelques parts aux Haïtiens.
Il parait un peu difficile vu le temps qui nous est accordé et la disponibilité des documents de
vérifier l’origine de ce complexe ; mais nous utiliserons des manuels, des rapports de conférence,
et tout autre moyen. Nous priorisons l’approche compréhensive pour mieux aborder la question.
Nous croyons que nous ne pouvons avancer aucune hypothèse voire confirmer la moindre
5 COMELIAU, Christian. Les relations Nord-Sud, éd. La découverte, Coll. Repère, Paris, 1991. (pp.4- 39).
6 BIRD Marc, L’Indépendance Haïtienne, éd. Fardin, Port-au-Prince, 2013.
Page | 3
d’entre elle sans utiliser des paramètres tel le tourisme, la sécurité frontalière, le commerce, la
migration etc. Nous essaierons de passer en revue ces paramètres, à notre avis, qui semblent les
plus importants en vue de confirmer ou d’avancer une hypothèse relative à notre question de
recherche, puisqu’ils sont le centre des rivalités entre les deux républiques.
L’histoire nous permet de prendre conscience des faits historiques qui font que, nous avons
aujourd’hui un tel type de coopération. Ainsi, nous avons vu l’importance et la nécessité de faire
des recherches sur les rapports existant entre ces deux pays, les systèmes de gouvernement etc.
Haïti et la république dominicaine ont une histoire quelque part commune. On ne saurait
comprendre les dynamiques de la coopération en ignorant complètement ou partiellement
l’histoire qu’elles ont en commun.
I- Problématique
La République d’Haïti et la république Dominicaine partagent l’ile appelée Ayiti, Quisqueya, ou
Bohio, plus tard Hispaniola etc. – ils ont toutes les deux des histoires en fait très différentes et
même à la fois. Deux nations qui sont nées dans de contextes historiques différents. Haïti est
libérée du joug français en 1803 après la bataille du 18 Novembre de cette même année. Les
dominicains de leur coté gagne la guerre haïtiano-dominicaine et ont proclamé leur indépendance
contre le régime de Boyer en 1844.
L’un des professeurs des Universités Dominicaines, Docteur David Alvarez a expliqué lors
d’une conférence les faits historiques qui conduisent à la révolution dominicaine. Il part d’une
date importante 1697 avec le traité de Ryswick qui divisa l’Ile en deux ; puis le traité de Bale qui
donne à la France l’ile entière, en passant par la révolution en Haïti, c’est-à-dire la partie l’Ouest
de l’île7 – pour arriver à 1822 où la République Dominicaine est annexée à Haïti sur le leadership
de Boyer. C’est avec Pablo Duarte qu’est venu l’indépendance de la république Dominicaine,
7 Compte-rendu de la conférence organisé à FOKAL, par la fondation Zile, le 28 février 2013 à Port-au-Prince sur
les relations haitiano-dominicaine. Intervenants : Docteur Arthus Weibert, Ambassadeur Despradel, l’historien
Georges Michel, Professeur David Alvarez.
Page | 4
Duarte n’était pas un soldat comme Dessalines ou Toussaint en guise de comparaison.
Contrairement à ce que pensent bon nombre de gens, en particulier une bonne partie de l’élite
intellectuelle dominicaine, Professeur Alvarez nous a fait savoir qu’Haïti n’a pas été une
métropole pour la République Dominicaine, ni la République Dominicaine n’était pas non plus
une colonie d’Haïti. Pourtant, un fait est certain, la République Dominicaine a construit son
nationalisme avec comme arrière-fond un « anti-haïtianisme » institutionnalisé et exacerbé.
Quand nous prenons Juan Bosch, un historien dominicain de souche haïtienne qui avait déjà
soulevé la question à savoir que les haïtiens en Rép. Dominicaine aurait contribué à sa libération
ou sa séparation d’Haïti. La première armée Dominicaine est formée d’un reste de l’armée
haïtienne. Un autre historien haïtien George Michel a intervenu lors de cette même conférence en
faisant une historicité l’unité de l’ile avec Toussaint Louverture (1801), avec sur tout les
différentes réalisations8 du premier gouverneur général de l’ile d’Haïti ou Hispaniola
9. Il montre
la normalité de la révolution dominicaine. Le divorce entre les deux est du à la dissemblance
entre les peuples selon lui. Les documents historiques montrent clairement le rôle des garnisons
de l’armée haïtienne dans la liberté de la République Dominicaine10
.
Notre problème consiste à comprendre pourquoi la République a vite connu un essor
économique et s’est comporté par rapport à Haïti comme un pays du Nord. Face à cette
préoccupation nous nous posons la question suivante : Pourquoi la République Dominicaine tout
en étant un pays du tiers monde comme Haïti devienne une métropole insulaire ?
Il est indéniable que l’histoire est un outil clé pour comprendre les relations internationales et les
formes de coopération qui existent entre les pays. Dans le cadre de ce travail nous essaierons de
passer en revue, sinon prioriser une approche sur le tourisme, le commerce comme étant des
secteurs économiques les plus important du monde.
8 La route de Dahabon, la ville Bahona. Prof Michel nous dit que sous le gouvernement de Louverture, l’ile était
divisé en 5 départements.
9 Les dominicains préfèrent d’appeler l’ile hispanola, pour montrer leur origine hispanique. Prof Weiber 2013. Et
professeur Michel lors de son intervention à la conférence.
10 Jean Price Mars. Haiti et la Rep. Dominicaine
Page | 5
II- Des traités sur l’ile
5 Décembre 1492, Christophe Colomb débarque sur l’île appelée d’alors Ayiti par les Tainos qui
étaient les premiers habitants de l’ile. Pour un intellectuel comme Edgard Morin, 1492 c’est le
début du système –monde (mondialisation) qui débute avec l’arrivé de ces européens en
Amérique. Leur présence est munie de l’européocentrisme. Un « européocentrisme » qui est basé
principalement sur l’unité de la foi chrétienne de ces européens voyageurs, va engendrer
automatiquement le rejet de l’autre qui n’a pas la même religion, ni la même culture qu’eux.
Nommé Hispaniola, Ayiti prit par la suite le nom de Saint-Domingue. Peuplée à l'origine
d'indiens qui furent exterminés, Haïti fut colonisée par les Espagnols, qui fondèrent la ville de
Saint-Domingue en 1498, mais le traité de Ryswick en 1697, accorda à la France la partie
occidentale de l'île, où des colons français s'étaient déjà établis.
1795, traité de Bâle, l'Espagne cède à la France la partie orientale de l'île, la France restitue les
territoires espagnols conquis au-delà des Pyrénées. L'île est réunifiée sur l'initiative de Toussaint
Louverture pour le plus grand bien de l'économie locale, il donne le nom d'Haïti au nouvel
ensemble.
III- La guerre haïtiano-dominicaine
Les Haïtiens entraient en Guerre contre les Dominicains qui veulent sortir du joug haïtien à un
moment où, même à l’Ouest, c’est-à -dire aux Cayes une rébellion gagne le terrain que l’auteur
nomme sous le nom de l’insurrection de Praslin. La nouvelle n’a pas tardé à atteindre Santo
Domingo qui est assiégé par l’armée haïtienne dirigée par Rivière Hérard, Président de la
République. Il voyait la nécessité de diviser en trois ailes. La première au centre sous sa direction
personnelle, la deuxième dirigée par le général Souffrant et du colonel Brouard, et la troisième
sous la direction du général Pierrot11
.
La première armée n’a pas essuyé d’échec contrairement à la deuxième quand elle atteint la
Fuente del Rodeo, ce fut une catastrophe. Seules les troupes de Rivière Hérard sortait victorieux
à Azua ce 19 mars. L’auteur nous fait remarquer que les Haïtiens défendaient l’intégrité,
11
PRICE MARS Jean, la république d’Haïti et la république Dominicaine, éd. Fardin, collection du Bicentenaire,
Port-au-Prince, 1953.
Page | 6
l’indivisibilité du territoire insulaire en protégeant l’indépendance haïtienne qui serait fragilisé
par la naissance d’une autre république sur l’ile. Mais le danger souligne-t-il c’est qu’on n’a pas
expliqué cela aux dominicains. Donc la guerre haitiano-dominicaine est une guerre
impopulaire. La situation se compliqua puisque, le président, commandant de l’armée n’a pas fait
savoir à ses soldats les vraies raisons de la guerre – il n’a pas non plus une équipe de
ravitaillement pour l’armée – notons que la bataille se fait à plus de six cent kilomètres, tout ceci
a contribué à la désertion continue de l’armée de Rivière Hérard à Azua malgré ses efforts pour
unifier l’ile12
. Le problème de communication est un explicatif de cette situation tragique. En
dépit que le président a envoyé plusieurs lettres à son cousin Hérard Dumesle, ministre de la
guerre, la situation n’a pas changé. Dumesle reste inactif et préfère de profiter des luxes que son
poste lui confère.
Suite aux situations critiques de la gestion de Jean Pierre Boyer de l’île entière, l’insurrection
dans l’Ouest prend plus de poids de jour en jour. Les Dominicains sont mécontents de la gestion
de Jean Pierre Boyer et luttent pour leur indépendance. D’un autre coté, Acaau est l’une des
figures de proue de cette initiative, emmena sous le nom de « l’armée souffrante ». Cette
insurrection en plus des Cayes gagne le département voisin comme la Grande Anse ; ils se
donnaient pour objectif de marcher sur Port-au-Prince. Encore une fois cette situation nous fait
comprendre qu’on est loin d’un Etat moderne. Acaau et ses partisans voulaient s’attaquer au
système socio-politique et économique, d’où leur interrogation sur l’origine de la richesse en
Haïti ; on dirait que la richesse a une couleur. Ainsi, on attribuait à Accau cette phrase célèbre :
« Le nègre riche est un mulâtre et le mulâtre pauvre est un nègre ». Le 13ème
régiment de l’Armée
se retrouve dans les idées révolutionnaires d’Accau, ce qui explique leur déportation à Santo
Domingo.
Jean Price Mars nous montre le poids de la France dans l’indépendance de la République
Dominicaine. Tout se passe par Levasseur, Consul général et chargé d’affaire de France à Port-
au-Prince ; il y a aussi le contre-amiral Alphonse de Moges etc13
. Au premier abord, les Français
avaient pour objectif de remettre l’île sous la domination française. « Le Manifeste », un journal
de l’époque a accusé M. Levasseur de complicité criminelle avec le faussaire présumé et blama
12
PRICE MARS Jean, op.cit p.16
13 PRICE MARS Jean, op.cit, chap II.
Page | 7
le gouvernement haïtien de s’être forcé la main nous rapporte Price Mars. On peut lire dans les
correspondances comment cette scission est orchestrée en grande partie par la France. Voilà un
fait historique qui montre la volonté des grandes puissances à désunir les peuples de ce territoire.
Haïti a perdu cette guerre parce qu’elle était loin d’être Etat moderne, où il y a la centralisation
du pouvoir, l’armée comme outil de contrôle du territoire. On a affaire plutôt à une armée
désorganisée. Mais aussi parque les grandes puissances, notamment la France a orchestré la
division de l’ile en deux Républiques.
IV- L’occupation américaine en Haïti et en République Dominicaine
Haïti et la République Dominicaine ont été occupé par les Etats-Unis d’Amérique, mais les
retombées ne semblent pas les mêmes. Docteur Georges Eddy Lucien stipule que l’occupation
américaine d’Haïti a occasionnée une sorte de centralisation qui, dans la logique de W. F.
Willoughby assure un maximum de contrôle14
. Professeur Sauveur Pierre Etienne admet aussi
que cette occupation a contribué en République Dominicaine à la création d’un Etat moderne qui
dans sa formule caractérisé par l’institutionnalisation des appareils répressifs et administratifs de
l’Etat15
. Mais, cette occupation aussi nous laisse des séquelles socio-économiques
insurmontables en Haïti, telles la dévastation de la couverture forestière, le déboisement de nos
campêches, le vol de nos réserves d’or etc.
La différence entre Haïti et la République Dominicaine c’est dans le mode de développement du
système capitaliste par les Américains. Si en République Dominicaine on crée les industries, en
Haïti les américains créent la main d’œuvre. Ce qui débouche sur le phénomène de braseros et de
Batey. André Corten nous dit que c’est à partir de l’occupation américaine que l’émigration
haïtienne en République Dominicaine devienne de plus en plus massive. Une émigration qui
s’oriente volontairement vers les plantations sucrières d’abord cubaine (1913), puis cubaine
(1919). Il faut dire que bien avant l’occupation américaine de la République Dominicaine, la
dictature instauré par Ulises Hereaux (1887-1899), il y avait une centralisation du pouvoir à
Santo Domingo qui engendra le renforcement des industries sucrières. L’occupant contrôle
14
LUCIEN Georges Eddy, Une modernisation manquée, vol 1. Éd. UEH, Port-au-Prince, 2013. P.88
15 ETIENNE Sauveur Pierre, note de cours, ESN, UEH, 2013.
Page | 8
l’appareil douanier et l’armée et conduit cette république vers un renforcement du système
capitaliste.
V- Rivalité entre République Dominicaine et Haïti
5.1.- L’industrie du tourisme comme vecteur de croissance économique
Le tourisme est une industrie économique qui se définit comme étant toute activité d’une
personne qui voyage pour son agrément, visite une région, un pays autre que le sien pour
satisfaire sa curiosité, son goût de l’aventure et de la découverte, son désir d’enrichir son
expérience et sa culture. L’industrie du tourisme est une source de profit capable de contribuer à
redresser la balance économique et augmenter la croissance d’une île ou d’une région. Dans le
cas de la rivalité entre Haïti et la République Dominicaine, ce secteur est primordial. Pour
certain, Haïti a une avance si on lie le tourisme à la mémoire et à l’histoire.
Dans les économies de la Caraïbe, le taux de chômage atteint des niveaux alarmants. Et les
auteurs tels que Célimène et Salmon attestent que les taux de chômage sont supérieurs à 20%16
.
Ils soutiennent que ces problèmes de croissance faible et de chômage élevé sont liés à des
problèmes spécifiques de gestion publique et de marges de manœuvre étroite en termes de
politique économique. Pour pallier à ce problème, le tourisme est brandi comme une alternative à
la croissance économique et au développement. L’économie caribéenne est reconnue pour sa
faiblesse et sa fragilité. L’industrialisation reste jusqu'à nos jours un grand défit pour la majorité
des pays de la Caraïbe – le tourisme à cet effet selon bon nombre d’auteur est un exit pour
remonter la pente du sous-développement.
5.2.-L’industrie touristique haïtienne
Le tourisme aujourd’hui demeure le mot passe-partout des politiques haïtiens, qui veulent faire
de ce secteur leur cheval de batail. Mais, il semble qu’ils sont entrain de confondre vitesse et
précipitation. Entant que chercheur dans les sciences du développement, on sait que
pertinemment que le « tourisme » doit être le résultat ou le reflet d’un long effort de
16
Célimène et Salmon, 1989
Page | 9
dynamisation d’une société. En d’autres mots, le tourisme est un aboutissement, et non un point
de départ. Le problème c’est qu’en Haïti on veut le faire passer comme point de départ. On peut
par cette démarche sombrer dans une forme de développement cosmétique de la société
haïtienne. Nous sommes en 2013, et le pays n’a pas une salle de cinéma. Même pour notre sport-
Roi, le football, on n’a pas un stade digne de recevoir un match international. La sélection est
obligée de se déplacer pour jouer en territoire étranger et généralement aux Etats-Unis des
matchs de la FIFA. D’où une grande faiblesse dans l’industrie touristique haïtienne. Pour
concurrencer les pays de la Caraïbe, cela suppose de doter le pays des infrastructures qui
desserviraient d’abord la nation haïtienne.
Le secteur du tourisme est Identifié comme étant 4ème
secteur de croissance par l’Ex-Premier
Ministre Duvivier Pierre. Il est considéré comme une pierre angulaire de la nouvelle Haïti tant
rêvée par tous. Mais bizarrement, ce secteur n’a pas une place de choix au Document de
Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (DSNCRP, 2008-2010) et
est traité en parent pauvre dans l’assiette budgétaire de nos gouvernements17
. Accordé une place
importante à ce secteur serait de mettre Haïti sur la voie du développement.
Le tourisme est comme un miroir de l’histoire. Les étrangers doivent voir sur le visage du
peuple, toute la fierté qui serait au visage des Héros comme Jean-Jacques Dessalines, Henry
Christophe, Capois La Mort, Marie-Jeanne, Claire Heureuse pour ne cite que cela. S’il faut se
concentrer sur le tourisme, il faut parallèlement penser à résoudre certains problèmes socio-
économiques et améliorer les conditions de vie du peuple haïtien.
5.2.1.-Le tourisme dans les années 70
Nous tenons à rappeler qu’Haïti faisait parti des premiers pays de la Caraïbe à avoir goûté aux
bénéfices de l’émergence d’un tourisme international après la reconstruction de l’économie
mondiale meurtrie par la seconde guerre mondiale. Il faut se rappeler également qu’à cette
période que le tourisme local se développait très bien dans le pays. La classe moyenne avait un
pouvoir d’achat, et avait accès au moins au service de base. Faire du tourisme local à cette
17
LAROSE Sandy, un pays à reconstruire, un tourisme à repenser, Haiti Progrès, 2012.
Page | 10
époque était quelque chose très ordinaire. Les fêtes champêtres étaient le meilleur moment pour
visiter les meilleurs coins de ce magnifique pays18
.
Quant à la rentabilité, le tourisme occupait dans le PIB 3,5 % et les recettes annuelles
atteignaient jusqu’à 50 millions de dollars US. Ce secteur était devenu capital pour notre
économie nationale et représentait plus de 20 % des exportations en 1970 et générait à lui seul à
cette époque plus de 60 000 emplois directs et indirects19
. Si Haïti était la première destination
de la caraïbe à cette période, ce n’est pas parce qu’on installait des bill-bord couteux sous les
boulevard de Miami, mais c’est parce qu’il y a un travail qui a été fait bien avant20
.
Aujourd’hui si le tourisme existe, il existe bien au rabais, un tourisme-populiste, un tourisme de
faux semblants. Un tourisme sans mémoire, sans histoire, un tourisme qui néglige volontiers la
ville de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines et qui embarque nos visiteurs chez Pétion et Simon
Bolivar à Jacmel. Un tourisme qui ne s’intéresse pas à la chaine des Cahos, la Crète-à-Pierrot,
Ravine-à-couleuvre etc. Peut-il exister un tourisme sans histoire ni mémoires ? Peut-on parler de
tourisme en Haïti quand même les gens de la classe moyenne ne peuvent se payer le luxe de
pratiquer le tourisme local ? Les conditions socio-économiques peuvent être une entrave au
développement de ce secteur. Parallèlement Oasis et Best Western constituent un pas en plus
dans la dynamisation de ce secteur d’activité qu’est l’industrie du tourisme en Haïti. Mise à part
de ces éléments, l’artisanat haïtien est aussi une avance par rapport au tourisme dominicain.
5.3.-Le tourisme dominicain
Le développement économique a donné un résultat efficace et efficient, conduit les pays à en
prendre la voie de l’industrie du tourisme. Haïti et la République Dominicaine comme deux pays
du Tiers-Monde n’ont pas la même politique touristique. On dirait que les dominicains, c’est-à-
dire l’élite dominicaine est consciente de l’importance de cette industrie et y accorde une plus
grande importance.
18
Haiti Progrès, Larose Sandy, op.cit
20 DSNCRP (2008-2010)
Page | 11
Grâce à l’industrialisation, ils ont bénéficiés de grande infrastructure routière et de
télécommunication de dernier cri. D’ailleurs des touristes de tout contrés surnomment la
République Dominicaine « le bijou de la caraïbe ». Les dominicains n’ont rien à envier aux
habitants de Miami en terme d’infrastructure. La plupart des touristes arrivent par l'Aéroport
International Las Américas, l'Aéroport de Punta Cana et l'Aéroport de Puerto Plata. Le pays a
quatre ports modernes: Santo Domingo, Haina, Boca Chica et Contrairement à Haïti, la
République Dominicaine a des infrastructures étonnantes. Elle a la plus grande capacité de
logement de la région caribéenne, avec près de 54.000 chambres. Le rythme de croissance dans
l'offre de chambres a conservé un grand dynamisme jusqu'en 2001, lorsque pour la première fois
elle a commencé à augmenter un taux majeur à celui des années antérieures (3.9%). Pour la
période janvier-septembre 2002 ce taux a été de 2.1%21
.
Le pays a une offre hôtelière diversifiée, car elle possède des petits hôtels ainsi que les plus
grands complexes hôteliers côtiers et des hôtels de luxe métropolitains. Cependant, la
construction des hôtels s'est concentrée dans les zones de plus grand développement touristique
telles que la Région Est et la zone de Puerto Plata, laquelle a plus de 40% de chambres
disponibles. De même, la République Dominicaine possède 12,600 kilomètres de routes qui
relient les différentes villes et destinations touristiques du pays, ce qui permet de voyager avec
facilité par route vers les différents points du territoire22
.
La majorité des touristes qui visitent la République Dominicaine viennent de l’Europe. En 2001
les visiteurs européens constituèrent 48.3% de la totalité des touristes qui séjournent en vacances
dans le pays, suivis par l'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) avec 42.0% et l'Amérique du
Sud, avec 7.6%, tandis que les pays d'Amérique centrale, les Caraïbes et d'autres ont participé
avec le 2.1% restant23
.
Les Etats-Unis est le principal émetteur individuel, avec 29.0%, suivi de l'Allemagne (14.5%),
du Canada (12.4%), de la France (8.5%), de l'Angleterre (6.1%) et de l'Espagne (6.0%). Les pays
21
Document officiel du ministère du tourisme dominicain, 2003.
22 Le tourisme en république Dominicaine, ministère du tourisme, 2003.
23 Op.cit
Page | 12
les plus dynamiques en termes de croissance absolue furent le Canada et les Etats-Unis en
Amérique du Nord, et l'Angleterre et la France en Europe24
.
5.4.-Parallèle entre les deux républiques sur le plan touristique
La république d’Haïti est confrontée a de sérieux problèmes infrastructurels et politiques qui font
que le tourisme est au ralenti durant ces 20 dernières années. Les crises politiques, les émeutes,
les manifestations, les coups d’Etats sanglants sont autant d’événements majeurs qui freinent le
développement de ce secteur en Haïti. Tous ces problèmes énumérés renvoient directement à la
problématique de la sécurité des visiteurs. Il ne peut exister de tourisme sans la stabilité
politique. Contrairement en république voisine, la stabilité politique est depuis ces 20 dernières
années une préoccupation et les dominicains ont compris l’importance d’une telle démarche.
Au niveau infrastructurel, le problème se pose à nouveau. La république d’Haïti ne peut oser
concurrencer la république dominicaine. Il faut d’abord admettre que là-bas, il y a de sérieux
investissement capitaliste, et des infrastructures correspondantes. La république dominicaine
compte à elle seule plus de quatre Aéroport international et des ports modernes. Nous accusons
beaucoup de retard quand aux infrastructures de base.
A notre avis, sur le seul terrain sur lequel on pouvait concurrencer notre voisin, sinon la prendre
de vitesse ; demeure le tourisme-mémoire et histoire sans oublier l’artisanat haïtien. C’est une
stratégie selon laquelle certains pays qui ont un passé glorieux tentent de lier leur tourisme
directement à leur histoire en lieu et place aux grandes infrastructures. Par exemple, on pourrait
faire de la maison de Dessalines à Marchand un lieu touristique. Mais on constate qu’on essaie
de délier l’histoire-mémoire et tourisme en Haïti. Une position qu’on critique souvent en Haïti. Il
faut aussi penser à industrialiser l’artisanat haïtien.
VI- La question de la frontière
La question de la frontière entre la république d’Haïti et la République Dominicaine est
multipolaire, dans le cadre de cet exercice nous tacherons de comprendre la contrebande. La
question de la frontière a été toujours une question épineuse pour l’ile d’Haïti. Une île qui est
24
ibid
Page | 13
divisée en deux ; d’un coté la république d’Haïti à l’Ouest, et la république Dominicaine à l’Est.
Plusieurs traités (Ryswick, Bale) ont été signés dans le temps pour régulariser ce problème.
Aujourd’hui si la frontière résout le problème de la limite des territoires, il en demeure d’autres
problèmes aussi cruciaux comme la contrebande. La grande interrogation est qu’est ce qu’on doit
faire pour résoudre ce problème qui ronge l’économie des deux pays et surtout Haïti ?
La contrebande se définit comme la vente clandestine des marchandises, selon le dictionnaire
Larousse-Bordas, Paris 1998. La contrebande comme fait, est délicat. Et une proposition de
résolution touchera de près la question de frontière, sans laquelle les échanges ne sont possibles.
La contrebande s’accompagne de la production des marchandises. Dans le cadre de la
production, la République Dominicaine atteint un seuil de production supérieure à celui de la
républiques d’Haïti. On ne saurait parler des échanges, de manière équilibrée entre ces deux
Républiques, puisque le flux de marchandises est à sens unique et atteint une proportion
illimitée, tel qu’aujourd’hui, le marché Haïtien est envahi par les produits dominicains.
On notifie que la frontière dominicaine est surveillé par des gardes et des militaires, ces derniers
exercent une vigilance sur tout ce qui entre et laisse le pays. Un contrôle qui va renforcer la
sécurité de cette dite frontière ; d’un autre coté, la partie haïtienne de la frontière est traitée en
parent pauvre par le gouvernement haïtien. On constate que les contrôles varient d’une
marchandise à une autre et pour les moins singulière, car les cargaisons se révélant d’une très
grande importance ne font pas toujours l’objet d’un contrôle méticuleux sinon d’un coup d’œil
furtif suivi d’un droit de passage. Cette faiblesse qu’accuse la partie haïtienne de la frontière
constitue un manque à combler. Le problème de la contrebande ne saurait être résolu, avec une
négligence aussi accrue de la part du gouvernement haïtien.
6.1.-Sécurité frontalière comme moyen de contrecarrer la contrebande
Dans le but de parvenir à une telle résolution, une politique structurelle doit être mise en place.
L’Etat haïtien étant le principal acteur de la politique doit fixer des dispositifs pouvant répondre
aux besoins de sa population. Exemplifions le cas d’Ouanaminthe, cette zone proche de la
frontière est réputée comme une zone où l’intervention de l’E f tat est quasiment inexistante. En
Page | 14
ce sens, il requiert à cette zone une présence de la force répressive de l’Etat, soit une garde
frontalière.
VII- Le commerce
Le commerce devrait être le premier secteur concerné par le gouvernement haïtien s’il veut
rivaliser la république Dominicain. D’une part l’implication du ministère du commerce et
également il relève du domaine de la sécurité nationale. Penser le commerce implique une
relecture de notre situation agricole. Sans oublier ce qu’il y a rapport à la santé, comme on peut
voir ce temps si, le gouvernement haïtien a mis l’interdiction d’entrée de certains produits
dominicains à cause de la grippe aviaire.
Toute la problématique du commerce frontalier entre la république d’Haïti et la république
dominicaine, réside dans le fait que les gouvernements haïtiens ne se donnent pas la peine
d’avoir un contrôle sur la qualité de produits, mais surtout sur la taxation prévue selon les lois
haïtiennes à cet effet. C’est en ce sens que la république voisine se considère comme un Etat du
Nord par rapport à Haïti.
Nous proposons qu’il y ait une garde frontalière bien équipée et formée pour surveiller les
contrebandiers. Aujourd’hui grâces aux nouvelles outils de l’information et de la
télécommunication, l’Etat haïtien pourra jouir des atouts assez intéressants. Par-dessus tout, s’il
n’y a pas une politique anti-contrebande de la part du gouvernement haïtien, l’on n’arrivera
jamais à enrayer ce mal qui frappe notre économie.
Comme nous le savons tous, l’Etat moderne est caractérisé par deux éléments fondamentaux :
c’est la maintenance de la contrainte légitime pour avoir le contrôle de son territoire, et la
capacité de gérer et d’avoir le contrôle de l’appareil administratif et douanier. Si l’Etat haïtien se
veut moderne comme il le prétend, il doit pouvoir contrôler la question de la contrebande sur la
frontière, parce que la véritable victime de la contrebande frontalière demeure l’Etat haïtien,
puisque la production haïtienne aujourd’hui est de très loin inférieure à celle de la république
voisine.
Page | 15
VIII- La migration haïtienne en République Dominicaine
Le flux migratoire dans le cadre de cette réflexion s’inscrit dans l’affluence des haïtiens vers la
République Dominicaine. Cette migration obéit à des contraintes économiques, sociales et
politiques. Ces causes trouvent leur fondement, dans l’incapacité de l’Etat à satisfaire dignement
les besoins de sa population. Les constats rapportent que trois principaux groupes sont ciblés
dans cette émigration vers la République dominicaine, les étudiants, les braseros et les
entrepreneurs qui s’y installent pour leur week-end.
Dans son fameux texte Etre haïtien et migrant à Guyane, Maude Laëthier voit dans la
migration une dimension anthropologique intéressante que quiconque ne peut nier. Le
phénomène migratoire constitue pour la chercheuse de l’IRD un moyen de redéfinir son identité
par rapport à l’autre et propose dans sa thèse une revisite de la notion de l’altérité25
. La migration
constitue un phénomène mondiale qui pour certain contribue au développement et pour d’autre
reste et demeure un handicape majeur, tel le cas d’Haïti et la Rép. Dominicaine. Aujourd’hui, il
est fort de constater que les projets de co-développement réussissent grâce aux migrants26
. Haïti
encore est perdante dans cette dynamique internationale. Tout cela arrive parce que les migrants
sont les détenteurs des connaissances et des informations pertinentes dont eux-seuls disposent sur
le pays d’origine et le pays d’accueil, par contre ils deviennent ipso facto des interlocuteurs
incontournables au développement de projets pérennes27
.
La migration haïtienne vers la République Dominicaine a commencé bien avant l’Occupation
américaine d’Haïti. Mais, elle s’est vite intensifiée avec l’émergence du capitalisme dominicain.
Les Occupants américains favorisaient le départ de plusieurs milliers haïtiens en république
Dominicaine et à Cuba. Selon Carlos Dore Cabral la migration d’Haïtien vers la république
voisine a des liens étroits avec le développement de l’industrie sucrière, d’où le capitalisme
dominicain28
.
25
Laëthier Maude, Etre Haïtien et migrant à Guyane, IRD, 2010.
26 Institut du développement et des relations durable internationales : Migration et Développement, Paris (29-30
mars 2006) ( p2).
27 Ibid.
28 Carlos Dore Cabral, in revue Chemin Critique: migration haïtienne et travail en république dominicaine, vol 2,
No 4., 1991. (p.56)
Page | 16
C’est un impératif pour qu’Haïti sorte de cette situation. Il faut résoudre à tout prix la
problématique du flux migratoire des Haïtiens vers la république dominicaine. En voici quelques
recommandations suivant notre lecture de la situation. Ces recommandations ne sont pas
exhaustives, elles font partie de notre réflexion sur ce sujet.
Déconcentrer les services publiques, c’est-à-dire créer des centres de santé, des
écoles publiques, des hôpitaux, électricité ;
Décentraliser le pouvoir économique, politique et judicaire en Haïti ;
Créer des centres d’attraction dans les zones rurales, tels que places publiques,
salles de cinéma, terrains de football et de basket bal, club littéraires et culturels ;
Favoriser la relance agricole, créer des banques agricoles, former les cultivateur,
irriguer les sols, faire des infrastructures agricoles, offrir des investissements aux
paysans ;
Favoriser la mise en valeur des métiers manuels ;
Construire des programmes d’éducation visant à conscientiser le peuple sur la
nécessité de construire ensemble le pays. Promouvoir l’éducation civique du
peuple;
Favoriser la création d’emploie a haute intensité, et implantation des industries
dans le pays ;
Encourager la création des Universités Publiques et privées.
IX- République Dominicaine et Haïti : nouvelle forme de rapport Nord/Sud
La république d’Haïti et la république Dominicaine partagent l’île malgré les différents conflits
et problèmes. Et si l’histoire de la réunion de l’île devenait une prérogative pour protéger d’une
nouvelle insurrection. Quoique étant séparer par une frontière, on a l’impression que les acteurs
de la communauté internationale parfois traitent avec l’ile comme s’il s’agissait d’un seul et
unique pays où l’Est est vue comme la métropole insulaire. La République dominicaine se
conçoit comme la capitale économique de l’île. Notre problème consiste à comprendre comment
est ce qu’elle est devenue si importante jusqu’à se faire appeler « la république insulaire ».
Page | 17
En lien avec notre question de départ, nous formulons trois grandes hypothèses, qui dans une
certaine mesure mérite d’être confirmée par des recherches beaucoup plus approfondies dans
l’avenir.
9.1.-L’hypothèse économique
Notre première hypothèse est d’ordre économique. L’économie dans le paradigme marxiste est la
réponse à tout. Karl Marx croit que c’est le Capital qui peut expliquer cette tendance. Le
capitalisme à l’américaine a réussi en république Dominicaine et a échoué en Haïti selon Sauveur
Pierre Etienne29
. Du moins selon Sauveur Pierre Etienne, il n’a jamais eu de capitalisme pas
même l’embryon en Haïti. Pourtant les américains ont occupé la République Dominicaine et ont
implanté le système capitaliste avec tout ce qu’il contient comme arsenal : Flux du capital,
implantation de grande industrie, grande infrastructure, grande propriété foncière pour
l’agriculture, croissance économique, la gestion de la croissance démographique etc.
Tout cela expliquerait des centaines et millier de braseros laissant le pays depuis l’occupation
américaine, et également sous Duvalier en grand nombre. Ces haïtiens qui vont en terre voisine
apportent main forte à l’économie et à l’industrie dominicaine d’où au Capitalisme dominicain
sous une volonté américaine. C’est ainsi, certains d’entre eux travaillent dans la construction et
infrastructure. L’hypothèse économique est la plus plausible, sinon la plus efficace pour
expliquer ce phénomène. Car dans ce paradigme c’est l’économie et le marché qui décident de
l’avenir des peuples.
Ainsi nous formulons notre hypothèse de la manière suivante : La république dominicaine se
définit comme une puissance par rapport à Haïti parce qu’elle a connu une grande
industrialisation et a réussi le saut capitaliste.
9.2.-L’hypothèse socio-historique
Notre seconde hypothèse découlant de nos réflexions est inspirée du cours de coopération
internationale de cette session. Avec l’école de la dépendance, on arrive à comprendre le schéma
dominant-dominé parfaitement bien. Mais un auteur comme Samir Amin, nous dirait à propos
29
ETIENNE Sauveur Pierre, Haïti, la République Dominicaine, Cuba : Etat, Economie et Société 1492-2009, L’
Harmattan, Paris, 2011
Page | 18
d’Haïti et de la république Dominicaine que l’esclave est la plus grande explication à ce que
Aujourd’hui la l’Est devienne une métropole insulaire. Haïti était plus exploitée, donc Haïti
aurait besoins plus de temps et d’énergie pour maintienne son économie.
Dans cette hypothèse ci-joint la variable de la pauvreté qui sous-entend une situation dans
laquelle un individu ou un pays se trouve dépourvu des ressources importantes. Quand nous
parlons des ressources de base, nous faisons référence à la capacité de se nourrir, de se vêtir,
d’avoir accès à un logement décent par exemple.
En ce sens nous formulons notre deuxième hypothèse comme suit : La partie l’Ouest était plus
exploitée que la partie l’Est, et aujourd’hui encore cette séquelle demeure. Les grandes
puissances développent une meilleure forme de coopération avec la République Dominicaine
qu’elles n’en ont pas fait avec Haïti.
9.3.-L’hypothèse de la mauvaise répartition des richesses.
La troisième hypothèse de notre travail découle de la mauvaise répartition des richesses et du
même coup accuse les autorités haïtiennes dans leur façon de diriger qui ne prévaut pas le bien-
être du peuple haïtien. Grégoire Eugene à travers son texte le Miracle Haïtien est possible nous
rapporte que moins que 5% de la population détiennent 90% du revenu national – et seulement
10% de ce revenu est redistribué pour plus de 95% de la population. Donc comment comprendre
la situation de ce petit pays sans ces données importantes30
. Il faut aussi passer en revue, le
paiement de la dette de l’indépendance (150.000.000 de Franc Or31
) à la France et la réduction de
moitié les frais de douane. Sans oublier bien sûr en 1915, l’occupation américaine était une
occasion pour les Etats-Unis d’atteindre trois grands objectifs :
1- de nous humilier32
;
30
In Sandy LAROSE, pauvreté, assistanat et pouvoir en Haiti, Hebdomadaire Haiti Liberté, 2013, No44, vol 6.
31 JOACHIM Benoit, Les racines du sous-développement haitien, Ed Deschamps, Port-au-Prince,1989. (P.89)
32 Deuxième partie d’une étude de Marc-Arthur Fils-Aimé [1],Document soumis à AlterPresse le 16 mai 2008
Page | 19
2- d’affirmer son hégémonie dans la zone33
;
3- surtout de nous appauvrir davantage. Les historiens sont unanimes que l’occupation
américaine faisait plus de bien à la national City Bank (qui a emporté notre réserve en or)
qu’elle a fait aux conseillers financiers américains corrompus à cette époque34
.
Suite à ces réflexions, nous formulons notre troisième hypothèse ainsi : La mauvaise répartition
des richesses en Haïti, les méfaits de l’occupation américaine, le paiement de la dette de
l’indépendance sont autant de facteurs explicatifs de notre sous-développement.
33 CASTOR Suzy, L’occupation américaine, CRESFED, 3ème éditions, Port-au-Prince, 1988.
34 LAROSE Sandy, Haïti Progrès. op.cit
Page | 20
Conclusion
Aujourd’hui l’assistanat devient un concept à la mode en Haïti. Ce terme passe-partout est utilisé
péjorativement pour décrire un système de redistribution des richesses ou de solidarité, dont les
effets pervers ruinent la fonction publique et le pays en général. Dans le cadre du paradigme de
la modernisation, on se rend compte que les pays du Nord se ventent d’apporter d’assistance ou
de l’aide humanitaire au pays du Sud. Lors du séisme du 12 Janvier 2013, la République
Dominicaine a trouvé une occasion en or de réaliser son rêve d’être un pays du Nord par rapport
à Haïti.
Il faut être prudent en relation internationale, quand il faut parler d’aide. Il n’y a pas d’aide en
réalité. Il n’y a que le jeu d’intérêt. On donne à l’autre pour le dominer, c’est que nous dit
Latouche. Il faut faire fi la notion de « pays ami » en relations internationales. Il n’y a que de
pays qui cherche leur intérêt (économique, géopolitique, historique etc.). Il faut être un fin-jouet
pour pouvoir tirer son épingle du jeu du système-monde. Le film de Raoul Peck, Assistance
Mortelle témoigne le coté sombre de ces aides « empoisonnées », sinon les « mauvaises fois »
qui peut en résulter dans la façon d’apporter ses « assistantes » à ces pauvres gens.
La thèse de la pauvreté ne tient pas pour Haïti
Jean Mary Louis dans la formulation même du titre de sa thèse d’emblée a démenti le que l’on
peut considérer Haïti comme un pays pauvre. C’est une invention, c’est un piège. La pauvreté
sous-entend une situation dans laquelle un individu ou un pays se trouve dépourvu des ressources
importantes. Quand nous parlons des ressources de base, nous faisons référence à la capacité de
se nourrir, de se vêtir, d’avoir accès à un logement décent par exemple. Bref, la pauvreté survient
dès que la population d’un pays se trouve confronté à ces problèmes de base. Mais dans notre
cas, il y a tout simplement une mauvaise répartition ou gestion des richesses et des biens du
pays. Il y a une utilisation du pouvoir par les leaders haïtiens qui ne favorise pas l’émancipation
du peuple.
Page | 21
Serge Latouche nous dit que la colonisation des esprits prend trois formes majeures : l’éducation,
la manipulation médiatique, la consommation du quotidien ou le mode de vie concret35
. Quand
nous essaierons de comprendre pourquoi la République Dominicaine se considère supérieur à
Haïti, Serge Latouche nous donne la provision intellectuelle adéquate pour réfléchir sur ce
phénomène. Si nous prenons une par une ces trois formes principales de colonisation préconisées
par Latouche, nous verrons que la République Dominicaine est en droit de se considérer comme
telle. Aujourd’hui, la République Dominicaine reçoit un nombre important et effrayant
d’étudiants haïtiens qui sont allé là-bas pour fréquenter les universités dominicaines. Les
dominicains colonisent le cerveau des étudiants haïtiens. Mise à part du capital économique qui
part en terre étrangère, il y a une sorte d’aliénation qu’il faut prendre en compte. Les haïtiens
sont allés pour travailler, et pour étudier. Depuis leur plus jeune âge, le petit dominicain apprend
à détester Haïti, ils créent une sorte de nationalisme dominicain avec un arrière-fond anti-
haitianisme exacerbé. A tel enseigne, il n’y a pas une plus grande injure en république
Dominicaine que de dire à quelqu’un : « Haitiano », qui est synonyme de « diable », et de tout ce
qui est mauvais.
Sur le plan de consommation, plus de la moitié des produits dominicains sont vendu en Haïti.
On consomme que du dominicain. Ces réflexions à la lumière de la compréhension de la pensée
de Serge Latouche, nous permettent d’aborder un peu le problème posé dans les formes de
relations entre les deux pays. Un travail beaucoup plus approfondi est à suggérer pour
comprendre mieux ces formes de rapports et pour une confirmation plus objective des
hypothèses de notre travail.
En définitive, toutes ces réflexions sont valides– tous ces faits ont amplement contribué à nous
mettre à genoux économiquement, socialement et politiquement depuis la fondation d’Haïti
comme Etat-Nation, jusqu’à aujourd’hui ; jusqu’à faire que la république dominicaine devienne
une métropole insulaire et traite avec la République d’Haïti comme si elle était un pays du Nord
et Haïti un pays du Sud.
Prof. Sandy R. LAROSE, Spécialiste en Développement, Juin 2013, Biblio-Media, Haïti.
35
LATOUCHE Serge, La pari de la décroissance, éd pluriel. (p.160).
Page | 22
Bibliographie sélective
BIRD Marc, L’Indépendance Haïtienne, éd. Fardin, Port-au-Prince, 2013.
CARLOS Dore Cabral, in revue Chemin Critique: migration haïtienne et travail en république
dominicaine, vol 2, No 4., 1991. (p.56).
CASTOR Suzy, L’occupation américaine d’Haïti, CRESFED, Port-au-Prince, 1989.
COMELIAU Christian. Les relations Nord-Sud, éd. La découverte, Coll. Repère, Paris, 1991.
(pp.4- 39).
ETIENNE Jean Fritzner, Pouvoir, religion et colonisation à l’époque moderne : le cas de
l’Empire colonial français en Amérique, thèse de doctorat soutenue à Paris VII, 2012– et note de
cours ENS, UEH, 2013. (P.22).
ETIENNE Sauveur Pierre, Haïti, la République Dominicaine, Cuba : Etat, Economie et Société
1492-2009, L’ Harmattan, Paris, 2011.
ETIENNE Sauveur Pierre, notes de cours de Master Histoire, ENS, UEH, 2013.
EUGENE Grégoire, Le Miracle haïtien est possible, Imprimé aux ateliers Fardin, Port-au-Prince,
sin datum.
JOACHIM Benoit, Les racines du sous-développement haïtien, Ed Deschamps, Port-au-
Prince,1989. (P.89)
LAËTHIER Maude, Etre Haïtien et migrant à Guyane, IRD, 2010.
LAROSE Sandy, un pays à reconstruire, un tourisme à repenser, Hebdomadaire Haïti Progrès,
2012.
LAROSE Sandy, pauvreté, assistanat et pouvoir en Haiti, Hebdomadaire Haiti Liberté, 2013,
No44, vol 6.
Page | 23
LATOUCHE Serge, La pari de la décroissance, éd pluriel. (p.160).
LOUIS Jean Mary, Invention d’Haïti comme société pauvre, Université de Montréal, 2010.
LOUIS Jean Mary, Notes de cours de coopération internationale, DSD, UEH, Port-au-Prince,
2013.
LUCIEN Georges Eddy, Une modernisation manquée, vol 1. Éd. UEH, Port-au-Prince, 2013.
PRICE MARS Jean, La république d’Haïti et la république Dominicaine, éd. Fardin, collection
du Bicentenaire, Port-au-Prince, 1953. Tome I.
PRICE MARS Jean, La république d’Haïti et la république Dominicaine, éd. Fardin, collection
du Bicentenaire, Port-au-Prince, 1953. Tome II.
Autre documents et sources utilisées
1- DSNCRP (2008-2010)
2- Document officiel du ministère du tourisme dominicain, 2003.
3- Le tourisme en république Dominicaine, ministère du tourisme, 2003.
4- Institut du développement et des relations durable internationales : Migration et
Développement, Paris (29-30 mars 2006) ( p2).
5- Deuxième partie d’une étude de Marc-Arthur Fils-Aimé, Document soumis à AlterPresse
le 16 mai 2008
6- Compte-rendu de la conférence organisé à FOKAL, par la fondation Zile, le 28 février
2013 à Port-au-Prince sur les relations haitiano-dominicaines. Intervenants : Docteur
Arthus Weibert, Ambassadeur Despradel, l’historien Georges Michel, Professeur David
Alvarez.