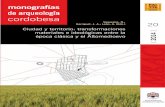"Politique, Memoire, Litterature: L'"Universalite fractionniste' d'Haiti au XIXe siecle" (2010)
R DE BALBIN, P BUENO 2009 ALTAMIRA UN SIECLE APRÈS
Transcript of R DE BALBIN, P BUENO 2009 ALTAMIRA UN SIECLE APRÈS
Article original
Altamira, un siècle après : art paléolithique en plein air
Altamira, one century after: Paleolithic rock art in the open air
Rodrigo de Balbín Behrmann *, Primitiva Bueno RamírezÁrea de Prehistoria, Universidad de Alcalá de Henares, C/ Colegios no 2,
28801 Alcalá de Henares, Espagne
Disponible sur Internet le 13 novembre 2009
Résumé
La découverte de l’art paléolithique en plein air, qui, à partir des années 1990, a pris beaucoupd’importance dans la Péninsule ibérique, a ouvert de plus amples perspectives dans l’interprétation desgraphies des groupes de chasseurs du Sud de l’Europe. Le développement de la recherche, aussi bien dans ledomaine de l’analyse stylistique, comme dans le site de Siega Verde, que dans le domaine de l’analyse descontextes archéologiques, comme dans le site de Foz Côa, a défini une des facettes les plus innovatrices duPaléolithique supérieur, créant ainsi une géographie bien différente de celle traditionnellement admise pourla Péninsule ibérique. La recherche actuelle continue à apporter de nouvelles données qui vérifient lesséquences paléolithiques–postpaléolithiques, dans lesquelles les symboles peints et gravés ont marqué etdéfini le territoire des groupes les plus anciens, constituant la base idéologique de la revendication de cesterritoires par ses héritiers les plus directs.# 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Paléolithique ; Plein-air ; Postpaléolithique ; Tradition ; Graphies ; Territoire
Abstract
The discovery of Paleolithic rock art in the open air, which, from years 1990 became very importantin the Iberian Peninsula, opened more prospective on the interpretation of graphics of the groups ofhunters in southern Europe. The development of research, both in the field of stylistic analysis, and in thesite Siega Verde, as in the analysis of archaeological contexts, as in the site of Foz Côa, defined the facetsthe most innovative of the Upper Paleolithic, creating a very different geography as the traditionallyallowed for the Iberian Peninsula. Current research continues to provide new data which satisfy thePaleolithic–postpaleolithic sequences, in which the painted and engraved symbols marked and defined
www.em-consulte.com
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
L’anthropologie 113 (2009) 602–628
* Auteur correspondant.Adresse e-mail : [email protected] (R.d.B. Behrmann).
0003-5521/$ – see front matter # 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.doi:10.1016/j.anthro.2009.09.014
the territory of the oldest groups, constituting the ideological basis for the claim of these territories by theheirs more direct.# 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Keywords: Paleolithic; Open air; Postpaleolithic; Tradition; Graphics; Territory
1. Introduction
Sans tomber dans l’exagération excessive, la découverte, la localisation et l’étude de l’artpaléolithique en plein air de la Péninsule ibérique, fut une des découvertes les plus importantesaprès celle de la fameuse grotte d’Altamira.
Si cela a supposé le commencement d’un nouveau mode de compréhension du passé, l’artpaléolithique en plein air a modifié radicalement l’image que nous avions des groupes de chasseurs.Cela a entraîné une rupture avec la plupart des idées généralement établies sur leur répartition enEurope, leur relation avec les espaces à ciel ouvert et, surtout, sur la signification univoque enrapport avec le religieux ou encore avec des versions totémiques, chamaniques ou magiques.
Cet article prétend ouvrir le champ à la réflexion sur les thèmes découlant de la situation enplein air d’une partie des graphies paléolithiques de la péninsule. Nous présenterons donc l’étatdes connaissances, les perspectives et la réalité des recherches, non seulement dans la proprePéninsule ibérique mais aussi dans d’autres régions d’Europe et d’Afrique qui possèdent desréférences appartenant à ce cadre.
2. Brève présentation historiographique
Avant 1981, il n’existait pas de gisements graphiques paléolithiques à ciel ouvert, mais il avaiteu cependant quelques réflexions sur la présence de figures à l’entrée des grottes recevant lalumière du jour (Laming-Emperaire, 1962 ; Ucko et Rosenfeld, 1967). De ces réflexions,surgirent les sanctuaires extérieurs et intérieurs de Laming-Emperaire (1962) et la propositionpostérieure de Leroi-Gourhan (1971).
Les abris de Cap Blanc et du Poisson (Lalanne et Breuil, 1911 ; Roussot, 1984), la Lluera(Fortea, 1989), la Viña (Fortea, 1990, 1992, 1994), Chufin (Almagro Basch, 1973) et tant d’autresétaient cependant des espaces quasiment en plein air (Fig. 1). On commençait à distinguer dansl’art paléolithique un aspect collectif et ouvert mais l’attachement aux théories interprétatives del’art des grottes continuait à être la voie obligée.
Les recherches à Siega Verde commencèrent en 1989, ayant comme antécédents les travauxdu site de Mazouco au Portugal (Fig. 2) (Jorge et al., 1981, 1982) et de Fornols-Haut en France(Sacchi, 1984, 1987, 1993a, 1993b, 1995, 2009 ; Sacchi et al., 1987, 1988a, 1988b) et lespremières manifestations espagnoles de Domingo García (Martin, 1981 ; Martin et Moure, 1981)et Piedras Blancas (Martinez, 1987, 1992) (Fig. 2). Pour la première fois, nous nous affrontionsaux problèmes et réalités que l’étude de l’art en plein air supposait dans les années 1990, lorsqu’iln’existait pas encore de référence chronologique pour cette forme artistique (Balbín Behrmann,1995 ; Balbín Behrmann et Alcolea, 1992, 1994 ; Balbín Behrmann et al., 1991, 1994, 1995,1996a, 1996b ; Balbín Behrmann et Santonja, 1992). On la trouvait dans des espaces jusqu’alorsinconnus pour l’art paléolithique, publics, de passage, en hauteur ou proches des cours d’eau(Fig. 3 et 4). Il fallait, de plus, y ajouter l’originalité de ses supports rocheux et d’une partie destechniques utilisées.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 603
Tous les sites d’art en plein air ne se ressemblaient pas, ce qui est également le cas des grottesdécorées. Le site de Mazouco (Jorge et al., 1981, 1982, 1981–1982) était de dimensions réduitesavec deux superficies décorées jusqu’à maintenant répertoriées, dont les différentesinterprétations (Balbín Behrmann et Alcolea, 1992, 1994 ; Baptista, 2001a), montrent qu’ilne s’agissait pas d’un lieu majeur. Dans des conditions encore plus extrêmes, Fornols-Haut(Sacchi, 1984, 1987, 1993a, 1993b, 1995 ; Sacchi et al., 1987, 1988a, 1988b) ou Piedras Blancas(Martinez, 1987, 1992) (Fig. 4) ne possédaient pas non plus de grands ensembles décorés. Maiscela semble illustrer la variété des contextes paysagers de ce type de graphie. Le premier sitementionné avec ses figures minuscules (D’Errico et al., 2002) est bien différent des situations devisibilité que l’on retrouve dans le cas des roches de Mazouco.
Un autre élément important se détachant de ces premières découvertes fut celui émergeant deson analyse stylistique. Les figures de Mazouco n’étaient pas du même style que celles deFornols, ce qui renforce l’hypothèse que l’art en plein air maintiendrait les mêmes changementsstylistiques que celui des grottes (Balbín Behrmann et Alcolea, 1992, 1994).
Le cheval piqueté du site de Domingo Garcia, à Segovia (Fig. 2) (Martin et Moure, 1981), vintajouter quelques arguments à cette perspective et mit en évidence pour la première fois un autretrait de ces marqueurs graphiques en plein air de la Péninsule ibérique : la persistance dans letemps, se matérialisant par l’utilisation des supports des mêmes sites tout au long de l’Holocène(Balbín Behrmann et al., 1982 ; Balbín Behrmann et Moure, 1988). L’occupation paléolithiqueétait documentée par les gravures piquetées et par une accumulation de gravures incisées (Ripoll
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628604
Fig. 1. Figures à l’extérieur des grottes de La Lluera, Chufín et Cap Blanc. Photos R. de Balbín Behrmann.External figures from the caves of La Lluera, Chufín and Cap Blanc. Photos R. de Balbín Behrmann.
Lopez et Municio, 1999). Le fait que ce type de technique soit peu visible justifierait l’hypothèseque les incisions fines furent, en plusieurs occasions, la base d’un remplissage picturalaujourd’hui disparu (Balbín Behrmann, 2008).
L’emplacement des sites de Fornols, Domingo García et, peu après, Piedras Blancas dans laSierra de los Filabres, à Almería, vint corroborer une autre localisation de l’art paléolithique enplein air : les sites en hauteur (Fig. 4). À la première mise à jour d’un unique support (Martinez,1987, 1992) dans le site de Piedras Blancas, se sont ajoutées d’autres superficies gravées,découvertes récemment (Martinez, 2009).
Le gisement de Siega Verde fut découvert en 1989 au cours des prospections du Musée deSalamanque dirigées par le directeur de l’époque, M. Santonja. La découverte d’une roche avecune gravure piquetée fut le départ d’une prospection intensive. Notre hypothèse se basait sur lefait que ce type de site devait répondre à des systèmes semblables à ceux utilisés dans les grottespaléolithiques, unique référence plausible pour le style de cet art en plein air. Le temps et letravail ont confirmé ce critère établi. Le site de Siega Verde contient presque 500 motifs, entrereprésentations d’animaux et signes (Alcolea et Balbín Behrmann, 2006, 2009), nombrecomparable aux grands sites de l’art paléolithique en grotte.
Les premières hypothèses élaborées se sont vues confirmées postérieurement (Alcolea etBalbín Behrmann, 2003a, 2003b, 2006 ; Bahn, 1992, 1995 ; Balbín Behrmann, 1995 ; BalbínBehrmann et Alcolea, 1992, 1994, 2001, 2002, 2005 ; Balbín Behrmann et al., 1991, 1994, 1995,1996a, 1996b ; Balbín Behrmann et Santonja, 1992) : la condition clairement paléolithique desreprésentations et des techniques utilisées, le développement d’un discours semblable à celui de
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 605
Fig. 2. Chevaux gravés en plein air de Piedras Blancas, Domingo Garcia, Mazouco et Siega Verde. Photos R. de BalbínBehrmann.Outdoor engraved horses from Piedras Blancas, Domingo Garcia, Mazouco and Siega Verde. Photos R. de BalbínBehrmann.
« l’art des cavernes », les parallélismes en matière de graphisme avec celui qui était employé dansles grottes à la même époque, l’interprétation de ces motifs comme la manifestation de laprésence de groupes humains à l’intérieur de la Meseta durant tout le Würm supérieur et, final,l’indépendance symbolique et temporelle entre les différents gisements en plein air, le caractèrede marqueur de certaines représentations destinées à être vues et non dissimulées, son caractèreouvert, public et transparent, la chronologie de la réalisation des figures correspondant à unmoment moyen avancé de l’art paléolithique supérieur, la présence de faune disparue non en tantque condition nécessaire mais significative. Ces sont les propositions que nous avons faites et quiont été confirmées un peu plus tard à partir des nouveaux travaux et trouvailles.
Les sites de Côa furent découverts durant la première moitié des années 1990 (Rebanda,1995a, 1995b), grâce à l’étude archéologique préliminaire à la construction d’un des plus grandsbarrages portugais. La polémique entre le développement et la conservation patrimoniale (Jorge,1995), déboucha en faveur de l’étude et la mise en valeur des sites (Zilhão, 1997), faisant naîtreainsi un grand projet d’étude, de prospection et de fouille. Son développement a apporté denombreuses données convaincantes sur les contextes matériels du Paléolithique supérieur dansl’intérieur de la Péninsule ibérique (Aubry, 1998, 2002 ; Aubry et Sampaio, 2009), ce qui supposaune avancée fondamentale dans la connaissance des sites en plein air.
Si le site de Siega Verde fut une référence stylistique pour la chronologie de ces ensemblesartistiques, il regroupe également un ensemble dense de supports décorés situé près d’un gué. Laquantité de sites de différentes entités quantitatives dans la vallée du Côa met à jour desconcentrations diverses dans un territoire relativement étendu (Planche 1 [1]). Ces noyaux, dontnous n’avons connaissance seulement que d’une partie de son contenu, étant donné que le site deCôa ne dispose pas pour le moment d’une étude d’ensemble, reflètent un développementartistique du début jusqu’à la fin du Paléolithique et même, un peu plus tard, avec une interruption
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628606
Fig. 3. Siega Verde dans le bassin de l’Agueda. Photo R. de Balbín Behrmann.Siega Verde bassin of Agueda. Photo R. de Balbín Behrmann.
durant les périodes moyennes avancées (Alcolea et Balbín Behrmann, 2009 ; Balbín Behrmann,2009). La relation entre ces sites et les zones d’habitat a apporté d’intéressantes confirmationsdans le site de Côa (Aubry et Sampaio, 2009 ; Bueno Ramírez et al., 2007).
Récemment, nos collègues portugais ont poursuivi les recherches dans le Nord du Portugal :Fraga Escrevida (Paradinha Nova, Bragança), Sampaio (Milho, Bragança) et Pousadouro (Grijóde Parada, Bragança) et ont pu localiser de nouveaux sites gravés en plein air (Baptista, 2001a,
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 607
Fig. 4. Gisements d’art paléolithique en plein air en altitude : Fornols Haut et Piedras Blancas. Photo R. de BalbínBehrmann.Sites with Paleolithic art in the open air at altitude: Fornols Haut and Piedras Blancas. Photos R. de Balbín Behrmann.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628608
Planche 1. 1. Image comparative des cartes de Siega Verde et Foz Côa. 2. Photos de détail et décalque général despeintures à la Grajera 2, Santiago de Alcantara. Photos R. de Balbín Behrmann.1. Comparative image of the maps of Siega Verde and Foz Côa. 2. Detail photos and general tracing of the paintings in LaGrajera 2, Santiago de Alcantara. Photos R. de Balbín Behrmann.
2001b). Ces sites, bien que nous n’ayons que peu de données (Baptista, 2006), pour le moment,pourraient apporter des éléments de grand intérêt du fait de leur proximité avec les grandsensembles de roches décorées en plein air de la région de Galice. Nous faisons ici référence auxfameux pétroglyphes, sans aucun doute de chronologie postglaciaire (Peña Santos, 2001 ; PeñaSantos et Vázquez Varela, 1979), qui, selon les séquences paléolithiques–postpaléolithiquescorroborées dans le Duero, le Tajo et le Guadiana, pourraient indiquer la présence de décorationsplus anciennes (Bueno Ramírez, 2009).
Au sud, les localisations de sites d’art paléolithique en plein air ont vu leur nombre augmenterdu fait de la politique spécifique de prospections dirigées. La même équipe du Côa est intervenuedans l’ensemble de Barroca (Baptista, 2004) et d’Ocreza (Baptista, 2001c) (Fig. 5), deux zonesde gué semblables à Siega Verde en cours d’inventaire.
La récente découverte des supports décorés en plein air de la région du Guadiana réitèrel’établissement de séquences paléolithiques–postpaléolithiques des régions du Tajo et du Duero.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 609
Fig. 5. Chevaux piquetés de Ocreza, Alto Sabor et Barroca. Photos A. Baptista et R. de Balbín Behrmann.Picked horses from Ocreza, Alto Sabor and Barroca. Photos A. Baptista and R. de Balbín Behrmann.
Les résultats de l’étude du site de Molino Manzanez (Collado, 2006), dans la partie espagnole dufleuve, sont les plus connus (Fig. 6).
La dernière découverte fut aussi le fruit d’une prospection systématique dirigée par notreéquipe dans la partie espagnole du Tage International, de nouveau à la frontière hispano-portugaise. Les applications théoriques et méthodologiques ont été développées ailleurs (BuenoRamírez et Balbín Behrmann, 2000a, 2000b, 2000c ; Bueno Ramírez et al., 2004), et nousn’entrerons pas de nouveau dans le détail. Nous avons repéré les supports gravés près des fleuveset ceux en relation avec les montagnes karstiques caractéristiques du paysage proche du Tajo.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628610
Fig. 6. Auroch linéaire gravé de Molino Manzánez. Photo R. de Balbín Behrmann.Engraved linear bull from Molino Manzánez. Photo R. de Balbín Behrmann.
Et c’est dans une de ces chaînes montagneuses, la Sierra de San Pedro, que nous avons localisé lepremier panneau avec des peintures paléolithiques en plein air du territoire espagnol (Planche 1[2]) (Bueno Ramírez et Balbín Behrmann, sous presse).
Cet espace est, pour le moment (Balbín Behrmann et Alcolea, 2006), de même que les sites duGuadiana et Piedras Blancas, un des plus méridionaux de l’art paléolithique en plein air. Celanous rappelle, de nouveau, que les manifestations artistiques du Pléistocène n’ont pas defrontières dans la Péninsule ibérique.
3. Géographie de l’art paléolithique en plein air de la Péninsule ibérique
À la fin des années 1990 du siècle passé, l’emplacement des sites de la Péninsule sur les rivesdes fleuves de l’intérieur pouvait être interprété comme une spécialisation des habitants de cesrégions.
Depuis la découverte du site de Siega Verde (Balbín Behrmann, 1995 ; Balbín Behrmann etAlcolea, 1992, 1994 ; Balbín Behrmann et al., 1991, 1994, 1995, 1996a, 1996b), nous avonsapporté toute une série d’arguments basés sur la référence traditionnelle à l’art paléolithique descavernes. Nous faisons ici référence aux arguments stylistiques du système de Leroi-Gourhan(1971), qui furent le fondement de toute datation de l’art cavernaire du Sud de l’Europe (BalbínBehrmann, 2009 ; Balbín Behrmann et Alcolea, 1992, 1994, 2001, 2002, 2006). Dernièrement, ilsemble nécessaire de rappeler que Leroi-Gourhan (1971) avait défini les quatre styles de l’artpaléolithique à partir des contextes stratigraphiques de l’art mobilier du Sud de la France et de lacomparaison de ces motifs avec ceux des parois. Il va sans dire que les études sur l’artpaléolithique ont évolué en y incorporant des datations directes. Il faut cependant reconnaître queles éléments de base de son interprétation se maintiennent encore sans difficulté (Alcolea etBalbín Behrmann, 2007 ; González Sainz, 1999, 2005).
Nous nous appuyons donc, pour l’art en plein air, sur une analyse fondée sur le même systèmeappliqué dans l’analyse des grottes afin de rattacher son style à une période ou une autre duPaléolithique supérieur. Personne ne remit en doute la réalité préhistorique de ces grottes malgréle fait que les critères du cadre chronologique provenaient presque exclusivement de soncatalogage stylistique. Altamira, jusqu’aux récentes datations directes, mais aussi de nombreusesgrottes françaises et espagnoles pourvues de datations paléolithiques à partir du style de leursdécorations sont d’autres exemples connus de ce genre d’attribution.
Le débat sur l’art en plein air se scinda en deux camps. Le premier, composé d’une partie de lascience française, se caractérisait par les premières interprétations du site de Côa (Clottes et al.,1995 ; Lorblanchet, 1993). Il rejetait la prise en compte des graphies paléolithiques en plein air,sauf s’il s’agissait d’une dernière étape de leur développement. Le deuxième camp réunissait lesamants du Passé, de l’ésotérisme, et ceux gravitant dans l’orbite anglo-saxonne de forte tendanceprotestante (Bednarik, 1995a, 1995b, 1995c, 1997), possédant une conception particulière del’étude de l’art rupestre. Les arguments avancés par ces derniers furent finalement battus enbrèche par les travaux de nos collègues portugais (Zilhão, 1995a, 1995b, 1997).
Ces deux versions, chacun dans des perspectives différentes, paraissent être ancrées dans lascience du XIX
e siècle (Moro-Abadia et Gonzalez Morales, 2005). L’académie française reproduitla même situation depuis la découverte d’Altamira : en France, il n’y a pas de grands sites en pleinair, à l’exception du support rocheux de Fornols-Haut. De ce fait, l’art paléolithique en plein airserait une version tardive de caractère ibérique. Il faudra donc attendre la mise en place decampagnes de prospections systématiques de repérage de ce type de gisement en France pourarriver à lire un nouveaux Mea culpa d’un sceptique (Cartailhac, 1902).
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 611
La recherche espagnole est aussi très influencée par le courant français, en particulier dans ledomaine de l’art paléolithique, ce qui est logique au vu de leur rapport étroit. Quelques-uns denos collègues ont suivi les hypothèses de datation tardive pour l’art en plein air. Mais celles-ci sesont retrouvées sans argument à mesure que les travaux du site du Côa ont avancé (Alcolea etBalbín Behrmann, 2006 : 313 et ss.). Peu de chercheurs, et certains seulement à titre personnel(Corchón, 1985, 1997 : 168 ; Corchón, 2006 ; Corchón et al., 1996 : 16), maintiennentaujourd’hui, la datation tardive de l’art en plein air.
La documentation archéologique (Aubry, 1998, 2002 ; Aubry et Sampaio, 2009) a renforcénos hypothèses sur les séquences du Côa et de Siega Verde (Balbín Behrmann, 1995 ; BalbínBehrmann et Alcolea, 1992, 1994 ; Balbín Behrmann et al., 1991, 1994, 1995, 1996a, 1996b). Lemême critère stylistique employé pour la datation de l’art en grotte devrait donc être utilisé pourl’art en plein air, si l’on prétend à une certaine rigueur scientifique.
Dans l’état actuel des connaissances, les spécialistes de la Péninsule semblent arriver à unconsensus sur la chronologie de l’art paléolithique en plein air, à part quelques réticences quenous avons commentées auparavant. Cela s’accompagne d’une tendance au repérage de cet artdans un secteur géographique défini et comme nous l’avons déjà dit, de la technique de la gravure(Baptista et al., 2009).
Depuis les premières découvertes, nous avons de plus insisté sur le fait qu’il n’existe aucunelogique dans la délimitation de l’art en plein air dans la partie occidentale de la Péninsule, à partcelle découlant directement de la circonscription des recherches à des zones concrètes. Il est deplus peu admissible de manière générale que les supports en plein air ne soient peints, étant donnéles difficultés de conservation de cette technique (Balbín Behrmann, 2009).
Parallèlement aux travaux effectués dans le Duero et le Tajo et, plus récemment, dans leGuadiana, d’autres collègues ont lancé plusieurs campagnes de prospections dans le Levant(Martinez Valle et al., 2003) et en Andalousie (Maura Mijares et Cantalejo Duarte, 2005 ;Martinez, 2009), ouvrant ainsi d’intéressantes perspectives de travail. Cela a confirmé égalementl’hypothèse d’une plus grande extension géographique de l’art paléolithique en plein air (BalbínBehrmann, 2009) et de son étroite relation topographique avec celle de l’art schématique (BuenoRamírez, 2009 ; Bueno Ramírez et Balbín Behrmann, 2001 ; Bueno Ramírez et al., 2003) (Fig. 7).
Dans la région du Levant, l’emplacement en plein air des sites dans la Valltorta est de plus enplus manifeste, puisque plus de 30 localisations ont été répertoriées (Martinez, 2009) (Fig. 8 etPlanche 2 [1]).
Sa présence en territoires connus comme pour l’abondance de l’art levantin renforcerait laperspective de chronologies plus étendues que celles exclusivement postglaciaires. Avancerl’hypothèse que certains motifs des abris levantins soient paléolithiques (Balbín Behrmann et al.,1989 ; Bueno Ramírez et al., 2007) repose désormais sur des arguments plus solides. Des motifscomme les cerfs d’Arpán et Chimiachas (Baldellou, 1985 ; Baldellou et al., 1993) ne détonnentpas dans des contextes stylistiques paléolithiques et leur rapprochement avec des motifs plusrécents s’intègre dans l’ensemble des graphies des sites en plein air de l’occident péninsulaire.
Plusieurs sites d’art paléolithique de la partie orientale de la Péninsule, considérés quasiment àciel ouvert, ont été antérieurement publiés. La Fuente del Trucho (Beltrán, 1990), avec cespeintures du Style II, a la particularité d’associer un panneau pratiquement à l’air libre avec desmotifs appartenant au Style IV. Le matériel archaïsant associé pourrait être daté du gravettiensolutréen (Mir et Salas, 2000) (Planche 2 [2]).
Le modèle d’emplacement des sites peints paléolithiques récemment documentés dans larégion de Murcia (Salmerón Juan et al., 1997, 1999a, 1999b) pourrait se caractériser par despetits abris en zone de ravin (Planche 2 [3]). Dans cette région, non seulement ils reprennent le
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628612
modèle d’emplacement classique de l’art schématique mais ils partagent également quelques-unes de ces enclaves. Ce genre de situation rappelle celle des bœufs peints de l’abri portugais deFaia, dans la zone Nord du Côa (Baptista, 1999a) (Planche 3[1]).
Dans le cas portugais, la technique picturale a conduit les chercheurs à émettre quelquesdoutes sur la chronologie paléolithique (Baptista, 1999b), au vu de la prédominance de latechnique de gravure dans les panneaux connus. Ironie intéressante si on sait que l’un desarguments principaux à l’encontre de la datation paléolithique de l’art en plein air est justementl’usage exclusif de la technique de la gravure. De nouveau, nous nous retrouvons face à descritères qui n’ont jamais été employés dans l’étude de l’art des grottes. En effet, aucun chercheurn’aurait mis en doute la chronologie paléolithique de Combarelles, en s’appuyant sur laprédominance des gravures dans ses décorations, ni celle du site de Las Monedas, pourl’exclusivité de la technique picturale.
Le panneau peint et gravé de la Cueva Ambrosio, dans la région de Almería se trouvequasiment en plein air. Il fut découvert lors de récentes excavations fouilles et a donné desréférences chronologiques : 16 620 � 280 BP, 16 500 � 280 BP (Ripoll Lopez et al., 1994 : 36),correspondant parfaitement au cadre stylistique de ses représentations (Planche 3 [2]).L’association des techniques amène une réflexion intéressante sur la représentativité de lapeinture en plein air, nuancée de nos jours par les difficultés de conservation.
Les travaux réalisés en Andalousie ont fait avancer la lecture de ces graphies préhistoriques.Le site de Piedras Blancas pris le protagonisme de cet art andalou en plein air. Mais comme le faitjustement remarquer Martinez (2009), Breuil et Burkitt (1929 : 51–53) avaient déjà fait connaître
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 613
Fig. 7. Carte de la Péninsule ibérique, avec des gisements d’art paléolithique en plein air cités dans le texte.Map of the Iberian Peninsula, with the sites with Paleolithic external art cited in the text.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628614
Planche 2. 1. Cerfs peints de Chimiachas et Arpán, à la rivière Vero. Photos R. de Balbín Behrmann. 2. La grotte dela Fuente del Trucho, à la rivière Vero, avec la décoration peinte intérieure en haut et la gravure extérieure en bas.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 615
Fig. 8. Abric d’en Meliá et ses gravures selon Martinez Valle et al. (2003).Abric d’en Meliá and its engravings under Martinez Valle et al. (2003).
Photos R. de Balbín Behrmann. 3. La grotte de Jorge à Cieza, et deux de ses peintures à droite. Photos R. de BalbínBehrmann.1. Deer painted in Chimiachas and Arpán, river Vero. Photos R. de Balbín Behrmann. 2. La Fuente del Trucho cave, VeroRiver, with the interior painted decoration up and the external engraving down. Photos R. de Balbín Behrmann. 3. Jorgecave in Cieza, and two of his paintings on the right side. Photos R. de Balbín Behrmann.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628616
Planche 3. 1. Décalque des bovins peints paléolithiques de Faia, Foz Côa, avec la superposition de plusieursanthropomorphes schématiques, selon A. Baptista. 2. Peinture et paysage de la cueva de Ambrosio.
un emplacement sous abri dans le site de Las Palomas I (Planche 3 [3]) et qui, comme à Tarifadans la Cueva del Moro (Mas Cornellá et al., 1995), rend plus explicite la présence de peintures etgravures paléolithiques dans les régions proches de l’Afrique (Fig. 9) (Balbín Behrmann etAlcolea, 2006).
Déjà dans les années 1970, l’association de points et de motifs animaliers, comme dans le sitede Las Palomas I et dans d’autres sites andalous, avait été attribuée au paléolithique (Fortea,1978 : 131). Cette attribution fut reprise postérieurement dans un travail monographique(Santiago Vilches, 1982) (Planche 3 [3]).
À partir des années 1990, les motifs paléolithiques recouverts par les décorationsschématiques commencent à être localisés, ce qui mit un point d’inflexion à l’identité desemplacements de ces deux formes d’expressions (Bueno Ramírez et Balbín Behrmann, 2001 ;Bueno Ramírez et al., 2003), incluant la dimension de plein air, en plus de l’emplacement sousabri, exclusifs jusqu’à présent des graphies postglaciaires.
Dans cette même dynamique paléolithique–postpaléolithique, plusieurs sites ont étérépertoriés dans la Province de Cadiz : en premier, Atlanterra (Bergmann, 1996 : 16 ; RipollLópez et Mas Cornellá, 1999), suivi du site El Realillo I et la grotte de La Jara I, à Tarifa, la
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 617
Fig. 9. Chevaux paléolithiques gravés et peintes de la cueva del Moro, à Tarifa, vue vers l’Afrique et situation de l’abri.Photos R. de Balbín Behrmann.Paleolithic engraved and painted horses in the cave of the Moro, Tarifa, overlooking of Africa and situation of the rockshelter. Photos R. de Balbín Behrmann.
Photos R. de Balbín Behrmann. 3. Peintures de Las Palomas, Atlanterra, La Jara et el Ciervo, Cadix. Photos ArteSureño.1. Trace of the Paleolithic painted bulls from Faia, Foz Côa, with the superposition of several schematic anthropomorphs,under A. Baptista. 2. Painting and landscape of the cave Ambrosio. Photos R. de Balbín Behrmann. 3. Paintings of LasPalomas, Atlanterra, La Jara and El Ciervo, Cadiz. Photos Arte Sureño.
Cueva del Ciervo à Los Barrios et la Cueva Horadada à San Roque (Martinez, 2009). Danschacun de ces sites, on a pu inventorier des motifs peints, principalement des cerfs et des chevauxmais aussi quelques signes de style paléolithique (Planche 3 [3]). Cela correspondrait à lapremière phase d’occupation graphique des sites d’art rupestre schématique.
En Estrémadure, les données ne cessent de se multiplier. Dans les années 1950, les peinturesde la Cueva de Maltravieso (Ripoll Lopez et al., 1997, 1999) commencèrent à être connues, qui,avec celles de la grotte de l’Escoural (Otte et Da Silva, 1996), furent les manifestations de l’artpaléolithique en grotte connues les plus au sud-ouest. Le site déjà mentionné de MolinoManzanez (Collado, 2006) fut découvert à partir de ses gravures postpaléolithiques. Le projet missur pied dans le Guadiana a réuni d’autres témoignages en Estrémadure (Collado, 2009) : despetites grottes comme la Mina de Ibor s’ajoutent à la liste des abris avec des gravures, élargissantainsi l’idée que nous nous faisions du panorama des chasseurs du Paléolithique supérieur.
Les superpositions que l’on a pu détecter à Santiago de Alcántara entre les motifs naturalisteset les figures schématiques (Bueno Ramírez et al., 2006 ; Carrera et al., 2007) nous ont amené àpoursuivre les prospections systématiques dans la Sierra de San Pedro, ce qui nous a permis derepérer le panneau de Grajera 2 (Bueno Ramírez et Balbín Behrmann, sous presse) (Planche 1[2]). D’autres emplacements du même environnement fournissent des séquences paléolithiques–
postpaléolithiques nécessitant une étude approfondie que nous venons à peine d’entreprendre.
4. Modèles d’emplacement de l’art paléolithique en plein air dans la Péninsuleibérique
Durant les dix dernières années du XXe siècle, la définition de l’art paléolithique basée
exclusivement sur les représentations des cavernes s’est enrichie par une analyse reposant sur desperspectives plus riches incluant les sites de gravures de la partie occidentale de la Péninsule.Mais durant le XXI
e siècle, de nouveaux éléments viennent s’ajouter, enrichissant ainsil’interprétation des différents types d’art en plein air dans le sud de l’Europe. Il est doncnécessaire d’infléchir les recherches vers l’élaboration de nouveaux points de vue sur les régionsclassiques, dans lesquelles il est fort probable que de nouveaux gisements soient localisés, enétablissant une classification des modèles d’emplacement connus, de leurs références de base etde leurs contextes. Et, bien entendu, il conviendrait de se questionner sur la datation desexpressions paléolithiques en plein air dans d’autres régions du globe.
Ces emplacements pourraient se résumer aux suivants.
4.1. Supports rocheux en cours d’eau
Nous en avons une connaissance approfondie dans les zones des fleuves de l’occidentpéninsulaire, mais il est vrai qu’il n’y a point de programmes spécifiques de recherche dansd’autres régions. Sa coïncidence territoriale avec les grottes décorées (Balbín Behrmann, 2009 ;Balbín Behrmann et Alcolea, 1992, 1994, 2001, 2002, 2006 ; Bueno Ramírez et al., 2007) estsignificative afin d’écarter de possibles spécialisations en relation avec l’existence de supportsaptes à une forme ou autre d’expression.
L’utilisation majoritaire de la technique de gravure est liée aux possibilités de conservation dela peinture en plein air. Les gravures piquetées et incisées constituent la technique la plusconservée. Les peintures de Faia, dans le Côa, les analyses réalisées dans le site de Siega Verde(Alcolea et Balbín Behrmann, 2009) et le panneau en plein air de Grajera 2 dans la Sierra de SanPedro mettent en valeur cependant le rôle moins connu de cette technique.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628618
Les liens entre la présence de l’eau et le développement de la vie humaine constituent une despreuves indéniables de son intérêt économique, les territoires étant marqués par des graphiesreconnues par ses habitants et les étrangers (Fig. 10). Plages aux espaces confortables commePenascosa (Baptista et al., 2009 ; Baptista et Reis, 2009), passages à gué comme Siega Verde(Alcolea et Balbín Behrmann, 2009), Ocreza (Baptista, 2001c), ou encore Molino Manzanez(Collado, 2006) sont des zones de circulation vers les plaines de l’intérieur qui ont permis decontrôler le mouvement des hommes, des matières premières et des animaux. La mise en valeur
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 619
Fig. 10. Panneaux de Siega Verde et Ribeira de Piscos près des rivières Agueda et Côa. Photos R. de Balbín Behrmann.Panels of Siega Verde and Ribeira de Piscos along the rivers Agueda and Côa. Photos R. de Balbín Behrmann.
de ces emplacements en tant que produits d’une stratégie sociale et économique suppose lecontrôle et la délimitation du territoire entre les chasseurs du Paléolithique supérieur.
Le style des sites connus positionne ces expressions en plein air dans un même contextechronologique que celles des cavernes. C’est le cas des plus anciens panneaux du site de Côa,nettement des styles II et III (Balbín Behrmann, 2009 ; Balbín Behrmann et Alcolea, 2001, 2002),ou encore du panneau peint déjà cité de la Grajera 2, de même datation ancienne que Fariseu, cequi renforce notre hypothèse stylistique.
L’étendue dans le temps des styles anciens dans le Côa coïncide de plus avec les plusanciennes chronologies de la Cantabrie et du sud de la France.
Comme c’est le cas de nombreuses grottes, les sites en plein air possèdent aussi de courtesséquences ou simplement discontinues. Le site de Siega Verde contient des motifsmajoritairement des styles III et IV ancien, à l’image des grottes de l’intérieur de la Péninsule(Balbín Behrmann et Alcolea, 1992, 1994, 2001, 2002).
Une grande partie du site du Côa fut orné de graphies du style IV avancé. À ce moment là, lesgisements se multiplient, comme c’est le cas dans les Cantabres en Cantabrique. Le cerf dePenascosa (Baptista, 1999a, 1999b ; Zilhão, 1997) ou l’ensemble de la Vallée de Cabrôes(Carvalho et al., 1996 ; Baptista, 1999a, 1999b) sont attribuables chronologiquement auxalentours de 12 000 BP, de même que les cerfs incisés du style IV d’Altamira ou du site d’ElCastillo (Fig. 11).
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628620
Fig. 11. Cerfs incisés de Siega Verde et El Castillo, cheval piqueté de Siega Verde et peint de Covalanas. Photos R. deBalbín Behrmann et Laboratorio de Estudios Paleolíticos de la Universidad a Distancia.Incised deer from Siega Verde and El Castillo, picked horse from Siega Verde and painted from Covalanas. Photos R. deBalbín Behrmann and Laboratorio de Estudios Paleolíticos de la Universidad a Distancia.
La coïncidence topographique des panneaux paléolithiques et postpaléolithiques offre dans lecas du Côa, du Tajo et du Guadiana, des données sur le dernier style de tradition paléolithique, lestyle V, entre 11 500 et 8000 BP (Bueno Ramírez et al., 2007). Conjointement, on peut observerdans ces mêmes sites un grand nombre de supports aux décorations attribuées à l’art schématique(Bueno Ramírez, 2009).
4.2. Supports rocheux aux sierras et presierras
Les renseignements apportés par les sites décorés en hauteur consolident l’hypothèse d’uneoccupation de tous les types de niches écologiques par les chasseurs paléolithiques et de leurmobilité.
Dans ces emplacements, il était certainement aisé de chasser dans les pâturages d’altitude,d’obtenir différents types de matières premières. Ils étaient d’excellents postes de contrôle sur lamer, comme à Almeria et dans les Pyrénées françaises. Ils permettaient également de pouvoircontrôler les grandes plaines de l’intérieur, comme dans le cas du site de Domingo Garcia.
La chronologie des décorations de ce type d’enclaves commence également au milieu duPaléolithique supérieur, à laquelle nous pouvons rattacher le motif des chevaux de PiedrasBlancas. Par ailleurs, les décorations de Fornols furent réalisées selon des conventions du style IVet postérieur, de même qu’une partie des gravures incisées des rochers en plein air du Levantespagnol (Martinez Valle et al., 2003 ; Martinez, 2009).
Dans ce contexte, il existe également des témoignages de peinture, plus encore si nousconsidérons dans ce sens quelques-uns des exemples de l’art levantin.
La coïncidence des panneaux paléolithiques et postpaléolithiques dans le site de DomingoGarcía confirme que ces séquences se retrouvent également dans les emplacements en hauteur, cequi devient évident si nous intégrons dans ce modèle quelques exemples de séquences d’artpaléolithique–postpaléolithique de la région andalouse.
4.3. Abris sous roche aux cours d’eau et aux sierras et presierras
C’est sans doute un des emplacements les plus classiques de l’art schématique et de l’artlevantin de la Péninsule ibérique : des emplacements en pleine lumière du jour mais protégés pardes rebords plus ou moins larges créant ainsi des espaces protégés pouvant servir d’abritemporaire.
Beaucoup d’emplacements dans le Levant possèdent ces caractéristiques : Fuente del Trucho,les abris peints de Murcia ou la grotte de Ambrosio. On pourrait y ajouter les gravures de la Valléede Jose Esteves, dans le Côa.
Et, une fois encore, nous citons les abris classiques du Levant. Nous pouvons utiliser denouveau le motif des cerfs de Arpán y Chimiachas comme exemple de motif probablementpaléolithique autour duquel se regroupent les abris décorés des arts levantin et schématique.
De même que dans les cas antérieurs, sa chronologie atteste d’éléments anciens dans le site deFuente del Trucho, Murcia o Ambrosio, ce dernier pourvu de datations radiocarbones del’utilisation des deux techniques, la peinture et la gravure.
Le style IV du site de José Esteves et la possible continuité dans des styles plus récentsconfirme une chronologie longue d’utilisation de ces abris. Cette chronologie présente, selon lesséquences paléolithiques–postpaléolithiques des dernières données recueillies en Andalousie, lamême dynamique de réitération dans la revendication des espaces en plein air que l’on retrouvaitdans les sites de la partie occidentale de la Péninsule (Bueno Ramírez, 2009).
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 621
Les supports en plein air ou sous abri ont occupé des emplacements proches des fleuves ou enrégions montagneuses, situant ainsi les graphies paléolithiques au sein de paysages identiques àceux des graphies postpaléolithiques (Bueno Ramírez et Balbín Behrmann, 2001). Leur lien avecdes zones d’habitat est un fait dans le cas des deux contextes chronologiques, de même que sonrapport avec les territoires d’intérêt économique (Bueno Ramírez et al., 2003). La relation avec lemonde funéraire reste cependant peu étudiée, bien que les données du site de Cap-Blanc (Lalanneet Breuil, 1911) pourraient offrir de possibles liens de grand intérêt.
Les chasseurs paléolithiques auraient été ainsi les vrais protagonistes de la conquête factuelledu territoire, les premiers l’ayant contrôlé en utilisant un système idéologique basé sur desgraphies reconnaissables par le groupe, transmettant ainsi les droits de propriété et d’usage desterres, les identifiant ainsi comme biens propres.
5. Groupes de chasseurs du Paléolithique supérieur vus à travers l’art en plein air
Si les grottes décorées ont supposé, pour la recherche, l’affirmation des lieux d’habitat deschasseurs du Paléolithique supérieur (Balbín Behrmann et al., 1999), les sites en plein airconfirment indéniablement la forte relation entre les groupes humains et les territoires marquéspar leurs symboles, dans lesquels ils se déplaçaient. Cette nouvelle perspective sur les ensemblesdu Paléolithique supérieur ouvre un éventail inédit d’emplacements qui enrichissent larépartition et la chronologie du Paléolithique supérieur européen et nous renseigne sur la capacitéd’échanges de groupes traditionnellement considérés comme marginaux (Balbín Behrmann etAlcolea, 1992, 1994).
Le schéma que nous connaissons n’est pas celui d’un domaine fermé mais plutôt le signed’une plus grande extension devant être définie, positivement ou négativement, dans toute laPéninsule ibérique.
C’est également prometteur pour d’autres régions européennes, dans lesquelles lareconnaissance de l’art des cavités est pratiquement inexistante (Bahn et al., 2003) et qui, aucontraire, comptent sur de nombreux sites en plein air de chronologie postglaciaire. Peut-être quede nouvelles lectures de ces supports pourraient amener des résultats similaires à ceux de laPéninsule ibérique, enrichissant ainsi la vision que nous possédons de la capacité d’expressiondes chasseurs de l’Atlantique (Bueno Ramírez, 2009).
D’autres formes d’expression d’art en plein air jamais auparavant considérées commepaléolithiques, justement de par leur emplacement en plein air, commencent à être vues demanière différente. C’est le cas des supports gravés de Sibérie (Bahn, 2002).
Appliquer cette perspective, celle des chasseurs paléolithiques décorant également les espacesde leur vie quotidienne, pourrait enrichir sensiblement l’analyse d’une partie de l’art africain. Onvoit apparaître des chronologies anciennes des graphies en plein air dans d’autres endroits duglobe. Cela pourrait conduire, en y ajoutant les preuves que nous avons brièvement rassemblées,à reconstruire le système idéologique des groupes humains du Paléolithique supérieur d’unemanière bien plus complexe que celle du cadre traditionnel.
Il est difficile face à cette quantité de données de soutenir, comme unique explication, lechamanisme ou autre version de signification religieuse. La variété des contextes, des techniques,la profonde relation avec le quotidien et le côté économique, dressent le portrait de groupeshumains dont les symboles les désignent comme détenteurs d’espaces déterminés, revendiquéstout au long des générations, créant ainsi de véritables territoires traditionnels (Bueno Ramírez,2009). Ces territoires, soigneusement définis, sont passés de père en fils, offrant les garanties depassage et la sécurité basée sur un entourage connu et familier.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628622
L’application de programmes d’analyse géographique détaillée apportera des éléments afin demesurer le rapport entre les enclaves décorées et les activités spécialisées ou les ensembles deplus grande dimension. C’est uniquement de cette manière que l’on pourra commencer à établirde nouvelles bases empiriques pour une reconstruction plus riche que celle actuellementemployée, du peuplement en plein air durant le Paléolithique supérieur.
L’organisation des données dont nous disposions avec celles connues des grottes offre unevision bien distincte de la position des groupes de chasseurs de la Péninsule ibérique, danslaquelle les mouvements de ces groupes s’appréhende plus clairement à partir de l’emplacementdes panneaux décorés en plein air (Bueno Ramírez et al., 2007).
La reconstruction traditionnelle du Paléolithique péninsulaire à partir de la position desgrottes décorées ou non, s’est vue sensiblement enrichie par l’incorporation des supports décorésen plein air. Cela a permis, de plus, de proposer des schémas démographiques plus larges queceux habituellement acceptés, d’apporter des réflexions sur les dimensions réelles des grottesdans le système d’habitat au Paléolithique supérieur. On ne pourra résoudre ce genre de questionsque par des études détaillées, en prenant en compte les multiples questions surgissant de laprésence inédite et de plus en plus abondante, de l’art en plein air paléolithique de la Péninsuleibérique.
La compréhension de ces sites rupestres en tant que sites archéologiques, en y appliquant lamême méthodologie (Bueno Ramírez et Balbín Behrmann, 2000a, 2000b), a consolidé uneperspective totalement nouvelle sur l’étude des lieux occupés par les chasseurs du Paléolithiquesupérieur. En effet, l’étude des sites en plein air de la partie occidentale a constitué la baseempirique du Paléolithique supérieur en dehors de la région cantabrique. Cela fut dû à l’effortdemandé aux chercheurs travaillant dans ces régions pour documenter la chronologie de cesformes d’expression qui, en grotte, du fait de leur style, n’ont jamais fait l’objet de doute.
La concentration des roches décorées dans la Péninsule ibérique constitue un des patrimoinesles plus remarquables du sud de l’Europe. Les pierres conservent en superficie une véritablebibliothèque du passé dans laquelle sont conservés la succession des symboles graphiquesancestraux, utilisés et reconnus par plusieurs générations durant plus de 30 000 ans.
Remerciements
La version française est de Agnès Louart que nous remercions.
Références
Alcolea, J.J., Balbín Behrmann, R. de, 2003a. El Arte Rupestre Paleolítico del interior peninsular. Elementos para elestudio de su variabilidad regional. In: Balbín Behrmann, R. de, Bueno Ramírez, P. (Eds.), Primer SimposiumInternacional de Arte Prehistórico de Ribadesella. El arte prehistórico desde los inicios del siglo XXI, Ribadesella,pp. 223–253.
Alcolea, J.J., Balbín Behrmann, R.de, 2003b. Témoins du froid. La faune dans l’art rupestre paléolithique de l’intérieurpéninsulaire. L’Anthropologie 107, 471–500.
Alcolea, J.J., Balbín Behrmann, R.de, 2006. Arte Paleolítico al aire libre. El yacimiento rupestre de Siega Verde,Salamanca. Arqueología de Castilla y León 16. Junta de Castilla y León 1–390.
Alcolea, J.J., Balbín Behrmann, R.de, 2007. C14 et style. La chronologie de l’art pariétal à l’heure actuelle. L’Anthro-pologie 111, 435–466.
Alcolea, J.J., Balbín Behrmann, R. de, 2009. El yacimiento rupestre de Siega Verde, Salamanca. Una visión de síntesis. In:Balbín Behrmann, R. de (Ed.), Arte Prehistórico al aire libre en el Sur de Europa. Junta de Castilla y León, pp. 57–88.
Almagro Basch, M., 1973. Las pinturas y grabados rupestres de la cueva de Chufín. Riclones (Santander). Trabajos dePrehistoria 30, 9–67.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 623
Aubry, T., 1998. Olga Grande 4: uma sequência do Paleolítico superior no planalto entre o Rio Côa e a Ribeira de Aguiar.Revista Portuguesa de Arqueologia 1, 5–26.
Aubry, T., 2002. Le contexte archéologique de l’art paléolithique à l’air libre de la vallée du Côa. In: Sacchi, D. (Ed.), L’artpaléolithique à l’air libre. Le paysage modifié par l’image (Tautavel, Campôme 7–9 octobre 1999). GAEP, GÉOPRE,Saint-Estève, pp. 25–38.
Aubry, T., Sampaio, J.D., 2009. Chronologie et contexte archéologique des gravures paléolithiques de plein air de laVallée du Côa (Portugal). In: Balbín Behrmann, R. de (Ed.), Arte Prehistórico al aire libre en el Sur de Europa. Junta deCastilla y León, pp. 211–224.
Bahn, P.G., 1992. Open air rock art in the Palaeolithic. In: Lorblanchet, M. (Ed.), Rock Art in the Old World. IndiraGandhi National Centre for the Arts, New Delhi, pp. 395–400.
Bahn, P.G., 1995. Cave art without the caves. Antiquity 69, 231–237.Bahn, P.G., 2002. L’art paléolithique de plein air dans le monde extra-européen. In: Sacchi, D. (Ed.), L’art paléolithique à
l’air libre. Le paysage modifié par l’image (Tautavel, Campôme 7–9 octobre 1999). GAEP, GÉOPRE, Saint-Estève,pp. 209–215.
Bahn, P.G., Pettitt, P., Ripoll Lopez, S., 2003. Discovery of Palaeolithic cave in Britain. Antiquity 77, 227–231.Balbín Behrmann, R.de, 1995. L’art paléolithique à l’air libre de la vallée du Douro. Archéologia 313, 34–41.Balbín Behrmann, R. de, 2008 (Ed.). Arte Prehistórico al aire libre en el Sur de Europa. Junta de Castilla y León.Balbín Behrmann, R. de, 2009. El arte rupestre paleolítico al aire libre en la Península Ibérica. In: Balbín Behrmann, R. de
(Ed.), Arte Prehistórico al aire libre en el Sur de Europa. Junta de Castilla y León, pp. 19–54.Balbín Behrmann, R.de, Alcolea, J.J., 1992. La grotte de Los Casares et l’Art Paléolithique de la Meseta espagnole.
L’Anthropologie 96, 397–452.Balbín Behrmann, R. de, Alcolea, J.J., 1994. Arte Paleolítico de la Meseta española. Complutum 5, Madrid, 97–138.Balbín Behrmann, R. de, Alcolea, J.J., 2001. L’Art Paléolithique en plein air dans la Péninsule ibérique : quelques
précisions sur son contenu, chronologie et signification. In: Zilhão, J., Aubry, T., Faustino Carvalho, A. (Eds.), Lespremiers hommes modernes de la Péninsule ibérique. Actes du Colloque de la Commission VIII de l’UISPP, Foz Côa,Novembre 1998, pp. 205–236.
Balbín Behrmann, R. de, Alcolea, J.J., 2002. L’art rupestre paléolithique de l’intérieur péninsulaire ibérique : une révisionchronoculturelle d’ensemble. In: Sacchi, D. (Ed.), L’art paléolithique à l’air libre. Le paysage modifié par l’image(Tautavel, Campôme 7–9 octobre 1999). GAEP, GÉOPRE, Saint-Estève, pp. 139–157.
Balbín Behrmann, R. de, Alcolea, J.J., 2005.Testigos del frío. La fauna en el Arte Rupestre Paleolítico del interiorpeninsular. Geoarqueología y Patrimonio en la Península Ibérica y el entorno mediterráneo. Adema, Soria 2005, 547–
566.Balbín Behrmann, R. de, Alcolea, J.J., 2006. Arte paleolítico en los confines de Europa: cuevas y aire libre en el sur de la
Península Ibérica. IV Simposio de Prehistoria Cueva de Nerja. La cuenca mediterránea durante el Paleolítico Superior38 000–10 000 años. Fundación Cueva de Nerja-UISPP, 118–136.
Balbín Behrmann, R. de, Alcolea, J.J., Santonja, M., 1994. Siega Verde y el arte rupestre paleolítico al aire libre. VIColoquio Hispano-Ruso de Historia, Madrid, 5–19.
Balbín Behrmann, R. de, Alcolea, J.J., Santonja, M., 1995. El yacimiento rupestre paleolítico al aire libre de Siega Verde(Salamanca, España): una visión de conjunto. Trabalhos de Antropologia e Etnología de Porto 35, 73–102.
Balbín Behrmann, R.de, Alcolea, J.J., Santonja, M., 1996a. Siega Verde. Un art rupestre à l’air libre dans la vallée duDouro. Dossiers d’Archéologie 209, 98–105.
Balbín Behrmann, R. de, Alcolea, J.J., Santonja, M., 1996b. Arte Rupestre Paleolítico al aire libre en la cuenca del Duero:Siega Verde y Foz Côa. Fundación Rei Afonso Henriques, Serie monografías y estudios, Zamora.
Balbín Behrmann, R.de, Alcolea, J.J., Santonja, M., 1999. Vie quotidienne et vie religieuse. Les sanctuaires dans l’ArtPaléolithique. L’Anthropologie 103, 23–49.
Balbín Behrmann, R.de, Alcolea, J.J., Santonja, M., Perez, R., 1991. Siega Verde (Salamanca). Yacimiento artísticopaleolítico al aire libre. In: Santonja, M. (Ed.), Del Paleolítico a la Historia. Museo de Salamanca, Salamanca, pp. 33–
48.Balbín Behrmann, R. de, Bueno Ramírez, P., Jiménez, P., Alcolea, J.J., Fernández, J.A., Pino, E., Redondo, J.C., 1989. El
abrigo rupestre del Llano, Rillo de Gallo, Molina de Aragón. XIX Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza 1989,II, 179–194.
Balbín Behrmann, R.de, Moure, J.A., 1988. El Arte Rupestre de Domingo García (Segovia). Revista de Arqueología 87,16–24.
Balbín Behrmann, R.de, Moure, J.A., Ripoll Perelló, E., 1982. Grabados esquemáticos de la comarca de Santa María deNieva (Segovia). In: Coloquio Internacional sobre Arte Rupestre Esquemático de la Península Ibérica, Resumen deComunicaciones, Salamanca, pp. 8–9.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628624
Balbín Behrmann, R.de, Santonja, M., 1992. Siega Verde (Salamanca). El Nacimiento del Arte Europa. Catalogo de laExposición de la Unión Latina, Paris, pp. 250–252.
Baldellou, V., 1985. El arte rupestre post-paleolítico de la zona del río Vero (Huesca). Ars Praehistorica III/IV, 1984/1985,11–138.
Baldellou, V., Painaud, A., Calvo, M.J., Ayuso, P., 1993. Las pinturas rupestres del barranco de Arpán (Asque, Colungo,Huesca). Bolskan 10, 31–96.
Baptista, A.M., 1999a. No tempo sen tempo. A arte dos caçadores paleolíticos do vale do Côa. Centro Nacional de Arterupestre. Vila Nova de Foz Côa.
Baptista, A.M., 1999b. O ciclo quaternário do Vale do Cõa. Com algumas considerações do metodo sobre estílos,valoração estética e crono-estratigrafia figurativa. Arkeos 6, 197–277.
Baptista, A.M., 2001a. The Quaternary Roc Art of the Côa Valley (Portugal). In: Zilhão, J., Aubry, T., Faustino Carvalho,A. (Eds.), Les premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique. Actes du Colloque de la Commission VIII del’UISPP, Foz Côa, Novembre 1998, pp. 237–252.
Baptista, A.M., 2001b. Novas descobertas de arte paleolítica de aire libre no Alto Sabor (Tras-os-Montes, Portugal). Site:www.ipa.min-cultura.pt.
Baptista, A.M., 2001c. Ocreza (Envendos, Maçao, Portugal central): um novo sítio com arte paleolítica de ar livre.Arkeos: Perspectivas em Diálogo 11, 163–192.
Baptista, A.M., 2004. Arte paleolítica de ar livre no rio Zêzere (Barroca, Fundao). Eburóbriga, Fundao 1, Primavera/verao. Museu Municipal José Monteiro 9–16.
Baptista, A.M., 2006. Para além do vale do Côa: a arte paleolítica de ar livre em território português. Curso de ArteRupestre al aire libre. Resúmenes de las Comunicaciones Junio 2006, Salamanca, pp. 15.
Baptista, A.M., Reis, M., 2009. Prospecção da arte rupestre no Vale do Côa e alto Douro portugés: Ponto da situação emjulho de 2006. In: Balbín Behrmann, R. de (Ed.), Arte Prehistórico al aire libre en el Sur de Europa. Junta de Castilla yLeón, pp. 145–192.
Baptista, A.M., Santos, A.T., Correia, D., 2009. O santuário arcaico do Vale do Côa: Novas pistas para a compreensâo daestruturaçâo do bestiário gravettense e/ou gravetto-solutrense. In: Balbín Behrmann, R. de (Ed.), Arte Prehistórico alaire libre en el Sur de Europa. Junta de Castilla y León, pp. 89–143.
Bednarik, R.G., 1995a. More news from Hell’s Canyon, Portugal. AURA Newsletter 12, 7–8.Bednarik, R.G., 1995b. Côa Valley rock art analytical research program. Internal report to EDP (Electricidade de
Portugal).Bednarik, R.G., 1995c. The Côa petroglyphs: an obituary to the stylistic dating of Palaeolithic rock-art. Antiquity 69, 877–
882.Bednarik, R.G., 1997. European Art: the Palaeolithic Legacy? Cambridge Archaeologica Journal 7, 255–268.Beltrán, A., 1990. Arte rupestre prehistórico en Aragón. Bolskan 7, 57–65.Bergmann, L., 1996. Los grabados paleolíticos de la cueva del Moro (Tarifa, Cádiz): el arte rupestre del paleolítico más
meridional de Europa, Almoraima. Edita Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Cádiz. Revista deEstudios Campogibraltareños 16, 9–26.
Breuil, H., Burkitt, M.C., 1929. Rock Paintings of Southern Andalusia. In: A description of a Neolithic and Copper AgeArt Group, Clarendon Press, Oxford.
Bueno Ramírez, P., 2009. Espacios decorados al aire libre del occidente peninsular. Territorios tradicionales de cazadores-recolectores y de productores. In: Balbín Behrmann, R. de (Ed.), Arte Prehistórico al aire libre en el Sur de Europa.Junta de Castilla y León, pp. 323–345.
Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R.de, 2000a. Art mégalithique, art en plein air. Approches de la définition duterritoire pour les groupes producteurs de la Péninsule Ibérique. L’Anthropologie 104, 427–458.
Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R.de, 2000b. La grafía megalítica como factor para la definición del territorio.Arkeos 10, 129–178.
Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R.de, 2000c. Arte megalítico en la Extremadura española. Homenaje a ElíasDiéguez Luengo. Extremadura Arqueológica, VIII. El Megalitismo en Extremadura 345–379.
Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R.de, 2001. Le sacré et le profane : notes pour l’interprétation des graphiespréhistoriques péninsulaires. Revue Archéologique de l’Ouest (Suppl. 9), 141–148.
Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R. de, sous presse. Marcadores gráficos y territorios tradicionales en la Prehistoriade la Península Ibérica. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada.
Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R. de, Alcolea, J.J., 2003. Prehistoria del lenguaje en las sociedades cazadoras yproductoras del sur de Europa. In: Balbín Behrmann, R. de, Bueno Ramírez, P. (Eds.), Primer SimposiumInternacional de Arte Prehistórico de Ribadesella. El arte prehistórico desde los inicios del siglo XXI, Ribadesella,pp. 13–22.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 625
Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R.de, Alcolea, J.J., 2007. Style V dans le bassin du Douro. Tradition et changementdans les graphies des chasseurs du Paléolithique supérieur européen. L’Anthropologie 111, 549–589.
Bueno Ramírez, P., Balbín Behrmann, R.de, Barroso, R., 2004. Application d’une méthode d’analyse du territoire à partirde la situation des marqueurs graphiques à l’intérieur de la Péninsule Ibérique : le Tage International. L’Anthropologie108, 653–710.
Bueno Ramírez, P., Barroso, R., Balbín Behrmann, R. de, Carrera, F., 2006. Megalitos y marcadores gráficos en el TajoInternacional: Santiago de Alcántara (Cáceres). Ayuntamiento de Santiago de Alcántara.
Carrera, F., Bueno Ramírez, P., Barroso, R., Balbín Behrmann, R. de, 2007. Recuperación patrimonial de arteprehistórico: los abrigos de El Buraco y La Grajera, Santiago de Alcántara, (Cáceres). Ayuntamiento de Santiagode Alcántara.
Cartailhac, E., 1902. Les Cavernes ornées de dessins. La Grotte d’Altamira (Espagne). Mea culpa d’un sceptique.L’Anthropologie 13, 348–354.
Carvalho, A.F.de, Zilhão, J., Aubry, T., 1996. Vale do Côa. Arte Rupestre e Pré-História. In: Parque Arqueológico do Valedo Côa, Ministério da Cultura, Lisboa.
Clottes, J., Lorblanchet, M., Beltrán, 1995. Are the Foz Côa engravings actually Holocene? International Newsletter onRock Art 12, 19–21.
Collado, H., 2006. Arte rupestre del valle del Guadiana. El conjunto de grabados del Molino Manzánez (Alconchel -Cheles, Badajoz). Memorias de Odiana 4. EDIA.
Collado, H., 2009. Arte rupestre prehistórico en Extremadura: 1997–2006. In: Balbín Behrmann, R. de (Ed.), ArtePrehistórico al aire libre en el Sur de Europa. Junta de Castilla y León, pp. 287–322.
Corchón, M.S., 1985. Características técnicas y culturales del arte pariétal paleolítico: su proyección en la Meseta. StudiaZamorensia Historica VI, 223–271.
Corchón, M.S. (Ed.), 1997. La cueva de La Griega de Pedraza (Segovia). Arqueología en Castilla y León, 3. Junta deCastilla y León.
Corchón, M.S., 2006. Las cuevas de la Griega y la Palomera (Ojo Guareña) y la cuestión de la cronología del ArtePaleolítico en la Meseta. In: Delibes, G., Diez, F. (Eds.), El Paleolítico Superior en la Meseta Norte Española. StudiaArchaeologica 54, pp. 75–112.
Corchón, M.S., Valladas, H., Becares, J., Arnold, M., Tisnerat, N., Cachier, H., 1996. Datación de las pinturas y revisióndel Arte Paleolítico de Cueva palomera (Ojo Guareña, Burgos, España). Zephyrus 49, 37–60.
D’Errico, F., Sacchi, D., Vanhaeren, M., 2002. Analyse technique de l’art gravé de Fornols-Haut, Campôme-France.Implications dans la datation des représentations de style paléolithique à l’air libre. In: Sacchi, D. (Ed.), L’artpaléolithique à l’air libre. Le paysage modifié par l’image (Tautavel, Campôme 7–9 octobre 1999). GAEP, GÉOPRE,Saint-Estève, pp. 75–86.
Fortea, F.J., 1978. Arte Paleolítico del Mediterráneo español. Trabajos de Prehistoria 35, 99–149.Fortea, F.J., 1989. Cuevas de La Lluera. Avance al estudio de sus artes parietales. In: González Morales, M.R. (Ed.), Cien
años después de Sautuola. Estudios en homenaje a Marcelino Sanz de Sautuola en el Centenario de su muerte.Diputación Regional de Cantabria, Santander, pp. 189–202.
Fortea, F.J., 1990. Abrigo de La Viña. Informe de las campañas 1980–1986. Excavaciones Arqueológicas en Asturias 55–
68.Fortea, F.J., 1992. La Lluera I y II. El Nacimiento del Arte Europa. Catalogo de la Exposición de la Unión Latina, Paris,
233–235.Fortea, F.J., 1994. Los ‘‘santuarios’’ exteriores en el Paleolítico cantábrico. Complutum 5, 203–220.González Sainz, C., 1999. Sobre la organización cronológica de las manifestaciones gráficas del Paleolítico superior.
Perplejidades y algunos apuntes desde la región cantábrica. In: Cacho, R., Gálvez, N. (Eds.), 32.000 BP: Una odisea enel tiempo. Reflexiones sobre la definición cronológica del arte parietal paleolítico. Edades Revista de historia 6,Universidad de Cantabria, Santander, pp. 123–144.
González Sainz, C., 2005. Actividad gráfica magdaleniense en la región cantábrica. Datación y modificacionesiconográficas. In: Bicho, N.F. (Ed.), O Paleolítico. Actas do IV Congresso de Arqueología Peninsular, 14–19 Setembrode 2004, Faro, pp. 157–181.
Jorge, V.O. (Ed.), 1995. Dossier Côa. Trabalhos de Antropologia e Etnologia XXXV (4) 311–896.Jorge, S.O., Jorge, V.O., Almeida, C.A.F.de, Sanches, M.J., Soeiro, M.T., 1981. Gravuras rupestres de Mazouco (Freixo da
Espada a Cinta). Arqueología 3, 3–12.Jorge, S.O., Jorge, V.O., Almeida, C.A.F.de, Sanches, M.J., Soeiro, M.T., 1982. Descoberta de gravuras rupestres em
Mazouco, Freixo da Espada a Cinta (Portugal). Zephyrus XXXIV–XXXV, 65–70.Jorge, V.O., Jorge, S.O., Sanches, M.J., Ribeiro, J.P., 1981–1982. Mazouco (Freixo-de-Espada à Cinta). Nótula
arqueológica, Portugalia, nova serie II/III, 143–145.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628626
Lalanne, G., Breuil, H., 1911. L’Abri sculpté de Cap-Blanc à Laussel (Dordogne). L’Anthropologie 22, 385–402.Leroi-Gourhan, A., 1971. Préhistoire de l’Art Occidental. 2 edición aumentada. Mazenod, Paris.Laming-Emperaire, A., 1962. La signification de l’art rupestre paléolithique : Méthodes et applications. Imprimerie
Picard et Cie, Paris.Lorblanchet, M., 1993. From Style to Dates. In: Lorblanchet, M., Bahn, P.G. (Eds.), Rock Art Studies: the post Stylistic
Era or Where do we go from here? Oxbow Books, Oxford, Monograph 35, pp. 61–72.Martin, E., 1981. Arte rupestre paleolítico en la Meseta. Memoria de Licenciatura, Valladolid (inédita).Martin, E., Moure, J.A., 1981. El grabado de estilo paleolítico de Domingo García (Segovia). Trabajos de Prehistoria 38,
97–108.Martinez, J., 1986–1987. Un grabado paleolítico al aire libre en Piedras Blancas (Escullar, Almería). Ars Praehistorica V–
VI, 49–58.Martinez, J., 1992. Arte Paleolítico en Almería. Los primeros documentos. Revista de Arqueología 130, 24–33.Martinez, J., 2009. Arte paleolítico al aire libre en el sur de la Península Ibérica: Andalucía. In: Balbín Behrmann, R. de
(Ed.), Arte Prehistórico al aire libre en el Sur de Europa. Junta de Castilla y León, pp. 237–257.Martinez Valle, R., Calatayud, P.G., Villaverde, V., 2003. Las figuras grabadas de estilo paleolítico del Arbic d’en Meliá
(Castelló): reflexiones en torno a la caracterización final del arte paleolítico de la España Mediterránea. In: BalbínBehrmann, R. de, Bueno Ramírez, P. (Eds.), El Arte Prehistórico desde los inicios del Siglo XXI. Primer SymposiumInternacional de Arte Prehistórico de Ribadesella, Ribadesella, pp. 279–290.
Mas Cornellá, M., Ripoll López, S., Matós Romero, J.A., Paniagua Pérez, J.P., López Moreno de Redrojo, J.R.,Bergmann, L., 1995. Estudio preliminar de los grabados rupestres de la Cueva del Moro (Tarifa. Cádiz) y el artepaleolítico del Campo de Gibraltar. Trabajos de Prehistoria Madrid 52, 61–81.
Maura Mijares, R., Cantalejo Duarte, P., 2005. Dos ‘‘Códigos gráficos’’ sobre un mismo soporte: cavidades con artepleistoceno y holoceno en la provincia de Málaga. In: Hernández Pérez, M., Soler García, J. (Eds.), Arte Rupestre en laEspaña Mediterránea. Actas del Congreso Celebrado en Alicante 25–28 de Octubre de 2004, Alicante, pp. 299–310.
Mir, A., Salas, R., 2000. La cueva de la Fuente del Trucho y su industria litica arcaizante del Pleniglacial Superior(Colungo, Huesca). Bolskan 17, 9–32.
Moro-Abadia, O., Gonzalez Morales, M., 2005. L’analogie et la représentation de l’art primitif à la fin du XIXe siècle.
L’Anthropologie 109, 703–721.Otte, M., Da Silva, A.C., 1996. Recherches préhistoriques à la Grotte d’Escoural, Portugal. ERAUL 65, 17–27.Peña Santos, A. de la, 2001. Petroglifos de Galicia. Ed. Via Láctea, A Coruña.Peña Santos, A. de la, Vázquez Varela, J.M., 1979. Los Petroglifos Gallegos. Grabados rupestres prehistóricos al aire libre
en Galicia. Cuadernos del Seminario de estudios Cerámicos de Sargadelos 30, Edicios do Castro, A Coruña.Rebanda, N., 1995a. Os trabalhos arqueológicos e o complexo de arte rupestre do Côa. Instituto Português do Patrimonio
Arquitectónico e Arqueologíco, Lisboa.Rebanda, N., 1995b. Barragem de Vila Nova de Foz Côa. Os trabalhos arqueológicos e o complexo de arte rupestre.
Boletim da Universidade do Porto 25, 11–16.Ripoll López, S., Mas Cornellá, M., 1999. La grotte d’Atlanterra (Cádiz, Espagne). International Newsletter on Rock Art
23, 3–5.Ripoll Lopez, S., Municio, L. (Eds.), 1999. Domingo García. Arte Rupestre Paleolítico al aire libre en la meseta
castellana. Monografías de la Junta de Castilla y León, 8.Ripoll Lopez, S., Muñoz, F.J., Perez, S., Muñiz, M., Calleja, F., Martos, J.A., Lopez, J.R., Amaya, C., 1994. Arte rupestre
paleolítico en el yacimiento solutrense de la Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco, Almería). Trabajos de Prehistoria 51,21–39.
Ripoll Lopez, S., Ripoll Perelló, E., Collado Giraldo, H., 1997. Avance al estudio de la Cueva de Maltravieso (Cáceres). Elarte rupestre paleolítico en Extremadura. Extremadura Arqueológica VII 95–117.
Ripoll Lopez, S., Ripoll Perelló, E., Collado Giraldo, H., 1999. Maltravieso, el santuario extremeño de las manos.Memorias 1, Museo de Cáceres.
Roussot, A., 1984. Abri du poisson. In: L’art des cavernes. Atlas des grottes ornées paléolithiques française, Ministère dela Culture de Paris, pp. 154–156.
Sacchi, D., 1984. L’art paléolithique de la France méditerranéenne. Musée des Beaux Arts de Carcassonne 52, pp. 84.Sacchi, D., 1987. L’art paléolithique des Pyrénées roussillonnaises. In: Abelanet, J. et al. (Eds.), Études roussillonnaises
offertes à Pierre Ponsich, Perpignan, pp. 47–52.Sacchi, D., 1993a. Les critères d’authenticité et de datation de l’art pariétal paléolithique. In: L’Art Pariétal Paléolithique.
Techniques et méthodes d’étude. Documents Préhistoriques 5, pp. 311–314.Sacchi, D., 1993b. Les suidés. In: L’Art Pariétal Paléolithique. Techniques et méthodes d’étude. Documents Préhisto-
riques 5, pp. 161–163.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628 627
Sacchi, D., 1995. Brèves remarques à propos du site d’art rupestre de Foz Côa (Portugal), de son importance et de sondevenir. In: Jorge, V.O. (Ed.), Dossier Côa. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 35. pp. 519–522.
Sacchi, D., 2009. Le Rocher Gravé de Fornols vingt trois ans après sa découverte. In: Balbín Behrmann de, R. (Ed.),ArtePrehistórico al aire libre en el Sur de Europa. Junta de Castilla y León, pp. 193–2010.
Sacchi, D., Abelanet, J., Brule, J.L., 1987. Le rocher gravé de Fornols-Haut. Archéologia 225, 52–57.Sacchi, D., Abelanet, J., Brule, J.L., Massiac, Y., Rubiella, C., Vilette, P., 1988a. Le rocher gravé de Fornols-Haut à
Campôme, Pyrénées Orientales, France. Étude préliminaire. I Congreso Internacional de Arte Rupestre. Bajo AragónPrehistoria VII/VIII (1986/1987) 279–293.
Sacchi, D., Abelanet, J., Brule, J.L., Massiac, Y., Rubiella, C., Vilette, P., 1988b. Les gravures rupestres de Fornols-Haut,Pyrénées-Orientales. L’Anthropologie 92, 87–100.
Salmerón Juan, J., Lomba Maurandi, J., Cano Gomariz, M., 1999a. El arte rupestre paleolítico de Cieza. Primeroshallazgos en la región de Murcia. Resultados de la 1 Campaña de prospecciones Losares-Almadenes 93. Memoriasde Arqueología 1993 8, 94–111.
Salmerón Juan, J., Lomba Maurandi, J., Cano Gomariz, M., 1999b. Las pinturas rupestres de El Paso, Los Rumíes y ElLaberinto (Cieza, Murcia). Actas del XXIV Congreso Nacional de Arqueología, Cartagena 1997, I, 197–208.
Salmerón Juan, J., Lomba Maurandi, J., Cano Gomariz, M. Grupo Los Almadenes, 1997. Avance al estudio del arterupestre paleolítico en Murcia: Las Cuevas de Jorge, Las Cabras y el Arco (Cieza, Murcia). XXIII Congreso Nacionalde Arqueología, Elche, 1995, Zaragoza, 201–216.
Santiago Vilches, J.M., 1982. La cueva de las Palomas en el arte paleolítico del sur de España. Boletín del Museo de CádizII, 1979–1980. Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz, 5–11.
Ucko, P., Rosenfeld, A., 1967. Arte Paleolítico. Ed. Guadarrama, Madrid.Zilhão, J., 1995a. The age of the Côa valley (Portugal) rock-art: validation of archaeological dating to the palaeolithic and
refutation on ‘‘scientific’’ dating to historic or proto-historic times. (coord.) Antiquity 69, 883–901.Zilhão, J., 1995b. The stylistically Paleolithic petroglyphs of the Côa valley (Portugal) are of Paleolithic age. A refutation
of their ‘‘direct dating’’ to recent times. In: Jorge, V.O. (Ed.), Dossier Côa. Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 35.pp. 423–470.
Zilhão, J., 1997. Arte Rupestre e Pré-História do Vale do Côa. Trabalhos de 1995–1996. Ministério da Cultura, Lisboa,13–37.
R.B. Behrmann, P.B. Ramírez / L’anthropologie 113 (2009) 602–628628