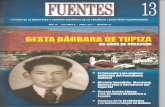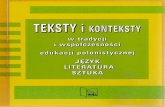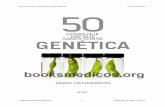Que sait-on de Clément Janequin ?
Transcript of Que sait-on de Clément Janequin ?
PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MUSICOLOGIE
v
Comité des publicationsAnne-Sylvie Barthel-Calvet, Marie-Noël Colette, Florence GétreauDenis Herlin, Hervé Lacombe, Catherine Massip, Cécile Reynaud
v
Édition!omas Soury
© Société française de musicologie
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction, par tous procédés, réservés pour tous paysISBN10 : 2-85357-031-2 ISBN13 : 978-2-85357-031-2 EAN: 9782853570312
Couverture : Jacopo Zucchi, Voûte de la Stanza degli Uccelli, ca 1576-1577Photographie d’Araldo De Luca ©
Nous remercions l’Académie de France à Rome – Villa Médicis pour ce cliché. ParisSociété française de musicologie
2013
v
édité sous la direction de Olivier Halévy, Isabelle His et Jean Vignes
CLÉMENT JANEQUINun musicien au milieu des poètes
Publié avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication
PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MUSICOLOGIE
v
Comité des publicationsAnne-Sylvie Barthel-Calvet, Marie-Noël Colette, Florence GétreauDenis Herlin, Hervé Lacombe, Catherine Massip, Cécile Reynaud
v
Édition!omas Soury
© Société française de musicologie
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction, par tous procédés, réservés pour tous paysISBN10 : 2-85357-031-2 ISBN13 : 978-2-85357-031-2 EAN: 9782853570312
Couverture : Jacopo Zucchi, Voûte de la Stanza degli Uccelli, ca 1576-1577Photographie d’Araldo De Luca ©
Nous remercions l’Académie de France à Rome – Villa Médicis pour ce cliché. ParisSociété française de musicologie
2013
v
édité sous la direction de Olivier Halévy, Isabelle His et Jean Vignes
CLÉMENT JANEQUINun musicien au milieu des poètes
Publié avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication
Il y a plus de 25 ans, Clément Janequin était l ’un des compo-siteurs les plus obscurs du XVIe siècle.
François Lesure, 19511
Si Clément Janequin n’est plus aujourd’hui un obscur compositeur, sa vie et bien des aspects de sa carrière restent teintés de mystère. À l’aube des années 1950, François Lesure et quelques érudits ont identi"é dans les archives départementales de la Gironde et de Maine-et-Loire2 ainsi que dans le Minutier central des notaires parisiens (Archives nationales3) une série de documents révélant l’existence précaire du célèbre musicien. Depuis, rien ne semble avoir été découvert sur la vie de Janequin. Son œuvre soulève toujours les mêmes questions : où s’est-il formé ? Comment s’est façonnée sa personnalité musicale ? Pourquoi sa carrière de musicien n’a-t-elle pas été à la mesure de son talent et de sa réputation ? A-t-il jamais été en poste à la cour de France ?
Premières traces de Clément Janequin dans les documents d’archives (1505-1525)
En l’état actuel des connaissances, les premières traces de Janequin remontent à 1505, année où il apparaît dans deux actes notariés comme témoin de Lancelot du Fau4.
1. François Lesure, « Clément Janequin : recherches sur sa vie et sur son œuvre », Musica Disci-plina, V (1951), p. 157. 2. Ci-après : AD.3. Ci-après : AN.4. AD Gironde, 3 E 4815, f. 15v et 16. Voir Paul Roudié et François Lesure, « La jeunesse bor-delaise de Clément Janequin (1505-1531). Documents inédits », Revue de musicologie, 49 (1963), p. 172-183.
Que sait-on de Clément Janequin ?
Christelle Cazaux-Kowalskiv
24
Ce dernier est un personnage d’une certaine importance, vicaire général de l’archevêque de Bordeaux, chanoine à Saintes et à Bordeaux, président des enquêtes au Parlement. Les actes aujourd’hui conservés dans les archives départementales de la Gironde ont été passés en l’abbaye de Pleine-Selve, le 26 août 1505, et quelques jours plus tard, le 5 septembre, à Saintes5.
Quel âge a Janequin à cette époque ? Sans doute n’est-il pas très âgé : on peut lui prêter environ vingt ans si l’on se réfère à l’hypothèse traditionnellement admise d’une naissance en 1485. Quoi qu’il en soit, il ne peut être beaucoup plus jeune puisqu’il a la capacité juridique de témoigner6. Le titre de « clericus » suggère de surcroît qu’il s’est sans doute déjà engagé dans les études conduisant à la prêtrise.
Surtout, il évolue dans le sillage d’un personnage particulièrement intéressant. Lancelot du Fau est un humaniste à qui le roi Louis XII con"e quelques missions diplo-matiques en Italie, en compagnie de Louis de Bourbon et de Francesco Soderini ; ce dernier est nommé évêque de Saintes en 15067.
Naissance et première formation musicaleJacques Levron a montré que la famille de Clément Janequin est originaire de Châtellerault (voir Illustration 1, Cahier couleur, p. v), modeste ville située entre Poitiers et Tours. Les parents, Étienne Janequin et Louise Liachère, sont morts avant 1534, laissant deux maisons situées dans la paroisse Saint-Jacques, trois pièces de terre dites « Les Jonchaz », « le Bois d’Auzon » et « #yors » ainsi que quelques jardins situés dans les environs de la ville, comme en témoigne un document notarié passé entre Clément Janequin et son frère Simon8. Les Janequin ne sont donc pas dénués de biens, même si nous en igno-rons la valeur et l’étendue. Auzon est le nom d’un ancien village se trouvant aujourd’hui
5. Paul Roudié et François Lesure, « La jeunesse bordelaise de Clément Janequin (1505-1531) », op. cit., p. 172. L’abbaye prémontrée de Pleine-Selve se trouve sur l’estuaire de la Gironde (Gironde, cant. de Saint-Ciers-sur-Gironde, arr. Blaye), dans le diocèse de Bordeaux et aux con"ns du diocèse de Saintes. 6. Il semble que les conditions d’âge requises pour exercer tel ou tel droit, prendre telle ou telle décision soient assez $ottantes à la "n du Moyen Âge et au début de la Renaissance. Il est donc di%cile de déterminer l’âge minimum de Janequin en 1505. Voir Michel Pastoureau, « Les emblèmes de la jeunesse », Histoire des jeunes en Occident, dir. Giovanni Levi et Jean-Claude Schmitt, Paris : Seuil, 1996, t. 1, p. 257-258.7. Paul Roudié et François Lesure, « La jeunesse bordelaise de Clément Janequin (1505-1531) », op. cit., p. 173. 8. Jacques Levron, Clément Janequin, musicien de la Renaissance : Essai sur sa vie et ses amis, Grenoble : B. Arthaud, 1948, p. 89-90, p. 117-118 ; AD Maine-et-Loire, 5E 1/8 (12 juin 1534).
!"#$%&"# !'"(%# : )*# +%# $,-.**)#, )*# /)+"# 0%*1)2%&"#
25
sur le territoire de la commune de Châtellerault, un peu au sud de la ville proprement dite9. « "yors », aujourd’hui "iours, est un hameau de la commune de "uré, situé à sept kilomètres à l’ouest de Châtellerault10. Malgré des recherches dans les dictionnaires topographiques et les cartes anciennes (Cassini), nous n’avons pu localiser de lieu appelé « Les Jonchaz ».
Simon Janequin — on ignore quelle est sa profession — vit à Angers avec son épouse Claudine Jagoys, dont le neveu, Maurille Ragot, étudie à l’Université. Le cousin germain des frères Janequin, François Regnault, est marchand et bourgeois de Paris11. Ces quelques éléments permettent de situer la famille Janequin dans un milieu assez modeste, celui d’une petite bourgeoisie de province qui a, toutefois, quelques attaches parisiennes.
Bien que personne n’ait pu le démontrer, il est très probable que Janequin soit né à Châtellerault. Y a-t-il reçu sa première formation musicale ? Aucun document ne le prouve mais l’hypothèse est vraisemblable. L’église Notre-Dame est la principale insti-tution ecclésiastique de la ville. Située à proximité immédiate du château d’Harcourt, résidence des vicomtes de Châtellerault, elle est érigée dès la #n du xiie siècle en collé-giale12. En 1427, Jean d’Harcourt fonde une psallette de quatre enfants de chœur placés sous l’autorité d’un maître a#n de chanter une messe quotidienne « à note » en l’honneur de la Vierge13. En 1449, quatre « vicaires » (chanteurs adultes) se joignent aux enfants de chœur14.
La psallette de Châtellerault attire l’attention du chapitre cathédral de Bordeaux, qui vient y recruter un petit chantre dès 1480. En 1481, par testament, Charles II d’An-jou (1436-1481) assure aux chanoines de Notre-Dame une rente permettant le recrute-ment de deux enfants et deux vicaires « ténoristes » supplémentaires. Il fonde également un collège dirigé par l’un des chanoines, ce qui permet aux petits chanteurs de poursuivre leurs études après la mue15. À la #n du xve siècle, la collégiale entretient par conséquent six chanteurs adultes et six enfants de chœur. Pour une petite ville comme Châtellerault, ce sont des e'ectifs relativement importants.
9. Louis Rédet, Dictionnaire topographique du département de la Vienne comprenant les noms de lieux anciens et modernes, Paris : Imprimerie nationale, 1881, p. 13. 10. "uré, Vienne, canton et arr. Châtellerault. Ibid., p. 408.11. François Lesure, « Clément Janequin : recherches sur sa vie et sur son œuvre », op. cit., p. 172-173 ; AN, Minutier central, C, 29 (1548) et C, 32 (1549). "uré, Vienne, canton et arr. Châtellerault. Ibid., p. 408.12. Abel Orillard, « La Collégiale Notre-Dame de Châtellerault », Société française d’Archéologie. Extrait du Bulletin Monumental no 1, Paris, 1937, p. 1-11.13. AD Vienne, G 1868.14. Ibid.15. Ibid.
!"#$%&'((' !)*)+,--./)(%-$ : 0+' %)$&-.1 2' !(34'1& 5)1'0+$1 6
26
Les archives relatives au fonctionnement de Notre-Dame sont malheureusement très fragmentaires. Aucune trace de Clément Janequin n’a pu être retrouvée dans les fonds conservés aux Archives départementales de la Vienne. Toutefois, quelques bribes d’informations subsistent concernant le personnel musical aux alentours de 1500.
Trois enfants de chœur sont nommés dans des actes passés en 1503. Jean Duboys et Pierre Gauvain16 — en remplacement de son camarade Jean Roy, décédé — sont présentés à des o"ces de chanteurs adultes, devenus vacants. Ils sont enfants de chœur depuis six ans et n’ont pas encore mué. Il s’agit de leur réserver ces postes tant qu’ils ne seront pas vocalement aptes à en assurer la charge. En attendant, le chapitre sera tenu de recruter deux chantres « bon musiciens et cappables, en aage et ydoine » pour servir à leur place. Au cours de ces tractations, le chapitre de Notre-Dame est représenté par deux de ses chanoines, Jean Colleteau et François Lebeau17. Ce dernier patronyme, quoique assez répandu, retient l’attention. Existe-t-il un lien de parenté entre François Lebeau, chanoine à Châtellerault, et trois autres Lebeau, Mathurin, Michel et Guillaume, avec lesquels Janequin a été en relation au cours de sa vie ? Mathurin Lebeau, procureur au Parlement de Paris, ami intime de la famille Attaingnant et exécuteur testamentaire de Janequin, est parent de Michel Lebeau, chanoine à Angers dans les années 1540. Par ailleurs, c’est en faveur d’un certain Guillaume Lebeau que Janequin résigne sa cure d’Unverre, près de Chartres, en 154918.
À l’instar du jeune garçon que le chapitre de Bordeaux était venu chercher à Châtellerault en 1480, peut-être Janequin a-t-il très tôt quitté sa ville natale — ou sup-posée telle. Il n’est pas impossible que son talent ait été remarqué et qu’il ait intégré quelque institution ecclésiastique plus prestigieuse ou tout simplement qu’il soit entré, adolescent, au service d’un personnage tel que Lancelot du Fau. Ce dernier, devenu évêque de Luçon en 1515 et mort en 1523, a-t-il été l’unique protecteur de Janequin entre le début des années 1500 et 1523 ou y en a-t-il eu d’autres avant lui ? Les archives relatives aux évêchés de Luçon (Vendée) et de Saintes (Charente-Maritime) n’ont peut-être pas encore été su"samment exploitées et il conviendrait d’aller y chercher la trace d’une jeunesse poitevine et saintongeaise qui pourrait avoir précédé l’installation de Janequin à Bordeaux.
16. Je remercie Frank Dobbins de m’avoir aimablement signalé l’existence d’un « P. Gauvain », auteur de chansons notées vers 1530 dans le ms. de la Bibliothèque nationale de France, N.A.F. 4599. Voir Henri Omont, « Nouvelles acquisitions du Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale : années 1891-1892 », Bibliothèque de l ’École des chartes, 53 (1892), p. 345. 17. AD Vienne, G 1868.18. François Lesure, « Clément Janequin : recherches sur sa vie et sur son œuvre », op. cit., p. 171.
!"#$%&"# !'"(%# : )*# +%# $,-.**)#, )*# /)+"# 0%*1)2%&"#
27
Débuts de Janequin comme compositeur (ca 1515-1525)
On ne possède aucune mention de Janequin entre 1505 et 1525, date à laquelle on constate que, devenu prêtre, il est au service de l’archevêque de Bordeaux, Jean de Foix (1501-1529), personnage de haut rang qui l’a pris sous sa protection à la mort de Lancelot du Fau (1523).
À cette époque, Janequin n’est plus vraiment un inconnu. Sa renommée s’est forgée au cours des vingt années sur lesquelles les archives sont, pour l’instant, restées muettes. L’œuvre du compositeur permet cependant de poser quelques jalons. La fameuse Guerre (La Bataille de Marignan, 1515) a sans doute contribué à rendre le musicien très vite célèbre, pas seulement en France mais dans toute l’Europe.
Parmi les premières œuvres attribuables à Janequin "gure une autre chanson, beau-coup moins connue que La Guerre, mais qui semble con"rmer que Janequin compose régulièrement dès les années 1510. Il s’agit d’un virelai anonyme du xive siècle, Or sus, or sus vous dormez trop (L’Alouette). Cette chanson à trois voix a circulé sous forme manus-crite dès les années 1510. Copiée dans un recueil &orentin autour de 151519, elle est imprimée à Venise, cinq ans plus tard, sans nom d’auteur20. Un arrangement à quatre voix de la même œuvre paraît en 1528 chez Attaingnant, aux côtés d’autres pièces descriptives signées de Janequin.
Le musicien aurait-il réalisé deux versions successives d’Or sus, l’une à trois, l’autre à quatre voix ? François Lesure avait autrefois attribué la version à trois voix à Janequin avant de revenir sur son a'rmation première21. L’hypothèse a été remise à l’honneur par Frank Dobbins, pour qui l’écriture de la chanson anonyme à trois voix, bien qu’assez maladroite, contient tous les éléments qui caractérisent le style si particulier des pièces descriptives de Janequin : onomatopées, échanges de brefs motifs mélodiques entre les voix, notes répétées à l’unisson, etc.22
19. Florence, Biblioteca nazionale centrale, Magliabechi XIX 117, f. 8v-10. Voir Lawrence F. Bernstein, « A Florentine Chansonnier of the Early Sixteenth Century », Early Music History, 6 (1986), p. 1-107. 20. Chansons a troys, Venise : Antico & Giunta, 1520 [RISM B 15206].21. François Lesure, « Clément Janequin : recherches sur sa vie et sur son œuvres », op. cit., p. 158 ; François Lesure, « Les chansons à trois voix de Clément Janequin », Revue de musicologie, 44 (1959), p. 197.22. Frank Dobbins, « Andrea Antico’s Chansons and the Di(usion of French Song in the Second Decade of the Sixteenth Century », « La la la... Maistre Henri » : Mélanges de musicologie o"erts à Henri Vanhulst, éd. Christine Ballman et Valérie Dufour, Turnhout : Brepols, 2009, p. 152. Voir aussi infra, p. 289-292.
!"#$%&'((' !)*)+,--./)(%-$ : 0+' %)$&-.1 2' !(34'1& 5)1'0+$1 6
28
Grâce à La Guerre, peut-être également grâce à L’Alouette ou à d’autres chansons dont l’écriture tranche avec les genres en vogue sous le règne de Louis XII, la renommée de Janequin se répand rapidement et largement dès le milieu des années 1510, atteignant d’emblée la péninsule italienne. Lorsque Pierre Attaingnant lui consacre l’un de ses tous premiers recueils de musique imprimée, aux alentours de 1528, le musicien est une "gure connue et reconnue dont les œuvres se vendent23.
Janequin à Bordeaux et en Gascogne (1525 à 1531) À Bordeaux, Janequin n’occupe apparemment aucune charge musicale. Il se contente de jouir de revenus ecclésiastiques, grâce au soutien de Jean de Foix, dont il se dit toujours le serviteur en 1528. Ce dernier intervient personnellement pour lui faire attribuer l’o#ce de « procureur des âmes » (préposé aux messes anniversaires) du diocèse de Bordeaux. Janequin est en procès avec la personne qui exerce réellement cette charge, un certain Bernard Destuberro, qui, de toute évidence, n’a guère l’intention de verser à Janequin la part de revenus qui lui revient. L’archevêque de Bordeaux intervient à nouveau, obligeant Destuberro à s’acquitter de 150 L. t. pour chacune des années 1526 à 152924.
Janequin est également titulaire de deux autres béné"ces dépendant de l’archevê-ché de Bordeaux : la cure de Saint-Michel de Rieufret, a$ermée par ses soins de 1526 à 152825 ainsi qu’un canonicat à Saint-Emilion, qu’il détient en 1525, auquel il semble renoncer en 1528, mais s’en déclare toujours titulaire en 152926. Selon une pratique cou-rante à cette époque, il n’exerce pas les charges ecclésiastiques correspondantes, mais les con"e à un vicaire.
Bien qu’il se déclare régulièrement en manque d’argent, Janequin n’est pas dépourvu de revenus. À cette époque, il cumule des béné"ces modestes mais qui correspondent ni plus, ni moins à ceux dont jouit un musicien de chapelle à cette époque : 150 L. t. par an pour l’o#ce de procureur des âmes, 100 L. t. par an pour la cure de Saint-Michel de
23. Chansons de maistre Clement Janequin nouuellement et correctemet imprimeez, Paris : Attaingnant, [1528] [A 4].24. AD Gironde, plusieurs documents sous la cote 3 E 4734. Voir Paul Roudié et François Lesure, « La jeunesse bordelaise de Clément Janequin (1505-1531) », op. cit., p. 177-179.25. Saint-Michel de Rieufret, Gironde, cant. Podensac. Voir AD Gironde, E 9802, f. 25v ; Paul Roudié et François Lesure, « La jeunesse bordelaise de Clément Janequin (1505-1531) », op. cit., p. 174-178.26. AD Gironde, 3 E 9802, f. 358v et f. 379, 3 E 4728, f. 266, 3 E 2496 ; voir Paul Roudié et François Lesure, « La jeunesse bordelaise de Clément Janequin (1505-1531) », op. cit., p. 174-182.
!"#$%&"# !'"(%# : )*# +%# $,-.**)#, )*# /)+"# 0%*1)2%&"#
29
Rieufret, 100 L. t. par an pour le canonicat de Saint-Emilion. Au total, ses revenus bor-delais lui assurent 350 L. t. par an, auxquelles s’ajoute une petite cure à Brossay, en Anjou, qu’il détient vraisemblablement dès le milieu des années 152027. À la même époque, un chantre de la Chapelle du roi de France dont les gages sont certainement plus élevés que la moyenne perçoit entre 240 et 300 L. t. par an, auxquels s’ajoutent parfois les revenus d’un canonicat ou d’une chapellenie supplémentaires28. Les di"cultés matérielles de Janequin semblent surtout liées à la perception e#ective de ces sommes et aux di#érents procès que cela entraîne.
Visiblement, Janequin cherche à se libérer de toute obligation d’ordre ecclésiastique, et peut-être même de toute charge musicale au sein d’une maîtrise ou d’une psallette. Il préfère jouir de la protection d’une personne assez riche ou in$uente pour lui permettre d’exercer pleinement son art — même si cette « liberté » ne lui épargne pas les soucis matériels. Après Lancelot du Fau et Jean de Foix, Janequin semble trouver un soutien auprès de Bernard de Lahet, avocat du roi à l’Amirauté de Guyenne puis au Parlement de Bordeaux. Ce dernier apprécie la compagnie des musiciens, si l’on en croit le témoignage d’Eustorg de Beaulieu, qui cite Clément Janequin comme membre de ce cercle29. Privé de ses béné%ces bordelais, le compositeur retrouve quelques sources de revenus plus au sud, en Gascogne, dans une région où Lahet a peut-être quelque in$uence par ses origines basques. Autour de 1530, Janequin se dit diacre de Garosse et curé de Saint-Jean-Baptiste de Mézos. Il conservera ce dernier béné%ce jusqu’en 155030. En 1531, Janequin se dit « maître des enfants de la cathédrale d’Auch ». La présence du cardinal de Clermont, alors évêque de la ville et futur employeur d’un autre musicien, Jean Lhéritier, explique peut-être le bref passage du musicien à Auch31.
Janequin à AngersJanequin ne s’attarde pas longtemps en Gascogne. En 1533, on le retrouve à Angers où réside son frère Simon et où il détient deux béné%ces à la collation du chapitre : une cure à Brossay ainsi qu’une chapellenie desservie à la cathédrale et traditionnellement
27. Jacques Levron, Clément Janequin, musicien de la Renaissance, op. cit., p. 73.28. Christelle Cazaux, La Musique à la cour de François Ier, Paris, Tours : École nationale des chartes-Centre d’études supérieures de la Renaissance, 2002, p. 81-85.29. Eustorg de Beaulieu, Les divers rapportz, éd. Michael A. Pegg, Genève : Droz, 1964, p. 241. 30. Garrosse, Landes, cant. de Morcenx ; Mézos, Landes, cant. de Mimizan.31. Merritt-Lesure, vol. I, introduction, p. ii.
!"#$%&'((' !)*)+,--./)(%-$ : 0+' %)$&-.1 2' !(34'1& 5)1'0+$1 6
30
réservée à l’un des membres de la psallette32. Cette année-là, il échange Brossay contre une cure à Avrillé, plus proche d’Angers33. De 1534 à 1537, il occupe le seul poste de musicien d’église qu’on lui connaisse : celui de maître des enfants de chœur de la cathé-drale d’Angers.
L’installation de Janequin à Angers est vraisemblablement favorisée par l’évêque et poète Jean Olivier (1532 à 1540) et par l’existence de cercles littéraires proches du courant marotique, où s’illustre notamment Germain Colin Bucher, mais aussi par la présence de musiciens tels que Loys Henry, qui succédera à Janequin à la tête de la psal-lette en 1537, et Guillaume Cadiot, chanteur et joueur de violes au service de l’évêque34.
Parmi les relations angevines de Janequin, il faut citer également François de Gondi, seigneur des Ra"oux, dont la résidence est située sur le territoire de la cure d’Avrillé. Gondi protège les artistes et semble apprécier Janequin au point de lui demander d’être parrain de deux de ses #lles, en 1533 et en 153735. Cette période de relative stabilité est particulièrement féconde pour le musicien qui voit nombre de ses œuvres publiées dans les recueils d’Attaingnant.
1530, un tournant : pourquoi Janequin n’entre pas au service du roi de France
Il est peu probable que Janequin ait été recruté à la cour de France à l’époque où, dans deux actes passés devant notaire, il se déclare « chantre du roi36 ». L’appellation, d’une part, est insolite : on peut être « chantre ordinaire de la chapelle », « chantre et chapelain de la chapelle », ou encore « chantre et chanoine de la chapelle », mais jamais « chantre du roi », tout au moins dans les documents d’archive. Les comptes de la Chapelle de François Ier, certes peu nombreux, ne font pas apparaître le nom de Janequin, pas plus que les états de la musique de la Chambre, mieux conservés. Aucun autre document des règnes de François Ier et d’Henri II ne cite notre musicien37.
Tout porte à croire cependant que Janequin a tenté d’obtenir une place à la cour de France en cette #n des années 1520. Quinze ans après Marignan, la situation politique lui
32. Jacques Levron, Clément Janequin, musicien de la Renaissance, op. cit., p. 73 sqq.33. Id., p. 80 et 115. 34. François Lesure, « Clément Janequin : recherches sur sa vie et sur son œuvre », op. cit., p. 160 sqq.35. Jacques Levron, Clément Janequin, musicien de la Renaissance, op. cit., p. 7.36. AD Gironde, 3 E 10000 ; voir François Lesure, « Clément Janequin chantre de François Ier », Revue de musicologie, 40 (1957), p. 203-205.37. Comptes édités dans Christelle Cazaux, La Musique à la cour de François Ier, op. cit., p. 309-337.
!"#$%&"# !'"(%# : )*# +%# $,-.**)#, )*# /)+"# 0%*1)2%&"#
31
permet de !atter à nouveau la monarchie. Chantons sonnons trompettes tabourins célèbre la paix de Cambrai (1529) et le retour en France des deux #ls de François Ier. Janequin est-il entré en contact avec le roi lors du passage de la cour de France à Bordeaux durant l’été 1530 ? Ce dernier lui aurait-il fait quelque promesse d’engagement ? Aucun docu-ment ne permet de l’a$rmer, mais une telle hypothèse expliquerait le curieux titre de « chantre du roi » dont se targue le musicien en 1531.
Très peu de temps après, en tout cas avant 1533, date de leur publication chez Attaingnant, Janequin met en musique trois poèmes de François Ier : Dictes sans peur ou l ’ouy ou nenny, Je n’ose estre content et Las, que crains-tu, amy, de quoy as de!ance (deuxième strophe de Je n’ose estre content)38. Le fait est unique dans l’œuvre de Janequin. C’est la première et la dernière fois qu’il compose des chansons sur les vers du roi, tout au moins d’après les sources qui nous sont connues. Mais surtout, quasiment au même moment, ces trois textes de François Ier sont également mis en musique par Claudin de Sermisy ; ils paraissent en 153239.
Une telle coïncidence de dates et de choix littéraires ne saurait être le fait du hasard. Janequin et Sermisy sont les deux #gures de proue du répertoire de la chanson au début des années 1530, chacun avec son style et sa manière particulière de composer. Il arrive assez souvent qu’un même texte soit mis en musique par plusieurs compositeurs. Mais lorsqu’il s’agit des vers du roi, la situation n’est pas anodine. Par ailleurs, la publication de certaines chansons sur des poèmes de François Ier coïncide avec l’engagement de leurs auteurs à la cour : c’est le cas par exemple de Pierre Vermont, (Les Yeulx bendez de triste congnoissance) en 1533 et de Pierre Sandrin (Doulce memoire en plaisir consommée, Ce qui souloit en deux se despartir, Vous usurpez, dames, injustement) en 153840.
Par ce geste, Janequin cherche certainement à se rappeler au bon souvenir d’un monarque dont il espère sans doute une marque de reconnaissance concrète. Quant à Claudin de Sermisy, que peut-il espérer de plus, lui qui est en poste à la cour depuis le règne de Louis XII ?
38. Vingt et quatre chansons musicales composees par maistre Clement Jenequin […], Paris : Attain-gnant, 1533 [A 40] [RISM A JJ443a]. Voir Catalogue de la chanson française à la Renaissance, http://ricercar.cesr.univ-tours.fr/3-programmes/basechanson/index.htm (consulté le 10 novembre 2010) ; François Ier, Œuvres poétiques Genève : Slatkine, 1984, D 24, CH 16. 39. Trente et troys chansons nouuelles en musique […], Paris : Attaignant, 1532 [A 30] [RISM B 153212].40. François Lesure, « François Ier : un roi-poète et ses musiciens », « La musique, de tous les pas-setemps le plus beau » : Hommage à Jean-Michel Vaccaro, éd. François Lesure et Henri Vanhulst,
!"#$%&'((' !)*)+,--./)(%-$ : 0+' %)$&-.1 2' !(34'1& 5)1'0+$1 6
32
Ces faits se déroulent autour de 1530, moment où la chapelle royale fait l’objet d’une importante réorganisation. À sa tête, François Ier a décidé de placer un haut digni-taire ecclésiastique, le cardinal de Tournon, tandis que la véritable direction musicale est con"ée à un « sous-maître ». Après une période de #ottement consécutive à la mort d’Antoine de Longueval, ancien maître de la chapelle (1525), à la captivité du roi en Espagne et aux di$cultés rencontrées par la régente pour le paiement du personnel de la cour, François Ier renouvelle et accroît les e%ectifs de sa chapelle de musique, aug-mente assez sensiblement les gages des chantres. La direction musicale de la chapelle de musique échoit "nalement à Claudin de Sermisy, à une date qui reste di$cile à préciser, mais qui se situe entre 1530 et 153341.
Janequin a-t-il brigué la direction de la chapelle ? Cela paraît assez vraisemblable, mais avait-il quelque chance de convaincre François Ier de l’engager alors qu’une "gure tout aussi reconnue dans le monde musical, Claudin de Sermisy, était présente à la cour de France depuis 1510 ?
Paris (1549-1558) : célébrité et dénuementAprès 1538, on perd à nouveau la trace de Janequin dans les documents d’archives. Dix ans plus tard, le musicien, qui doit avoir cinquante-cinq ou soixante ans, se déclare étudiant. Sans doute cherche-t-il, comme le suggère François Lesure, à acquérir quelque grade universitaire lui permettant de prétendre à des béné"ces ecclésiastiques plus lucra-tifs42. Il s’installe à Paris en 1549 et y reste vraisemblablement jusqu’à sa mort en 1558. Janequin est alors au sommet de son art, abondamment publié par Nicolas Du Chemin, mais plus que jamais dépourvu de moyens de subsistance, hormis peut-être quelques lar-gesses glanées çà et là, auprès du cardinal Jean de Lorraine, de son "ls François de Guise, ou d’autres grands personnages.
Du côté de la cour de France, Sermisy règne toujours sur la chapelle de musique et la reconnaissance royale se fait attendre. En 1555, Janequin, nouveau locataire d’une maison située rue neuve Saint-Sulpice, se déclare en"n « chantre ordinaire de la chapelle
41. Claudin de Sermisy porte le titre de sous-maître de la chapelle de musique dans le compte de 1533, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 10389, f. 5. Un document littéraire daté approximativement de 1530 (Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 17276, f. 95) le désigne comme « maître et recteur » sans toutefois employer clairement le titre de « sous-maître ». Voir Christelle Cazaux, La Musique à la cour de François Ier, op. cit., p. 260-261.42. François Lesure, « Clément Janequin : recherches sur sa vie et sur son œuvre », op. cit., p. 163-164.
!"#$%&"# !'"(%# : )*# +%# $,-.**)#, )*# /)+"# 0%*1)2%&"#
33
du roi43 ». Un homme de près de soixante-dix ans, aussi renommé que lui, était-il réel-lement disposé à servir comme simple chantre à la chapelle de musique ? Était-il encore capable de chanter, si tant est qu’il l’ait jamais été ?
Dans le testament qu’il rédige en janvier 1558, le musicien se dit même « composi-teur ordinaire en musique pour le roi notre sire44 ». Sous François Ier et Henri II, ce titre de « compositeur », ponctuellement porté par Pierre Sandrin en 1547, ne correspond pas vraiment à une charge assortie de gages réguliers mais plutôt à une sorte de dignité. Que recouvrent réellement les titres dont se pare Janequin dans les dernières années de sa vie ? A-t-il perçu quelque pension royale tout en étant dispensé d’obligations réelles à la Chapelle ? Il n’y a aucune trace du musicien dans les rares comptes conservés pour le règne d’Henri II45. Sa mort, survenue entre le 18 janvier 1558, date du testament, et le 7 avril 155846, ne semble avoir suscité aucun hommage de la part des musiciens et des poètes contemporains.
v
Que sait-on vraiment de Clément Janequin ? À travers le prisme de la documentation archivistique, on aurait tôt fait de réduire sa biographie à une série de tractations "nan-cières et de litiges incitant à juger l’homme quelque peu « chicanier », pour reprendre un quali"catif employé naguère par François Lesure47.
Janequin semble profondément atypique, comme homme et comme musicien. Son style se démarque très nettement de celui de ses contemporains les plus talentueux, Claudin Sermisy, Pierre Certon ou d’autres. Bien qu’ayant embrassé la carrière ecclésias-tique en devenant prêtre, il est resté toute sa vie en marge des institutions religieuses. Hormis les quelques années angevines, Janequin n’a vraisemblablement jamais occupé
43. AN, Minutier central, C/54 (28 septembre 1555). Voir François Lesure, « Clément Janequin : recherches sur sa vie et sur son œuvre », op. cit., p. 174-175. 44. AN, Minutier central, LXXIII/51 (18 janvier 1558 n. st.). Voir François Lesure, « Clément Janequin : recherches sur sa vie et sur son œuvre », op. cit., p. 169-170.45.f. 1392, année 1559). En particulier, aucun compte de la chapelle ne subsiste. Voir Jeanice Brooks, Courtly Song in Late Sixteenth-Century France, Chicago : University of Chicago Press, 2000, p. 413-536 ; Isabelle Handy, Musiciens au temps des derniers Valois (1547-1589), Paris : Honoré Champion, 2008.46. Yves Delaporte, « Clément Janequin, compositeur ordinaire du roi, curé d’Unverre. Date de sa mort (1558) », Bulletin de la Société archéologique d’Eure-et-Loir. Mémoires, XXI (1958/4), p. 177-180. 47. Merritt-Lesure, vol. I, p. iv.
!"#$%&'((' !)*)+,--./)(%-$ : 0+' %)$&-.1 2' !(34'1& 5)1'0+$1 6
34
de fonctions musicales au sein d’une institution ecclésiastique. Sa carrière, si médiocre au regard de son talent musical, résulte-t-elle d’un destin malheureux ou d’un choix personnel ? Janequin a-t-il été confronté à une concurrence particulièrement dure, voire à des ennemis personnels, comme le suggère Philippe Caron dans son étude du Chant des oyseaux48 ? Avait-il quelque défaut rédhibitoire, par exemple une voix désagréable, handicap bien réel pour un musicien de chapelle ?
Aux charges ecclésiastiques, Janequin semble avoir préféré la protection de prélats éclairés, ouverts aux idées nouvelles et aux milieux littéraires et artistiques de leur temps, fréquentations sans doute plus stimulantes pour l’exercice de son art que les obligations parfois pesantes de l’encadrement d’une maîtrise et de la vie en communauté.
Sans doute n’aurait-il pas dédaigné d’entrer au service du roi de France si l’occasion s’était présentée. Claudin de Sermisy s’est-il trouvé sur son chemin ? Janequin a-t-il déplu à François Ier ? Il reste étonnant qu’un roi désireux de s’entourer des meilleurs artistes de son temps, toujours prêt à récompenser un instrumentiste, comblant de faveurs le luthiste Albert de Rippe, n’ait pas cherché — réussi ? — à attirer Janequin à la cour de France, pas plus que son successeur Henri II. Gageons cependant que de nouvelles découvertes archivistiques permettront de lever un peu plus le voile sur le mystère de la vie de Clément Janequin.
48. Voir infra la contribution de Philippe Caron, p. 385.
!"#$%&"# !'"(%# : )*# +%# $,-.**)#, )*# /)+"# 0%*1)2%&"#