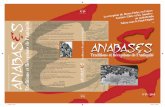Premières
-
Upload
universitecheikhantadiopdedakar -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Premières
Premières élections ouvertes en Guinée : ouvrent-elles la voie à la stabilité ?
1
Premières élections ouvertes en Guinée : ouvrent-elles la voie à la stabilité ?
Akim BAYOR
L’élection, qui vient du latin electio ou « choix », se définie comme l’instrument de
désignation des gouvernants. Elle est un substitut au tirage au sort ou aux prédictions des
oracles, à l’hérédité ou à la cooptation. Elle est une alternative viable à l’autodésignation,
mais aussi un outil de participation des citoyens à la gestion de la chose publique1.
En conviant chaque individu au choix de ses représentants, l’élection crée un consensus
autour du plan global d’orientation des affaires dans lequel majorité et minorité, votants et
non votants se retrouvent. Il n’y a donc pas lieu pour une quelconque frange du peuple de
contester la place des dirigeants ainsi choisis, ni de dénoncer les mesures prises par ceux-ci
lorsqu’elles l’ont été en dehors de toute illégalité et de toute injustice. L’on ne devrait pas non
plus se trouver face à un soulèvement contre un tel pouvoir. Bref, il y aurait de la stabilité.
L’élection aurait alors un effet consolidant sur la stabilité d’un pays. Mais cela suppose
évidemment qu’il s’agisse d’une élection conduite dans la transparence aussi bien au niveau
du déroulement des opérations électorales que de la proclamation des résultats. La liberté
et la sincérité du vote sont, ici, des exigences de taille.
La Guinée, pour la première fois de son histoire depuis l’accession à la souveraineté
internationale en 1958, vient de passer une épreuve électorale réellement ouverte et à priori
dénuée de toute pression d’un président sortant. Quand l’on sait combien l’héritage des
précédents régimes est lourd de tensions et pressions, ne pourrait-on pas aisément faire le
pari d’une nouvelle ère dans l’histoire et pour l’avenir de la guinée ? Ne serions nous pas
autorisés à soutenir la survenue d’une nouvelle page pour la Guinée, faite de gouvernance
apaisée, de sécurité humaine, et donc de stabilité ?
Un aperçu du tableau qu’affichait la guinée à la veille de l’élection présidentielle de 2010
révèle l’ampleur du déficit engrangé jusque là sur les plans politique, économique et social.
Bien que le régime Conté ait pu, depuis les années 90, apparaître aux yeux des puissances
occidentales comme l’un des derniers pôles de stabilité dans une région victime de
déliquescence des États, la situation intérieure de cet État laissait entrevoir la réunion de
tous les ingrédients pour une explosion de la violence.
La situation économique était des plus précaires. Entre les manifestations contre la hausse
du coût de la vie, la recrudescence des coupures d’eau et d’électricité, et les arriérés
réclamés par les agents de la fonction publique, la seule question pertinente était de savoir
quand l’un de ces éléments allait précipiter le pays vers une dérive violente2. Sur le plan
politique, la rigueur dogmatique mélangée de cruauté paranoïaque de Sékou Touré3, et la
confiscation stratégique des leviers d’émancipation, par la mainmise sur l’appareil sécuritaire
1 Dodzi KOKOROKO, Les élections disputées : Réussites et échecs, Pouvoir, 129, 2009, p.115.
2 Paul CHAMBERS, Guinée : le prix d'une stabilité à court terme, Politique africaine, 2004/2 N° 94, p. 140.
3 Une décennie à peine après son accession à la tête de l’État, Sékou Touré s’est transformé en dictateur. Par exemple, entre 1958 et 1971, neuf des 71 membres du Gouvernement furent exécutés, huit moururent en prison, 18 furent condamnés aux travaux forcés à perpétuité, 20 remis en liberté provisoire, cinq se réfugièrent à l’étranger.
Premières élections ouvertes en Guinée : ouvrent-elles la voie à la stabilité ?
2
de Lansana Konté4, ont caractérisé le visage politique de la guinée pendant plus d’un demi-
siècle. Au plan social, malgré la réalité d’un sentiment national qui n’exclue, contrairement à
ce qui prévaut au Liberia et en Côte d’Ivoire, aucun des grands groupes ethniques de la
nation, le malaise généralisé, la lassitude à l’égard de l’État et la stigmatisation
communautaire5 dans laquelle se sont distingués les régimes successifs, constituaient de
réels facteurs nourriciers de l’instabilité6.
Mais cela n’est-il pas qu’un mauvais souvenir, sensé faire place à une nouvelle donne faite
de promesse et d’espoir pour une Guinée dénuée de toute graine déstabilisante ? Au jour
d’aujourd’hui, au lendemain de l’élection présidentielle et des législatives unanimement
considérées comme la voie souhaitée pour la consolidation de la paix sociale et l’édification
d’une ambiance politique apaisée, pouvons-nous soutenir, si ce n’est son effectivité, les
chances d’accomplissement d’un tel vœu ?
Il est important de répondre le plus précisément à cette interrogation car entre la stabilité
affichée, le plus souvent constatée en apparence, et la stabilité réellement vécue, il y a un
grand écart. La mainmise d’un régime de terreur sur l’appareil sécuritaire peut parfois
paraître refléter un état passager de sérénité sociale. Pourtant la stabilité réelle que peut
connaître une société exige, en plus de l’apaisement des rapports entre les acteurs en
présence, la durabilité d’une telle situation. Si la stabilité apparente repose sur une mise au
pas de la plupart des forces du fait de l’une, la stabilité réelle, elle, appelle à une interaction
réfléchie entre les différentes forces qui composent la société dans une ambiance
compétitive faite de poids et de contrepoids.
L’analyse du cas guinéen, orientée vers la recherche d’éléments attestateurs de l’existence
d’une stabilité réelle, nous amène à répondre négativement à la question posée plus haut.
La lutte électoraliste s’est révélée très tendue (1). Ce qui n’a pas aidé à stabiliser d’avantage
la situation socioéconomique en Guinée (2).
4 Paul CHAMBERS, op cit., P.133 et suivants.
5 Qu’il s’agisse de Lansana Conté ou de Sékou Touré, l’usage des clivages ethniques est passé en Guinée au rang de véritable mode de gouvernance. L’ethnie peul, majoritaire démographiquement et détentrice d’une bonne part du commerce intérieure en a particulièrement pâti. La liste longue des supposés complots dont l’a accusé Sékou Touré est significative. Dès 1960, le « complot de Diallo Ibrahima » qui semble-t-il jugeait Sékou Touré indigne d’être président. Le complot « des intellectuels tarés et des forces décadentes » ; celui « des syndicalistes et des éléments d’extraction féodale et anarchiste » ; celui « des petits commerçants », celui « des grands commerçants en connivence avec l’impérialisme » ; l’invasion portugaise du 22 novembre 1970 qui fut transformée en complot. Mais le plus sanglant de tous pour les Peuls, fut le « Complot peul », de 1976-77, lors duquel Boubacar Telli Diallo, ex-secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, et d'innombrables autres personnes, furent emprisonnés, exécutés ou morts en détention.
6 Pr Aboubacry Moussa LAM Le « complot peul »: Sauvons la guinée de ses vieux démons !, Université Cheikh
Anta DIOP - Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Département d’histoire, Disponible sur : http://www.leral.net/Le-complot-peul-Sauvons-la-guinee-de-ses-vieux-demons-_a86883.html (Consulté le 02 septembre 2013).
Premières élections ouvertes en Guinée : ouvrent-elles la voie à la stabilité ?
3
1- Une lutte électoraliste tendue
En tant que premières élections sans la participation d’un candidat titulaire, le marathon
électoral par lequel vient de passer la Guinée s’érige en véritable paracrise, paravent
démocratique, appelé à réorienter le destin politique guinéen dans une direction plus
éclairante. L’on attendait de ces élections présidentielle et législative un dénuement tel que
la classe politique dans son ensemble en sortît libérée parce que rassurée de l’ouverture
effective du concours électoral en Guinée. Mais l’attente est restée quelque peu vaine au
vue du résultat effectivement perçu aujourd’hui. Le rôle stabilisant attendu des élections sur
la situation politique semble être un échec. Pourtant, par le statut des candidats qui y ont pris
part et par le soutien recueilli de la part de toute la communauté internationale, le processus
électoral guinéen emportait le choix de tout parieur en faveur d’un déroulement serein et
empreint d’égalité entre les parties en course. C’est seulement à cette condition qu’une page
nouvelle faite de stabilité aurait pu être considérée comme ouverte. Pourtant, c’est à un
scénario inverse que l’on a assisté aussi bien en ce qui concerne la présidentielle de juin
2010 que les législatives récemment tenues en fin septembre 2013.
L’élection présidentielle
La présidentielle de 2010 a ouvert la voie à tous les dangers, tant elle a été pleine de
révélations et d’incohérences.
Révélation au premier tour car le vote a, en grande partie, suivi les divisions ethniques et
régionales7, et les deux candidats représentants les deux plus grands groupes ethniques
sont arrivés en tête. Cellou Dalein Diallo - venant de Moyenne-Guinée et appartenant au
plus grand groupe ethnique de Guinée, les Peulh - est arrivé en première position. Dissident
de longue date et leader de l’opposition, Alpha Condé, perçu comme un représentant du
groupe ethnique Malinké, le deuxième groupe ethnique du pays, est arrivé second. Des
failles et des irrégularités avaient aussi été décelées8, mais c’est la configuration
communautariste de l’électorat qui alerte le plus, du fait du risque d’instabilité que présente
un tel phénomène lorsqu’il est instrumentalisé. La suite a malheureusement donné raison à
une telle hypothèse. Les concurrents politiques d’entre les deux tours n’ont pas hésité à
accentuer les tendances ethnicistes déjà notées.
Incohérence, au second tour, parce que le retournement spectaculaire de la balance
électorale en faveur du candidat Alpha Condé ayant réuni au premier tour seulement 18%
contre 43% pour son adversaire Cellou Dalein Diallo, s’il n’est pas inconcevable, n’est pas
non plus incontestable. Les luttes ouvertes et cachées d’influence qui ont jalonné le
processus ayant mené au second tour ne l’ont pas été sans affecter les règles du jeu. Les
7 The Carter Center, Observer les élections présidentielles de 2010 en Guinée : Rapport final, p.11. Disponible sur : http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/guinea-2010-FinalReport-fr.pdf (Consulté le 03 septembre 2013).
8 Un rapport du Carter Center du 24 juillet 2010 a pointé du doigt de nombreuses failles procédurales et la gestion désordonnée des processus de comptage des voix et de tabulation des résultats. Ce qui avait abouti à l’annulation d’environ 900000 voix par la Cour Suprême en raison d’erreurs et d’irrégularités administratives. Ceci s’est traduit par la privation de droits civiques pour environ 21.4% des électeurs enregistrés.
Premières élections ouvertes en Guinée : ouvrent-elles la voie à la stabilité ?
4
défiances réciproques des deux camps autour du maintien ou non de l’échéance électorale
du 19 septembre 2010, la bataille pour le contrôle de chaque parti sur l’organe régulateur
qu’est la CENI9 à travers son président et la répression sanglante des protestations par les
forces de l’ordre, ont fini de transformer ce qui partait pour être une lutte franche en une
pomme de discorde10.
Moins une enquête de crédibilité, c’est la cristallisation des positions à laquelle débouche
toute procédure partisane ou apparaissant comme telle qui retient notre attention. C’est elle
qui représente une menace pour la stabilité.
Les élections législatives
Les législatives n’on été que la suite du bras de fer engagée au lendemain de la
présidentielle entre des adversaires farouches dont l’un a gagné depuis peu le pouvoir en
Guinée. Le processus a été marqué par des crises profondes dans le raccordement des
positions sur des points sensibles tels que la révision du fichier, le choix de l’opérateur de
saisie dans le fichier électoral, la sécurité dans le décompte des voies et le choix des
membres de la Commission électorale indépendante. Mais c’est le sentiment de défiance et
de mépris noté tout le long du processus entre les acteurs qui inquiète. Car, quand il s’agit
de nuisance, point n’est nécessaire qu’il s’agisse de vérité pour causer des dégâts chez
l’adversaire. Ne dit-on pas populairement qu’il est plus facile de détruire que de construire ?
L’on a pu en effet entendre des opposants se réclamant d’une lecture « réaliste » soutenir
que le vote est en Guinée largement ethno-communautaire, et donc assez stable. D’autant
plus qu’Alpha Condé aurait promu beaucoup de membres de son groupe ethnique, les
Malinké, à des postes de responsabilité dans l’administration, radicalisant ainsi encore les
tensions dans la sphère politique11. D’autres sont allés jusqu’à faire le parallèle entre Alpha
Condé et l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et conseillent de prendre l’exemple
d’Alassane Ouattara, qui est finalement allé aux élections contre Gbagbo en 2010… avec un
« plan B », une force armée à portée de main, pour pouvoir contrer une éventuelle tentative
de confisquer les résultats du scrutin12. Ils soutiennent que c’est d’autant plus important qu’ils
soutiennent que le pouvoir lui-même serait en train de se préparer à la violence, d’entretenir
des groupes de chasseurs traditionnels malinké dits « donzos » et d’acheter des armes13.
9 Après la mort de Ben Sékou Sylla le 13 septembre, une lutte politique féroce pour la direction de la CENI a
éclaté entre l’UFDG et le RPG. Au cours d’une élection tenue à la hâte en présence seulement de quelques uns de ses membres, Louceny Camara favorable au RPG est élu à la présidence de la CENI malgré la contestation membres de la CENI pour vice de vice de procédures.
10 The Carter Center, Idem, p. 12 et suivants.
11 Certains sites d’opposition suivent au moyen de tableaux Excel les nominations des responsables politiques
et administratifs et leur ethnicité. Voir par exemple « Régime Maninka d’Alpha Condé. Gouvernement de janvier 2011 », http://webguinee.net/etat/postcolonial/alpha-conde/gouvernement/ gouvernement-janv-04-2011.html.
12
International Crisis Group, Guinée : Sortir du bourbier électoral, Rapport Afrique N°199 | 18 février 2013, p. 4.
13 Idem, p. 4., pour détail, voir note n° 20.
Premières élections ouvertes en Guinée : ouvrent-elles la voie à la stabilité ?
5
Certains accusent même le pouvoir d’attentats contre certaines figures de l’opposition, voire
de projeter un « génocide à la rwandaise contre les Peuls »14.
Du côté du pouvoir, des voix considèrent que l’opposition n’est qu’une fragile coalition
d’anciens Premiers ministres compromis par leur association avec les anciens régimes et
d’une minorité de commerçants affairistes et profiteurs, ce que le titulaire du ministère de
l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) Alhassane Condé et d’autres
appellent « l’axe Bambeto-Cosa »15, terme désignant une zone de Conakry et faisant allusion
aux commerçants peul de la capitale et, plus largement, aux Peul. Les partisans du président
estiment que ces individus bénéficient de ressources importantes, et donc d’un avantage
injuste, à cause de leur collaboration avec les régimes passés, et qu’ils doivent être défaits
et privés de leurs privilèges pour faire enfin « décoller » le pays. Ce sont là des positions
idéologiques et propagandistes de nature à alimenter les oppositions, à les crisper ét
entraîner un repli sur soit, prélude à l’implosion.
Pourtant, des législatives apaisées étaient indispensables pour doter le pays d’un parlement
représentatif de sa diversité, donner sa place à l’opposition et équilibrer le dispositif
institutionnel. Elles étaient cruciales pour que l’espoir suscité, par le remplacement de
dirigeants militaires illégitimes par un président civil élu, ne se transforme pas en désillusion.
De façon générale, le jeu politique attendait beaucoup de ces deux échéances électorales
sensées servir de rampe de lancement pour un autre chantier hautement plus déterminant
pour l’avenir des Guinéens : le secteur socio-économique. Mais hélas ! Car la seule chose à
laquelle a débouché la lutte récente pour le pouvoir est la mise à nue d’une absence de
consensus sur les règles du jeu politique. En conséquence, le jeu électoral, malgré l’espoir
suscité, n’a pas posé les bases d’une confiance favorable au déclenchement d’un processus
de régulation de la crise socio économique.
2) L’accentuation de la crise socioéconomique
La stabilité d’une société repose pour l’essentiel sur la réalité d’une sécurité économique
ainsi que l’existence partagée d’une justice sociale. En Guinée, le bilan de ses deux
exigences à la veille de l’élection présidentielle de 2010 était si lourd de déficit que le seul
espoir pour une mise sur rail de l’appareil économico social résidait dans la ferveur
participative et la visibilité espérées en tant que promesses d’une élection saine. En lieu et
place de la tenue d’une telle promesse, le processus électoral écoulé a accouché d’une
culture de la division et de la haine communautaire, entretenant ainsi les tensions sociales et
la régulation économique passionnée.
14 Voir par exemple le courrier adressé au président angolais José Eduardo dos Santos par l’association peul
basée aux Etats-Unis Pottal-Fii-Bhantal Fouta-Djallon, dénonçant la formation de « milices ethniques » pro-Condé en Angola, ou bien encore le communiqué du vice-président en exil de l’UFDG, Oury Bah, qui dénonce un attentat à la grenade contre El Hadj Modi Sidy Diallo, notable de l’UFDG, et évoque « les miliciens armés du pouvoir, les donzos, les recrutements à caractère ethnique dans les forces de défense et de sécurité ». « Formation des milices ethniques en Angola », Guinee58 (guinee58.com), 30 mars 2012 ; « Attentat manqué contre Elhadj Modi Sidy, membre du conseil politique de l’UFDG », Lejourguinee (lejourguinee.com), 3 novembre 2012. « Le génocide à la rwandaise est en marche en Guinée », guineepresse.info, 13 janvier 2012.
15 « Exclusif : le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation Alhassane Condé répond à
l’opposition », Guinéenews© (guineenews.org).
Premières élections ouvertes en Guinée : ouvrent-elles la voie à la stabilité ?
6
Les tensions sociales entretenues
Si l’usage du discours ethnique pour regrouper une communauté autour de soi est décrié
bien que répandu, c’est moins contre son effet polarisant du débat autour des personnes,
que contre le risque de crispation des sentiments et d’embrasement des passions.
Le contexte électoral de 2010 a déstabilisé l’équilibre ethnique qui régnait jusque là dans le
pays. Les candidats à l’élection présidentielle, Cellou Dalein Diallo de l’ethnie peule et Alpha
Condé de l’ethnie malinké, ont mis en avant l’ethnicité comme étant une idée politique forte.
Cet échec du processus électoral guinéen à mettre d’accord les acteurs autour des règles du
jeu a aussi eu pour effet d’éveiller les sensibilités ethniques redoutées, quoique à
soubassement purement opportuniste et politique. Les adversaires ne laissent aucune
occasion pour jeter l’opprobre sur une communauté, parfois sans aucune justification
valable. Ainsi, au lendemain de l’attaque du 19 juillet analysée comme une tentative de coup
d’État contre le président nouvellement élu, la réaction du camp présidentiel n’a pas laissé
de doute quand au ciblage d’un groupe ethnique comme auteur des faits16. En effet,
immédiatement après l’événement, le président Condé a fait allusion à sa dimension «
communautaire » (17).
Par ailleurs, entre les deux tours de la présidentielle, une rumeur a circulé sur
l’empoisonnement de partisans d’Alpha Condé. Lors d’un meeting le 22 octobre 2010 à
Conakry, une centaine de sympathisants venus assister à un meeting ont été hospitalisés
après avoir consommé de l’eau. Il n’y a finalement pas eu de mort. Des vendeurs de rue,
forcément identifiés comme Peul, ont été accusés. Certains partisans de Condé ont dénoncé
des « crimes contre l’humanité » et une tentative d’« élimination massive »18. Dans plusieurs
localités de Haute Guinée, à Siguiri et Kankan, et aussi à Kissidougou et N’Zérékoré, des
Peul ont été pris à partie, et plusieurs ont été tués19.
Le nouveau gouvernement dirigé par Alpha Condé n’a pas cherché par la suite à apaiser les
tensions interethniques, bien au contraire. Il suffit de constater la purge importante dans
l’administration au profit des Malinkés20, les mesures restrictives prises à l’encontre des
opérateurs économiques, peuls pour la plupart, ainsi que les interventions musclées
16
L’hypothèse, évoquée par certains, d’un faux complot organisé par le pouvoir sur le modèle de ceux employés par Sékou Touré pour se débarrasser de ses ennemis, semble peu vraisemblable et témoigne avant tout du degré de suspicion qui marque la vie politique guinéenne.
17
Il a déclaré à Radio France internationale : « les gens arrêtés appartiennent à une certaine communauté », sans plus de précision. Voir « Alpha Condé sur RFI: ‘Ce n’était pas un coup d’Etat mais une tentative d’assassinat’ », rfi.fr, 19 juillet 2011.
18
« Crimes contre l’humanité à Conakry. Des centaines de militants de l’Alliance arc-en-ciel empoisonnés », echosdeguinee.com, 23 octobre 2010. Cet article d’une violence incroyable, signé d’un « Rédempteur » anonyme et repris par toute une série de sites guinéens, était encore sur le site officiel du RPG d’Alpha Condé (http://rpg-guinee.com/) en juillet 2011.
19
« Rapport d’enquête sur les violences et violations des droits humains durant le processus électoral guinéen de 2010 », Open Society Initiative for West Africa, juillet 2011.
20
IRIN, « Guinée : les divisions ethniques menacent le bon déroulement des élections », 11 .12.2011 .
Premières élections ouvertes en Guinée : ouvrent-elles la voie à la stabilité ?
7
effectuées par les forces de l’ordre dans les quartiers « chauds » à majorité peule, lors de
grandes manifestations de l’opposition. Ces différents éléments, combinés à la défaite de
Cellou Dalein Diallo aux élections, ont créé chez les Peuls un sentiment d’exclusion
ethnique, voire de persécution21.
Un autre facteur aggravant du risque de violence est le manque de contrôle du pouvoir sur
les forces de sécurité. Bien que la réforme de ce secteur ait été enclenché avec des
mesures au moins symboliques, la persistance d’un sentiment d’impunité au sein des forces
de l’ordre et la gestion et le traitement ethniciste encore de mise maintient une atmosphère
lourde de tension. Il n’y a en effet ni contrôle ni transparence dans la gestion des ressources
et des dépenses militaires22. Si cette situation a permis à certains de s’enrichir par l’exercice
d’activités criminelles et illégales, elle est source de ressentiments internes, beaucoup de
militaires endurant des conditions de vie et de travail particulièrement difficiles. Le sentiment
d’injustice qui prévaut au sein des Forces Armées Guinéennes légitime pour certains
l’indiscipline, le manque de respect pour le grade et l’insubordination dont elles font
notoirement preuve et qui ont amené à plusieurs mutineries23. S’ajoute à cela une corruption
généralisée et le maintien de pratiques telles que le rançonnement des civils.
Voila autant d’éléments nourriciers de méfiance, d’esprit de revanche et d’hostilité, tous
vecteurs d’instabilité.
Une régulation économique passionnée
Secteur pourtant hautement sensible et nécessitant, plus que n’importe quel autre secteur de
l’État, les vertus d’une vision éclairée que peut offrir une vie politique stable, l’économie
guinéenne pâtit de flou et des descensions qui ont entouré la bataille pour le fauteuil
présidentiel et les sièges du parlement.
Le pouvoir issu des élections du 07 novembre 2010 a trouvé une économie à la traîne. Il a donc entrepris des réformes avant la mise en place de l’Assemblée législative, lieu adéquat de décision de politique économique. Mais ce n’est pas la question de pertinence ou non d’une telle option qui est nocive à la paix sociale et à la sécurité. C’est plutôt la nature des choix faits à cette occasion et la lecture qui en est faite par les acteurs de la société qui peuvent selon l’usage fait freiner la dissipation des tensions.
Parmi les choix controversés, le contrat signé avec la compagnie australo-britannique Rio
Tinto et son partenaire chinois Chinalco pour l’exploitation du fer des blocs 3 et 4 du mont
Simandou. Contrairement aux engagements pris par le nouveau régime, cette signature a eu
lieu avant la mise en place du nouveau code minier. Selon certains observateurs, l’accord
offre des conditions fiscales très favorables à Rio Tinto24. Même si les défenseurs de l’Etat
21
Coopération Belgique - France – Suisse Mission conjointe du CGRA, de l’OFPRA et de l’ODM, Rapport de mission, mars 2012, p. 5
22
International Crisis Group, « Guinée : remettre la transition sur les rails », Rapport Afrique n°17 8, 23.09.2011.
23
« Guinea: Witnesses Describe Security Force Excesses », Human Rights Watch, 29 novembre 2010; « Climat tendu en Guinée où l’état d’urgence a été décrété », rfi.fr, 18 novembre 2010.
24
Voir par exemple « Analyse du coût économique probable de l’accord minier entre la Guinée et Rio Tinto », guineenews.org, 26 avril 2011.
Premières élections ouvertes en Guinée : ouvrent-elles la voie à la stabilité ?
8
assurent que les conditions fiscales appliquées sont celles d’usage25, la rumeur selon
laquelle l’État aurait touché 700 millions de dollars dans la transaction26 a suffit à instaurer
un climat de méfiance entre les forces de l’opposition et le pouvoir.
Une autre orientation économique, politisée et hautement porteuse de tension sociale, est le
choix opéré par l’État dans la recherche d’une réponse à la hausse du coût de la vie des
populations. Les autorités nouvellement arrivées au pouvoir ont d’abord recouru à une
distribution de riz subventionné. Mais la politisation du système dans les quartiers27 a vite été
dénoncée. Le pouvoir décide alors d’impliquer de « de vrais hommes d’affaires »28,
encourageant en l’occurrence un pool d’entrepreneurs libanais à entrer dans le marché : en
juin et juillet 2011, des dizaines de milliers de tonnes de riz ont été livrées, mises en
circulation à un prix légèrement supérieur aux ventes précédentes, soit 187 000 francs
guinéens le sac29. Malheureusement, là aussi, le départ entre une motivation de pure
économie et un coup politique est très mince. Alpha Condé ayant à de nombreuses reprises
dénoncé le poids d’une poignée de grands importateurs peul dans le marché du riz, les
qualifiant de « mafia » qui « spécule »30, les chances que la communauté ainsi concernée
lise dans ce choix de politique économique un affront est bien réelle. Pire, cela pourrait
accentuer la méfiance nourrie dans les milieux d’affaires à l’égard de ce groupe ethnique par
le fait des régimes précédents. On se rappelle de Sékou Touré et de son successeur
Lansana Conté dénonçant les commerçants parasitaires qui affament le peuple et qui
complotent pour faire monter les prix pour s’enrichir et qui « sabotent » les politiques de ce
même peuple en créant des stocks de riz et des produits comme l’essence ou en les
réexportant en fraude. Ce n’est pas un hasard si les grands commerçants, principales cibles
de ces attaques, ont généralement soutenu la campagne de son adversaire, Cellou Dalein
Diallo.
Tout ceci ne concoure pas à la création des conditions pour un climat apaisé.
25
« Droit de réponse du gouvernement sur l’accord avec Rio Tinto sur le projet Simandou », guineenews.org, 3 mai 2011.
26
Selon une source au moins, l’Etat n’aurait touché en réalité qu’une petite partie de l’argent (15 pour cent), le reste devant venir au fur et à mesure de la rentabilisation du projet. Cf. International Crisis Group, op cit., p. 17, note n°127.
27
International Crisis Group, op cit., p. 18-19, note n°135 28
« Vente et distribution de ‘riz du changement’. Quand Alpha Condé prêche dans le désert ! », guineenews.org, 13 avril 2011.
29
« Sécurité alimentaire : Alpha Condé recourt aux hommes d’affaires libanais pour faire baisser le prix du riz », guineenews.org, 14 juin 2011.
30
« Alpha Condé : ‘En Guinée, tout est à faire’ », lefigaro.fr, 16 novembre 2010.
Premières élections ouvertes en Guinée : ouvrent-elles la voie à la stabilité ?
9
Résumé
Une analyse du comportement des divers acteurs de la récente transition guinéenne laisse
apparaître une dénaturation de l’idéal électoral, aussi bien dans les attitudes que dans les
réactions servies. Des incohérences, à défaut de les qualifier d’irrégularités, ont été notées.
Elles ont favorisé entre les parties de vives confrontations ouvertes ou fermées, chacune des
parties n’hésitant pas à appuyer sur le bouton du repli identitaire pour servir sa cause. Ce qui
a sensiblement relevé le niveau de la tension sociale, de l’insécurité, de la précarité socio
économique ; tous des ingrédients pour repousser la stabilité politique et socioéconomique
tant espérée.
Références bibliographiques
-« Analyse du coût économique probable de l’accord minier entre la Guinée et Rio Tinto »,
(guineenews.org), 26 avril 2011
-« Alpha Condé : ‘En Guinée, tout est à faire’ », lefigaro.fr, 16 novembre 2010
-« Alpha Condé sur RFI: ‘Ce n’était pas un coup d’Etat mais une tentative d’assassinat’ »,
rfi.fr, 19 juillet 2011
-« Attentat manqué contre Elhadj Modi Sidy, membre du conseil politique de l’UFDG »,
Lejourguinee (lejourguinee.com)
-Coopération Belgique - France – Suisse Mission conjointe du CGRA, de l’OFPRA et de
l’ODM, Rapport de mission, mars 2012
-Dodzi KOKOROKO, Les élections disputées : Réussites et échecs, Pouvoir, 129, 2009
-Paul CHAMBERS, Guinée : le prix d'une stabilité à court terme, Politique africaine, 2004/2
N° 94
-« Droit de réponse du gouvernement sur l’accord avec Rio Tinto sur le projet Simandou »,
guineenews.org, 3 mai 2011
-« Guinea : Witnesses Describe Security Force Excesses », Human Rights Watch, 29
novembre 2010; « Climat tendu en Guinée où l’état d’urgence a été décrété », rfi.fr, 18
novembre 2010
-IRIN, « Guinée : les divisions ethniques menacent le bon déroulement des élections », 11 .12.2011 .
-International Crisis Group, « Guinée : remettre la transition sur les rails », Rapport Afrique
n°17 8
-International Crisis Group, Guinée : Sortir du bourbier électoral, Rapport Afrique N°199 | 18
février 2013
Premières élections ouvertes en Guinée : ouvrent-elles la voie à la stabilité ?
10
-Pr Aboubacry Moussa LAM Le « complot peul »: Sauvons la guinée de ses vieux démons !,
Université Cheikh Anta DIOP - Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Département
d’histoire, Disponible (leral.net)
-Rapport d’enquête sur les violences et violations des droits humains durant le processus
électoral guinéen de 2010, Open Society Initiative for West Africa, juillet 2011
-« Régime Maninka d’Alpha Condé. Gouvernement de janvier 2011 », (webguinee.net)
-« Exclusif : le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation Alhassane
Condé répond à l’opposition », Guinéenews. (guineenews.org)
- « Sécurité alimentaire : Alpha Condé recourt aux hommes d’affaires libanais pour faire
baisser le prix du riz », guineenews.org, 14 juin 2011
-The Carter Center, Observer les élections présidentielles de 2010 en Guinée : Rapport final,
p.11. (cartercenter.org)
-« Vente et distribution de ‘riz du changement’. Quand Alpha Condé prêche dans le désert !
», guineenews.org, 13 avril 2011.