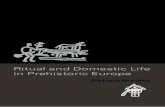Prehistoric Water Management in Mexico
Transcript of Prehistoric Water Management in Mexico
Les anciens Mexicains,experts en irrigation
Près de 500 ans avant notre ère, les habitants du Mexique protohistoriqueconstruisaient et géraient déjà d’immenses réseaux d’irrigation,les plus vastes du continent américain à cette époque.
James NEELY,archéologue, est professeur éméritede l’Université du Texas.
Christopher CARAN,géologue, préside lesLaboratoires d’analysedu Quaternaire, à Austin,aux États-Unis.
dossier_72_Neely_GJ2305.xp 15/06/11 17:45 Page 30
,CONQUÊTE
C inq mois pluvieux, sept mois arides. Depuisque des paysans cultivent les terres au Suddu Mexique, ils sont confrontés à cette dure
réalité climatique. De mai à septembre, les pluiesassociées à la mousson font pousser les plantes,ce qui a très tôt fait des hautes vallées du Sud leberceau de l’agriculture américaine. En revanche,pendant la saison sèche, rien ne pousse. Dommage,car avec de l’eau, deux, voire trois, récoltes de maïsseraient possibles chaque année. En fait, ces récoltesmultiples, les anciens cultivateurs du Sud mexi-cain les obtenaient ! Il y a plus de 25 siècles, ilsont mis au point des systèmes d’irrigation couvrantdes centaines de kilomètres carrés, en détournantavec ingéniosité sources et ruisseaux. Contraignantparfois le précieux liquide à traverser la ligne departage des eaux (la frontière entre les bassins-versants, de chaque côté de laquelle les cours d’eaus’écoulent dans des directions différentes), ils l’ache-minaient autour de canyons et le long de pentesescarpées. Par 1 000 astuces, ils récupéraient leseaux de pluie et s’évertuaient à exploiter toute l’eaude leur environnement.
Beaucoup de ces grandes structures de collectedes eaux et d’irrigation ont survécu en parfait étatpendant 1500 à 3000 ans. Le barrage de Purrón,par exemple, fut construit à partir de 750 avantnotre ère (voir la figure page 35), probablementpar des représentants de la culture Popoloca (dontles descendants peuplent toujours la région). Sesdimensions ont atteint 400 mètres de longueur,100 mètres de largeur et presque 25 mètres dehauteur. Armés de paniers, ses bâtisseurs ontdéplacé quelque 2,64 millions de mètres cubes deterre, faisant vraisemblablement de cet ouvrage laplus grande structure de rétention d’eau del’Amérique d’avant le XVIIIe siècle. Cette échellemonumentale n’a été obtenue que progressive-ment : plusieurs petits barrages, datés d’environ1100 avant notre ère et découverts récemment,ont été construits dans le même canyon.
Quand les «serpentsde pierre» transportaient l’eauNon loin de là, les ingénieurs protohistoriques ontédifié des milliers de kilomètres de canaux et d’aque-ducs. Ces immenses réseaux sont d’autant plus éton-nants qu’ils ont été construits sans outils de métal,sans roues et sans animaux de trait. Même les plusanciennes structures attestent d’un bon niveau tech-nique des bâtisseurs et de leur capacité à entretenirdes réseaux aussi étendus. Nous illustrerons icil’ingéniosité des anciens hydrauliciens méso-américains en considérant plus particulièrement lescanaux de la vallée de Tehuacán ainsi que le réseaud’irrigation en terrasses de la vallée d’Oaxaca, sansdoute érigés respectivement par les Popolocas etles Zapotèques (de –500 à 1000).
31
200 HECTARES DE TERRASSES CULTIVABLESont été créés dans la vallée mexicained’Oaxaca il y a environ 2 500 ans, afin d’exploiter les sources d’eau effervescente du site de Hierve el Agua.
L’ESSENTIEL� Pour combler le manque de pluiependant la saison sèche,les cultivateurs du Suddu Mexique ont très tôtconstruit de nombreuxaménagements hydrauliques : barrages,réseaux d’irrigation, puits...
�Le plus ancien ouvrageest ainsi un puits datéd’environ 10000 ans.
�Les aménagements ontensuite progressivementpris de l’ampleur, pouratteindre des dimensionsmonumentales. Certainsont été utilisés pendantdeux à trois millénaires.
Rob
Woo
d, W
ood
Rons
avill
e, In
c.
dossier_72_Neely_GJ2305.xp 15/06/11 17:45 Page 31
32 INCAS, MAYAS, AZTÈQUES… © POUR LA SCIENCE
Les recherches modernes sur ces deux secteursont débuté dans les années 1960, avec les pros-pections de deux archéologues : Richard MacNeishdans la vallée de Tehuacán, et Kent Flannery pourcelle d’Oaxaca. L’un d’entre nous (J. Neely) a parti-cipé aux deux projets. L’hydraulique n’était pas aucentre de ces études, malgré son évidente impor-tance dans les deux régions. Les premières décou-vertes n’eurent donc aucune suite, jusqu’à ce quenous décidions, à la fin des années 1980, de nousassocier pour analyser les ouvrages hydrauliques desvallées de Tehuacán et d’Oaxaca.
Le réseau de la vallée de Tehuacán se révéla êtrele plus important système hydraulique protohisto-rique de l’Amérique précolombienne. Plus de1200kilomètres de canaux, répartis en cinq réseauxqui se recoupent par endroits, ont été construits afind’irriguer plus de 330 kilomètres carrés de terrescultivées, soit une superficie égale à 3,5 fois cellede la ville de Paris.
Comment s’y prenaient les anciens hydrauli-ciens ? Comme des maraîchers ! Pour créer leurspremiers réseaux, il y a 2 500 ans, ils creusaientdes sillons dans le sol, qu’ils flanquaient de petitesdigues. Chaque canal acheminait l’eau depuis unesource jusqu’à des champs situés en contrebas. Ilserpentait souvent, de façon à ce que la pentesoit douce et ne dépasse pas deux degrés. L’essentielde l’eau convoyée provenait de grosses sources,dont les eaux, riches en minéraux, contenaienténormément de calcite, un calcaire (CaCO3) dontsont faites les stalagmites notamment. Froides etsous pression à leur sortie, les eaux se retrouvaientsous le soleil et s’évaporaient en partie. Lors dece phénomène, la calcite et les minéraux qu’ellescontenaient précipitaient. En se cristallisant surles parois des canaux, les minéraux les imper-méabilisaient, mais menaçaient aussi de les combler.La contribution de chaque litre d’eau était certesréduite, mais un gros canal débitant plus d’undemi-million de litres par jour, le problèmedevenait vite important. En se durcissant, lescouches successives formaient un revêtementrocheux nommé travertin, ou tuf calcaire. Il s’agitd’une roche sédimentaire caractérisée par de petites
cavités inégalement réparties, qui se forme enmilieu calcaire près des sources. Dans les grandscanaux, cette roche s’accumulait au rythme moyend’un centimètre par an, soit un mètre par siècle.
Résultat ? Nombre de canaux finirent par secombler, sans toutefois que s’interrompe l’écou-lement. En effet, chaque canal grossissait en quelquesorte de lui-même, car les dépôts s’accumulantau fond le faisaient régulièrement déborder, et sesdigues se recouvraient ainsi de travertin. Par ceprocessus, le fond et les bords du canal s’élevaientpetit à petit en même temps (voir l’encadré pageci-contre). Peut-être aidé par des travaux réguliersd’entretien, le canal pouvait conserver sa formeen U tout en s’élevant progressivement. De cettefaçon, un petit canal creusé dans le sol devenaitpeu à peu un ouvrage imposant, constitué d’unruisseau coulant au sommet d’une base triangu-laire. Certains canaux ont ainsi été surélevés à 5mètres de hauteur sur une base large de30.
En langue aztèque, ces sinueux canaux fossi-lisés ont reçu le nom de tecoatl, c’est-à-dire «serpentde pierre ». Longs de plusieurs kilomètres, cestecoatls barrent la vallée de Tehuacán depuis laProtohistoire, et y influent sur le cheminementdes routes et l’emplacement des villages.
Les confidences du travertinLà où creuser un canal était impossible, les ancienshydrauliciens ont construit des aqueducs en terreet en pierres compactées. De conception simplequand on les compare aux aqueducs romains, ilsétaient néanmoins efficaces. Le canyon du rio Xiquilafournit un exemple intéressant. Situés à des niveauxdifférents au-dessus du cours d’eau, deux aqueducsd’environ un mètre de largeur le traversent en conser-vant une pente pratiquement constante malgré lesaccidents du terrain. Ils seraient le fruit d’une colla-boration entre les Popolocas et les ancêtres desMixtèques (900-1521). Des tessons de poteriesretrouvés sur place permettent de dater la construc-tion de l’aqueduc inférieur aux alentours de l’an400.Cet ouvrage d’un kilomètre de longueur passeentre 4 et 12 mètres au-dessus du rio, ce qui le rendaitvulnérable aux crues et glissements de terrain dus àla rivière. Il a été abandonné sans doute vers 700,lorsque fut construit un second aqueduc de sixkilomètres de longueur, qui surplombait la rivièrede 20 à 22 mètres. Ce second ouvrage est resté enservice jusqu’en 1540 au moins. Comme le premieraqueduc, il transportait de l’eau de rivière peu chargéeen minéraux, et n’est donc pas recouvert de travertin.
Pour l’archéologue, les canaux en travertin ontl’avantage de garder une trace indélébile de leurutilisation et de leur environnement. Les stratesminérales successives ont piégé d’abondants restesd’algues aquatiques, de diatomées (des micro-algues qui s’entourent d’une coque siliceuse), de
DES SYSTÈMES D’IRRIGATIONexistent dans le Sud duMexique depuis laPréhistoire. Le plus anciensystème connu est un puitsdécouvert à San MarcosNecoxtla et vieux de10 000 ans. Les habitants dela région ont continué àconstruire de vastesréseaux d’eau jusqu’à lacolonisation.
Vallée d’Oaxaca
Teotihuacán
San Marcos Necoxtla
Hierve el Agua
Barrage de Purrón
Vallée de Tehuacán
Canyon de Xiquila
Golfe du Mexique
Mexico•
• •
•
•
Mel
issa
Tho
mas
FondamentalArchéologieJames NEELY et Christopher CARAN
dossier_72_Neely_GJ2305.xp 15/06/11 17:45 Page 32
CONQUÊTE
33DOSSIER N°72 / JUILLET-SEPTEMBRE 2011 / © POUR LA SCIENCE
La formation d’un tecoatl
L e « serpent de pierre », ou tecoatl, visible sur ce cliché est l’un des mil-liers qui sillonnent la vallée de Tehuacán. Chaque tecoatl était au
départ un simple canal creusé dans le sol pour convoyer une eau de sourcetrès minéralisée. À mesure que cette eau s’écoulait, les minéraux qu’ellecontenait précipitaient. Ils ont formé à la longue une concrétion épaissequi, d’année en année, a fini par surélever le canal au-dessus du sol, sanspour autant empêcher son fonctionnement. C’est ainsi que certainstecoatls atteignent 5 mètres de hauteur, 30 mètres de largeur à la base etserpentent dans la vallée parfois sur plus de 15 kilomètres.
Canal creusédans le sol
Eau d’irrigationDigue en terre
Accumulationrapide de travertin
Digue enfouie sous les« débordements » de travertin
Le canal est devenu un tecoatl,un serpent
de pierre.
Au début, le canaln’est fait que de terre.
En dix ans,le canal accumuleune épaisseur d’environdix centimètres de travertin.
Au stade suivant, l’eau déborde, et les bords du canalsont rehaussés.
Saignée d’entretienrecouverte de travertin récent
Eau d’irrigation s’écoulantau-dessus du niveau du sol
Canal d’origine creusé dans la terre
COUPE TRANSVERSALE D’UN TECOATL
30 mètres
5 mètres
Clic
hé: J
ames
Nee
ly; d
essi
ns: M
atte
w F
rey,
Woo
d Ro
nsav
ille
Harli
n, In
c.
dossier_72_Neely_GJ2305.xp 15/06/11 17:45 Page 33
mousses et de plantes de marais qui ont pousséle long des canaux. Ces organismes étant sensiblesà leur environnement, nous pouvons reconstituerla composition chimique de l’eau, sa vitesse d’écou-lement et sa limpidité. Le travertin a aussi conservéle pollen de plantes cultivées dans les champsvoisins, et il nous a ainsi appris que les canaux irri-guaient du maïs, des piments et des tomates.L’amarante, plante que nous faisons pousser pourses fleurs pourpres, était cultivée pour ses grainesou poussait à l’état sauvage au bord des champs.Les typhas, ces roseaux remarquables par leursfleurs en cylindre, prospéraient le long des canaux.Sans doute n’étaient-ils pas cultivés, mais les paysansles cueillaient probablement pour en tirer de lanourriture, des fibres et des tiges.
Les canaux créaient un habitat humide dans unmilieu semi-aride. Aussi sommes-nous sûrs queles plantes aquatiques qui constituent l’essentiel desrestes organiques contenus dans le travertinfurent contemporaines de l’utilisation du canal.Nous avons pu dater ces restes organiques aucarbone14 et montrer ainsi que certains des canauxdatent de –800, et que plusieurs ont été entre-tenus ou modifiés jusqu’au début du XVIe siècle.
Autre secteur doté d’un très ancien système d’ir-rigation, la vallée d’Oaxaca, un des berceaux de ladomestication du maïs, se trouve à quelque 170kilomètres au Sud-Est de la vallée de Tehuacán.Cette vallée abrite un lieu nommé Hierve el Agua(« l’eau bout» en espagnol) où, grâce à une formeoriginale d’irrigation, des paysans ont pratiqué laculture de –500 jusqu’en 1350, c’est-à-dire pendant18 siècles (voir la figure page 36). Originaire deplusieurs grandes sources, l’eau jaillit très chargéeen dioxyde de carbone. Telle l’eau d’une bouteillede Perrier que l’on vient de déboucher, elle semblebouillir. Dans les profondeurs du sol, cette eau estsous pression, et dissout une bien plus grande quan-tité de gaz par unité de volume qu’elle ne peut lefaire à la pression atmosphérique.
À Hierve el Agua, de l’eau profonde remonterapidement à la surface par des failles, et relâche degrandes quantités de gaz au moment où elle émerge.Comme l’eau et le dioxyde de carbone réagissentpour donner de l’acide carbonique (H2CO3),cette eau est capable de dissoudre le substrat calcaire.Ainsi, l’eau de Hierve el Agua contient beaucoupde calcite, comme celle de la vallée de Tehuacán,mais aussi de fortes concentrations de calcium et
de bicarbonate (HCO3–, c’est-à-dire de l’acide carbo-
nique dissous). Cela constitue une signature de l’ori-gine des eaux circulant dans les canaux, signatureque le travertin a conservée.
Ce lieu où de l’eau froide «bout » a dû étonnerles premiers habitants de la région, qui découvri-rent aussi la possibilité d’irriguer avec cette eaudurant la saison sèche. Comme les pentes raidessituées sous la source étaient rocheuses, ils y ontédifié près de deux kilomètres carrés de terrasses,maintenues par des murs de soutènement en pierre,en charriant quelque trois millions de mètres cubesde terre ! Pour former ces surfaces cultivables, ilssemblent avoir choisi la terre avec soin, allant peut-être jusqu’à la tamiser pour obtenir une textureporeuse et régulière, et ainsi améliorer le drainage.Chaque mur de soutènement était surmonté d’uncanal aujourd’hui reconnaissable à sa « coque »en travertin. En tout, un réseau totalisant 6,5 kilo-mètres de canaux fut ainsi édifié et maintenu enétat (voir la figure page30).
La pente de ces canaux de terrasse était assezfaible pour faciliter leur alimentation à partir descanaux plus larges acheminant directement l’eaudes sources. À l’extrémité aval de chacun de cescanaux de terrasse, un bras ramenait l’eau nonutilisée vers l’un des canaux d’alimentation ou bienplusieurs petits canaux partaient en direction deterrasses situées plus bas. Tout au long des canaux,des bassins circulaires peu profonds nommés pocitos(petits puits), espacés de quelques mètres, permet-taient aux paysans de prélever, à l’aide de petitsrécipients, de l’eau d’arrosage. En espagnol duMexique, ce type d’arrosage manuel est nomméle riego a brazo, et se pratique encore dans la région.
Une irrigation manuelleLa conception générale des terrasses et des canauxest particulièrement astucieuse: l’espacement régu-lier des murs et la faible largeur des terrasses mini-misent la quantité de terre nécessaire à leur édifi-cation ; par ailleurs, pocitos et canaux muraux sonttoujours à portée de main, car, même sur les pentesles plus raides, quand les murs de soutènementatteignent 2,4 mètres de hauteur, la largeur desterrasses reste relativement constante. La plupartfont 2,4 à 3 mètres de largeur, soit environ deuxbrassées des habitants de l’époque. Placés à la basede chaque mur de soutènement, des drains récu-pèrent l’eau d’infiltration – précaution impor-tante, car si l’eau d’arrosage avait pu rester dansla terre des terrasses, ses minéraux s’y seraient accu-mulés au point de rendre le sol étanche et tropdur pour être retourné à la main, voire pour queles racines poussent.
La quantité d’eau en circulation était contrôléeen permanence au sein du réseau, de sorte qu’ilétait possible de ne faire circuler l’eau sur les canaux
34 INCAS, MAYAS, AZTÈQUES… © POUR LA SCIENCE
Nous avons trouvé ce qui pourrait être le plus ancien puits des Amériques,creusé il y a près de 10000 ans.
dossier_72_Neely_GJ2305.xp 15/06/11 17:45 Page 34
CONQUÊTE
muraux que quand et où elle était nécessaire. C’estpourquoi aucun canal mural ne s’est transforméen tecoatl : trop peu d’eau y passait pour que lescouches minérales s’accumulent au point de lesurélever. Seule une fine couche de travertin recouvreles canaux muraux, ce qui a préservé maints détailsde la construction. On note ainsi l’absence devannes ou d’ouvertures à travers lesquelles l’eauaurait pu être déviée en quantité vers les terrasses.En d’autres termes, les paysans n’utilisaient pas l’ir-rigation par submersion, qui aurait saturé de miné-raux la précieuse terre de culture en quelques annéesseulement. Au prix d’un rude travail d’arrosage àla main, ils ont ainsi évité la dégradation trop rapidede leur système et, en économisant l’eau, augmentéla surface irrigable.
Le tout premier puits d’AmériqueCette patiente activité n’était pratiquée que pendantla saison sèche. Pendant la mousson d’été, les pluieshydrataient les cultures tout en lavant les sols dela charge minérale laissée pendant la saison sèchepar les eaux d’arrosage. Ce processus était renforcépar la décomposition des matières organiques utili-sées comme engrais, tels les déchets domestiques.Nous avons aussi observé que le sol des terrassesrenferme des fragments de poterie dont l’ancien-neté augmente avec la profondeur, ce qui attesteque les paysans incorporaient leurs déchets à chaquerecharge de la terre constituant les terrasses.Nous avons ainsi appris quelles étaient les pote-ries domestiques les plus susceptibles d’être casséeset réutilisées comme remblai. De fait, nous avonsnoté que les céramiques utilisées dans un petit lieude culte voisin étaient beaucoup plus fines.
Tous ces ouvrages hydrauliques de grandeampleur sont l’aboutissement d’une longue périodede développement, comme en témoignent plusieurs
aménagements plus simples et plus anciens décou-verts récemment. Outre les petits barrages pion-niers situés près du barrage de Purrón, nous avonstrouvé en 1993 ce qui pourrait être le plus ancienpuits des Amériques. Creusé il y a près de 10000ans,il était profond de cinq mètres, tandis que le diamètrede son ouverture au niveau du sol était de dix mètres.En usage pendant environ 2000 ans, ce puits antiquese trouve aujourd’hui dans le village de San MarcosNecoxtla, dans la vallée de Tehuacán. L’ouvrageest probablement antérieur aux débuts de l’agricul-ture américaine, mais son existence atteste que lagestion de l’eau, ne serait-ce que sur un modeembryonnaire, a commencé tôt.
À l’instar des prédecesseurs du barrage dePurrón, d’autres ouvrages hydrauliques rudimen-taires ont probablement été construits entre leforage de ce puits et les grands aménagementscommencés il y a près de 3 000 ans. Les toutespremières cultures ont peut-être été arrosées abrazo, voire à l’aide de petits canaux qui n’ont pasrésisté au temps ou qui restent à découvrir.Ainsi l’irrigation, que l’on a longtemps cru posté-rieure d’au moins 2 000 ans à l’agriculture dansla vallée de Tehuacán, y aurait en réalité suivi deprès la domestication des premières plantes, entre6500 et 4900 avant notre ère (voir Les germesdes civilisations, par F. Gendron, page 14).
Quoi qu’il en soit, il reste à comprendre commentles anciens hydrauliciens mexicains ont réussi à main-tenir des pentes inférieures à deux degrés sur desterrains accidentés. Aujourd’hui, il serait impossiblede le faire sans instruments modernes de géomètre.Les anciens Égyptiens établissaient leurs visées àlongue distance à l’aide de niveaux et de tiges étalon-nées. Ces méthodes simples et efficaces ont proba-blement été pratiquées aussi dans le Mexique proto-historique, mais nous n’en avons pas la preuve.
35DOSSIER N°72 / JUILLET-SEPTEMBRE 2011 / © POUR LA SCIENCE
LE BARRAGE DE PURRÓNdans la vallée de Tehuacánserait la plus grande structure précolombiennede rétention d’eau. Sonédification commençavers –750, mais les travauxse poursuivirentjusque vers 1150. Le barragemesure au total 25 mètresde hauteur sur 400 mètresde longueur. Son réservoir,aujourd’hui comblé par lessédiments, accueillait l’eaudescendant des montagnesvisibles en arrière-plan.
Jam
es A
.Nee
ly
dossier_72_Neely_GJ2305.xp 15/06/11 17:45 Page 35
En revanche, il nous est possible de répondrepartiellement à la question de la planification desréseaux de canaux. Dans une localité reculée dela vallée de Tehuacán, nous avons retrouvé uneligne de petits galets qui prend son origine dansun coude de tecoatl. Cette ligne descend la courtepente d’un défilé, puis remonte de l’autre côtéjusqu’à un point légèrement plus élevé, lequeldomine une petite vallée dépourvue de canaux. Ilpourrait s’agir d’une « ébauche » en vue de laconstruction d’un futur canal, que rendrait possiblele surélèvement progressif du tecoatl existant. Eneffet, pour que l’eau du tecoatl coule naturellementjusqu’à l’autre côté du défilé, celui-ci aurait dû êtrerehaussé d’un mètre, ce qui correspond à environun siècle de croissance d’un tecoatl. Les ancienshydrauliciens ont-ils mis en place un repère afinde ne pas manquer le jour où l’irrigation du versantd’en face serait enfin devenue possible ?
Un facteur de civilisation ?Autre question: les systèmes d’irrigation étaient-ilscréés et contrôlés par leurs utilisateurs ou par des«autorités de l’eau»? Dans les années 1950, l’his-torien Karl Wittfogel a avancé son « hypothèsehydraulique», selon laquelle partout dans le monde,l’exploitation et le partage à grande échelle desressources en eau ont constitué une étape décisivedu développement des civilisations. Dans cettehypothèse, seules les «sociétés hydrauliques» seraientdevenues des civilisations, c’est-à-dire des sociétéshautement organisées (une agriculture permanente,une administration hiérarchisée, des services d’ar-chivage, etc.), dotées de villes et de centres de pouvoir,et au sein desquelles les surplus de la productionagricole auraient permis la spécialisation du travail.Selon Wittfogel, une société hydraulique se civi-
lise parce qu’un approvisionnement stable en eaului fournit à la fois la raison et la capacité de parvenirà l’état de civilisation. Dans cette logique, la construc-tion et l’entretien de grandes infrastructures degestion de l’eau supposent une société très orga-nisée. Nombre de chercheurs ont mis en doute lavalidité de ces idées, arguant que la coopérationde petites entités sociopolitiques plus ou moinsorganisées, mais capables d’exploiter ensemble unesérie de petits systèmes hydrauliques interconnectés,a pu aussi conduire à l’apparition de réseaux étendus,et ce en l’absence d’autorité centrale.
La réalité était probablement intermédiaireentre ces deux modèles : à mesure que la complexitésociopolitique augmentait, un système de gestioncentralisé et hiérarchique de l’eau s’est mis en place,tandis que de petites sociétés autonomes ou semi-autonomes continuaient d’opérer en parallèle. LeMexique actuel illustre bien ce fonctionnement.Dans la vallée de Tehuacán, l’irrigation est géréepar des sociedades de agua (« sociétés de l’eau») nongouvernementales, dont l’origine pourrait êtreprécolombienne. Aujourd’hui encore, des droitsà l’eau se transmettent par héritage, pratique donton trouve la trace dans les manuscrits aztèques etdans les documents coloniaux. Chaque petitecommunauté est responsable de l’utilisationcorrecte et de l’entretien de sa portion du réseaude canaux, mais la gestion globale résulte d’unconsensus entre différentes communautés parte-naires. Ainsi, la gestion de l’eau est à la foislocale et collective. Le débat sur la façon dont lessociétés anciennes ont construit et géré les infra-structures hydrauliques n’est cependant pas clos.En revanche, il y a unanimité pour reconnaîtreque les systèmes hydrauliques du Mexique proto-historique sont de merveilleuses réalisations. �
36 INCAS, MAYAS, AZTÈQUES… © POUR LA SCIENCE
articles• J. NEELY, Prehistoric watermanagement in highlandMesoamerica, in Water Historyand Humanity, Springer andUNESCO, 2011.
• J. NEELY, Mesoamerican formative period water management technology :an overview with insightson development and regional interaction, in New Perspectiveson Formative MesoamericanCultures, Archaeo Press, 2005.
• J. NEELY, A contextual study ofthe « fossilized » prehispaniccanal systems of the Tehuacánvalley, Puebla, Mexico,in Antiquity, vol. 75, n° 289,pp. 505-506, 2002.
• S. CARAN et al., A late paleo-indian/early archaic water wellin Mexico : possible oldestwater-management feature inthe New World, inGeoarchaeology : AnInternational Journal, vol. 1,n° 12, pp. 1-36, 1996.
À HIERVE EL AGUA,d’anciennes terrassescultivées entourent l’unedes sources d’eau minéraleeffervescente.
Jam
es A
.Nee
ly
dossier_72_Neely_GJ2305.xp 15/06/11 17:45 Page 36

















![[Prehistoric America] - ScienceViews.com](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6333b0f7a6138719eb0abae5/prehistoric-america-scienceviewscom.jpg)