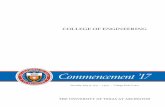Parcours de la Sehnsucht dans l'œuvre de Freud : au commencement
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Parcours de la Sehnsucht dans l'œuvre de Freud : au commencement
PARCOURS DE LA SEHNSUCHT DANS L'ŒUVRE DE FREUD : AUCOMMENCEMENTThierry Longé
ERES | « Essaim »
2009/1 n° 22 | pages 47 à 64 ISSN 1287-258XISBN 978274210735
Article disponible en ligne à l'adresse :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-essaim-2009-1-page-47.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thierry Longé, « Parcours de la Sehnsucht dans l'œuvre de Freud : aucommencement », Essaim 2009/1 (n° 22), p. 47-64.DOI 10.3917/ess.022.0047--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour ERES.© ERES. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans leslimites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de lalicence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit del'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockagedans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
Parcours de la Sehnsucht dans l’œuvre de Freud :
au commencement
Thierry Longé
« Die Menschen haben immer die Sehnsucht, alle Geheimnisse mit einem Schlüssel auf sperren zu wollen 1. »
Freud
Je sais bien qu’exprimer une idée une ou deux fois, sous la forme d’un aperçu fugitif, n’est tout de même pas la même chose que de la prendre au sérieux, la prendre au mot (wörtlich), la suivre à travers tous les détails contradictoires, et conquérir pour elle la position qui lui revient parmi les vérités reconnues. C’est la différence entre un flirt léger et un mariage en bonne et due forme, avec toutes ses obligations et ses difficultés. Épouser les idées de… : voilà une expression usuelle, tout au moins en français 2.
« Épouser les idées » de Freud, c’est en accepter tous les méandres, les impasses, les circonlocutions, les attentes et les repentirs, les suspensions et les abandons, les dérives et les dérivations. « On n’a qu’à se baisser, nous serine Lacan, dans le champ de Freud, on n’a qu’à se baisser pour ramasser ce qu’il y a à trouver 3 », nous invitant à reprendre ce vieux geste du glaneur. Encore faut-il se baisser, ainsi nous dit-il dans sa leçon du 3 juin 1964, « le Nachträglich, par exemple, a été, dans sa portée, négligé, encore qu’il fût là et qu’il n’y avait qu’à le ramasser 4 ».
1. GW. Nachtragsband, p. 133. Homme magnétique : « Les hommes ont toujours cette Sehnsucht : vouloir ouvrir avec une clé tous les mystères. » OCP, t. VI, p. 39.
2. S. Freud, Sur l’histoire du mouvement psychanalytique, Édition Cornelius Heim, NRF, 1991, p. 27 (GW, X, 52).
3. Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1973, p. 197.
4. Ibid.
Essaim 22.indd Sec3:47Essaim 22.indd Sec3:47 24/04/09 9:09:3324/04/09 9:09:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
48 • Essaim n° 22
Après avoir, il y a quelque temps 5, proposé une introduction à la notion de Die Sehnsucht dans l’œuvre de Freud, il s’agira aujourd’hui de poursuivre une enquête quant à ses usages par Freud dans l’ensemble de son œuvre. Ici, au commencement, aus den Anfängen, c’est-à-dire dans ce cabinet des curiosités, cette arrière-salle, ce laboratoire que sont les lettres à Fliess, où il essaie, une à une, l’exposition de ses idées principielles. C’est là que nous trouverons les premiers usages de cette notion : avant que le trivial et le vernaculaire ne cèdent le pas et ne se cadencent à l’armature du discours théoricien.
Au départ de cette enquête il y eut la résistance, aisément constatable à tout lecteur, qu’oppose à la traduction la notion de Sehnsucht, en elle-même d’abord, contextuellement ensuite, aux divers moments de son emploi.
Certes, la promotion récente, par les traducteurs en « français freudien », des Œuvres complètes, sous la houlette de Jean Laplanche, de la notion unifiante de désirance pour chacune des occurrences de la Sehnsucht, en lieu et place de celle d’aspiration, de désir ardent (cupidine ardere) et surtout de nostalgie, peut être considérée comme une avancée sur le chemin de la conceptualisation post-freudienne.
Reste à apprécier la pertinence doctrinale de cette décision. Reprenons plutôt ce geste, auquel Lacan nous invitait, et glanons en ces commence-ments, dans la correspondance et nécessairement au-delà, ces fragments qui nous permettent d’épouser les idées… de Freud, celles-là mêmes dont il ne nous donna qu’un aperçu fugitif et qu’il nous faut prendre au sérieux, qu’il nous faut prendre au mot.
S’en acquitter, ce sera constater deux moments distinguables de son usage. Le premier relève de l’étude de la mélancolie dont il produit la formule d’une écriture simplifiée et dont il faut suivre l’éclosion le doigt pointé sur son schématisme sexuel. Le second, puisé à la source des propres tourments de Freud, montre la première dérivation 6 possible de cette notion d’un champ à l’autre, du sexuel au symptôme.
L’équation de la mélancolie
Cette première occurrence de la Sehnsucht dans la correspondance néces-site une introduction qui anticipe les développements à venir, faute de quoi, son exposition risque d’apparaître fort indigeste. Au moment de son écriture, la seule topique implicite dont Freud use est celle de la personne, qu’il inscrit, nous le verrons dans le schéma sexuel qui guide ses pas, dans un plan ortho-normé où l’abscisse serait la frontière somato-psychique et l’ordonnée la
5. Thierry Longé, « Die Sehnsucht. Introduction à une notion freudienne », Carnets 67, janvier-avril 2008, p. 61-76, École de psychanalyse Sigmund Freud.
6. C’est un emprunt délibéré aux thèses de J. Laplanche, notamment dans Dérivation des entités psychanalytiques, 1977, rééditions PUF, coll. « Quadrige », 2008.
Essaim 22.indd Sec3:48Essaim 22.indd Sec3:48 24/04/09 9:09:3324/04/09 9:09:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
Parcours de la Sehnsucht dans l’œuvre de Freud : au commencement • 49
frontière du moi, découpant quatre espaces ouverts : sur le monde extérieur, le monde intérieur, l’espace somatique et l’espace psychique. La cinétique du graphe est dominée par le modèle de l’action-réaction, dérivé de celui de l’arc réflexe. Cette conceptualisation sommaire entrera par la suite violemment en collision avec la montée en puissance de la théorie du fantasme et la promo-tion de l’inconscient, nécessitant la création de nouveaux paradigmes après l’abandon, dont on sait la complexité, de la neurotica. Pour l’heure il faut s’en tenir strictement à ce modèle pour suivre les méandres de l’élaboration qui va suivre. Et il faudra pour autant en conserver le souvenir pour en retrouver la trace dans les écrits ultérieurs comme un brin persistant dans le tressage de l’armature théoricienne. À telle enseigne, on a pu constater la persistance du modèle réactionnel dans l’approche personnaliste de la mélancolie proposée vingt ans plus tard 7. De même on peut en apercevoir la permanence dans l’étude du modèle infantile, au principe que « l’enfant ne possède encore aucune des démarcations entre le conscient et l’inconscient 8 ». Ce constat réac-tualisera alors automatiquement l’ancien modèle mis à nu par le décapage des suivants. On peut soutenir, encore faudrait-il le montrer avec précision, que, dans l’élaboration de son édifice théorique, Freud procède par empilement des modèles et des paradigmes dont les usages se réactivent nécessairement et parfois secrètement en fonction des objets et des topiques qu’ils impliquent.
La lettre 39
La première occurrence de la Sehnsucht, donc, dans les lettres à Fliess était introuvable dans la version expurgée de la lettre 39 (initialement 18) du 19 avril 1894 9. Cette lettre est une lettre de plainte et de suspicion, celles d’un Süchtiger 10 (toxicomane) soumis à l’oppression d’un sevrage, ici son tabagisme, à celui qui le lui impose.
7. C. Dostal-Diaz, J. Le Brun, T. Longé et S. Rabinovitch, cf. « L’abandon, l’autre nom de la mélan-colie freudienne », Essaim n° 20, p. 21-38.
8. S. Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, chapitre X, p. 424 : « Beim Kind, das noch keine Scheidung zwischen Bewüssten und Unbewüssten besitzt, GW XI, p. 424.
9. S. Freud, Lettres à Wilhelm Fließ 1887-1904 Édition complète. Traduit de l’allemand par F. Kahn et F. Robert, Paris, PUF, octobre 2006, p. 93-94. Les citations des Lettres à Fließ à venir le seront à partir de cette édition, à cette nuance près que seront conservées les occurrences de la Sehnsucht dans la langue d’origine dans chacune d’entre elles.
10. « Die Sucht renforce cette modalité du désirer, dans l’état qu’elle indique : rage, colère, manie, passion, voire démangeaison, et dont l’addiction, la toxicomanie – die Süchtigkeit –, nous donne une version réalisée par la formule de la quête et de la recherche visant à combler le seul manque de l’objet en tant qu’il vient toujours à manquer dans ce désirer du Süchtiger – le toxicomane. Et non comme manque à être, dans ce comblement de la perte présentifiée, substantifiée par la substance addictive elle-même, qui fait de l’addict un chercheur qui ne cherche plus au-delà de l’objet qui lui manque, requalifiant le désir en besoin. » Cf. Die Sehnsucht, « Introduction à une notion freudienne », op. cit.
Essaim 22.indd Sec3:49Essaim 22.indd Sec3:49 24/04/09 9:09:3324/04/09 9:09:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
50 • Essaim n° 22
Plainte : « Pour le medicus qui toute la journée s’échine à comprendre les névroses, il est très pénible de ne pas savoir si l’humeur dépressive dont il souffre est de nature logique ou hypocondriaque. »
Suspicion : « Cette fois, c’est ce que tu dis, toi, qui me paraît suspect, car mon affaire cardiaque est la seule où je t’ai entendu tenir des propos contradictoires. La dernière fois, tu as expliqué que cela restait nasal et tu as dit que l’examen percutoire du cœur nicotiné ne donnait rien, aujourd’hui tu manifestes une grande inquiétude à mon égard, tu m’interdis de fumer. Je ne peux comprendre cela qu’en supposant que tu as voulu me cacher ce qu’il en est vraiment, et je te demande de ne pas le faire. »
Plainte et suspicion à l’égard de celui qui dispose sur lui d’un savoir absolu et qui le lui refuse : « Si tu peux dire quelque chose de certain, fais-le-moi simplement savoir » pour conclure par un très stoïcien : « Je suppor-terai très dignement l’incertitude et le raccourcissement de ma vie. » On sait la place que devait occuper entre les deux hommes la supposition d’un tel savoir, à travers l’élaboration fliesséenne de la théorie des périodes. Ainsi, dans la lettre 44, concernant la certitude qu’il entretient de mourir jeune, cet appel pathétique aux accents faustiens : « Je serai éternellement ton débiteur si tu me dis clairement le fin mot de tout cela ; je crois en effet au fond de moi-même que tu sais précisément ce qu’il en est. »
Le Süchtiger lypémaniaque – Freud retrouvant ici la nomenclature esqui-rolienne 11 pour caractériser sa propre humeur dépressive – souhaite-t-il convertir l’ivraie nicotinique pour consentir au bon grain de la connais-sance, ou veut-il maintenir le compromis entre ces deux passions. La référence nietzschéenne au sacrifizio dell’intelletto à la Pascal de la lettre 43 (22 juin 1894) à quoi s’apparenterait le renoncement de l’habitude de fumer creuse l’abîme au-delà de l’anecdotique. Il n’est que de renvoyer au texte de Nietzsche lui-même 12.
11. En introduisant le terme de « lypémanie », passion triste, Étienne Esquirol fit tentative infruc-tueuse de substitution à l’arrogante et hégémonique mélancolie. Cf. J.-B. Baillière, Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal, 1838.
12. « On trouve aussi de la jouissance, et une profusion de jouissance, à souffrir soi-même, à s’in-fliger de la souffrance ; chaque fois que l’homme se laisse persuader de faire abnégation de soi, au sens religieux du mot, ou de se mutiler comme les Phéniciens et les ascètes, ou simplement de mortifier ses sens et sa chair, de s’humilier ou de se convulser dans la pénitence comme les Puritains, de disséquer sa conscience toute vive et de consentir comme Pascal au sacrifizio dell’intelletto, c’est sa cruauté qui l’aiguillonne et le pousse en avant, le dangereux frisson d’une cruauté tournée contre lui-même. Considérez enfin que même le disciple de la connaissance, en se forçant à connaître, contre le penchant de son esprit et souvent de son cœur, en s’obligeant à nier là où il voudrait affirmer, aimer, adorer, agit en artiste et glorifie la cruauté. Sonder ainsi toutes choses jusque dans leurs profondeurs, les fouiller jusqu’au tréfonds, c’est déjà une façon de se faire violence, de faire souffrir exprès la volonté foncière de l’esprit qui s’élance sans cesse vers l’apparence et le superficiel. Dans toute volonté de connaître, il y a au moins une goutte de cruauté. » F. Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, n° 229, éd. 10/18, 1962, p. 168, trad. fr. G. Bianquis, Aubier, 1951.
Essaim 22.indd Sec3:50Essaim 22.indd Sec3:50 24/04/09 9:09:3324/04/09 9:09:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
Parcours de la Sehnsucht dans l’œuvre de Freud : au commencement • 51
De l‘anesthésie
C’est dans ce contexte qu’on doit lire l’étonnante vignette culinario-clinique, dont l’édition princeps des lettres nous privait. Il n’y propose rien de moins que la mise en équation de la mélancolie, anticipant de quelques mois (probablement janvier 1895) le manuscrit G qui lui est consacré.
Moi non plus je n’ai pas aimé la femme du Dr Er. Je suis peut-être injuste envers elle quand je la qualifie d’« oie » à la rubrique viande et à la rubrique légume de « tubercule détestable 13 ». Que l’analyse lui ait été désagréable, je veux bien le croire, elle n’a fait que confirmer ainsi l’idée de « défense », c’est la troisième fois qu’elle se défile. Par ailleurs, je veux lui délivrer un certificat de bonnes mœurs : elle est anaesthesica + Sehnsucht inassouvie : mélancolie 14, pas question d’angoisse, donc pas de coït non plus – si je suis correctement informé. Bien sûr, je n’ai rien trahi de ce que je savais sur le conseiller aulique. Elle s’imagine que personne n’a rien deviné et elle me hait comme étant la source possible de trahison.
Cette exposition minimaliste de la théorie libidinale de la mélancolie à l’occasion de cette brève vignette, Freud l’amplifie quelque peu, dès juin de la même année, dans le manuscrit E, intitulé « Comment apparaît l’angoisse 15 ».
Mais ce sont les développements du manuscrit G qui donnent sa pleine mesure à l’équation de la mélancolie où s’écrit le déséquilibre entre la sensation somato-psychique et la tension psychique relatives au sexuel. La mélancolie supposerait, à ce moment de l’élaboration freudienne, une réduction voire une annulation de la sensation et corrélativement un excès de la tension sexuelle psychique. Le mode d’écriture, ici celui d’une simple équation, est ambigu en ce qu’il pourrait laisser accroire en première lecture à une description causale de la mélancolie, là où Freud se conten-terait d’une proposition descriptive phénoménale de l’état mélancolique. Posé cela, ce serait cependant gommer l’ambiguïté du propos qui s’appuie sur le schéma sexuel.
Voyons comment elle s’expose dans le fameux manuscrit :
13. Z’widerwurzen. Expression autrichienne formée à partir de Wurzen (en allemand : Wurzel) et de zuwider (das ist mir zuwider : cela me répugne) pour désigner une personne antipathique (note des traducteurs).
14. Sie ist : Anaesthesica + ungestillte Sehnsucht : Melancholie.15. Lettres à Wilhelm Fließ, p. 105 : juin 1894. « Ici vient s’intercaler une connaissance acquise en même
temps sur le mécanisme de la mélancolie. Très souvent les mélancoliques ont été des anesthési-ques, ils n’éprouvent pas le besoin (ni d’ailleurs la sensation) du coït, mais ils ont une grande Sehnsucht d’amour (große Sehnsucht nach Liebe) sous sa forme psychique, on serait tenté de dire : tension amoureuse psychique ; là où celle-ci s’accumule, reste insatisfaite (unbefriedigt), apparaît la mélancolie. Ce serait donc le pendant de la névrose d’angoisse.
Là où de la tension sexuelle physique s’accumule – névrose d’angoisse. Là où de la tension sexuelle psychique s’accumule – mélancolie. »
Essaim 22.indd Sec3:51Essaim 22.indd Sec3:51 24/04/09 9:09:3324/04/09 9:09:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
52 • Essaim n° 22
Voici à peu près les faits qui se présentent, nous dit Freud :a) Il existe des relations frappantes entre la mélancolie et l’anesthésie. Cela est prouvé :– par cette constatation : chez beaucoup de mélancoliques il y a eu, longtemps auparavant, de l’anesthésie ;– par cette expérience : tout ce qui provoque de l’anesthésie favorise l’apparition de la mélancolie ;– par un type de femmes ayant de grands besoins psychiques (sehr bedürftigen Frauen), chez qui la Sehnsucht vire facilement à la mélancolie (bei denen Sehnsucht leicht in Melancholie umschlägt) et qui sont anesthésiques.b) La mélancolie naît de l’intensification de la neurasthénie du fait de la masturbation.c) La mélancolie survient en se combinant de manière typique avec une angoisse grave.d) Dans la mélancolie, le type – extrême – semble être la forme héréditaire pério-dique ou cyclique 16.
L’esthésie sexuelle somato-psychique (sensation de volupté : Woll-lustempfindung) est, en tant que perception, strictement corrélée au degré d’excitation du groupe sexuel psychique. De sorte que l’anesthésie sexuelle peut ressortir tout autant aux signes, à la potentialité, mais aussi à la causa-tion de la mélancolie comme ce paragraphe du manuscrit l’indique :
Dans quelle mesure, maintenant, l’anesthésie favorise-t-elle la mélancolie ?Dans le cas de la frigidité, l’anesthésie n’est pas la cause mais le signe d’une
disposition à la mélancolie.Dans les autres cas, l’anesthésie est la cause de la mélancolie, parce que le
groupe sexuel psychique, renforcé bien sûr par l’arrivée de la sensation de volupté, est affaibli par l’absence de celle-ci. (Références aux théories générales sur la liaison de l’excitation dans la mémoire.)
On peut être anesthésique sans être mélancolique.La mélancolie se rapporte à l’absence d’excitation sexuelle somatique.L’anesthésie se rapporte à l’absence de volupté.L’anesthésie est un signe de la mélancolie.L’anesthésie est une préparation à la mélancolie car le groupe sexuel psychique
est affaibli par l’absence de sensation de volupté tout comme par l’absence d’exci-tation sexuelle somatique 17.
Ainsi l’anesthésie sexuelle somato-psychique, définie comme absence ou perte de la sensation de volupté, et assumant, dans ce texte, cette triple fonction de signe, de potentialité (disposition ou préparation) et de cause à la mélancolie, est incapable d’induire, à elle seule, la mélancolie comme état. Sa manifestation suppose une autre composante associée, en tant que l’état mélancolique est, à cette époque de l’élaboration freudienne, un déséquilibre
16. Manuscrit G, op. cit., p. 129-130.17. Ibid., p. 134.
Essaim 22.indd Sec3:52Essaim 22.indd Sec3:52 24/04/09 9:09:3324/04/09 9:09:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
Parcours de la Sehnsucht dans l’œuvre de Freud : au commencement • 53
énergétique (gradient d’excitation) interprétable dans la perspective d’une dialectique action-réaction 18 et relevant d’une topique personnaliste prenant appui sur le schématisme sexuel. L’anesthésie sexuelle en réduisant le degré d’excitation du groupe sexuel psychique (Psychische Gruppe) prépare les conditions du déséquilibre propice à l’émergence d’un état mélancolique. Selon ce schématisme, l’éconduction de la tension sexuelle (Sexualspan-nung) qui s’opère par l’intermédiaire du groupe sexuel dépend du degré d’excitation de ce dernier. La réduction de la tension sexuelle psychique n’est possible que si les voies de son éconduction restent perméables, ce qui suppose un degré d’excitation suffisant du groupe sexuel psychique qui la prend en charge puis la décharge via la réaction spécifique.
Ainsi l’anesthésie en réduisant l’excitation du groupe sexuel inhibe la décharge de la tension sexuelle psychique. C’est cette accumulation de la tension qui précipite l’installation de l’état mélancolique. Pour Freud, ce schématisme vaut tout aussi bien pour l’apparition de l’angoisse, en deçà de la frontière somato-psychique, concernant la tension sexuelle physique, comme le souligne le manuscrit E cité ci-dessus.
Transcription de G. Fichtner du schéma sexuel de Freud, reprise de la page 571 de l’édition allemande (S. Freud Briefe an Wilhelm Fließ 1887-1904, Michael Schröter Edition S. Fischer 1999).
18. Nous avons montré récemment que l’argumentaire freudien de la causalité mélancolique s’était profondément transformé par l’introduction de la notion de « travail », travail de deuil et travail de la mélancolie, en substitution à la « dialectique action-réaction » (Einwirkung-Reaktion) à l’œuvre dans les textes précoces. Le destin de l’anesthésie s’en trouva dès lors scellé. Celui de la Sehnsucht est à écrire, c’est ce à quoi nous nous engageons. Cf. C. Dostal-Diaz, J. Le Brun, T. Longé et S. Rabi-novitch, « L’abandon, l’autre nom de la mélancolie freudienne », Essaim, n° 20, p. 21-38.
Essaim 22.indd Sec3:53Essaim 22.indd Sec3:53 24/04/09 9:09:3324/04/09 9:09:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
54 • Essaim n° 22
Cette écriture simplifiée soutient et encourage Freud dans sa tentative de démembrement et de réduction de la mélancolie. En ceci notamment que le réglage de la production de l’excitation sexuelle somatique et la déviation de la tension sexuelle du groupe sexuel psychique permettent, à eux seuls, de distinguer les trois formes de mélancolie : mélancolie grave, mélancolie neurasthénique et mélancolie d’angoisse. Les deux premières ressortissent à une chute transitoire ou périodique de la production d’ex-citation soit par la défaillance du système de production, soit par un usage immodéré. La troisième est le fait d’une déviation de la tension sexuelle à la frontière somato-psychique génératrice d’angoisse.
De la Sehnsucht
De ce schème neurobiologique Freud s’écarte cependant légèrement en nommant Sehnsucht l’affect corrélatif à la variation de la tension sexuelle (Sexualspannung). Cet écart, dont les incidences quant au destin de son usage dans l’œuvre sont considérables – et c’est l’un des buts de notre travail que de le démontrer –, est la conséquence de deux manœuvres distinguables.
La première consiste à identifier deux registres, celui des besoins sexuels supposés et celui des désirs dans une écriture flottante qui semble effacer leur différence (voir dans la citation du manuscrit E en note 14 et dans celle du manuscrit G note 16 l’oscillation Bedürfnis-Sehnsucht).
La seconde s’effectue par l’étayage prit sur le deuil pour rendre compte des modalités de la perte dans la mélancolie.
L’affect correspondant à la mélancolie est celui du deuil, c’est-à-dire la Sehn-sucht pour quelque chose qui est perdu. Dans la mélancolie, il pourrait s’agir d’une perte, une perte dans la vie pulsionnelle (und zwar in Triebleben – et plus précisément dans la vie pulsionnelle) 19.
Freud inscrit donc ici la Sehnsucht au registre de l’affect directement lié à la nature de la perte, dont il serait l’expression déchiffrable. Si l’affect est le même dans le deuil et dans la mélancolie, ou plutôt s’il lui corres-pond, leur différenciation respective portera moins sur sa nature que sur sa genèse.
Dans le deuil, le désir est tendu vers l’objet perdu (Sehnsucht nach etwas Verlorenem), nous dit Freud. Si l’on transcrit cette formulation dans l’écriture de son schématisme sexuel, on peut dire que le défaut d’éconduc-tion de la tension sexuelle, responsable de la stase tensionnelle, source de l’affect, est la conséquence de l’impossible réalisation de la réaction spéci-fique par défaut de l’objet sexuel, dont la perte caractérise le deuil. La stase
19. Manuscrit G, op. cit., p. 130.
Essaim 22.indd Sec3:54Essaim 22.indd Sec3:54 24/04/09 9:09:3424/04/09 9:09:34
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
Parcours de la Sehnsucht dans l’œuvre de Freud : au commencement • 55
de la tension sexuelle est induite par l’absence de variation de l’excitation du groupe sexuel. De sorte que c’est l’impossible décharge du groupe sexuel psychique, indispensable à l’éconduction de la tension, qui induit la stase en amont dans le circuit pulsionnel. L’affect corrélatif, au niveau du moi, de cette stase de la tension sexuelle est donc directement lié à la perte de l’objet sexuel. En conséquence, sa restauration par substitution devrait faire disparaître et la stase et l’affect, en l’absence de tout dommage sur l’ensemble du circuit de la vie pulsionnelle.
Dans la mélancolie, la perte n’est pas objectale, elle est, nous dit Freud, plus précisément une perte dans la vie pulsionnelle (Triebleben). C’est le circuit de la pulsion lui-même qui se montre défaillant, dans sa capacité de délestage périodique. La Sehnsucht en tant qu’affect est dans la mélancolie, comme dans le deuil, la traduction pour et dans le moi de la stase de la tension sexuelle (Sexualspannung). Mais ici, cette stase est consécutive à la réduction de l’investissement du groupe sexuel psychique, ou pour le dire avec les mots de Freud lui-même, « le groupe sexuel psychique (psychische Sexualgruppe) perd de sa grandeur d’excitation (Erregungsgröße einbüßt) 20 ». L’action que qualifie einbüßen renvoie à un dommage réparable, distin-guable de celle du perdre (verloren) sollicitée pour le deuil dans le sens de la disparition. Elle maintient donc l’idée d’une variation de la grandeur d’excitation du groupe sexuel psychique, à l’origine de l’endommagement réversible du circuit de la vie pulsionnelle.
Les conditions de ces variations exposées dans la suite le manuscrit G confirmeront la nécessaire distinction à produire entre perte au sens de la perte de l’objet dans le deuil par sa disparition et perte au sens de la variation sur un gradient d’excitation du groupe sexuel psychique dans la mélancolie.
Dans le deuil, la stase de la tension sexuelle affecte le moi des consé-quences d’une perte objectale, induisant une rupture de l’arc action-réaction sans altération du circuit de propagation de l’énergie sexuelle psychique. Dans la mélancolie, cette même stase est la conséquence d’une défaillance transitoire ou périodique du circuit de la pulsion, défaillance localisée à la perte de grandeur de l’excitation du groupe sexuel psychique.
Ce dommage est induit en premier lieu par la réduction ou l’arrêt de la production d’excitation sexuelle somatique (somatische Sexualerregung) : c’est celle qui caractérise la « mélancolie grave et native » (genuine) qui fait retour périodiquement, et la « mélancolie cyclique » où alternent les périodes d’intensification et d’arrêt de la production. C’est celle aussi que provoque la masturbation excessive qui conduit à un délestage exagéré de l’organe terminal et ainsi à un faible niveau de stimulation de celui-ci, entamant la production de
20. Ibid., p. 130-133.
Essaim 22.indd Sec3:55Essaim 22.indd Sec3:55 24/04/09 9:09:3424/04/09 9:09:34
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
56 • Essaim n° 22
l’excitation sexuelle somatique et conduisant à l’appauvrissement durable du groupe sexuel somatique et ainsi à l’affaiblissement du groupe sexuel psychique ; c’est la « mélancolie neurasthénique ».
Toute différente sera la causalité de la « mélancolie d’angoisse » forme mixte de la névrose d’angoisse et de la mélancolie, où la tension sexuelle est déviée du groupe sexuel psychique, alors que la production de l’excitation sexuelle n’est pas diminuée, laissant présupposer que l’excitation sexuelle somatique est utilisée d’une autre manière à la frontière [somato-psychique] 21. Dans ce dernier cas, l’affect d’angoisse se substitue à celui de Sehnsucht en l’absence de stase tensionnelle.
Cette dernière modalité de la mélancolie vient confirmer, si besoin était encore, au terme de ce démembrement de la mélancolie, la corrélation sans hiatus entre l’affect – die Sehnsucht – et la stase tensionnelle, commune au deuil et aux trois premières formes de mélancolie.
C’est cette communauté de la Sehnsucht à deux états distinguables, l’un relevant du normal – le deuil –, l’autre du pathologique – la mélan-colie –, qui va rendre possible la dérivation de la notion et l’extension de son usage.
A contrario, l’anesthésie, qui s’inscrit dès les débuts de son usage dans la sphère du pathologique, s’avérera impossible à dériver hors de la dialectique action-réaction et ne résistera pas à l’abandon de la neurotica et à l’extension à la métapsychologie de la théorie (anesthésie versus travail, nous l’avons déjà signalé) 22.
La hantise de Rome
La première dérivation que nous avons à connaître et que la corres-pondance nous permet d’établir, quant à l’usage freudien de la notion de Sehnsucht, est sa promotion symptomale. Freud l’extrait de sa propre expérience. Il la nomme et la désigne par l’objet qui leurre la tension de désir, le désirement. Du même mouvement se trouvent ainsi qualifiées et la nature du symptôme – ici névrotique, nous dit-il – et la complexité de l’objet requis à sa cristallisation. Il convient d’étudier le mouvement qui anime ces deux nécessités, tant la formation symptomatique que l’élection de cet objet complexe mis en position leurre. Il faut ensuite appréhender les conditions de son surmontement et enfin valider si possible son inscription au registre de cette sphère notionnelle. Ce découpage ne vaut que pour la présentation et la clarté de l’exposition, il laisse de côté la dynamique à l’œuvre qui relèverait davantage d’une analyse nodale permettant de
21. Le démembrement de la mélancolie se trouve p. 133 du manuscrit G.22. Cf. supra note 18.
Essaim 22.indd Sec3:56Essaim 22.indd Sec3:56 24/04/09 9:09:3424/04/09 9:09:34
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
Parcours de la Sehnsucht dans l’œuvre de Freud : au commencement • 57
concevoir le rapport singulier entre le choix du symptôme et le choix de l’objet.
Avancer, comme ici, mais comme toujours, un choix traductionnel, dont la pertinence ne peut être que sujette à caution, est déjà en soi une interprétation de l’événement qu’est la possible dérivation, le caractère dérivable de la notion de Sehnsucht. Dériver mais détacher de sa première occurrence, cet usage nouveau et singulier ne peut simplement être confondu avec elle, d’autant que l’appui initial sur une écriture schéma-tique lui fait dorénavant défaut. Il ne bénéficie pas encore ou insuffisam-ment de l’étayage métapsychologique alors en pleine gestation.
Le moment du symptôme
L’hypothèse de la dérivation se soutient de quelques étapes prélimi-naires indispensables. Nous avons vu comment Freud installe la notion de Sehnsucht dans l’équation de la mélancolie, en solidarité avec celle d’anes-thésie. Décalant son usage, le transposant dans le champ des psycho-né-vroses de transfert, ici nommément l’hystérique, Freud le dépayse de son schématisme sexuel initial. Cet exil signifie un changement de paradigme. À la dialectique de l’action et de la réaction et aux repères orthogonaux qui découpent le schéma sexuel par les frontières du moi (Ichgrenze) et du somato-psychique (somato-psychische Grenze), Freud substitue le temps diachronique de la psychogenèse et l’espace de la fantaisie.
La Sehnsucht désignera ainsi ce temps de l’infantile où se forgent les fantasmes. Elle est moment, période – die Zeit der « Sehnsucht » – au cours duquel se développent les éléments du caractère infantile du sujet, « une fois que l’enfant se trouve soustrait aux expériences vécues sexuelles. C’est pendant cette même période que se sont fabriquées les fantaisies 23 », nous indique Freud.
Pour autant, en ce premier mouvement, si la Sehnsucht « caractérise en premier lieu l’hystérie, l’anesthésie actuelle (même si elle n’est que poten-tielle) en constitue le principal symptôme 24 ». Ainsi dans l’anticipation de sa dérivation au champ symptomal de l’hystérie, Freud maintient la Sehn-sucht dans la solidarité du diptyque qu’elle réalise avec l’anesthésie.
La dérivation proprement dite ne s’opérera que dans l’année qui va suivre. D’abord, dans la lettre 149 25 où il lui confère le statut de symptôme
23. Lettre du 27 octobre 1897.24. Ibid.25. Lettre du 3 décembre 1897. Freud ajoute le commentaire suivant : « Elle se rattache à mon enthou-
siasme de lycéen pour le héros sémite Hannibal, et cette année, tout comme lui en effet, je ne suis pas allé du lac de Trasimène à Rome. »
Essaim 22.indd Sec3:57Essaim 22.indd Sec3:57 24/04/09 9:09:3424/04/09 9:09:34
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
58 • Essaim n° 22
et le nomme de son objet : « Ma Sehnsucht pour Rome (Romsehnsucht) est d’ailleurs profondément névrotique. »
Élevée au rang de symptôme, nommée de son objet, la Sehnsucht freu-dienne devient observable par celui-là même qui en pâtit – « cette Sehn-sucht me tourmente de plus en plus » (da diese Sehnsucht immer quälender wird) 26, puis le déborde en s’aiguisant :
Au milieu de la dépression matérielle et morale de ce temps, je suis hanté par le désir d’aller passer, cette année, la semaine pascale à Rome. Sans aucun droit d’ailleurs, car je ne suis parvenu à rien, mais les circonstances m’empêcheront vrai-semblablement de faire ce voyage 27.
Cette hantise est une proposition d’Anne Berman, première traductrice des lettres à Fliess, dans la version expurgée de l’édition française. Elle traduisait ainsi le quält mich die Versuchung du texte : littéralement, la tenta-tion d’aller passer la semaine pascale à Rome me tourmente, me torture. La hantise qualifie ici l’exaspération du symptôme en une idée fixe, obsédante, tourmentante, torturante. Il faut sans doute se saisir de cet à-peu-près traductionnelle où se trouvaille le cheminement dynamique du symptôme. Hantise qui pourrait tout aussi bien dire le tout du symptôme.
La hantise romaine ainsi constatée s’alimente du désir éperdu, inépui-sable d’appropriation de l’objet dont témoignent ces longues heures passées à étudier la topographie de la ville antique lorsque rien d’autre n’est possible 28.
« Rome », unique objet ?
La complexité de l’objet « Rome » autour duquel se noue le symptôme (Romsehnsucht) a produit de nombreux énoncés, pour l’essentiel inféodés à la thèse de l’auto-analyse, celle qu’un Didier Anzieu, notamment, a pu soutenir et déployer, en son temps. Faut-il pour autant assentir à cette opinion selon laquelle l’une de ses variantes, « aller à Rome », serait pour Freud accomplir la totalité de ses désirs 29 ?
Plus sûrement, ne vaudrait-il pas mieux s’affranchir de cette doctrine pour mieux détailler une à une les facettes du cristal symptomatique ?
26. Lettre du 23 octobre 1898. « Je ne suis cependant pas assez concentré pour faire quelque chose d’autre à côté, sauf peut-être étudier la topographie de Rome, car cette Sehnsucht me tourmente de plus en plus. »
27. Nous utilisons ici la traduction d’Anne Berman de la lettre 262, initialement 141, du 30 janvier 1901. On peut la comparer à celle de la dernière traduction : « Au milieu de la dépression morale et matérielle de cette période, je suis tourmenté par la tentation de passer cette année la semaine de Pâques à Rome. Sans droit aucun, rien n’est fait, et il est probable que ce sera impossible pour des raisons extérieures. »
28. Cf. supra note 27.29. D. Anzieu, L’auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse, Paris, PUF, 3e édition, 1988,
p. 137.
Essaim 22.indd Sec3:58Essaim 22.indd Sec3:58 24/04/09 9:09:3424/04/09 9:09:34
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
Parcours de la Sehnsucht dans l’œuvre de Freud : au commencement • 59
Dans cette perspective alors, il est nécessaire d’élargir les références textuelles au livre des rêves et inclure l’analyse détaillée que Freud y fit des quatre rêves de la hantise de Rome – Sehnsuchtträume von Rom – qui amplifie celle de la correspondance, mais aussi leurs échos jusque dans sa Psychopathologie.
L’objet « Rome » peut se décliner selon plusieurs perspectives distin-guables. Deux seront ici privilégiées et détaillées pour le miroitement qu’elles rendent manifeste et que suppose sa complexité : l’oubli du nom du père et la passion « Fliess ».
« Aller-à-Rome » ou l’oubli du nom du père
En quoi la hantise romaine de Freud s’apparenterait-elle à une réaction de deuil ? Voici la réponse concise que nous propose Conrad Stein, dans l’article qu’il consacra à la Rome imaginaire de Freud 30 :
La nostalgie de Rome a fait son apparition peu de temps après la mort de Jacob Freud, et elle a duré jusqu’au voyage de Rome, soit une période de quatre ans 31, exac-tement celle que Freud désigne comme ayant été celle de son auto-analyse, auto-analyse dont le livre contient l’essentiel. De ce livre Freud dira qu’il a été la réaction à la mort de son père ; nous pouvons en conclure que la nostalgie de Rome a duré ce qu’a duré son auto-analyse, que son auto-analyse a duré ce qu’a duré le deuil de son père et que le voyage a marqué l’accomplissement du deuil.
Cette analyse biographique de l’œuvre comme réaction de deuil, de fait, Freud en faisait lui-même la proposition 32, ce qui vaudrait autorisation à réduire l’avènement de l’œuvre à cette unique dimension, dans l’efface-ment de cet effet d’après-coup qu’il stipulait pourtant explicitement ; ainsi, pour Marthe Robert :
Le projet même de l’ouvrage coïncidait avec une crise ; Freud se contraignit finalement à l’écrire pour tenter de surmonter l’état intérieur fort pénible où la mort de son père l’avait plongé 33.
30. C. Stein, « Rome imaginaire. Fragment d’un commentaire de L’interprétation des rêves de Sigmund Freud », dans « La transgression », vol. 1 de la revue de psychanalyse L’inconscient, janvier 1967, p. 15, réédition 2002.
31. Le choix de cette durée moyenne, que les faits ne corroborent pas – entre la mort de Jacob et la publication le 4 novembre 1899 du livre des rêves il s’écoule trois ans, la ritournelle du voyage à Rome, elle, en occupe cinq dans la correspondance –, permet à l’auteur d’apparier l’écriture de l’œuvre et la réalisation du voyage à Rome, sous le même chef, celui de la transgression.
32. Préface à la deuxième édition de la Traumdeutung, dans OCP, t. IV, p. 18. « Ce livre a une autre signification subjective que je n’ai pu comprendre qu’après l’avoir terminé. Il s’est révélé être pour moi un fragment de mon auto-analyse, ma réaction à la mort de mon père, donc à l’événe-ment le plus significatif, la perte la plus radicale intervenant dans la vie d’un homme. »
33. M. Robert, La révolution psychanalytique, « La vie et l’œuvre de Freud », t. I., Paris, Payot, 1964, p. 158-159.
Essaim 22.indd Sec3:59Essaim 22.indd Sec3:59 24/04/09 9:09:3424/04/09 9:09:34
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
60 • Essaim n° 22
Cette proposition tendrait à lier ensemble la thématique romaine des quatre rêves en Sehnsucht – via l’auto-analyse des Sehnsuchttraüme von Rom de la Traumdeutung – et le symptôme de la hantise de Rome (Romsehnsucht) pour les amalgamer en une seule et même réaction de deuil et conséquem-ment faire de la réalisation du voyage à Rome son accomplissement. C’est, à tout le moins, ce que nous croyons lire à travers ces propositions.
Or Freud, en interrogeant les rêves romains du point de vue de l’infan-tile, en tant que source du rêve, se décale de cette perspective et réduit de fait la fonction du deuil paternel à sa seule dimension d’actualisation.
À la lettre, le renversement de l’objet Rom nous propose une autre version signifiante : Rom – Mor(t). De la langue allemande à la langue fran-çaise. D’autant que l’on constate son inscription dans une chaîne associa-tive métonymique, par laquelle le nom de Rome convoque d’autres sites, d’autres parcours qui font trajectoire, trajectoire d’une vie dans la récollec-tion des étapes biographiques. Ainsi sont nommés Freiberg en Moravie, lieu de naissance, Breslau, point de départ de l’exode viennois, Leipzig, Prague, mais aussi Karlsbad, dans la correspondance, et puis Lübeck, Glei-chenberg, Ravenne, Karlsbad et Prague encore, Paris enfin dans la série des rêves de Rome. Ainsi Rome n’est jamais Rome en tant qu’elle-même, ou plus précisément Rome est déjà là avant qu’elle ne puisse advenir en tant qu’elle-même, mais tout converge vers elle sans qu’on puisse jamais l’atteindre sauf à produire cet acte d’y être : non de s’y rendre, mais d’y être, d’y séjourner et de répéter ce séjour pour la faire consister.
De sorte que Rome noue l’ensemble de la chaîne métonymique qui passe par Paris. Ou pour le dire autrement, sur le trajet du symptôme, Rom en tant que but – Ziel – de la hantise, fut précédée d’un autre but, Paris, et s’écrivit dans une autre langue 34.
De même que Paris orienta, donna un but à la hantise de Freud, de même Rome quelques années plus tard. Peut-on dire alors que Rome chiffre la mort, au sens où c’est la mort qui fait hantise ? s’interroge Freud pour celui qui veut entreprendre le voyage, quel qu’il soit, quel qu’il fût. Puisque de cheminer, quels que soient les chemins, tous y mènent : « si ma constitution le supporte », s’inquiète le pauvre juif, s’il trouve son chemin en terre étrangère, répond le juif ignorant. Rome, Ville éternelle, devient lieu de l’éternité, cet au-delà de la frontière dont le franchissement est sans
34. S. Freud, « L’interprétation du rêve », traduction établie par J. Altounian, Pierre Cotet, René Lainé, Alain Rauzy, François Robert, Paris, PUF, 2003, OCP, vol. IV, p. 232. (GW, t. II-III, p. 201). « Tout à côté est tapie dans ma mémoire une autre histoire, celle d’un juif ignorant le français, à qui on recommande expressément de demander à Paris le chemin de la rue Richelieu. Paris, lui aussi, fut durant de longues années un but de ma Sehnsucht (ein Ziel meiner Sehnsucht – un but [de] à ma hantise), et la félicité avec laquelle je foulai pour la première fois le pavé de Paris fut pour moi le garant de ce que je parviendrais aussi à l’accomplissement d’autres souhaits. Demander son chemin est de plus une allusion directe à Rome car, on le sait, tous les chemins mènent à Rome. »
Essaim 22.indd Sec3:60Essaim 22.indd Sec3:60 24/04/09 9:09:3424/04/09 9:09:34
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
Parcours de la Sehnsucht dans l’œuvre de Freud : au commencement • 61
retour. Mais désirer Rome, être en chemin vers, puis voir Rome, être enfin dans Rome mais sans Rome, c’est localiser sans la franchir la limite à partir de laquelle un point de vue rétrospectif sur l’ensemble pourrait être posé.
Le cheminement imaginaire vers cette Rome espérée et inaccessible est peuplé des figures célébrées comme autant de jalons des idéaux guerriers de l’enfance. Ce sont celles d’Hannibal, de Masséna et par son intermé-diaire celle de Napoléon.
Force est de constater combien d’erreurs 35 et d’approximations parsè-ment ces deux pages, ce dont Freud rendra compte de diverses façons : notes et corrections lors des éditions ultérieures, élucidations analytiques.
Mais repérer l’erreur de mémoire comme « une déformation reposant sur des choses refoulées » lui permet d’y cerner le complexe paternel à l’œuvre dans ce refoulement :
L’erreur qui m’a fait dire Hasdrubal au lieu de Hamilcar, c’est-à-dire qui m’a fait mettre le nom du frère à la place du nom du père – der Name des Vaters –, se rattache à un ensemble d’idées où il s’agit de l’enthousiasme pour Hannibal que j’avais éprouvé étant encore lycéen et du mécontentement que m’inspirait l’attitude de mon père à l’égard des « ennemis de notre peuple 36 ».
Cette reconfiguration de la filiation, et la tentative de l’effacement du nom du père qui en est le symptôme, on la retrouve plus secrètement dans la filiation de l’autre héros de sa jeunesse : André Masséna auquel il suppose, bien à tort, une ascendance juive. Masséna-Manassé, du nom de l’un des deux fils du patriarche Joseph 37, l’oniromancien, l’interprète des songes, fils préféré et successeur de Jacob, le père d’Israël 38. Le choix de Manassé comme nomination du fils aîné, conçu dans l’allégeance à son nouveau maître, élevé qu’il vient d’être à la dignité de vizir du Pharaon, est tout sauf anodin. Joseph par et à cause de ses talents d’interprète des songes
35. Dans sa lettre à Fliess du 27 août 1899, Freud en dénombre par avance 2 467 « que j’y laisserai », écrit-il, un brin bravache et querelleur, à celui qu’il a nommé à cette fonction de correcteur. Dans le post-scriptum de cette lettre, qu’il cite intégralement au chapitre XII de sa Psychopathologie, ce nombre lancé, sans intention aucune, nous dit-il, chiffre la déception et l’espoir d’accéder à la plus grande des reconnaissances. Dans l’actualité, c’est devenir « Maréchal » qu’ils se nomment, à l’instar du héros de sa jeunesse, André Masséna, fils de commerçant, orphelin très jeune, maréchal d’Empire à 46 ans, précisément l’âge auquel Freud sera nommé Professor extraordinarius, à son retour de Rome, par l’empereur François-Joseph Ier, le 5 mars 1902.
36. Ibid., p. 234.37. À propos de Manassé : « Dans l’Ancien Testament, Israël est présenté comme une communauté
à structure tribale, depuis le moment de son apparition en tant que peuple, au début de l’Exode, jusqu’à l’établissement de la monarchie en terre de Canaan. Les tribus, qui sont au nombre de douze, correspondent aux douze fils du patriarche Jacob (Genèse, XXIX-XXX), que celui-ci eut de quatre femmes. Léa lui donna Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon ; Rachel lui donna Joseph (qui est remplacé dans certains textes, lorsque Lévi n’est pas nommé, par ses deux fils Éphraïm et Manassé) et Benjamin ; Bilhah, une servante, lui donna Dan et Nephtali ; enfin, Zilpah, une autre servante, lui donna Gad et Asher. » M. Guillet, « Les douze tribus d’Israël », Encyclopaedia Universalis, 2002.
38. Histoire de Joseph au quatrième chapitre de la Genèse.
Essaim 22.indd Sec3:61Essaim 22.indd Sec3:61 24/04/09 9:09:3424/04/09 9:09:34
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
62 • Essaim n° 22
doit renoncer à son propre nom et épouser la fille d’un prêtre d’Héliopolis. « Joseph donna à l’aîné (de ses deux fils) le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m’a fait oublier toute ma peine et toute la famille de mon père 39. » Manassé signifiant : il m’a fait oublier.
Nous en savons peut-être désormais un peu plus sur ce qui insiste dans ces rêves de Rome et de ce qui les noue à la hantise comme symptôme : l’oubli, l’effacement du nom du père.
« Pâques-à-Rome » ou la passion « Fliess »
La hantise de Rome (Romsehnsucht) chez Freud est l’un des fils rouges des quatre dernières années de sa correspondance avec Fliess. On ne saurait la résumer au seul désir de s’y rendre, en dépit de ce qu’il nous en dit une fois réalisé le voyage à Rome si longtemps différé.
C’est peu dire qu’il s’y soit préparé, au point que l’on pourrait écrire, sans trop d’exagération, que Freud a inventé la psychanalyse pour pouvoir un jour se rendre à Rome. « Cela a été, pour moi aussi, grandiose et l’accomplissement d’un souhait longtemps caressé, tu le sais. Un peu rapetissé, comme le sont ces accomplissements quand on les a attendus trop longtemps, mais quand même un sommet de la vie. » Voilà comment Freud rend compte à Wilhelm Fliess de cette première fois, de cette première visite si longtemps attendue et si longtemps remise dans l’une des dernières lettres qu’il lui adressa 40.
Si la réalisation du voyage à Rome est, comme il l’écrit, un climax, un point culminant, un sommet de son existence, qui donnerait l’apparence d’un surmontement de ce qui le hantait, une chose est certaine cependant. Avant que de surmonter cette impossibilité, Freud n’a cessé d’en proposer la possibilité à Fliess, jusqu’à produire ce syntagme particulier « Pâques-à-Rome », qui fait ritournelle ou moulin à prières sous sa plume 41.
Dans les deux lettres qui encadrent « ce point culminant » de son existence, nous pouvons lire les signes d’un autre événement dont le taris-sement et l’extinction de la correspondance sont la conséquence. C’est la rupture de l’amitié entre les deux hommes et le constat définitif de leur séparation, c’est la fin de leur cheminement ensemble. Ici, leur route se sépare. Ici, c’est Rome qu’il faut écrire, Rome vers laquelle Freud rêva,
39. Genèse, 41, 51.40. Lettre 271 du 19 septembre 1901, p. 566. La correspondance en compte 287 et s’achève en juillet
1904. 41. C’est le cas de la lettre 191 du 6 février 1899, p. 437, ou encore celle du 27 août de la même année
(Lettre 211, p. 468). Peut-être aussi celle du 16 avril 1900, bien qu’elle ne fasse plus proposition et adresse à l’autre, mais vire à la formule pieuse, version métonymique du « l’an prochain à Jérusalem » de Pessa’h. (Lettre 243, p. 518). Nous ne citons ici que quelques-unes des nombreuses occurrences recensées dans la correspondance où « Rome » ou ce syntagme viennent sous la plume de Freud.
Essaim 22.indd Sec3:62Essaim 22.indd Sec3:62 24/04/09 9:09:3424/04/09 9:09:34
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
Parcours de la Sehnsucht dans l’œuvre de Freud : au commencement • 63
tout au long des quatre dernières années de cette intense correspondance, d’entraîner son ami Wilhelm.
Les termes de cette rupture ont leur importance, les voici dans les deux lettres citées.
Nous ne pouvons absolument pas nous dissimuler que nous nous sommes tous deux un peu éloignés l’un de l’autre… Et toi aussi tu as atteint là les limites de ta perspicacité, tu prends parti contre moi et tu me dis, ce qui dévalue tous mes efforts : « Le liseur de pensées ne fait que lire chez les autres ses propres pensées 42. »
Dans la lettre du 19 septembre 43, on retrouve la même amertume :Cela m’a peiné de perdre mon « unique public », comme dit notre Nestroy 44.
Pour qui donc vais-je pouvoir écrire ? Si à partir du moment où une de mes interpré-tations te met mal à l’aise, tu es prêt à soutenir que le « liseur de pensées » ne devine rien chez l’autre, mais ne fait que projeter ses propres pensées, tu n’es vraiment plus du tout mon public, tu considères forcément tout comme les autres que ma méthode de travail dans son ensemble est sans valeur.
Certes, les formes y sont, mais la rupture est consommée : « Tu n’es vraiment plus du tout mon public », « cela m’a peiné de perdre mon “unique public” », « Pour qui donc vais-je pouvoir écrire ? » Wilhelm ne sera pas du voyage à Rome, puisque décidément, comme les autres, il refuse la technique psychanalytique comme méthode thérapeutique. Et plus encore, puisque le chemin qui y mène, celui qu’ils auraient pu parcourir ensemble, celui qu’il faut emprunter pour entrer dans Rome, la « via reggia 45 » que Freud pourra identifier dix ans 46 plus tard à l’interpré-tation du rêve, faisant ainsi de Rome l’allégorie de l’inconscient.
Faudrait-il en conclure que le voyage ne s’effectue que du renonce-ment à ce long cheminement commun ? Que c’est dans la réalisation de la perte de son « seul public » que se précipite celle du voyage ? Que c’est du délitement de l’objet Rome, objet complexe, par le fracas de l’un de ses composants essentiels qu’écrit le syntagme « Pâques-à-Rome », que vient se dissoudre provisoirement la puissance du symptôme, libérant le mouve-ment si longtemps contenu et suspendu jusque-là.
42. Lettre 270, p. 564.43. Lettre 271, p. 566.44. Freud dans une des dernières lettres à Fliess, en date du 11 mars 1902, reprend l’anecdote
suivante : « Ma clientèle avait fondu et ayant perdu mon dernier public en ta personne j’avais retiré de l’imprimerie ma dernière publication. On dit que Nestroy, regardant un jour de représentation à bénéfice, par le trou du rideau et ne voyant que deux spectateurs à l’orchestre, s’écria : “Je connais l’un de ces publics”, il a un billet de faveur. J’ignore si l’autre “public” en a un aussi ! »
45. « La voie royale » menant à Rome.46. Ajout de 1909 à la Traumdeutung : « L’interprétation du rêve est la via reggia menant à la connais-
sance de l’inconscient dans la vie d’âme. »
Essaim 22.indd Sec3:63Essaim 22.indd Sec3:63 24/04/09 9:09:3424/04/09 9:09:34
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S
64 • Essaim n° 22
Dans ce premier temps du parcours de la Sehnsucht dans l’œuvre, nous pouvons concevoir cette notion au carrefour de plusieurs grands moments de la théorisation freudienne, ceux qui traitent du sexuel, du désir, de la perte et de sa représentation. Il faudrait le prolonger pour rencontrer les autres dérivations possibles : elles seront métapsychologiques, dans leur dimension économique, et ce sera l’intense investissement de l’objet absent ou perdu – die Sehnsuchtsbesetzung – qui sera requis ; elles seront aussi anthropologiques, dans sa version idéale, et c’est la Vatersehnsucht qui se trouvera alors convoquée.
Essaim 22.indd Sec3:64Essaim 22.indd Sec3:64 24/04/09 9:09:3424/04/09 9:09:34
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 82
.225
.240
.187
- 2
4/06
/201
7 09
h18.
© E
RE
S D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 82.225.240.187 - 24/06/2017 09h18. © E
RE
S

























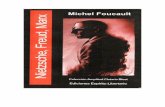










![O Método Especulativo em Freud [2008]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631cd5c9a906b217b90725bd/o-metodo-especulativo-em-freud-2008.jpg)