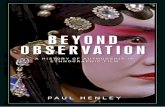Observation et entretien1
-
Upload
univ-rennes2 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Observation et entretien1
Introduction
Tomber enceinte alors qu'on est étudiante est souvent
difficile à accepter. Rares sont les cas de grossesse vraiment
planifiés durant cette période charnière de formation.
Cependant, aujourd’hui, il existe de plus en plus de jeunes
femmes qui tombent enceintes pendant leurs études et qui
décident de garder et d’élever leurs enfants tout en continuant
leur formation. En effet, l’Observatoire National de la Vie
Etudiante dénombrait 74 000 étudiantes dans cette situation en
2010. Ces jeunes mères relèvent un défi important en s’occupant
à la fois de leur enfant et de leur propre développement et
réussite. En plus de devoir s’adapter aux changements qui vient
avec le fait de devenir mère, elles doivent aussi s’occuper de
terminer leurs études, tout en maintenant une vie sociale et en
s’émancipant de leur propre famille, avec ou sans l’aide du
père de l’enfant. Si elles veulent réussir en tant que jeune
mère et étudiante, elles sont obligées d’adopter des rôles
multiples.
Même si on connaît l’existence de ce phénomène
aujourd’hui, ce thème des jeunes mères qui continuent leurs
études est peu abordé. Quand on parle des rôles multiples que
doivent endosser ces jeunes femmes, elles ont tendance à être
considérées comme une population vulnérable. D’un part, il
existe l’inquiétude de savoir si la jeune mère va être capable
de poursuivre ses études. D’autre part, il existe également
l’inquiétude du bien-être de l’enfant, de savoir s’il va être
bien traité et élevé en raison du manque d’expérience et de
ressources de la mère. Peu d’études portent sur le vécu,
l’expérience des jeunes mères qui essaient de concilier leurs
études universitaires et leurs rôles familiaux. Cette absence
nous amène à penser que ce phénomène de “mère étudiante” est
peu accepté, dans notre société occidentale. La plupart des
études sur ce thème portent sur les conséquences négatives de
leur situation (et non sur leur vécu) sans considérer que
souvent celles-ci témoignent plus pour une absence de soutien
que d’un manque de compétence.
Il nous semble donc pertinent de traiter ce sujet de
l’expérience de la maternité à l’Université. Comment est vécue
la grossesse à l’université ? Quel soutien est offert par
l’Université et les étudiants ? Comment se passe le retour à
l’université après l’accouchement ? Comment l’entourage réagit-
il à l’annonce de la grossesse ? Quelles difficultés les jeunes
mères rencontrent-elles et quels points positifs retiennent-
elles de leur expérience ? C’est à ces interrogations que nous
avons cherché à répondre en étudiant la réalité des jeunes
mères à l’université. Par le biais de cette étude, nous avons
également cherché à mieux comprendre comment sont perçus ces
rôles (mère, étudiante,…) par les jeunes mères elles-mêmes.
Nous souhaitions avoir une compréhension plus approfondie du
vécu des jeunes mères qui essaient de poursuivre leurs études
supérieures. Donner un aperçu sur le vécu des jeunes mères à
l’université, avec le support des témoignages de mères
étudiantes qui ont déjà vécues la situation, peut aider de
futures mères à mieux appréhender ce qui les attend.
Pour répondre à ces questions, nous avons utilisé
différentes méthodes de recherches que nous exposerons dans une
première partie.
Avec les résultats obtenus, nous avons pu dégager deux
axes de réponses, un premier axe plutôt extérieur à la mère-
étudiante, relatif aux préoccupations d’ordre financier et aux
différents supports mis en place à l’Université.
Dans un second temps, nous traiterons de plusieurs aspects
relatifs aux jeunes femmes elles-mêmes, en étudiant la manière
dont elles gèrent leur situation, du soutien moral dont elles
peuvent bénéficier ou non de la part de leur entourage et
également de…
I - Méthodologie
L’entretien est une technique dont le but est de
recueillir de l’information par le biais d’une interaction qui
se déroule dans une relation de face-à-face entre
l’évaluateur/interviewer et la personne enquêtée/interviewée.
L’entretien est un outil très utile : il est simple, rapide et
les ressources nécessaires à sa réalisation sont très
abordables. Dans le cadre de notre sujet, l’entretien constitue
un outil d’évaluation incontournable. Par le biais de
l’entretien, nous allons pouvoir recueillir différentes types
d’informations, toutes nécessaire à la réalisation de notre
sujet de recherche : des faits, des opinions, des points de
vue, des propositions, et des analyses concernant l’expérience
des jeunes mères. C’est pour cela que nous choisissions cet
outil car nous cherchons à collecter des informations
qualitatives et non quantitatives.
Le type d’entretien que nous avons choisi est l’entretien
semi-directif et c’est une possibilité pour nous car nous
disposons d’assez d’information sur les enjeux et les questions
prioritaires à traiter au cours de notre évaluation. Ce type
d’entretien a pour objectif de recueillir l’expression des
acteurs par rapport à une trame générale qui est plus stricte
que dans l’entretien non directif et plus souple que dans
l’entretien directif. La trame est construite à partir d’un
guide d’entretien. Notre guide d’entretien (voir annexe 2) est
composé de thématiques, de sous questions et d’objectifs liés à
ces questions (l’information que nous cherchons à obtenir à
travers ces questions).
Pour réaliser nos entretiens, nous avons suivi quatre
étapes :
Dans un premier temps, nous avons commencé par la phase de
démarrage et de mise en confiance. Lors de cette phase, il
est essentiel de connaître et respecter les coutumes,
présenter et expliquer les raisons de l’enquête. Il est
aussi très important de exposer les « règles du jeu » à la
personne enquêtée : la durée prévue de l’entretien et s’il
y a un enregistrement des réponses.
La deuxième phase est la phase d’ajustement entre le sujet
et les réponses des personnes cibles. Il faut donc
s’adapter au statut de l’interlocuteur et veiller aux
spécificités des réponses pour avoir des informations
complètes pour répondre à notre sujet. Il faut aussi être
flexible mais sans oublier de maîtriser l’évolution de
l’entretien.
Dans la phase de suivi du guide d’entretien et
d’approfondissement, il est important de montrer de la
réactivité en utilisant la contradiction et la relance.
La dernière phase est la phase de conclusion et post
entretien. Il est nécessaire de relire et remettre en
forme rapidement les notes prises durant l’entretien et
noter les éléments non verbalisés, la communication
sémiotique, qui ont marqué l’entretien.
Les avantages d’utiliser l’entretien comme outil sont très
intéressants. Comme nous l’avons mentionnée précédemment, il
est rapide et simple d’utilisation. Les délais sont courts et
les coûts sont faibles. L’entretien est aussi l’outil approprié
à utiliser lorsqu’on cherché à rencontrer un nombre limité des
personnes, ce qui est notre cas. Même si cet outil nous
convient, il a aussi un certain nombre de limites. Il y a un
nombre très limité de personnes que l’on peut rencontrer. Il
peut exister aussi un problème de la représentativité des
interlocuteurs. L’information doit par fois être vérifiée et
l’entretien a souvent besoin d’être combiné avec d’autres
outils pour arriver à une analyse complète et la plus objective
possible.
D’après Stéphane BEAUD et Florence WEBER dans « Le Guide
de l’enquête de terrain », nous avons trois outils à
disposition pour traiter l’entretien : « l’écriture, notation
et transcription, qui transforme enquête, entretiens,
impressions en documents, qui objective, qui permet la mise à
distance, le recul, la mise à plat ; la lecture critique, qui
rapporte des documents à leurs contextes, qui repère et
décrypte les allusions, les malentendus, les contradictions,
les références croisées ; le classement qui met en fiches des
éléments tirés de documents disparates, qui fait apparaître des
relations invisibles aux enquêtés, extérieures à l’interaction.
» (p. 235). L’écriture aide en transformant les entretiens en
textes. Lorsque nous avons suivi ces consignes, les textes de
nos trois entretiens sont devenus des lectures que l’on a pu
critiquer et analyser. Le classement transforme ces textes en «
matériaux à décortiquer, à désosser, à désarticuler. » (p.236).
Beaud et Weber indiquent également la procédure à suivre
pour le classement des entretiens. Les entretiens doivent être
classés et nous devons commencer par transcrire intégralement
les passages qui semblent les plus pertinentes pour notre
sujet. Dans notre cas, du au nombre limités des entretiens,
nous sommes obligés de dépendre entièrement des trois
entretiens que nous avons réalisés. C’est donc Joseph Maxwell
qui, dans « La modélisation de la recherche qualitative : Une
approche interactive » (1999) a suggéré de commencer l’analyse
dès le 1er entretien et poursuivre l’analyse tout au long de la
recherche et ne pas attendre d’en avoir plusieurs pour
commencer à les traiter. Comme nous n’avons que trois
entretiens nous avons suivi son approche quant à l’analyse des
entretiens.
Lorsque nous avons fini les entretiens, nous nous avons
appuyé sur le conseil de BEAUD et WEBER : « rangez et classez
vos entretiens d’un côté, vos observations de l’autre. Ensuite,
évaluez-les à partir de vos souvenirs personnels […]. Le
meilleur antidote au « tout-transcription » et au rêve
d’exhaustivité, c’est de vous poser sans cesse la question :
pour quoi faire ? Cet entretien mérite-t-il d’être entièrement
décrypté? Cette observation mérite-t-elle d’occuper une place
centrale dans votre analyse ? Pourquoi ceux-ci, et pas un autre
? » (p. 240) En suivant ce conseil, nous avons pu hiérarchiser
les entretiens et les parties les plus importantes selon leur
pertinence envers notre sujet. Ces deux auteurs nous ont aidé à
comprendre le chemin qu’il fallait prendre pour bien analyser
un entretien. Il est très important de restituer le contexte.
Tout ce qui a été dit lors de l’entretien est dépendant du
moment où l’entretien s’est déroulé, le lieu, l’environnement.
C’est pourquoi, il est essentiel de prendre en compte le
contexte lors de l’analyse. Un autre élément essentiel de la
contextualisation est qu’il est nécessaire de décrire et
analyser les relations de l’enquête. Nous avons pu témoigner le
comportement de la personne enquêtée et ce comportement est un
aspect important de l’entretien. Il faut toujours prendre en
compte le langage parlé mais aussi le langage sémiotique, les
signes par lesquels on communique avec les autres.
Analyser le déroulement de l’entretien aide à avoir une
compréhension plus approfondi de l’entretien. Un entretien
n’est jamais linéaire : « Le début correspond à un round
d’observation, chacun se prête par bonne volonté au jeu de
l’entretien. Arrive un moment où les choses s’accélèrent, les
positions se défont. Il y a des « tournants » d’entretien,
c’est-à-dire des moments où, pour différentes raisons (à la
suite d’une question, par une association d’idées, etc.),
l’interviewé change de posture, prend un autre ton, dit des
choses qui contredisent ce qu’il a dit précédemment, développe
longuement des thèmes qu’il n’avait pas du tout abordés et
qu’il avait peut-être dissimulés lors de la première partie de
l’entretien. Vous vous en apercevez mieux lors de l’écoute de
la bande que sur le moment où vous êtes pris par la situation
d’entretien. Cherchez à repérer ces points de basculement, ces
moments où la parole de l’enquêté change de statut. » (p. 261-
262)
Dans « L’enquête et ses méthodes : l’entretien », Alain
BLANCHET et Anne GOTMAN proposent d’autres façons de analyser
le contenu. Elle implique des hypothèses : « c’est une lecture
exogène informée par les objectifs de l’analyste. Elle ignore
la cohérence explicite du texte et procède par décomposition
d’unités élémentaires reproductibles (…). Elle a pour fonction
de produire un effet d’intelligibilité et comporte une part
d’interprétation » (p.92). Ces auteurs proposent de procéder de
deux manières différentes : soit l’analyse entretien par
entretien, soit l’analyse thématique. L’analyse entretien par
entretien se base sur le fait que chaque entretien a des
singularités importantes et surtout lorsqu’il s’agit des études
qui portent sur des récits de vie. Le deuxième type d’analyse
et celui que nous avons suivi lors de ce dossier, est l’analyse
thématique. Cette analyse est un peu contraire à la précédente.
Elle essaye de ne pas se centrer sur la singularité et «
découpe transversalement ce qui, d’un entretien à l’autre, se
réfère au même thème. » (p. 97-98).
Blanchet et Gotman expliquent que l’analyse thématique est
« cohérente avec la mise en œuvre de modèles explicatifs de
pratiques ou de représentations, et non d’actions.
L’identification des thèmes et la construction de la grille
d’analyse s’effectuent à partir des hypothèses descriptives de
la recherche (…). Elles procèdent d’une itération entre
hypothèses et corpus. (…) L’unité thématique n’est donc pas
définie a priori comme l’unité linguistique. C’est un noyau de
ses repérable en fonction de la problématique et des hypothèses
de la recherche. Mais, une fois sélectionnés pour l’analyse
d’un corpus, les thèmes constituent le cadre stable de
l’analyse de tous les entretiens » (p.98).
D’après ces auteurs, il existe deux façons de procéder dans
l’analyse thématique/ soit par l’analyse horizontale, soit par
l’analyse verticale. L’analyse horizontale, celui que nous
avons décidé d’employer dans notre dossier, relève les
différentes formes sous lesquelles apparaît le même thème d’un
entretien à un autre. Les thèmes que nous avons décidé de
traiter de cette manière sont l’aspect financier, l’entourage,
le projet de vie et l’aide apporté par l’université. L’analyse
verticale est un « passage en revue des thèmes abordés par
chaque sujet pris séparément dans un but de synthèse. » (p.99)
L’analyse verticale n’est pas très pertinent dans notre cas du
au fait que les personnes interviewé ont toutes traites les
mêmes thèmes.
Nous avons resté sur la même cible pour l’entretien
réalisé ce semestre. Les mères qui ont eu un enfant lors de
leur scolarisation à l’université sont l’agent principal dans
notre sujet de l’expérience de la maternité à l’université.
Afin d’entrer en contact avec des personnes à interviewer,
nous avons posté plusieurs annonces dans la partie “Petites
annonces” de l’Environnement Numérique de Travail (ENT) de
l’Université Rennes 2. Deux personnes nous ont alors répondu,
l’une avec un enfant de 6 ans et qui a repris ses études à
Rennes il y a un an, la deuxième étudiante en deuxième année à
Paris, avec un bébé de deux mois et demi. Cette dernière nous a
par ailleurs conseillé un forum http://www.mamansetudiantes.com
où nous avons pu entrer en contact avec plusieurs jeunes mères,
dont une qui a eu un enfant à la fin de son master1 et qui est
aujourd’hui diplômée. Par ailleurs, ce forum nous semble être
un bon terrain d’observation, puisqu’il permet aux (futures)
mères de discuter entre elles de leurs interrogations, de leurs
études et de leurs jobs, et des difficultés qu’elles peuvent
rencontrer.
Nous avons également réalisé une observation auprès de la
crèche parentale « Au clair de la lune » de Rennes 2. Une
observation s’agit de « réhabiliter l’ensemble des sens comme
moyen empirique de saisir la réalité du monde mais il ne s’agit
surtout pas de prendre vos sens pour la réalité ; il faut se
garder de tout ethnocentrisme, objectiver sa propre position
pour pouvoir produire un regard neutre de tout jugement de
valeur. » (Lefèvre, 2005) Lors d’une observation, l’enquêteur
doit se place dans le cadre même où se déroulent les phénomènes
étudiés. Il faut également essayer d’intervenir un minimum pour
arriver à observer comment les phénomènes se déroulent de
manière naturelle. Nous avons donc recueilli de l’information
par notre simple présence dans le cadre étudié, dans les forums
des mères étudiantes et à la crèche universitaire de Rennes 2.
Cette technique de la méthodologie qualitative que nous
suivons peut être difficile car il faut être capable de savoir
ce qui est important de percevoir et de savoir comment filtrer
l’ensemble d’informations que l’on peut recueillir. Pour
pouvoir réaliser cette tâche, nous nous avons assuré d’avoir
une problématique claire pour être capables de recueillir
l’information et d’identifier les indicateurs pertinente à
notre recherche. Les indicateurs correspondent « à la fraction
de réalité que l’on considère comme représentative du phénomène
que l’on étudie » (Maxwell, 1999).
L’observation nécessite d’un triple travail : de
perception, de mémorisation et de notation. Lors d’une
observation, ces trois activités interagissent pour pouvoir
effecteur correctement une observation. Comme l’entretien et
comme nous l’avons signalé antérieurement, nos observations ont
été structurées par rapport à nos objectifs de recherche.
Egalement, les observations nous ont permis de dégager
certaines pistes des thèmes à traiter ou à approfondir lors de
ce dossier.
L'observation que nous avons choisi d’utiliser est
l’observation directe méthodique. Granai (1967) constate que ce
méthode est « un procédé d'observation contrôlé : il suppose
que des hypothèses de recherche aient été formulées, à partir
desquelles un plan raisonné d'observation pourra être élaboré :
le questionnaire d'enquête, sorte de mémento méthodique à
l'usage de l'enquêteur. Mais il faut noter ici que si le
questionnaire d'enquête a pour objet essentiel d'ordonner et de
contrôler les observations, il ne saurait constituer le cadre
ne-varietur des démarches de l'enquêteur. Ici réside, en effet,
le danger du questionnaire d'enquête : de son expérience passée
et des résultats acquis par sa propre discipline, le sociologue
est tenté d'inférer les cadres de son observation actuelle. Le
système de concepts qu'il applique à la réalité sociale risque
de lui en fournir une image faussée, en quelque sorte
préfabriquée. » Nous basant sur notre guide d’entretien pour
avoir les questions pertinentes à nous poser, nous avons fait
attention à ce risque. L'ethnographe Marcel Griaule nous a
aussi guidées et valider notre choix d’utiliser ce
questionnaire en disant que « le seul questionnaire valable est
celui que l'usager créera et perfectionnera lui-même, d'abord
selon des données plus ou moins nettes, selon des chances ou
des intuitions, ensuite selon une technique de plus en plus
serrée. De simple guide-âne, il devient instrument précis ; il
joue un rôle de plus en plus intime dans l'enquête, à laquelle
il s'incorpore très étroitement. De ce fait, il lui laisse
moins de liberté — ou même, de fantaisie, de cette fantaisie si
féconde parfois — il l'oriente, il tend à en administrer les
hasards » (1957).
II – Difficultés externes liés à l’organisation
Ce qui semble poser le plus de difficultés aux jeunes
mères rencontrées, c’est l’organisation. En effet, entre
l’organisation de leur emploi du temps, avec le choix d’un mode
de garde, le temps consacré à leurs études et à leur famille,
et l’organisation financière en essayant de conjuguer
différentes aides et parfois un emploi, on s’aperçoit de la
complexité de la situation. C’est pourquoi nous avons décidé
d’aborder dans cette partie les aides disponibles dont elles
peuvent bénéficier mais aussi leurs perceptions face à celles-
ci. Nous verrons ensuite ce que les universités sont en mesure
de faire pour accompagner ces mères-étudiantes et comment ces
dernières s’organisent.
1) Aspect financier et administratif
Tout d’abord, les difficultés financières sont une des
premières choses qui peuvent frapper ces jeunes mères. En
effet, si certaines peuvent avoir un job d’étudiant, une grande
majorité ne dispose d’aucunes ressources liées à un emploi.
Cependant, il s’avère qu’en 2010, d’après l’Observatoire
National de la Vie Etudiante, 70% des mères-étudiantes avaient
le soutien du père de l’enfant et que celui-ci peut être en
capacité de ramener un salaire pour subvenir à leurs besoins.
Malgré tout, un smic peut sembler insuffisant pour entretenir
un ménage de 3 personnes dont un enfant.
Vers quelles aides se tourner alors quand on vient de
donner la vie ou qu’on s’apprête à le faire, tout en continuer
ses études ? La Caisse des Allocations Familiales (CAF) a mis
en place la Prestation à l’Accueil du Jeune Enfant (PAJE).
Cette prestation comprend, sous condition de revenus, un
versement de 923,08 € au 7èm mois de grossesse pour faire face
aux premières dépenses liées à l’arrivée de l’enfant. La CAF
propose également une allocation de base à tous les parents
touchant moins de 35 480 € ; pour un premier enfant, elle
s’élève à 184,62 € par mois. A cette allocation, qui est
valable jusqu’aux 3 ans de l’enfant, peut s’ajouter le
complément de libre choix du mode de garde qui prend en charge
une partie de la somme à payer, lorsque les parents décident de
faire garder leur enfant par un ou des professionnels (crèche,
assistante maternelle agréée etc…).
Outre ces aides liées directement à l’arrivée de l’enfant, la
jeune mère peut également bénéficier, sous certaines conditions
d’une Aide Personnalisée au Logement (APL) versée également par
la CAF.
Enfin, par son statut d’étudiant, la jeune femme peut faire une
demande auprès du CROUS pour bénéficier d’une bourse sur
critères sociaux. Il existe par ailleurs un complément
maternité de 270 € versé par le CROUS sur 9 mois à la fin du
congé maternité. Sur les 500 000 étudiants boursiers en 2004-
2005, seulement 350 étudiantes ont fait cette demande.
Ainsi, même s’il semble y avoir de multiples aides disponibles,
la réalité peut être différente. En effet, une de ces jeunes
mères a déclaré « Bah financièrement c’est un peu difficile, on est à 3 sur le
salaire de mon copain. Il gagne en moyenne 1650, 1700€, on a un petit peu d’APL
mais c’est tout. Du fait qu’il gagne ce salaire là, on est environ 30 ou 40€ trop riche
pour que j’ai des bourses et pareil trop riche pour que j’ai la gratuité du bus donc on
est vraiment très chaud tous les mois».
On peut alors se poser la question de la nécessité de
créer un statut particulier pour celles qui sont pour l’instant
aux yeux des organismes, soit mère, soit étudiante. En effet,
la création de ce statut permettrait de répondre de façon plus
adaptée aux situations particulières de ces jeunes femmes. De
plus, d’après des témoignages trouvés sur internet, il est
difficile de revendiquer quoique ce soit lorsque votre statut
est inexistant. Nous allons rentrer plus en détail sur ce sujet
lors de la deuxième partie de ce dossier.
Enfin, une des jeunes femmes interrogée nous a rapporté
les soucis qu’elle a pu rencontrer lorsqu’elle se renseignait
auprès d’un service public : Pôle emploi.
« Et je me rappelle, je commençais à me renseigner, avoir appelé Pôle Emploi, leur
avoir demandé des renseignements, est ce que je pourrais avoir des aides pour
reprendre mes études et la nana au téléphone s’était foutue de moi l’air de dire «
Mais vous êtes complètement folle, reprendre vos études avec un enfant, vous devriez
plutôt faire des ménages » vraiment méprisante, c’est dingue. Et en tant que mère au
foyer, je touchais plus. Ça je trouve ça pas logique du tout, je reprends mes études, je
me bouge et on touche vachement moins. C’est comme si on encourageait les mères
à rester au foyer à s’occuper de ton gosse et basta, ça c’est fou, mais bon. »
Ainsi, lorsque ces mères ont du arrêter temporairement leurs
études pour accueillir et élever leur enfant, il semble que ce
soit encore plus difficile de les reprendre.
Or, d’après le Conseil du Statut de la Femme au Québec1 « Soutenir
ces étudiantes aura, indéniablement, des conséquences positives pour l’ensemble de
la société car les liens ne sont plus à faire entre pauvreté, exclusion sociale et
manque de scolarité. De plus, la scolarité des mères a un effet positif sur le
cheminement scolaire de leurs propres enfants. En ce sens, tout soutien apporté aux
mères aux études constitue un investissement dans la génération à venir. »
En effet, deux des jeunes femmes interrogées nous ont affirmé
que retourner en cours leur a permis de s’épanouir et de
reprendre confiance en soi « Mais ça m’as fait du bien de retourner en
cours, ça m’a aidé à m’adapter à ma vie de mère étudiante, surtout parce que j’étais
resté avec Charlotte depuis sa naissance, c’était dur au début de me rappeler que
j’étais aussi une jeune fille étudiante et pas seulement une maman, ça m’a beaucoup
aidé sur cet aspect. » et « C’est mon copain qui m’a poussé surtout à postuler parce
que je n’avais plus du tout confiance en moi. Le fait de rester des années à m’occuper
seulement du petit tu te dis « bon je ne vais plus y arriver, je ne vais plus en être
capable » et puis en fait bah si quand même puisque j’ai été prise et je suis super
contente d’avoir été prise et ça me plait vachement ce que je fais. Mais heureusement
que mon conjoint est derrière moi et qu’il m’a poussé à le faire parce que sans lui
j’aurais pas eu le courage de le faire. ».
2) Aides apportées par l’Université
Une fois que ces jeunes mères ont pris la décision de
continuer ou de reprendre leurs études, elles vont devoir
trouver certaines astuces afin de pouvoir concilier la
concentration, l’assiduité et le temps nécessaire pour les
travaux à rendre, avec la garde de leur enfant.
1 http://www.csf.gouv.qc.ca/modules/fichierspublications/fichier-29-259.pdf
Il semble alors naturel de se tourner vers son université ou
ses professeurs et de leur demander de quelles solutions on
peut bénéficier.
Ainsi, le premier problème qui se pose c’est : que faire de mon
enfant lorsque je dois aller en cours ? Si certaines attendent
que leur enfant soit en âge d’aller à l’école, ce n’est pas le
cas pour toutes. Elles ont alors la possibilité de se tourner
vers les modes de gardes traditionnelles (crèche, halte-
garderie, assistante maternelle…) ou vers leurs proches. Ainsi,
l’une des mères interrogées nous a confié que son enfant allait
à l’école, puis à la garderie mais que lorsque celle-ci doit
fermer mais qu’elle-même n’a pas terminé les cours, c’est sa
voisine qui va récupérer son enfant à l’école. Une autre nous a
déclaré que sa fille était gardée alternativement par sa mère
ou par sa belle-mère. Cette dernière avoue même avoir pensé
l’emmener avec elle en cours quand elle était bébé.
Pourtant, il existe une autre solution, bien que peu développée
en France : les crèches universitaires. Nous sommes allées à la
rencontre du personnel travaillant dans la crèche universitaire
de Rennes2, qui est subvention en grande partie par la ville de
Rennes et la CAF, mais également par l’Université et le Conseil
Général. Ainsi, cette solution semble idéale grâce à sa
proximité d’une part, et également par son prix qui est entre
0,31 centimes et 2€40 de l’heure. Ce tarif est fixé en fonction
des revenus, il correspond à 0,05% du revenu mensuel. La crèche
de Rennes2 accueille actuellement 13 enfants ce qui
représentent 18 à 20 familles. Dans un objectif de mixité et
parce que les parents doivent à la crèche une demi-journée de
présence par semaine (c’est une crèche parentale), celle-ci
fait en sorte d’accueillir autant d’enfants d’étudiants que de
personnels de l’université. Parmi les demandes émanant
d’étudiants, la crèche réserve la priorité aux mères
célibataires. Cependant, la crèche reçoit beaucoup plus de
demandes qu’elle n’a de places disponibles. Le personnel de la
crèche ne se contente pas d’accueillir et de s’occuper des
enfants, ils ont également un rôle de conseil et d’orientation
envers les parents, afin de les guider et de les rassurer dans
leur nouveau rôle.
Malgré ses avantages, la crèche universitaire a le même
inconvénient que la plupart des autres modes de garde, son
amplitude horaire. En effet, elle est ouverte de 8h15 à 18h30,
ce qui peut poser problème puisque les cours peuvent commencer
plus tôt et se terminer bien plus tard.
Par ailleurs, si la jeune femme décide de
continuer/reprendre ses études mais qu’elle estime qu’elle ne
pourra pas assister à suffisamment de cours, elle peut se
rendre auprès de l’administration afin de bénéficier du statut
de non-assidu qui est accordé aux salariés ou aux chargés de
famille. Certains cursus proposent également des diplômes à
distance.
Enfin, quand est-il de l’organisation dans le travail ?
Les enseignants sont-ils compréhensifs ? D’après les entretiens
réalisés, il semble que ces derniers ne soient pas toujours
très cléments envers ces jeunes mères « On a l’impression que les profs
croient qu’on n’a pas de vie à côté, qu’il faut qu’on fasse que ça sauf que moi j’peux
pas. Le soir quand je rentre, je ne travaille pas, je bosse le weekend. Des fois quand
j’ai vraiment des gros trucs à faire, des dossiers, je dis à mon copain « bon tu pars
chez ton père avec le fils ce weekend il faut que je bosse que je sois toute seule »,
parce que bosser avec le petit c’est vraiment difficile. Et le soir il faut faire des choix,
soit je bosse mais je suis crevée ou alors je peux pas, je rentre il faut faire la popote,
le bain du petit, le coucher, lire une histoire… Donc non tant pis, je m’occupe du petit,
je bosse le weekend. » et « Les professeurs ne se montrent pas toujours très
compréhensifs, comme un prof qui m’a dit une fois : «Votre cas prouve que les études
sont trop faciles puisqu’il vous est possible de mettre un enfant au monde et
d’achever ce cursus d’études ».
On trouve également des témoignages de maman-étudiante sur des
blogs qui corroborent cette idée « Le plus drôle, c’est quand je dois
justifier mes absences aux TD à mes profs. Il y a ceux qui se sentent mal à l’aise et qui
me déroulent d’un coup le tapis rouge « Non, mais évidemment que votre absence ne
sera pas comptée ! Maman et étudiante, quel courage ! » et puis il y a ceux qui ne me
croient pas et qui me demandent, les yeux écarquillés, la voix horrifiée, l’acte de
naissance de mon enfant.»2
L’une des mères interrogées temporise cependant « Après ils sont
compréhensifs quand même. L’autre fois il y a eu une grève à l’école et j’avais pas
envie de le laisser toute la journée à la garderie parce que ça coûte des sous aussi
donc je leur ai dit bah non je ne viens pas parce que je garde mon petit et il n’y a pas
de problème. Mais sinon non il n’y a pas d’aide. ».
Ce sur quoi toutes ces jeunes mères s’accordent, c’est sur la
difficulté de trouver du temps et un endroit calme pour
réviser, entre l’enfant qui joue bruyamment ou le bébé qui est
malade ou qui se réveille en pleine nuit. Ainsi, l’une d’entre
2 http://sobusygirls.fr/2013/10/17/jai-teste-pour-vous-etre-maman-et-etudiante
elles nous dit « Un autre inconvénient est les soirs de révisions d'examens
avec un bébé sur les bras qui ne veut pas dormir ou qui est malade. Dans ces cas-là,
tu es content d’être à deux ! », une autre « Pendant les révisions, c’est la course !
Déjà on oublie les révisons pendant la journée. Parce qu’entre le bruit des petites
voitures, le robot parlant et les « maman, caca ! », d’un coup, la fac me paraît n’être
qu’un vague souvenir dans une vie antérieure. ».
Nous avons pu nous rendre compte que dans la plupart des
cas, les mères-étudiantes sont dans des situations financières
difficiles et qu’il peut sembler compliquer de connaître toutes
les aides dont on peut bénéficier. On peut penser qu’il y a un
manque de diffusion de l’information quant aux possibilités
offertes. De plus, la création d’un statut de mère-étudiante
permettrait de centraliser toutes les aides et de diminuer le
nombre de demandes à effectuer auprès des organismes. Ce statut
pourrait par ailleurs être bénéfique au niveau des Universités,
afin de bénéficier plus facilement de report d’examens, de
dispense d’assiduité ou d’une plus grande tolérance en cas
d’absence.
Il est également important d’encourager ces mères à reprendre
ou à continuer leurs études afin qu’elles puissent s’épanouir
et en faire bénéficier leurs enfants sur le long terme. Cet
encouragement pourrait passer notamment par la multiplication
des dispositifs de garde au sein des universités comme c’est
déjà le cas dans quelques unes.
III – Difficultés internes
1- L’entourage
La maternité à l’université est peu de fois planifiée. La
grossesse d’une étudiante peut être vue comme une transition
précoce vers un nouveau rôle, celui de mère. Nous pouvons
remarquer que les qualités d’un étudiante universitaires, comme
l’individualisation, la recherche de l’identité,
l’expérimentation de différents rôles, sont contradictoires
avec les qualités qu’une mère doit avoir, telles que la
stabilité psychologique, une sensibilité maternelle, etc.
Lorsqu’une étudiante universitaire devient mère, elle doit
redéfinir sa perception d’elle-même au même temps qu’elle
essaie de définir sa relation avec son enfant, avec sa famille,
avec son partenaire. Il devient donc difficile de répondre à la
fois à ses propres besoins et à ceux de son enfant. (Nath et
al., 1991; Osofsky et al., 1993; Schellenbach et al., 1992;
Wakschlag et Hans, 2000). De nombreuses études comparant les
pratiques parentales des mères adultes (plus de 24 ans) et des
mères jeunes (moins de 23 ans) montrent que les mères
étudiantes sont « souvent moins sensibles aux besoins de leur
enfant, ont des attentes moins réalistes quant à son
développement, sont moins stimulantes et utilisent plus de
pratiques disciplinaires coercitives que les mères adultes
(pour un relevé, Moore et Brooks-Gunn, 2002; Osofsky et al.,
1993; Zeanah, Boris et Larrieu, 1997).
Des nombreuses raisons peuvent être citée de pourquoi les
mères étudiantes ont particulièrement besoin de leur
entourage (jeune âge, manque de préparation, de stabilité,
d’emploi,…) et de leur aide. Le soutien social a une importance
capitale pour les jeunes mères. Le concept de soutien social
peut changer d’un auteur à un autre mais lorsqu’on parle de
soutien social dans ce contexte, on entend « les processus par
lesquels les relations sociales peuvent promouvoir la santé et
le bien-être » (Cohen, Gottlieb et Underwood, 2000). Selon
Cohen (2000), le soutien social « permet à une personne de
croire qu'elle est aimée, estimée et qu'on prend soin d'elle,
qu'elle a de la valeur et qu'elle appartient à un réseau de
communication et d'obligations réciproques. Le soutien social
aurait un effet positif sur la santé mentale et physique par
son influence sur les émotions, les cognitions et les
comportements. Cela procure un sentiment que la vie est stable
et prévisible et une reconnaissance de sa valeur personnelle. »
Il est possible de distinguer trois types de soutien
social perçu par l’entourage des mères étudiantes tels que le
soutien émotionnel et le soutien instrumental.
Lorsqu’on parle du soutien émotionnel ou
psychologique, un soutien relié à l’estime de soi, on
entend les actions qui encouragent la personne, la
rassurent quant à sa valeur personnel et lui montrent
son importance en l’écoutant l'écoutant, en lui
manifestant de l'empathie, en la respectant et en lui
fournissant des rétroactions sur ses compléments et
ses attitudes » (Duchesne, 2008). Henley indique
également que le soutien émotionnel est « la
possibilité de parler à quelqu'un de ses problèmes,
de demander conseil, de recevoir de l'encouragement,
des marques d'appréciation et de l'empathie et de
compter sur quelqu'un en cas de besoin » (1997). Ce
soutien est en effet le plus important d’une mère
étudiante, nécessaire pour aider la nouvelle mère a
garder une stabilité émotionnelle au bien-être d’elle
et de son enfant.
Le soutien instrumental, connu également comme
soutien pratique, sont les aides concrètes qui aident
à la personne dans ses efforts comme les aides aux
tâches domestiques, dans les soins des enfants, la
garde des enfants, etc. (Duchesne, 2008; Henley,
1997). Dans ce soutien l’on peut inclure l’aide
financière de la part de ses proches ou des aides
sociales discutée plus en détail lors de la première
partie de ce dossier.
Un troisième type de soutien que nous pouvons
mentionner est le soutien social dont l’on peut
inclure le soutien récréatif ou la compagnie sociale,
qui se définit «par le partage d’activités de loisir
ou récréatives avec d'autres personnes » (Ménard,
2010).
Le dernier type de soutien est le soutien
informationnel qui se constitue de « la transmission
d'informations pour répondre à un besoin, pour
définir, comprendre et gérer des événements
problématiques (Cohen et Wills, 1985; Duchesne,
2008). Le partage d'informations sur les habiletés
parentales (Letourneau et al., 2004) ou sur des
ressources spécialisées (Duchesne, 2008) en sont
quelques exemples.
Même si les effets spécifiques de ces différents types de
soutien social sont peu documentés, surtout chez les mères
étudiantes, il est possible de constater que ces effets sont
essentiels chez ces jeunes mères. Devoir s’occuper d’un enfant
alors qu’elles n’ont souvent pas compléter leur propre
développement psychologique et émotionnel implique des besoins
différents à ceux de mères adultes et donc ces soutiens gagnent
encore plus d’importance. Par exemple, la grossesse chez une
étudiante universitaire n’est pas souvent planifiée.
(Charbonneau, 2003) Cela implique donc une tendance à être
moins préparée qu’une mère adulte se traduisant donc par un
besoin plus important d’un soutien relié au rôle parental, des
conseils et d’information concernant les soins et l’éducation
de l’enfant ou d’un soutien financier pour arriver à satisfaire
les besoins de base de la mère et de l’enfant.
Lors de cette partie du dossier, nous nous intéressons à
la source de ce soutien social qui renvoie « à la personne ou
au groupe de personnes qui offre du soutien » (Veiel, 1985). Il
est donc possible d’inclure dans cette source de soutien la
famille, les relations amicales et amoureuses, les compagnons
et compagnes à l'école, les enseignantes et enseignants, le
voisinage et les services communautaires et sociaux.
(Schellenbach et al., 1992; Veiel, 1985). Gabrielle, une des
mères étudiantes que nous avons interviewé, constate
l’importance de ce soutien et la source celle-ci lorsqu’on lui
demande si son entourage a aidé à faciliter sa situation : « Ah
oui vachement, C’est la famille qui nous aide le plus: mes parents, mes frères et
sœurs et mes beaux-parents. Puis, ma mère est restée avec moi les 4 premiers mois
après la naissance de Charlotte, ça m’a aidé énormément et quand j’allais en cours,
pouvoir confier ma fille à ma mère me soulageait beaucoup. Surtout que ça me
permettais d’économiser les frais des ‘baby-sitters’. Nos amis aussi bien sûr étaient là
pour nous, même s’ils n’avaient pas beaucoup de temps non plus et que leur intérêt
pour les enfants était très limité.»
L’importance de la source de soutien est differente pour
une mère étudiante et jeune que pour une mère adulte. Par
exemple, Schellenbach (1992) note que la famille joue un rôle
beaucoup plus important et fonctionnel pour les mères
étudiantes que pour les mères adultes et Bucholtz et Korn-
Bursztyn (1993) constatent qu’une mère étudiante a moins
recours au soutien de leurs amies et amis que les mères plus
âgées. Marie, une des nos interviwées delcarent, lorsqu’on le
demande si ses amis l’ont soutenu, déclarent que « Mes amis,
mes amis…mmm oui (hesitante). Bah au fait ce n’est pas qu’ils
ne m’ont pas soutenu, c’est plus le fait qu’il n’y a pas grande
choses qu’ils peuvent faire pour te soutenir, tu comprends ?
Ils m’ont aidé avec mes cours, en me passant leurs cours pour
que je puisse photocopier au cas où je ne venais pas en cours
car j’étais fatigué ou des choses comme ça. Mais ils ne
comprennent pas, c’est impossible de comprendre si tu ne l’as
pas vécu. » Coletta (1981) vient soutenir cette idée en disant
que « les amies et amis sont une source moins satisfaisante de
soutien émotionnel que la famille et le conjoint. » D’après nos
entretiens et observations nous pouvons noter que les sources
de soutien les plus importantes chez ces mères étudiantes
semblent d’abord être les membres de la famille, le père de
l’enfant/le copain ou le conjoint et les amis. Quant aux
professionnels de la santé et des services sociaux et le
personnel des organismes communautaires, ils semblent garder un
rôle secondaire dans ce soutien social.
Il est important de remarquer que par rapports à nos entretiens
et observations, une source de soutien reste la plus présente
et la plus indispensable : celle de la grand-mère de l’enfant.
Son rôle est essentiel dans la vie de la mère étudiante et de
son nouvel enfant, surtout lors des premières années suivant la
naissance de l’enfant, «tant par son implication auprès de
l'enfant que par le modèle parental qu'elle offre » (Moore,
2002). Notre troisième interviewé confirme ce fait : « Ma mère
a toujours gardé Seb [l’enfant]. Je suis parti vivre avec elle
quand il est naît et quand j’allais en cours, il restait avec
elle. J’ai eu de la chance car l’année qu’elle a arrêté de
travailler, c’est l’année que Sébastien est né. Je ne sais pas
comment j’aurais fait si ça n’avait pas été le cas. Et c’est
grâce à elle que j’ai réussi à avoir mon diplôme, elle gardait
Seb quand j’allais en cours, quand je devais travailler sur un
dossier, pour faire mon mémoire, tout, tout mais vraiment tout.
Quand j’entends les histoires des autres mamans étudiantes, je
trouve que j’ai eu beaucoup de chance parce qu’avec ma mère,
tout a été beaucoup plus facile pour moi et pour Seb. »
La jeune maman devient donc plus dépendante de l’aide de sa
mère, par exemple, dans le cadre de l’information quant aux
soins de l’enfant qu’elle ne peut pas obtenir auprès de ses
amies n’ayant pas d’enfant. La mère de la mère étudiante reste
beaucoup plus présent que « les pères, les sœurs ou les frères,
dont le rôle est la plupart du temps effacé ou négligeable. »
(Charbonneau, 2003). Charbonneau constate qu’au moment de son
enquête « moins du tiers des jeunes mères disaient recevoir du
soutien de leur père» et indique que « le soutien provenant de
la fratrie est négligeable : ils sont rarement un point
d'appui, une source de réconfort et ils sont cités comme une
source d'aide dans moins de la moitié des cas par ces mères
étudiantes. » Par exemple, notre première interviewé constate
ce fait avec le père de son conjoint et sa mère : « Son père très
très mal, il ne voulait plus me voir, j’étais la paria. Ma mère très contente, alors
qu’elle m’avait toujours dit « Ne fais pas un enfant trop tôt blablabla » en fait elle
était super contente et puis heureusement qu’elle était là parce que c’est vraiment
elle qui m’a soutenue. Donc j’ai accouché là où ma mère habitait et je suis restée
vivre 3 ans là bas. » Ou encore des pères qui ont du mal à accepter la
situation : « Mon père […] n’était pas du tout content, surtout quand je lui ai dit
que j’allais garder le bébé. Il ne m’a pas parlé pendant presque toute ma grossesse,
ça a était très dure. » Charbonneau rajoute que « lorsqu’ils sont cités
c'est surtout pour une garde ou un transport urgent ou pour un
prêt d'argent. Leurs sœurs peuvent, par contre, fournir une
aide plus diversifiée que les frères mais, le plus souvent,
leur soutien prend la forme d'une garde d'urgence et de
l'écoute de confidences » (2003).
2- La reprise d’études
Une des principales raisons pour lesquelles les femmes
arrêtent leurs études est la grossesse. Marie indique que « il
n'était pas question de reprendre les cours le lendemain [de l’accouchement] surtout
que je me trouvais dans une formation où il est nécessaire d'être dynamique dès le
début de l'année, enfin comme dans toute formation. J'ai donc fait un report
d'inscription pour ma deuxième année.» Les filles qui tombent enceint à
un jeune âge sont plus susceptibles de subir des perturbations
dans leur éducation, que les filles qui n’ont pas d’enfants.
D’après l’INSEE, seulement la moitié des filles qui tombe
enceintes avant l’âge de 22 sont diplômées. Même si le taux de
grossesse à l’université a atteint son plus bas depuis quarante
ans, le décrochage scolaire de la part des mères étudiantes
reste élevé. Nous pouvons constater également, que les filles
qui tombent enceinte lors dès études universitaires, sont plus
susceptibles à avoir des revenus plus faibles que les filles
qui n’ont pas d’enfants lors de leurs études.
Lorsqu’une étudiante est enceinte à l’université, elle a
des besoins spécifiques qui ne sont pas favorables au bon
déroulement de l’année universitaire. Et ces besoins
particuliers peuvent ne pas être « tolérées » par l’école, tel
est le cas des étudiantes doivent garder le repos pour des
raisons médicales comme l’indique Marie quand elle décrit que
« je n’ai pas travaillé à fond, car en plus de la fatigue, j’avais des nausées et des
vomissements. J’ai même été arrêtée quelques semaines avec interdiction de bouger
lors de mon 5e mois de grossesse ». Une grossesse peut aussi être très
inconfortable et fatiguant pour l’étudiante qui doit être
capable de supporter une journée des cours et de travail à
faire chez soit. Marie, encore une fois, illustre cette
situation lorsqu’on lui demande les inconvénients d’être
étudiant et mère à la fois: «Je pense qu’un des pires inconvénients est la
fatigue. T’es toujours fatigué quand tu es maman ! (rires) Quand ton enfant est
malade et tu passe la nuit à prendre soin de lui et le jour d’après t’a une présentation
ou un contrôle, là je te dis ce n’est pas facile. ». Il ne faut pas oublier non
plus de l’état physique de la nouvelle maman. Après un
accouchement, une femme a besoin de temps pour se remettre.
Cela peut poser des problèmes lorsqu’on parle de la reprise
d’études.
La reprise d’études lorsqu’une étudiante est devenue maman
peut donc s’avéré très compliqué. Sans la motivation et sans
l’aide de l’entourage et de l’université, il est très difficile
de réussir dans cette tâche. Ces étudiantes, pas comme les
autres, sont dans un univers pas toujours évident à gérer.
En ce qui concerne la question du statut, elles sont, soit
étudiantes au regard de leur établissement, soit mamans au
regard de la Caf par exemple, mais le statut d’étudiante-maman
n’existe pas. « La situation de ces étudiantes n’est pas reconnue, alors qu’elles
font une triple journée : elles cumulent les cours, le bébé et souvent un job. Nous
agissons pour un statut social d’autonomie de l’étudiant. Notre action se tourne
aussi vers la création de crèches universitaires et vers un emploi du temps plus
souple » avoue un responsable d’aides sociales à l’Unef. Cela
sera une des solutions qui pourront aider et encourage la
reprise d’études des ces mères étudiantes.
Mais qu’en pensent les étudiantes concernées ? D’après les
forums que nous avons observé, nous avons constate que par
exemple une étudiante dit « qu’il est difficile de revendiquer
quelque chose avec un statut inexistant ». Une autre, enceinte
de plusieurs mois, assure que lorsque l’accouchement a lieu
durant les examens, ces étudiantes ne bénéficient pas d’un
report d’examens. « J’ai une amie qui a reporté son 2e semestre à cause de
cela », affirme-t-elle. Si l’université n’est pas flexible avec
ces étudiantes, ont risque de décourager la reprise d’études de
ces mamans. Mais un des problèmes reste que les étudiantes
mamans ou futures mamans manquent d’informations. Beaucoup
n’ont jamais entendu parler de l’existence de crèches
universitaires par exemple. Certes il en existe très peu en
France mais ça aide. Une autre maman étudiante reconnaît que la
crèche « dépanne pas mal. Nous sommes plusieurs étudiantes sur Lyon à utiliser
le service et on s’entraide avec les cours ou du baby-sitting de temps à autre ».
Donc, même s’ils existent des contraintes lors d’une
reprise d’étude suite à une grossesse, cela n’est pas
impossible. Toutes les mères que nous avons interviewées, ont
repris leurs études. Dans le cas de Flore elle explique ce qui
l’a motivée à reprendre ses études : « Euh… Bah j’en avais marre de
rien faire tout le temps, que par et pour le petit, la routine de l’emmener à l’école de
le ramener. Je ne m’épanouissais pas du tout là dedans. Je savais que j’avais envie de
faire un boulot dans le domaine du livre mais je ne savais pas que cette formation là
existait en fait. Il n’y en a que deux en France, il y a Lille et Rennes. Donc après je me
suis renseignée et j’ai vu qu’il y avait ça. C’est mon copain qui m’a poussé surtout à
postuler parce que je n’avais plus du tout confiance en moi en fait. Le fait de rester
des années à m’occuper seulement du petit tu te dis « bon je ne vais plus y arriver, je
ne vais plus en être capable » et puis en fait bah si quand même puisque j’ai été prise
et je suis super contente d’avoir été prise et ça me plait vachement ce que je
fais. » Marie aussi en parle de sa reprise d’études qui a été
motivée par sa mère : « Je voulais le faire. Je voulais être diplômée, j’ai
toujours trouvait ça indispensable. Ma mère était mère au foyer toute mon enfance
mais elle avait eu son diplôme quand elle était jeune et elle avait travaillé avant
m’avoir. Quand elle a divorcé mon père, j’avais que 9 ans et elle était très contente
d’être diplômée et de pouvoir trouver un bon travail pour satisfaire à nos besoins.
Quand je suis tombée enceinte, elle me l’a répété au moins dix mille fois (rires). »
Nous pouvons donc conclure que reprendre les études est
essentiel pour l’estime de chaque maman. Elles nous montrent un
besoin de continuer à avoir une identité propre à elles et ne
pas juste être maman. Il est aussi possible de remarquer que,
comment nous l’avons discuté auparavant dans ce dossier, le
soutien que reçoivent ces mères lors de la reprise d’étude est
essentiel pour une réussite scolaire.
Une de nos interviewée n’a pas repris les études car elle
n’a jamais arrêté : « Je n’ai jamais arrêté les études. Charlotte est née en
juin, à 8 mois, quand je me suis rendu compte que j’étais enceinte j’avais presque
trois mois, j’ai pu finir mon semestre. Je devais faire un stage pendant l’été mais il
n’était pas obligatoire, je voulais le faire mais bon… J’ai eu toutes mes vacances pour
m’occuper de la petite avec l’aide de ma mère et de mon copain. J’ai repris les cours
début octobre, j’ai loupé les premières semaines parce que les cours commençait en
septembre et comme j’allaitais c’était super compliqué au début. Mais ça m’as fait du
bien de retourner en cours, ça m’a aidé à m’adapter à ma vie de mère étudiante,
surtout parce que j’étais resté avec Charlotte depuis sa naissance, c’était dur au
début de me rappeler que j’étais aussi une jeune fille étudiante et pas seulement une
maman, ça m’a beaucoup aidé sur cet aspect (sourit) ». Elle a réussi à finir
sa formation sans faire de pause, ce qui n’est pas toujours
facile ou même commun. Mais elle affirme que cela n’est pas
facile et conseille les autres mamans que « le plus important c'est
de reprendre quand on se sent prête, à son rythme. Vouloir à tout prix assumer à
100% ses études alors qu'on est parent depuis peu, on court le risque de surmenage.
Faut aller lentement, au début au moins. »
Conclusion
« Les données disponibles ne permettent pas de dresser un portrait
précis des diverses problématiques qui s’y rattachent, de préciser
les besoins des jeunes mères ni d’évaluer les résultats des mesures
déjà appliquées. Elles ne permettent pas non plus d’établir le lien
entre grossesse-maternité et abandon scolaire ni de savoir combien
de femmes doivent renoncer à un projet scolaire à cause de
responsabilités familiales. » Québec