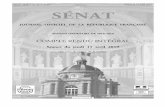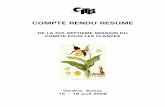L'intelligence économique - La prise en compte du management interculturel
Transcript of L'intelligence économique - La prise en compte du management interculturel
1
L’intelligence économique La nécessité du management interculturel
Pierre-‐Louis Manouvrier
M2 Management Interculturel 2012-‐2013
Sous la direction d’ Anne Gabaud
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Limoges
Corps
3
Sommaire
Introduction .......................................................................................................................... 4
1- L’intelligence économique, des définitions et évolutions ............................................. 5
1.1 – Des définitions variées ......................................................................................... 5
1.1.1 - Définition selon Henri Martre ........................................................................... 5
1.1.2 - Définition selon Christian Harbulot .................................................................. 6
1.1.3 - Définition selon Bernard Carayon .................................................................... 7
1.2 – Les intérêts et usages de l’intelligence économique ............................................. 7
1.3 – Une intelligence économique numérique ............................................................. 8
2- Fonctions et usages de l’intelligence économique .......................................................... 8
2.1 – Quelle approche de l’IE pour quel usage ? ............................................................. 9
2.2 – Les fonctions principales de l’intelligence économique, son organisation ............. 9
2.3 – L’intelligence économique au-delà de « l’économique » ..................................... 10
3- Le management interculturel, moteur de l’intelligence économique ............................ 11
3.2 – IE, diplomatie et gestion des risques interculturels ............................................... 12
3.2 – Quel avenir pour l’intelligence économique ? ...................................................... 13
Conclusion ......................................................................................................................... 14
Bibliographie ...................................................................................................................... 15
Corps
4
Introduction
L’intelligence économique correspond au processus de recherche et d’interprétation
des informations concernant une entreprise, un secteur d’activité, une région ou une
culture dans l’objectif de développer les outils adaptés pour parvenir à décrypter les
actions et les opérations des acteurs économiques et de connaître leurs capacités. Elle
comprend toutes les opérations de surveillance de l’environnement concurrentiel
(protection, veille, influence) et se différencie du renseignement traditionnel par la nature
de son champ d’application. L’intelligence économique concerne le domaine des
informations ouvertes, et exige donc le respect d’une méthode, d’une éthique.
L’intelligence économique se développe avec l’accroissement des échanges
commerciaux et la multiplication des acteurs concurrents. Elle est étroitement liée à la
libéralisation des économies et au système économique international, le capitalisme. La
construction d’une culture collective de l’information ou « coopétition » (Revel) est un
facteur essentiel de l’intelligence économique et la compétition internationale entre les
états, les entreprises et autre entités économiques a permis à la consolidation des échanges
d’information, sous de nouvelles formes.
Il devient donc essentiel pour les entités économiques de se rendre compte de
l’importance de l’intelligence économique pour contribuer à obtenir des avantages
concurrentiels et la prise en compte du management interculturel devient nécessaire pour
obtenir les meilleurs résultats. Parce que chaque économie nationale produit un modèle
propre d’intelligence économique, les acteurs économiques doivent considérer les
variations selon les pays dans lesquelles ils veulent développer leur activité.
Corps
5
1-‐ L’intelligence économique, des définitions et évolutions
Puisque l’intelligence économiques est un concept récent son interprétation et ses
définitions varient en fonction des experts et des situations des entreprises elles-mêmes.
Savant mélange entre espionnage industriel légal, veille commerciale et lobbying, l’IE
reste une notion assez récente et trop peu considérée par les entreprises. Cependant, le fait
de protéger son entreprise ou son institution d’éventuels concurrents que ce soit au niveau
de l’innovation ou bien des ressources humaines en garantissant un accès limité des
informations propres à l’entreprises permettent de garantir un certain avantage
concurrentiel nécessaire au bon fonctionnement de son organisation.
Les nouvelles technologies ont provoqué une évolution, une transformation des
méthodes liées à l’intelligence économique et les experts ne parviennent pas à trouver de
consensus quant à l’attitude à adopter pour optimiser l’IE à terme.
1.1 – Des définitions variées
Il est difficile de définir l’intelligence économique d’une manière figée, tant son
champs d’activité et ses sources sont multiples. Ainsi on peut trouver différentes
définitions selon les usages qui sont fait de l’IE, le secteur d’activité auquel on l’applique
ou bien la nature des institutions. Les différences culturelles peuvent aussi jouer un rôle
dans la définition de l’IE, selon l’accessibilité et les méthodes utilisées dans le recueil des
informations stratégiques, leur interprétation et les conséquences sur les entreprises.
1.1.1 -‐ Définition selon Henri Martre
L’intelligence économique peut être définie comme « l'ensemble des actions
coordonnées de recherche, de traitement et de distribution, en vue de son exploitation, de
l'information utile aux acteurs économiques ». Ces diverses actions sont menées
légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du
Corps
6
patrimoine de l'entreprise, dans les meilleures conditions de délais et de coûts.
L’information utile est celle dont ont besoin les différents niveaux de décision de
l’entreprise ou de la collectivité, pour élaborer et mettre en œuvre de façon cohérente la
stratégie et les tactiques nécessaires à l’atteinte des objectifs définis par l’entreprise dans
le but d'améliorer sa position dans son environnement concurrentiel. Ces actions, au sein
de l'entreprise, « s’ordonnent autour d’un cycle, générateur d’une vision partagée des
objectifs de l'entreprise. »
La définition d’Henri Martre, auteur du premier rapport sur l’IE intitulé
Intelligence économique et stratégie des entreprises publié en 1994, met l’accent sur la
nécessité d’avoir une culture d’entreprise forte qui garantie les objectifs de l’entreprise à
long terme.
1.1.2 -‐ Définition selon Christian Harbulot
« L’intelligence économique se définit comme la recherche et l’interprétation
systématique de l’information accessible à tous, afin de décrypter les intentions des
acteurs et de connaître leurs capacités. Elle comprend toutes les opérations de surveillance
de l’environnement concurrentiel (protection, veille, influence) et se différencie du
renseignement traditionnel par : la nature de son champ d’application, puisque qu’elle
concerne le domaine des informations ouvertes, et exige donc le respect d’une
déontologie crédible ; l’identité de ses acteurs, dans la mesure où l’ensemble des
personnels et de l’encadrement – et non plus seulement les experts – participent à la
construction d’une culture collective de l’information ; ses spécificités culturelles, car
chaque économie nationale produit un modèle original d’intelligence économique dont
l’impact sur les stratégies commerciales et industrielles varie selon les pays. »
Pour Christian Harbulot, ce sont les méthodes et les outils utilisés pour développer
l’IE qui jouent un rôle primordial. De plus, sa définition prends en compte les spécificités
culturelles dans la gestion de l’information et dans l’utilisation de ces informations.
Corps
7
1.1.3 -‐ Définition selon Bernard Carayon
L'intelligence économique est « une politique publique d'identification des secteurs et
des technologies stratégiques, d'organisation de la convergence des intérêts entre la sphère
publique et la sphère privée », selon Bernard Carayon. Il s’agit d’ « une politique
publique se définissant par un contenu et par le champ de son application. Le contenu vise
la sécurité économique. Il doit définir les activités que [l’entreprise] doit protéger et les
moyens que [cette dernière] se donne à cet effet. Le contenu détermine comment
accompagner les entreprises sur les marchés mondiaux, comment peser sur les
organisations internationales où s'élaborent aujourd'hui les règles juridiques et les normes
professionnelles qui s'imposent aux Etats, aux entreprises et aux citoyens. »
Dans la définition de B. Carayon, le rôle des institutions publiques dans
l’interprétation des résultats de l’IE est majeur et la prise de conscience des spécificités
techniques et culturelles se doit d’être générale et globale de la part des acteurs
économiques concernés.
1.2 – Les intérêts et usages de l’intelligence économique
L’intelligence économique telle quelle est définit aujourd’hui permet aux différent
acteurs économiques, aux entreprises d’envergure internationale de maitriser les
évolutions technologiques des concurrents, de sécuriser son patrimoine immatériel, son
savoir-faire, et d’anticiper les évolutions des secteurs concernés.
Cette notion multidisciplinaire pioche dans les domaines de la géopolitique, de la
gestion des entreprises, de l’économie, des relations internationales, des sciences
politiques, du droit et de la sociologie. Le rôle des professionnels de l’IE est de combiner
un ensemble de connaissances dans ces disciplines afin de comprendre l’environnement
dans lequel évolue l’entreprise et de prendre les bonnes décisions relatives à la prospérité
de l’activité économique. L’IE devient outil essentiel dans la veille et la gestion des
ressources de l’entité économique concernée et la maitrise des conflits interculturels ne
doit pas freiner la gestion de l’information stratégique. Les méthodes et la gestion des
Corps
8
informations sont en constante évolution et les entreprises doivent être capables de
comprendre les mécanismes qui permettent de valoriser les informations recueillies.
1.3 – Une intelligence économique numérique
Depuis l’apparition de l’informatique et de la gestion de données de manière
numérique, l’intelligence économique est devenue de plus en plus digitale ; la gestion et
la transmission des informations se fait par le biais des technologies numériques. Ainsi, la
démocratisation des équipements informatiques depuis la fin des années 1990 et
notamment dans les années 2000 a permis aux entreprises de travailler de manière plus
efficaces, aussi bien en ce qui concerne l’archivage des opérations passées que la
production de projets futurs. L’avènement des réseaux sociaux et autres aspects du web
2.0 révolutionne l’intelligence économique et les générations de professionnels de l’IE
devront compter sur les outils de communication numériques pour optimiser leur travail.
2-‐ Fonctions et usages de l’intelligence économique
L’intelligence économique permet avant tout à un acteur économique de
comprendre l’environnement dans lequel l’entreprise évolue et de veiller à ce que les
stratégies utilisées par ses concurrents ne puissent pas influer de façon négative sur son
activité. Afin de déterminer les stratégies nécessaires à l’entreprise pour prospérer dans
son secteur d’activité, il faut déterminer de façon précise les méthodes à utiliser pour
optimiser les études, recueillir les données, interpréter les résultats et agir en fonction des
conclusions des recherches. Différentes approches sont possibles, selon l’objectif à
atteindre et les ressources des entreprises ou des institutions.
Corps
9
2.1 – Quelle approche de l’IE pour quel usage ?
Selon les travaux de l’AFDIE (Association française pour le développement de
l’intelligence économique), inspirés par les idées développées aux États-Unis par la
Society of Competitive Intelligence Professionnals (SCIP), l’intelligence économique
comprend les tâches de recherche et de recueil des informations, par la veille, la recherche
documentaire et l’investigation. Viennent ensuite le traitement des informations
recueillies et l’interprétation de ces données via l’entretien de bases de données et de
savoir, à partager avec les partenaires économiques au sein de l’entreprise. Cette étape est
appelée l’administration des données et elle doit déboucher sur la formulation de
recommandations stratégiques en terme d’innovation, de conduite de projets,
d’anticipation et de maitrise des risques. Enfin la mise en œuvre des actions est la dernière
étape du schéma d’IE et cela se traduit par l’animation des réseaux d’influence (par le jeu
de la communication), la mise en place de stratégies de correction ou de prévention des
erreurs et bien sur la recherche d’une unité au sein de l’institution économique afin que
chacun des acteurs suive les mêmes recommandations.
Finalement, les évaluations des données et des changements apportées par l’étude
des effets et des pratiques économiques permettent de déterminer l’impact de l’IE sur
l’entreprise.
2.2 – Les fonctions principales de l’intelligence économique, son organisation
Les fonctions principales de l’IE sont la maitrise, la mémoire, le réseau et l’analyse
approfondie de l’environnement économique et du secteur d’activité correspondant à
l’entreprise (L'Intelligence des risques). Le réseau, fonction principale de l’IE est divisé
en différents niveaux d’influence ; le réseau externe est constitué de personnes
n'appartenant pas à l'entreprise, de provenances diverses (connaissances des employés,
clients, fournisseurs, partenaires, contacts délibérés…). Ce réseau externe est aujourd’hui
en plein développement grâce à l’avènement des réseaux sociaux et des technologies
numériques en général. En effet les influences externes des entreprises sont de plus en
Corps
10
plus impliqués dans le processus de feedback, nécessaire aux entreprises pour adapter leur
stratégie. Le réseau interne est composé des employés de l'organisation pouvant servir
d’experts sur une question, et fournir des informations nécessaires à l’obtention
d’informations et à leur interprétation. La solidité de la culture de l’entreprise ou de
l’institution est essentielle pour permettre l’efficacité de ce réseau. Plus une entreprise est
« unie », plus les données recueillies seront viables et les solutions proposées cohérentes.
La mémoire est « l’organe » de mémorisations des informations et des
connaissances explicites de l’entreprise. Il s’agit le plus souvent de bases de données
recueillies par l’entreprise elle même ou des sociétés de conseil aux entreprise. Les
métadonnées sont compatibles avec les réseaux de l’entreprise et partagées avec les
collaborateurs, en interne.
La maitrise est étroitement liée aux ressource humaines dans le sens où l’IE est au
service de l’organisation de l’entreprise. La maitrise permet de fixer les grands objectifs et
de définir, d’identifier les problèmes que l’entreprise doit résoudre pour optimiser son
activité. La maitrise des informations doit se faire dans le respects des règles
déontologiques et la maitrises des spécificités culturelles permettent la gestion la plus
efficace des informations recueillies.
Enfin, l’analyse des informations par l’entreprise doit permettre à l’entreprise de
prendre les bonnes décisions. Ce processus d’IE est renouvelable autant de fois que
nécessaire et les différentes catégories, fonctions, sont constamment liées à la gestion des
risques interculturels.
2.3 – L’intelligence économique au-‐delà de « l’économique »
Comme évoqué précédemment, l’intelligence économique vise à assurer que le
patrimoine immatériel d’une entreprise reste complet, c’est à dire en protégeant les
innovations, les savoir-faire. Il permet aussi d’assurer la veille, le lobbying et la
prospective de l’entité économique, c’est à dire son avenir économique et social.
Cependant, afin de maximiser son efficacité, les entreprises soucieuses de leur avenir
Corps
11
doivent prendre en compte différents facteurs culturels qui définissent une société, une
région ou un secteur d’activité.
On peut ainsi considérer que les experts et autres membres de la société civile,
même s’ils n’ont pas un impact immédiat sur l’entreprise peuvent influencer les
consommateurs et il est essentiel de prendre en compte ces acteurs dans les stratégies à
moyen et à long termes de l’entreprise afin d’acquérir un avantage sur ses concurrents.
L’environnement, au sens large du terme, c’est à dire les acteurs en présence, leurs
positions, les arguments défendus par les concurrents et le cadre général des circuits de
décisions (officiels et non officiels) doit également être pris en considération lorsqu’une
entreprise veut maximiser et développer sa stratégie en terme d’intelligence économique.
Les réseaux sociaux (personnels et professionnels) sont de bons outils qui permettent
d’allier veille, lobbying et communication et sont aujourd’hui utilisés par de nombreux
acteurs économiques ou non. Cela permet en effet de vérifier les tendances des marchés
mais aussi les avis des consommateurs qui ont gagné de la voix en terme de critique
produit et feedback. Ainsi, l’IE devient plus sociale qu’économique en engageant les
différents acteurs qui influencent l’activité économique.
3-‐ Le management interculturel, moteur de l’intelligence économique
Le processus d’intelligence économique étant étroitement lié à l’environnement
des entreprises, il est indispensable de prendre en compte les spécificités culturelles des
différentes régions où l’IE peut jouer un rôle. La gestion des risques interculturels se doit
d’être réalisée au cours des différentes étapes de préparation, recueil, analyse et
interprétation des données puisque les spécificités propres aux cultures des entreprises et
des pays peuvent limiter l’impact de l’IE. Les risques interculturels sont liés aux cultures
nationales ou régionales et impactent les entreprises et les acteurs économiques locaux.
En effet, les négociations et partenariats dépendent des relations entre acteurs et ces
relations peuvent être affectées par les différences et les conflits culturels. De plus, si les
Corps
12
« entreprises de culture occidentales » cherchent à développer leur activité dans un pays
dont la culture est différente il faudra adapter les méthodes de prospection et de recueil
des information, d’étude des marchés par exemple en fonction des spécificités locales.
Le rôle du négociateur interculturel est alors essentiel dans l’engagement d’un
processus d’étude et de mise en place de l’intelligence économique, depuis la veille
jusqu’au lobbying, en veillant à respecter les « codes culturels » et les coutumes locales
(Iribane : 180).
3.2 – IE, diplomatie et gestion des risques interculturels
Aujourd’hui, les états et institutions officielles chargées de la coopération et de la
diplomatie publique s’intéressent de plus en plus aux méthodes utilisées par les
professionnels de l’intelligence économique dans la gestion des risques et dans la
promotion économique. En effet, diplomatie et intelligence économique sont étroitement
liés et l’action de la France s’oriente autour de trois axes majeurs, la veille stratégique, le
soutien à la compétitivité des entreprises et des établissements de recherche, et la sécurité
économique (Blarel).
C’est sous l’autorité du MAEEM (Ministère des Affaires étrangères et
européennes) que la France mobilise son réseau d’ambassades pour contribuer à
l’intelligence économique. Ce réseau diplomatique est fondamental pour la veille
stratégique qui prend des formes multiples ; la veille politique est faite par les ambassades
et consiste à collecter des informations stratégiques pertinentes pour le gouvernement et
certaines entreprises, ayant des partenaires à l’étranger. La veille technologique et
scientifique concerne les innovations en matière de développement industriel et permet
aux entreprises françaises d’exploiter les informations collectées afin d’anticiper les
opportunités et les risques afférant au domaine scientifique et technologique. La veille sur
les normes couvre les évolutions des normes du commerce international et l’accès aux
marchés publics pour les entreprises françaises. Enfin, la veille sécuritaire garantie la
sécurité des français expatriés à l’étranger.
Corps
13
L’influence est également un élément important de la politique d’intelligence
économique de la France puisque différents programmes de soutiens à des projets
émanant d’entreprises françaises permettent d’augmenter l’impact des ces entreprises à
l’étranger, par le biais des ambassades et professionnels du commerce. De plus, le soutien
à l’exportation et à la compétitivité ainsi que la présence française au sein des
organisations internationales (FMI, OMC) est assuré par ce réseau d’ambassades.
Enfin, la question du contrôle de la formation des diplomates fait partie de la
stratégie d’IE établit par la France et les missions diplomatiques de sensibilisation des
futurs professionnels de la diplomatie préparent aux méthodes d’IE.
3.2 – Quel avenir pour l’intelligence économique ?
Afin de garantir la gestion et la pratique de l’IE dans les meilleurs conditions
possibles, les pouvoirs publics et institutions éducatives se doivent de considérer
l’enseignement des méthodes d’analyse, de recueil, de gestion et d’interprétation des
données issues de l’IE afin de garantir la compétitivité des entreprises et donc des Etats.
La formation en intelligence économique requiert un enseignement
pluridisciplinaire qui prend en compte différentes disciplines ; en effet la géopolitique, les
sciences de gestion, l’économie, les relations internationales, la sociologie les sciences
politiques et le droit sont les moteurs de l’IE. Même si la question d’une filière IE n’est
pas encore envisagée par l’Université publique ni par les institutions privées
d’enseignement supérieur en France, certains pays tels que les Etats-Unis proposent déjà
des formations spécifiques en intelligence économique, via des entreprises privées
(Google). Afin de systématiser la pratique de la veille et la mise en œuvre de dispositifs
de suretés adaptées aux entreprises, les formations universitaires doivent considérer ce
domaine, aussi bien que celui du management interculturel comme une filière d’avenir en
parfaite corrélation avec les défis économiques de notre société. L’exploitation des
opportunités et la détection des menaces qui vont à l’encontre des entreprises et des états
sont nécessaires et seuls des professionnels pourront répondre aux besoins spécifiques des
Corps
14
acteurs économiques concernés. Cependant, la volonté des pouvoirs publics et la prise de
conscience par les entreprises de la nécessité de l’amélioration de la pratique de l’IE n’est
pas encore suffisante à ce jours et les professionnels de l’intelligence économiques sont à
trop peu nombreux pour répondre aux exigences du système économique globalisé.
Conclusion
Comme nous l’avons vu au cours de ce dossier, la question de l’intelligence
économique est un aspect essentiel pour la viabilité d’une entreprise, dans une économie
de marché telle qu’aujourd’hui, où la concurrence et l’innovation jouent un rôle clé. Les
différentes définitions de l’IE montrent à quel point le concept est délicat et variable, en
fonction des cultures et des secteurs d’activités, mais aussi selon la nature de l’institution
(entreprise ou Etat).
Les méthodes de veille, d’analyse, de recherche et d’interprétation de l’intelligence
économiques se doivent d’être adaptées aux réalités économiques des sociétés et il est
plus qu’essentiel pour les professionnels de l’IE de prendre en compte les spécificités
culturelles et sociales des régions étudiés. Une entreprise doit également veiller à
posséder une culture propre afin de garantir l’obtention des meilleurs résultats et de
prendre les meilleurs décisions stratégiques, résultats de l’IE.
Enfin, on peut se demander comment les pays leaders sur le plan des échanges
commerciaux à l’international anticipent et préparent les experts en intelligence
économique de demain puisque l’offre de formation dans ce domaine pourtant essentiel
est quasi inexistant aujourd’hui.
15
Bibliographie
- Carayon, Bernard. « A armes égales ». La documentation française. Juillet 2006
- Carayon, Bernard. « Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale ». La
documentation française. Juillet 2003
- De Fontgalland, Eric. « Intelligence des marchés et développement international ».
Hermes Lavoisier. 2005
- Délégation interministérielle à l’intelligence économique. « Le Guide du routard de
l’intelligence économique ». Editions Hachette. Octobre 2012
- Harbulot, Christian. « Le manuel de l'intelligence économique », PUF, 2012
- Iribane, Philippe. « Cultures et mondialisation, Gérer par-delà les frontières ». Ed. du
Seuil, Essais. 2002
- intelligence-economique.gouv.fr
- Lacoste, Pierre. « Défense nationale et sécurité collective, les métiers de l'intelligence
économique ». Février 2006
- Martre, Henri. « Intelligence économique et stratégie des entreprises ». La
documentation françaises. Février 2004
- Marti, Yves-Michel. « L'intelligence économique : comment donner une valeur
concurrentielle à l'information ». Editions d’Organisation. 2001.
- Martinet, Bruno. « L'intelligence économique : les yeux et les oreilles de
l'entreprise ». Ed. d'Organisation, Paris 1995
- Marcon, Christian. « L’intelligence économique ». Ed. Dunod. Septembre 2006
- Besson, Bernard. Jean Claude Possin. « L'Intelligence des risques : Sécurité, Sûreté,
Management, Environnement ». Ed. IFIE, 2006.
- Revel, Claude. « Nous et le reste du monde : Les vrais atouts de la France dans la
mondialisation », Éditions Saint-Simon, 2008,
- Violet-Surcouf, Antoine. « Influence et Réputation sur Internet : communautés,
crises et stratégies ». La Bourdonnaye, 2013.