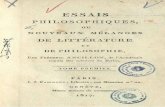L'industrialisation du Cameroun : 50 ans d'une méthode des essais et erreurs
-
Upload
univ-dschang -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of L'industrialisation du Cameroun : 50 ans d'une méthode des essais et erreurs
L’industrialisation du Cameroun : 50 ans d’une méthode des essais et erreurs
Moïse Williams POKAM KAMDEM
FLSH – Université de Dschang
Pour citer cet article :
Moïse Williams Pokam Kamdem, (2013), « L’industrialisation du Cameroun : 50 ans d’une méthode
des essais et erreurs », in A. Fomethe (dir), Cinquantenaire de l’indépendance et de la Réunification du
Cameroun. Bilan, enjeux et perspectives. Actes du Colloque de Dschang, 10-12 mai 2010, Dschang, Presses
Universitaires de Dschang, pp.304-333.
Résumé
L’objectif de cette communication est d’étudier les stratégies d’industrialisation du
Cameroun depuis les années 1960. L’industrialisation reste un leitmotiv pour l’Afrique et le
Cameroun notamment, puisqu’elle est présentée comme la voie obligée pour atteindre la
modernité et le développement. Le constat, peu reluisant, est que les efforts déployés ces
dernières décennies n’ont pas permis de faire du Cameroun un pays industrialisé. Les
politiques et les projets élaborés dans ce sens n’ont pourtant pas fait défaut.
Cette étude fait d’abord ressortir les implications qu’il y a à construire et à multiplier
des modèles d’industrialisation, donc à légitimer l’erreur dans la conduite de ce processus. Elle
établit également que, d’une part, les stratégies d’industrialisation du Cameroun sont jusqu’à
nos jours une somme d’essais aux résultats mitigés et que, d’autre part, le Cameroun continue à
rechercher sa voie dans le domaine industriel.
Mots clés : Cameroun, industrialisation, stratégies, politique industrielle, essais et erreurs.
INTRODUCTION
L’Europe a mis bien plus d’un siècle pour s’industrialiser. L’essor des Nouveaux Pays
Industrialisés (NPI), quoique présenté comme fulgurant, n’en est pas moins le résultat d’un
processus long.1 Cinquante ans d’indépendance suffisent-ils alors pour s’interroger sur
l’industrialisation du Cameroun, voire de l’Afrique ? Il faut pourtant se convaincre de ce qu’un
État n’est pas assez jeune pour évaluer des politiques qu’il a mis en œuvre.
L’industrialisation reste un leitmotiv pour le Cameroun comme pour l’Afrique depuis
un demi siècle où elle demeure présentée par les politiques et par des analystes comme la voie
obligée pour atteindre la modernité et le développement. Ceci justifie la place qu’elle tient dans
les discours et les programmes. Andrew Kamarck écrivait en 1968 déjà que « la plupart des
gouvernements africains qui veulent essayer d’industrialiser leur pays le plus vite possible ont
1 On a évoqué de façon lyrique un « envol des oies sauvages vers le soleil levant » pour décrire l’industrialisation rapide des NPI d’Asie du sud-est. Par ailleurs, la littérature abonde sur l’histoire économique de ces pays, nouveaux modèles d’industrialisation ; lire notamment Jean-Christophe Simon, (1991), « L’impératif industriel et la dynamique du développement », in Philippe Bonnefond, (éd.), Modèles de développement et économie réelle, Chronique du Sud, pp.57-65 ; Elisabeth De La Taille, (2001), « Les stratégies de développement industriel des pays du sud : les leçons de l’expérience mexicaine », Cahiers de recherche, n°2, Université de Toulouse 1; Julien Miannay, (2008), « L’industrialisation des pays émergents : autonomie de l’émergence ou émergence d’une nouvelle dépendance », communication au Colloque « L’émergence : des trajectoires au concept ? », Bordeaux, 27-28 novembre.
des intentions excellentes. »2 Pourtant, poursuivait-il, « l’industrialisation est encore très loin
pour la plupart des pays africains. Mais cela ne change rien à la nécessité pour l’Afrique de se
rapprocher le plus possible de ce but. »3 Alors, comment comprendre cette obsession pour
l’industrialisation ? Peut-être, comme le souligne Touna Mama, parce qu’il existe un lien étroit,
une « forte corrélation », entre le sous-développement et la sous-industrialisation.4 Par
conséquent, s’industrialiser reviendrait à se développer. D’ailleurs, les stratégies de
développement et d’industrialisation se confondent aisément. L’industrialisation est toute à la
fois « un slogan, un mythe, une stratégie et un programme mobilisateur. »5 Voilà pourquoi
depuis cinquante ans, au Cameroun notamment, cette question reste cruciale.
On pourrait, à partir de là, proposer un bilan matériel et une description sectorielle de
ce processus. Notre objectif est, par contre, de porter un regard sur les stratégies
d’industrialisation appliquées par le Cameroun. Il est donc de retracer, de faire un bilan des
choix qui ont conduit à un bilan matériel et sectoriel mitigé et faire alors l’histoire de cinquante
ans d’une tentative d’industrialiser le Cameroun, avec ses acquis et surtout ses erreurs.
Ce bilan s’articule autour de deux moments. Le premier, compris entre 1960 et 1986, se
focalise sur les stratégies d’industrialisation au cours de la période de planification. Le deuxième
quant à lui, entamé depuis 1986, présente les stratégies d’industrialisation du Cameroun sous
ajustement. Nous ne nous priverons pas de préciser, tout d’abord, le rapport que nous
établissons dans cette communication entre l’industrialisation et la méthode des essais et
erreurs.
I. L’industrialisation par essais et erreurs
Il semble, en scrutant l’histoire économique du XXe siècle, que l’industrialisation soit un
processus essentiellement reproductible : toute expérience d’industrialisation paraît s’inspirer
d’une expérience antérieure. Les économistes suggèrent ainsi une pléthore de stratégies. Ils
soulèvent le caractère inopérant des stratégies rivales ; ils mettent en exergue les expériences
2 Andrew Kamarck, (1968), Le développement économique en Afrique, Paris, Les Éditions Internationales, p.155.
3 Ibid.
4 Touna Mama, (1996), Crise économique et politique de déréglementation au Cameroun, Paris, Éditions L’Harmattan, p.93. Le président Paul Biya déclarait ainsi par exemple que « Le Cameroun ne saurait rester éternellement un pays exclusivement agricole. Le moment nous semble donc venu de nous doter d’une véritable "boussole" permettant de conduire de manière méthodique et rationnelle l’industrialisation de notre pays », cité par ONUDI, (2002), Pour une nouvelle politique industrielle au Cameroun, p.12.
5 Jean-Christophe Simon, (1991), « L’impératif industriel et la dynamique du développement »…, p.57.
réussies dans quelque pays et en font des modèles. On pourrait conclure alors, que, dans le
domaine de l’industrialisation également, il n’y ait rien de nouveau sous le ciel. Mais quelle
stratégie adopter ? Yves Carsalade recense « les trois stratégies » auxquelles on recourt à travers le
monde : l’industrialisation par substitution d’importations (ce fut le cas en Amérique latine
dans les années 1930 et en Asie du sud dans la décennie 1950) ; l’industrialisation par
promotion des exportations (par laquelle se sont distingués les pays d’Asie du sud-est et
d’Amérique latine au cours des années 1960) ; les industries industrialisantes (notamment dans
les pays socialistes, l’Algérie et en Inde).6
Si donc l’industrialisation est reproductible, alors les États jeunes qui y aspirent doivent
recourir à un apprentissage. C’est fort de cet argument que dans leurs travaux, de nombreux
auteurs s’érigent en pédagogues de l’industrialisation : il faut apprendre et se rapprocher de
ceux qui ont réussi, peut-on lire en substance. Réfléchissant par exemple sur la stratégie de
développement à adopter par les pays africains, un économiste japonais note ainsi que ceux-ci
« devraient donc étudier précisément comment les pays extrême-orientaux ont procédé »7…
Dans cette logique d’apprentissage, la probabilité des erreurs est aussi élevée que celle des essais.
Comment donc expliquer la persistance, et même dans certains cas l’aggravation de la
sous-industrialisation dans des pays du sud ? Par la conjoncture internationale défavorable ? Par
le contenu inadapté que ces pays ont donné à ces stratégies classiques ? Par la qualité
approximative de leur mise en œuvre ? Ou par le caractère inopérant de stratégies prescrites à
des pays comme des remèdes-miracle pour éradiquer la sous-industrialisation et le sous-
développement ? Ces différents éléments entrent en ligne de compte. Il faudrait néanmoins
relever la vision et la démarche simpliste que le monde occidental a des réalités extérieures à lui,
8 ainsi que les dangers qui en découlent.
On a dans tous les cas l’impression en relisant Susumu Watanabé, soit qu’il décline la
vision japonaise du développement de l’Afrique, soit qu’il évoque celle de la Banque mondiale,
que les stratégies récemment proposées aux pays africains (import-substitution, promotion des
6 Yves Carsalade, (2002), Les grandes étapes de l’histoire économique : revisiter le passé pour comprendre le présent et anticiper l’avenir, Palaiseau, Éditions École Polytechnique, p.258.
7 Susumu Watanabe, (1997), « Quo vadis Africa ? La stratégie de développement de la Banque mondiale vue par le Japon », in Tiers-monde, vol. 38, n° 150, p.327. C’est nous qui soulignons. Il n’est d’ailleurs pas le seul à le penser ; S.K.B. Asante et David Chanaiwa, (1998), mentionnent par exemple que « la tentative d’intégration de l’Asie du Sud-Est mérite d’être soigneusement examinée par les Africains », p.281.
8 Voir Béatrice Hibou, (1998), « Banque mondiale : les méfaits du catéchisme économique. L’exemple de l’Afrique subsaharienne », in Esprit, n° 245, août - septembre, pp.101-111.
exportations, révolution agro-industrielle, interventionnisme, libéralisme …)9 ont déjà été
expérimentées au Cameroun sans jamais concrétiser ses tentatives d’industrialisation. Ce qui est
d’usage est qu’on applique pendant quelques années une « solution » économique et
industrielle venue d’ailleurs ; dès que la solution s’avère inopérante voire dangereuse pour
l’économie et l’État, une autre est proposée, avec des effets similaires si non plus graves.
Comment encore ne pas accréditer la thèse de cette inadaptation des stratégies
recommandées aux pays du sud si leur lecture est elle-même sujette à controverse ? S’agissant
ainsi de l’analyse de l’industrialisation-modèle des NPI, Jean-Christophe Simon relève :
Pour les économistes radicaux on était devant un phénomène unique et accidentel d’industrialisation avancée mais dépendante, de l’autre côté chez les libéraux on était persuadé d’avoir là un cas classique de développement selon les lois des avantages comparatifs et de la régulation par un marché efficace…10 La profusion de stratégies d’industrialisation défendues avec un prosélytisme
idéologique et économique très actif permet donc de considérer que l’industrialisation des pays
lancés aux trousses du développement soit le résultat d’une méthode des essais et erreurs. Cette
méthode, utilisée en sciences de l’éducation, en sciences expérimentales et en sciences sociales,
suppose que le plus important lorsqu’on trébuche soit de pouvoir se relever. L’essai précède
l’erreur, affirmait Karl Popper.11 L’histoire économique récente, elle-même, viendrait à la
rescousse de cette démarche : les pays qui défendent aujourd’hui le libre-échange ont, à
différentes périodes, eu recours au protectionnisme (les États-unis, l’Angleterre, la Corée du
sud…). Les NPI, avant d’être érigés en modèle de la stratégie de promotion des exportations,
ont pour certains expérimenté la stratégie de l’import-substitution.12
Il faut tout de même relever que, faire de l’industrialisation un processus jonché d’essais
et erreurs implique que des leçons en soient tirées. En la matière, puisqu’il s’agit de politique
industrielle, on sait qui en est le chef d’orchestre et qui en sont les concepteurs. Si
l’industrialisation devient un projet de société, si l’on en fait un enjeu électoral, alors le droit à
9 Susumu Watanabe, (1997), « Quo vadis Africa ? »…, pp.311-330.
10 Jean-Christophe. Simon, (1991), « L’impératif industriel et la dynamique du développement »…, p.58.
11 Karl Popper, (1955), Misère de l’historicisme, cité par Bernard Dantier, (2004), « Karl Popper : "Les théories et leur priorité sur l’observation et l’expérimentation"», consulté le 27.04.2010. URL : classiques.uqac.ca/…/popper...karl/…Metho_Popper_Karl.pdf. On considère par exemple que l’enfant qui apprend à marcher procède par essais et erreurs : imitant les plus grands, il se met debout, essaye de faire un pas ; expérimente les contraintes de la pesanteur ; tombe ; se relève ; essaye à nouveau, jusqu’à trouver son équilibre et à se déplacer en tenant sur ses pieds.
12 C’est le cas du Brésil qui a expérimenté la stratégie de l’import-substitution de 1950 à 1976 avant d’y substituer celle de la promotion des exportations dès 1976.
l’erreur doit être légitimement mis en cause.13 Tout projet industriel a, en effet, une incidence
sociale et économique considérable ; par conséquent, il faut que quelqu’un en soit comptable.
Le Cameroun s’est lancé depuis cinquante ans dans une course qui devrait le conduire
au stade de pays industrialisé. Ce processus a connu ses moments d’illusions et de désillusion,
d’enchantement et de désenchantement.14
II. Les stratégies d’industrialisation du Cameroun sous la planification
La première période de l’industrialisation s’ouvre après l’indépendance de la partie
française du Cameroun ; mais évidemment, on ne peut pas ignorer l’héritage colonial ; car, à
juste titre, l’industrialisation du Cameroun indépendant a été conditionnée par cet héritage.
A. L’héritage colonial
De 1946 à 1959, la France colonisatrice a élaboré et appliqué, au Cameroun
notamment, les plans FIDES. Ces plans ont permis de mettre en place le noyau industriel du
Cameroun, concentré autour des villes de Douala et d’Édéa. De fait, la présence européenne
dans cette colonie de fait15 avait de forts relents économiques. Aussi, le Cameroun, pour
répondre à une division internationale du travail déjà en cours, poussait sa spécialisation dans
la fourniture à la métropole de matières premières. Au nom du pacte colonial, la France se
réservait en retour l’exclusivité de la fourniture des biens d’équipement au Cameroun. Il est
utile de relever la place de l’économie des plantations dans ce système d’exploitation, d’autant
plus que cette économie a engendré, au cours de la période post-coloniale, des complexes agro-
industriels, trait distinctif des États ex-colonies ; nous en dirons encore un mot.
C’est aussi dans cette logique d’exploitation, de mise en valeur, que le cœur du projet
d’industrialisation du Cameroun français, à savoir le barrage et la centrale hydroélectrique
¢¢¢ 13 S’agissant par exemple du projet de constitution de l’entreprise CELLUCAM, un analyste notait en 1981 que « Pour une industrie aussi lourde, le droit à l’erreur n’existe pas », nécessairement du fait de la nature de l’activité, de son coût financier et des objectifs socioéconomiques qui étaient assignés au projet ; J.J. Renard, (1981), « L’industrie du papier dans les pays en voie de développement », Industries et travaux d’outre-mer, p.514, cité par Jean Claude Willame, (1985), « Cameroun : les avatars d’un libéralisme planifié », in Politique africaine, n°18, p.62.
14 Alain Boutat, (1991), Technologies et développement au Cameroun : le rendez-vous manqué, Paris, Éditions L’Harmattan, p.205.
15 Le Cameroun a certes été, tour à tour, un protectorat allemand, un territoire sous mandat de la Société des Nations avec la double administration britannique et française, puis un territoire sous tutelle des Nations Unies avec la double administration britannique et française. Il n’en a pas moins subi les affres du colonialisme européen.
d’Édéa, fut construit à partir de 1949. Il était voué à vivifier le capital français à travers
l’implantation et le fonctionnement de l’entreprise Aluminium du Cameroun (ALUCAM).
L’histoire de cette centrale à elle seule reflète la ruse coloniale.16 Initialement, le plan
d’équipement du Cameroun (1946) prévoyait la construction d’un important nombre
d’usines.17 Au début des années 1950, la production énergétique était déjà opérationnelle. Tous
les projets industriels contenus dans le plan d’équipement furent pourtant reportés.
L’administration française entreprit alors de « réfléchir » au moyen d’utiliser le formidable
potentiel hydroélectrique d’Édéa. Une convention fut passée en 1951 avec la société française
d’électrochimie, Ugine, pour étudier les diverses possibilités d’utilisation des excédents
d’énergie par des industries de transformation.
La ruse de cette opération est évidente : la société Ugine collaborait depuis 1942 avec la
société Péchiney pour implanter un complexe métallurgique en Afrique. Le Cameroun offrait la
ressource hydroélectrique nécessaire au montage d’un projet aussi lourd. Ce fut donc sans
surprise qu’ALUCAM, émanation de Péchiney-Ugine, reçut l’approbation des autorités
françaises et démarra ses activités en 1957, après avoir été créée trois années plus tôt. En
implantant cette unité de transformation au Cameroun, la France présenta cette initiative
comme la preuve de sa volonté d’industrialiser ses territoires outre-mer. Il n’en était rien :
d’abord, parce que ALUCAM n’avait pas d’effets d’entraînement sur le reste de l’économie
camerounaise18 ; ensuite, parce que cette économie, comme celles des autres pays sous influence
coloniale, s’enracinait dans l’économie de traite.
Par ailleurs, pour se placer dans une logique globale de l’industrialisation avant
l’indépendance et les enjeux après-indépendance, comment ne pas reprendre ces mots d’un
personnage proche des milieux industriels français qui déclarait en 1959 :
Quelle solution restera-t-il à la présence française dans une indépendance [de ses territoires d’outre-mer], sinon l’implantation économique ? C’est en vendant français, c’est en imposant du matériel
16 Voir Maurice Laparra, (2002), « Enelcam – Alucam. L’énergie hydroélectrique du Cameroun à la rencontre de l’aluminium », in Dominique Barjot et al, L’électrification outre-mer de la fin du XIXe siècle aux premières décolonisations, Paris, publications de la Société française d’histoire d’outre-mer/La Fondation EDF, pp.177-200.
17 Williams Pokam Kamdem, (2007), « L’énergie dans le processus de mise en valeur du Cameroun français : 1946-1959 », mémoire de maîtrise en Histoire, Université de Yaoundé 1, p.49. On retrouve parmi ces projets industriels des usines de pâte à papier, de chlore, de chlorate, de méthanol, de chaux et de ciment.
18 Philippe Hugon, (1968), Analyse du sous-développement en Afrique noire. L’exemple de l’économie du Cameroun, Paris, PUF, pp.120-121. L’auteur en arrive à cette conclusion en relevant que les centres de décision d’ALUCAM étaient situés hors du Cameroun, que la matière première était importée tandis que la production, elle, était exportée.
français, c’est en créant une industrie nouvelle française en Afrique que nous resterons en Afrique…19 Cette volonté évidente de générer des dépendances s’est concrétisée, puisqu’au
lendemain de leur indépendance, les pays de l’aire française dépendaient en grande partie de la
métropole pour la fourniture des biens d’équipement ; pièces de rechange comprises. La France
continue d’ailleurs d’occuper une place importante dans les flux commerciaux de ces pays, bien
qu’elle ait pris de sérieux coups avec l’entrée en scène de nouveaux acteurs, à l’instar de la
Chine et de l’Inde.20
La France et son administration quittaient le Cameroun aux premières heures de
l’année 1960. Ses intérêts économiques y restaient cependant solidement implantés
L’indépendance politique, nominale, n’avait pas été complétée d’une indépendance
économique21 : les structures économiques, rigides par définition et héritées du passé colonial,
prédestinaient le Cameroun à continuer de contribuer fidèlement au bien-être de la métropole,
au risque d’hypothéquer le sien.
L’industrialisation du Cameroun indépendant débutait donc sous le sceau français,
résolument tournée vers la satisfaction de besoins extérieurs.
B. Le goût de l’import-substitution
Dès l’indépendance de la partie française du territoire, le Cameroun choisit de
perpétuer la planification initiée par la France. C’est dans cette optique que débutent les plans
quinquennaux. La stratégie de développement du Cameroun est complétée par le libéralisme
planifié, lancée en 1965 par le président Ahidjo.22 S’appuyant sur la planification déjà en cours,
elle tentait de faire la synthèse entre le capitalisme et le socialisme en accordant la priorité à
l’agriculture et à l’agro-industrie. L’État encourageait l’initiative privée mais restait le seul à
définir les objectifs à atteindre en termes d’infrastructures et d’investissements.
19 Jacques Marseille, (2005), Empire colonial et capitalisme français : histoire d’un divorce, Paris, Albin Michel, p.346.
20 L’actualité et l’intérêt de cette question sont bien perceptibles à travers la récente publication, par Fantu Cheru et Cyril Obi, de l’ouvrage The Rise of China and India in Africa: Challenges, Opportunities and Critical Interventions, Zed Books, 2010, 272p.
21 Philippe Hugon, (1968), Analyse du sous-développement…, p.16.
22 Il déclarait cette année-là que « Nous sommes donc pour le libéralisme, un libéralisme moderne, planifié, donc tempéré par l’action régulatrice de l’État ».
La préparation du premier plan quinquennal (1960-1965), dont les résultats ont été
mitigés, avait été confiée à des experts étrangers. Le Cameroun choisit pour son
industrialisation l’option d’attirer les compétences et les capitaux étrangers. La politique
industrielle était alors clairement orientée vers la substitution des importations par des
productions locales. C’est la stratégie de l’import-substitution dont on sait qu’elle fut un
leitmotiv tiers-mondiste des années 1960. Dès l’indépendance, le Cameroun mit en œuvre cette
stratégie de développement industriel en protégeant le marché intérieur par des barrières
tarifaires et des restrictions quantitatives. Une ambition louable qui n’est pas sans rappeler le
protectionnisme colonial qui avait si savamment mis à mal la liberté commerciale dans les
colonies.
Une batterie de mesures était donc adoptée. Elle visait à attirer les investisseurs
étrangers, le Cameroun ne disposant encore ni du capital nécessaire, ni de la main-d’œuvre
qualifiée. On cite parmi ces mesures la mise en place du code des investissements, qui prévoyait
des exonérations fiscales et douanières en faveur des entreprises qui s’implanteraient au
Cameroun, et l’adhésion du Cameroun à l’Union Douanière et Économique des États de
l’Afrique Centrale (UDEAC), avec l’intention d’ouvrir le marché sous-régional aux industriels
installés au Cameroun.
Le peu de littérature officiel sur le premier plan quinquennal montre à l’évidence que
celui-ci avait été loin de combler les attentes et aussi que la Réunification en 1961 avait rendu
inadaptées ces prévisions. Quelques réorientations faites au cours du deuxième plan (1966-
1971) n’ont pas changé grand-chose, la politique d’import-substitution ayant du mal à être
appliquée. On note néanmoins le démarrage des activités de quelques unités de production
industrielle comme la Cotonnière Industrielle du Cameroun (CICAM) en 1966 et la Société
Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) en 1967.
Les résultats peu probants de cette première phase d’import-substitution ont été
implicitement reconnus par l’État, puisqu’en 1971, le troisième plan annonçait une nette
rupture dans la stratégie d’industrialisation du Cameroun. Ce nouveau plan quinquennal avait
d’ailleurs été baptisé « Plan de la production et de la productivité ». Il avait l’ambition de
réorienter la politique d’industrialisation du Cameroun en insistant sur la création et
l’extension des industries de transformation pour la consommation finale, ainsi que des
industries productrices de biens intermédiaires.23 Cette volonté de rupture s’est prolongée sous
le quatrième plan, jusqu’en 1986.
Désormais, le financement public des projets retenus dans les plans diminuait (de 64 %
du financement total du deuxième plan à 51,6 % du financement du troisième plan).24 L’État
camerounais n’hésitait plus cependant à investir directement dans la production et les services,
multipliant au passage les prises de participation au sein des unités industrielles qui se
constituaient.
C. L’ère des « éléphants-blancs » ou le temps du décollage industriel
Du milieu de la décennie 1970 à celui des années 1980, le politique voulait substituer le
rêve de voir les Camerounais maîtres de leur propre développement industriel à celui d’un
investissement étranger qui tardait à se manifester. Le Centre d’Assistance aux Petites et
Moyennes Entreprises (CAPME) créé dès 1970 et le Fonds d’Aide et de Garantie aux PME
(FOGAPE) constitué en 1975, sont jetés dans la bataille, au même titre que la Société
Nationale d’Investissement (SNI) qui s’employait depuis 1964 à promouvoir l’investissement
étranger au Cameroun. L’État entre pleinement en scène, encouragé par des courants
économiques et des hommes d’affaires européens porteurs de projets d’usine clé en main.25
C’est la période faste où tout semble réussir au Cameroun. C’est le temps de l’État-
magicien irrésistiblement transporté dans le monde merveilleux de l’interventionnisme. Est-ce
les vertus de la nouvelle stratégie de développement que lance le président Ahidjo en février
1975 lors du Congrès de Douala qualifié de « Congrès de la maturité » ? Cette nouvelle
stratégie, faisant référence à un développement autocentré, venait compléter le libéralisme
planifié en recadrant ses ambitions. Elle visait à développer le Cameroun en s’appuyant
23 Diane Tcheumeni, (2005), « La politique industrielle du Cameroun. Essai d’analyse historique (1960-2000) », Mémoire de maîtrise en Histoire, Université de Yaoundé I, p.34. Il faudrait néanmoins tempérer l’idée d’aboutissement que l’on se fait de cette période : le troisième plan notamment ne réalisa qu’une faible part de ses ambitions. Comme le relève Yves Morel, des 70 milliards de F.CFA d’investissements prévus au cours de ce plan, seuls 29 milliards furent réalisés. 14 300 emplois industriels auraient dû être créés ; seuls 5 000 l’ont été (Morel, 1978 : 181).
24 Yves Morel, (1978), Tableaux économiques du Cameroun, Douala, Collège Libermann, p.178.
25 Il serait par exemple intéressant de s’intéresser au rôle du capital français dans le choix et la constitution des agro-industries au Cameroun ; c’est notamment le cas des Grands Moulins de Paris (GMP), dont J.C. Willame disait le patron proche du président Ahidjo.
davantage sur ses propres ressources et moins sur les appuis extérieurs.26 C’est également une
période marquée par un discours politique très étayé, presque savoureux. Elle inaugure la
Révolution verte ; elle engendre aussi les géants de l’agro-industrie.27
L’agro-industrie au Cameroun est, nous l’avons déjà souligné, une émanation du passé
colonial : du protectorat allemand à la Réunification des parties anglaise et française de ce pays,
il est aisé d’en déceler la trame. L’économie des plantations est ainsi restée une constante dans
le système d’exploitation colonial, substituant de vastes espaces culturaux à des plantations
familiales voire communautaires qui, à l’évidence, ne pouvaient relever le défi de la production
de masse et de l’approvisionnement du marché européen. Le colonisateur s’imaginait
certainement que l’inefficacité des cultivateurs indigènes ne pouvait être corrigée que par la
rigueur dans l’organisation et la gestion de vastes plantations, ainsi que par l’assimilation de
techniques et de cultures nouvelles. Pour devenir rentable, il fallait atteindre la limite fragile
entre l’intensif et l’extensif. L’envergure de la Gesellschaft Süd Kamerun, de la Gesellschaft
Nordwest Kamerun, de la Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft, de la Cameroon Development
Corporation (CDC) ou de la Société africaine forestière et agricole (SAFA), donne une idée de ce
qu’a constitué cette économie coloniale des plantations.
L’idée d’une incapacité de la paysannerie à se diversifier et à augmenter sa production
est également à la source de la création des agro-industries après l’indépendance.28 Le but de ce
vaste programme était, en effet, de :
substituer à l’agriculture traditionnelle, considérée comme incapable de faire face aux besoins croissants d’une population de plus en plus urbaine, de grands projets qui, accessoirement, génèreraient une couche de techniciens et d’administrateurs favorables par ce biais aux orientations du régime.29 Ainsi naissent la Société Camerounaise des Engrais (SOCAME) en 1973, la Cameroon
Sugar Company (CAMSUCO) et la Société de Développement du Blé (SODEBLE) en 1975, la
mémorable Cellulose du Cameroun (CELLUCAM) en 1976… Une file de mastodontes
26 Véritable slogan, malgré les bonnes intentions du politique, cette nouvelle stratégie de développement ne visait qu’à retourner une conjoncture qui avait maintenu les investisseurs étrangers loin du Cameroun, pendant plus d’une décennie, et qui avait en partie mis en échec le libéralisme planifié et la stratégie de l’import-substitution.
27 Voir notamment Georges Courade, (1993), « La constitution d’empires agro-industriels étatiques depuis l’indépendance au Cameroun : politique de développement rural et / ou national ? », in African Economic History, n°12, pp.33-48.
28 Piet Konings (1986), « L’État, l‘agro-industrie et la paysannerie au Cameroun », in Politique africaine, n°22, juin, p.120.
29 Philippe Dessouane, Patrice Verre (1986), « Cameroun : du développement autocentré au national-libéralisme », in Politique africaine, n°22, juin, p.114.
traversait le paysage industriel du Cameroun. Contenus dans le secteur agro-industriel et agro-
forestier, à l’exception notable de la Société Nationale de Raffinage (SONARA) qui constitue à
elle seule l’orgueil pétrolier national, ces éléphants ont été érigés en symbole du décollage
industriel au cours de la décennie 1975-1985 (Cf. tableau 1).
Certains y auraient néanmoins préféré la promotion des petites et moyennes
entreprises/petites et moyennes industries (PME/PMI). Alain Boutat se réjouissait ainsi : « Un
effort particulier mérite toutefois d’être salué : l’option récente consistant à développer les
petites et moyennes entreprises [au Cameroun] ».30 Le code des investissements de 1984
encourageait, en effet, la création des PME/PMI et en faisait la base du développement
industriel, donnant raison à ceux qui estimaient que les géants de l’agro-industrie n’étaient que
de vaines espérances. La seconde moitié de la décennie 1980 a été, d’un certain point de vue,
consacré à ces PME/PMI, aussi bien dans les aménagements du code des investissements que
dans le discours politique.31 Leur réussite, elle aussi, n’a été qu’une vaine espérance.
Cette phase d’interventionnisme de l’État donna néanmoins l’impression que le
Cameroun avait entamé durablement son développement industriel. Les indications des
organisations internationales en faisaient d’ailleurs un pays à revenu intermédiaire jusqu’au
milieu des années 1980, solidement ancré dans une économie moderne. On n’hésitait pas à
parler du « miracle camerounais ». La tonalité des analyses sur le Cameroun changea cependant
dès la fin de la décennie 1980. Le verdict était plutôt dur :
Quoique considérés comme des pays "à revenu intermédiaire", martela par exemple Marc Raffinot, des pays comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun ou le Congo ne sont en rien comparables aux pays "à revenu intermédiaire" d’Amérique latine. Il y a une différence de structure économique fondamentale entre un pays "primaire exportateur", même doté de revenus appréciables, et un pays semi-industrialisé.32 Le décollage industriel du Cameroun n’était-il donc que de façade ? Ne s’agissait-il que
d’une simple illusion, malgré l’élargissement du secteur industriel ? La réponse par l’affirmative
devrait être privilégiée. Les choix du Cameroun étaient remis en cause, une fois de plus : ses
prouesses industrielles ne lui avaient pas permis de se sortir de sa dépendance structurelle vis-à-
vis de l’extérieur et le confinait à des tâches de fournisseur de produits primaires, à peine
30 Alain Boutat, (1991), Technologies et développement au Cameroun…, p.205.
31 « Nous avons encouragé les PME/PMI parce que c’est un secteur productif, déclarait le président Biya en 1989. Nous voulons que les Camerounais soient essentiellement productifs au lieu que la plupart cherchent à se concentrer dans le commerce qui est au fond, une activité certes utile, mais spéculative ». Cité par Diane Tcheumeni, (2005), « La politique industrielle du Cameroun »…, p.99.
32 Marc Raffinot, (1991), Dette extérieure et ajustement structurel, EDICEF, p.15.
transformés. L’industrialisation était bâtie autour d’une agro-industrie essentiellement rentière
et sensible aux variations des cours mondiaux.33
Une somme d’erreurs de politique économique et industrielle, amplifiée par une
conjoncture mondiale caractérisée par le choc et le contre-choc pétroliers ainsi que par la
détérioration des cours internationaux des produits primaires, - il faut y ajouter les errements de
certains gestionnaires - fit basculer le Cameroun dans la crise, véritablement en 1987.
L’industrie allait en souffrir, au même titre que l’économie nationale et les populations.
III. Les stratégies d’industrialisation du Cameroun sous ajustement
Y a-t-il meilleure stratégie que l’ajustement pour tenter de résorber une récession, voire
une crise ? C’est en tout cas la stratégie que le Cameroun adopta au milieu de la décennie 1980,
lorsque les difficultés économiques s’accumulèrent.
A. L’industrie camerounaise dans la crise
La crise de l’industrie au Cameroun est complexe, dans ses facteurs et dans ses effets.
L’étude publiée en 1993, conjointement par le groupement de recherche français DIAL
(Développement des Investigations sur l’Ajustement à Long terme) et la Direction
camerounaise de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DSCN), donne une vue
intéressante de ce second aspect. Nous ne nous privons pas d’en citer un extrait, long mais
édifiant :
Entre 1984 et 1991, l’industrie moderne camerounaise dans son ensemble a connu une intense récession. En 1992 la crise s’approfondit, n’épargnant désormais presque aucun secteur. A l’exception notable du bois, les exportations semi-transformées ont beaucoup de mal à surmonter les effets de la baisse des principales matières premières, et résistent à peine mieux que les secteurs orientés vers le marché intérieur ou régional. L’agro-alimentaire, le secteur le plus à l’abri de la concurrence étrangère, a été de ce fait un peu moins touché que l’industrie manufacturière, du moins jusqu’à la dernière période. Par contre, le secteur des biens de consommation manufacturés, qui est aussi le plus exposé parce qu’il ne bénéficie ni de la proximité de ressources ni de protections naturelles, subit une régression d’ampleur considérable, sous les effets cumulés de la concurrence nigériane et de la chute du revenu national.34 La situation était donc loin d’être enviable pour les industriels, y compris l’État. Dans
un environnement économique international qui avait désormais pris les couleurs du
libéralisme, l’État interventionniste est vite mis au banc des accusés. On lui fait notamment le
33 Diane Tcheumeni, (2005), « La politique industrielle du Cameroun »…, p.65.
34 DIAL-DSCN, (1993), L’industrie camerounaise dans la crise 1984-1992, novembre, p.1.
reproche de s’être trop impliqué dans le développement industriel. On ne manque pas de
pointer du doigt son goût pour l’agro-industrie. Le procès contre l’État tourne alors à un procès
contre les géants de la Révolution verte ; les « éléphants-blancs ». Njoh Mouelle relève que
mastodontes étaient des « réalisations de projets d’usines clef-en-mains, précédées par aucune ou
peu d’études sérieuses de l’environnement technico-scientifique tout comme de la viabilité
économique des dits projets. »35 Cette période d’entrepreneuriat étatique est perçue comme une
phase de surchauffe techno-industrielle par Jean Claude Willame. Ses conséquences sont
importantes : d’abord, une maîtrise peu avérée des technologies importées36, des problèmes de
gestion et surtout l’endettement extérieur. Le graphique suivant illustre cette situation.
Graphique 1 : Évolution de la dette extérieure du Cameroun de 1973 à 1983 (en
millions de dollar US)
Source : Jeune Afrique Économique, n°56, décembre 1984, repris par Jean Claude Willame, (1985), « Cameroun : les avatars d’un libéralisme planifié », in Politique africaine, n°18, p.69.
35 Ebénézer Njoh Mouelle, « Le transfert de technologies et la question de la créativité », consulté le 03.05.2010. URL : www njohmouelle.org/actu/20090323200634.pdf. Les études sur la question concluent à l’inadéquation entre ces réalisations industrielles et leur environnement d’implantation : études de faisabilité légères ; calculs politiciens, favoritisme avéré, gestion inacceptable…
36 Philippe Hugon (1968 : p.16) estimait ainsi que « Le Cameroun a importé d’Europe les techniques sans pour autant assimiler la mentalité qui en est la cause ». Dans une analyse plus globale, Ha-Joon Chang commentait, au sujet des résultats de la stratégie de l’import-substitution par les pays du sud, que « avant de fabriquer des autos, il faut commencer par faire des tee-shirts : des productions où une technologie simple se combine avec une main-d’œuvre peu qualifiée. » Ha-Joon Chang, (2005), « Le libéralisme garantit l’échec du Sud », entretien, consulté le 27.04.2010. URL :www.alternatives-internationales.fr/article.php3?id_article=131.
0
500
1000
15002000
2500
3000
3500
4000
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
Années
Mon
tant
Le Cameroun, bien que présenté au milieu des années 1980 comme un pays peu
endetté,37 a néanmoins connu une hausse accélérée de sa dette vis-à-vis de ses partenaires
étrangers. On peut, en partie, imputer cette situation au financement des grands projets
(infrastructures d’industrialisation et nouvelles unités industrielles) recensés au cours des
troisième et quatrième plans de développement. La dette extérieure du Cameroun est ainsi
passée de 431, 4 millions de dollar en 1973 à 3 367,4 millions de dollar en 1983.
Une sérieuse hypothèque pesait dès lors sur le développement social et économique du
Cameroun et de façon plus spécifique, sur le développement du secteur industriel national. Il
devenait nécessaire de mettre en place une nouvelle stratégie pour conserver le rêve de
l’industrialisation.
B. Le Plan directeur d’industrialisation : entretenir la flamme
La crise économique des années 1980 et l’ajustement qui a suivi ont contribué à diluer
le rôle ainsi que la responsabilité de l’État, le condamnant à se désengager des secteurs
productifs et à se contenter de réguler.
Le Cameroun, au même titre que de nombreux pays africains, a choisi d’emprunter le
long tunnel de la crise en se laissant guider par le Fonds Monétaire International (FMI) et la
Banque mondiale. Le choix de cette assistance faite d’injonctions et de conditionnalités trop
peu souvent remises en cause, a fini par faire germer dans les esprits l’idée que les gouvernants
étaient davantage préoccupés par l’atteinte des objectifs macroéconomiques dictés par ces
institutions internationales, que par la satisfaction des demandes des populations.38
Du point de vue industriel, la décennie 1990 est marquée au Cameroun par l’adoption
d’un plan directeur d’industrialisation (1987). Celui-ci avait été préparé par le Ministère
camerounais du développement industriel et commercial (MINDIC), avec la participation de
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). Il visait la mise
en valeur des ressources nationales, qui devrait être fonction de l’accroissement démographique
et devrait prendre en compte le tarissement, dès la fin des années 1980, des recettes pétrolières
37 Le reproche a d’ailleurs été fait à l’endroit d’Ahmadou Ahidjo de n’avoir pas pris suffisamment de risque en refusant obstinément de recourir à l’emprunt international pour financer l’industrialisation. Le sous-endettement du Cameroun au cours de cette période est donc parfois analysé comme un « réflexe de prudence d’un leadership soucieux de "doser" toute chose ». Lire à ce sujet Manga Kuoh, (1996), Cameroun : un nouveau départ, Éditions L’Harmattan, pp.36-37.
38 Béatrice Hibou, (1998), « Banque mondiale : les méfaits du catéchisme économique »…, pp. 126-127.
du Cameroun. Il s’agissait donc d’un véritable engagement à stimuler le secteur, les
entrepreneurs et les initiatives privés pour compenser le désengagement de l’État.
C’est dans cette logique que l’on envisagea de réduire la concentration de l’activité
industrielle nationale dans la seule zone littorale (Douala, Édéa). Le code des investissements de
1990 introduisit même une nouveauté au Cameroun : les zones franches industrielles. Si ces
espaces préférentiels ont constitué un atout majeur pour des pays tournés vers la promotion des
exportations (NPI, Île Maurice…), leur mise en œuvre et leurs résultats sont encore loin d’être
flatteurs au Cameroun.
Les rédacteurs du plan directeur envisageaient également un regain de l’activité des
PME/PMI, en faisant à nouveau l’axe de l’industrialisation du Cameroun ; option rendue
aléatoire après la dissolution de la CAPME en 1990 et du FOGAPE en 1992. De fait, le
développement des PME/PMI est resté sommaire tout au long de la décennie 1990. Une réelle
politique de promotion de ce secteur n’a été réaffirmée qu’en décembre 2004 par les autorités
camerounaises, avec la création d’un ministère des petites et moyennes entreprises, de
l’économie sociale et de l’artisanat.
Le plan directeur d’industrialisation n’a donc été qu’une somme d’ambitions généreuses
restées vœux pieux, du fait d’un environnement économique morose marqué par l’extrême
contraction des finances publiques et un désengagement notable de l’État camerounais des
secteurs productifs.
Ce désengagement a pris les formes d’une désindustrialisation : le tissu industriel
camerounais, fragile depuis le milieu des années 1980, commença à se comprimer (Cf. tableau
2). Le plan directeur d’industrialisation avait permis au Cameroun d’affirmer sa volonté de
créer davantage d’entreprises. Des analystes envisageaient cependant une option contraire,
estimant à cette période que « la santé de l’industrie camerounaise dépendra de plus en plus de
la survie des entreprises en activités plutôt que des créations. »39 La tendance à la baisse de
l’effectif des entreprises industrielles que l’on releva au Cameroun, tout comme la vague
inachevée de liquidations d’entreprises,40 constitue un indice de l’état de santé inquiétant de
l’industrie nationale au cours de la période d’ajustement.
39 DIAL-DSCN, (1993), L’industrie camerounaise dans la crise 1984-1992, p.3.
40 La liquidation de la CELLUCAM, par exemple, entamée en juillet 1986, n’a été bouclée qu’en 2008.
Tableau 2 : Évolution du secteur industriel au Cameroun (1985-2000)41
Source : Constantin Abena Nguema, (2006), Impact des accords de l’OMC sur l’économie du Cameroun, négociation et mise en œuvre, Rapport préparé dans le cadre du programme intégré conjoint d’assistance technique (JITAP), CNUCED, pp.13-14.
La contraction du secteur industriel camerounais a eu pour cause la lente résorption
des difficultés structurelles qu’avaient relevées la crise, ainsi que l’incapacité de
l’entrepreneuriat privé à remplacer l’État, malgré les aménagements du code des
investissements, le choix de politiques libérales, les privatisations et le développement effréné de
l’économie informelle.42
C. Vers de grandes ambitions industrielles
En adoptant la loi n°2001/004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements, le
Cameroun réaffirmait son choix porté sur l’économie de marché, en privilégiant la promotion
des exportations comme stratégie d’industrialisation. Le code des investissements, modifié en
janvier 199443, était visiblement désuet. Les affres de la crise, ainsi que les sermons des
institutions de Bretton Woods avaient fini par persuader les autorités camerounaises de ce que le
libéralisme et l’insertion dans l’économie mondiale étaient le passage obligé pour entrevoir la
possibilité d’un développement soutenu par les bailleurs de fonds internationaux.
41 La DSCN comptabilisa 223 entreprises dans le secteur industriel au Cameroun en 1993-1994. En 1994-1995 ce chiffre passe à 214 ; puis 200 en 1995-1996 ; 208 en 1996-1997 et 202 en 1997-1998. Voir DSCN, (2000), Annuaire statistique du Cameroun 1999, p.178. Les statistiques de l’exercice 1998-1999, soit 212 entreprises, correspondent à l’évaluation faite par Constantin Abena Nguema pour l’exercice 1999-2000. L’ONUDI faisait, quant à elle, état en 2005 de quelque 200 entreprises industrielles au Cameroun, employant près de 53 000 personnes. Voir Mission économique de Yaoundé (2007), Le secteur industriel au Cameroun (fiche de synthèse), Ambassade de France au Cameroun, p.1.
42 Au sujet de l’évolution récente de l’économie camerounaise, lire Jean-Joël Aerts et al, (2000), L’économie camerounaise : un espoir évanoui, Paris, Karthala, 287p ; Modeste Nkutchet, (2005), L’état de l’économie camerounaise, Paris, L’Harmattan, 335p.
43 Adopté en juin 1960, le code camerounais des investissements a été modifié à différentes reprises (1964, 1966, 1984, 1990, 1994) pour tenter de l’adapter aux évolutions et d’en faire ainsi l’instrument essentiel de la promotion du développement industriel et commercial du pays.
1985-1986
Nombre d’entreprises
Effectifs employés
487 69.618
1999-2000
Nombre d’entreprises
Effectifs employés
212 59.091
Parallèlement, le souhait de nombreux analystes de voir le Cameroun redevenir maître
de son destin économique et revenir à la planification à moyen et long terme se fait pressant. Le
Cameroun peut désormais s’inscrire dans une logique du post-ajustement. Ses rapports
controversés avec le FMI ne sont pas près de prendre fin ; toutefois, l’alibi de la conditionnalité
devenant caduc, les financements disponibles depuis l’atteinte du point d’achèvement de
l’initiative pays pauvres très endettés, et l’enjeu électoral plus que jamais d’actualité, plus rien ne
s’oppose à la nécessité de réfléchir à une politique industrielle adaptée et à la stratégie qui
l’accompagnerait.
L’action gouvernementale semble prendre de la vigueur, depuis peu, sous le slogan des
« grandes ambitions » lancé par le candidat Paul Biya en 2004, lors des présidentielles. Les
documents de référence sont élaborés et donnent des indications sur le développement de tous
les secteurs de la vie sociale, économique et même politique : le document de stratégie de
réduction de la pauvreté (DRSP) en 2003, le document de stratégie pour la croissance et
l’emploi (DSCE) en 2009, la vision du développement du Cameroun à l’horizon 2035
(Cameroun vision 2035) en 2009. Les rencontres se multiplient. L’image d’un Cameroun qui
bouge veut être diffusée. L’idée d’un retour à la planification, elle, fait son chemin.
Dans cette effervescence gouvernementale44, tempérée par un intérêt mesuré des
couches populaires, l’industrialisation reste encore le leitmotiv. On l’assimile au « socle » et à
« la pierre angulaire de la vision de développement à long terme du Cameroun. »45 Les axes de
cette nouvelle vision industrielle sont déterminés : l’industrie agroalimentaire, l’industrie du
bois et l’industrie textile. On y ajoute la construction du yard pétrolier de Limbé, l’extension
des capacités de production d’ALUCAM, la construction de barrages et centrales
hydroélectriques (Lom Pangar, Natchtigal, Song Ndong, Song Mbengue, Kikot, Memve’ele,
Bini …), ainsi que de complexes miniers (exploitation du fer de Balam, exploitation de l’or à
Bétaré Oya…). Reste à densifier le tissu industriel camerounais et améliorer la compétitivité des
entreprises appelées à réaliser ses ambitions. Reste également à s’assurer que les créneaux
choisis, notamment la révolution agricole, le développement des industries extractives, la
44 Prudent, le gouvernement Cameroun ne manque pas de tempérer lui-même cet ambitieux projet de faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035, soulignant que celui-ci « est sujet à un ensemble de risques et d’incertitudes susceptibles de le rendre rédhibitoire. Il peut s’agir de situations incertaines, de dangers plus ou moins prévisibles, de paris risqués, ou d’autres hypothèques. » Voir MINEPAT, (2009), Cameroun Vision 2035, document de travail du Ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire, février, p.51.
45 MINEPAT, (2009), Cameroun Vision 2035, p.36.
promotion des PME/PMI, la mise à niveau des entreprises, la compétitivité des filières à fort
potentiel de croissance et de création d’emplois, l’amélioration du climat des affaires, le
développement de la recherche, de l’innovation et de la normalisation technique46, perdent de
leur connotation de déjà entendu, et s’avèrent être des choix gagnants.
Il faut également relever le point de vue de certains observateurs qui considèrent que,
malgré ces ambitions louables, le Cameroun ne donne pas encore la preuve d’une politique
d’industrialisation pertinente et cohérente.47 L’élaboration de cette politique, appuyée sur une
stratégie à long terme, resterait à faire. Elle doit être à la mesure de l’espérance des couches
populaires qui attendent de voir leurs conditions de vie s’améliorer très bientôt et durablement.
CONCLUSION
L’industrialisation n’est pas qu’un souhait pour le Cameroun ; elle est un impératif qui
fédère les espérances d’un pays convaincu de disposer du potentiel nécessaire. Depuis 1960,
pourtant, des initiatives ont été prises et multipliées pour atteindre cet objectif. Aucune des
stratégies, « importées » et abandonnées avec empressement, n’a encore permis de bâtir un
secteur industriel suffisamment puissant et dynamique pour impulser une amélioration durable
des conditions de vie des populations. Le constat est évident que les essais d’industrialisation
du Cameroun ont jusqu’à présent été peu concluants. Conclure à l’échec semble
disproportionné au regard des réalisations industrielles qui continuent, pour certaines, de faire
la fierté d’un pays. Par contre, nier les erreurs, les mauvais choix, serait improductif. Il est aisé
d’imputer ces erreurs à des chocs externes. Il serait tout aussi opportun de réfléchir sur le choix
de la stratégie industrielle la plus adaptée pour le Cameroun, tout en prenant en compte les
leçons du passé récent.
Les théoriciens de l’économie font de l’industrialisation, peut-être malgré eux, un
processus par essais et erreurs. L’histoire récente tend à corroborer cette supposition : les pays
du sud joueraient leur industrialisation avec un dé, expérimentant tour à tour des stratégies qui
foisonnent.48 Ce constat voile néanmoins un aspect plus décisif de la question à savoir le choix
des stratégies mises en œuvre, en rapport avec l’environnement domestique et international.
46 MINEPAT, (2009), Cameroun Vision 2035, p.36.
47 Babissakana, (2010), « Pas d’industrialisation sans un État industriel », interview au Quotidiens Mutations, 17 février 2010, on www.aeud.fr/Babissakana-Pas.d.html (consulté le 27.04.2010).
48 "But nobody knows what will work until they try, and the more experiments, the more discoveries ". Cette réflexion, parut dans Life Magazine le 24 avril 1944, certes au sujet des solutions possibles au problème noir aux
Puisqu’un bilan sert à la projection, il faudrait souhaiter pour le Cameroun que la
somme des erreurs, cumulées depuis cinquante années, serve dès à présent à concrétiser le
nouvel essai. Toutes les leçons ont-elles cependant été tirées des essais précédents ?
Etats-Unis, résume, à notre avis, la démarche d’industrialisation des pays du sud, faite d’essais, d’espérances et, bien trop souvent, d’erreurs.
Tableau 1 : Situation de quelques grandes réalisations industrielles des 3e et 4e plans quinquennaux
Dénomination Année de création /
inauguration
Estimation de la participation du capital public∗∗∗∗
Investissement réalisé Objectifs assignés au projet Sort
CELLUCAM Cellulose du Cameroun
1976 / 1981 Forte 75 milliards de F CFA Production annuelle de 122.000 tonnes de pâte à papier
Fermeture en 1982, dissolution et mise en liquidation en juillet 1986.
SOCAME Société camerounaise des engrais
1973 / 1976 Forte 30 milliards de F CFA Production annuelle de 90.000 tonnes d’engrais
Fermeture en 1981 pour mauvais résultats
CAMSUCO Cameroon Sugar Company
1975 / 1977 Très forte 23,7 milliards de F CFA
Production annuelle de 50.000 tonnes de sucre
Privatisée
SODEBLE Société de développement du blé
1975 Très forte 40 milliards de F CFA Production annuelle de 125.000 tonnes de blé
Mise en liquidation en avril 1988. Réorientée vers la culture de maïs et de soja
SONARA Société nationale de raffinage
1976 / 1981 Forte 66 milliards de F CFA Répondre localement à la demande en hydrocarbures
Signature d’un contrat de performance avec l’Etat et restructuration
HEVECAM Société de développement de l’hévéa au Cameroun
1973 / 1975 Très forte 30 milliards de F CFA Production annuelle de 34.000 tonnes de latex
Privatisée
Source : L’auteur ; d’après M. Tchoungang, (1987), « L’entreprise publique camerounaise face au défi du désengagement de l’État », pp.109-110 et Jules Sakutu Amvene, (1987), « L’intervention de l’État dans l’économie camerounaise : les entreprises publiques », pp.100-103 in Revue camerounaise de management, numéro spécial colloque Les secrets de la performance des entreprises publiques camerounaises, Douala 09 – 10 mars 1987. Jean Claude Willame, (1985), « Cameroun : les avatars d’un libéralisme planifié », in Politique africaine, n°18, pp.46-47, 50-54 ; 58-68.
∗ Moins de 50% du capital = Modérée ; entre 50 et 79% du capital = Forte ; entre 80 et 100% du capital = Très forte.
Bibliographie
� Ouvrages
AERTS Jean-Joël et al, (2000), L’économie Camerounaise : un espoir évanoui, Paris, Karthala, 287p. BARJOT Dominique, LEFEUVRE Daniel, BERTHONNET Arnaud, CŒURE Sophie, (2002),
L’électrification outre-mer de la fin du XIXe siècle aux premières décolonisations, Paris, publications de la Société française d’histoire d’outre-mer/La Fondation EDF, 664p.
BOUTAT Alain, (1991), Technologies et développement au Cameroun : le rendez-vous manqué, Paris, Éditions L’Harmattan, 235p.
CARSALADE Yves, (2002), Les grandes étapes de l’histoire économique : revisiter le passé pour comprendre le présent et anticiper l’avenir, Palaiseau, Éditions École Polytechnique, 390p.
HUGON Philippe, (1968), Analyse du sous-développement en Afrique noire. L’exemple de l’économie du Cameroun, Paris, PUF, 327p.
KAMARCK Andrew M., (1968), Le développement économique en Afrique, Paris, Les Éditions Internationales, 262p.
MANGA KUOH, (1996), Cameroun : un nouveau départ, Paris, Éditions L’Harmattan, 158p. MARSEILLE, Jacques, (2005), Empire colonial et capitalisme français : histoire d’un divorce, Paris,
Albin Michel, 638p. MOREL Yves, (1978), Tableaux économiques du Cameroun, Douala, Collège Libermann, 232p. NKUTCHET Modeste, (2005), L’état de l’économie camerounaise, Paris, L’Harmattan, 335p. RAFFINOT Marc, (1991), Dette extérieure et ajustement structurel, Paris, EDICEF, 238p. Revue camerounaise de management, numéro spécial colloque « Les secrets de la performance des
entreprises publiques camerounaises », Douala 09 – 10 mars 1987, 112p. TOUNA MAMA, (1996), Crise économique et politique de déréglementation au Cameroun, Paris,
Éditions L’Harmattan, 263p.
� Articles & communications
ASANTE S.K.B. et CHANAIWA D., (1998), « Stratégies comparées de la décolonisation économique », in MAZRUI A.A. (éd), Histoire générale de l’Afrique, tome VIII : l’Afrique depuis 1935, Paris, Unesco, pp. 259-281.
COURADE Georges (1984), « Des complexes qui coûtent cher : la priorité agro-industrielle dans l’agriculture camerounaise », Politique africaine, n°14, juin, pp.75-91.
DESSOUANE Philippe, Verre Patrice (1986), « Cameroun : du développement autocentré au national-libéralisme », Politique africaine, n°22, juin, pp.111-119.
HIBOU Béatrice, (1998), « Banque mondiale : les méfaits du catéchisme économique. L’exemple de l’Afrique subsaharienne », Esprit, n° 245, août - septembre, pp.98-139.
KONINGS Piet (1986), « L’État, l‘agro-industrie et la paysannerie au Cameroun », Politique africaine, n°22, juin, pp.120-137.
MIANNAY Julien, (2008), « L’industrialisation des pays émergents : autonomie de l’émergence ou émergence d’une nouvelle dépendance », communication au Colloque « L’émergence : des trajectoires au concept ? », Bordeaux, 27-28 novembre 2008.
SIMON Jean-Christophe, (1991), « L’impératif industriel et la dynamique du développement », in Bonnefond Philippe, (éd.), Modèles de développement et économie réelle, Chronique du Sud, pp.57-65.
SUSUMU WATANABE, (1997), « Quo vadis Africa? La stratégie de développement de la Banque mondiale vue par le Japon », Tiers-monde, vol. 38, n° 150, pp.311-330.
WILLAME Jean Claude, (1985), « Cameroun : les avatars d’un libéralisme planifié », Politique africaine, n°18, pp.44-70.
� Mémoires
POKAM KAMDEM Moïse Williams, (2007), « L’énergie dans le processus de mise en valeur du Cameroun français (1946-1959) », mémoire de maîtrise en Histoire, Université de Yaoundé I, 131p.
TCHEUMENI Diane, (2005), « La politique industrielle du Cameroun. Essai d’analyse historique (1960-2000) », mémoire de maîtrise en Histoire, Université de Yaoundé I, 138p.
� Rapports
ABENA NGUEMA Constantin, (2006), Impact des accords de l’OMC sur l’économie du Cameroun, négociation et mise en œuvre, rapport préparé dans le cadre du programme intégré conjoint d’assistance technique (JITAP), CNUCED, 69p.
DIAL-DSCN, (1993), L’industrie camerounaise dans la crise 1984-1992, novembre, 16p. DSCN, (2000), Annuaire statistique du Cameroun 1999, 369p. MINEPAT, (2009), Cameroun Vision 2035, document de travail du Ministère de l’économie,
de la planification et de l’aménagement du territoire, février, 76p. Mission économique de Yaoundé (2007), Le secteur industriel au Cameroun (fiche de
synthèse), Ambassade de France au Cameroun, 4p. ONUDI, (2002), Pour une nouvelle politique industrielle au Cameroun, 123p.
� Ressources en ligne
BABISSAKANA, (2010), « Pas d’industrialisation sans un État industriel », interview au Quotidiens Mutations, 17 février 2010, consulté le 27.04.2010. URL : www.aeud.fr/Babissakana-Pas.d.html
DANTIER Bernard, (2004), « Karl Popper : "Les théories et leur priorité sur l’observation et l’expérimentation"», consulté le 27.04.2010. URL : classiques.uqac.ca/…/poperr_karl/…Metho_Popper_Karl.pdf
DE LA TAILLE Elisabeth, (2001), « Les stratégies de développement industriel des pays du sud : les leçons de l’expérience mexicaine », Cahiers de recherche, n°2, Université de Toulouse 1, consulté le 03.05.2010. URL : w3.univ-tlse1.fr/LEREPS/publi/teleload/Delataille2001_2pdf
HA-JOON Chang, (2005), « Le libéralisme garantit l’échec du Sud », entretien, consulté le 27.04.2010. URL : www.alternatives-internationales.fr/article.php3?id_article=131
NJOH MOUELLE Ebénézer, « Le transfert de technologies et la question de la créativité », consulté le 03.05.2010. URL : www njohmouelle.org/actu/20090323200634.pdf.