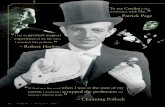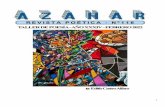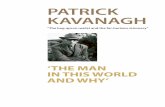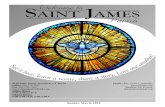L’hypertextualité comme révélateur d’identité dans Aliss de Patrick Senécal
Transcript of L’hypertextualité comme révélateur d’identité dans Aliss de Patrick Senécal
Clotilde Landais L’hypertextualité dans Aliss de Senécal Septembre 2008
1
L’hypertextualité révélatrice d’identité dans Aliss de Patrick Senécal
Clotilde Landais
Landais, Clotilde. “L’hypertextualité comme révélateur d’identité dans Aliss de Patrick Senécal.” [“Aliss by
Patrick Senécal: Revealing True Identity Through Hypertextuality”] Clair-Obscur 5 (2009): 50-61.
La réécriture d’œuvre littéraire n’est pas un exercice rare. Nombre d’auteurs s’y sont
prêtés pour donner leur interprétation d’un texte, et Patrick Senécal ne fait pas exception
lorsque, dans son roman Aliss1, il s’empare des contes de Lewis Carroll Alice’s Adventures in
Wonderland et Through the Looking-Glass and What Alice Found There2. Dans cet article,
nous verrons que, par un jeu particulièrement construit de transposition, Senécal révèle
l’identité de Lewis Carroll par le biais de son double romanesque, Charles.
Le narratologue français Gérard Genette en particulier s’est penché d’un point de vue
théorique sur cet exercice qu’est la réécriture. Dans son ouvrage Palimpsestes, il étudie
notamment ce qu’il appelle l’hypertextualité, soit « toute relation unissant un texte B ([…]
hypertexte) à un texte antérieur A ([…] hypotexte) sur lequel il se greffe d’une manière qui
n’est pas celle du commentaire3 ». Ainsi, la réécriture d’une œuvre peut être qualifiée plus
précisément d’hypertextualité. Cependant, deux autres conditions sont nécessaires pour que la
relation soit effectivement hypertextuelle. Tout d’abord, l’hypertexte est un « texte dérivé
d’un texte antérieur par transformation simple (nous dirons désormais transformation tout
court), ou par transformation indirecte : nous dirons imitation4 ». De plus, pour qu’il y ait
hypertextualité, il faut que « la dérivation de l’hypotexte à l’hypertexte [soit] à la fois massive
[…] et déclarée, d’une manière plus ou moins officielle5 ». Dans la mesure où le titre du
roman de Patrick Senécal et de nombreux éléments de la narration sur lesquels nous
reviendrons renvoient explicitement aux contes de Lewis Carroll, nous pouvons considérer
qu’une relation hypertextuelle unit ces textes – Aliss constituant l’hypertexte, et les contes de
Carroll l’hypotexte.
Aliss comme hypertexte des contes de Carroll
Cette dérivation massive et déclarée de l’hypotexte vers l’hypertexte apparaît tout
d’abord dans les personnages, à commencer par celui de l’héroïne, qui donne son nom au
roman : Aliss6. La description de ce personnage est sans équivoque par rapport à l’héroïne de
Carroll, et sous ses traits d’adolescente du XXe siècle, Aliss reste la petite fille victorienne au
caractère suffisant qui veut être considérée comme une adulte. Elle est d’ailleurs présentée
avec les caractéristiques principales de l’héroïne carrollienne : petite fille modèle pour sa
mère – « Alice a tout pour nous rendre heureux, Marc et moi. Elle est brillante, a de très
bonnes notes à l’école…7 » –, jeune fille qui s’ennuie pour ses amis – « […] elle dit qu’elle
est en train de se limiter, dans cette petite vie tranquille8 » – ou élève curieuse selon son
professeur de philosophie – « C’est ça, Alice : une passionnée brillante et curieuse mais trop
impulsive et, avouons-le, un peu naïve.9 » De même, la description de l’héroïne de Carroll
donnée par Jean-Jacques Lecercle, citant James Kincaid, s’applique parfaitement à la jeune
Québécoise : « Cette Alice, qui vient gâcher l’Eden du Pays des merveilles […] est à la fois
coquette et prude, égocentrique et snob […].10 » Les deux Alice peuvent en effet être
qualifiées de snobs tout d’abord car, bien qu’elles soient les intruses, elles ne cessent de
critiquer ce monde qu’elles ne comprennent pas : « — Eh bien, je dirais que cette Aliss ne
comprend pas trop comment ça fonctionne ici. Elle a… disons… une autre façon de voir les
choses…11 » De même, bien qu’elles sachent toutes deux que le Wonderland ne leur
correspond pas, elles refusent de le reconnaître tant que cet avertissement vient d’un adulte.
Elles imposent leur avis, leur regard extérieur – qui n’est pas objectif pour autant –, la
première en récitant les principes qu’on lui a inculqués, la seconde en se raccrochant à la
Clotilde Landais L’hypertextualité dans Aliss de Senécal Septembre 2008
2
morale judéo-chrétienne tout en se droguant pour oublier qu’au fond d’elle-même, ce qu’elle
s’impose la répugne. Jusqu’à ce que toutes deux soient expulsées de ce monde, telle Ève
chassée du Paradis.
Égocentriques ensuite car les actes de ces personnages n’ont qu’un seul but : entrer au
jardin / Palais et rencontrer la reine, sans se soucier de déranger l’équilibre du microcosme
dans lequel elles interviennent. Elles acceptent ainsi tous les défis qu’on leur propose pour
pouvoir se rendre dans le lieu auquel tous les autres personnages ont accès. Les deux Alice
agissent donc sous l’impulsion d’un « désir d’indépendance malsain12 » d’après Jean
Gattegno, comme cela est signifié d’un côté par la fable du Morse et du Charpentier, et de
l’autre par les avertissements plus explicites de Charles : « — Ça peut mener loin, ça, au bout
de tout, jeune fille. Très loin. Parfois trop. À des endroits insoupçonnés.13 » Si les
conséquences sont minimes pour Alice qui s’éveille au moment où le rêve aurait pu se
transformer en cauchemar, il n’en est pas de même pour Aliss qui, elle, doit affronter des
épreuves physiques de plus en plus terribles.
Même si Aliss est le signe le plus évident d’une hypertextualité entre le roman
québécois et les contes victoriens, les autres personnages du roman sont également en faveur
d’une relation massive et déclarée entre les deux textes. La reine Rouge renvoie directement
au second conte de Carroll et correspond au personnage de la reine de Cœur du premier conte,
comme en atteste la réplique suivante : « Qu’on lui coupe la tête, tiens !14 » Le Chat du
Cheshire également, qui apparaît sous les traits de Chess – dont le nom renvoie à l’intrigue du
second conte –, et dont le sourire est ce que l’on voit le plus chez lui : « Il a cessé de ricaner,
mais je vois son sourire. Un drôle de sourire qui, même de loin, est beaucoup trop grand pour
sa face […].15 » Le Ver à Soie est incarné par Verrue. Être asocial et méprisant, il est celui qui
fait réaliser aux deux Alice à quel point elles trouvent désagréables les habitants du
Wonderland : « J’ai jamais rencontré tant de gens malpolis en si peu de temps : le Monsieur
Métro, la proprio, le mari de la proprio, la serveuse du restau, et maintenant lui, ce vieux
schnock !16 » La Duchesse apparaît comme Andromaque la duchesse qui, comme dans le
premier conte, ne sait pas s’occuper de son bébé :
— That’s it, maudit cochon ! Là, c’est fini pour vrai!
[…] Elle lance son bébé !
Littéralement ! Elle prend son élan, allonge le bras, et le lance17 !
Le fait qu’elle qualifie son bébé de « cochon » est une autre référence directe au bébé
de la Duchesse de Carroll qui est littéralement un porc. Le Chapelier et le Lièvre de Mars, les
deux personnages les plus excentriques du monde de Lewis Carroll, se retrouvent sous les
traits de Chair et Bone. Ils sont identifiables par leur amour du thé d’un côté :
— Ah ! Le thé ! s’écrient de concert les deux compères.
Sur le plateau se trouvent une théière, un pot de lait et trois tasses. […] Bone se dirige vers la
théière, tout heureux :
— Un peu de lait, ma chère18 ?
De l’autre, par leur obsession de la maîtrise du temps :
— Ne dites pas que ce n’est pas le temps ! Stupide expression dictatrice ! Comme si c’était le
temps qui décidait le moment de faire les choses ! Le temps n’a pas à décider quoi que ce
soit ! C’est toujours le temps pour tout, vous entendez ? Le temps n’a qu’à se soumettre, voilà
tout19 !
Enfin, le dernier – mais non des moindres – protagoniste du roman établissant la
relation entre le texte québécois et les contes victoriens est le personnage de Charles, alias
Lewis Carroll. En effet, nombre d’éléments permettent de relier Charles au révérend
Dodgson : tout d’abord, Charles bégaie en présence d’adultes, mais pas avec les enfants :
Clotilde Landais L’hypertextualité dans Aliss de Senécal Septembre 2008
3
— Mer… mer… merci beauc… beauc… ccc… coup, madem… dem… dem…
Un bègue. Ce sera pas simple.
— … mademmm… mmm… moissss…
Ses yeux reviennent sur moi… et là, on dirait qu’il me voit vraiment. Sa main, qui avait
presque atteint son but, s’immobilise. Ça se transforme soudain dans son regard, comme si on
avait mis une ampoule neuve. Sa main s’abaisse, sans qu’il ait repris son portefeuille.
— Merci beaucoup, mademoiselle20.
Le bégaiement de Charles, qui réapparaît dans le texte chaque fois qu’il s’adresse à un
adulte, disparaît en présence d’Aliss. Il la considère donc comme une enfant, à l’instar de son
homonyme victorienne. Ensuite, la partie de sa vie que Charles présente à Aliss fait écho à
une partie de la biographie de Dodgson : « Je suis mathématicien de formation. J’ai pratiqué
ce difficile mais passionnant travail durant quinze ans. Je l’ai même enseigné durant quelques
années en Angleterre.21 »
Par ailleurs, Charles est désigné textuellement comme double de Dodgson, dans la
mesure où il est renvoyé à sa fictionalité. Il est par exemple décrit comme création littéraire :
[Charles] se met à se frotter les mains, à se mordiller les lèvres, à danser d’un pied sur l’autre ;
bref, l’ensemble des signes de nervosité répertoriés par tous les romanciers du monde. À croire
qu’il se caricature lui-même22.
Cette « caricature » de lui-même signifie bien l’idée de double, tant par la perversion
que sous-entend la caricature que par l’aspect fictionnel marqué par le terme « romancier ».
Charles est également renvoyé à sa fictionalité par le personnage d’Aliss qui le compare à un
livre à cause de son langage parfois « précieux et érudit23 » :
Un livre ! Je parle à un livre ! Les pages ont un ton un peu nasillard, mais c’est un livre quand
même ! [I]l n’y a rien d’affecté chez lui, pas de pédantisme. C’est naturel, il s’en rend même
pas compte24.
Ainsi, Charles s’exprime à la manière du XIXe siècle, comme devait le faire Dodgson ;
ou comme s’il était le personnage d’un livre écrit par un auteur de cette époque.
Enfin, tel le Lapin Blanc des contes, Charles tient le rôle d’initiateur de l’aventure.
C’est en effet en le suivant qu’Aliss est entraînée dans le tunnel du métro qui la conduit au
Wonderland :
Le temps que je traverse la rue, mon monsieur a disparu. Sûrement dans le métro. Je prends le
même chemin que lui, descends l’escalier roulant. […]
Vite, vite, je m’élance, je me propulse, je me fusée-à-réactionne vers le wagon et réussis à me
glisser entre les portes coulissantes […]25.
Ainsi, les personnages, dès leur présentation, constituent un renvoi déclaré à
l’hypotexte. De même, le fait que tous les personnages principaux de l’univers carrollien se
retrouvent dans le roman québécois est en faveur de cette dérivation massive nécessaire à
l’hypertextualité selon Genette. Cependant, les personnages ne sont pas le seul indice.
L’intrigue même établit le lien entre l’hypertexte et son hypotexte.
En effet, le schéma des aventures d’Aliss suit celui de son homonyme : dans le
premier chapitre, Aliss suit le Lapin Blanc alias Charles dans le métro et se retrouve au
Wonderland. Puis, les épisodes de « The Pool of Tears » et de « A Caucus-Race and a Long
Tale » sont réunis dans le chapitre 3 où Aliss, sous l’effet d’hallucinogènes, croit se noyer
dans une mare de sperme, suite à un concours d’éjaculations. La rencontre avec Verrue, si elle
se produit plus tôt dans le roman que dans les contes (chapitre 2 au lieu du chapitre 5),
reprend la même thématique du « Qui es-tu ? » Ce placement du chapitre dès le début du
roman insiste sur l’importance de cette question dans l’hypertexte. Aliss rencontre ensuite
Andromaque, alias la Duchesse, ainsi que Chess, comme dans l’épisode « Pig and Pepper ».
Clotilde Landais L’hypertextualité dans Aliss de Senécal Septembre 2008
4
De là, toujours sur les traces d’Alice, l’héroïne québécoise se rend à la « Mad Tea-Party »
organisée par Chair et Bone, d’où elle gagne son droit de passage pour le Palais de la reine
Rouge. Puis, elle doit affronter une version sadienne de « The Mock Turtle’s Story » avant,
finalement, de se retrouver à son procès et d’être renvoyée dans son monde.
Comme l’illustrent ce résumé des aventures d’Aliss au Wonderland ainsi que
quelques-uns des traits caractérisant les personnages, le roman québécois se déroule donc
dans un contexte contemporain à l’auteur. Pour cette raison et d’autres que nous allons
maintenant examiner, le procédé de transformation utilisé par Senécal pour sa réécriture des
contes de Carroll relève de ce que Genette appelle la transposition.
Hypertexte et transposition
Selon Genette, la transposition « est sans nul doute la plus importante de toutes les
pratiques hypertextuelles, ne serait-ce […] que par l’importance historique et
l’accomplissement esthétique de certaines des œuvres qui y ressortissent26 ». Or, nombre
d’éléments de l’hypotexte de Lewis Carroll ont fait l’objet d’une transposition dans
l’hypertexte de Patrick Senécal.
La première opération de transposition entre l’hypotexte et l’hypertexte se situe donc
au niveau du décor : l’histoire ne se déroule plus dans l’Angleterre victorienne, mais à
Montréal, en l’an 2000. L’effet de réel est renforcé par les détails donnés par l’auteur : dans le
centre de Montréal, Aliss se rend rue Saint-Denis et rue Sainte-Catherine, où elle prend le
métro, avant de n’avoir plus que le pont Jacques Cartier comme repère. Cependant, malgré cet
ancrage dans la réalité, le monde dans lequel Aliss se rend est tout droit sorti de l’imaginaire
de Lewis Carroll, comme les noms de rue le sous-entendent : Dodgson et Lutwidge, qui sont
respectivement le vrai nom de Carroll et celui de sa mère ; Daresbury, qui est la ville natale de
Dodgson ; Snark, qui est le titre d’un autre conte de Carroll ; Humpty, du nom d’un
personnage de Through the Looking-Glass, etc.
La deuxième opération de transposition concerne les jeux de langage dans lesquels
Lewis Carroll excellait. Si l’on ne retrouve pas les « nursery rhymes » détournées, Senécal a
repris les calembours du Chapelier et du Lièvre de Mars en les plaçant dans la bouche de
Chair et Bone, soit dans leurs dialogues :
— Pour une nouvelle, elle connaît les nouvelles. […]
— Je dirais même que pour une novice, elle connaît quelques-uns de nos vices27.
Soit dans leur étiquetage de flacons :
Embrouillé et difforme, un cerveau flotte avec une parfaite immobilité. Un bout de la moelle
épinière y est encore accroché […] Sur une étiquette, je peux lire : « Cerveau lent ». […] Je
vais au bocal à côté. À l’intérieur, un bras, coupé au coude, avec une main maigre et crochue à
son extrémité. L’étiquette dit : « A bras cada bras » […]28.
Senécal introduit par ailleurs un autre jeu sur le langage à partir du personnage
d’Andromaque qui ne s’exprime qu’en alexandrins :
Bon, très bien, je te prends, même si t’es pas Bardot.
Même que je vais t’apprendre un vrai bon numéro.
Faut voir ce que t’as l’air comme danseuse sous un spot.
Tu regardes certaines filles, on dirait le jackpot,
Mais aussitôt qu’elles dansent, elles deviennent des banquises,
C’est comme si elles dansaient dans un sous-sol d’église29.
Clotilde Landais L’hypertextualité dans Aliss de Senécal Septembre 2008
5
La troisième opération de transposition se situe au niveau d’Aliss. Comme nous
l’avons vu au début de notre article, celle-ci est devenue adolescente entre les deux textes.
Ainsi, par le biais de cette différence d’âge, Patrick Senécal applique littéralement le caractère
« sexué, chargé d’affect érotique, objet d’un regard désirant30 » que Jean-Jacques Lecercle
attribue à l’héroïne carrollienne. De la même façon qu’Alice, la jeune Québécoise est
gouvernée par ses désirs, et sa fascination pour le Palais en est le meilleur exemple. Tout
comme le jardin est la première chose aperçue par Alice, le Palais est le premier bâtiment
qu’Aliss remarque en arrivant au Wonderland. Et pour reprendre le propos de Jean Gattegno :
le jardin de Carroll est associé à « des images chargées de sensorialité, mélange de luxe et de
volupté31 » auxquelles le Palais fait plus que répondre dans le roman de Senécal. Cherchant
son plaisir à tout prix – puisque toute fascination est aliénante –, Aliss est prête à tout pour y
pénétrer, y compris à se droguer et se prostituer.
La dernière opération de transposition concerne le caractère des protagonistes, qui se
voient corrompus dans l’hypertexte : comme nous l’avons signalé par rapport au passage à
l’adolescence de l’héroïne, celle-ci voit sa coquetterie enfantine transposée en érotisme, voire
en nymphomanie, qui la conduira à la prostitution. Tous les personnages sont tirés dans cette
direction, y compris celui de Charles, le double de Lewis Carroll. Or, le révérend Charles
Dodgson fut soupçonné de pédophilie – notamment sur la personne de la petite Alice Liddell,
inspiratrice des deux contes éponymes, qu’il aurait demandée en mariage alors qu’elle n’était
encore qu’une enfant. Senécal interprète ici au sens strict ce qui n’a peut-être été que
platonique chez le révérend anglais et, de ce fait, représente Charles sous les traits d’un
pédophile actif : Le Valet qui était sorti réapparaît ; il n’est plus seul. Une jeune fille l’accompagne et plus elle
approche, plus je réalise à quel point elle est jeune. Onze ans, douze maximum.
[…] La Reine met son bras autour des épaules de la jeune zombie et, souriante, lance vers
Charles :
— Je pense que c’est le genre de petite plotte que t’haïs pas, ça, non ?
[…] Sur quoi, il prend la jeune fille par la main et marche rapidement vers le rideau du fond32.
Cette préférence sexuelle de Charles est renforcée par une autre référence
extradiégétique : celle au marquis de Sade. Outre le lien évident entre La nouvelle Justine et le
couple de sado-masochistes, les extraits lus par Minnie tendent à souligner la pédophilie de
Charles. En effet, ces passages sont tirés du chapitre 6, dans lequel Rodin « fustige soixante
[enfants] dans sa matinée, trente-cinq filles et vingt-cinq garçons33 ».
La reine Rouge, par ailleurs, qui ne faisait que s’imaginer faire tomber des têtes dans
les contes victoriens – « — Mais c’est elle, dit le Griffon. C’est elle qui s’imagine tout ça : on
n’exécute jamais personne, vous savez.34 » –, est dans l’hypertexte une meurtrière en fuite
dont le passe-temps favori est l’empaillage de ses victimes :
— Tu t’appelles Michelle Beaulieu […], t’as tué ton directeur d’école, ton ancienne patronne
pis ton pimp ! T’as fui la police ! Pis […] tu empailles des gens en souvenir de ton père35 !
De même, si le Ver à Soie fumait la pipe36, Verrue fume du haschisch et entraîne Aliss
dans les drogues dures – les Macros, qui la font se sentir forte et grâce auxquelles elle
supportera les épreuves qu’elle s’inflige, et les Micros, qui la rendent paranoïaque – avant de
la pousser vers la prostitution :
— […] je pensais que tu pourrais danser pour moi…
— Danser ? Toute nue ?
— Non, en habit de scaphandrier… Évidemment, toute nue !
[…]
Verrue, le front moite de fièvre, a un sourire entendu :
Clotilde Landais L’hypertextualité dans Aliss de Senécal Septembre 2008
6
— Toi qui cherchais une job plus payante, je pense que t’as du potentiel… […] Malgré ton
manque d’expérience, je suis sûr qu’Andromaque te prendrait… Tu es son genre…37
Ensuite, Senécal fait de la Duchesse une prostituée dont le nom est synonyme de
fidélité conjugale. Alors que le personnage carrollien était d’une laideur remarquable,
l’hypertexte lui attribue une grande beauté, et littéralise ainsi la séduction qu’elle exerce sur
Aliss38, lui faisant goûter à l’homosexualité :
Andromaque, le visage en sueur, les cheveux défaits, me regarde alors et dit :
— Tu m’abandonn’ras pas, douce Aliss, n’est-ce pas ?
[…] Sa voix est désespérée, en parfait contraste avec ce que nous faisons, avec ce qui nous
arrive39.
Chair et Bone, enfin, sont au service de la reine Rouge. Leur principale occupation est
de torturer jusqu’à la mort les dissidents dans le but de prouver l’inexistence de l’âme, ce que
le Temps ne leur permet jamais de faire, les prenant de court à chaque fois. Avec les doubles
québécois du Chapelier et du Lièvre de Mars, l’apprentissage de la dialectique, que Jean
Gattegno40 appelle « l’art de la question », prend un tout autre sens :
— Il faut répondre à nos questions, mon cher Pouf. […] Vous voilà ligoté sur notre table
d’opération. Alors, maintenant que vous êtes à table, il est temps de vous mettre à table.
[…]
La jambe de Pouf est tout ouverte, il y a dans l’ouverture des… des petits trucs de métal, là,
des élargisseurs, je sais pas comment appeler ça, fuck ! mais ça maintient la chair largement
écartée ! Ostie ! pis le sang qui coule ! Chair est penché sur l’ouverture […]41.
La transposition du caractère des personnages de Lewis Carroll va dans le sens d’une
corruption de leurs traits majeurs : le Bien et le Beau ont cédé la place au Mal et au Laid, et ce
qui était innocent est devenu pervers. Ainsi, Le Lapin Blanc est pédophile, la reine une
meurtrière, la Duchesse une prostituée, le Ver à Soie un junkie, le Lièvre de Mars et le
Chapelier des psychopathes et le Chat de Cheshire un zombie. Toutes ces transpositions
indiquent le caractère ludique de la réécriture hypertextuelle. Par ailleurs, comme le souligne
le terme d’« écritures doubles42 » que Frank Wagner préfère donner aux procédés
hypertextuels de Genette, l’hypertextualité génère des doubles de l’hypotexte dans
l’hypertexte. Aussi, la transposition de chacun de ces personnages ainsi que de l’action reflète
le côté sombre de l’univers carrollien.
Hypertexte et construction identitaire
Dans la mesure où l’hypertexte a souvent valeur de commentaire43 de l’hypotexte dont
il est produit, nous pouvons en déduire que Patrick Senécal ne s’est pas adonné à cet exercice
de transposition par simple jeu. L’exacerbation du caractère corrompu de chaque personnage
de Carroll semble dire que les contes victoriens ne seraient pas aussi innocents que leur
appartenance à la littérature jeunesse le laisse croire. Le portrait de Carroll en pédophile actif
sous-entend par ailleurs que le révérend Dodgson n’était peut-être pas celui qu’il voulait faire
croire.
Comme en témoigne la question que Verrue et la reine Rouge posent à l’héroïne –
« Qui es-tu […] ?44 » –, la quête identitaire est au centre du roman. Cependant, le sujet de
cette quête n’est pas seulement la jeune fille. Charles l’est également, en tant que double de
Carroll, mais également en tant qu’artiste. En ce sens, l’hypertextualité permet de comprendre
cette recherche identitaire de l’écrivain puisque, comme le souligne Frank Wagner, cette
quête peut se résumer de la façon suivante : « Deviens qui tu es, via autrui.45 » Charles doit
donc se réaliser en tant qu’artiste, via Carroll. Or, le fait que Wagner définisse
Clotilde Landais L’hypertextualité dans Aliss de Senécal Septembre 2008
7
l’hypertextualité en reprenant une formule de Nietzsche est intéressant car le philosophe
constitue, après Carroll et Sade, une troisième référence extradiégétique dans le roman
québécois. Cette référence chez Senécal s’explique par la conception que le philosophe donne
de l’artiste. En effet, pour Nietzsche, l’artiste est l’incarnation du surhomme, puisque la
puissance du surhomme :
est essentiellement celle du créateur, associant le bien et le mal, le négatif et le positif,
l’instinctif et le rationnel […]. Le surhomme est prioritairement un artiste ! Aimer, pour lui,
c’est prodiguer des formes, c’est travailler une matière pour qu’elle rayonne de l’éclat de la
beauté46.
Ainsi, le rapprochement entre Charles et la pensée de Nietzsche placerait Charles
comme surhomme : il est effectivement créateur, car sculpteur dans la diégèse. Par ailleurs, il
associe le bien et le mal, le négatif et le positif par la confrontation de l’hypotexte – qui
représente le bien, l’innocence – et de l’hypertexte – qui représente le mal. Enfin, par les
formes qu’il prodigue à sa sculpture, il cherche à la faire rayonner de beauté, bien que cela
passe par le travail de tissus morts.
L’artiste fictif cherche à retrouver la beauté d’Alice Liddell en créant une sculpture à
visage féminin. Dans le récit, cette sculpture représente donc une métaphore de
l’hypertextualité qui unit Aliss aux contes de Carroll : en partant de restes humains (à valeur
d’hypotexte), Charles crée un nouveau visage (l’hypertexte). Mais l’assemblage qui en résulte
est d’une laideur horrible, tout comme le Wonderland québécois est corrompu par rapport au
Wonderland victorien. Ainsi, la confrontation des deux hypertextes – le roman québécois d’un
côté et la sculpture de l’autre – permet de dégager deux identités artistiques opposées, dont
l’une est le double de l’autre. Charles construit donc son identité artistique en opposition à
celle d’un autre artiste dont il est le double, Lewis Carroll.
En effet, dans la mesure où « [l]’écriture hypotextuelle est […] lecture, ou plutôt
relecture (“en acte” dirait Genette) de son hypotexte fondateur47 », il faut considérer le résultat
produit par Charles comme correspondant à son idéal de beauté, comme en attestent ses
expressions faciales tandis qu’il y travaille : « Toutes sortes d’émotions se succèdent sur son
visage tourmenté : béatitude, colère, horreur, désespoir, mélancolie, bonheur, remords…48 »
Ainsi, à travers cette métaphore de l’hypertextualité basée sur l’œuvre de Lewis Carroll,
Patrick Senécal donne sa relecture des contes victoriens : si Charles, double de Carroll, en
prétendant chercher la beauté, produit l’horreur, alors Carroll, en prétendant raconter une
« belle histoire », a en fait déguisé ses fantasmes pédophiles. Les transpositions allant dans le
sens d’une corruption des personnages victoriens servent à appuyer cette relecture.
L’hypertextualité permet donc de révéler la vraie nature de Lewis Carroll par l’intermédiaire
de Charles, son double corrompu.
Clotilde Landais L’hypertextualité dans Aliss de Senécal Septembre 2008
8
Ouvrages cités
L. CARROLL [1865 et 1871], Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-
Glass and What Alice Found There, M. GARDNER (ed.), The Annotated Alice,
Harmondsworth, Penguin, 1960.
L. CARROLL [1865], Les aventures d'Alice au pays des merveilles, Paris, J’ai Lu, coll.
« Librio », 2000.
L. CARROLL [1871], Alice à travers le miroir, Paris, J’ai Lu, coll. « Librio », 2002.
J. GARNIER, « Nietzsche (F.) » Encyclopedia Universalis sur Cd-rom.
J. GATTEGNO, L’univers de Lewis Carroll, Paris, José Corti, 1990.
G. GENETTE, Palimpsestes : la littérature au second degré, Paris, Seuil, coll. « Poétique »,
1982.
P. HELLEGOUARC’H, « Écriture mimétique : essai de définition et situation au XXe siècle »,
Formules, No 5, Paris, Noésis, 2001, pp.100-118.
J.-J. LECERCLE, Alice, Paris, Autrement, coll. « Figures mythiques », 1998.
F. NIETZSCHE [1892], Also sprach Zarathustra, Ditzingen, Reclam, 1978.
F. NIETZSCHE [1892], Ainsi parlait Zarathoustra, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1985.
D. A. F. de SADE [1799], La nouvelle Justine, Paris, 10/18, 1998.
P. SENÉCAL, Aliss, Beauport, Alire, coll. « Fantastique », 2000.
F. WAGNER, « Les hypertextes en questions (Note sur les implications théoriques de
l’hypertextualité) », Études Littéraires, Vol. 34, No 1-2, Hiver 2002, pp.297-314.
1 P. SENECAL, Aliss, Beauport, Alire, coll. « Fantastique », 2000. 2 L. CARROLL [1865 et 1871], Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass and What
Alice Found There, M. GARDNER (ed.), The Annotated Alice, Harmondsworth, Penguin, 1960. Dans la mesure
où Senécal les mêle dans son roman, nous considérons que les deux textes de Carroll ne constituent qu’une seule
base référentielle. 3 G. GENETTE, Palimpsestes : la littérature au second degré, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1982, p.13. 4 Ibid., p.16. 5 Ibid., p.19. 6 L’héroïne de Senécal s’appelle également Alice, mais puisqu’elle modifie l’orthographe de son nom en arrivant
au Wonderland, nous utiliserons cette autre orthographe pour la distinguer de l’héroïne de Carroll. 7 P. SENECAL, Aliss, op. cit., p.1. Ce que l’on retrouve dans les passages où Alice récite les bonnes manières que
l’on lui a inculquées, comme par exemple : « — Vous devriez apprendre à ne pas faire de remarques
personnelles, dit Alice non sans sévérité. C’est très grossier. » L. CARROLL, Les aventures d’Alice au pays des
merveilles, op. cit., p.50 [“‘You should learn not to make personal remarks,’ Alice said with some severity; ‘it's
very rude.’” L. CARROLL, Alice’s Adventures in Wonderland, op. cit., p.94]. 8 Ibid., p.3. Ce passage fait référence au suivant : « Alice commençait à en avoir marre d’être assise au bord de
l’eau, près de sa soeur, à ne rien faire […].” Ibid., p.7 [“Alice was beginning to get very tired of sitting by her
sister on the bank, and of having nothing to do […].” Ibid., p.25].
Clotilde Landais L’hypertextualité dans Aliss de Senécal Septembre 2008
9
9 Ibid., p.4. Ce passage fait référence au suivant : « […] Alice se leva d’un bond, car, en un éclair, elle réalisa
qu’elle n’avait jamais vu un lapin avec un gousset et une montre à en sortir. Dévorée de curiosité, elle le suivit à
travers champs […]. Ibid. » [“[…] Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never
before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she
ran across the field after it […].” Ibid., p.26]. 10 J.-J. LECERCLE, Alice, Paris, Autrement, coll. « Figures mythiques », 1998, p.17. 11 P. SENECAL, Aliss, op. cit., p.496. Ceci est notifié dans les contes de Carroll par les nombreux « Nonsense ! »
qui échappent à l’héroïne. 12 J. GATTEGNO, L’univers de Lewis Carroll, Paris, José Corti, 1990, p.234. 13 P. SENECAL, Aliss, op. cit., p.19. 14 Ibid., p.383. Qui correspond au : « — Qu’on lui coupe la tête ! » L. CARROLL, Les aventures d’Alice au pays
des merveilles, op. cit., p.59 [“Off with her head!” L. CARROLL, Alice’s Adventures in Wonderland, op. cit.,
p.109]. 15 Ibid., p.185. Ce passage fait référence au suivant : « — Je ne savais pas que les chats du Cheshire souriaient
tout le temps ; en fait, je ne savais pas que les chats pouvaient sourire. » Ibid., p.43 [“I didn’t know that Cheshire
cats always grinned; in fact, I didn’t know that cats COULD grin.” Ibid., p.83]. 16 Ibid., p.45. Ce passage fait référence au suivant : « […] comme Alice ne parvenait pas à trouver de bonne
raison et comme l’état d’esprit du Chenillon lui semblait très déplaisant, elle lui tourna le dos. / […] Alice ne dit
rien; jamais on ne l’avait si souvent contredite de sa vie, et elle sentait qu’elle commençait à perdre son calme. »
Ibid., p.35 et 37 [“[…] as Alice could not think of any good reason, and as the Caterpillar seemed to be in a VERY
unpleasant state of mind, she turned away. / […] Alice said nothing: she had never been so much contradicted in
her life before, and she felt that she was losing her temper.” Ibid., pp.68 et 72]. 17 Ibid., p.272. Ce passage fait référence au suivant : « — Tenez ! Vous pouvez pouponner, si ça vous chante !
dit la Duchesse à Alice, et, à ces mots, elle lui lança le bébé. » Ibid., p.45 [“‘Here! you may nurse it a bit, if you
like!’ the Duchess said to Alice, flinging the baby at her as she spoke.” Ibid., p.85]. 18 Ibid., p.306. Ce passage fait référence au suivant : « — Vous prendrez bien un peu plus de thé, dit le Lièvre de
Mars, sans la moindre ironie. » Ibid., p.54 [“‘Take some more tea,’ the March Hare said to Alice, very
earnestly.” Ibid., p.101]. 19 Ibid., p.309. Ce passage fait référence au suivant : « — Si vous connaissiez le Temps aussi bien que moi, dit le
Chapelier, vous ne parleriez pas de perdre mon temps. Ce n’est pas mon temps, mais le Temps. » Ibid., p.51 [“‘If
you knew Time as well as I do,’ said the Hatter, ‘you wouldn’t talk about wasting IT. It’s HIM.’” Ibid., p.97]. 20 Ibid., pp.16-17. 21 Ibid., p.19. 22 Ibid., p.147. 23 Ibid., p.139. 24 Ibid., p.17. 25 Ibid., pp.15-16. Ce passage fait référence au suivant : « [E]lle le suivit à travers champs et eut juste le temps de
le voir s’engouffrer dans un vaste terrier sous la haie. / L’instant d’après, Alice y descendait à sa suite […]. / Le
terrier descendait à pic comme un tunnel, puis plongeait en coude […]. » L. CARROLL, Les aventures d’Alice au
pays des merveilles, op. cit., p.7 [“[S]he ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it pop
down a large rabbit-hole under the hedge. In another moment down went Alice after it […]. / The rabbit-hole
went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down […].” L. CARROLL, Alice’s
Adventures in Wonderland, op. cit., p.26]. 26 G. GENETTE, Palimpsestes, op. cit., p.291. 27 P. SENÉCAL, Aliss, op. cit., p.291. 28 Ibid., p.303. 29 Ibid., pp.189-190. 30 J.-J. LECERCLE, Alice, op. cit., p.41. 31 J. GATTEGNO, L’univers de Lewis Carroll, op. cit., p.76. 32 Ibid., pp.375-377. 33 D. A. F. de SADE [1799], La nouvelle Justine, Paris, 10/18, 1998. 34 L. CARROLL, Les aventures d’Alice au pays des merveilles, op. cit., p.69 [“‘Why, SHE,’ said the Gryphon.
‘It’s all her fancy, that: they never executes nobody, you know.’” L. CARROLL, Alice’s Adventures in
Wonderland, op. cit., p.125]. 35 P. SENÉCAL, Aliss, op. cit., p.503. 36 Ce passage fait référence au suivant : « Elle se haussa sur la pointe des pieds et lança un coup d’œil par-dessus
le bord du champignon : immédiatement, son regard croisa celui d’un gros Chenillon bleu, qui était assis tout là-
haut, les bras croisés, fumant tranquillement un long houka sans prêter la moindre attention à Alice ou à quoi que
ce soit. » L. CARROLL, Les aventures d’Alice au pays des merveilles, op. cit., p.33 [“She stretched herself up on
Clotilde Landais L’hypertextualité dans Aliss de Senécal Septembre 2008
10
tiptoe, and peeped over the edge of the mushroom, and her eyes immediately met those of a large caterpillar, that
was sitting on the top with its arms folded, quietly smoking a long hookah, and taking not the smallest notice of
her or of anything else.” L. CARROLL, Alice’s Adventures in Wonderland, op. cit., p.66]. 37 P. SENECAL, Aliss, op. cit., pp.175 et 178. 38 Ce passage fait référence au suivant : « Et elle se serra de plus en plus contre Alice tout en parlant. / Alice
n’aimait pas trop qu’elle la colle d’aussi près ; premièrement, parce que la Duchesse était tellement laide ; et
deuxièmement, parce qu’elle avait exactement la taille requise pour pouvoir appuyer son menton sur l’épaule
d’Alice, et c’était un menton très pointu des plus désagréables. Cependant, elle n’aimait pas être impolie ; elle
prit donc son mal en patience. » L. CARROLL, Les aventures d’Alice au pays des merveilles, op. cit., p.67 [“And
she squeezed herself up closer to Alice's side as she spoke. […] Alice did not much like keeping so close to her:
first, because the Duchess was VERY ugly; and secondly, because she was exactly the right height to rest her chin
upon Alice's shoulder, and it was an uncomfortably sharp chin. However, she did not like to be rude, so she bore
it as well as she could.” L. CARROLL, Alice’s Adventures in Wonderland, op. cit., p.120]. 39 P. SENÉCAL, Aliss, op. cit., p.388. 40 J. GATTEGNO, L’univers de Lewis Carroll, op. cit., p.235. 41 P. SENECAL, Aliss, op. cit., pp.307 et 316. 42 F. WAGNER, « Les hypertextes en questions (Note sur les implications théoriques de l’hypertextualité) »,
Études Littéraires, Vol. 34, No 1-2, Hiver 2002, p.297. 43 G. GENETTE, Palimpsestes, op. cit., p.17. 44 P. SENECAL, Aliss, op. cit., p.49. 45 F. WAGNER, « Les hypertextes en question », op. cit., p.307. 46 J. GARNIER, « Nietzsche (F.) » Encyclopedia Universalis sur Cd-rom. 47 F. WAGNER, « Les hypertextes en question », op. cit., p.302. 48 P. SENÉCAL, Aliss, op. cit., p.149.