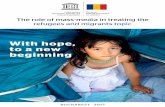Trafficking in migrants : illegal migration and organised crime ...
Les migrants marocains: une mondialisation par le bas
Transcript of Les migrants marocains: une mondialisation par le bas
g é o p o l i t i q u e , g é o é c o n o m i e , g é o s t r a t é g i e e t s o c i é t é s d u m o n d e a r a b o - m u s u l m a n
Avril-Juin 2012 • 10,95 €Magazine trimestriel • Numéro 14
AfghAnistAn : LA reconversion des seigneurs de LA guerre
www.mo
yenorient-presse.com
3:HIKROB=^VU^Z[:?a@a@l@e@k;
M 07
419 -
14 - F
: 10,9
5 E - R
Dgéopolitique
du MarocLe réveiL démocratique
de La monarchie ?
entretien exclusif avec hasni abidiL’avenir du monde arabe
damasUne ville sous le contrôle de Bachar al-Assad
médiasLe succès des émissions islamiques
artLa révolution comme source d’inspiration
14CANADA : 15,95 CAD • ÉTATS-UNIS : 18 USD
• SUISSE : 20 CHF • ALLEM
AGNE/BELGIQUE/GRÈCE/PO
RTUGAL : 12 EU
R • AU
TRICHE : 12,50 EUR • CAMEROUN/CÔTE D’IVOIRE/GABO
N/SÉN
ÉGAL : 7 500 CFA • MARO
C : 130 MAD • DOM : 10,95 EU
R • PO
LYNÉSIE FRA
NÇAISE/NOUVELLE-CALÉDONIE : 1 500 CFP
60
78
10
© Xinhu
a/Yin Bogu
© D
eird
re K
line
© Shu
tterstock/Rafal Cichawa
6 Actualités - Agenda10 Regard de Hasni Abidi sur l’avenir du monde arabe
DOSSIER MAROC 15
16 Repères Maroc : Cartographie 18 L’« exception » marocaine : stabilité et dialectique de la réforme Baudouin Dupret et Jean-Noël Ferrié
24 Des islamistes au service du roi ? Haouès Seniguer
30 « Soutenir la révolution dans le monde arabe est un devoir » Entretien avec Abdellah Taïa
34 Repères religion : Les contradictions d’une jeunesse plus conservatrice Mohammed-Sghir Janjar
36 Repères économie : Quelle croissance dans un Maroc en pleine transition ? Mouna Cherkaoui
40 Sahara occidental : les enjeux politiques du développement KarineBennafla
46 Les migrants marocains : une mondialisation par le bas Mehdi Alioua
50 Le Maroc dans le contexte régional maghrébin Pierre Vermeren
56 Maroc - États-Unis : un axe stratégique au Maghreb Bichara Khader
GÉOPOLITIQUE 60
60 Bilan et perspectives géopolitiques de la barrière israélienne David Amsellem
66 Révolution et télévision : l’avènement de l’islam « cathodique » KalthoumSaâfiHamda
POINTS CHAUDS 71
GÉOÉCONOMIE 72
72 Afghanistan : la guerre des qumandan pour le contrôle des terres Fariba Adelkhah
VILLES • ART 78
78 Une ville sous le contrôle du Baas : Damas, capitale de la Syrie Fabrice Balanche
86 Le « printemps des rues » : une création arabe contemporaine en mutation Nadia Radwan et Aminata Tembély
BD • LIVRES • WEB 92
SommaireMoyen-Orient no 14 • Avril - Juin 2012
Moyen-Orient 14 • Avril - Juin 2012 5
72
15© M
AP
© François Fleury
Moyen-Orient 14 • Avril - Juin 2012 15
D O S S I E R
Le réveil démocratique de la monarchie ?
En France, le Maroc est d’abord vu comme une destination touristique. Un imaginaire qui permet à Mohammed VI de jouir d’une bonne image. Or ce dernier a dû réagir face au « printemps arabe » avant que les protestations ne remettent en cause son pouvoir (p. 18). Après une modification de la Constitution et des élections législatives en 2011, les islamistes gouvernent pour la première fois, pro-mettant de préserver l’« exception marocaine » (p. 24). Les défis restent nombreux, comme la pau-vreté (p. 36) ou la question du Sahara occidental (p. 40). Dans un Maghreb en transformation (p. 50), le royaume cherche à se maintenir comme partenaire privilégié de l’Occident (p. 56).
GÉOPOLITIQUE DU MAROC
Mohammed VI et son frère © AFP PHOTO/POOL Philippe Wojazer
46 Moyen-Orient 14 • Avril - Juin 2012
Mehdi AliouaDocteur en sociologie, enseignant-chercheur à l’université internationale de Rabat et associé au Centre Jacques Berque pour les études en sciences sociales et humaines au Maroc
D O S S I E R M A R O C
© Shutterstock/rj lerich
A près une émigration massive dans les années 1950-1960 due à la mobilisation inter-nationale de la main-d’œuvre ouvrière par la France et d’autres pays d’Europe, le royaume
alaouite est resté sans discontinuité un pays migratoire et il est aujourd’hui encore une source importante de migrants, avec un flux annuel dépassant les 100 000 personnes. Le nombre de Marocains résidant à l’étranger a plus que doublé entre 1993 (1,5 million) et 2007 (3,3 millions), selon des chif-fres officiels. On évoque même 4,5 millions pour 2011. Cette croissance tient au fait que les enfants de migrants, bénéficiant
des évolutions législatives en leur faveur et d’un meilleur ac-cueil, s’y sont inscrits. Au-delà des statistiques, c’est l’impact économique, social et politique qui est considérable. Aussi, un ensemble de dispositions juridiques, de lois, de politiques gouvernementales, d’institutions et de groupes de réflexion ont-ils été créés pour encadrer les migrations et tenter d’en tirer profit : il s’agit pour le Maroc de développer une politi-que plus efficace et globale lui permettant de garder un lien fort avec ses ressortissants et leur descendance, d’assurer la pérennité des transferts de fonds et de « stimuler » les inves-tissements des migrants (cf. Repères p. 16-17).
Les migrants marocains :une mondialisation par le bas
Les Marocains résidant à l’étranger sont pour le royaume un levier économique et politique. Grâce à eux, le Maroc s’assure des entrées de fonds qui atteignent plus de 5 milliards d’euros par an. Des politiques publiques ont d’ailleurs été mises en place pour couver cette « poule aux œufs d’or ». Nous assistons dès lors à l’émergence d’une mondialisation par le bas (1), produite par les migrants, devenus un « joker diplomatique » pour Rabat.
Moyen-Orient 14 • Avril - Juin 2012 47
Ces dix dernières années, le Maroc a connu une activité législa-tive, politique et diplomatique intense concernant la migration, avec, par exemple, la réforme globale du cadre juridique la ré-gissant qui datait, jusqu’à la loi no 02-03 du 11 novembre 2003 sur « l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc, l’émigra-tion et l’immigration irrégulières », du protectorat français (1912-1956). Sous la pression de l’Union européenne (UE), le royaume a dû se montrer rassurant quant à sa capacité à contrôler ses frontières et l’émigration dite « irrégulière », et ce, dans un contexte post-11 septembre 2001 et à l’heure où la migration dite de « transit », notamment celle des Afri-cains subsahariens, était une préoccupation majeure de l’UE. À travers cette norme essentiellement répressive, le Maroc es-père accentuer la coopération avec les Vingt-Sept par des par-tenariats de mobilité et maintenir (voire augmenter) le nombre de visas pour ses ressortissants. Il se positionne comme un allié stratégique de l’UE dans sa vision de plus en plus sécuritaire de la migration, bénéficiant au passage de plusieurs dizaines de millions d’euros pour l’aider à mieux contrôler ses frontières.Adopté en 2007, le Code de la nationalité autorise la transmis-sion de celle-ci par la mère, quel que soit le lieu de naissance. Ce texte, qui inclut d’autres dispositions permettant de ne pas perdre le lien avec les enfants de migrants marocains nés hors
du pays, est renforcé par la Constitution de 2011, qui consacre la double nationalité. De plus, les Marocaines et les Marocains résidant à l’étranger sont devenus électeurs et éligibles, même si cela ne s’applique pas encore réellement. Enfin, un ensemble d’institutions et d’organisations ont été créées, comme le mi-nistère chargé des Marocains résidant à l’étranger ou le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).
• Une « porte d’entrée » en Europe
La migration devient un enjeu majeur pour la politique inté-rieure et étrangère du Maroc, qui ne manque pas de l’utiliser régulièrement comme « joker diplomatique » en rappelant à ses interlocuteurs européens que de nombreux Marocains vi-vent dans tel ou tel pays, ou, de manière plus sécuritaire, qu’en tant que « porte d’entrée » en Europe, il est un partenaire stra-tégique incontournable. Le royaume espère ainsi tirer profit de sa position géographique et fonde ses espoirs de croissance sur un arrimage réussi à l’UE.Les migrations internationales et leurs liens avec le dévelop-pement occupent donc au Maroc une large place dans les
Des Marocaines font la queue à Mohammedia pour obtenir un emploi en Espagne.© AFP Photo/Abdelhak Senna
48 Moyen-Orient 14 • Avril - Juin 2012
Les migrants marocains : une mondialisation par le basD O S S I E R • M A R O C Les migrants marocains : une mondialisation par le bas
discussions entre experts sur la gouvernance, devenant même pour ce pays un « atout » dans les relations internationales. Cela est possible, car la question du développement dans l’approche étatique de gestion des migrations a été l’une des priorités du calendrier politique mondial au cours des dernières années. Il s’agit d’accompagner des actions de plus en plus restrictives et sécuritaires vis-à-vis des migrations internationales, à la fois par une plus grande inclusion des questions de développement et une meilleure intégration des questions migratoires dans les pro-cessus de planification. C’est ainsi que le Maroc, parmi les insti-gateurs de la Convention des Nations unies pour la protection des droits des travailleurs migrants, a réussi à devenir un acteur diplomatique important en ce qui concerne la migration et a été à l’initiative de la Conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement organisée à Rabat en 2006. La migration internationale n’est donc pas qu’une rente budgétaire pour le Maroc, elle est aussi un outil politique.Dans le même mouvement, la politique d’ouverture du royaume à la mondialisation s’accélère : le pays espère s’an-crer à l’espace euro-méditerranéen en devenant un carrefour. Depuis l’accession au pouvoir de Mohammed VI en 1999, il s’est lancé dans cet immense chantier, avec la modernisation et le développement économique comme enjeu et la prolifé-ration des stratégies d’attraction des investissements directs à l’étranger (IDE) comme moyen. Pour cela, il s’agit, d’une part, de développer les infrastructures, particulièrement celles des voies de communication et de télécommunication, et, d’autre part, de faire évoluer les institutions, les règles et les normes vers cette nouvelle politique économique : adhésion à des zo-nes de libre-échange, création de zones franches, privatisations, ouverture supplémentaire au commerce avec suppression (ou diminution) des barrières non tarifaires, réduction des coûts de transaction, convertibilité du compte de capital, flexibilité du marché du travail, etc. La stratégie du Maroc est de devenir une zone de circulation, de passage et de transit, une plate-forme, un hub… La région Tanger-Tétouan, au nord-ouest,
est utilisée comme levier de cette stratégie, notamment avec la zone « Tanger Med » : l’État marocain y a fait construire un immense port, des zones franches ainsi que des stations balnéaires. Ici, tout ou presque est consacré aux circulations, à leurs différentes formes, à leurs convergences et à leurs inter-connections : import-export, transbordement, assemblage pour export, fret, réexportation, transport de populations, lignes à grande vitesse (avec le TGV français pour 2015), autoroutes, tourisme, loisirs, centres d’affaires, etc.Si, en s’ouvrant de la sorte, le Maroc se développe et se mo-dernise d’un côté, de l’autre, les inégalités interpersonnelles et entre les territoires s’accroissent : des zones de pauvreté ne profitent aucunement de cette croissance produite par l’ouver-ture à la mondialisation. Pour autant, certains Marocains ne restent pas à attendre que la richesse vienne à eux : ils prennent des initiatives et tentent de pallier leur exclusion. La migration, interne ou internationale, le contournement de certaines fron-tières ou règles administratives, l’économie souterraine, la « débrouille » font partie de ces initiatives. Et paradoxalement, grâce au développement de certains secteurs du Maroc, cela devient plus facile et plus tentant : routes, Internet, téléphonie mobile, alphabétisation, concentration de richesses et de mar-chés, agences facilitant les transferts d’argent, etc. Autrement dit, les mouvements de populations, qui sont les premiers vec-teurs des relations économiques, s’intensifient grâce aux évolu-tions politiques et aux infrastructures financées principalement par les États dans le but de développer leur pays. De ce point de vue, l’accélération relative de croissance que connaît le Maroc, loin de limiter la migration, semble plutôt la favoriser, suggérant alors que le lien entre développement et migration n’est pas aussi simple que le conçoivent certains décideurs.
• Une économie de la « débrouille »
Ce sont les grandes cités comme Rabat, Casablanca ou Tanger qui deviennent aujourd’hui des carrefours migratoires. Tous les jours, des milliers de Marocaines et de Marocains débarquent dans les villes à la recherche de solutions, participant ainsi à l’urbanisation massive que connaît le pays. Et c’est depuis ces trois villes principales que l’on migre aujourd’hui vers l’inter-national, alors que l’on émigrait depuis la campagne et les pe-tits douars : plus du tiers des nouveaux émigrants y ont vécu au moins un an avant leur départ (2). De plus, ces trois villes deviennent aussi des lieux de retour pour certains migrants marocains vivant à l’étranger qui préfèrent souvent revenir en vacances ou se réinstaller dans une ville proche de ce qu’ils ont connu à l’étranger, plutôt que dans leur douar d’origine. Enfin, elles accueillent également des migrants étrangers, des Européens, des Asiatiques, des Maghrébins et de plus en plus d’Africains subsahariens. Bref, elles deviennent des lieux de départ, de passage, d’installation et de retour, c’est-à-dire des carrefours migratoires.Ces derniers émergent souvent des quartiers populaires pé-riphériques de ces grands centres urbains qui sont d’anciens
Des Subsahariens bloqués dans un centre d’accueil à Melilla, enclave espagnole au Maroc.
© AFP Pho
to/Abd
elhak Senn
a
Les migrants marocains : une mondialisation par le bas
Moyen-Orient 14 • Avril - Juin 2012 49
Les migrants marocains : une mondialisation par le bas
bidonvilles où les migrants de l’intérieur (et aujourd’hui d’Afrique subsaharienne), souvent en situation de déshérence lorsqu’ils font leur « entrée en ville », ont dû se reconstituer une « vie sociale » : ils ont aménagé collectivement ces es-paces sur lesquels ils circulent, dans lesquels ils s’installent et qu’ils finissent par « habiter ». Ces lieux, connectés au monde grâce aux circulations migratoires, deviennent les supports d’une mondialisation par le bas. En effet, beaucoup d’habi-tants de ces quartiers périphériques survivent au moyen des mandats envoyés par un proche qui a migré à l’étranger ; et beaucoup de petites maisons y ont été construites à l’aide de ces transferts, passant de la tôle au dur, transformant donc le paysage urbain. Les difficultés d’accès au crédit bancaire pour ces populations font que l’autofinancement représente 80 % des logements réalisés (3).Généralement, ces nouveaux propriétaires construisent étage par étage et financent leur investissement et leurs travaux au fur et à mesure en louant. La plupart des locataires sont compo-sés de nouveaux migrants de l’intérieur, venus grossir les rangs des travailleurs précaires en laissant derrière eux leur famille à qui ils envoient la plus grande partie de leur modeste salaire. Avec le temps, certains d’entre eux décident de s’installer et changent de mode d’habitation, devenant parfois eux-mêmes propriétaires et/ou élaborant des projets d’émigration interna-tionale, mais sont remplacés par de nouveaux venus. En outre, depuis les années 2000, les migrants subsahariens représentent aussi une part importante et sous-estimée de ces locataires. Même si, pour beaucoup, le Maroc n’est qu’une étape menant à l’Europe, ils participent à l’économie de la « débrouille », cet « entre pauvres », et permettent à certaines familles maro-
caines de s’assurer un petit revenu ou de devenir propriétaires. Nous assistons bien à l’articulation entre différents régimes de mobilité et à l’émergence d’une économie de la circulation, c’est-à-dire, au même titre que la zone franche de « Tanger Med », à un carrefour. En s’ouvrant de la sorte, le Maroc entre de plain-pied dans la mondialisation économique. Dans des formes similaires, les oubliés de cette politique de développe-ment économique teintée de néolibéralisme essaient, souvent contre ou en concurrence avec l’État, eux aussi d’y entrer : pendant que Rabat change ses lois, développe ses infrastruc-tures, adhère à des zones de libre-échange, définit des plans d’action visant l’intégration socio-économique, culturelle et politique des Marocains à l’étranger, peaufine sa diplomatie et sa communication en matière migratoire, met en place des politiques facilitant les transferts financiers et les retours, etc., ces populations produisent une mondialisation par le bas qui intègre bien plus profondément qu’on ne le pense ce pays à l’espace euro-méditerranéen. n
Mehdi Alioua
(1) Alain Tarrius, La Mondialisation par le bas. Les nouveaux nomades de l’économie souterraine, Bal-land, 2002.
(2) Mehdi Alioua, « Nouveaux et anciens espaces de circulation in-ternationale au Maroc. Les grandes villes marocaines, relais migratoires
émergents de la migration transna-tionale des Africains subsahariens au Maghreb », in Revue d’étude des mondes musulmans et de la Méditer-ranée, no 119-120, novembre 2007, p. 39-58.
(3) Haut Commissariat au plan du Maroc, 2005. •
••N
ot
es•••
Les grandes villes, comme ici Casablanca, attirent les migrants intérieurs, venus des campagnes.
© Shutterstock/rj lerich