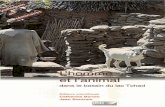Architecture et remplissage sédimentaire du bassin profond ...
Les faunes de vertébrés Jurassiquesde la bordure Nord-Orientale du Bassin d'Aquitaine (France):...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Les faunes de vertébrés Jurassiquesde la bordure Nord-Orientale du Bassin d'Aquitaine (France):...
A ·/ / ! 1 î
LES FAUNES DE VERTÉBRÉS JURASSIQUES DE LA BORDURE NORD-ORIENTALE DU
BASSIN D'AQUITAINE (FRANCE) : BIOCHRONOLOGIE ET ENVIRONNEMENTS
PATRICK VIGNAUD, FRANCE DE BROIN, MICHEL BRUNET, ELIE CARIOU, PIERRE HANTZPERGUE & BRIGITTE LANGE-BADRE
VIGNAUD P., DE BROIN F., BRUNET M., CARIOU E., HANTZPERGUE P. & LANGE-BADRE B. 1994. Les faunes de vertébrés jurassiques de la bordure Nord-Orientale du Bassin d'Aquitaine <France) : biochronologie et · environnements. IJurassic Vertebrale faunas from the North-Eastern border of the Aquitaine Basin (France) : biochronology and environmentsl. GEOBIOS, M.S. 17: 493-503.
RÉSUMÉ
Depuis la seconde moitié du 19ème siècle, le Jurassique de la bordure Nord-orientale du Bassin d'Aquitaine a livré de nombreux fossiles de vertébrés continentaux (Poissons et Chéloniens dulçaquicoles, Sphénodontidés, Crocodiliens et Dinosauriens), littoraux ou lagunaires (Sélaciens et Chéloniens) et marins (Poissons, Ichtyosauriens, Sauroptérygiens et Thalattosuchiens). La biochronologie des gisements a été révisée. La comparaison des caractères sédimentologiques et des caractères biologiques permet de préciser le milieu de vie des faunes et le paléoenvironnernent de chacun des gisements.
MOTS-CLÉS : VERTÉBRÉS, JURASSIQUE, BASSIN D'AQUITAINE, CONTINENTAL, MARIN, BIOCHRONOLOGIE, El\'VIRONNE!\ŒNTS.
A.BSTRACT
Since the second part of 19th century, the Jurassic of the Aquitaine basin (north-eastern border) has yielded numerous fossil vertebrales from the continental area (freshwater fishes and chelonians, sphenodontids, crocodili a ns ru1d tlinosaurs), the littoral domain (selachians and chelonians) and the marine domain (fishes, ichtyosauriruls, sauroplerygians and thalaltosuchians). The biochronology of the localities is re,·iewed. Comparison between sedimentological characters and biological characlers yields more precise details the !ife type of the different faunas and on the paleoenvironment of the localities.
KEY-WORDS : VERTEI3RATES, JliHASSIC, AQUIT AINE BASIN, CONTINENTAL, MARINE, DIOCHRONOLOGY, ENVIRON~IENTS.
INTRODUCTION
Depuis le siècle dernier, le Jurassique de la bordure nord-orientale du Bassin d'Aquitaine a livré des vertébrés provenant d'une quarantaine de gisements (Fig. 1). Si les récoltes anciennes sont parfois difficilement utilisables, les gisements récemment décrits apportent des précisions importantes sur les paléoenVironnements. De plus ces gisements sont parfaitement repérés stratigraphiquement et leur faune est bien connue. Ils s'étagent du domaine continental au domaine marin relativement profond et se répartissent de l'Hettangicn au Tithonien inférieur.
Lors de l'étude des gisements mésozoïques, il apparaît fréquemment des décalages, parfois importants, entre les interprétations paléoenvironnementales déduites de la sédimentologie et celles résultant de la paléontologie.
Le but de ce travail est donc double : d'une part, préciser le milieu de vie de certains animaux, et d'autre part, apporter des données nouvelles sur les paléoenvironnements et la paléogéographie du Bassin d'Aquitaine pendant le Jurassique. Pour cela, nous avons comparé le biotope des faunes et les caractères sédimentaires de chaque gisement.
0 Ti1hooico A Callovicn
O l(jmméridgicn * O>tbonica
A O>lordicn '(); O•jocicn
LES ENVIRONNEMENTS BIOSÉDIMENTAIRES JURASSIQUES DE LA MARGE NORD-AQUITAINE
Le développement du cycle jurassique s'exprime sur la marge nord-aquitaine par une succession de dépôts de nature variée qui traduisent, selon leur âge et leur contexte géographique, l'installation d'environnements sédimentair~s pouvant être rapportés à un modèle synthétique (Fig. 2). Il convient de souligner le caractère théorique d'un tel modèle, vis à vis de facteurs extrêmement variables d'un étage à l'autre, tels que la différenciation et l'extension respectives des aires paléogéographiques, l'éloignement relatif du domaine continental ou les estimations bathymétriques pour un secteur donné .
..
494
• Aaltnica·T031cica
~ lkn•nsicn
Figure 1 · Situation géogra· phique des gisements à verté· brés jurassiques de la bordure nord-orientale du Bassin d'Aquitaine (les numéros correspondent à ceux de la Fig. 3,
. colonne N .. ). Jurassic rJerte· brate localities from the northeastern border of Aquitaine Basin (for numbers, see Fig. 3 N'""column).
Des environnements continentaux de la Terre armoricaine, puis de la Plate-forme centrale à partir de l'Oxfordien supérieur, aucun sédiment caractéristique ne semble avoir été préservé par l'érosion. Leur proximité est ~ttestée ponctuellement par des dépôts sublittoraux, supratidaux ou lagunaires comme les assises du Lias inférieur à pistes de Dinosaures de Vendée (Gabilly et al. 1978) ou les laminites tithoniennes à empreintes de pas du Quercy (Hantzpergue & Lafaurie 1991). De même, la fréquence des vertébrés terrestres dans les assises évaporitiques du Jurassique terminal charentais indiquerait le voisinage de terres émergées (Buffetaut et al. 1989).
Les environnements confinés résultent soit de leur position interne sur une plate-forme barrée,
495
DOMAINE
CONTINENTAL
DOMAINE MARIN
Milieu confiné
@
® .:. ·.·.· . .
Milieu sublittoral Barri'ére
ou lagunaire ou Haut.lond
Milieu ouvert
Rampe carbonatée Bassin peu profond
distale ~~~-------------------------------.0
50
Figure 2 · Modèle synthétique des environnements sédimentaires du Jurassique nord-aquitain, Synthetic mode/ of Jurassic sedimentary enuironments from ·"-'orth·Aquitaine. Deposite enuironments : Emerged land (AJ ; marine enuironments rB-GJ : B . sublittoral, C · enclosed, D · barrier, E-F · carbonated platform Œ ·proximal part, F ·distal part), G · shallow basin.
soit d'isolements relatifs sur une plate-forme isopaque recouverte d'une faible tranche d'eau. Ainsi, le faciès saumâtre à characées et lignite du Bathonien de St Gaultier (Indre) traduit une sédimentation protégée d'arrière-récifs, tandis que les dépôts évaporitiques du Tithonien charentais expriment le confinement d'un bassin en fin de comblement.
Aux environnements de haut-fond ou de "barrière" correspond notamment l'insularité des paysages du Callovien poitevin : ils allient une flore et une faune terrestres à àes éléments du milieu marin franc.
Le milieu ouvert s'étage sur une rampe carbonatée d'ex-tension variable où. selon la profondeur, il est possible de distinguer deux principaux types d'environnements. Jusqu'à une profondeur avoisinant cinquante mètres, un environnement proximal est marqué par une sédimentation fortement carbonatée, soumise à des apports épisodiques de matériel grossier provenant éventuellement de la barrière ou de la zone littorale. Les associations fauniques y sont dominées par des organismes benthiques. La partte distale de la rampe carbonatée est limitée à une profondeur évaluée à une centaine de mètres. Les sédiments à dominante marna-calcaire renferment des faunes caractérisées par la fréquence relative des formes pélagiques. A titre d'exemple, c'est dans ce contexte, qu'au Kimméridgien supérieur, la vasière virgulienne se développe sur de vastes étendues (Hantzpergue 1989).
Au-delà de la rampe carbonatée, s'individualise un bassin peu profond, à sédimentation marneuse et faune à céphalopodes dominants. C'est
notamment durant le Toarcien, le Callovien, l'Oxfordien et le Kimméridgien moyen que ces envi
. ronnements de bassins s'étendent uniformément sur la plus grande partie de la marge nord aquitaine (Enay et al. 1980 ; Gabilly et al. 1985).
MÉTHODES D'ÉTUDE
Pour chaque gisement, nous avons confronté le "milieu de dépôt" déduit des données sédimentologiques, et le "milieu de vie" correspondant aux associations fauniques (Fig. 3).
Les listes fauniques proviennent de deux sources d'information : celles des anciens auteurs qui nécessitent des révisions taxonomiques et celles reposant sur des études récentes.
Les récoltes anciendes : Parmi la quarantaine de gisements inventoriés, environ la moitié correspond à des découvertes, souvent sporadiques, du siècle dernier. L'imprécision géographique, un repérage stratigraphique vague, ou manifestement erroné et des déterminations pas toujours en accord avec les descriptions rendent parfois ces données inutilisables. Dans ce cas les sites n'ont pas été pris en compte.
Les récoltes récentes : Les gisements récemment décrits sont repérés stratigraphiquement au moins au niveau de la zone. La principale source d'imprécision provient du milieu de vie des animaux. Chez les crocodiles, par exemple, la famille des Teleosauridae est moins adaptée à la vie marine que celle des Metriorhynchidae. Pourtant, leurs restes fossiles sont souvent associés dans les sédiments. La rareté des dépôts continentaux jurassiques fausse
496
1-·----,-Figure 3 - Répartition stratigraphique des gisements à vertébrés jurassiques de la bordure nordorientale du Bassin d'Aquitaine, en fon.ction du contexte biosédimentaire. A-G : contexte biosédimentaire (voir Fig. 2) ; trait plein et pointillé : milieu de vie ; hachures : milieu de dépôt. Colonne Nos"numéros des gisements suivant l'ordre stratigraphique. Colonne "gisements" : localité et numéro du département ; 16, Charente ; 17. Charente-Maritime ; 36, Indre 46, Lot ; 4ï, Lot-etGaronne ; 85, Vendée ; 86, Vienne. Stratigraphie
·position of Jurassic verte·
ET ACES ZONES NOl CIS(MENl s
Gr .a~ 38 Cny>.Uc
Ge .a~ 37 S.~c
Gr .a~ 3G Mooovud z "' Gr .a~ 3S Champ(>Uoc z 0 Gr .a~ l4 Sigogpc x ... ;:: c .... ~ l3 Ou..ïtoo
Gr a~ 32 La Mo.-elhc
7 31 Rouill.ac
Auw.siodo<C..W. JO Fumel
Euodozus 29 Gigouzx
Eudo<usfMuabili> 28 Fl..a.ujac-Poojols
z Eudozus/Mul•bilis v SlCyr
"' (; MuUbili> 0
26 S.Ama.od
ü: . MuUbili> 2.S Good-R..cJlc "' :1: :1: MuUbili> 2A Touvre-A(?.< ;;:
MuUbili> 23 L..o.ogcvüùt.-c
Cymodooc il Le Ch.ty
Cymodocc 2l A)trt
z Pl= W.. 20 FOM<:dcl...oix .... 0 a: Bim..unmo.tum 19 Il ôd>cboa <>< ~ ><
7 lB Poôti.on 0
CorO<U!um 17 Ch.t<=u G aill.ud
z ADttps/CO<O<Wum 16 l..a>'OUX ... >
ADttps/CO<O<Wum 15 Mjg»t 0 -' -'
Bo<uûllc.t "' G.-.cifu/ N>cq>s 15 u
Grocilis 14 La Cueille
z Disau/Rruoeo<t•lum 13 Grulou.C.juc ~ u La Coa>be z ? 0 ;:': ? Il Boo.atf,C.Ol < "' ? 10 Tua!
z ? en S;uu.ac
"' 0 ? œ Po< Ocr. 0 :z PoilW ., ? 07
-' Mutchi.so!Uc (?) 06 Com~ .. .. ~ 7 Q5 L"AigWJJ<>o
z ? ~ ,o.Jiouc:' "' 0 Vivon.oc a: 7 0) "" 0
7 ... 0"2 s. cuv.;.
@ ® © @
46 •/////.
("'.V/"' 16 VU.U.ô:
16 ... ~;;d/h r" ,
16 W//h
r""· 16
l7 •/////.1
l7 //;;; ... , r'"'"" 16
47
46
46
46
16
16
16
16
17
17
17
17
86 --86
86 l/.1////.1
86
86
S6 r;::::; 46 " •//'///
'//.1.1/ ~;~ 3G ///////.
36 •/.1////, //////.
PW///.- //////.1
86 '////.1
16
86
S6
36
17
16
86
16
<D <D <Cl
///.
""
//h :,////
J/Ü ru///
//.0,
...... ~:~' //N/:l
1 ";J ~;;,l
//N 1.,.,///
1 r" '
"'' [//////
,,//.1
' ///A ,, (,
1 1 r,,
1
... 1 1
~ '////1 //.1
///1 ////',
//.1 -~
,.,,
/////R:
1 :({;:::/ 1
V////' ///////•
braie lncalitie.ç from thf! north -eastern border nf the Aquitainf! basin in lerms of biosedinrentary eontext. A-G : biasedimcntary eantext (.çee Fig. 21 ; eontinuor1s and broken fine : knawn /ife type ; hatehing : depasitional enviranment. N" colwnn : lncality nunrber in stratigraphie arder. "Gi.<elllf!nt.ç" eolumn : locality and the nunrber of its administratit•e dl!partment.
... 7 Le ve;llon &.S ////////
"' 01 x
probablement les données statistiques et suggère le même milieu de vie pour œs deux familles . Les Teleosauridae avaient probablement un milieu de vie plutôt littoral , mais poU\·aient fréquenter épisodiquement la haute mer.
La répartition des faunes, en fonction de leur milieu de vie, est donc malais-ée quand il s'agit de découvertes ponctuelles. Par contre - et c'est le cas de la plupart des gisements récemment décrits · quand la faune est s-uffisamment riche et bien repérée stratigraphiquement, il est possible
d'apporter des informations nouvelles sur le paléoenvironnement.
GISEMENTS
HETTANGIEN
Le Veillon (site no 1, Vendée) Ce gisement a livré depuis une trentaine d 'années de très nombreuses empreintes de pas de Reptiles qui se répartissent en deux types :
497
- empreintes tétradactyles : au nombre d'une centaine, elles ont été attribuées par de Lapparent & Montenat 1967 à deux formes : Dahutherium sp. et Batrachopus gilberli. En les comparant à des empreintes du Trias du Connecticut, ces auteurs les ont attribuées à des reptiles pseudosuchiens mais aucun document ostéologique n'a jusqu'à présent confirmé cette interprétation ; - empreintes tridactyles : 400 empreintes de pas et une vingtaine de pistes de Dinosaures se répartissent entre sept espèces : Grallator olonensis, G. maximus, G. variabilis, Eubrontes veillonensis, Saltopoides igalensis, Anatopus palmatus et Talmontopus tersi (in Lapparent & Montenat 1967 ; Weishampel et al. 1990).
Les auteurs ont évoqué la possibilité d'attribuer Grallator et Saltopoides aux Coelurosauriens, Eubrantes aux Carnosauriens, Talmontopus et Anatopus à des Ornithopodes.
Conclusion - Le gisement de la pointe du Veillon se situe à l'extrémité nord des domaines mésozoïques transgressifs et discordants sur le socle précambrien et paléozoïque de Vendée. Le Bassin d'Aquitaine est alors formé d'une plateforme carbonatée peu profonde bordée au nordouest et à l'est par des massifs émergés (Te!Te armoricaine et Plate-forme centrale).
Les te1Tains fossilifères, constitués d'une alter- ~nance de calcaires, d'argiles et de grès datés de /'· l'Hettangien, (Carpentier 1947-49 ; Auger 1970 ; Gabilly et al. 1978) évoquent une plaine littorale.
TOARCIEN
Saint Gervais (si:.e no 2, Charente) Poissons indéterminés (Coquand 1862).
Vivonne (site no 3, Vienne) Ichthyopterygia Ichthyosauria indét. (Glan-geaud 1896).
Alloué (site no 4, Charente) Ichthyopterygia : Ichthyosauria indét. (Coquand 1862 ; Glangeaud 1896).
L'adaptation des Ichtyosaures à la vie en haute mer (allongement du museau, forme hydrodynamique du corps, palettes natatoires) est réalisée probablement dès le Trias.
Conclusion - Dans le Poitou, l'influence d'un seuil se fait sentir à partir du Pliensbachien. Le Toarcien est marqué par des lacunes stratigraphiques et le développement de faciès gréseux et d'oolithes ferrugineuses à l'aplomb du seuil alors que de part et d'autre, les marnes sont prédominantes, les faciès plus profonds.
La présence d'Ichtyosaures est bien conforme à ce contexte.
AALÉNIEN - BAJOCIEN
L'Aiguillon (Site no 5, Charente-Maritime) Poissons indét. (Verger et al. 1978).
Argenton-sur-Creuse (site no 6, Indre) : tranchée du Compan Elasmobranchii : Asteracanthus ( = Strophodus) reticulatus (in Sauvage 1900a).
Ce genre, réputé marin n'est pas lié à une profondeur très stricte. Dans les gisements du CentreOuest, on le trouve dans les dépôts provenant de. milieux relativement profonds (Aalénien d'Argen- >
ton-sur-Creuse) et dans des dépôts plus littoraux (Bathonien de St Gaultier). De nombreux sélaciens actuels occupent successivement les différents milieux marins et fluviatiles au cours de leur vie. Une biologie sensiblement identique peut être envisagée pour le genre Asteracanthus.
''Environs de Poitiers" (site no 7, Vienne) Actinopterygii, Semionotidae : Lepidotes cf. mantelli (in Glangeaud 1896).
Le genre Lepidotes est signalé dans des dépôts marins peu profonds au Jurassique et dans des dépôts fluviatiles à partir du Crétacé inférieur. -"Environs de Poitiers", Chauvigny (site no 8, Vienne).
Sauropterygia, Pliosauridae : Pliosaurus ( = Liopleurodon) grossouurei (in Rolland 1885 ; Glangeauù 1896).
Sansac (site no 9, Charente) Crocodylia, Thalattosuchia, Teleosauridae Ste-neosaurus sp. (in Glangeaud 1896).
Le milieu de vie de ces animaux peut être considéré comme littoral mais avec possibilité de plus en plus fréquente d'incursions en mer au cours du :Mésozoïque.
Conclusion - Jusqu'à l'Aalénien inférieur, la configuration paléogéographique du Toarcien subsiste. A partir de l'Aalénien moyen, et pendant le Bajocien, un accident majeur du socle hercynien rejoue et sépare la région Centre-Ouest en detLx domaines. Le compartiment nord-est est presque constamment surélevé, alors que le compartiment sud-ouest est caractérisé par une sédimentation plus profonde, en accord avec les données de la paléontologie.
BATHONIEN
Tercé (site no 10, Vienne)
1 '
Crocodylia, Thalattosuchia, Teleosauridae Steneosaurus sp. (in Bourgueil et al. 1971).
Bonargent (site no 11, St Gaultier, Indre) Elasmobranchii : Asteracan.thus reticulatus, A. magnus . Sauropterygia : Plésiosauriens indét. Crocodylia, Thalattosuchia, Teleosauridae Steneosaurus sp. (in Sauvage 1900a).
Les dents de "Téléosauriens" ont été attribuées à Liopleurodon grossouvrei par Cossman (1899) puis au genre Machimosaurus par Sauvage (1900a), mais elles sont pointues et pourvues de stries trop régulières pour appartenir à ce dernier genre (Krebs 1968). Elles pourraient plutôt être rapportées au genre Steneosaurus dont la variation individuelle de la morphologie dentaire peut être importante .
St GaultieL Canière de La Combe (site no 12, '!~d're) Elasmobranchii : Asteracanthus magnus. Saurischia, - Sa uropodomorpha : Pelorosaurus sp., - Thcropoda : Megalosaurus bucldandi (in Sauvage 1900a ; Weishampcl et al. 1990).
Si l'attribution de la dent au genre Pelorosaurus par Sauvage (1900a) semble sujette à caution, son appartenance au sous-ordre des Sauropodomorpha ne fa it aucun doute . Les conditions de dépôt indiquent un milieu marin confiné peu profond .
Gréalou (site no 13, Lot) Actinoptcrygii , Scmionotidac Lepidotes sp. (in Bleicher 1870l.
G. Bleicher, 1870 fa it état de la présence d'écailles de Lepidotes dans l'"Oxfordicn" de Gréalou : il s'agit en fait de terrains bathoniens. L'étude sédimcntologiquc indique un milieu !aguno-lacustre, confirmé par la présence de Charophytcs ct de Planorbes .
Conclusion - Une sédimentation d'environnement corallien sc développe de part et d'autre du Seuil du Poitou mais aucun indice d'émersion n'a, jusqu'à présent, été observé dans le Berry, cc qui pose un problème du fait de la présence de Dinosaures . Il est cependant important de signaler que le Callovien n'est pas individualisé dans cette région (Lorenz 1992). Dans le Quercy, la présence de pseudomorphes de gypse indique un milieu laguno-lacustrc, unique dans le Bathonien supérieur français, qui correspond au milieu de vic des faunes .
498
CALLOVIEN
La Cueille (site no 14, Vienne) : zone à Gracilis Crocodylia, Thalattosuchia, Metriorhynchidae Metriorhynchus cf. blainvillei (in Brunet 1969).
Bonillet et Migné-les-Lourdines (sites no 15, Vienne) Elasmobranchii : Asteracanthus ornatissimus Sauropterygia, Pliosauridae : Pliosaurus sp. Crocodylia, Thalattosuchia - Teleosauridae : Steneosa.urus sp., Steneosaurus cf. heberti - Metriorhynchidae : Metriorhynchus sp., M. cf. durobrivensis, M. cf. brachyrhynchus, M . moreli (in Brunet 1969 ; Barale et al. 1974)
La faune de Bonillet provient des zones à Gracilis et Anceps et celle de Migné-les-Lourdines des zones à Anceps et Coronatum.
La famille des l'vlet!iorhynchidae constitue la majeure partie des fossiles de Thalattosuchia découverts dans le Poitou.
Les sédiments témoignent d'un milieu peu profond mais la présence de fvletriorhynchidae , de Pliosa uridae et d'ammonites · indique un milieu ouvert sur l'océan . L'excellente conservation des végétaux (Cycadales et Bennettitales) révèle la proximité de terres émergées.
Lavoux (site no 16, Vienne) : zones à Anceps et Coronatum Elasmobranchii : Asteracantlws sp., Acrodus sp. Actinopterygii, Pycnodontidae : Macromesodon sp. Sauropterygia, Pliosauridae : Pliosaurus sp. Crocodylia, TI1alattosuchia, Metriorhynchidae Metriorhy nclws afT. moreli (in Brunet 1969 Bourgueil et al. 1971).
L'association faunique est identique à celle de Bonillet et fvligné-les-Lourdines mais le sédiment, constitué de calcaire oolithique à grains fins ct à ciment sparitique, indique un milieu de plus forte énergie encore moins profond .
Chateau Gaillard (site no 17, Vienne) : zone à Coronatum Crocodylia, Thalattosuchia, Mctriorhynchidae : M. superciliosus (in Wenz 1968).
Conclusion - La bordure septentrionale du Bassin d'Aquitaine se divise, à partir du Bathonien supérieur en deux domaines. A l'ouest, les domaines vendéen et charentais comprennent des séries profondes de mers ouvertes. A l'est, le domaine pictave, où sc localisent les gisements dé-
crits, fait partie d'une vaste platefonne carbonatée de haute énergie et de faible profondeur qui s'étend jusqu'aux Pyrénées.
Les associations fauniques, inchangées du Callovien inférieur au Callovien moyen, confinnent les données de la sédimentologie : le Poitou constituait nne platefonne peu profonde, ouverte sur l'océan et parsemée de petites îles. Le Callovien supérieur fait totalement défaut dans cette région.
OXFORDIEN
"Environs de Poitiers" (site n• 18, Vienne) Actinopterygii, Semionotidae : Lepidotes fittoni (in Glangeaud 1896). Saurischia, Theropoda : Megalosaurus sp. (in Lapparent & Lavocat 1955 ; Lapparent 1967 ; et Theropoda indét. in Weishampel et al. 1990).
La présence de Megalosaurus sp. ne peut être confirmée en l'absence de tout reste correspondant.
Richebonne (site n• 19, Charente-Maritime) : zone à Bimammatum Crocodylia, Thalattosuchia (s. 1.) indét. (Dupuis et al. 1975 ; Buffetaut 1977).
Les sédiments se sont déposés en milieu de rampe carbonatée distale.
Fosse de Loix (site n• 20, Charente-Maritime) : zone à Planula Crocodylia, Thalattosuchia, Metriorhynch.idae : Metriorhynclws superciliosus (in B11ffetaut 1977).
Les dépôts sont localisés sur la partie distale d'une rampe carbonatée.
Conclusion - L'abondance des récifs coralliens du Berry à l'Angoumois à partir de l'Oxfordien moyen confirme l'existence de hauts-fonds. Sur la bordure méridionale du Massif vendéen, se développe une platefonne récifale à partir de l'Oxfordien supérieur. Le passage à des faciès marneux à Céphalopodes se réalise rapidement entre ces hauts-fonds .
Les milieux de dépôt correspondent bien au mode de vie des faunes découvertes en Charente-Maritime.
KIMMÉRIDGIEN
Aytré (site n• 21, Charente-Maritime) zone à Cymodoce
499
Crocodylia, Thalattosuchia, Teleosauridae : probablement Steneosaurus sp. (in Buffetaut 1977).
Le Chay (site n• 22, Charente-Maritime) : zone à Cymodoce · Elasmobranchii : Asteracanthus reticulatus (in Glangeaud 1896).
Langevinière (site n• 23, Charente) : zone à Mutabilis Sauropterygia indét. Crocodylia : Thalattosuchia indét. (Bourgueil et al. 1971 ; Gabilly et al. 1978).
Touvre-Agas (site n• 24, Charente) zone .à Mutabilis Actinopterygii, Semionotidae : Lepidotes gigas Chelonii indét. Crocodylia, Thalattosuchia, Metriorhynchidae Metriorhynchus sp. (in Coquand 1862 ; Glangeaud 1896)
Gond-Pontouvre, Ruelle (site n• 25, Charente) : zone à Mutabilis Chelonii indét. (in Coquand 1862 ; Glangeaud 1896 ; Hantzpergue 1984).
St Amand (site n• 26, Charente) :zone à Mutabilis Chelonii indét. Crocodylia, Thalattosuchia, Metriorhynchidae : Metriorhynchus sp. (in Coquand 1862 ; Hantzpergue 1984).
Le sédiment est constitué de marnes que l'on retrouve dans les autres gisements de Charente. Il correspond à des dépôts de rampe distale ou de bassin. L' hypothèse d'un transport des restes de chélonien dans ces milieux profonds peut être retenue, puisque dans l'état actuel de nos connaissances, aucun chélonien n'est adapté à la vie marine franche avant le Crétacé.
St Cyr (site n• 27, Lot) : zone à Mutabilis/Eudoxus Sauropterygia : Plesiosauridae indét. (in LangeBadré et Pajaud 197€).
Flaujac-Poujols (site n• 28, Lot) : zone à Mutablis/Eudoxus Sauropterygia : Pliosauridae indét. (in Lange-Badré et Pajaud 1976).
Gigouzac (site n• 29, Lot) : zone à Eudoxus Crocodylia, Thalattosuchia, Teleosauridae : Steneosaurus sp. (in Hantzpergue et al. 1982).
La faible dispersion des éléments squelettiques indique un transport peu important et un milieu calme.
Fumel (site n• 30, Lot) : zone à Autissiodorensis Elasmobranchii : Asteracanthus aff. Lepidus, Hybodus acutus Holocephali : Ischyodus sp. Actinopterygii - Semionotidae : Lepidotes maxi~us, L. aff. palliatus, L. aff. Loeuis , L. sp. - Pycnodontidae : Mesodon affinis, M. combesi, M. fourtaui, M. Lingua, Microdon hugii, A!hrodon boLoniensis, Gyrodus cuuieri, G. oltis, G. montmejai, Pycnodontidae indét. - Eugnathidae : Caturus woodwardi - Pachycormidae : Hypsocormus combesi. Chelonii : Tropidemys sp. ; Plesiochelys sp. (indéterminables en fait). lchthyosauria : lchthyosaurus sp., Ophtalmosaurus sp. Sauropterygia, Plesiosauridae : Cryptoclidus sp. (?) Crocodylia, TI1alattosuchia, Teleosauridae : Slf!· neosaurus sp., Ma.chimosaurus hugii. Metriorhynchidae : Dacosaurus maximus. Pterosauria Ptérodactylien indét. (Sauvage 1900b, 1902).
La présence des groupes est attestée d'après les figurations de Sauvage. Cependant, la validité des taxons spécifiques ct génériques n'a pu être vérifiée que pour les Tortues et parait être valable pour les Crocodiles. Cette impo1tantc faune montre un double cachet marin et littoral.
La faune marine est représentée par des Thalattosuchiens évolués (Dacosaurus, i\1achimosaurus) des Ichtyosaures ct des Plésiosaures.
Parmi les poissons, les Holocéphales sont réputés habiter les zones profondes, alors que les Pycnodontidae et l'Eugnathidac indiquent plutôt un domaine littoral ou récifal.
La présence de Ptérodactyles a parfois été signalée loin des côtes et ne permet donc pas de préciser davantage le milieu.
Les alternances de calcaires argileux et de marnes plus ou moins bitumineuses, indiquent un domaine de rampe distale.
Conclusion - Dans la reg1on Centre-Ouest, le Kimméridgien inférieur est marqué par la faible profondeur des milieux de dépôts. Le Kimméridgien supérieur marque le début d'une phase transgressive qui conduit à l'uniformisation des
500
faciès marneux "virguliens" plus profonds, comme l'indique la présence de faunes à Ichtyosaures et Métriorhynques.
Dans le Quercy, l'association de faunes pélagiques et littorales indique un passage rapide des faciès de bassin aux faciès littoraux, en accord avec les reconstitutions paléogéographiques.
TITHONIEN
Rouillac (site n• 31, Charente) Chelonii : Pleurosternon sp. (inédit).
Cette tortue est réputée dulçaquicole. Le décalar important entre le milieu de vie et le milieu t
dépôt {rampe carbonatée) accrédite lbypothès d'un transport post-mortem.
La Morelière (site n• 32, Charente-Maritime): zone à Gravesiana Chelonii : Tha.Lassemys moseri (in Rieppel 1980).
Cette tortue, dont l'appartenance au genre Thalasssemys est improbable (de Broin 1991), appartient à un groupe mal délimité : les Thalassemydidae - Plesiochelyidae, dont les membres ne sont pas adaptés à la vie marine franche. Son milieu de vie était probablement littoralou lagunaire.--Chassiron (site n• 33, Charente-Maritime) : zone à Gravesiana Saurischia, Thcropoda (Coelurosaurien selon Lapparent & Oulmi 1964 et indét. selon Weishampel et al. 1990).
Il est probable que cette empreinte de pas provienne des dépôts laminés de faciès purbeckien qui surmontent les couches à Grauesia de la coupe de Chassiron.
Sigogne (site n• 34, Charente) : zone à Gravesiana Actinopterygii, Semionotidae : Lepidotes sp. (in Brunet & Hantzpergue 1983).
Les sédiments sc sont déposés sur la rampe carbonatée proximale.
Champblanc {site n• 35, Charente) : zone à Gravesiana Elasmobranchii : Polyacrodus cf. pa.ruidens, P. sp. et/ou Hybodus sp. et/ou Lissodus sp. Actinopterygii, Semionotidae : Lepidotes sp., autre indét. {inédit). Actinistia, Coelacanthidae indét. {inédit). Chelonii : Pleurosternon sp. et Tretostemon sp. (ia de Broin et al. 1991).
Crocodylia, Mesosuchia - Goniopholididae : "Goniopholis sp." - Pholidosauridae : "Pholidosaurus sp." Lepidosauria : Sphenodontidae indét. et Homoesaurus cf. maximiliani. Saurischia : un petit Théropode indéterminé mais distinct de Megalosaurus sp. et de Nuthetes destructor du Tithonien anglo-français (inédit).
Cette faune, d'abord décrite par Buffetaut et al. (1989), est complétée à l'aide de nouveau matériel (fouilles P. Hervat). L'association d'animaux terrestres (Dinosaures, Sphénodontidés) et fluviatiles ou littoraux (Poissons, Sélaciens, Tortues, Crocodiles) indique un milieu sublittoral à continental, en accord avec le milieu de dépôt.
Montgaud (site no 36, Charente) : zone à Gravesiana Actinopterygii, Semionotidae : Lepidotes sp. (in Coquand 1862).
St Sevère (site no 37, Charente) : zone à Gravesiana Poissons indét. associés à des "coquilles fluviatiles indét." (Coquand 1862).
Crayssac (site no 38, Lot) : zone à Gravesiana Actinopterygii, Semionotidae : Lepidotes sp. Crocodylia, Thalattosuchia : Teleosauridae indét. Crocodylia (s.l.) : empreintes de pas (Hantzpergue & Lafaurie 1991).
L'étude sédimentologique fournit des précisions très détaillées sur le milieu de dépôt : les poissons (Lepidotes) et les Téléosauriens proviennent de dépôts intertidaux inférieur et moyen associés à des restes de végétaux (Ptéridophytes) alors que les empreintes de pas sont imprimées sur des couches à ripple-marks et roud-cracks, déposées en milieu intertidal supérieur.
Conclusion - La régression du Jurassique terminal se manifeste, sur la bordure Nord-Aquitaine, par l'installation de milieux restreints et confinés, formant un golfe d'orientation NW-SE : faciès "purbeckien" dans la région de Cognac (Charente), faciès "pré-évaporitique" jusqu'à Périgueux (Brunet & Hantzpergue 1983), et des calcaires fins et lithographiques sur la bordure méridionale.
Les faunes confirment la vaste émersion de l'aire située à proximité des Charentes et du Quercy.
INTERPRÉTATIONS
Cette étude a permis de réviser l'âge des gisements ct laisse entrevoir la possibilité d'enrichir
501
la biochronologie à l'aide des redétermination: fauniques et en particulier celle des Thalattosuchiens. Elle a permis aussi de mieux appréhender les phénomènes dans le temps et l'espace tels que les migrations. Ainsi, par exemple, la faune de Champblanc (zone à Gravesiana) montre des affinités (présence de Homoesaurus in Buffetaut et al. 1989) avec les faunes de Cerin et Creys (zone à Beckeri), de Bavière (zone à Hybonotum) et de Canjuers (zone à Mucronaturn : in Atrops 1991 ; Roman et al. 1991). De même, les Tortues Tretosternon et Pleurosternon se rencontrent aussi dans le Sud de l'Angleterre, le Boulonnais, le Portugal (de Broin et al. 1991) et l'Allemagne (Grabbe 1884). Un réseau de communications terrestres existe donc, au moins temporairement, à partLr du Kimméridgien supérieur sur l'Europe occidentale.
Grâce à cette étude, les paléoenvironnements ont pu être précisés. Ainsi, la découverte d'empreintes de pas permet de localiser les zones émergées (Hettangien de Vendée, Tithonien de Chassiron et de Crayssac).
La synthèse des connaissances sur le Callovien du Poitou permet d'évoquer un paysage insulaire sous un climat plus humide que traditionnellement admis. Le principal argument avancé en faveur d'un climat sec est l'épaisseur importante de la cuticule de certains végétaux (Lemoigne et Thierry 1968). Or, des cuticules épaisses ont récemment été découvertes en relation avec des sols sursalés ou déficients en oxygène (Alvin 1982). Ainsi, au Callovien, le contexte biosédimentaire du Poitou : présence d'une flore arborescente (Baral. et al. 1974) et de sédiments riches en argiles <Dclfaud 1983), témoigne plutôt d'un climat humide.
La répartition des faunes en fonction du milieu de dépôt permet de mieux appréhender leur milieu de vie. Ainsi, par exemple, les Metriorhynchidae et les Teleosauridae sont souvent associés dans les sédiments à partir du Callovien. L'anatomie des Metriorhynchidae montre de nombreuses adaptations à la vie marine : forn1~ hydrodynamique du corps, réduction puis disparition de l'armure dermique, partie distale de la colonne vertébrale infléchie vers le bas, tendance à la transformation des membres antérieurs en palettes natatoires (Fraas 1902), mouvements des membres de bas en haut (Debelmas 1958). Ces animaux ne devaient se rendre à terre que pour la ponte. Chez les Teleosauridae, l'adapation au milieu marin ne porte essentiellement que sur les membres antérieurs et n'atteint jamais celle des Metriorhynchidae (Buffetaut 1980). Malgré ces différents degrés d'adaptation à la vie marine,
leurs restes sont souvent associés dans les dépôts de barrière ou de rampe carbonatée proximale. Par ailleurs, quand le milieu de dépôt ne correspond pas au milieu de vie des faunes, un transport post-mortem doit être envisagé comme c'est le cas dans le Kimméridgien de Gond-Pontouvre et de Ruelle ou dans le Tithonien de Rouillac par exemple.
CONCLUSION
Les nouvelles données paléontologiques ont d'ores et déjà permis de réviser la chronologie des gisements à vertébrés jurassiques de la bordure nordorientale du Bassin d'Aquitaine. Une meilleure connaissance des tendances évolutives de certains caractères chez les Thalattosuchiens pourrait permettre d'obtenir une plus grande précision.
Grâce à la comparaison entre le milieu de vie des faunes et le milieu de dépôt, nous avons précisé l'environnement des gisements - notamment le paysage insulaire du Poitou au Callovien - et le milieu de vie de certains taxons (Poissons Lepido· tes et Asteracanthus et Thalattosuchiens).
Enfin, les nouvelles données stratigraphiques et environnementales permettent de mieux appréhender les échanges fauniques en fonction de la répartition géographique des vertébrés du Tithonien pour l'Europe occidentale.
Remerciements Nous adressons nos vifs remerciemenL-; à P. Hervat, J.C. Rage, P. Taquet et S . Wenz pour les déterminations des noU\·eaux spécimens de Champblanc, à E . Buffetaut pour la relecture du manuscrit et à C. Durand pour la réalisation de la carte.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ALVIN K.L. 1982 - Cheirolepidiaceae : biology, structure and paleoecology. Reu. of Paleobot . and Paly11., 37, 112 : 71-98.
ATROPS F. 1991 - Présence d'ammonites du Tithonique inférieur dans les calcaires lithographiques de Canjuers (Va r , France). ln BER..'IIER P. & GAILLARD C. (eds.) : Les calcaires lithographiques. Sédimentologie, Paléontologie, Taphonomie. Geobios, M.S. 16 : 137-146.
AUGER F. 1970 - Etude géochimique de quelques formations géologiques dans le Nord du Bassin d'Aqui· taine (Vendée) et des sols qui en dérivent. Thèse de 3e cycle, Poitiers : 128 p. dactyl. (inédit).
l3ARALE G., C.<\RIOU C. & RADL"REAU C. 1974 - Etude biostratigraphique et paléobotanique des gisements de calcaire blanc callo\·ien du Nord de Poitiers. Geo· bios, 7, (1): 43-70
502
BLEICHER G. 1870 - Essai de .géologie comparée des Pyrénées, du Plateau central et des Vosges. C. Decker lmp., Colmar : 106 p.
BOURGUEIL B., GABILLY J., COIRIER B. & MOREAU P. 1971 - Notice de la carte géologique de Chauvigny au 50 OOOe. BRGM (éd.), Orléans, 18: 1-27. ·
BROIN F . de 1991 - Données préliminaires sur les Chéloniens du Tithonique inférieur de Canjuers (Var, France) . ln BERNIER P. & GAILLARD C. (eds.) : Les calcaires lithographiques. Sédimentologie, Paléontologie, Taphonomie. Geobios, M.S. 16: 167-175.
BROIN F . de, BARTA-CALMUS S., BEAUVAIS L., CAMOIN G., DEJAX J., GAYET M., MICHARD J.G., 0LIVAUX T., ROMAN J., SIGOGNEAU-RUSSEL D., TAQUET P. & WENZ S. 1991 - Paléobiogéographie de la Téthys, apports de la Paléontologie à la localisation des rivages, des aires émergées et des plates-formes au Jurassique et au Crétacé. Bull. Soc. géol. Fr., 162, 1 : 13-26.
BRUNET M. 1969 - Note préliminaire sur une faune de vertébrés du Callovien des environs de Poitiers. C.R. Acad. Sc. Paris, 268: 2667-2670.
BRUNET l\l & H..._.'ITZPF.RGUE P. 1983 - Première découverte d'un poisson sémionotiforme du genre Lepido· les dans le Portlandien des Charentes. Remarques paléogéographiques. Ann. Soc. Sei. Nat . Charente· Maritime, 7, 1: 137-141.
BUFFETAUT E. 1977 - Sur un Crocodilien marin, Metriorhynchus superciliosus, de l'Oxford ien supérieur <Rauracien) de l'Ile de Ré (Charente-Maritime). Ann. Soc. Sei. Nat. Charente-Maritime, 6, 4 : 252-266.
BuFFETAUT E. 1980 - Teleosauridae et Metriorhynchidae : l'évolution de deux familles de Crocodiles mésosuchiens marins du Mésozoïque. 105e Congrès Nat. des Soc. Savantes, Caen, 3 : 11-22.
BUFFETAUT E., POUIT D., RIGOLLET L. & ARCHAMBEAU J .P. 1989 - Poissons et Reptiles continentaux du Purbeckien de la région de Cognac (Charente). Bull. Soc. géol. Fr., 8, 5, 5 : 1065-1069.
CARPENTIER A. 1947-49 - Les flores infraliasiques des Deux-Sèvres et de la Vendée. Amz. Pal., 33 : 179-180 ; 34 : 1-16 ; 35 : 1-23.
COQUAND H. 1858-62 - Description physique, géologique, paléontologique et minéralogique du département de la Charente. Barlatier, Feissat et Demoudry éd., Marseille, 2: 1-351.
COSSMANN 1\1. 1899 - Sur la découverte d'un gisement palustre à Paludines dans le terrain bathonien de l'Indre. Bull. Soc. géol. Fr., 3, 27 : 136-143.
DEBELMAS J. 1958 - Découverte d'une ceinture pelvienne de Dacosaure dans le Néocomien des environs de Castellane (Basses-Alpes). Trau. Lab. Geol. Fac. Sei., Grenoble, 34 : 43-48.
DELFAUD J. 1983 - Les paléoclimats du Jurassique en Europe occidentale. Actes Coll. AGSO Bordeaux. Bull. lnst. Geol. Bass. Aquit., CNRS Cahiers du Quaternaire, 34: 121-135.
DUPUIS J ., CARIOU E., COIRIER B. & DUCLOUX J. 1975 -Notice carte géologique Marans, 1150 OOOe. BRGM (éd.), Orléans, 609, 14 : 28.
ENAY R., MANGOLD C., CAR!OU E., CONTIN! D. , DEBRAND·PASSARD S ., Do:-.:zE P ., GABILLY J., LEFA· \"RAIS-RA\?.!OND A., MOUTERDE R. & THIERRY J . 1980 - Synthèse paléogéographique du Jurassique
français par le Groupe français d'études du Jurassique. Doc. La.b. Géol., Lyon, H.S. 5 : 1-210.
FRAAS E. 1902 - Die Meer - Crocodilier (Thalattosu. chia) des oberen Jura unter specieller Berüchsichti
gung von Dacosaurus und Geosaurus. Paleontographica, 49: 1-71.
GABILLY J. et al. 1978 • Poitou-Vendée-Charentes. Guides géologiques régionaux. Coll. dirigée par Ch. Pomerol, Masson, Paris : 200 p.
GABILLY J., CARIOU E. & liANTZPERGUE P. 1985 - Le détroit du Poitou au Jurassique : mythe ou réalité paléogéographique ? Bull. section ScU!nces, 9 : 141-159.
GLANGEAUD S. 1896 - Les reptiles et les poissons du Jurassique des environs de Poitiers, Angoulême et La Rochelle. Bull. Soc. géol. Fr., 24: 155-171.
GRABBE A. 1884 - Beitrag zur Kenntniss der Schildkroten des deutshen wealden. Zeitsh. Deutsch. Geol. Gesel, 36: 17-38.
HANTZPERGUE P . 1984 - Notice de la carte géologique de Mansle au 50 OOOe. BRGM (éd.), Orléans, 685 : 1-24.
HANTZPERGUE P. 1989- Les ammonites k.imméridgiennes du haut-fond d'Europe occidentale. CahU!rs paléont., (éd.) CNRS : 1-428.
HANTZPERGUE P., LAFAURIE G. & LANGE-BADRE B. 1982 - Un crocodilien du Jurassique supérieur marin des environs de Cahors. Bull. Soc. études Lot, 103, 4 : 375-385.
HANTZPERGUE P . & LAFAURIE G. 1991 · Les calcaires lithographiques du Tithonien quercynois : Stratigraphie, Paléogéographie et contexte biosédimentaire. ln BERNIER P. & GAILLARD C.(eds) : Les calcaires lithographiques. Sédimentologie, Paléontologie, Taphonom.ie. Geobios, M.S. 16 : 237-243.
KREBS B. 1968 - Le crocodilien Machimosaurus : Contribuçao para o conhecimento da fauna do Kimeridgiano da mina de Lignito Guimrota (Leiria, Portugal). Mém. Seru. Géol., Port., 14: 1-53.
LANGE-BADRE B. & PAJAUD D. 1976 · Des reptiles marins dans le Quercy. Bull. Soc. Etudes Lot, 1 : 1-11.
LAPPARENT A. F. de 1967 - Les dinosaures de France. ScU!nces, 51 : 4-20.
LAPPARENT A. F. & de LAVOCAT R. 1955 - Dinosauriens. Traité de Paléontologie. Sous la direction de J. Piveteau, Masson et Cie, Paris, 5 : 785-962.
LAPPARENT A. F. de & MONTENAT C. 1967 · Les empreintes de pas de Reptiles de I'Infralias du Veillon (Vendée). Mém. Soc. géol. Fr., 46., 107 : 1-44.
LAPPARENT A. F. de & OuLMI M. 1964- Une empreinte de pas de Dinos?urien dans le Portlandien de Chassiran (Ile d'Oléron). C.R. Som. Soc. géol. Fr. : 232-233.
LEMOINE Y. & THIERRY J. 1968 - La paléoflore du Jurassique moyen de Bourgogne. Bull. Soc. géol. Fr., 7, 10: 323-333.
LORENZ J. 1992 - Le Dogger du Berry. Contribution à la connaissance des plates-formes carbonatées euro-
503
péennes du Jurassique. Documents du BRGM, 212: 1-397.
RIEPPEL O. 1980 · The skull of the Upper Jurassic: Cryptodire turtle Thalassemys, with a reconsideratian of the Chelonian braincase. Palaeontographica, 171, 4-6 : 105-140.
ROLLAND G. 1885 • Oolithe inférieur du Poitou. Bull. Soc. géol. Fr., 3, 13: 386-411.
ROMAN J., ATROPS F., ARNAUD M., BARALE G., BARRAT J.M., BOULLIER A., BROIN F. de, M!CHARD J.G., TAQUET P. & WENZ S. 1991 • Le gisement tithonique inférieur de Canjuers (Var, France) : état actuel des connaissances. ln BERNIER P. & GAILLARD C. (eds) : Les calcaires lithographiques. Séd.imentologie, Paléontologie, Taphonomie. Geobios, M.S. 16 : 126-135.
SAUVAGE H.E. 1900a · Note sur les poissons et les reptiles du Jurassique inférieur du département de l'Indre. Bull. Soc. géol. Fr., 28 : 500-504.
SAUVAGE H.E. 1900b - Les poissons et les reptiles du Jurassique supérieur de Fumel (Lot et Garonne). Bull. Soc. géol. Fr., 28 : 496-499.
SAUVAGE H.E. 1902 - Recherches sur les vertébrés du Kimméridgien supérieur de Fumel (Lot et Garonne). Mém. Soc. géol. Fr., 25 : 1-32.
VERGER F. et al., 1978 - Notice carte géologique L'Aiguillon sur mer, 1150 OOOe. BRGM (éd.), Orléans, 608, 12-13 : 28.
WEISHAMPEL D.B., DODSON P. & OSMOLSKA H. 1990 -The Dinosauria. Univ. California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford : 733 p.
WENZ S. 1968 · Contribution à l'étude du genre Metriorhynchus. Crâne et moulage endocrânien de Metriorhynchus superciliosus. Ann. Pal. (Vertébrés), 54, (2) : 148-191.
P. VIGNAUD & M. BRUNET, E. CARIOU & P. HANTZPERGUE Université de Poitiers
Laboratoire de Géobiologie, Biochronologie et Paléontologie humaine, Jeune Equipe DRED <DS3) "Dynamique évo
lutive et Méthodes quantitatives en Biochronologie" 40 avenue du Recteur Pineau
F-86022 Poitiers Cedex
F. DE BROIN Muséum National d'Histoire naturelle
Institut de Paléontologie et URA 12 du CNRS 8 rue Buffon
F-75005 Paris
B. LANGE-BADRÉ Université Paris VI
Laboratoire de Paléontologie des Vertébrés et Paléontologie humaine
4 place Jussieu F-75005 Paris Cedex 06 ·