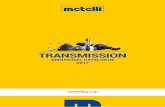LE SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS LIBÉRAL DU XIXe SIÈCLE : BUREAUCRATIE OU CAPITALISME ?
Transcript of LE SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS LIBÉRAL DU XIXe SIÈCLE : BUREAUCRATIE OU CAPITALISME ?
LE SYSTÈME FISCAL FRANÇAIS LIBÉRAL DU XIXe SIÈCLE : BUREAUCRATIE OU CAPITALISME ? Bruno Théret IRIS/CNRS Université Paris Dauphine Novembre 1990 Etude publiée dans ÉTUDES ET DOCUMENTS N° III, 1991 Revue du Comité pour l'histoire économique et financière de la France Ministère de l'Économie, des Finances et du Budget. Encore tout récemment, on a pu réaffirmé en y voyant "une rupture ou un tournant décisif" que "tout un champ d'activités financières «capitalistes» sous l'Ancien Régime passe (…) dans la sphère publique à la suite de la Révolution"(1). Or si on ne se borne pas à une vue juridique et impressionniste sur les transformations révolutionnaires comme nous y incitent lesrécents travaux de M. Bruguière et de P. F. Pinaud(2), un tel jugement apparaît par bien des côtés comme un des derniers avatars de cette "légende administrative"(3) dont furent imprégnés les premiers les agents du système eux-mêmes(4). L'approfondissement en cours de la connaissance du fonctionnement réel du système fiscal du XIXe siècle conduit au contraire à considérer qu'il existe dans le domaine fisco-financier à cette époque un contraste "violent entre la théorie et le fait"(5) et qu'on ne peut plus admettre sans discussion des affirmations comme celles qui voudraient que "la perception directe par l'État avec (…) mise en place d'une administration fiscale moderne" succède à la vénalité des offices de finance et «au trafic des finances royales par les fermiers et traitants»(6). Toutefois, alors qu'il commence à exister moult études d'histoire sociale sur les financiers du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, études qui permettent de se faire une idée d'ensemble sur leur place économique, politique et sociale(7), il n'y a pas encore de recherches systématiques du même type sur le groupe social correspondant des receveurs et trésoriers payeurs généraux du XIXe siècle. Tout se passe comme si le nouvel attribut de fonctionnaires dont ils sont désormais gratifiés continuait de les protéger de la curiosité de la plupart des historiens et des sociologues qui s'intéressent au nouveau monde bourgeois. Les travaux de M. Bruguière et P.F. Pinaud font certes exception et sont tout à fait précieux à ce titre puisqu'ils livrent déjà un faisceau fort important d'indices permettant de soupçonner l'importance de cette fraction "fisco-financière" de la haute bourgeoisie(8). Mais, même si on fait abstraction du fait que ces auteurs se sont surtout attachés dans leurs publications au premier XIXe siècle et nous laissent donc sur notre faim quant au devenir des financiers sous
la Troisième République, il subsiste dans leurs travaux certaines ambiguités qui empêchent encore à "l'Histoire sainte de l'Etat" d'être véritablement désacralisée. M. Bruguière, par exemple, laisse entendre parfois que "l'Ancien Régime (…)est mort (…)en 1814, avec la primauté du pouvoir militaire et de ses exigences", "le service moderne et civil de l'État" étant ainsi né "sous les frères de Louis XVI (…) avec la responsabilité ministérielle"(9). Ailleurs, il considère que c'est avec la fusion des fonctions de payeur et de receveur en 1865 qu'on en serait enfin arrivé à l'abolition de "l'univers des fermiers, traitants et prêteurs" de l'Ancien Régime(10). Quant à P. F. Pinaud, il admet également que c'est à cette date que le Trésor Public arrive véritablement à "se libérer du joug" des receveurs généraux, sa puissance étant suffisante désormais pour qu'il puisse "asseoir son crédit sans être obligé de faire appel à des affairistes"(11). Or, certains de ses propres travaux, mais aussi d'autres sources comme Stourm (1912) par exemple, montrent qu'il n'en est rien et que, même si elle subit une certaine dérive pour toute une série de raisons, la puissance des nouveaux Trésoriers Payeurs Généraux dans période 1865-1914 est encore très importante. Ne faut-il pas attendre 1890 pour que soient supprimées les commissions et remises qui leur sont allouées au titre des impôts, ces fonctionnaires-banquiers passant alors au traitement fixe intégral pour leurs activités proprement fiscales tout en conservant leurs fonctions de banquiers ? N'est-ce point seulement en 1915 ou 1918(12) que le système du cautionnement sur leurs biens propres qui fait des comptables supérieurs du Trésor Public de véritables officiers d'Ancien Régime disparaît au profit d'une caisse de "cautionnement mutuel" ? En somme, nous faisons partie de ces lecteurs un peu déçus que les trop rares auteurs qui se sont intéressés aux receveurs généraux du XIXe siècle en pressentant leur formidable importance pour la compréhension de ce siècle n'aient pas cru "nécessaire de succomber à (ce qu'ils appellent) la tendance actuelle de l'histoire sociale" en nous fournissant "une approche plus économique du rôle de ces fonctionnaires banquiers"(13). C'est pourquoi nous voudrions dans cet article apporter une contribution en ce sens en rassemblant un certain nombre de "données" encore éparses et en les faisant fonctionner comme une recherche de preuves ou pour le moins d'indices à l'égard des soupçons que ces auteurs ont aidés à faire (re)naître(14). En effet, en tant qu'économiste cherchant à saisir la nature contemporaine des relations entre l'Etat et l'économie par contraste avec celles qui prévalaient aux époques antérieures, nous avons été conduit à endosser la thèse d'A. Mayer - quoiqu'avec des arguments différents et complémentaires des siens - selon laquelle, en Europe, il y a persistance de l'Ancien Régime politique jusqu'à la Première Guerre mondiale, la guerre de Trente ans du XXe siècle (Legendre 1975) - c'est-à-dire la séquence guerre-crise-guerre des années 1914-1945 - correspondant à la véritable crise structurelle de mutation d'un tel régime(15). Selon nous, cet auteur a raison d'affirmer que "jusqu'ici les historiens ont trop insisté sur l'essor de la science et des techniques, du capitalisme industriel et mondial, de la bourgeoisie et des classes moyennes, de la société civile démocratique et du modernisme culturel". En se préoccupant davantage "de ces forces novatrices et de l'avènement de la société nouvelle que de ces forces d'inertie et de résistance qui ont freiné le déclin de l'ordre ancien", "les historiens et les spécialistes des sciences humaines du monde occidental" ont "donc eu une nette tendance à sous-estimer, voire à dévaloriser, la capacité d'endurance des vieilles forces et des vieilles idées, et leur habileté à assimiler, retarder, neutraliser et subjuguer la modernisation capitaliste, y compris l'industrialisation. Il en résulte une vision partielle et déformée du XIXe et du début du XXe siècle". Bref, "pour parvenir à une vue plus équilibrée, les historiens devraient prendre en compte non seulement le drame du changement progressif mais aussi la tragédie implacable de la persévérance historique tout en étudiant leur interaction dialectique"(16). Il faut donc "réviser les périodisations globales traditionnelles, qui sont pour l'essentiel un héritage idéologique du XIXe siècle, et qui présupposent ce qui reste précisément à démontrer : l'évolution grossièrement concomitante
des éléments les plus divers d'un ensemble, à l'intérieur de la période considérée", le problème étant "dès lors de cerner, à l'intérieur d'un ensemble de données de nature différente quels sont les niveaux en évolution rapide, ou en transformation décisive, et quels sont les secteurs à forte inertie, dans le moyen ou le long terme"(17). Il n'y a que dans cette perspective que l'on pourra admettre que "le XIXe siècle a vu se réaliser ce dont avaient rêvé les monarques absolus du XVIIe siècle ou leurs ministres : des Etats centralisés, dotés d'une administration nombreuse, hiérarchisée, des armées importantes dès le temps de paix, réunissant en temps de guerre de tels effectifs que l'art de les mettre en mouvement devint une des principales conditions des succès militaires"(18), tout en concevant que la réalisation de ce rêve a eu pour contrepartie le maintien du type de relation entre l'Etat et le "capitalisme" qui caractérisait déjà l'Ancien Régime. Bref, si l'Etat reste un champ essentiel d'accumulation pour une bourgeoisie qui épouse encore en fait dans sa masse l'idéal terrien aristocratique devenu idéal rentier dans sa version libérale du XIXe siècle, il faut s'intéresser de plus près aux financiers et à la Finance en examinant si derrière les changements de formes et les améliorations techniques ne subsistent pas des rapports sociaux inchangés sur le fond. C'est dans cette perspective que cet article, d'une part, reprend d'une manière systématique le questionnement "bruguiérien" de l'affirmation, désormais traditionnelle quoiqu'en fait établie au vu de la période 1770-1795, selon laquelle "la Révolution française avait fait passé le système fisco-financier du capitalisme à la bureaucratie" (Bosher 1970), et d'autre part, cherche à poser les prémices d'une interrogation plus systématique à venir sur la place du capitalisme financier d'Etat dans tout le grand XIXe siècle (1815-1935) en montrant à partir d'un certain nombre d'évaluations que ce rôle, en dépit de son extrême discrétion, n'a pu être que très important. I. La bureaucratie fiscale contre le capitalisme financier ? Limites d'une prétendue opposition. Peut-on véritablement opposer la bureaucratie au capitalisme ? S'il n'est pas dans notre objet d'apporter une réponse générale à cette question, il nous est néanmoins possible d'affirmer que tel n'est pas le cas en matière fisco-financière. Si, en effet, en ce domaine, le terme de bureaucratie veut dire tout d'abord étatisation complète et disparition de la gestion capitaliste marchande des fonds publics et de la dépendance de l'Etat vis-à-vis de la bourgeoisie financière, on ne peut pas dire qu'il y a eu passage du capitalisme à la bureaucratie au XIXe siècle pour quatre raisons essentielles que l'on peut ainsi résumer : - d'une part, pendant tout le siècle, les fonctions fiscales de base sont assurées par des agents - fonctionnaires ou non - qui, pour la plupart, ne sont pas rémunérés pour l'essentiel par des traitements fixes mais continuent de toucher des "remises" proportionnelles à leur chiffre d'affaires fiscal; - d'autre part, certaines fonctions financières fondamentales sont encore exercées par les "banquiers-fonctionnaires" installés à leur compte, les receveurs généraux appellés ensuite trésoriers payeurs généraux dès qu'ils concentrent également entre leurs mains les fonctions de payeurs des dépenses; - ensuite, l'unité de trésorerie de l'Etat est en fait assurée par l'intermédiaire de la Banque de France, banque commerciale privée dominée par la Haute Banque et qui, bénéficiant de la concession du privilège étatique de l'émission monétaire, négocie contractuellement avec l'Etat le niveau et la qualité de ses contreparties en "services"; - enfin, la Haute Banque puis les grandes banques de dépôts sont également très présentes dans la gestion des emprunts publics longs et le placement des rentes perpétuelles sur l'Etat.
Par contre, si on entend par bureaucratie quelque chose d'ordre plus "technique" correspondant à un développement des bureaux repérable quantitativement et éventuellement assimilable à une certaine rationalisation ou modernisation, on peut considérer que le XIXe siècle a connu un développement de la bureaucratisation, voire "une véritable «révolution bureaucratique»" (Bruguière 1975). Toutefois ces transformations, d'une part, ne peuvent être assimilées à une gestion directe par l'Etat de ses finances comme on vient de le suggérer, d'autre part, ne sauraient être imputées à la Révolution qui renverse la monarchie absolutiste, laquelle a plutôt introduit le désordre dans le système fisco-financier notamment en supprimant les impôts indirects et en recourant à l'élection des receveurs. La rationalisation de l'administration a en fait commencé bien avant la Révolution et ne s'est pas arrêtée après, ayant fait plutôt l'objet d'un développement sans solution de continuité au delà des aléas révolutionnaires. On peut même affirmer que la Ferme Générale est un des principaux "coupables" en ce domaine, elle qui cherchait, ce faisant, à faire rendre mieux, pour son propre compte, le prélèvement fiscal qu'opérait ses 35 000 agents(19). Il faut admettre que la bureaucratisation de l'administration des finances, quelque soit le sens dans lequel on l'entend et dans les limites de son effectivité, n'est guère imputable sur le fond au processus révolutionnaire et n'est pas non plus réductible à une administration directe par une bureaucratie non marchande. Il convient donc de considérer que les modifications apportées par la Révolution et l'avènement du libéralisme politique sont d'un autre ordre et résident plutôt dans l'accroissement de la légitimité de l'impôt et l'instauration d'un contrôle externe sur la bureaucratie d'Etat, étant entendu que l'abandon des privilèges fiscaux de droit et le vote de l'impôt et des dépenses publiques n'empêchent pas en eux-mêmes ni le développement de la bureaucratie au niveau de l'administration des prélèvements étatiques, ni la croissance du pouvoir économique, voire politique, du capitalisme financier investi dans les finances publiques. Le libéralisme étant au niveau de l'Etat essentiellement fondé sur le vote de l'impôt, les changements qu'il introduit et qui conduisent à cette nouvelle légitimité de l'impôt concernent les formes des prélèvements et les procédures de fixation de leur niveau. L'impôt-contribution suppose l'adhésion, et cette adhésion recherchée ne peut être obtenue en permanence que si l'Etat se conforme à une bonne gestion de son économie. Bref, à travers le vote de l'impôt, le libéralisme veut un "Etat léger" se comportant en "bon père de famille", un "État à bon marché" au "budget modique" (Bouvier 1972). Mais ne se soucie-t-il pour autant que d'équilibre budgétaire comme on pourrait le penser en s'arrêtant à l'énoncé du programme dogmatique des économistes libéraux ? En fait, comme en témoignent la "restauration" très impopulaire des impôts indirects, la limitation censitaire du droit de vote associé aux contributions directes et la récurrence des révoltes anti-fiscales et des moments révolutionnaires, la légitimité de l'Etat fiscal au XIXe siècle conçerne encore "moins les masses que les cadres" de la société - les propriétaires terriens et rentiers parmi lesquels se trouvent désormais noblesses et bourgeoisie - tout comme celle du régime monarchique ne conçernait que ses "cadres", à savoir le roi, sa bureaucratie, le cour, les propriétaires terriens (petits et grands) et quelques marchands (Wallerstein 1980). Or ces cadres sont ceux-là même qui peuvent être intéressés à ce que le crédit public se développe, et crédit public veut dire endettement public et donc déficit budgétaire. On ne peut nier cependant que la légitimité du fisc soit également liée aux modalités du recouvrement de l'impôt pour une opinion libérale qui veut, on vient de le voir, un Etat "à bon marché". Le passage de l'impôt tribut monarchique à la "contribution" bourgeoisie va ainsi avec l'instauration d'un principe d'économicité également bourgeois dans la gestion de ces contributions assurant sa pleine efficacité et qui voudrait l'administration fiscale directe et l'élimination de la "finance privée" parasitaire. Mais là-encore entre le discours et la pratique, il y a disjonction, ne serait-ce toujours que parce que la doctrine elle-même est
paradoxale. Dans le cadre d'une économie d'ancien type où continuent de prédominer les valeurs terriennes et plus largement rentières, la "modernisation" du système de prélèvement correspond, en effet, à la fois à une prise de contrôle de la bourgeoisie dans son ensemble sur l'Etat et à l'affermissement du pouvoir d'une bourgeoisie d'Etat. Contrôler l'Etat, c'est alors non seulement accéder au régime politique, c'est aussi maîtriser son "économie" et pourquoi pas la "mettre en valeur" en la considérant comme une source directe d'accumulation via une (re)distribution de revenu dont on peut améliorer le rendement par une rationalisation bureaucratique. Ainsi, en pratique, il n'est pas sur le fond contradictoire avec le libéralisme de concéder à des capitalistes «l'industrie» de la finance publique. N'est-ce-pas d'ailleurs en ce sens que l'on peut interprêter le Dictionnaire des finances de 1894 lorsqu'il nous dit que "les économistes convaincus que l'industrie privée est dans beaucoup de cas plus apte que l'Etat à rendre aux citoyens les services qu'ils réclament, limitent à un petit nombre les fonctions de la collectivité et réduisent l'impôt au minimum"(20). I.1.Le changement de fond : le vote annuel de l'impôt par le Parlement. C'est donc dans l'apparition d'un régime parlementaire, c'est-à-dire d'un nouveau réglement de co-propriété de l'Etat territorial dans lequel le vote de l'impôt, puis celui des dépenses publiques, occupent une place centrale, que réside la rupture révolutionnaire fondamentale. Dorénavant, le pouvoir législatif est séparé de l'exécutif et est mis en place un ensemble d'institutions qui sanctionnent les nouvelles relations entre les "cadres" de la société - entre les différentes fractions ou groupes de propriétaires - et dont les rapports mutuels et le fonctionnement propre sont codifiés dans une Constitution écrite. En ce qui conçerne plus particulièrement la fiscalité, c'est dès le début de la période révolutionnaire que les Constitutions nouvelles reprennent à leur compte les revendications de l'aristocratie et de la bourgeoisie d'Ancien Régime : abandon des privilèges de droit moyennant de véritables droits politiques dont celui essentiel du consentement à l'impôt, déclaration des droits de l'homme et du citoyen stipulant que "tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée". La Constitution de 1791 (celle de la brève première monarchie constitutionnelle) déclare, quant à elle, que "les contributions publiques sont fixées chaque année par le corps législatif". Néanmoins ces principes restant largement inappliqués jusqu'à la Restauration, c'est seulement sous celle-ci que la France "fit sa première expérience suivie de régime représentatif. La société issue de la Révolution, dernière forme de la société française ancienne, se stabilise (alors) provisoirement avant de subir le choc du machinisme et que se fasse sentir le poids d'un prolétariat ouvrier"(21). La Charte de 1814 met ainsi en place deux chambres représentant la Nation : l'une héréditaire que le roi complète à son gré; l'autre élue au suffrage censitaire, la Chambre des députés des départements. Ces chambres votent les lois et contrôlent un budget dont elles n'ont pas néanmoins l'initiative. "Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a pas été voté par les deux chambres et sanctionné par le roi" (art. 48 de la Charte). A partir de ce simple droit de voter l'impôt, "la bourgeoise foncière qui tient la Chambre des députés", vu les conditions de cens (contributions directes acquittées) requises pour être électeur et éligible, s'attribue des prérogatives nouvelles(22). Dès 1817, elle se fait reconnaître le droit de contrôler les dépenses ministère par ministère; en 1827, ce droit est étendu aux grands service publics à l'intérieur de chaque ministère, et en 1831, aux divers chapitres budgétaires(23). En cela, rien que de logique pour "les véritables actionnaires de la société" (selon l'expression de "l'idéologue" Daunou), car "celui qui a le droit de voter l'impôt, mais qui n'en a le devoir qu'autant qu'il est indispensable et jusqu'à concurrence de
ce qui est indispensable, a nécessairement le droit d'examiner s'il est demandé pour les nécessités de l'Etat, de vérifier ces nécessités, les dépenses et leurs motifs, de surveiller l'emploi des fonds et de s'assurer qu'ils n'ont pas été distraits de la destination pour laquelle seulement ils ont été accordés"(24). Et malgré ses penchants initiaux pour l'absolutisme, "le Second Empire parcourut à nouveau ces différentes étapes : en 1852, on revint au vote par ministères, en 1861, le vote par sections fut rétabli, le vote par chapitres en 1869"(25). Ainsi la "bourgeoisie", quelques soient ses fractions - et ce terme inclut désormais la noblesse elle-même -, s'est fait reconnaître un pouvoir financier global, géré par un Parlement qui la représente de façon plus ou moins large. Les grands principes de l'orthodoxie budgétaire classique qui fondent la conception juridique et libérale de la "science des finances" sont par là-même institués, formant le carcan de règles budgétaires, législatives ou simplement coutumières, qui va constituer la trame du nouveau système fisco-financier. Les contraintes juridiques d'élaboration et d'exécution du budget. Tandis que sous l'Ancien Régime, on finissait toujours par dépenser sans tenir compte des ressources disponibles, ces nouvelles règles budgétaires introduisent des relations obligées entre dépenses et recettes publiques. Dorénavant, le "sacrifice" que constitue une dépense publique au financement de laquelle les propriétaires participent doit "être strictement subordonné aux possibilités et proportionnel aux ressources individuelles"(26). La nouveauté n'est pas tant ici dans le fait budgétaire lui-même, puisque, contrairement à ce qu'affirme la science financière classique, "l'idée d'une monarchie d'Ancien Régime sans budget, juste quant au droit, ne l'est pas dans les faits. La pratique financière de l'Etat suppos(ait déjà) des mécanismes que l'on peut qualifier de budgétaires, en retenant du mot les concepts de prévisions, de comptabilisation et de vérification des dépenses et des recettes"(27). La nouveauté est interne à la «procédure budgétaire». Le budget doit respecter certaines contraintes de présentation et d'élaboration. Il est voté, fait l'objet d'une publicité et son exécution est contrôlée. Les contraintes institutionnelles qui pèsent sur la présentation du budget avant qu'il ne soit soumis au vote des représentants sont en général regroupées, rappellons-le, en cinq règles majeures : unité, universalité, annualité, spécialité et équilibre. Toutefois la dernière de ces règles n'est pas du même ordre que les autres dans la mesure où elle n'est pas dotée comme celles-ci d'un caractère légalement contraignant et il convient de l'envisager à part. La règle de l'unité tout d'abord veut que l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires soit présenté dans un seul document. Elle a un objectif politique précis : permettre le contrôle efficace du parlement sur le gouvernement en évitant de vider de son contenu le document budgétaire soumis à l'approbation parlementaire(28). Poursuivant le même objectif que la règle de l'unité qu'elle complète en la précisant, la règle d'universalité budgétaire consiste "à fondre en une seule masse les ressources fiscales et autres produits et à imputer l'ensemble des dépenses publiques sur cette masse de recettes"(29). Elle est composée de deux sous-règles, celle du produit brut (qui, par exemple, implique de ne pas comptabiliser les recettes fiscales déduction faite des frais de recouvrement) et celle de la non-affectation des recettes (qui interdit l'assignation d'une recette spécifique à une dépense et implique donc la centralisation des caisses publiques). La règle de l'annualité budgétaire veut, de son côté, que le budget soit établi chaque année pour un an, les dépenses de l'année devant correspondre à des recettes de l'année. Elle est destinée à empêcher les anticipations de recettes - fuite en avant dans le déficit - permettant ainsi un contrôle plus serré des dépenses et une maîtrise plus grande de la fiscalité. La règle de la spécialité, enfin, veut que ce soit "sur des unités relativement réduites de crédit" - des chapitres ou des sections budgétaires qui aient un sens -
que porte l'autorisation parlementaire. Elle est alors un puissant moyen de contrôler l'activité gouvernementale(30). Le contrôle budgétaire. Aux règles juridiques de présentation du budget, il faut adjoindre celles qui ont trait au contrôle de l'exécution des budgets votés, car, pour que la procédure bien réglée du vote budgétaire soit opérationnelle, encore faut-il que le pouvoir exécutif respecte le budget voté. D'où la nécessité d'un contrôle parlementaire sur les finances publiques réellement pratiquées. "Ce contrôle parlementaire fut constitué par une série de lois votées en quelques années; une loi du 28 avril 1817 obligea les ministres à soumettre annuellement au Parlement leurs comptes définitifs. Une loi du 15 mai 1818 créa la loi de réglement des budgets, par laquelle le Parlement était appelé à vérifier et à apurer les budgets exécutés (...); la loi de réglement, qui cloturait le cycle budgétaire ouvert par le vote du budget, permettait de vérifier la correcte application par l'Administration des décisions prises lors du vote du budget. Une ordonnance du 10 décembre 1825 créa une commission de vérification des comptes des ministres, chargée d'examiner leur comptabilité et de communiquer ses observations au ministre des finances et aux chambres; les irrégularités constatées devaient faire l'objet de sanctions"(31). Les chambres demandèrent en outre l'assistance de la Cour des Comptes dont les "déclarations de conformité" initialement réservées au Chef de l'Etat lui furent communiquées, ce qui permit d'améliorer un contrôle de régularité et d'opportunité des pratiques financières de l'exécutif qui néanmoins ne s'exerca qu'a posteriori. Ce contrôle entraina certaines mesures exemplaires comme l'obligation qui fut faite à un ministre de rembourser sur ses fonds personnels des travaux effectués bien que non budgétisés. Mais il avait surtout pour but de contraindre le gouvernement à rendre publiquement des comptes, publicité qui était à la fois un trait fondamental du régime représentatif et une condition sine qua non d'un renforcement du crédit public et de la puissance financière de l'Etat et de ses bailleurs de fonds. La règle doctrinaire de l'équilibre. Enfin, bien qu'elle n'ait pas le caractère législatif des règles d'élaboration et de contrôle du budget, la règle de l'équilibre budgétaire est néanmoins fort importante dans le libéralisme fisco-financier en tant qu'élément normatif jouant sur les discours et attitudes des représentants des "actionnaires" de l'Etat. Cette règle implique d'abord que les recettes proprement administratives - contributions et revenus du domaine public - compensent les dépenses ordinaires. Elle veut ensuite que le recours à l'emprunt soit réduit et proportionné aux dépenses exceptionnelles - dépenses d'équipement et, le cas échéant, dépenses de guerre - qui excèdent la capacité contributive annuelle du pays; elle va donc de pair avec cette autre règle de doctrine qui veut qu'à dépenses exceptionnelles correspondent des recettes exceptionnelles. Cependant, formulée de la sorte, cette doctrine n'aurait pas été désavouée par l'Ancien Régime, et ce qui la fait apparaître dorénavant comme véritablement normative, c'est qu'elle semble avoir été mieux respectée et/ou que l'on s'y soit référé en permanence. Au vu des graphiques 1 et 2, on voit en effet qu'effectivement l'équilibre budgétaire a bien été apparemment un objectif qu'on s'est efforçé de respecter, le déficit ayant été à peu près "côtoyé" - selon l'expression consacrée - la plupart du temps, en tous cas beaucoup plus souvent que sous l'Ancien Régime. Toutefois, il est clair également qu'il ne s'agit pas non plus d'une règle annuelle à portée immédiate car nombreuses restent les années où, à court terme, le déficit n'est pas véritablement contenu (cf. graphique 3, zoom sur la période 1815-1813). Paradoxalement, d'ailleurs, l'emprunt public long, la rente perpétuelle
sur l'Etat, ne connut jamais de croissance aussi importante que dans cette période d'affichage d'une stricte orthodoxie budgétaire où la charge de la dette, en conséquence, représentait une part considérable des dépenses publiques(32).
1 02 1 03 1 04 1 051 02
1 03
1 04
1 05GRAPHIQUE 1 : DEPENSES ET RECETTES ORDINAIRES DE L'ETAT
DEPENSES
RESSOURCES ORDINAIRES
1815-1939
M. F
. CO
URA
NT
Source : Fontvieille 1976
1 01 1 02 1 031 01
1 02
1 03GRAPHIQUE 2 : DEPENSES ET RESSOURCES ORDINAIRES DE L'ETAT
DEPENSES
REVENU.NET
1600-1780
M. LIVRES TOURNOISSource : Guéry 1978
5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
GRAPHIQUE 3 : DEPENSES ET RECETTES ORDINAIRES DE L'ETAT
DEPENSES
RESSOURCES ORDINAIRES
1815-1913
M. F
. CO
URA
NT
Source : Fontvieille 1976 La règle de l'équilibre, appuyée sur les quatre règles législatives précédentes, apparaît ainsi plutôt comme le masque doctrinaire de règles implicites déterminant un niveau et une périodicité des dépenses exceptionnelles et du retour à l'équilibre budgétaire qui soient compatibles avec une reproduction élargie sans crise du crédit public, seule susceptible d'en faire un pôle maîtrisable de l'investissement bourgeois. Le nouvel efficace des règles fisco-financières libérales réside ainsi non pas dans l'équilibre à court terme mais dans le retour régulier à l'équilibre - voire à l'excédent budgétaire - et dans l'absence de déséquilibre cumulatif, bref dans la capacité du système à rendre véritablement "exceptionnel" l'ancien "extra-ordinaire". C'est pourquoi le désir bourgeois de conserver une assise solide au crédit public fournit sans doute mieux que la revendication de l'équilibre budgétaire la clef de la croissance du système fisco-financier du XIXe siècle. I.2. Portée et temporalité de la modernisation du Trésor public . Un autre réquisit "officiel" du libéralisme serait que le recouvrement de l'impôt soit désormais entièrement "nationalisé", c'est-à-dire du ressort exclusif de l'Administration. L'argument le plus frappant avancé en ce sens est que, bien que la Régie des contributions directes soit reconstituée à partir de l'Administration des vingtièmes, de même que celles des contributions indirectes, de l'enregistrement et des douanes le sont à partir de la Ferme Générale (et cela, pour certaines, bien avant la Révolution), les fermiers généraux, en tant que tels, disparaissent de la scène, et cela, pour bon nombre d'entre eux comme Lavoisier, du fait même d'une liquidation physique. Certes le passage à la guillotine en une seule fournée de 28 fermiers, le 19 floréal an II, a de quoi marquer les mémoires; on ne saurait en déduire pour autant que la ferme générale ainsi décapitée en est, en tant qu'institution, sortie intégralement "nationalisée". Un autre argument plus sérieux est que, à l'issue de la période impériale, l'organisation du Trésor public apparaît comme plus autonome, efficace et rationnelle. L'Etat maîtriserait ainsi totalement le processus de prélèvement et pourrait notamment centraliser son système de caisses afin "d'appliquer" avec célérité ses recettes à ses dépenses. Les divers travaux déjà cités ainsi que d'autres plus anciens conduisent cependant, d'une part, à voir dans les changements réalisés l'expression d'une continuité dont la Révolution n'a été au mieux qu'un processus accélérateur, d'autre part, à relativiser la portée de l'autonomie du Trésor public en ce domaine. D'un côté, en effet, le processus de centralisation du Trésor public doit être
considéré comme étant déjà en voie d'achèvement à l'orée du processus révolutionnaire; dès avant la Révolution, la tendance historique est à la centralisation du Trésor Royal - réalisée officiellement en 1788 - et à un meilleur contrôle administratif des opérations fisco-financières. De l'autre, l'administration directe par l'Etat du procès de prélèvement est au contraire loin d'être définitivement acquise. L'unité de trésorerie et le contrôle des opérations fisco-financières. Dès 1777, Necker avait établi "le premier réglement général de la comptabilité publique et (…) tenté de substituer à un imbroglio de receveurs, de payeurs et de contrôleurs, de trésoriers, de régisseurs, un service de la Trésorerie simple et bien hiérarchisé, comportant une caisse centrale et des commis qui n'étaient pas propriétaires de leurs offices". Et "la France aurait sans doute réalisé l'unité de la Trésorerie dès la fin du XVIIIe siècle si la Révolution n'avait pas interrompu l'effort que Necker et Calonne avaient entrepris parallèlement à celui des anglais. A la veille de la Révolution, tous les principes essentiels étaient posés; mais il a fallu attendre le Premier Empire et la Restauration pour les mettre en application"(33). Dit autrement, en ce domaine, la Révolution aurait plutôt freiné le processus qu'elle ne l'a accéléré. Premier constat. L'oeuvre d'unification des régimes comptables et de suppression des caisses particulières fut, en fait, "réalisée grosso modo en une cinquantaine d'années, du règne de Louis XVI à la Monarchie de Juillet"(34). L'établissement par Mollien de la Caisse de service en 1806, puis de la Direction du mouvement général des fonds - l'ancêtre de l'actuelle Direction du Trésor - au sein même du Ministère des finances par le Baron Louis en 1814, et enfin l'unification des caisses en une caisse centrale ainsi que l'institution d'un payeur unique du Trésor sous le titre de directeur des dépenses par Corvetto en 1817(35), ne sont ainsi que l'aboutissement d'une logique technico-administrative qui se développe dans un temps long. Il faut ainsi encore attendre la fin du Second Empire pour que le Trésor Public acquiert pour l'essentiel la forme institutionnelle qu'on lui connait aujourdhui : "C'est seulement en 1865 que les fonctions de receveur général et de payeur dans chaque département sont réunies et qu'apparaît la figure du trésorier-payeur général. Jusqu'alors la fusion n'avait été faite qu'au sommet : aux échelons locaux, il y avait encore des comptables spécialisés dans les recettes et des comptables spécialisés dans les dépenses"(36). Deuxième constat. Quant au principe désormais codifié de la séparation des ordonnateurs des recettes et dépenses publiques d'avec les comptables chargés du recouvrement et du paiement effectif, il n'est pas non plus une innovation révolutionnaire. Ce principe était déjà, en effet, appliqué de facto sous la Monarchie absolue (mise en place des intendants flanqués ensuite des directeurs des vingtièmes, assignations des dépenses à des recettes conservées dans les caisses des financiers qui n'avaient ainsi plus aucun rôle d'ordonnancement). Il y a certes mise en place sous le Premier Empire d'un double contrôle centralisé des comptables publics : contrôle judiciaire par la Cour des Comptes, instituée en 1807, qui met en jeu a posteriori leur responsabilité pécuniaire, mais celle-ci est l'héritière directe des Chambres des Comptes des anciens Parlements(37); et contrôle administratif par l'Inspection générale du Trésor (1801) puis des finances (1816) qui s'exerce de façon interne et disciplinaire pendant l'exécution des opérations sur l'ensemble des agents des Administrations fiscales, mais là-encore, cette institution relève de cette logique interne déjà à l'oeuvre au XVIIIe siècle et qui pousse à la "modernisation" de la structure administrative de l'Etat. Un perfectionnement administratif, fruit de l'absolutisme napoléonien.
Pour s'en convaincre, il suffit de considérer qu'en la matière, c'est Napoléon Bonaparte, le "roi de la Révolution" selon l'expression de F. Furet(38), qui, poussant à un terme encore jamais atteint l'absolutisme centralisateur, a parrainé l'institution de la plupart de ces pratiques administratives. Or l'épisode napoléonien constitue en un espace de temps réduit un cycle complet et caricatural de vie d'un régime politique absolutiste : ralliement-maintien dans une dépendance curiale d'une large fraction de l'ancienne aristocratie et création d'une nouvelle noblesse d'origine militaire et financière, exaltation des valeurs de l'ancienne société à ordres et restauration du rôle de l'église avec recherche d'une légitimité d'ordre religieux (sacre), guerre permanente, patrimonialisme et mercantilisme, méfiance à l'égard du crédit, attachement exclusif à la monnaie métallique, restrictions au fonctionnement des organes représentatifs des classes dominantes et, pour finir, abandon du consentement à l'impôt(39). Ainsi, si le Consulat et le Premier Empire s'appuient sur la bourgeoisie financière - les receveurs généraux et la Haute Banque qui connait à cette époque un "âge d'or" (Soboul 1976, Pernoud 1981) -, c'est encore à la manière ancienne, celle qui liait l'ancienne monarchie absolue à ses financiers. Mais ce point mérite d'être précisé. Jusqu'en 1806, l'Etat impérial dépend en matière fiscale simultanément des receveurs généraux (rétablis en 1795 et dont les modalités de cautionnement sont fixées en 1799) et d'un "groupe de banquiers et de fournisseurs nommés faiseurs de service" (40) chargés d'escompter les rescriptions des receveurs. A partir du Consulat, en effet, les receveurs départementaux (généraux) souscrivent au début de l'exercice fiscal des engagements mensuels de paiements par douzième des impôts directs, et l'échéance de ces engagements étant retardée de quatre mois, cela a pour effet, d'un côté, de nécessiter un escompte immédiat de ces engagements par des banquiers - Stourm parle à ce propos "de taux usuraires demandés et obtenus par les anciens spéculateurs du Directoire"(41) -, de l'autre, "de réserver d'importantes jouissances d'intérêt aux receveurs", puisque ces derniers acquittaient en seize mois ce qui devait leur être payé en douze. La tentative faite en 1802 de faire escompter les engagements des receveurs généraux par une Agence qui leur fut propre ayant échoué, ce fut la compagnie financière privée dite des Négociants réunis qui finit en 1804 par bénéficier du marché de cet escompte. Mais celle-ci, lançée dans une spéculation malheureuse qui la met à court d'argent, ne tarde pas, tout en continuant à récupérer les encaisses des receveurs, à utiliser le réescompte de la Banque de France, ce qui a pour effet, à l'heure des échéances, de mettre cette dernière au bord de la faillite(42). Banqueroute des faiseurs de service donc, renvoi du ministre Barbé-Marbois et arrivée de Mollien comme nouveau ministre, réforme administrative, voilà encore une séquence qui rappelle à souhait l'Ancien Régime. La réforme qui doit "libérer le Trésor des intrusions étrangères" - c'est-à-dire des banquiers et spéculateurs peu scrupuleux - consiste alors à "créer à leur place, dans le sein même de l'administration des finances, des banquiers-fonctionnaires"(43), lesquels ne sont cependant autres que les receveurs départementaux en place et déjà assimilés aux anciens receveurs généraux. La caisse de service, nouvellement chargée d'appliquer les recettes aux dépenses dans les départements, ouvre pour cela des comptes courants rémunérés à tous les receveurs généraux dans lesquels ceux-ci sont incités par des bonifications d'intérêt à déposer les recettes fiscales au fur et à mesure qu'elles rentrent dans leur caisse et non plus seulement selon l'échéancier préétabli. On aura l'occasion de revenir sur cette institution définitivement mise au point en 1820(44), "invention géniale" qui solidarisait les intérêts de l'Etat avec ceux de ses financiers et que l'on peut à juste titre considérer comme la véritable «révolution» du point de vue financier(45). Bornons-nous, pour l'instant, à constater qu'en 1806 donc, sous l'appellation nouvelle de fonctionnaire-banquier et selon un mécanisme nouveau, le receveur général est confirmé dans ses anciennes prérogatives de financier privé de l'Etat : ce qui le rend "fonctionnaire", c'est uniquement qu'il doit officiellement cesser d'employer ses
excédents de recettes fiscales dans des placements de son choix, et que pour cela, l'Etat lui verse des commissions et des intérêts sur ses propres impôts. Comme a pu le dire Mollien lui-même, l'instigateur de la réforme, «la caisse de service complète les rapports du Trésor avec tous les comptables; elle appelle au Trésor public le produit des impôts directs, avant l'époque même fixée par les souscriptions et les engagements des receveurs généraux… C'est au nom de leur propre intérêt qu'elle porte les comptables à accélérer leurs versements au Trésor» (c'est nous qui soulignons). En d'autres termes, l'amélioration technique que constitue la caisse de service ne libère pas pour autant l'Etat de l'intérêt personnel des financiers chargés du recouvrement des impôts, et elle constitue une innovation qui s'inscrit dans les tendances structurelles de l'Etat centralisateur et ne rompt pas le rapport de cet Etat à ses financiers capitalistes. II. La persistance de «la finance» dans le recouvrement des contributions et "l'application" des recettes aux dépenses. La teneur des principaux changements qui affectent, à l'issue de la période révolutionnaire et impériale, le système fiscal pris comme un tout étant précisée, attachons-nous maintenant à évaluer plus précisément ce qui le situe dans la continuité d'un modèle de relation Etat/capitalisme hérité de l'Ancien Régime. Car si "l'administration financière de l'Etat au XIXe siècle" a été "le résultat subtil d'une décantation (…) des ingrédients les plus efficaces du système antérieur : une bureaucratie abondante et notée comme à la Ferme et à la Régie; des chefs puissants et bien rémunérés, comme les Intendants des Finances et du Trésor de 1788; des percepteurs et des comptables intéressés aux affaires de l'Etat, grâce à un bénéfice personnel, comme les anciens Fermiers Généraux"(46), il est alors intéressant d'essayer de préciser la portée de cette décantation, tant au niveau de son "rendement" économique que de sa longévité, et cela aux deux niveaux de ce que l'on peut appeller respectivement le processus technique de prélèvement et celui de sa "mise en valeur" socio-économique. II.1.La continuité dans le travail de recouvrement : les nouvelles régies, filles de la ferme générale et des offices de finances. Nous avons retracé dans les schémas 1 et 2 l'organisation institutionnelle du système de prélèvement issu de la période révolutionnaire et impériale et tel qu'on le retrouve juste avant la guerre de 1914-18(47). Au sommet de l'édifice, il y a le ministère des finances avec ses deux types de services; les uns sont placés sous l'autorité directe du ministre, comme la direction de la comptabilité publique, la direction du mouvement général des fonds, la direction de la dette inscrite, la direction du contrôle des administrations financières et de l'ordonnancement…; les autres "relevant moins directement du ministre"(48) sont dirigées par un directeur général assisté d'un conseil d'administration, à savoir les cinq directions générales constituant la tête des régies financières des "contributions directes", des "contributions indirectes", des "douanes", de "l'enregistrement, du timbre et des domaines", des "manufactures de l'Etat" enfin.
MIN
ISTE
RE
DES
FIN
ANCE
S(1
800
pers
.)
DIR
ECTI
ON
S
GÉN
ÉRA
LES
DES
CON
TRIB
UTIO
NS
(4
00 p
ers.
)
RÉG
IE F
INAN
CIER
E
DES
MAN
UFAC
TURE
S
DE
L'ÉT
AT
RÉG
IE F
INAN
CIER
E
DES
D
OUA
NES
(230
00 p
ers.
)
RÉG
IE
FIN
ANCI
ERE
DE
L'EN
REG
ISTR
EM
ENT,
DU
TIM
BRE
ET D
ES D
OM
AIN
ES
(450
0 pe
rs.)
RÉG
IE F
INAN
CIER
E
DES
CON
TRIB
UTIO
NS
IN
DIR
ECTE
S (
2500
0 pe
rs.)
D
irec
teur
sdé
part
emen
taux
(8
6)
Insp
ecte
urs
(
190)
Sou
s D
irect
eurs
(arr
ondi
ssem
ents
)
(100
)
Rece
veur
spa
rtic
ulie
rs s
éden
taire
s
(vill
es :
2500
)
DRO
ITS
CON
STAT
ÉS
Dua
lité
Cont
rôle
urs
(400
)
Com
mis
de
dire
ctio
n
(7
00)
As
siet
te :
surv
eilla
nces
, e
xerc
ices
et
rece
nsem
ents
Reco
uvre
men
t des
aver
tisse
men
ts à
pay
er
Ville
s
Rece
veur
spa
rtic
ulie
rs a
mbu
lant
s
(
2000
)
Com
mis
prin
cipa
ux
(2
000)
Cam
pagn
es
As
siet
te :
surv
eilla
nces
, e
xerc
ices
,re
cens
emen
ts,
reco
uvre
men
t
DRO
ITS
AU C
OM
PTAN
T
Rece
veur
sbu
ralis
tes
(16
.000
)
Reco
uvre
men
tdé
livra
nce
des
expé
ditio
ns e
tré
cept
ion
des
déc
lara
tions
Cent
ralis
atio
n d
es f
onds
rec
ouvr
és
RÉG
IE F
INAN
CIER
E
DES
CON
TRIB
UTIO
NS
D
IREC
TES
(7
000
pers
.)
ADM
INIS
TRAT
ION
DE
L'AS
SIET
TE
(130
0 pe
rs.)
Dua
lité
AD
MIN
ISTR
ATIO
ND
U R
ECO
UVR
EMEN
T
(55
00 p
ers.
)
Rôl
es :
eff
ets
àre
couv
rer
sou
mis
sion
au p
réfe
t et
man
dem
ent
D
irec
teur
sdé
part
emen
taux
(8
6)
Insp
ecte
urs
(
106)
Cont
rôle
urs
(1
000)
Con
fect
ion
des
rôle
s en
rel
atio
n
av
ec le
s
répa
rtite
urs
Trés
orie
rs p
ayeu
rs
géné
raux
(86)
Rece
veur
spa
rtic
ulie
rs d
es fi
nanc
es
(arr
ondi
ssem
ents
)
Perc
epte
urs
(5
000)
Enc
aiss
emen
t et
res
pons
abili
té f
inan
cièr
e su
rse
s fo
nds
prop
res
Cent
ralis
atio
n d
es f
onds
rec
ouvr
és
SCHÉ
MA
1 :
ORGA
NISA
TION
INS
TITU
TION
NELL
E DU
PRO
CESS
US D
E PR
ÉLEV
EMEN
T A
LA F
IN D
U XI
X EM
E SI
ECLE
D'A
PRES
STO
URM
(19
12)
:
REGI
ES F
INAN
CIER
ES D
ES C
ONTR
IBUT
IONS
DIR
ECTE
S ET
INDI
RECT
ES
(330
)
DIR
ECTI
ON
S
GÉN
ÉRA
LES
DES
CON
TRIB
UTIO
NS
(4
00 p
ers.
)
RÉG
IE
FIN
ANC
IERE
DE
L'EN
REG
ISTR
EM
ENT,
DU
TIM
BRE
ET D
ES D
OM
AIN
ES
(450
0 pe
rs.)
Cent
ralis
atio
n d
es f
onds
rec
ouvr
és
Trés
orie
rs p
ayeu
rs
géné
raux
(86)
SERV
ICES
SÉD
ENTA
IRES
Rece
veur
s pa
rtic
ulie
rs
o
u bu
ralis
tes
Cont
rôle
urs
Co
mm
is
Reco
uvre
men
t
des
dro
its
Liqu
idat
ion
des
droi
ts
Rece
veur
s pr
inci
paux
Vérif
icat
eurs
Vi
site
des
mar
chan
dise
s
RÉG
IE F
INAN
CIE
RE
DES
MAN
UFAC
TURE
S
DE
L'ÉT
AT M
ON
OPO
LE D
ESTA
BACS
et P
OUD
RES
Vent
e
Entr
epos
eurs
(rec
eveu
rs p
rinc
ipau
x
ou p
artic
ulie
rs)
D
ébita
nts
(don
t rec
eveu
rs
bura
liste
s)
(48
000)
Vent
e
SERV
ICE
ACTI
F
(200
00)
RÉG
IE F
INAN
CIE
RE
DES
D
OU
ANES
(230
00 p
ers.
)
D
irec
teur
s
(23)
Ins
pect
eurs
div
isio
nnai
res
(125
)
Capi
tain
es
(169
)
Lie
uten
ants
et
Sous
-Lie
uten
ants
(3
29)
Brig
adie
rs
(360
0)
Prép
osés
(14
600)
Sur
veill
ance
des
fron
tière
s
D
irec
teur
sdé
part
emen
taux
(8
7)
Insp
ecte
urs
(
108)
V
érifi
cate
urs
(Sou
s-in
spec
teur
s)
(466
)
Enre
gist
rem
ent,
vent
e de
pap
ier
timbr
é et
de
timbr
es fi
scau
x
Rece
veur
s
(282
2)
MO
NO
POLE
DES
ALL
UM
ETTE
S
Com
pagn
ie f
erm
ière
Adju
dica
tion
Mis
e à
ferm
e
SCHÉ
MA
2 :
ORGA
NISA
TION
INS
TITU
TION
NELL
E DU
PRO
CESS
US D
E PR
ÉLEV
EMEN
T A
LA F
IN D
U XI
X EM
E SI
ECLE
D'A
PRES
STO
URM
(19
12)
:
REGI
ES F
INAN
CIER
ES D
E L'
ENRE
GIST
REM
ENT
ET D
U TI
MBR
E,
DES
MAN
UFAC
TURE
S, E
T DE
S DO
UANE
S
Rece
veur
spa
rtic
ulie
rs d
es fi
nanc
es
Les agents des nouvelles régies
Comme on l'a déjà signalé, l'organisation interne de l'ensemble de ces institutions, les procédures multiples de contrôle hiérarchique et croisé, etc… sont pour l'essentiel directement héritées, avec bien entendu quelques perfectionnements éventuels, de celles qui prévalaient antérieurement. Elles recopient les schèmes et méthodes mis au point par les intendances de généralité et l'administration des vingtièmes en ce qui concerne l'administration de l'assiette des contributions directes, par les offices des receveurs généraux pour l'administration de leur recouvrement, et la ferme générale pour l'ensemble des droits indirects(49). Ainsi on peut montrer, par exemple, que "l'administration de l'enregistrement et des domaines, créée et organisée par la Ferme Générale à partir de 1726, a traversé à peu près intacte les bouleversements politiques de la fin du XVIIIe siècle. Ce n'est donc pas à la loi du 22 frimaire an VII, comme le prétendait une mémoire administrative hémiplégique, que remontent ses principes essentiels, ses méthodes, et jusqu'à ses formulaires ou son vocabulaire : c'est à la minutie rigoureuse des Fermiers de Louis XV (…)"(50). Mais laissons de côté ici cet aspect le plus couramment rappellé de la continuité administrative pour nous intéresser essentiellement à la question plus délaissée du statut socio-juridique des collecteurs. Statuts. Observons d'abord à ce propos qu'entre 1875 et 1890, le monopole des allumettes nouvellement créé (1872) fait l'objet, dans la plus pure tradition d'Ancien Régime, de mises à ferme par adjudications successives, ce qui est déjà, à son échelle, révélateur de la permanence de la dépendance de l'Etat à l'égard du capitalisme pour la gestion de ses ressources. On doit également remarquer que si cette procédure d'affermage n'est plus qu'un cas isolé au niveau de l'Etat central, elle semble avoir perduré de manière plus significative encore au niveau local puisqu'à ce niveau, "le système de fermage n'a pas complètement disparu", une loi de 1816 permettant "aux communes de faire percevoir les droits d'octrois par un fermier"(51). Mais d'une portée plus importante est le constat que, d'une manière générale, les statuts et les modes de rémunération des collecteurs des diverses régies ne sauraient être réduits à ceux de salariés à traitements fixes. Les statuts sont au contraire très diversifiés, ce qui rend extrêmement ambigü le qualificatif de fonctionnaire qu'on leur donne usuellement, celui-ci ne revêtant pas du tout la même signification qu'actuellement. On peut ainsi discerner des agents fonctionnaires à traitements fixes (intégral ou partiel), des agents fonctionnaires rémunérés par des remises, des non-fonctionnaires rémunérés également par des remises, des commis "privés" rémunérés comme salariés par les catégories précédentes, et enfin des "surnuméraires" en général non rémunérés qui commencent de cette manière leur carrière dans l'administration. Dans leur ensemble, les régies financières mobilisent donc au début du XXe siècle autour de 100.000 personnes dont moins de la moitié seulement sont des fonctionnaires spécialisés. De plus au minimum 8.000 des 40.000 fonctionnaires ne sont rémunérés que par des remises sur leur chiffre d'affaires comme les non fonctionnaires, et plus de 400 fonctionnaires parmi les plus importants ont un traitement fixe qui ne représente qu'une faible partie de l'ensemble de leurs émoluments. Les 8.000 fonctionnaires "à remise", percepteurs et receveurs des contributions directes et de l'enregistrement implantés au niveau des cantons, représentent d'ailleurs près de la moitié des fonctionnaires des régies financières si l'on fait abstraction des douaniers du "service actif" dont les fonctions ne sont pas strictement fiscales. Ainsi, en dépit du fait que le manque d'information sur les receveurs des "droits constatés" des contributions indirectes et sur ceux des douanes ne nous permette
pas de statuer sur leur cas(52), on peut déjà considérer que le recouvrement d'au moins 70 % des recettes fiscales se fait en rémunérant les collecteurs de base par des remises à partir desquelles ils doivent assurer le bon fonctionnement de leur office; ces remises apparaissent ainsi, pour une part, comme la contrepartie du risque entrepreneurial pris par les collecteurs et qui consiste à engager leur responsabilité personnelle et leurs propres capitaux dans le recouvrement des fonds publics dont ils acceptent de se charger. Examinons alors successivement les deux principales régies pour lesquelles on dispose d'informations afin de se faire une idée plus précise des revenus officiels de ces divers collecteurs d'impôt. Dans l'administration des contributions directes d'abord, comme sous l'Ancien Régime avec la séparation des intendances de généralité et des directions des vingtièmes d'avec les offices de receveurs, on peut constater dans le schéma 1 que les 1300 personnes qui participent à la confection des rôles - administration de l'assiette - sont séparées institutionnellement de celles qui assurent le recouvrement réel (on parle de "dualité"). Les premier sont des fonctionnaires à traitement fixe(53) tandis que les 5.400 receveurs et percepteurs, soumis au cautionnement et qui sont responsables sur leurs fonds propres des "effets à recouvrer" que constituent les rôles émis, ne touchent que des traitements fixes qui sont relativement faibles par rapport au total de leurs émoluments (voire nuls pour les percepteurs) en pourcentage de leur "chiffre d'affaires"; en fait, ils se payent pour l'essentiel directement sur l'impôt. Comme on aura à revenir sur le cas des receveurs généraux dans la mesure où ils sont les seuls, en tant que comptables supérieurs, à hériter des fonctions financières proprement dites qui leur permettent de "mettre en valeur" à l'ancienne manière les ressources qu'ils centralisent, on peut se contenter ici d'évoquer la situation des percepteurs. Ceux-ci ont pris la place en 1804 des collecteurs et "adjudicataires de la perception à la moins dite", et de "simples entrepreneurs de recouvrement qu'ils étaient", ils sont devenus fonctionnaires nommés et dépendants d'une hiérarchie (receveurs particuliers et receveurs généraux)(54). Toutefois, il semble bien, même si on ne dispose pas d'indications précises sur leur mode de recrutement, que ce sont les mêmes "professionnels" qui restent en fonction et que ceux-ci continuent de gérer leur affaire d'une manière très proche de celle qui prévalait lorsqu'ils n'étaient qu'adjudicataires. La responsabilité "sur leurs propres deniers" des fonds à recouvrer qu'ils continuent d'endosser nécessite de leur part de posséder un capital initial, capital transmissible et qui indique que la perception est une sorte de charge ou d'office constituant un fond de commerce(55). De plus, dans la mesure où ils sont assujettis comme leurs collègues receveurs de rangs supérieurs à disposer de leurs propres locaux et personnels, ils sont bien de véritables entrepreneurs ou si l'on veut des officiers ministériels privés. S'expliquent ainsi ces pratiques courantes qui "conduisaient à ressusciter l'hérédité et la vénalité des charges", "les démissions conditionnelles des fonctionnaires" se faisant fréquemment à prix d'argent comme en témoignent des "exemples (…) nombreux, notamment dans l'administration des finances, à tous les degrés de la hiérarchie, aussi bien pour le recrutement des percepteurs ou des receveurs particuliers des finances que pour celui des receveurs généraux ou des conseillers référendaires de la cour des comptes"(56). Par ailleurs, des fiches prosopographiques sur les receveurs généraux et trésoriers payeurs généraux élaborées par P.F. Pinaud(57), il ressort que la perception a pu être une première étape, pour les moins bien dotés au départ, dans une stratégie d'accumulation financière personnelle ou familiale menant jusqu'au stade suprême de fonctionnaire-banquier. Ce type de trajectoire déjà repérable dans la cohorte des receveurs généraux de 1795 à 1865, devient assez courant après cette dernière date, ce qui d'ailleurs correspond sans doute au fait que les trésoriers payeurs généraux du second XIXe siècle sont en moyenne "issus de milieux moins riches" que les receveurs généraux du premier(58).
Emoluments. Tentons alors d'estimer le revenu de ces percepteurs en 1913 en considérant d'abord que chaque percepteur draine en moyenne 180.000 francs(59). En appliquant les taux moyens estimés de frais de perception de 4,4 % et de 7,65 % rapportés par J.-J. Clamagéran pour 1853 et 1854 (cf. infra tableau 1), on obtient un revenu brut moyen par percepteur compris entre 7.900 et 13.800 francs. Bien qu'on ne connaisse pas la répartition interne au sein de la hiérarchie des contributions directes des frais de fonctionnement de l'administration (entre percepteurs, receveurs particuliers et receveurs généraux), on peut néanmoins estimer que la part des frais de personnel et de matériel représente environ 30 % du chiffre d'affaires public des trésoreries générales (cf. infra, tableau 2) et que ce coefficient peut sans doute être réduit pour les percepteurs, par exemple à 20%. On arrive ainsi à une rémunération nette moyenne pour les percepteurs comprise entre 6.300 et 11.000 francs. Compte tenu d'une dispersion probable de ces revenus qui ne comprennent pas d'ailleurs les rémunérations "accessoires" comme celle des cautionnements, on peut alors considérer qu'une bonne partie des percepteurs disposait d'un revenu annuel largement supérieur à 7.000 francs et devait même atteindre assez aisément les 10.000 francs au début du XXe siècle. Grâce au travail récemment publié de J.-P. Massaloux, on a également quelques informations sur les 2800 receveurs de l'enregistrement "rémunérés au moyen de remises proportionnelles à l'importance des recettes de leur bureau, avec minimum garanti pour chaque classe"(60). Même si l'auteur est rapide sur l'évolution de la Direction de l'enregistrement, des domaines et du timbre à partir de 1815, on peut ainsi se faire une idée plus précise que pour les autres régies de l'ensemble de ses effectifs et des rémunérations en son sein. En 1900, on sait que la Direction générale est composé d'un Directeur Général au traitement annuel de 25.000 francs assisté de 70 fonctionnaires dont 3 administrateurs avec traitement variant selon l'ancienneté entre 12.000 et 15.000 francs, de 10 chefs de bureaux touchant de 7.000 à 10.000 francs, de 15 sous-chefs, 19 rédacteurs principaux et 23 commis du "cadre auxiliaire" "aidés il est vrai par de nombreux employés de bureaux non titulaires". La même année, les 87 directeurs départementaux touchent selon leur classe 8.000, 10.000 et 12.000 francs auxquels s'ajoutent "des indemnités de frais de bureaux variant, selon l'importance de leurs postes entre 1.900 et 9.300 francs et destinées à compenser forfaitairement les dépenses de service qu'ils supportent (loyer et chauffage des locaux, salaires des commis, etc.)". Les 591 employés supérieurs (551 inspecteurs et sous-inspecteurs) ont un traitement fixe qui s'échelonne entre 3.500 en début de carrière et 6.000 francs, auxquels s'ajoute des indemnités de frais de tournées variant entre 800 et 1.000 francs. "A la même époque, la rémunération des receveurs est encore constituée par des remises, comme celle des contrôleurs sous l'Ancien Régime. Mais alors les bureaux sont répartis en six classes et leur classement est établi tous les cinq ans d'après la moyenne des produits. Dans la dernière, le traitement annuel du receveur ne peut être inférieur à 2.000 francs, dans la première à 7.000"(61). Au total donc, environ 4500 agents titulaires dont 3600 du niveau receveur (cadre principal dont, en plus des receveurs-collecteurs, près de 400 conservateurs des hypothèques, environ 200 receveurs-contrôleurs et rédacteurs, et 200 agents détachés en Algérie), et si l'on ajoute les surnuméraires et les commis rémunérés par les agents titulaires, un effectif global de 7.000 personnes(62). Toujours selon le même auteur, les rémunérations échouant aux personnels de cette régie ne sont pas inférieures au XIXe siècle à celles qu'ils percevaient à l'époque de la Ferme Générale ou de l'Administration Générale des Domaines et Droits domaniaux. Il n'y a que les directeurs qui, en perdant leur fonction de comptable en deniers, désormais exclusivement assurée par les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers, ont subi une réduction de leurs
émoluments. Mais avec un revenu annuel supérieur ou égal à 10.000 francs pour la plupart d'entre eux, ils continuent de faire partie de la haute bourgeoisie. On doit regretter que J.-P. Massaloux ne nous donne pas les taux de remise concédés aux receveurs à la même époque. Il nous semble, en effet, qu'il a tendance à sous-estimer les revenus des receveurs en cette fin de siècle et à n'attirer l'attention que sur la relative faiblesse des gains des receveurs débutants(63). Or, cette faiblesse du revenu des fonctionnaires débutant est un trait général de la fonction publique libérale (également hérité de l'ancien régime comme le non paiement des surnuméraires), trait qui avait pour fonction de sélectionner dans les fonctions ceux qui avaient les moyens de subsister sans revenu ou avec un revenu insuffisant pendant quelques années(64). Il y a donc pour la même fonction de receveur une grande dispersion des rémunérations dont il aurait été intéressant d'avoir une idée. On ne peut ici que tenter une évaluation à partir d'informations sur les taux de remise concernant 1791 et 1801. A l'époque de la «Régie des droits d'enregistrement et autres y réunis» créée en 1791, la remise des receveurs était de 1,75% pour des recettes comprises entre 300.000 et 400.000 livres, de 2,5% dans les bureaux produisant de 100.000 à 150.000 livres et 5% dans ceux encaissant moins de 10.000 livres, les receveurs devant alors constituer un cautionnement égal au quart de leur recette annuelle quoique ne pouvant excéder 40.000 livres(65). On constate ainsi que si la moyenne des émoluments des receveurs n'est que de 590 livres alors que celle d'un directeur départemental est de 7.200 et celle d'un inspecteur de 3.250, cela n'empêche pas que les receveurs les mieux dotés puissent toucher presqu'autant qu'un directeur : dans les bureaux les plus riches, ils reçoivent entre 5250 et 7000 livres et dans les bureaux intermédiaires entre 2.500 et 3.750 livres. On note également que le cautionnement des directeurs n'est que de 20.000 livres alors que celui des receveurs dans les bureaux intermédiaires est déjà de 25.000. On dispose également d'informations pour l'année 1801 où "sauf dans les bureaux chargés uniquement de la gestion des domaines nationaux, les remises variaient de 5 centimes à 1,6666 centimes par franc selon le montant des encaissements annuels. A l'époque rares étaient les bureaux recouvrant moins de 20.000 francs, et pour ce résultat, les remises étaient de 916 francs. Par ailleurs les produits dits ordinaires évalués à 145 millions pour l'an IX, étaient perçus par 2.700 receveurs environ. La moyenne des recouvrements par bureau ressortait donc à 55.000 francs et les remises correspondantes s'élevaient à 1.900 francs en chiffre rond. Mais les bureaux importants qui réalisaient des recettes supérieures à 100.000 francs procuraient à leurs titulaires des rémunérations atteignant 3.000 ou même 4.000 francs. Enfin, le barême était tel qu'en pratique aucun receveur ne touchait plus de 6.000 francs". A la même époque, le traitement des directeurs s'étalait de 9.000 (3e classe) à 12.000 francs (1e classe), les inspecteurs touchant environ 6.000 et les vérificateurs 3.700 francs(66). Le taux moyen de remise était donc alors de 3,5 % (1.900/55.000) et la dispersion dans les gains des receveurs allait sans doute de 1 à 6. Si l'on pose comme plausible le même niveau moyen de remise, vu l'immobilisme de l'institution, nous pouvons calculer les revenus des receveurs en 1913 à partir des données fournies par R. Stourm. Cette année-là, en effet, chaque receveur de l'enregistrement collecte environ 340.000 francs(67) et un remise de 3,5 % leur assurerait donc en moyenne 11.900 francs par an. Avec une dispersion de un à trois entre cette moyenne et le revenu le plus élevé comme en 1801, on obtient 35.700 francs environ pour ce dernier. Toutefois, il est certain que les receveurs susceptibles de toucher un tel revenu ne pouvaient le faire qu'en engageant à leur compte un certain nombre de commis. On peut alors estimer que les frais généraux des grosses recettes sont de l'ordre d'un tiers du revenu brut des receveurs, chiffre qui correspond à peu près au taux estimé pour les trésoreries générales et à l'évaluation fournie par Massaloux pour les conservations des hypothèques en 1801(68); le revenu net des plus gros receveurs pourrait ainsi atteindre 23.800 francs. En prenant le rapport entre les
indemnités maximales de frais de bureaux (9.300 francs) et le traitement des directeurs de première classe (12.000 francs) en 1900 pour obtenir un ratio de frais, on aboutit à près de 44 %, ce qui, appliqué à la rémunération brute des plus gros receveurs, leur laisse alors encore près de 20.000 francs de revenu net. Enfin, si l'on privilégie, par contre, l'hypothèse d'une hiérarchie stable des gains des receveurs entre 1801 et 1900, on arrive seulement à un revenu net des plus gros receveurs de 12.000 francs (6 fois le minimum légal de 2.000 francs). Il apparaît donc, en tout état de cause, comme fort probable qu'un certain nombre de receveurs pouvait obtenir à un certain stade de leur carrière des revenus - de l'ordre de 10.000 francs et plus - égaux voire supérieurs à ceux des directeurs départementaux. En prenant une large marge, on peut ainsi estimer que le groupe social des collecteurs de base des prélèvements - percepteurs et receveurs rémunérés à la remise - gagnent à la fin du siècle, à partir d'un certain stade de leur carrière, au moins voire plus de 10.000 francs par an. Ce chiffre est à comparer, d'un côté, avec le fait que, en 1894, par exemple, sur 415.000 fonctionnaires civils de l'Etat et des collectivités locales, seulement 3.000 hauts fonctionnaires gagnent plus de 7.000 F par an, et 1.985 plus de 10.000 F, de l'autre, avec cette autre information selon laquelle ces mêmes hauts fonctionnaires, par la valeur moyenne de leurs successions, "font partie des privilégiés de la fortune" et arrivent en deuxième position dans l'échelle de la richesse "derrière les «propriétaires» sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, après la bourgeoisie d'affaires à la Belle Epoque; et à toutes les époques devant les cadres supérieurs et les professions libérales"(69). On voit alors qu'il est fort probable que les percepteurs et les receveurs faisaient partie de cette "bonne bourgeoisie" dont les revenus personnels étaient insuffisants pour vivre en rentiers mais, qui ajoutés à un traitement (ici des émoluments) relativement élevé, permettaient "de vivre sur le pied de la grande bourgeoisie"(70). Ceci nous paraît confirmé par une anecdote(71) selon laquelle, en 1815, le directeur de la comptabilité publique limogé par le baron Louis et dont le remplaçant plus jeune se retrouve avec un traitement de 12.000 francs, est nommé receveur particulier au Havre, ce qui indique à peu près le niveau hiérarchique où se trouve cette fonction financière qui, si elle conçerne les contributions indirectes et les douanes, n'est sans doute pas à un niveau supérieur à celui d'un percepteur de grande ville(72). Certes, en l'absence d'information plus précise sur l'ensemble de ces collecteurs, notamment en ce qui conçerne la nature exacte de leur charge, leur mode de recrutement, le mode de constitution et de transmission de leurs capitaux, les taux de remises, leurs opérations annexes éventuelles, leur insertion dans le tissu social local, etc…, bref sur leur stratégie de reproduction, il est sans doute prématuré de les qualifier simplement de capitalistes, même s'il ne semble pas faire de doute que, sur le plan financier, les percepteurs et les receveurs particuliers, du moins, sont des sous-traitants à leur propre compte des receveurs généraux(73) ; ils payent eux-mêmes leur personnel, ils sont propriétaires (ou locataires) de leurs locaux professionnels et ils font seulement l'objet d'une surveillance externe de la part des maillons supérieurs de la hiérarchie des finances. C'est pourquoi, d'ores et déjà, il paraît difficile de parler à leur propos de bureaucratie impersonnelle salariée et il faut sans doute plutôt y voir une bourgeoisie d'office. Pour aller plus loin et pouvoir apporter un éclairage plus précis sur le niveau de bureaucratie (administrative ou capitaliste) prévalant au XIXe siècle dans l'administration des finances ainsi que sur le degré d'importance et de concentration monopoliste de l'investissement bourgeois dans la gestion des finances publiques, il faudrait prolonger l'étude en cours des sommets du système par des recherches sur ses niveaux inférieurs. Toutefois, si le doute peut être encore permis au niveau de la collecte fiscale de base quant aux types de rapports sociaux qui y prévalent, il est beaucoup moins légitime, on va le voir maintenant, en ce qui conçerne les quelques 87 receveurs ou trésoriers payeurs généraux qui se partagent désormais la gestion au niveau départemental de la totalité des recettes fiscales
recouvrées dans leur territoire. Mais avant d'entrer dans la description de cette nouvelle organisation, il est utile de faire un premier constat en ce qui conçerne son efficacité économique globale. La faible amélioration du rendement du procès de prélèvement. En 1913, la moisson respective des diverses régies est la suivante : les contributions directes récoltent 1.193 millions dont 577 pour le compte des collectivités locales; les indirectes stricto sensu 826 millions (dont 215 pour les droits au comptant), les douanes 662, l'enregistrement 1.189 et les monopoles 573 millions(74). Avec 17% des recettes et une armée de plus 20.000 hommes, les douanes sont financièrement les moins rentables; viennent ensuite les indirectes avec 21 % des recettes collectées par 8.000 fonctionnaires du service général et 15.000 receveurs buralistes non fonctionnaires, puis les monopoles avec 15 % de la recette globale et 48.000 détaillants sans compter les entreposeurs (pour la plupart déjà receveurs particuliers ou principaux). En ce début du XXe siècle, l'enregistrement semble avoir la meilleure productivité du travail puisqu'il collecte 31% des impôts avec seulement 4.500 agents titulaires directement rémunérés, dépassant ainsi les contributions directes qui n'en rapportent autant qu'avec un personnel bien supérieur (7.000 agents titulaires). Il serait intéressant de savoir si ces différences de productivité se retrouvent sous la forme de différences dans les rémunérations, traitements et taux des remises, mais en l'état actuel de la recherche historiographique, cela est impossible. On peut considérer toutefois qu'elles se retrouvent sous la forme de différences dans les coûts de recouvrement puisque le taux moyen des frais de perception évaluable, selon les sources, à 10 % ou 14,36 % en 1853-1854, se distribuerait respectivement en 4,2 % ou 4,87 % pour l'enregistrement, le timbre et le domaine, 4.4 % ou 7.65 % pour les contributions directes, 11.2 % ou 13.95 % pour les boissons et droits divers, et 17.7 % ou 21.32 % pour les douanes et les sels(75). TABLEAU 1 : LES COÛTS DE PRÉLÈVEMENT : COMPARAISON XVIIIe / XIXe SIÈCLES(76)
Types 1726 1768-72 1774 ? 1783 1786 1786 1786 1786 1788 1798 1853 1854 1864 Typesd'impôts d'impôtsSources : Clamagéran Lavoisier Durand Boiteau-Necker Necker Marion Dict. Encycl. Necker de Chabrol Necker de Parieu Ponthier
Massaloux Mathias-O'Brien Massaloux Mathias-O'Brien Massaloux Mathias-O'Brien Clamagéran Clamagéran Clamagéran Massaloux Massaloux Clamagéran Clamagéran Clamagéran(Offices) 10,70%
Impôts directs 6,05% 6% 5,70% 4,40% 7,65% contributionstailles, vingtièmes directes
(Régie 1780) 10,95% 11,77% 8,70% 7,50%Domaine et (maximum) 14,50% 10,38% 12,92% 10,71% (évaluation 4,20% 4,87% Enregistrement
droits domaniaux budgétaire) domainetimbre
(Ferme) 12,08% 11,84% 13,45%Droits de contributions
consommation 10,20% (Lavoisier) 14,32% 14,20% 20% indirectesdont aides 13% 13,70% 11,20% 13,95% dont droits int.et traites 15% 17,70% 21,32% et douanes
10,19% (octrois)Ensemble 10,56% 10,80% 13,96% 10% 14,36% Ensemble
Il est alors frappant de constater (cf. tableau 1) que le coût de collecte du prélèvement n'a pas été véritablement bouleversé par rapport à l'Ancien Régime. Ainsi, ce coût se situerait en 1786 entre 10.6 et 14 % selon les sources, soit un ordre de grandeur tout à fait comparable à celui qui prévaut au milieu du XIXe siècle. Plus précisément, on aurait pour les impôts directs avant la Révolution un taux de frais variant entre 5.7 % et 6.1 % à comparer avec les estimations ci-dessus de 4.4 % à 7.6 %; pour l'enregistrement, le timbre et le domaine, un taux situé entre 12 % et 9 % avant 1789, taux estimé à 7.5 % en 1798 et 7% en 1801 et de l'ordre de 4 à 5 % après; et pour les impôts de consommation, un coût estimé avant la Révolution à 14 % ou à 20 % selon les estimations, coût comparable aux taux de 14 % à 21 % fournis par Ponthier de Chamaillart pour 1854. Ainsi, s'il paraît bien y avoir eu un net
progrès pour l'enregistrement et les droits domaniaux au XIXe siècle(77), ce progrès serait compensé par une perte de rendement pour les droits indirects et surtout les douanes, la productivité du travail de collecte des impôts directs restant à peu près la même. Voilà un constat qui devrait inciter à approfondir la recherche sur la prétendue amélioration du rendement que la bureaucratisation des finances aurait accomplie ainsi que sur la "supériorité", évidente pour un G. Jèze, par exemple, de la forme "régie" sur celle de la ferme dès lors que les fondements et les techniques de base de la fiscalité restent inchangés(78). Bref, on ne peut plus considérer sans examen qu'il y a eu des économies considérables réalisées entre 1786 et 1854 dans la gestion du recouvrement et que "en France, le procédé de la régie a eu pour résultat de réduire considérablement les frais de perception des impôts"(79). Réduire, peut-être, considérablement sûrement pas; en tout cas, cela n'est pas l'avis de Clamagéran en 1867. Mais alors n'est-ce point que les "super-profits" faits par les fermiers généraux et autre régisseurs se sont maintenus après leur disparition et qu'ils ont seulement été mieux dissimulés et redistribués entre les diverses catégories de "fonctionnaires" des finances ? Bien qu'on ne puisse actuellement donner une réponse définitive à une telle question, on peut toutefois a minima considérer que, même si les agents principaux des régies sont désormais des "fonctionnaires publics nommés par l'Etat", cela n'entraine pas nécessairement, au delà d'un juridisme étroit, qu'il y ait recouvrement direct de l'impôt par l'administration et/ou, en conséquence et selon une conception webérienne de la bureaucratie, amélioration du rendement. Deux raisons peuvent fonder, en effet, une telle prise de position : d'une part, les officiers de finance d'Ancien Régime étaient déjà des fonctionnaires en ce sens; d'autre part, les hauts-fonctionnaires du XIXe siècle libéral sont encore recrutés parmi les privilégiés de la fortune. Toutefois, un troisième élément paraît encore plus fondamental à ce titre, à savoir le fonctionnement concret du système d'ensemble des régies fisco-financières qui éclaire le statut réel des fonctionnaires des finances qui désormais concentrent entre leurs mains, par le biais de ce nouveau système, l'ensemble des prélèvements publics. ENCADRÉ 1 : EVOLUTION INSTITUTIONNELLE DU SYSTÈME DE LA RECETTE GÉNÉRALE (Sources : Bruguière 1989, Pinaud 1982a et 1990, Stourm 1912) 1542 Création des premiers receveurs généraux du Royaume pour la collecte de l'impôt direct (à l'époque les tailles). 1780 Les 48 receveurs alternatifs dans 24 généralités sont réduits à 24 par Necker, puis supprimés au profit d'une seule "compagnie" composée de 12 membres et placée sous l'autorité d'un caissier habilité à engager la responsabilité de la compagnie.. 1781 Rétablissement par Joly de Fleury des 48 charges. 1789 48 receveurs généraux centralisent les impôts directs collectés par 408 receveurs particuliers. Ils souscrivent des rescriptions échelonnées sur 15 à 22 mois correspondant au montant des impôts qu'ils se sont engagés à faire rentrer et qui sont escomptables à une Caisse commune des recettes générales, "point d'aboutissement nécessaire des impôts perçus". 1790 Suppression et remboursement des offices de finance : les receveurs généraux et particuliers sont remplacés par 544 receveurs de district élus. Suppression des Trésoriers payeurs généraux des pays d'État. Suppression des impôts indirects et de la Ferme Générale. 1791 Établissement de payeurs généraux dans chaque département, lesquels sont astreints à un cautionnement "réglé d'après le montant des sommes que la nécessité du service oblige à leur confier habituellement" et recevant des traitements fixes échelonnés entre 1800 et 10 000 livres. 1795 Rétablissement d'un agent unique nommé par le pouvoir central pour la perception des impôts au niveau du département sous le titre de receveur départemental des impositions directes 1796 Les préposés aux recettes succèdent aux receveurs de districts. 1797 Redécoupage du territoire et instauration de 418 préposés aux recettes d'arrondissement.
1798 Suppression des préposés aux recettes des chefs lieux de départements dont les fonctions sont directement confiées aux receveurs départementaux. Fixation des émoluments : 6000 et 2400 francs de traitement fixe respectivement pour les receveurs et les préposés, remise de 0,33 % pour la collecte et de 0,1 % supplémentaire pour les receveurs sur l'ensemble. 1799 Obligation faite aux receveurs départementaux de souscrire des rescriptions payables à date fixe et par douzième de mois en mois. Fixation des cautionnements personnels à 1/20 de la contribution foncière du département payable en numéraire. Les cautionnements centralisés dans une "Caisse de garantie et d'amortissement" indépendante de la Trésorerie Nationale reçoivent un intérêt dont le taux réajustable chaque année est cette année là fixé à 10 %. 1800 Les préposés aux recettes deviennent receveurs particuliers dont le cautionnement est fixé d'après les mêmes règles que celles s'appliquant aux receveurs généraux. La relation de ceux-là à ceux-ci est assurée par l'obligation faite aux receveurs particuliers d'émettre des soumissions à verser à la recette générale le montant des contributions 15 jours avant les termes assignés aux receveurs généraux pour les envois au Trésor. Création de la Banque de France avec un capital dont plus de la moitié est fourni par les cautionnements des receveurs généraux auxquels sont réservés 3 sièges de Régent. Réorganisation du Trésor Public désormais enlevé à la direction des assemblées de représentants et placé dans les mains du Ministre des Finances, puis d'un Ministre du Trésor. 1801 Création de l'Inspection générale du Trésor composée de 15 membres chargés de vérifier les caisses des receveurs généraux et particuliers, des payeurs généraux, particuliers et militaires. 1802 Création de l'Agence des receveurs généraux, comité de 12 receveurs généraux représentant les 3/4 de leurs collègues et chargés d'avancer 40 millions au Trésor sous forme de rescriptions payables à 20 jours. 1803 Institution des payeurs particuliers également soumis à un cautionnement en numéraire (lequel s'échelonne pour l'ensemble des payeurs entre 25 et 40 000 francs) et dépendant des payeurs généraux de département. 1806 Suite à l'affaire des "négociants réunis" qui met en péril la Trésorerie et la Banque de France (fermée pendant 4 mois), création par Mollien de la Caisse de Service à la place du Comité des receveurs. Obligation est faite aux receveurs d'envoyer 3 fois par mois l'état de leurs recettes et est créé un compte courant accordant une bonification d'intérêt (5 %) sur toute somme créditée à ce compte en sus de leurs échéances par les receveurs pour les paiements de dépenses dans les départements ou les remises de fonds à Paris. La Caisse accepte également les mandats tirés par les receveurs généraux à concurrence des sommes créditées à ces comptes courants. 1808 Introduction de la comptabilité en parties doubles pour toute comptabilité publique. 1814 Unification par le Baron Louis du ministère des Finances et du ministère du Trésor. Remplacement de la Caisse de Service par le Direction du Mouvement Général des Fonds, les avances des receveurs se faisant directement au Trésor. 1816 L'inspection générale du Trésor devient Inspection des finances. Création par Corvetto d'un Comité des receveurs généraux sur le modèle de l'ancienne Caisse commune des recettes générales et admission officielle des particuliers à déposer leurs fonds chez les receveurs, lesquels doivent les déposer dans un "compte courant" spécial au Trésor. Le taux d'intérêt sur les cautionnements passe de 5 à 4%. 1815 Suppression du système des obligations souscrites pour les contributions directes qui nécessitaient le recours de l'Etat à l'escompte, obligations qui n'avaient plus lieu d'être étant donné la mise en place du système du compte courant avec bonifications d'intérêts. 1817 Réorganisation de la Trésorerie avec suppression de certains payeurs au niveau central et unification des caisses. Mise en place d'un payeur unique, le directeur des dépenses astreint à un cautionnement de 200 000 francs et d'un caissier unique également astreint à un cautionnement et centralisant les recettes et les dépenses effectuées au Trésor et prenant le titre de Caissier de la caisse centrale et de service du Trésor royal (avec rang de directeur de ministère). 1820 Nouveau mode de service pour les recettes générales avec institution de «comptes courants à intérêts réciproques avec époques de valeur au milieu et à la fin de chaque dizaine» pour les recettes générales à côté des comptes courants des receveurs où sont déposés leurs fonds particuliers. La bonification d'intérêt de 5% versée pour les sommes excédant les montants inscrits dans une série de 12 termes démarrant au 15 avril dus par les receveurs généraux vaut également en sens inverse pour toute somme versée avec retard par rapport à ces termes. La même décision définit pour la première fois les rémunérations diverses que touchent les receveurs sous forme de commissions et de remises spéciales sur l'impôt indirect et celui de toutes les recettes effectuées pour le compte du Trésor. 1823 Nouvelle unification des fonctions de payeurs au sein du Trésor. 1825 Création par Villèle du Syndicat des receveurs généraux au capital de 30 millions sous l'égide de huit d'entre eux et ayant "pour objet toutes les opérations de finance et de banque que le syndicat jugera avantageuses aux intérêts de la compagnie et principalement celles qui seront utiles au service du Trésor royal".
1829 Réforme marginale de l'organisation du Trésor aboutissant à quelques économies et à la redéfinition des traitements et des cautionnements des payeurs généraux de département. 1832-33 Réédition d'anciens réglements sur la responsabilité des comptables et loi relative au contrôle des récépissés à talon qui servaient à libérer les divers comptables de niveau hiérarchique inférieur de leurs dettes à l'égard du Trésor lorsqu'il apportaient les fonds recouvrés à la recette générale (via les recettes particulières des finances). 1836 Institution de la règle selon laquelle l'encours du compte courant des receveurs généraux sur fonds particuliers doit au moins être égal à celui du cautionnement. 1844 La rémunération des cautionnements passe de 4 à 3 %. 1849 Importante réduction (environ 10%) des émoluments officiels des receveurs généraux. 1862 Les receveurs particuliers et les percepteurs sont habilités à intervenir directement dans le paiement des rentes et pensions et indirectement (en dehors des chefs lieux de département) pour l'ensemble des dépenses. 1865 Réunion dans les mêmes mains des fonctions de payeur général et de receveur général sous le titre de trésorier payeur général. La mesure bénéficie essentiellement aux receveurs généraux (seulement 8 payeurs généraux deviennent T.P.G.). Nouveau mode de rémunération : trois classes de trésoreries pour les traitements fixes respectivement de 6 000, 9 000 et 12 000 francs par an; commission à la recette (tarif décroissant mais uniforme pour tous les départements); commissions à la dépense (à taux variables); remises uniformes sur les produits des coupes et aliénations de bois de l'Etat ainsi que sur les placements des communes et établissements de bienfaisance. 1869 Suppression de la règle obligeant à ce que le montant du compte courant des trésoriers payeurs généraux soit égal à celui de leur cautionnement. 1887 Remplacement du compte courant à intérêts réciproques par un "nouveau mode de remises calculées à forfait d'après un coefficient propre à chaque trésorerie générale". 1889-90 Éclatement officiel du "scandale de la juxtaposition du fonctionnaire et du banquier" et décret de transformation partielle des trésoriers payeurs en agents à traitement fixe (12 000 francs) avec suppression des commissions ou remises allouées par le budget, paiement par l'Etat de leur personnel titularisé et allocation d'une indemnité de frais divers et de matériel, les remises sur les avances à la dette flottante ainsi que celles distribuées par la caisse des dépôts et consignations, le Crédit foncier, la Ville de Paris pour placements de leurs emprunts étant maintenues. 1893 La rémunération des cautionnements passe de 3 à 2,5 %. 1908 Abandon du système de la rémunération des cautionnements. 1912 Limitation à 40 000 francs du produit net des trésoreries générales avec reversement du surplus au Trésor avec d'ores et déjà prévu un reversement de 60 000 F dans le budget de 1913. 1915 Remplacement du cautionnement sur les deniers propres des comptables par le système de "l'Association Française de Cautionnement Mutuel". II.2.La permanence de la mise en valeur privée des fonds publics : persistance et nouvelle forme de la finance d'Ancien Régime. On sait quelles évolutions se sont produites dans le monde de la finance sous l'Ancien Régime. Les receveurs généraux, avec l'institution des intendants, puis de l'administration des vingtièmes, ont d'abord été privés de l'administration de l'assiette; le personnage du traitant tel qu'il apparut aux XVIe-XVIIe siècles (Bayard 1987) eut ensuite tendance à disparaître (Bouvier et Germain-Martin 1969)(80); quant aux fermiers généraux, regroupés au XVIIIe siècle dans la compagnie financière de la ferme générale qui avait désormais le monopole exclusif de la collecte des impôts indirects, ils avaient mis de l'ordre et de la régularité dans leurs affaires et "donné à l'Etat une leçon d'administration" (Legendre 1975). A l'époque de la Révolution, "ces parvenus respectables n'ont plus les louches allures de leurs prédécesseurs du siècle précédent". Mollien (agent de la Ferme puis du Contrôle Général des finances, fondateur de la Caisse d'Amortissement et de la Banque de France, puis ministre du Trésor, créateur de la Caisse de service) a pu ainsi écrire : "On sait quelle révolution s'était faite, depuis le milieu du XVIIIe siècle, dans les moeurs des financiers français" (Bouvier et Germain-Martin 1969). Bref, ils étaient devenus des spécialistes de la fiscalité indirecte au même titre que les receveurs généraux l'étaient de la fiscalité directe; ils
étaient l'exemple même d'une mobilisation de la bureaucratie par le capitalisme. Dans cette évolution, la "finance" avait alors été de plus en plus dépouillée de son rôle d'intermédiaire financier (au sens moderne) au bénéfice de la Banque; elle avait dû progressivement se contenter de faire fructifier le prélèvement fiscal pour son propre compte via la dette flottante et le jeu de ses avances au Trésor. Permanence des fonctions A l'issue du processus révolutionnaire, un des changements parmi les plus remarquables est, on l'a vu, la disparition presque complète des fermiers d'impôts, disparition prise souvent pour équivalente de celle de la finance d'Ancien Régime(81). Pourtant, telle n'est pas sa portée pratique réelle et on soutiendra ici, au contraire, qu'elle a élevé à un niveau encore jamais atteint le degré de monopolisation de la gestion privée des prélèvements publics. En fait, pas plus que la bourgeoisie d'Ancien Régime, la finance n'a été victime de la Révolution et, en ce domaine comme dans d'autres, il y a eu essentiellement changement de forme - avec apparition de la figure du «banquier-fonctionnaire» - dans le cadre d'une évolution dans la longue durée illustrée notamment par la lente rationalisation économique que la finance n'a cessé de connaître. La "nationalisation" de la ferme générale a été limitée, en effet, tout d'abord à une mise en régie - la fonction de fermier étant de la sorte "convertie" en celle de receveur général -. Or ce processus était largement entamé bien avant les événements révolutionnaires, puisque c'est dès 1780, on l'a vu, que, à l'instigation de Necker, de nombreux droits affermés ont fait l'objet de mises en régie, les droits d'enregistrement et les aides étant confiés respectivement à une «Administration Générale des Domaines et Droits Domaniaux» (en fait une régie intéressée) et à une «Régie Générale des Aides», la Ferme Générale ne conservant que la perception des traites, des gabelles et du produit des tabacs(82). Ensuite, si la ferme générale a tout simplement disparu dans un premier temps, c'est parce que les aides et traites elles-mêmes ont été supprimées. Et si une bonne proportion de fermiers n'en réchappe pas non plus, c'est surtout parce qu'ils servent alors, selon le modèle traditionnel de la chambre de justice, de victimes expiatoires plutôt qu'en raison de leur qualité de capitalistes dilapidateurs des fonds publics. En témoignent, d'un côté, la réapparition dès le Directoire de l'institution avec réembauchage des "échappés", de l'autre, tant le prestige qu'avaient acquises les fonctions au sein même de l'administration que le déchainement de la spéculation sur les fonds publics concomitante à leur disparition. Enfin, si la Ferme Générale ne réapparaît que sous la forme d'une Régie des Droits Réunis dépossédée de la gestion réelle des fonds qu'elle collecte(83), c'est sans doute parce que, dans l'intervalle, les receveurs généraux sont revenus sur le devant de la scène politico-financière et ont occupé toutes les places laissées vacantes, monopolisant de la sorte dans leurs caisses la totalité des fonds fiscaux. Désormais ce sont eux qui, par la pluralité de leurs "fonctions", vont jouer le rôle central dans la reproduction de l'Etat de finance. Fonctions fiscales. Les "receveurs généraux", nommés par le gouvernement, succèdent à partir de 1795 aux receveurs de district élus. Définitivement installés en 1799 à la tête des préfectures financières qu'ont été d'abord les départements(84), avec leurs "préposés" au niveau des arrondissements - qui vont devenir un an plus tard les receveurs particuliers des finances -, ils recouvrent désormais les contributions directes et indirectes de l'ensemble de leur "territoire". Pour se faire, ils centralisent les opérations menées au niveau cantonnal et
communal par les percepteurs et les divers receveurs des autres régies. Il y a donc dorénavant "un seul comptable centralisateur par département"(85). Bien qu'officiellement désormais "fonctionnaires" des finances, les receveurs ne peuvent toutefois qu'être recrutés dans les milieux capitalistes (anciens manieurs d'argent financiers et banquiers ou encore enrichis récents dans les fournitures de guerre et les spéculations sur les biens nationaux). Ils continuent, en effet, à être personnellement responsables des fonds fiscaux qu'ils manipulent et sont, en conséquence, astreints à un important cautionnement (dépôt préalable de fonds destiné à garantir l'Etat contre des malversations éventuelles)(86). C'est pourquoi R. Stourm peut encore décrire en 1912 le statut des nouveaux receveurs généraux de la manière suivante : "En résumé, la conception administrative du receveur général revêtit alors la forme d'un fonctionnaire-banquier, chargé, à ses risques et périls, de recouvrer l'impôt et de centraliser les fonds dans son département. Le service continuait à lui être, pour ainsi dire affermé dans l'étendue de sa circonscription. Mais il était tenu de déposer ses fonds et de les faire valoir, tous sans exceptions, dans les mains du Trésor exclusivement, par l'intermédiaire de la caisse de service, qui lui servait un intérêt rémunérateur. Telle est l'origine de l'organisation du service des trésoriers généraux", car "le caractère de l'institution créé en 1806 s'est perpétué jusqu'à ces derniers temps, sauf (…) quelques modifications (…)" (c'est nous qui soulignons)(87). Au coeur du système fisco-financier subsiste donc un fonctionnement qui reste soumis à des intérêts non administratifs et privés sur le modèle de l'Ancien Régime, et la régie généralisée ne peut alors pas être considérée comme la fin de l'ancienne finance mais doit plutôt être vue comme un nouveau type de son rapport à l'Etat(88). Et si à travers les receveurs généraux de département, la finance d'Ancien Régime se perpétue, ce n'est pas seulement parce qu'il y a une certaine continuité "dynastique" comme on va le voir, mais aussi et d'abord parce qu'il y a permanence dans le contenu de la "fonction", c'est-à-dire dans la relation qui s'institutionnalise sous une nouvelle forme en 1806 entre l'Etat et le groupe social des fonctionnaires-banquiers. En ce qui concerne l'évolution dans le siècle du statut de ce groupe, quatre dates essentielles sont à retenir(89) : 1806, année de l'institution de la Caisse de service qui fonde la distinction entre le «compte courant à intérêts réciproques» déjà entrevu et dans lequel le receveur est incité à déposer les impôts collectés et le «compte courant des trésoriers généraux» où il est tenu de placer les fonds particuliers qu'il peut rassembler; 1865, année de la réunion des fonctions de receveur général et de payeur dans les mains des receveurs généraux désormais dénommés trésoriers payeurs généraux(90); 1890, année où les trésoriers payeurs généraux passent au traitement fixe pour leurs activités de collecte de l'impôt; et 1915, date qui voit la fin de la contrainte de cautionnement sur fonds personnels. ENCADRÉ 2 : LES COMPTES DES RECEVEURS GÉNÉRAUX AU TRÉSOR «Compte courant à intérêts réciproques» : Il s'agit là du lien central - "bien simple mais très solide et très sûr" selon Stourm - entre l'Etat et le financier en tant que personne privée habilitée à gérer les fonds publics: «les trésoriers généraux sont rattachés au Trésor par le lien d'un compte courant, dans lequel ils sont débités de toutes les recettes et crédités de toutes les dépenses qu'ils effectuent pour le compte du Trésor et de ses correspondants» (Instruction générale de 1859). Ce lien dans sa simplicité ne se comprend pas cependant sans "les intérêts réciproques" qui l'accompagnent; ainsi "le compte courant était débité, avec intérêts à la charge du trésorier général, des recettes encaissées, et crédité, avec intérêts à son propre profit, des payements ou versements effectués" (Stourm 1912), système qui assure des primes au receveur qui abandonne rapidement ses fonds au Trésor - en les affectant à des dépenses locales, en les transférant à un collègue voisin, ou encore en les plaçant au compte courant du Trésor à la Banque de France -, et des pénalités s'il conserve des encaisses inactives. "Par cette formule de comptabilité empruntée aux usages du commerce, l'intérêt public et celui du trésorier général sont constamment rattachés l'un à l'autre" (d'Audiffret, un des promoteurs du système, dans son livre Système financier de la France; c'est nous qui soulignons). Toutefois en raison des "époques de valeur", une prime était donnée à l'habileté gestionnaire des trésoriers, habileté dont seule la généralisation la
rendit finalement "immorale" et contestée. Voici ce qu'en dit Stourm : "D'après le système des époques de valeurs, les intérêts du compte courant au lieu d'avoir pour point de départ la date exacte de chaque opération, couraient seulement du milieu à la fin de chaque dizaine. Il en résultait qu'un trésorier général avisé, pour peu qu'il trouvât moyen d'anticiper l'échéance des dépenses, ou d'ajourner l'inscription des recettes, de quelques jours seulement, gagnait facilement dix jours d'intérêts pleins". «Compte courant des trésoriers généraux» : Il s'agit du compte courant ouvert à la caisse de service (Trésor) aux noms personnels des trésoriers et dans lequel ceux-ci versent des fonds non fiscaux, qu'il s'agisse de leurs fonds propres ou de ceux qu'ils ont collecté en tant que banquiers particuliers : c'est le "système d'avances, en vertu duquel les trésoriers généraux furent autorisés à drainer les épargnes particulières de leur département afin de les amener dans les caisses du Trésor" (Stourm 1912). Les dépôts, effectués chez les trésoriers généraux "soit en compte courant ordinaire, soit en compte courant de chèque à vue, soit à échéance fixe", devaient être versés "dans leur intégralité au Trésor, où ils produisent au profit du trésorier général un intérêt toujours supérieur à celui que le trésorier général lui-même sert à ses déposants, ce qui constitue son bénéfice". "Ainsi, tandis que le perpétuel souci des grandes sociétés de crédit est de trouver l'emploi sûr et rémunérateur des fonds qu'elles détiennent en dépôt, le trésorier général n'a qu'à frapper aux guichets du Trésor public pour obtenir un tel emploi" (Stourm 1912). Bref, le compte courant des receveurs est le résultat du fait que "l'administration supérieure a cru devoir autoriser les trésoriers généraux des départements à entretenir, sur les différentes places de France, avec les capitalistes et les commerçants, des relations de banque qui leur procurent, à peu de frais, les ressources opportunes d'un crédit personnel, nécessaire pour suppléer, au besoin, à l'insuffisance accidentelle des recettes de l'Etat… Par cette ingénieuse combinaison, l'Etat profite des meilleurs procédés du génie commercial pour l'exécution journalière de son service" (d'Audiffret). Fonctions banquières publiques de financier… Les réformes de 1865 et de 1890 n'empêchent pas cependant R. Stourm, en 1912, de continuer à parler du "rôle actuel" de banquier des trésoriers payeurs généraux, ceux-ci continuant à pouvoir placer automatiquement les fonds de leurs clients "personnels" dans la dette flottante en touchant un différentiel d'intérêt. Il suffit d'ailleurs d'utiliser l'indicateur donnant la proportion du revenu des trésoriers généraux qui leur vient de leur côté "fonctionnaire", pour se rendre compte qu'ils sont encore au titre du budget de 1913 nettement plus banquiers que fonctionnaires : dans un revenu officiel moyen de 34.000 francs environ cette année là, leur traitement de fonctionnaire (12.000 F) ne représente seulement que 35 %(91). A cette date encore, si on adoptait les critères de classement de la comptabilité nationale contemporaine (SECN base 70, par exemple), les trésoriers payeurs généraux seraient ainsi classés dans le secteur des entreprises financières marchandes, leur revenu non marchand ne représentant pas 50 % de leur revenu total officiel. Il ne s'agirait pas, en outre, d'entreprises publiques puisque les recettes marchandes des trésoriers ne retombent pas dans l'escarcelle de l'Etat qui n'a pas la propriété des entreprises. Le terme de banquier, ici utilisé de manière très large, peut toutefois prêter à confusion, surtout si l'on se réfère au clivage classique entre finance et banque qui veut, rappellons-le, que "les financiers sont au service du prince; les banquiers au service du négoce international"(92). En effet, si ce qui caractérise la banque par rapport à la finance, c'est qu'elle "est une activité libre et ouverte à tous" et que "pour «s'ériger en banquier», il suffit d'avoir un domicile et (qu')il n'existe donc pas dans ce secteur de «chaines à briser» pour donner libre cours à l'esprit d'entreprise"(93), alors le fonctionnaire-banquier du XIXe siècle n'est bien toujours qu'un financier et non un banquier; il est même théoriquement plus que jamais un financier puisque désormais il lui est interdit de placer ses excédents de recettes dans des placements de son choix, ses activités privées de "banque" elles-mêmes ne devant légalement déboucher que sur le placement de ses fonds au Trésor public afin d'alimenter la dette flottante. Le banquier, quant à lui, reste spécialisé dans l'émission et l'escompte de monnaie de papier à l'échelle nationale et internationale, ainsi que dans l'intermédiation financière - le placement des emprunts -.
Mais le XIXe est le siècle où la distinction tend en pratique à s'estomper, tout au moins au sommet de la hiérarchie bancaire qui, selon l'expression consacrée, rentre «dans le régime». Dès le début du siècle, en effet, la Haute Banque finit de pénétrer dans "l'industrie de la finance" tant par le biais du rôle monétaire nouveau joué par la Banque de France - qui est en quelque sorte son conseil d'administration - que par celui des achats de Bons du Trésor à court terme ou la concession longtemps conservée du monopole du placement des rentes sur l'Etat. Il n'en reste pas moins qu'à cette époque, même si on ne constate plus "de démarcation stricte entre ces deux groupes de manieurs d'argent"(94), le partage des "fonctions" entre financiers et banquiers reste encore relativement bien circonscrit : à la finance, la gestion de l'impôt et de la dette flottante; à la banque, celle de la monnaie et de la dette consolidée. Il s'agit là sans doute du compromis originel tissé entre ces deux fractions concurrentielles de la bourgeoisie d'argent qui n'ont pas manqué de faire la Révolution pour leur propre compte : celle catholique des offices de finance et de justice déjà "dans le régime", mais réduite au XVIIIe siècle à la portion congrue en raison de la puissance de la Ferme Générale, et celle non catholique des marchands-banquiers "hors du régime", mais qui y entre avec éclat en tant que banque "presqu'aussi officielle que la finance elle-même"(95). Et fonctions bancaires de banquiers privés. Progressivement cependant, la situation tend à se modifier, le compromis originel étant en permanence soumis à rediscussion, la banque utilisant le parlement pour tenter de réduire les prérogatives de la finance qui, quant à elle, est soutenue par l'exécutif(96). D'un côté, la monnaie et le crédit à court terme tendant à se confondre, la banque se mit à empiéter sur le domaine de la finance. Ainsi, d'un côté, la Banque de France, d'abord, par le réescompte des Bons du Trésor et son avance au compte courant du Trésor, puis la Caisse des dépôts et Consignations par le placement des fonds de ses caisses d'épargne vassales vont intervenir de plus en plus dans la dette flottante la plus liquide. De l'autre, la Banque de France encore, puis les grandes banques de dépôts vont de plus en plus concurrencer, au fur et à mesure de leur développement, l'activité de collecte des receveurs généraux(97). En sens inverse, les recettes puis trésoreries générales, grâce à l'étendue de leur réseau de percepteurs et de receveurs particuliers, sont prédisposées à placer et à gérer les titres longs des rentes d'Etat et des emprunts émis par les grands établissements financiers (Crédit Foncier et Caisse des dépôts) et les collectivités territoriales (villes et établissements de bienfaisance). Dit autrement, l'activité de banque des receveurs généraux se développe naturellement en concurrence avec celle des "vraies" banques dans le même mouvement par lequel leur monopole sur la dette flottante est entamé. Au fur et à mesure que s'accroît leur collecte de fonds, ils sont de plus en plus incités à se comporter en véritables banquiers et donc à développer leur activité pour compte propre d'une manière non officielle. Plus précisément, c'est le Trésor lui-même qui dans la mesure où il dépend toujours au XIXe siècle presque exclusivement de l'activité des receveurs généraux pour la gestion de la dette flottante la plus liquide et la plus sensible(98) - raison d'être du compte courant des trésoriers généraux auprès de la Caisse de service, puis de la Caisse unifiée du Trésor -, incite les receveurs généraux - en avaient-ils besoin ? - à développer leur activités bancaires. Ainsi, le compte courant des receveurs porte longtemps un "gros intérêt" de 3,5 %(99), ce qui laisse aux trésoriers une large marge pour collecter des dépôts à vue(100). Mais comme dit Stourm, ces opérations de dépôts en entrainaient "forcément d'autres en faveurs des clients, qu'il faut bien recruter et retenir, telles que l'exécution des ordres d'achats et de ventes de valeurs de bourse". Encore que si de telles activités annexes avaient été circonscrites à de telles opérations de bourse, on eut pu être là-encore dans le domaine de leurs activités de
fonctionnaire, au moins dans la première moitié du siècle, puisqu'alors la bourse était principalement animée par la mobilisation des titres de rentes sur l'Etat. Etant donné que "le volant de manoeuvre constitué par leurs fonds était considérable", il était somme toute normal qu'une de leurs tâches fusse "désormais de faciliter le service du Trésor en maintenant le cours des valeurs publiques dont ils détenaient par ailleurs une grosse masse"(101). Toutefois, bien évidemment, ils ne contentent pas de ces opérations et se comportent en fait comme "de véritables banquiers se livrant à l'escompte, effectuant des prêts, investissant pour leur propre compte"(102). "A l'exemple de leurs prédécesseurs d'Ancien Régime, les trésoriers généraux, (ils) n'hésitent pas à se lancer dans les affaires privées, joignant escompte, prêts, investissements à leurs opérations financières normales. Le plus souvent, ils réalisent des profits énormes, rapides, sans frais et sans risques excessifs"(103). Bref, "les receveurs généraux, gros capitalistes, (…) se livrent à la banque, se lançant dans les affaires privées. Ils commanditent les banques locales"(104). Comme le reconnaît aisément A. Thiers lui-même, "presque tous, indépendamment de leurs recettes, font beaucoup d'affaires particulières pour le revirement des fonds"(105) et "leur fortune personnelle et les capitaux qui leur sont confiés, en l'espèce l'argent des contribuables, leur permettent d'énormes opérations qu'ils mènent à bien, sans frais et à peu de risque"(106). D'ailleurs, "il arrive parfois que ce soit l'administration elle-même qui incite les receveurs généraux à s'occuper de banque"(107). C'est particulièrement net lorsque l'Etat du Premier Empire les pousse à créer en 1802 l'agence des receveurs généraux afin de tenter de se libérer des faiseurs de services pratiquant des "taux usuraires de 12, 9 et 6% par an"(108) ou, en 1816 et 1825, alors qu'il s'agit de rétablir le crédit de l'Etat et de soutenir la rente, avec la constitution, à l'instigation des ministres des finances Corvetto et Villèle, du Comité et du Syndicat des receveurs généraux admis immédiatement à l'escompte de la Banque de France(109). Certes, il s'agissait là de périodes troublées. Mais de telles opérations continuent à être tolérées pendant tout le siècle, alors même qu'une réglementation précise finit par circonscrire strictement les activités de banque des receveurs(110). En témoignent les "précautions" prises qui à elles "seules découvrent au milieu de quels dangers et de quels entrainements se meuvent les fonctionnaires qu'on cherche à en préserver" (sic!), dangers de "sinistres" financiers, de faillites dont l'Etat a d'ailleurs dégagé explicitement par anticipation sa responsabilité en le faisant savoir par le moyen d'un écriteau placé "d'une manière apparente dans la salle du public" des trésoreries(111). Le financier-banquier, nouvelle figure de la finance On est donc bien là dans la même situation que celle qui prévalait sous l'Ancien Régime. Dans cette situation qu'on peut considérer comme due au caractère métallique de la monnaie-impôt avec laquelle l'Etat effectue ses paiements, le financier est toujours la meilleure médiation possible entre l'Etat et ses bailleurs de fonds et il tire de cette position d'intermédiaire l'avantage de pouvoir jouer sur les deux tableaux, en articulant, voire en confondant, ses activités de banque et de finance. Cependant le XIXe siècle n'est pas réductible aux siècles qui l'ont précédé, y compris à ce niveau, et pour résumer la situation du fonctionnaire-banquier , il convient de distinguer les traits qui en font un financier au même titre que les financiers d'Ancien Régime et ceux qui en font un financier du XIXe siècle "libéral" et non plus un financier de l'absolutisme. Premier aspect de la question donc, le fonctionnaire-banquier est encore sur le fond un capitaliste à son compte et n'a, en dehors de son "petit" traitement fixe, de fonctionnaire que l'épithète. Ses activités principales de "fonctionnaire" sont certes effectuées pour le compte de l'Etat, mais même en ce cas, il est un entrepreneur capitaliste : il investit ses fonds propres
sous la forme d'un cautionnement rémunéré par des intérêts; il avance dans l'affaire salaires et frais de matériel; il vend à l'Etat ses services de gestion des finances et non pas directement son travail personnel. Le prix de ces services est un pourcentage du chiffre d'affaires fiscales que l'Etat lui cède, une "remise", type de rémunération qui, conjointement au cautionnement, apparente de très près le receveur du XIXe siècle à son prédécesseur officier d'Ancien Régime. Ce qui fait, par contre, la spécificité de la nouvelle recette générale par rapport à la finance d'Ancien Régime, c'est d'abord que la relation tissée entre l'Etat et son financier n'est plus contractuelle; il n'y a plus d'adjudication ni de vente de la fonction(112), et le financier ne peut plus discuter concurrentiellement le montant de sa remise(113). C'est aussi, corrélativement, que cette remise prend la forme d'intérêts payés par l'Etat sur le montant de ses propres ressources fiscales(114). C'est, ensuite, que ces intérêts correspondent maintenant à la fois à l'ancienne remise des receveurs généraux, aux intérêts des avances "personnelles" que ceux-ci effectuaient sur les propres fonds de l'Etat, et aux bénéfices qu'ils tiraient éventuellement également de l'investissement de ces fonds dans les fermes ou les traités conçernant les revenus extraordinaires (Dessert 1986). C'est enfin que désormais tous les fonds fiscaux recouvrés sont regroupés dans les caisses des seuls trésoriers généraux qui se voient ainsi concédé le monopole exclusif de gestion de la totalité des ressources fiscales de l'Etat sur une portion déterminée du territoire national. Le monopole financier territorial est ainsi poussé à son comble, ce qui explique que les anciens aspects concurrentiels de la relation entre l'Etat et ses financiers aient disparu. Mais, comme l'a montré avec force F. Braudel (1979), ce n'est pas la concurrence qui fait le capitalisme, surtout le capitalisme financier qui n'a de cesse que de se retrouver en situation de monopole. L'Etat, par l'intermédiaire du gouvernement, se borne donc désormais à reconnaître à l'égard du financier qu'il met en poste par simple nomination(115) une "dette sans versement préalable de fonds" à taux fixe et à mettre à sa disposition l'ensemble des administrations fiscales en lui assurant le monopole de la collecte; ce faisant, il s'assure réciproquement par le cautionnement contre le risque de faillite du financier. De son côté, le financier monopoleur, d'une part, prend le risque personnel de recouvrer les contributions directes - avec l'aide de ses sous-traitants et de son personnel -. D'autre part, il s'engage à centraliser l'ensemble des fonds fiscaux recouvrés sur son "territoire" départemental et à les "appliquer" aux dépenses locales ou à les transférer au compte central du Trésor avec la plus grande diligence de manière à limiter la dette flottante de l'Etat. Enfin, il doit réserver au Trésor l'exclusive de l'usage de ses fonds particuliers quelles qu'en soient les provenances. C'est essentiellement par cette exclusive réciproque que le financier du XIXe siècle peut être dit "fonctionnaire". Mais paradoxalement, cela oblige à simultanément et immédiatement considérer ses activités "annexes", sans lesquelles il n'est dès lors pas possible de comprendre comment et pourquoi il peut continuer à exercer ses activités après la Révolution. Concéder sur le mode marchand le monopole territorial de la gestion financière des ressources fiscales n'a pas, en effet, de raison d'être en elle-même dans un Etat contrôlé par une bourgeoisie rentière plus soucieuse d'économiciser que de montrer son pouvoir. On ne voit pas non plus pourquoi l'Etat dont l'impôt est légitime et dont l'administration contrôle elle-même l'établissement de l'assiette, ne prendrait pas à son compte le risque du recouvrement si c'était là le seul enjeu de la finance. En témoigne d'ailleurs la réforme de 1889 qui publicise cette fraction de l'activité des trésoriers généraux(116). Aussi, l'essentiel du lien entre l'Etat et ses financiers ne passe pas seulement essentiel par la relation institutionnalisée dans le compte courant des recettes fiscales, mais aussi et peut-être surtout par celle relative à ce second compte qui conçerne les fonds particuliers des trésoriers. En d'autres termes, pour le prix de leurs services, les financiers sont censés régler l'ensemble des
problèmes de trésorerie de l'Etat. Ils doivent non seulement diminuer le passif de la dette flottante en accélérant la vitesse de circulation des recettes fiscales, mais ils doivent aussi couvrir un passif irréductible surtout dans un pays encore en voie d'unification où la monnaie pondéreuse circule mal alors que les paiements se font encore en espèces. D'où leurs activités nécessaires de banquiers collecteurs de métal auprès de "correspondants" locaux, les élites notabiliaires régionales. Comme dit Stourm, "qu'il s'agisse de 100 millions, de 50 ou de 30 seulement, on ne saurait, pour une avance aussi considérable, refuser aux quatre-vingt six fonctionnaires qui la consentent les moyens de se la procurer". Par là est manifestement fondé le lien d'appartenance du fonctionnaire-banquier à la grande famille des financiers d'Ancien Régime, son crédit se confondant bien de la sorte avec celui de l'Etat, et ses activités personnelles ou particulières se mêlant indissociablement avec ses fonctions publiques(117). Une conclusion s'impose donc : il n'y a pas administration directe du procès de prélèvement fiscal dans son ensemble au XIXe siècle, car le maillon essentiel du processus ainsi que nombres d'autres éléments de la chaine qui transporte le tribut du contributeur (qui n'est pas toujours le contribuable) vers le Trésor sont encore tenus par des bourgeois d'office, propriétaires des moyens de leur activité, vendant non pas leur travail mais leurs services, et confondant ainsi, au mieux, leur intérêt personnel avec l'intérêt de l'Etat, au pire, l'intérêt de l'Etat avec leur intérêt personnel. Tous comptes faits, le passage "révolutionnaire" du fermier général, dernière mouture, au receveur général, nouvelle mouture, n'a pas été une rupture aussi considérable qu'il y paraît au premier abord dans l'organisation du recouvrement des impôts. Plus que d'un bouleversement structurel de la relation entre l'Etat et ses financiers, il s'est agi d'abord d'un changement de groupe dominant à l'intérieur du monde de l'argent - l'ancien officier refaisant surface, curieusement matiné de banquier, et détrônant à son tour le fermier -, changement habituel dans l'économie financière de l'Ancien Régime. Au delà des changements de forme, c'est bien encore essentiellement une rénovation dans la continuité qui s'exprime ici. Et son déclin à l'orée du XXe siècle. Il est clair toutefois qu'il y a un déclin relatif de l'importance des comptables supérieurs du Trésor dans la gestion de la dette flottante à partir de la Troisième République, déclin à mettre au compte des progrès de la monétarisation (Saint Marc 1983), du développement des Caisses d'épargne qui fournissent des liquidités en excès au Trésor public (Priouret 1966) et de la spécialisation de la Banque de France comme Banque de l'Etat permise par le développement des réseaux des grandes banques de dépôts (Bouvier 1979 et 1980). L'éminence de leur rôle interne au système fisco-financier s'amenuise donc à l'image du solde de leur compte courant (cf. graphique 4) et du taux d'intérêt servi. Alors qu'au milieu des années 1870, ce compte courant atteint plus de 100 millions, soit un peu plus de 4% du montant des recettes fiscales de l'Etat, il tombe à 30 millions juste avant la grande guerre. Quant au taux d'intérêt servi, il semble qu'il faille attendre 1899 pour qu'il soit réduit de 3.5 % à 2%, mais il chute alors successivement en trois ans à 1.75 %, 1.5 % et 1.25%, et à partir de 1904, il ne remonte qu'à 1.75%(118). La position de banquier public des Trésoriers Payeurs Généraux est donc ébranlée à la fin du siècle. C'est sans doute pourquoi, sous la pression de la Banque, ils perdent également une série de prérogatives de type privé et subissent un contrôle accru de leurs activitiés bancaires, ce qui va avec la désertion observable de la fonction par les grands "lignages" financiers à la même époque (cf. infra). Mais cette dégradation progressive de leur situation au niveau de l'économie publique n'entraine pas inéluctablement un déclin immédiat et généralisé de la place de ces financiers dans l'économie globale. Sans doute le maintien de leur position sociale nécessite-t-il alors
de leur part d'entreprendre une reconversion dans la banque ou la finance internationale, secteurs particulièrement actifs en cette fin de siècle qui voit s'amplifier les mouvements internationaux de capitaux.
1 8 1 5 1 8 2 5 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 5 1 8 6 5 1 8 7 5 1 8 8 5 1 8 9 5 1 9 0 5 1 9 1 50
20
40
60
80
100
120
140
160
180
GRAPHIQUE 4 : SOLDE DES COMPTES COURANTS DES TRÉSORIERS PAYEURS GÉNÉRAUX
Sources : Stourm 1912, p. 458, Pinaud 1983 et 1990
mill
ions
de
fran
cs c
oura
nt
En tout état de cause, le déclin de la recette générale n'est que relatif jusqu'en 1914 et les précautions que prend finalement l'Etat pour se démarquer de ses financiers trop entreprenants ne peuvent masquer l'odeur d'Ancien Régime qui se dégage encore du système, même si celle-ci est désormais "épicée" d'une bonne dose d'hypocrisie(119). Car il n'y a dans cette activité bancaire multiple des financiers qu'un simple effet de système et l'apparente "réprobation" administrative n'est à ce point ostentatoire que parce qu'il lui faut pouvoir, le moment venu, se désolidariser d'une crise de crédit frappant un de ses financiers. Les gouvernements successifs étaient en fait parfaitement "complices" d'un système qui était au fondement de la gestion de la dette flottante. Y compris pour le pouvoir politique républicain, cela paraissait la meilleure manière de faire, toute alternative étant pire en termes politiques ainsi que divers gouvernements l'apprirent à leurs dépens lors des diverses crises de trésorerie qui parsemèrent le siècle et dont l'issue favorable eut une importance cruciale pour la totalité de l'édifice du crédit public. Cela valait-il la peine, en effet, de troquer contre plusieurs millions de déposants des caisses d'épargne beaucoup plus difficiles à "gérer" en cas de crise sociale et/ou de trésorerie les 32.000 riches clients des trésoreries générales(120) et/ou les réseaux de parentèles tissés entre eux par les receveurs et qui leur permettaient de mobiliser sur l'ensemble du territoire "l'épargne des capitalistes"(121) ? Cela n'était-il pas politiquement et socialement beaucoup plus risqué, d'autant plus qu'il fallait alors en outre passer par l'intermédiaire du pouvoir législatif ? Cela valait-il la peine également de risquer de subir les dictats de la Haute Banque en faisant appel de manière permanente aux avances de la Banque de France ? N'était-il pas de toute évidence politiquement beaucoup plus favorable d'avoir affaire à 86 financiers "nommés", disséminés dans les départements et donc à l'évidence plus facilement manipulables, plutôt qu'au conseil national d'administration des banquiers, quant à lui, lié à l'Etat par un simple rapport contractuel seulement périodiquement renouvelable(122) ? En fait, seules de telles raisons socio-politiques sont à même d'expliquer la longévité des fonctionnaires-banquiers alors que, d'un côté, les fonds de caisse d'épargne étaient gérés de façon malthusienne, et que, de
l'autre, il était également techniquement plus rationnel d'utiliser plus systématiquement le compte courant du Trésor à la Banque de France comme cela se faisait en Angleterre(123). Bref le pouvoir politique, qu'il soit monarchique ou républicain, était intéressé au maintien des activités bancaires privées des trésoriers généraux, et c'est pourquoi l'ambivalence de leurs fonctions fut maintenue au moins jusqu'à la première guerre mondiale, c'est-à-dire y compris après la réforme de 1889 qui en fit pour partie de véritables fonctionnaires rémunérés par traitement. Dit autrement, s'il y a une "dualité" des trésoriers généraux "dans laquelle il est impossible que l'administration pénètre plus avant pour être sûre qu'ils ne se livrent pas à des opérations autres que celles qu'ils doivent faire", c'est-à-dire si le fonctionnaire-banquier qu'est le trésorier général est à la fois un fonctionnaire qui "fait des opérations pour le compte du Trésor" et un banquier qui "fait des opérations pour son propre compte" (selon le ministre des finances en 1888), c'est qu'au XIXe siècle, cela fait l'affaire de l'administration des finances et du gouvernement. Richesse et stratégies de pouvoir des banquiers fonctionnaires On peut ainsi considérer que des trois principaux changements apportés par le XIXe siècle au fonctionnement de l'Etat de finance - unité du Trésor Public, contrôle rigoureux des opérations et "indépendance vis-à-vis des collecteurs de fonds et des banquiers de tous ordres", c'est le dernier qui a été le plus lent à se mettre en place. On peut également mettre ce constat en rapport avec le fait que les deux premiers changements relèvent d'un processus technico-administratif autonome et interne à l'Etat, alors que le dernier implique au contraire des transformations de l'ordre économique. Dit autrement, l'innovation radicale en ce domaine - la libération du procès "technique" de prélèvement des contraintes de l'accumulation capitaliste individuelle, soit la fin de l'investissement bourgeois dans la finance publique - butait sur le même type d'obstacles que sous l'Ancien Régime, la Révolution n'ayant fait en la matière qu'accélérer le processus de concentration du monde financier dans le même mouvement où elle opérait l'unification des élites bourgeoises et nobles. Bien entendu, attirer l'attention sur les 87 grands financiers qui se partagent le recouvrement des fonds publics "ordinaires" ne vaut que s'ils n'ont pas un poids somme toute marginal dans la société de l'époque, tant au niveau économique que politique. Ne peut-on pas en fait, comme le fait l'historiographie traditionnelle, les oublier sans risque en les considérant comme des "vrais fonctionnaires" ? Ne peut-on pas, en d'autres termes, faire comme si, à travers eux, l'Ancien Régime ne persistait pas, ou bien, même s'il persistait à ce niveau, considérer que cela n'a pas eu finalement d'importance ? Ces questions sont capitales, car évidemment, les développements précédents tendant à montrer la persistance de l'Ancien Régime au sein même du processus de prélèvement n'ont d'intérêt pour l'histoire présente que s'ils apportent une meilleure compréhension de l'économie générale du XIXe siècle. Il est difficile, là encore, en l'état actuel des connaissances de répondre avec précision à ces questions. Il y a néanmoins un certain nombre d'indicateurs qui conduisent à considérer qu'elles appellent sans équivoque des réponses négatives. Ces indicateurs qui permettent une première mesure du poids des fonctionnaires-banquiers dans la société du XIXe siècle sont de trois ordres. Un premier type d'informations concerne le fait que le capitalisme "officier", que l'on retrouve dans la nouvelle recette générale en bonne place avec quelques "réchappés" de la ferme générale et aux côtés de figures nouvelles provenant du négoce et de la spéculation sur les biens nationaux et les fournitures de guerre, ne subit pas de dévalorisation de son capital dans la période révolutionnaire, bien au contraire. Un deuxième type d'indicateur de puissance des banquiers fonctionnaires a trait non plus seulement à ces héritages qu'ils peuvent mobiliser (encore qu'il y ait un certain redoublement d'un aspect sur
l'autre), mais aussi aux nouveaux réseaux familiaux tissés sur tout le territoire, selon le modèle de leurs prédécesseurs de la monarchie absolue, aussi bien par les anciennes familles que par les parvenus de la Révolution. Le troisième type d'indice a trait au niveau très élevé, "exagéré" selon l'opinion publique de la fin du XIXe siècle, de leurs revenus et de leur capital, niveau qui soutient aisément la comparaison avec ceux des groupes les plus riches et les plus puissants de la haute bourgeoisie et de la noblesse que l'on peut repérer par ailleurs. Une importante continuité de milieu. Les officiers de finance, membres éminents de la noblesse de robe et de la bourgeoisie d'office, ont participé activement avec les banquiers à la Révolution et, à la différence des fermiers généraux, ils n'ont pas été, en tant que tels, touchés physiquement et financièrement par la vague terroriste. Au contraire, d'un côté, seuls deux anciens receveurs généraux ont payé physiquement de leur personne le changement révolutionnaire alors même que douze d'entre eux étaient par ailleurs liés à la Ferme Générale(124); de l'autre, "à la pire époque de sa détresse financière la Convention votait néanmoins le rachat de tous les offices de l'Ancien Régime, soit plus d'un demi-milliard" dans lequel est incluse évidemment la valeur des recettes de généralité(125). On a vu également que la Révolution et l'Empire aux abois en matière fiscale n'ont pu se passer des receveurs généraux et surtout des plus importants d'entre eux placés à la direction des divers comités chargés de redonner du crédit à l'Etat à la suite de la banqueroute des deux tiers. Dès lors, c'est le caractère héréditaire et/ou vénal des recettes qui a tendance à se reproduire et assure la continuité sociale du groupe(126). On ne sait malheureusement pas grand chose sur les modalités "marchandes" de transmission de ces nouveaux "offices de finance" et on doit se contenter sur ce thème de quelques remarques. Il est d'abord frappant d'observer que le montant global des cautionnements demandés aux nouveaux receveurs n'est apparemment pas très éloigné de la valeur des offices de leurs homonymes d'ancien régime. Ainsi, alors que la recette de Paris-Généralité est un office qui valait 1 280 000 livres tournois en 1781(127), le cautionnement pour la recette générale de Paris vaut 1 500 000 francs entre 1815 et 1848(128). Et comme pour la plus petite recette, celle de Bourges, l'office vaut 250 000 livres, une estimation de la valeur moyenne des offices de finance des 48 recettes de généralité à environ 600 000 livres qui conduit à une valeur globale de ces offices de 29 millions, soit le même ordre que les cautionnements correspondant des 87 recettes départementales du XIXe siècle, ne paraît pas trop improbable. D'une manière plus générale, dans la mesure où la suppression des offices de finance, mais aussi de justice, s'est accompagné de leur remboursement en numéraire, on peut considérer que les anciens officiers ont été particulièrement bien placés, d'une part, pour spéculer sur les biens nationaux et les fournitures de guerre, d'autre part, pour reprendre les recettes générales(129) en réinvestissant dans les cautionnements, immédiatement ou après le retour au calme, les fonds dégagés. Ainsi, en dépit du fait que "la plupart des receveurs généraux de Louis XVI (cessent) d'exercer toute fonction officielle après 1791" et que seulement deux de leurs descendants directs retrouvent une telle fonction avant 1815(130), on peut quand même recenser parmi les 142 receveurs généraux sur lesquels on dispose de renseignements sur les 218 qui rentrent en fonction de 1795 à 1815, une trentaine d'anciens officiers de finance et de justice et une quarantaine de fils d'officiers de finance en y incluant trois descendants de lignages de fermiers généraux(131), ensemble auquel il faut ajouter également une vingtaine de receveurs qui déjà succède à un parent receveur général nouveau régime, soit au total près de 90 receveurs issus des milieux de l'office et/ou de la finance(132). De plus, le mouvement amorçé sous le Consulat et l'Empire de réapparition d'anciens hauts personnages de la finance d'ancien régime ou de leurs héritiers ainsi que des mécanismes de reproduction
endogène du milieu s'accentue à partir de la Restauration. En ce qui concerne les receveurs généraux, cela se traduit par exemple par la réapparition de quelques descendants directs des fermiers généraux comme Delahante (fils et gendre de fermier général, important receveur de 1814 à 1854) et Deville (fils de fermier général et receveur général de 1848 à 1857), ou encore par le retour dans la "profession" d'un Brugière de Barrante (fils d'un trésorier général de France en 1784), d'un Randon-Latour (membre de la famille Randon comptant toute une lignée de receveurs généraux d'ancien régime, fils d'un conseiller du roi receveur des tailles et demi-frère d'un administrateur du Trésor royal en 1788)(133), d'un Tassin de La Vallière (fils d'un procureur du baillage d'Orléan, Intendant des finances du Duc d'Orléan), d'un Caze de la Bove (fils d'une receveur général des fermes), d'un Marcotte (administrateur des forêts, fils d'un receveur des fermes) et de son frère, etc. Bref, sur les 272 receveurs généraux en fonction de 1800 à 1865, "92 appartiennent à la noblesse" et "au total 124 étaient nobles de souche ou d'apparence, soit presque la moitié du corps". Parmi ces 124 receveurs, 17%, soit 21 sont de vieille noblesse, pour la plupart d'entre eux, noblesse de robe. Or "ces familles étaient souvent alliées les unes aux autres par des mariages et servaient le roi depuis de nombreuses générations". C'est donc tout naturellement qu'elles vont continuer à s'organiser de la sorte ainsi que l'a bien montré P. F. Pinaud(134). Ne prenons ici qu'un exemple qui a le mérite dêtre passé encore inaperçu en dépit de sa relative importance, celui du "cousinage" par la médiation des familles Puissant (ferme générale) et Hamelin (recette générale) entre les Baudon de Mony (fermiers généraux) et les Taillepied de Bondy (receveurs généraux) que l'on retrouve tous deux dans la recette générale au XIXe siècle : Marie-Romain Hamelin, receveur général de Louis XVI à Bourges, est, en effet, marié à une fille Puissant et en a un fils, riche fournisseur des armées sous le Directoire et le consulat, mais aussi une fille, laquelle devient "en 1793 la bru de Taillepied de Bondy"(135); or une autre Puissant est également mariée au fermier Baudon de Mony, père et grand-père des receveurs départementaux et régents de la Banque de France du même nom qui vont au XIXe siècle fonder le plus puissant réseau fisco-financier qui semble avoir été à cette époque (cf. infra, schéma 3). De plus, comme ces robins de vieille souche servent sans aucun doute de référence pour toute la "profession", leur importance dépasse de loin leur simple nombre et leur influence se traduit non seulement par le désir d'annoblissement qui va continuer à structurer l'éthos du capitalisme financier, mais aussi par l'organisation du groupe des receveurs généraux nouveau régime en tant que "caste particulière" de l'administration française(136). ENCADRÉ 3 : RECEVEURS GÉNÉRAUX OFFICIERS OU LIÉS A DES OFFICIERS OU DES FERMIERS NOMMÉS AVANT 1815
Pério
deFO
NC
TIO
NS
AV
AN
T 1
789
FON
CT
ION
S A
PRE
S 17
89A
cq.
60 +
A
scen
danc
e si
off
ice
Patr
onym
esi
fina
nce,
just
ice
et a
rmée
(n.c
. not
aire
s)R
ecev
eur G
énér
al d
eb.
nat
.im
p.ou
rece
veur
nou
veau
régi
me
1795-1796
AB
AD
IE J
ean
Jose
phPr
ocur
eur d
u ro
i à A
uch
Ger
s 17
95-1
800
CH
AM
BO
N F
ranç
ois
Con
trôl
eur d
ans
la p
artie
des
dom
aine
sD
ordo
gne
1795
-181
4ou
iou
iC
RO
IZE
T H
ugue
sE
ntre
pose
ur d
es ta
bacs
Can
tal 1
796-
1814
oui
oui
Proc
ureu
r du
roi à
Aur
illac
CU
ISIN
ET
Fra
nçoi
sPr
ocur
eur d
u ro
i (re
ceve
ur d
es c
onsi
gnat
ions
)C
reus
e 17
95-1
805
(fai
llite
)ou
iou
iPr
ocur
eur d
u ro
iD
AL
LE
T N
icol
asD
irec
teur
Gén
éral
com
ptab
ilité
arr
iéré
eT
arn
1795
-180
3D
AU
PHIN
Cyr
iaqu
e(r
ecev
eur d
e di
stri
ct, a
dmin
istr
ateu
r sal
ines
)Ju
ra 1
796-
1799
oui
oui
Lie
uten
ant p
révô
st d
e la
mar
écha
ussé
e de
Lon
sD
OY
EN
Cha
rles
Con
trôl
eur a
mbu
lant
à la
régi
e gé
néra
leL
oire
t 179
5-18
15, M
anch
e 18
15-1
824
Con
seill
er a
u pr
ésid
ial d
e N
ancy
FEB
UR
EA
voca
t, re
ceve
ur d
e l'E
nreg
istr
emen
tSa
ône
et L
oire
179
6-18
00FO
RE
STIE
R P
ierr
eA
voca
tA
llier
179
4-19
79Pr
ocur
eur d
u ro
i(D
e) F
RE
CIN
E A
ugus
tinA
voca
t au
parl
emen
t, B
ailli
de
Mon
tric
hard
loir
-et-
Che
r 179
6-17
99C
onse
iller
gré
netie
r au
gren
ier à
Sel
de
Mon
tric
hard
FRIN
-CO
RM
ÉR
É J
érôm
eT
réso
rier
des
gue
rres
, rec
eveu
r par
t. d'
élec
tion
May
enne
179
5-18
02ou
iou
i Pr
ocur
eur a
u si
ège
roya
l de
Lav
alG
AM
ON
Jos
eph
Proc
ureu
r de
la c
omm
une
d'E
ntra
igue
sA
rdèc
he 1
795-
1799
GIR
OU
D
Not
aire
roya
lIs
ère
1793
-181
5, B
asse
s-Py
réné
es 1
816-
1817
LE
FEV
RE
Mat
hieu
Rec
eveu
r Uni
vers
ité d
e D
ouai
Nor
d 17
94-1
799
(des
titué
)L
EFE
VR
E L
ouis
Dire
cteu
r de
la ré
gie
géné
rale
Hau
te G
aron
ne 1
796-
1801
MA
IGN
OL
Ant
oine
Not
aire
roya
lPu
y-de
-Dôm
e 17
95-1
801
Rec
eveu
r de
l'Enr
egis
trem
ent
MA
RT
IGN
E G
uyN
otai
re ro
yal
Sart
he 1
795-
1798
oui
oui
MO
RE
AU
Fra
nçoi
sN
otai
re ro
yal
Indr
e 17
95-1
799
PRO
UST
Fra
nçoi
sC
aiss
ier d
e la
rece
tte d
es ta
illes
Deu
x Sè
vres
179
6-18
15ou
iou
i
RE
ISE
T J
acqu
es(I
ngén
ieur
des
Pon
ts e
t Cha
ussé
es)
Ht-
Rhi
n 17
95, E
spag
ne 1
813,
Sei
ne-I
nfér
ieur
e 18
16-1
834
Rec
eveu
r des
fina
nces
, maî
tre
des
eaux
et f
orêt
sR
IVA
LS
Ray
mon
d(2
5 an
s)A
ude
1795
-180
7ou
iou
iR
ecev
eur g
énér
al d
es ta
illes
, avo
cat a
u pa
rlem
ent
RO
BE
RT
Rec
eveu
r gén
éral
des
aid
esG
iron
de 1
796-
1802
SAIN
T M
AR
TIN
Avo
cat a
u pa
rlem
ent,
cons
eille
r C
. Com
ptes
vauc
luse
179
6-18
07O
ffic
ier
SOU
LE
S N
icol
asE
mpl
oyé
à la
Tré
sore
rie
Nat
iona
leSe
ine-
Infé
reur
e 17
95-1
810
(des
titué
)SO
MM
ER
VO
GE
L X
avie
rIn
spec
teur
des
forê
tsB
as-R
hin
1795
-179
6V
AL
IN (L
'ain
é) R
ené
Rec
eveu
r des
cap
itatio
nsL
oire
-Inf
érie
ure
1796
-179
9ou
iou
iV
IEL
LA
RD
Pie
rre
(Avo
cat)
Man
che
1795
-179
9Pr
ocur
eur à
Sai
nt-L
ôY
TIE
Z J
ean
Bap
tiste
Com
mis
à l'
adm
inis
trat
ion
des
dom
aine
sA
veyr
on 1
796-
1798
1797-1799
BR
IÈR
E d
e SU
RG
Y J
ean
Cou
r des
aid
es e
t Cha
mbr
e de
s co
mpt
esM
osel
le 1
799-
1800
Gen
dre
Ferm
ier G
énér
al H
ocqu
art
CH
AZ
AU
D J
ean
Fran
çois
(Hom
me
de lo
i)G
ers
1800
, Vie
nne
1801
-180
4C
onse
iller
en
l'éle
ctio
n de
Con
fole
nsG
AM
ON
Flo
rent
in(2
3 an
s)A
rdèc
he 1
799-
1815
Rec
eveu
r Gén
éral
N.R
. (fr
ère)
GO
SSU
IN L
ouis
Lie
uten
ant G
énér
al d
u B
ailla
ge D
u Q
uesn
oyN
ord
1799
-182
1M
aire
d'A
vesn
e (f
ils),
Avo
cat a
u Pa
rlem
ent (
gend
re),
Rég
isse
ur E
nrgt
(nev
eu)
GO
UPI
L J
acqu
esR
ecev
eur d
es ta
illes
Sart
he 1
798-
1811
GO
UV
ILL
IER
Jea
nR
ecev
eur d
es ta
illes
Hau
te-M
arne
179
9-18
12ou
iR
ecev
eur d
es ta
illes
GR
AV
IER
Jea
n Pi
erre
Avo
cat a
u pa
rlem
ent,
secr
étai
re d
u ro
iA
lpes
-Mar
itim
es 1
798-
1800
LU
CE
(de
TR
EM
ON
T) V
icto
rV
endé
e 17
99-1
815,
Indr
e-et
-Loi
r 181
6-18
30R
ecev
eur G
énér
al N
.R.
MA
RR
AG
ON
Jea
n B
aptis
teC
ontr
ôleu
r gén
éral
du
cana
l du
Mid
iH
érau
lt 17
99, H
aute
-Gar
onne
180
1-18
10D
irect
eur d
u ca
nal d
u M
idi (
gend
re)
VIL
LIE
Z J
osep
hA
voca
t, pr
ocur
eur d
u ro
iM
eurt
he 1
797-
1798
1800-1815
BA
LL
AN
D d
'AU
GU
STE
BO
UR
G F
ranç
ois
Cap
itain
e de
cav
aler
ieC
reus
e 18
05-1
811
Cap
itain
e de
cav
aler
ieB
AL
LA
ND
d'A
UG
UST
EB
OU
RG
Jea
n(2
4 an
s)C
reus
e 18
11-1
845
Rec
eveu
r Gén
éral
N.R
.B
AU
DO
N d
e M
ON
Y P
asca
lD
irec
teur
des
dro
its d
oman
iaux
?L
ot 1
809,
Hte
Gar
onne
181
5, N
ord
1821
-183
4Fe
rmie
r Gén
éral
BE
RT
RA
ND
de
BO
UC
HE
POR
N R
ené
Hau
te-M
arne
181
2-18
42A
voca
t au
Parl
emen
t de
Met
zB
LA
CH
ET
TE
Jac
ques
Nég
ocia
nt, p
ayeu
r gén
éral
à l'
arm
éeD
rôm
e 18
00-1
814
Rec
eveu
r Gén
éral
N.R
.B
OR
EL
LI (
de S
ER
RE
S) T
hom
asB
anqu
ier
Loz
ère
1805
-182
8R
ecev
eur G
énér
al N
.R.
BO
UR
BO
UL
ON
de
ST E
DM
É E
dmé
Paye
ur g
énér
al à
l'ar
mée
Ais
ne18
06, V
endé
e 18
20, I
lle e
t Vil.
182
1,M
anch
e 18
23-1
850
Tré
sori
er g
énér
al d
u C
omte
d'A
rtoi
sde
BO
UT
RA
Y A
ndré
Off
icie
rM
ayen
ne 1
802-
1825
Rec
eveu
r Gén
éral
A.R
., Pa
yeur
des
rent
es d
e l'H
otel
de
Vill
eC
HA
ILL
OU
Ale
xand
reE
ure
1804
-180
7 (d
estit
ué p
our f
ailli
te)
Rec
eveu
r Gén
éral
N.R
.C
HA
ZA
UD
Fra
nçoi
sV
ienn
e 18
04-1
842
Rec
eveu
r Gén
éral
N.R
. et g
endr
e T
réso
rier
de
Fran
ce A
.R.
CO
RB
INE
AU
Mar
ie L
ouis
Sein
e-In
fére
irue
181
0, M
arne
181
6-18
23C
omm
issa
ire
Insp
ecte
ur g
énér
al d
es h
aras
du
roi
CR
EPY
Bon
Jos
eph
(20
ans)
Yon
ne 1
810-
1831
Maî
tre
des
Com
ptes
DA
NE
T J
osep
h(2
6 an
s, c
olla
bora
teur
de
son
père
)M
orbi
han
1810
-181
6 (e
n dé
fici
t)R
ecev
eur G
énér
al N
.R.
DA
NE
T J
ulie
n(f
rère
du
préc
éden
t)Ju
ra 1
809-
1819
Rec
eveu
r Gén
éral
N.R
. (fi
ls e
t gen
dre)
DE
CL
ER
CK
Jea
n B
aptis
teE
mpl
oyé
à la
Tré
sore
rie
Nat
iona
leG
iron
de 1
801,
Tar
n et
Gar
onne
181
5,A
isne
182
1-18
43C
omm
issa
ire
à la
Tré
sore
rie
Nat
iona
le, D
irec
teur
com
ptab
ilité
cen
tral
eD
ESP
OU
S C
laud
eC
onse
iller
du
roi,
Rec
eveu
r des
taill
esH
érau
lt 18
00-1
810
DE
SPO
US
And
ré(2
4 an
s)H
érau
lt 18
10-1
832
Rec
eveu
r Gén
éral
N.R
.D
ESR
OU
ZIE
RE
S L
ouis
Rec
eveu
r des
dom
aine
sE
ure
et L
oir 1
800-
1806
(dém
issi
onna
ire)
DIB
ON
Jea
n B
aptis
teFi
late
urA
isne
180
0-18
04D
irect
eur d
es a
ides
DU
CO
S Jo
seph
Avo
cat
Deu
x N
èthe
s 18
00, B
as-R
hin
1814
, Som
me
1818
-182
4C
onse
iller
Cou
r des
Com
ptes
, Rec
eveu
r gén
éral
des
ferm
es (F
amill
e C
aze)
GA
RN
IER
-DE
SCH
EN
ES
Edm
ond
(Pay
eur g
énér
al e
n 18
05)
Pyré
nées
Ori
enta
les
1806
-181
1D
ir. d
es D
om. e
t Rég
isse
ur d
e l'E
nreg
ist.
(fils
), A
dm. G
énér
al D
om. (
gend
re)
GA
ZE
AU
de
La
BO
UE
RE
Eur
e-et
Loi
r 180
6-18
16L
ié à
la fa
mill
e C
aze
de la
Bov
e (r
ecev
eur g
énér
al d
es fe
rmes
)G
IBE
RT
Gui
llaum
eN
otai
reO
ise
1801
-181
1ou
iC
onse
iller
du
roi
GIB
ER
T A
chill
e(2
5 an
s)O
ise
1811
-185
7R
ecev
eur G
énér
al N
.R.
GIL
LE
S C
laud
e(C
ontr
oleu
r des
con
trib
utio
ns d
irec
tes)
Sein
e et
Ois
e 18
02-1
815
Con
seill
er C
our d
es c
ompt
es, a
ides
et f
inan
ces
de M
ontp
ellie
r (ge
ndre
)G
OU
PIL
Jac
ques
Fond
é de
pou
voir
de
son
père
Sart
he 1
811-
1838
Rec
eveu
r Gén
éral
N.R
.G
UIC
HA
RD
Gui
llaum
eY
onne
180
5-18
10C
onse
iller
du
roi
HA
RL
E C
harl
es(2
2 an
s)Pa
s-de
-Cal
ais
1812
-182
4R
ecev
eur G
énér
al N
.R.
HA
UD
RY
de
JAN
VR
Y A
ndré
Ard
enne
s 18
10-1
815
(rév
oqué
)Fe
rmie
r Gén
éral
(fils
et g
endr
e)JU
NO
T G
uyPa
yeur
à l'
arm
éeL
ot-e
t-G
aron
ne 1
801,
Hte
Saô
ne 1
802-
1815
Con
serv
ateu
r des
forê
tsL
APE
YR
IER
E J
ean
Lou
isA
voca
t au
parl
emen
t, re
ceve
ur d
u cl
ergé
Sein
e 18
04-1
810
LA
PEY
RIE
RE
Jea
n Jo
seph
Sein
e 18
10-1
831
(fai
llite
)R
ecev
eur G
énér
al N
.R.
LA
RO
QU
E d
e ST
GIR
ON
S G
uilla
ume
Ari
ège
1804
-181
5R
ecev
eur G
énér
al N
.R.
LA
W d
e L
AU
RIS
TO
N L
ouis
(Off
icie
r de
mar
ine)
Loi
re-I
nfér
ieur
e 18
05-1
830
Mar
écha
l de
cam
pL
EFE
VR
E M
athi
eu A
ntoi
ne
N
ièvr
e 18
01-1
829
Rec
eveu
r Gén
éral
N.R
.L
EJE
AS
Ant
oine
(23
ans)
Côt
e d'
Or 1
803-
1815
Avo
cat a
u pa
rlem
ent p
uis
R. G
. des
fer
mes
Dijo
n (+
gen
dre
R.G
. N.R
.)M
AR
RA
GO
N J
ean
Phili
bert
Hau
te-G
aron
ne 1
810-
1815
Rec
eveu
r Gén
éral
N.R
.(d
e) M
IEU
LL
E J
osep
hA
voca
t au
parl
emen
tA
lpes
-Mar
itim
es 1
801-
1815
,Mai
ne-e
t-L
oire
181
6-18
32Pr
ocur
eur d
u ro
iM
ON
NO
T J
acqu
esA
dmin
istr
ateu
r Rég
ie N
at. E
nreg
istr
emen
tD
oubs
180
1-18
12ou
iou
iN
IVIE
RE
Lau
rent
Fond
é de
pou
voir
de
son
père
(27
ans)
Rhô
ne 1
807-
1831
Rec
eveu
r Gén
éral
N.R
.(D
e) P
AR
RO
N D
omin
ique
(25
ans)
Hau
te-L
oire
180
8-18
47M
aréc
hal d
e ca
mp
PEY
RU
SSE
And
ré(s
olda
t)It
alie
180
3, In
dre-
et-L
oir 1
806-
1815
Con
sul d
e C
arca
sson
ePI
ER
LO
T L
ouis
Em
ploy
é da
ns le
s fe
rmes
du
roi
Aub
e 18
03-1
811
(fai
llite
)PI
LO
TE
de
La
BA
RO
LL
IER
EO
ffic
ier
Gar
d 18
02-1
815
Gen
tilho
mm
e du
roi d
e Po
logn
e(D
e) R
IBE
RO
LL
ES
Gilb
ert
Puy-
de-D
ôme
1801
-181
2Se
crét
aire
du
roi
(De)
RIB
ER
OL
LE
S B
arth
élém
yA
udite
ur a
u C
onse
il d'
Eta
tPu
y-de
Dôm
e 18
12-1
833
Rec
eveu
r Gén
éral
N.R
.R
IVA
LS
Aug
uste
(off
icie
r)A
ude
1807
-181
5R
ecev
eur G
énér
al N
.R. (
frèr
e)R
OG
ER
Nic
olas
Prem
ier c
omm
is d
es fi
nanc
esA
isne
180
4-18
06SA
INT
MA
RT
IN P
IER
RE
Cha
rles
Gra
nd P
ropr
iéta
ireV
aucl
use
1807
, Loi
r-et
-Che
r 181
6-18
33R
ecev
eur G
énér
al N
.R.
TA
ILL
EPI
ED
de
BO
ND
Y C
harle
sPô
180
2, M
aine
-et-
Loi
re 1
806,
Dou
bs 1
816-
1821
Rec
eveu
r Gén
éral
A.R
. (fi
ls e
t pet
it-fi
ls)
La reconstitution des réseaux familiaux de financiers. Pour situer la place des receveurs généraux dans la société du XIXe siècle, on peut alors considérer l'importance numérique de cette "caste" relativement à celle des financiers des siècles précédents. A ce titre, comparés aux 500 lignages financiers du XVIIe et du début du XVIIIe siècle qui dominaient en s'appuyant sur les quelques 3 000 personnes qui leur servaient de vivier (Dessert 1986), et dont le nombre a dû se réduire ultérieurement, nos 87 trésoriers généraux appuyés sur les quelques 300 receveurs particuliers et 5.000 percepteurs dans leur dépendance directe ainsi que sur un réseau de 32 000 riches clients, paraissent atteindre tout autant la masse sociale critique. Et cela d'autant plus que leur pouvoir financier a été considérablement renforcé en valeur absolue non seulement en raison des monopoles régionaux qu'ils détiennent désormais sur l'ensemble des ressources fiscales, mais également du fait de l'augmentation de la production marchande. Faut-il rappeller, à ce propos, que les receveurs généraux sont, rien que pour leurs activités fiscales, intéressés à une masse d'argent représentant entre 10 et 15 % d'un produit national croissant ?
Mais, c'est aussi par l'intensité des relations qu'ils ont pu tisser entre eux sur tout le territoire qu'on peut apprécier l'étendue de leur pouvoir économique et social. La constitution de réseaux familiaux et les stratégies d'annoblissement sur lesquelles P. F. Pinaud a attiré le premier l'attention ne témoignent pas seulement, en effet, de la continuité par delà la révolution de certains lignages de noblesse de robe de vieille souche, ni du maintien de leur position de référents sociaux pour la haute bourgeoisie de finance. Elles traduisent également des stratégies financières qui se déploient à la fois dans tout l'espace territorial et dans la temporalité longue du XIXe siècle dans son ensemble. On présente dans les schémas suivant, tirés d'une première exploitation des travaux prosopographiques publiés, quelques exemples de ces groupes financiers endogamiques(137). Le réseau financier le plus important est de toute évidence celui que nous avons appellé la "galaxie financière Baudon de Mony - Akermann - Fontenillat - d'Audiffret". Celle-ci couvre, en effet, un espace considérable et s'étend sur tout le siècle. Elle s'inscrit par ailleurs très nettement dans la continuité de la ferme générale avec cependant des apports de la recette générale d'ancien régime, de la Banque et du grand négoce. Ce réseau est composé de 25 receveurs et trésoriers payeurs généraux se succédant en trois générations et répartis en quatre sous-ensembles familiaux plus serrés alliés entre eux(138). Le groupe principal (au nord-ouest du schéma 3) est constitué par des liens familiaux étroits à partir du lignage "fermier" des Baudon de Mony allié anciennement aux Puissant, également de la Ferme Générale, et par là, aux Hamelin et Taillepied de Bondy de la recette générale ancien régime (cf. supra); dès la première génération, par les filles, les Baudon s'allient aux (de) Boubers et aux Law de Lauriston, l'ensemble fournissant trois receveurs de la première génération et trois de la deuxième; puis, par les (de) Boubers et leur alliance avec les Renouard, la famille s'étend à une troisième génération de quatre trésoriers payeurs généraux; on y compte en outre deux régents et un premier sous-gouverneur de la Banque de France. Par ailleurs, dès l'Empire, ce premier sous-groupe entretient des relations de cousinage avec le sous-groupe Akermann (nord-est du schéma 3) par la médiation des Collart-Dutilleul(139), sous-groupe qui s'étend également sur trois générations et compte ainsi, alors que le premier Akermann débute comme receveur général en 1800, trois trésoriers payeurs généraux dont l'un perdure jusqu'en 1887; ici aussi on compte un régent de la Banque de France qui y siège 31 ans et jusqu'en 1890. Le troisième sous-groupe (sud-est) est également relié par cousinage à Pascal Baudon, de la première génération, par l'intermédiaire des Fontenillat; ce sous-groupe est, quant à lui, plutôt structuré en constellation de diverses familles (les Gibert, les Doyen, les Cambacérés(140)) liées les unes aux autres par une multiplicité de relations de parenté qui s'enchainent. En ce cas d'ailleurs, bien qu'on y compte déjà quatre régents et un sous-gouverneur de la Banque de France, seules sont directement couvertes les deux premières générations de receveurs généraux avec quatre d'entre eux dans chacune; le lien à la troisième génération des trésoriers payeurs généraux existe cependant et se fait alors par une alliance directe entre un Fontenillat et la famille d'Audiffret qui, en ce qui la concerne, n'est rentrée dans la recette générale qu'à la deuxième génération (deux membres) et compte un trésorier payeur général qui se maintient jusqu'en 1884. Au total donc, sur 25 receveurs-trésoriers généraux de ce réseau, on en dénombre 8 qui débutent avant la Restauration, 9 qui exercent ensuite en terminant leur activité avant 1865 et 8 qui finissent comme trésoriers payeurs généraux. Près du dixième des effectifs de receveurs généraux à un moment donné appartenaient ainsi à ce réseau familial qui, à lui seul, formait un véritable syndicat et qui, si l'on tenait compte de l'implantation des recettes départementales contrôlées, apparaîtrait encore plus considérable. Il est d'autant plus frappant alors de constater qu'apparemment, les activités de ce réseau s'arrêtent avant 1889, lorsque commencent à se faire plus précises les menaces sur le statut des trésoriers.
B
AUDO
N (D
E MO
NY)
Ch
arle
sFe
rmie
r Gé
néra
l 176
7-17
74Di
rect
eur
de D
ts D
oman
iaux
(?)
- 17
81 (
?). R
égiss
eur d
e l'
Adm
inist
ratio
n de
s Do
mai
nes
et
Droi
ts D
oman
iaux
178
1-87PU
ISSA
NTEl
isabe
th f
ille d
e Fe
rmie
r Gé
néra
l
B
AUDO
N (D
E MO
NY)
Pa
scal
(?
† 18
48)
Rece
veur
Gén
éral
180
9-18
34Ré
gent
de
la B
anqu
e de
Fra
nce
e
n 18
34
(n° 3
3)
(Fils
)
B
AUDO
N (D
E MO
NY)
A
dolp
he (
1812
† 1
888)
Audi
teur
Con
seil
d'Et
atRe
ceve
ur G
énér
al 1
835-
1845
Rége
nt d
e la
Ban
que
de F
ranc
e
en
1838
-184
9 (?
)
(n° 3
4)
(Fils
)
D
e BO
UBER
S Ad
olph
e
( 1
791
† 18
61)
Secr
étai
re p
artic
ulie
r de
Mol
lien
Insp
ecte
ur g
énér
al d
es F
inan
ces
C
onse
iller d
'Eta
tSe
crét
aire
gén
éral
Min
istè
rede
s Fi
nanc
es 1
828-
1846
Rece
veur
Gén
éral
184
6-18
52
(n° 5
5)
(Bea
u-fr
ère)
L
AW D
e LA
URIS
TON
Cha
rles
(176
9 †
?)(F
ils d
'une
mar
écha
l de
cam
p,
frè
re M
aréc
hal)
Rece
veur
Gén
éral
182
0-18
42
(n° 2
68)
(Bea
u-fr
ère)
L
AW D
e LA
URIS
TON
Lou
is (1
773
† 18
34)
Offic
ier
de M
arin
e, N
égoc
iant
Re
ceve
ur G
énér
al 1
805-
1830
(n
° 267
)
(frè
res)
REN
OUAR
D DE
BUS
SIÈR
E
Loui
s Pa
ul (
1827
† 1
910)
Age
nt d
e ch
ange
Rece
veur
Gén
éral
185
2-18
65
T
. P. G
. 186
6-18
70Go
uver
neur
Cré
dit
Fonc
ier
I er
Sous
-Gou
vern
eur
de la
B
anqu
e de
Fra
nce
(n
° 392
)
(Gen
dre)
REN
OUAR
D DE
BUS
SIÈR
E
Alfre
d
D
irect
eur d
e la
Mon
naie
d
e Pa
ris
(Fils
)
D'A
RCY
Pier
re
(18
02 †
188
1)
Perc
epte
ur 1
828
Rece
veur
Par
ticul
ier
1829
-184
3 R
ecev
eur
Géné
ral 1
843-
1866
T
. P. G
. 186
6-18
71
(n° 1
6)
(Cou
sins
)
B
ARTH
OLDI
Jac
ques
Ba
nqui
er
SOÉ
HNÉE
Jea
n
B
anqu
ier
Cens
eur
de la
Ban
que
de F
ranc
e
18
00-1
808
(Gen
dre)
(Gen
dre)
(Cou
sin)
C
OLLA
RT-D
UTIL
LEUL
F
ranç
ois
(18
29 †
191
3)Re
ceve
ur P
artic
ulie
r 18
55-1
864
Rece
veur
Gén
éral
186
4-18
66
T. P
. G. 1
866-
1887
Ban
quie
r à T
ours
(n
° 102
)
C
OLLA
RT-D
UTIL
LEUL
Al
exan
dre
Insp
ecte
ur G
énér
al d
es F
inan
ces
Con
seille
r Maî
tre
puis
Proc
ureu
r Gé
néra
l à la
Cou
r de
s
C
ompt
es 1
830-
1864
(Fils
)
A
KERM
ANN
Fran
çois
Jo
seph
(?
† 18
48)
Rece
veur
Gén
éral
180
0-18
33
(n° 4
)
A
KERM
ANN
Fran
çois
A
dolp
he (
1809
† 1
890)
Com
mis
Min
istèr
e de
s Fi
nanc
esRe
ceve
ur G
énér
al 1
834-
1866
T.
P. G
. 186
6-18
78Ré
gent
de
la B
anqu
e de
Fra
nce
18
59-1
890
(n
° 5)
(Fils
)
(Beau-frère)
(Gen
dre)
B
OQUE
T De
SAI
NT S
IMON
Caiss
ier
Géné
ral d
u Tr
ésor
Pub
lic
e
n 18
32
Dire
cteu
r de
la D
ette
Insc
rite
en
1837
(Gen
dre)
D
UCOM
MUN
Du L
OCLE
A
lexa
ndre
(18
04 †
188
4)Re
ceve
ur P
artic
ulie
r 18
31-1
836
Rece
veur
Per
cept
eur
1836
-185
7Re
ceve
ur G
énér
al 1
857-
1866
T.
P. G
. 186
6-18
73
(n° 1
64)
(Bea
u-fr
ère
?)
FONT
ENIL
LAT
Henr
i
(
1793
† ?
)Fi
ls de
nég
ocia
nt e
t ge
ndre
d'u
n
ban
quie
r bel
geRe
ceve
ur G
énér
al 1
831-
1862
Rége
nt d
e la
Ban
que
de F
ranc
e
de
1845
à 1
863
(n
° 186
)
(Par
enté
par
di
vers
mar
iage
s)
DOYE
N Ch
arle
s
Fran
çois
(17
55 †
184
8)Co
ntrô
leur
de
la R
égie
Gén
éral
e
a
vant
178
9
Rece
veur
Gén
éral
179
5-18
24
Ban
quie
r de
1824
à 1
848
(n
° 161
)(F
ils)
D
OYEN
Cha
rles
Pi
erre
(17
97 †
186
6)Ag
ent
de c
hang
e à
Paris
Rece
veur
Gén
éral
182
3-18
59So
us-G
ouve
rneu
r de
la B
anqu
e
de F
ranc
e en
185
9
(n° 1
62)
(B.-f
rère
)
De S
AULT
Y (P
RUVO
ST)
Ph
ilippe
(17
65 †
183
3)Tr
ésor
ier
de la
Cai
sse
du
G
énie
181
0-18
14Re
ceve
ur G
énér
al 1
814-
1833
Ré
gent
de
la B
anqu
e de
Fran
ce à
par
tir d
e 18
17
(n
° 415
)
(Parenté)
BAST
ERRE
CHE
J
ean
(178
7 †
1882
) F
ils d
e ba
nqui
er-a
rmat
eur
N
égoc
iant
Rece
veur
Gén
éral
183
1-18
65
(n
° 31)
(Par
enté
)
BAST
ERRE
CHE
? (?
† ?
) Ré
gent
de
la B
anqu
e de
Fran
ce
(Nev
eu)
D
e CA
MBA
CERE
S
Jean
Ant
oine
(?
† ?)
Cons
eille
r M
aîtr
e à
la C
our
des
Com
tes,
Aid
es e
t F
inan
ces
de M
ontp
ellie
r
G
ILLE
S Cl
aude
(?
† ?
)Co
ntrô
leur
des
Con
tri-
butio
ns D
irect
es
Rece
veur
Gén
éral
1802
-181
5 (n
° 210
)
(Gen
dre)
(Parenté)
GI
BERT
Gui
llaum
e
(
1750
† 1
820)
Nota
ire
Re
ceve
ur G
énér
al 1
801-
1811
Rég
ent
de la
Ban
que
de F
ranc
e
de
1806
à 1
811
(n
° 207
)(F
ils)
GIBE
RT A
CHIL
LE
Pier
re (
1786
† 1
860)
Rece
veur
Gén
éral
181
1-18
57
(n° 2
08)
(Cou
sins)
(Gen
dre)
De M
EFFR
AY D
e CE
RSAG
ES
A
chille
(17
87 †
183
2) O
ffic
ier,
Prop
riéta
ire,
Dépu
té R
ecev
eur
Géné
ral 1
825-
1830
(n
° 323
)
(Parents)
(Frè
re)
D'A
UDIF
FRET
Cha
rles
(
? †
? )
Dire
cteu
r de
la C
ompt
abilit
é Pu
bliq
uePr
ésid
ent
de C
ham
bre
à la
Cou
r de
s
Com
ptes
D'
AUDI
FFRE
T Pi
erre
( 1
827
† 18
84)
Com
mis
au M
inist
ère
des
Fina
nces
Rec
eveu
r Pa
rtic
ulie
r 18
50-1
856
Re
ceve
ur G
énér
al 1
856-
1865
T. P
. G. 1
865-
1884
(n° 2
1)
D'
AUDI
FFRE
T Fl
orim
ont
( 1
789
† 18
58)
Chef
du
Mou
vt G
énér
al d
es F
onds
181
5Di
rect
eur
des
Octr
ois
de P
aris
1820
-183
0Di
rect
eur
de la
Det
te In
scrit
e 18
30-1
837
Con
seille
r d'E
tat
Re
ceve
ur G
énér
al 1
837-
1856
(n° 2
0)
D'
AUDI
FFRE
T-PA
SQUI
ER
Gas
ton
(Fils
)(F
ils)
PASQ
UIER
Etie
nne
(? †
?)
Dire
cteu
r Gé
néra
l
des
Tab
acs
(Gen
dre)
L
AW D
e LA
URIS
TON
?
(Fils
)(G
endr
e)
De B
OUBE
RS J
érôm
eGe
ntilh
omm
e de
la v
éner
ie d
u ro
i, m
arié
à C
unég
onde
Fol
ard,
f
ille d
'un
Cons
eille
r d'E
tat,
min
istre
plé
nipo
tent
iaire
(Fils
)
B
AUDO
N (D
E MO
NY)
?
Con
seille
r M
aîtr
e à
la
Co
ur d
es C
ompt
es
(Nev
eu)
REN
OUAR
D de
SAI
NTE
C
ROIX
Lou
is M
arie
(1
827
† 19
10)
Of
ficie
r d'
état
-maj
or 1
838
P
réfe
t 18
48-1
856
Rece
veur
Gén
éral
185
7-18
66
T
. P. G
. 186
6-18
74
(n° 3
93)
(Cou
sins)
De S
OUBE
YRAN
Lou
is
(1
801
† 18
86)
Frè
re d
e Pa
ul, P
réfe
t
Re
ceve
ur P
artic
ulie
r 18
30Re
c. P
erce
pteu
r Pa
ris 1
839
Rece
veur
Gén
éral
18
58-1
866
T. P
. G. 1
866-
1870
(n
° 421
)
SA
VARY
Dur d
e Ro
vigo
M
inist
re(G
endr
e)(G
endr
e)
TA
ILLE
PIED
DE
BOND
Y
Cha
rles
(176
7 †
1843
)Re
ceve
ur G
énér
al 1
802-
1821
TA
ILLE
PIED
DE
BOND
Y
Jean
Bap
tiste
Re
ceve
ur e
t fil
s de
Rec
eveu
r
Gén
éral
Anc
ien
Régi
meHA
MEL
IN M
arie
-Rom
ain
(1
734
† ?)
Rece
veur
gén
éral
An
cien
Rég
ime
PUIS
SANT
Mar
ie J
eann
e
(Fils
)(G
endr
e)
SCHÉ
MA
3 :
LA G
ALAX
IE F
INAN
CIÈR
E BA
UDON
DE
MON
Y -
AKER
MAN
N -
FONT
ENIL
LAT
- D'
AUDI
FFRE
T
(Par
ents
)
CASI
MIR
-PER
RIER
ban
quie
r, m
inist
re(B. F
.)
Certes, on peut toujours penser que le réseau de parentèle a pu se perpétuer sous d'autres noms en raison notamment d'alliances par les femmes; il reste toutefois plus plausible de considérer que cette puissante famille élargie a dû, à cette époque, opérer une reconversion de ses investissements économiques et sociaux. Cela est d'autant plus probable que la partie proprement financière du réseau constituée des receveurs généraux de la famille s'appuyait sur toute une structure d'appui, "infrastructure" composée non seulement de représentants de la Banque de France et de hauts-fonctionnaires des Finances, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes, mais aussi d'hommes politiques(141); or cette infrastructure s'est vue également de plus en plus remise en question sous la Troisième République, surtout dès la fin de sa période "opportuniste"(142). Vont aussi en ce sens les observations que l'on peut tirer des schémas 4, 5 et 6 qui représentent des groupes familiaux de financiers moins importants quoiqu'encore, pour certains, considérables. Ainsi, ce que nous avons appellé le groupe Humann (schéma 4) et qui comprend huit (ou neuf) receveurs-trésoriers également répartis sur trois générations (dont deux receveurs généraux de la première heure du nouveau régime - 1795 et 1796 - et trois T. P. G.), semble également arrêter ses activités fisco-financières en 1888, ce qui représente toutefois près d'un siècle de continuité dans la fonction. Le même type d'observations est valable pour le groupe (de) Matharel (schéma 5), soit 6 receveurs dont trois T. P. G. qui ne vont pas au-delà de 1885.
HUMANN Jean Georges (? † ? ) Négociant, Député Ministre des Finances
HUMANN Jacques (1811 † 1891) Inspecteur des FinancesReceveur Général 1853-1866 T. P. G. 1866-1877 (n° 239)
(Fils)
SAGLIO ( ? † ?)Receveur Général en Allemagne
CROIZET Hugues (1752 † 1831)(Fils d'un Procureur du Roi)Employé au Contrôle Généraldes Finances en 1776, AvocatEntreposeur des Tabacs 1781Trésorier Municipal 1790Receveur des Domaines 1791Receveur de districtReceveur Général 1796-1814Député 1815-1830 (n° 117)
COUDERC De SAINT-CHAMANT Pierre Henri Louis (1821 † 1902) Commis au Ministère des Finances Receveur Particulier 1846-1849 Receveur Général 1849-1866 T. P. G. 1866-1881 (n° 113)
(Gendre)
(Gendre)
LEBEGUE DE GERMINY Gabriel (1799 † 1871)Maître des Requêtes au Conseil d'Etat 1833Receveur Général 1833-1836Préfet 1838, Conseiller Maîtreà la Cour des Comptes 1841Receveur Général 1846-1854Ministre des Finances en 1851Gouverneur du Crédit Foncier de France 1854-1857Gouverneur de la Banque de France 1857-1863 Sénateur (n° 269)
(Gendre)
(Fils)
SCHÉMA 4 : LE GROUPE HUMANN
HUMANN Théodore (1803 † 1873) NégociantAuditeur au Conseil d'EtatReceveur Général 1836-1846 Député 1816-1848 (n° 240)
(Gendre) (Fils)
COUDERC De SAINT-CHAMANT François (1780 † 1863) Intendant en Espagne Receveur Général 1815-1847 (n° 112)
(Fils)
LEBEGUE DE GERMINY Adrien (1826 † 1922)Commis au Ministère des Finances Inspecteur des FinancesChef de bureau au Ministère des Finances 1854Receveur Général 1854-1865 T. P. G. 1865-1888Régent de la Banque de France (n° 270)
REISET Jacques Louis (1771 † 1836)Fils d'un receveur des finances et maître des eaux et forêtsIngénieur adjoint des Ponts et ChausséesReceveur Général 1795-1834Régent de la Banque de France de 1826 à 1836 (n° 389)
(Neveu)
(frères) (B. F.)
(Gendre)
RICHARD DE SOULTRAIT Gaspard (1793 † 1858)Officier général 1818-1831Receveur Général 1831-1858 (n° 397)
(Fils)
RICHARD DE SOULTRAIT Jacques (1822 † ? )Percepteur à Lyon 1861-1876 T. P. G. 1876-1885
OUTREQUIN DE SAINT-LEGER Alexandre (? † ?)Receveur Général d'Illyrie 1800-1814 Receveur Général 1820-1830 (n° 349)
(Gendre)
De MATHAREL Louis (1783 † 1854 ) Fils d'officier Receveur Général 1844-1851 (n° 319)
De MATHAREL Jean-Baptiste (1817 † 1883)Commis au Ministère des Finances Inspecteur Général des Finances T. P. G. 1874-1880
(Fils)
De MATHAREL Marie Victor (1819 † 1885)Commis au Ministère des Finances Payeur adjoint de l'armée 1841Receveur Particulier 1845-1850 Receveur Général 1850-1866 T. P. G. 1866-1879 (n° 320)
(Fils)
SCHÉMA 5 : LE GROUPE DE MATHAREL
(B. F.)
(frè
res)
DURRIEU Antoine (1782 † 1845)Contrôleur des contributionsdirectes 1811-1815Receveur Particulier 1815-1826Receveur Général 1826-1845 (n° 171)
(Fils)
DURRIEU Antoine Henri (1821 † 1890) Fondé de pouvoir de son père Receveur Général 1845-1866 T. P. G. 1866 (n° 175)
LACAVE-LAPLAGNE Jean Pierre Conseiller Maître à la Cour des Comptes Ministre des Finances
(Gendre)
LACAVE-LAPLAGNE ?Avocat Général à la Cour de Cassation
(Frère)
LOUCHET Louis (1753 † 1815)Professeur, Homme de LettresAdministrateur départemental Député à la ConventionReceveur Général 1795-1815 (Destitué) (n° 296)
(Fils)(Gendre)
LOUCHET Emile (1801 † 1874) Percepteur à Sceaux 1837Receveur Particulier 1837-1842 Receveur Général 1842-1865 T. P. G. 1865-1867 (n° 297)
De LAVAREILLE Léonard (? † ?)Président Trésorier de France de la Généralité de Poitiers
CHAZAUD Jean (1747 † 1818) Fils du conseiller Chazaud de la BaignéeAdministrateur de district Député à la ConventionReceveur Général 1800-1804 (n° 94)
CHAZAUD François (1778 † 1858)Receveur Général 1804-1842 (à 26 ans) (n° 95)
(Fils)
CHAZAUD Augustin (1810 † 1876) AvocatReceveur Particulier 1843-1847Receveur Général 1847-1867 (n° 96)
(Fils)
(Gendre)
UNE LIGNE DIRECTE : LES CHAZAUD
DAUPHIN Cyriaque (1753 † ?) Fils de Lieutenant PrévôtPropriétaire, Administrateur des Salines de l'Est Receveur de districtReceveur Général 1796-1799 (n° 131)
DANET Jean (1751 † 1820)Armateur, Négociant et Banquier Président de l'administration départementale, Député. Président du Tribunal de Commerce Receveur Général 1803-1810 (n° 124)
(Fils)
DANET Joseph (1780 † 1863) Collaborateur de son père Receveur Général 1810-1816 (en déficit) (n° 125)
DANET Joseph (? † ?) Receveur Général 1809-1819 (n° 126)
(Gendre)
(Frère)
UNE LIGNÉE INTERROMPUE : LES DANET
DELPECH DE SAINT GUILHEM Marie Philippe (1821 † 1902)Employé des finances en Algérie Receveur Général 1859-1865 T. P. G. 1865-1880 (n° 146)
BOURQUENEY François (? † ?) Avocat au Parlement de Besançon avant 1789 Receveur des finances sous le Consulat Caissier Général du Trésor de 1810 à 1825
(Fils)
BOURQUENEY Félix (1794 † 1879) Percepteur à Paris 1831-1854 Receveur Général 1854-1862 (n° 59)
LAFFITTE Jacques (? † ?) Banquier
(Gendre)
LA LIGNÉE BOURQUENEY
(neveu par alliance)
DE PORTES Claude (1790 † ?) Attaché au Cabinet du Ministre de l'Intérieur1811-1813 Sous-Préfet 1813-1844Receveur Particulier 1844-1850 Receveur Général 1850-1859 (n° 380)
(Parents)
CAZE (de La BOVE) Maire Joseph (? † ?)Receveur général des fermes à Lyon avant 1789
(Fils)
CAZE (de La BOVE) Alexandre (1783 † 1850) Inspecteur des finances Receveur Général 1816-1830 (n° 85)
(Gendre)
DUCOS Joseph (1767 † 1836) Receveur Général 1800-1824Régent de la Banque de France de 1811 à 1826 (n° 165)
(Parents)
GAZEAU de La BOUERE Charles François (? † ?) Percepteur 1798-1806 Receveur Général 1806-1816 (n° 204)
CAZE (de La BOVE) Gaspard (? † ?)Conseiller Maître à la Cour des Comptes
GOUPY Martin Fils d'un Régent de la Banque de FRance
(Gendre)
(Gendre)
LES CAZE de La BOVE
LE GROUPE LACAVE-LAPLAGNE
SCHÉMA 6 : QULQUES GROUPES FAMILIAUX DE RECEVEURS
En bref, les schémas présentés montrent qu'il y a des groupes fisco-financiers plus ou moins puissants et plus ou moins concurrentiels en raison sans doute d'une grande inégalité dans les "rendements" des recettes générales, ce qui se traduit par des stratégies familiales plus ou moins diversifiées et amples. Il est net également que toutes ces stratégies s'inscrivent non
seulement dans la longue durée, ce qui témoigne d'une certaine spécialisation dans la finance de certaines familles, mais aussi dans un espace social large, puisque les activités proprement financières mobilisent en général non seulement des relations entre financiers mais aussi des alliances avec des éléments familiaux appartenant plus strictement à l'ordre politico-administratif (haut-fonctionnaires et hommes politiques). Enfin, il est clair qu'il y a lieu de s'interroger sur ce qui apparaît comme une discontinuité dans les années 1880, époque où commence à s'imposer la méritocratie républicaine des classes moyennes "capacitaires" et où une bonne partie des anciennes dynasties de haut-fonctionnaires se met à "pantoufler" dans les affaires privées (Charle 1982)(143). Cela dit, compte tenu qu'au vu des premières pousses, la moisson promet d'être fructueuse, il conviendrait de poursuivre la recherche sur cette "caste" des financiers du XIXe siècle tant sur le plan sociologique qu'économique. Il serait utile notamment de construire les traces territoriales des divers réseaux familiaux, en mettant ainsi en évidence de manière plus précise les différences de puissance financière des diverses familles. En outre, une recherche qui ouvrirait la voie à une véritable sociologie historique de la finance devrait se donner comme objectif, au-delà du perfectionnement des données individuelles, de dresser de manière systématique la topographie socio-économique du monde fisco-financier en mettant en évidence les liens qu'il entretient simultanément avec les autres secteurs financiers (banquiers, agents de change, compagnies d'assurance, etc…), la haute administration et le monde politique. Enfin, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il est indispensable de mieux cerner quel a été le devenir des divers lignages ou familles à partir de la fin du XIXe siècle, à l'époque du déclin des diverses sources de rente. L'importance exceptionnelle des revenus officiels des receveurs généraux. Pour se faire une idée plus précise de la place des trésoriers généraux dans la société libérale, on ne peut cependant en rester à ce type de recherche qui, s'il montre bien la nature des rapports au politique et le mode de valorisation sociale des détenteurs de la recette générale, nous laisse encore démuni lorsqu'il s'agit de saisir leur poids en argent, c'est-à-dire leur importance économique quantitative. Certes, la société libérale qui s'installe avec la Restauration n'est plus une société où pour accéder à l'aristocratie, il est nécessaire d'être bien né. Au contraire, désormais la richesse apparaît comme le critère qui supplante la naissance pour accèder aux positions supérieures, les stratégies d'annoblissement témoignant donc d'une certaine façon de la richesse de ceux qui les suivent. Mais pour saisir l'impact économique de la présence récurrente des financiers publics au XIXe siècle, il faut des indices plus précis de classement quant au pouvoir spécifiquement économique de ces entrepreneurs. A cette fin, on dispose d'abord de quelques témoignages bien informés dont nous avons pour certains (Thiers, Duchâtel, d'Audiffret) déjà fait état et selon lesquels les receveurs généraux étaient nécessairement de "gros capitalistes". Mais, que représentent ces "capitalistes entreprenant à leurs risques et périls le service de la Trésorerie" comparés aux autres capitalistes dans d'autres domaines ? Où peut-on les situer dans l'échelle sociale par rapport aux grands propriétaires fonciers, aux gros négociants et aux hauts banquiers par exemple ? De plus, ces témoignages directs ne valent surtout que pour le premier XIXe siècle. Pour la Troisième République, on est plus démuni en dépit d'une opinion publique qui dénonce "l'extravagance", "l'exagération" de leurs émoluments. Tentons alors, comme on l'a fait pour les collecteurs de moindre rang, de nous faire une idée de leur richesse individuelle à différentes époques à partir de quelques chiffres disponibles tirés de quelques sources éparses(144).
Le premier indicateur disponible est le montant moyen des cautionnements, sans doute stable tout au long du siècle et de l'ordre de 330 000 francs environ, soit déjà une bonne fortune pour démarrer. Compte tenu de la dispersion des cautionnements selon les départements, on a là un indice clair du fait que, sauf intervention de sous-commanditaires participant à la mise de fonds, il fallait être fort riche pour accéder aux recettes les plus profitables dont le cautionnement, rappellons-le, dépassait largement le million (Gille 1959). On peut également se faire une idée plus précise de ce que représentent ces cautionnements - tout en gardant en mémoire qu'ils ne représentent nullement le prix de cession des trésoreries sur lesquels on ne dispose guère d'informations -, en rapprochant leur montant du prix des études de notaires. Selon P. Verley, à la fin du XIXe siècle "dans les chefs lieux d'arrondissement et de département", le prix de ces charges pouvait "atteindre 180 à 200 000 francs" et "à Rouen, à Versailles, dans la banlieue de Paris, il est souvent de 300 à 400 000 francs" alors qu'à Paris, une étude vaut 500 000 à 700 000 francs et quelque fois davantage"(145). Ainsi, alors même que celles-ci étaient considérées à la fin du XIXe siècle comme classant leurs détenteurs dans la bourgeoisie d'affaire(146), rien que le cautionnement d'une recette moyenne permettait d'acquérir une charge de notaire déjà fort importante. On peut également comparer le cautionnement moyen des receveurs généraux avec celui exigé par le Trésor des sociétés d'agents de change à Paris que nous donne également P. Verley(147). Ce cautionnement est fixé en 1818 à 125 000 francs et il passe en 1862 à 250 000 francs. Même si on y ajoute la "réserve statutaire à la chambre syndicale" qui est de l'ordre de 100 000 francs, la comparaison suggère qu'une recette générale moyenne est, au moins dans tout le XIXe siècle, un «office» plus important et donc d'une valeur nettement plus élevée qu'une société parisienne d'agent de change, certaines recettes départementales parmi les moins rentables pouvant toutefois se situer à un niveau équivalent à celle-ci. Or, il s'agit là également d'une entreprise qui ouvre le chemin de la fortune, comme en témoigne l'évolution du prix moyen de vente des offices d'agent de change à Paris; ce prix qui est de l'ordre de 70 000 francs en 1816, de 500 000 francs en 1850 et de 1 200 000 francs dans le premier quart du Second Empire, atteint presque les deux millions à la fin du même régime, puis redescend à 1 600 000 francs à la fin du siècle(148). Le rapprochement entre ces divers "offices" conforte d'ailleurs l'idée déjà entrevue qu'il existait une pratique de vente des recettes générales selon un prix qui s'actualisait lors des changements de "fonctionnaires" et devait alors sans doute largement dépasser le prix des immobilisations matérielles(149). Mais une autre question à éclaircir trouve également sa source dans ce rapprochement : les trésoreries n'étant pas des sociétés, ne serait-ce qu'en commandite simple, y avait-il une place pour des sous-commanditaires comme c'était le cas pour les agents de change ? L'existence des réseaux familiaux pourrait bien trouver ici une partie de son explication par analogie avec ce qui se met à prévaloir à la fin du siècle chez les cambistes lorsque la profession se ferme sur la base de l'hérédité : alors que celle-ci se met à classer d'emblée dans la très haute bourgeoisie, on observe une diminution de la part du capital apporté par les associés au bénéfice d'un accroissement des apports personnels et de ceux des sous-commanditaires appartenant à la famille de l'agent(150). TABLEAU 2 : ESTIMATION DU REVENU DES TRESORIERS PAYEURS GENERAUX (H1)
ANNÉE 1 8 2 0 1 8 3 2 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 3 1 9 1 3 Economiesans réforme après réforme obtenue
1.Traitement fixe (TF) 6000 6000 6000 9000 9000 12000 -3000Taux d'intérêt sur 4% 4% 3% 3% 3% 0% Cautionnement 330000 330000 330000 330000 330000 330000 2.Profit sur cautionnement 13200 13200 9900 9900 9900 0 9900(1+2) Emoluments fixes 19200 19200 15900 18900 18900 12000 6900Enveloppe budg. corresp. = 87*(1+2) 1,67 1,67 1,38 1,64 1,64 1,04 0,60(millions de F. courant) 3.Chiffre d'affaires 8 , 4 8 , 5 1 2 , 4 1 0 , 0 1 4 , 8 7 , 0 7,764.Recettes fiscales totales 873 923 1287 3250 4760 4760 3/4.Taux brut de remise 0,97% 0,92% 0,96% 0,31% 0,31% 5.Frais généraux 2,29 2,30 3,35 2,71 4,00 4,06 -0,065/3.%frais généraux (H1) 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 27,1% 58,0% -30,9%Bénéfice net (3-5) 6 , 1 5 6 , 2 0 9 , 0 1 7 , 2 9 1 0 , 7 6 2 , 9 4 7 , 8 2Rev. an. par tête (en F) 70656 71217 103542 83784 123632 33793 89839Part fixe du revenu 27,2% 27,0% 15,4% 22,6% 15,3% 35,5% -20,2%Taux de remise nette 0,7% 0,7% 0,7% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%PIB 8966 11581 14279 25409 49571 49571 Recettes fiscale % PIB 9,74% 7,97% 9,01% 12,79% 9,60% 9,60% Bénéfice net % PIB 0,069% 0,054% 0,063% 0,029% 0,022% 0,006% 0,016%Revenu mensuel/T.P.G. pour PIB actuel (F act.) 3 ,283506 2 ,562268 3 ,021394 1 ,373928 1 ,039184 0 ,284046 0,755138
Comptes avances dette flottante 20 63 80 100 38,5 38,5 Taux d'intérêt avances 5% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 1,75% 2,0%6.Intérêts versés par l'Etat 1,00 2,36 3,00 3,75 1,44 0,67 0,777.Part trésorier en % (H'1) 40,56% 40,56% 40,56% 40,56% 40,56% 40,56% Intérêts reçus trésoriers (6*7) 0,41 0,96 1,22 1,52 0,59 0,27 0,31Commissions sur fisc en % 0,30% 0,30% 0,30% 0,10% 0,10%Commissions sur fisc 2,62 2,77 3,86 3,35 4,91 0,00 4,91Remises extra-budgétaires 1,45 0,80 2,55 0,77 3,62 1,62 2,00
Structure de l'enveloppe Rémunération cautionnements 13,62% 13,51% 6,97% 8,61% 5,84% 0,00% Traitements fixes 6,19% 6,14% 4,22% 7,83% 5,31% 14,91% Commissions sur fisc 31,06% 32,58% 31,24% 33,50% 33,25% 0,00% Intérêts comptes d'avances 4,81% 11,27% 9,85% 15,21% 3,97% 3,90%Remises extra-budgétaire 17,22% 9,39% 20,61% 7,74% 24,53% 23,19% Frais de fonctionnement 27,11% 27,11% 27,11% 27,11% 27,11% 58,00% Sources : Stourm (1912, p. 464), Pinaud (1990, pp. 57 et 60), Fontvieille (1982, p. 39), Toutain (1987, p. 147 et sv.). TABLEAU 3 : ESTIMATION DU REVENU DES TRESORIERS PAYEURS GENERAUX (H2)
ANNÉE 1 8 2 0 1 8 3 2 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 3 1 9 1 3 Economie(sans réforme) (après réforme) obtenue
1:Traitement fixe (TF) 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 12000 -3000Taux d'intérêt sur 4% 4% 3% 3% 3% 0% Cautionnement 330000 330000 330000 330000 330000 330000 02:Profit sur cautionnement 13200 13200 9 9 0 0 9 9 0 0 9 9 0 0 0 9 9 0 03:(1+2) Rev. fixe par RG 19200 19200 15900 18900 18900 12000 6900(millions de francs courant) 4:Recettes fiscales totales 873 923 1287 3250 4760 4760 5:Taux de commission (H2) 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 6:Commissions (4*5) 0,90 0,95 1,33 3,35 4,91 0,00 4,917:Commissions par R.G. (F) 10343 10936 15248 38506 56396 0 56396Comptes d'avance dette flot. 20 63 80 100 38,5 38,5 0Taux d'intérêt avances 5% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 1,75% 08:Intérêts versés par l'Etat 1,00 2,36 3,00 3,75 1,44 0,67 0,779:Part trésoriers en % (H'2) 20,95% 20,95% 20,95% 20,95% 20,95% 40,56% 10:Intérêts reçus R.G. (8*9) 0,21 0,49 0,63 0,79 0,30 0,27 0,03Taux d'intérêt reçu par RG 1,05% 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 0,71% 11:Intérêts par R.G. (en F) 2 4 0 8 5 6 9 0 7 2 2 5 9 0 3 1 3 4 7 7 3 1 3 8 3 3 912:(7+11) Rev. var. (F) 12752 16625 22473 47537 59873 3 1 3 8 5673513:Rev. budg. RG (3+12) 31952 35825 38373 66437 78773 15138 63635
Cout budgét. de 13 (M.F) 2,78 3,12 3,34 5,78 6,85 1,32 5,54Frais généraux 2,29 4,63 3,35 2,71 4,00 4,00 014:Coût budgétaire total 5 , 0 7 7 , 7 5 6 , 6 9 8 , 4 9 1 0 , 8 5 5 , 3 2 5,5415:Remises extrabudg. R.G. 1 , 4 6 0 , 7 5 0 , 8 0 1 , 5 1 1 , 6 5 1 , 6 5 0en % / revenu budg. 24,08% 24,08% 24,08% 24,08% 2 4 , 0 8 % 1 2 5 , 2 8 % -101%Coût total (14+15) 6,53 8,50 7,49 10,00 12,50 6,97 5,54Rev. officiel moyen R.G (F) 48749 44451 47612 83793 97739 34103 63635
PIB 8966 11581 14279 25409 49571 49571 Recettes fiscale % PIB 9,74% 7,97% 9,01% 12,79% 9,60% 9,60% Revenu R.G. % PIB 0,047% 0,033% 0,029% 0,029% 0,017% 0,006% Revenu mensuel/Tête pour un PIB actuel 2 ,265450 1 ,599261 1 ,389332 1 ,374072 0 ,821537 0 ,286655 0 ,534882
Structure de l'enveloppe Rémunération cautionnements 17,58% 13,51% 11,50% 8,61% 6,89% 0,00% Traitements fixes 7,99% 6,14% 6,97% 7,83% 6,26% 14,98% Commissions sur fisc 13,78% 11,19% 17,71% 33,50% 39,24% 0,00% Intérêts comptes d'avances 3,21% 5,82% 8,39% 7,86% 2,42% 3,92%Remises extra-budgétaire 22,38% 8,83% 10,73% 15,10% 13,20% 23,68% Frais de fonctionnement 35,06% 54,50% 44,71% 27,10% 31,99% 57,41% Sources : Stourm (1912, p. 464), Pinaud (1990, pp. 57 et 60), Fontvieille (1982, p. 39), Toutain (1987, p. 147 et sv.). En gardant en mémoire également que les revenus annuels des agents de change sont de l'ordre de 75 000 à 100 000 francs au début du XXe siècle comme au milieu du XIXe siècle, "avec certes de grosses différences selon les charges"(151) et sachant que ceux-ci doivent les partager avec leurs sous-commanditaires, venons-en maintenant plus directement à l'examen du revenu des receveurs généraux. On ne dispose certes en ce domaine, pour le moment, que d'informations éparses, mais elles suffisent toutefois à éclairer la question. Première information rapportée par P.F. Pinaud : selon un député opposé aux receveurs, en 1829, le receveur de la Côte d'Or et celui de la Saône-et-Loire gagneraient respectivement, sans tenir compte de leurs opérations de banque, 80 000 et 122 000 francs(152). Cette information est à mettre en relation avec celle rapportée par C. Charle selon laquelle soixante six ans plus tard, en 1895, c'est-à-dire après la réforme de 1889, un fonctionnaire anonyme, également hostile, parle de revenus égaux à 100 000 et 150 000 francs pour les Trésoriers Payeurs Généraux, soit deux à trois fois le salaire des ministres(153). Il s'agit peut-être de chiffres exagérés, encore que si l'on admet comme probable que les receveurs, vu le niveau très élevé de leurs revenus officiels, devaient dégager une très forte épargne et accumuler à une grande vitesse, on doit considérer qu'ils disposaient de gros revenus privés et non officiels provenant de valeurs mobilières et de créances hypothécaires et chirographaires. Contentons-nous néanmoins des revenus officiels, et comparons ces témoignages avec les données et estimations des tableaux 2 et 3 dans lesquels nous avons tenté d'approcher les revenus officiels des trésoriers généraux en 1820, 1832, 1850, 1880 et 1913, à partir de quelques "enveloppes" budgétaires les concernant - trouvées chez Stourm (1912) et Pinaud (1990) - et
en utilisant des données de rentrées fiscales - dues à Fontvieille (1976) -. Compte tenu de la forte marge d'incertitude inhérente aux méthodes d'évaluation susceptibles d'être utilisées, nous avons posé dans ces deux tableaux des hypothèses très différentes de calcul (H1, plus forte dans le tableau 2 et H2 plus faible dans le tableau 3), hypothèses qui permettent de mieux mesurer la sensibilité des résultats aux hypothèses retenues(154). En gros, dans le tableau 2, on a d'abord reconstitué le "chiffre d'affaires" des T.P.G. (leur coût total pour les institutions publiques) en 1913 en faisant comme si il n'y avait pas eu de réforme en 1890 et en admettant que ce qu'on a appellé le "taux brut de remise" (rapport de leur chiffre d'affaires aux recettes fiscales totales qu'ils collectent) était le même qu'en 1880. Connaissant, en outre, les frais de fonctionnement en 1913, on a pu alors calculer un pourcentage de ces frais dans le chiffre d'affaires (27,1 %) que l'on a supposé constant sur toute la période antérieure. Selon que, les diverses années sélectionnées, on disposait du chiffre d'affaires ou des frais de fonctionnement, on a pu calculer la donnée manquante à partir de ce pourcentage, et ainsi arriver à une estimation du bénéfice net des trésoriers qui, divisé par 87, donne leur revenu officiel annuel moyen(155). Celui-ci est, en ce cas, de l'ordre de 70 000 à 100 000 francs, soit une évaluation qui, compte tenu de la dispersion sans doute forte entre les trésoreries (il en existe d'ailleurs trois classes avec traitements fixes différenciés à partir de 1865) et vu les revenus des agents de change parisiens que l'on a pu classer comme équivalent à ceux d'un receveur moyen, paraît être une estimation assez satisfaisante. Dans le tableau 3, on a utilisé une autre méthode plus analytique qui consiste à évaluer séparemment les différentes sources de revenu des trésoriers. On a ainsi calculé tout d'abord leur revenu fixe en additionnant leur traitement fixe avec le revenu de leur cautionnement. On a ensuite décomposé leur revenu variable en deux composantes budgétaires, les commissions sur impôts et les intérêts sur avances en compte courant, et une composante extra-budgétaire, les remises accessoires diverses (coupes de bois, emprunts CDC, CFF, villes et établissements de bienfaisance). Pour les commissions fiscales, on a pu calculer le taux en 1880 (0,1 %) et on l'a supposé constant sur toute la période; pour les intérêts sur avances, on a considéré constant le pourcentage de ceux retenus par les trésoriers (21 % environ), pourcentage calculable en 1913 sur le budget simulé sans réforme (ce qui équivaut à un taux des intérêts reçus par les receveurs de 0,8 % environ sur la presque totalité de la période); quant aux remises extra-budgétaires, connues en 1913, on les a considérées comme constituant un pourcentage constant de l'enveloppe budgétaire affectée aux receveurs généraux (24,1 % correspondant à la valeur calculable sur le budget 1913 simulé sans réforme), celle-ci étant elle-même calculée (selon une procédure itérative destinée à la caler sur les enveloppes connues) à partir du revenu des trésoriers et de frais de fonctionnement pris initialement égaux à ceux donnés ou calculés dans le tableau 2. On obtient de la sorte à la fois le revenu proprement budgétaire des receveurs et leur revenu officiel total, par agrégation de leurs diverses composantes. Or si l'estimation est en ce cas sensiblement la même pour 1880, soit 84 000 francs environ, elle est par contre nettement inférieure pour les autres années. Ceci, compte tenu que R. Stourm nous donne directement le revenu moyen effectif en 1913, soit 34 000 francs, pose problème pour les trois années 1820, 1832 et 1850 du premier XIXe siècle, car contrairement à ce qu'on attendrait, le revenu des receveurs serait alors dans la période monarchique presque deux fois plus faible qu'en 1880. C'est sans doute, pour ces années, la valeur du taux hypothétique de commission de 0,1 % sur les recettes fiscales qui est trop bas, ces recettes étant à cette époque environ trois fois plus faibles qu'en 1880 et ayant dû, en conséquence, supporter des commissions plus élevées; le jeu du pourcentage constant de remises extra-budgétaires par rapport à un coût budgétaire lui-même sous-estimé ne fait que renforcer l'écart entre les périodes. Pour obtenir les mêmes
niveaux de revenu que dans le tableau 2, il suffirait de supposer un taux de commission de l'ordre de 0,3 % dans ces années(156). Il ressort donc de ces simulations que les évaluations du tableau 2 concernant les revenus moyens des trésoriers sont les plus plausibles. Néanmoins, en tout état de cause, compte tenu de la dispersion des revenus individuels, l'hypothèse (H2), en dépit de sa faiblesse pour la première moitié du siècle, laisse encore entrevoir la possibilité de revenus officiels considérables pour les recettes les plus rentables. En effet, si l'on considère que la dispersion entre le cautionnement moyen et celui d'une recette parisienne peut aller de 1 à 5, et que l'on applique ce même coefficient de dispersion au revenu, un revenu moyen de 50 000 francs correspond à un revenu à Paris de 250 000 francs. A titre de comparaison, outre la référence déjà faite aux agents de change, on peut rappeller, par exemple, la situation du département de la Manche étudié par A. Guillemin, situation qui, selon cet auteur, n'a guère changé dans le siècle et où parmi les riches nobles, propriétaires fonciers rentiers et grands notables (ceux qui devaient précisément déposer leurs fonds à la recette générale), un seul jouit de presque 100 000 francs de rentes annuelles, un autre de 70 000 francs parmi 17 qui ont plus de 30 000 et 33 plus de 10 000(157). Pour avoir une idée plus actuelle du pouvoir économique de ces revenus des trésoriers, on les a également rapportés dans les tableaux au PIB des années correspondantes, puis réévalués avec une valeur contemporaine de ce PIB, soit 5 000 milliards de francs. Il apparaît alors que les taux de rémunération calculés équivalent à des revenus actualisés mensuels par trésorier compris entre 1.374.000 et 3.283.506 de nos francs actuels; même celui de 1913 qui semble faible au vu de la réduction opérée par rapport à la situation des années 1880, équivaut quand même à 285.000 francs environ par mois et par trésorier (soit 28.5 millions de centimes actuels). Avec ce type d'indicateur, il ressort en outre que, quand bien même le revenu absolu des receveurs généraux serait plus faible dans le premier XIXe siècle que dans le second, leur pouvoir économique pourrait y être considérablement plus fort dans la mesure où leur part dans le produit national brut se maintient à un niveau relatif plus élevé. On est enfin conduit à penser que le coup porté aux T. P. G. par les réformes républicaines du tournant du XXe siècle, s'il est de nature à faire fuir de la profession la grande bourgeoisie d'affaires, surtout dans les trésoreries secondaires, laisse toutefois aux Comptables Supérieurs du Trésor un revenu officiel qui continue de les classer parmi l'élite de la fortune. Et si entre 1865 et 1915, le fait que près de 45 % des 465 trésoriers payeurs généraux nommés ne sont plus issus des Finances (120, soit plus du quart, venant de l'administration préfectorale et un bon nombre des ambassades ou directement de la classe politique) témoigne effectivement d'un changement politique important dans le recrutement, celui-ci montre surtout qu'il y a une certaine réouverture de l'accès à la fonction pour des outsiders, et non pas que la fonction soit elle-même fondamentalement bouleversée dans son statut "d'office" à la manière de l'ancien régime. N'observe-t-on pas d'ailleurs qu'en 1895 encore, nombre de trésoriers continuent de gérer leur "trésorerie comme autrefois les abbés géraient leurs abbayes", ne résidant pas sur place et n'y venant que pour toucher leurs traitements(158). Cela dit, pour situer les trésoriers payeurs généraux dans la société bourgeoise de leur époque, on peut encore chercher à "capitaliser" leurs revenus de façon à estimer ce qu'ils représentent en terme de fortunes. En prenant le taux de rendement de la rente sur l'Etat(159), on obtient dans l'hypothèse H1 un équivalent-capital social passant de plus d'un million environ en 1820 à près de deux millions et demi en 1880; en 1913, après réforme, le capital d'un T. P. G. est encore d'environ un million de francs (cf. tableau 4). Les receveurs généraux avaient donc des revenus de "millionnaires" même après les réformes qui ont amputé leur revenu public. Or, en 1911, on compte dans la France entière seulement 0,1% de successions supérieures à 1 million et qui représentent 28% de la fortune totale
déclarée(160). A la même époque, à Paris, le quart seulement des successions de hauts fonctionnaires et de négociants et industriels - les deux catégories proportionnellement les plus riches de la population - est supérieur au million. Toujours à Paris, entre 1890 et 1914, alors que désormais la profession d'agent de change classe dans "la très haute bourgeoisie", sur les 47 successions d'agent enregistrées dans la capitale dont la valeur moyenne est de 4.2 millions, 14 sont inférieures à un million et 27 (soit 63 %) sont inférieures à trois millions(161). TABLEAU 4 : EVALUATION DU CAPITAL SOCIAL OFFICIEL DES TRÉSORIERS GÉNÉRAUX ANNÉE 1 8 2 0 1 8 3 2 1 8 5 0 1 8 8 0 1 9 1 3 1 9 1 3
(sans réforme) (après réforme)1.Rev. officiel moyen (H2) 48749 44451 47612 83793 97739 341032.Rev. an. par tête (H1) 70656 71217 103542 83784 123632 337933.Taux d'intérêt de la rente 6,65% 4,39% 5,32% 3,56% 3,44% 3,44%Capital 1/3 (millions F) 0,733 1,013 0,895 2,354 2,841 0,991Capital 2/3 (millions F) 1,062 1,622 1,946 2,353 3,594 0,982 On peut donc estimer, sans grand risque de se tromper, et rien que sur la base de leurs revenus officiels de "fonctionnaire", que les receveurs généraux, surtout avant la réforme de leur statut, ont été parmi les plus gros capitalistes de leur époque et ont bénéficié, en conséquence, d'un formidable pouvoir d'accumulation. Comme ils bénéficiaient sans doute également de revenus conséquents d'origine privée ou provenant de titres de la dette publique consolidée, il faut donc considérer comme fortement probable le fait qu'ils aient eu une place très importante dans l'économie du XIXe siècle, à la manière des financiers d'Ancien Régime dans celle des siècles précèdents. Jusqu'aux réformes du tournant du XIXe siècle, ils devaient sans doute constituer une fraction des haut-fonctionnaires dont le niveau de fortune et de revenu égalait, voire même dépassait, celui des grands propriétaires fonciers et de la haute bourgeoisie d'affaires. Il est clair, enfin, que ces réformesont réduit la "valeur" des trésoreries générales en tant qu'investissement profitable, et qu'alors le grand capital financier qui auparavant y prédominait a dû logiquement se désengager du secteur. On doit se demander alors si ces conclusions ne sont pas contradictoires avec ce que nous dit P. F. Pinaud des trésoriers payeurs généraux qui, selon lui, "ne possèdent pas de grosses fortunes mobilières et immobilières (l'échantillon va environ de 30 000 à 800 000F), ni d'importants revenus (environ 10 000 à 35 000 F par an)", "ces fonctionnaires de la bourgeoisie moyenne, notables dans leurs départements" ne pouvant que rêver "d'atteindre à la bourgeoisie d'affaires dont ils ne font pas partie"(162). En fait, tout dépend ici de la date concernée par les "premiers dépouillements" de cet auteur qui lui ont permis d'établir ces résultats. Ceux-ci sont, en effet, compatibles avec les données de R. Stourm si ces dépouillements ont porté sur l'extrême fin de la période, soit l'immédiat avant-guerre pour lequel R. Stourm avance également un revenu de l'ordre de 35.000 francs (encore qu'il s'agisse chez lui d'un revenu moyen et non d'un revenu maximum). Les conclusions de P. F. Pinaud sur l'évolution de la profession auraient donc alors seulement anticipé sur un avenir plus tardif, comme en témoignent, par ailleurs, non seulement l'évaluation du revenu moyen des T.P.G. pour 1880 qui, quant à elle découle quasi-directement des données de R. Stourm(163), mais aussi le fait que nombre de T.P.G. de l'ancienne génération finissent leur carrière seulement dans les années 1880(164). III. Conclusion. Au terme de cette analyse du système fiscal du XIXe siècle, ce qui ressort, c'est que seule une partie du procès "technique" de prélèvement, celle ayant trait au travail fiscal d'assiette,
et peut être une partie du travail de recouvrement, a été véritablement étatisée, mise en administration directe. Dès qu'il s'est agi de convertir les assiettes fiscales en prélèvements véritables, de transformer les effets à recouvrer en argent sonnant et trébuchant, de centraliser cet argent et de l'appliquer aux dépenses, on a encore fait appel à des "financiers". Ces capitalistes prennent le risque personnel du recouvrement et, en contrepartie, on leur concède le monopole étatique de la fiscalité afin que la confusion de leur intérêt personnel et de l'intérêt du Trésor les incite à gérer au mieux la dette flottante. Certes, il y a également une "modernisation" du système de recouvrement. Le nouveau système des banquiers-fonctionnaires est plus concentré, plus rationalisé. Peut-être également les taux de remise concédés aux financiers sont-ils plus faibles qu'auparavant, l'administration de l'Etat tolérant des activités financières non officielles (ou plutôt officiellement non reconnues comme liées à leurs activités officielles) qui font que les receveurs généraux sont moins exigeants sur les remises. Mais la "modernisation" apparaît tout de même quelque peu tardive, comme le montre l'ampleur de l'économie réalisée lors de la réforme de 1890. La véritable innovation sociale de la révolution ne réside donc ni dans la centralisation, ni dans une bureaucratisation qui aurait permis de faire l'économie d'un capitalisme financier public au profit "privatisé". D'un côté, en effet, la centralisation s'inscrit dans une tendance lourde de l'Etat territorial national et obéit à un processus technocratique endogène au système administratif et relativement indépendant de la configuration exacte des rapports sociaux; de l'autre, l'amélioration des procédures de contrôle du recouvrement n'empêche pas le maintien en place de la finance d'Ancien Régime. L'innovation essentielle appellée à modifier le fonctionnement de l'Etat de finance et apportée d'ailleurs par la Monarchie constitutionnelle sous la Restauration, c'est l'institutionnalisation dans la longue durée du parlementarisme par lequel se réalise le programme politique de l'aristocratie foncière reconstituée et élargie à la bourgeoisie la plus nantie, acquisitrice de biens nationaux. Le changement fisco-financier décisif est là, dans ce nouveau régime d'existence de la société dans l'Etat, dans cette "monarchie des propriétaires" à l'anglaise où, pour les élites unifiées de la noblesse et du tiers état, la fin du privilège fiscal va de pair avec un nouveau mode de vie politique et de contrôle des finances publiques. Mais cette transformation n'implique nullement, finalement, la nationalisation complète des finances comme le montre la portée des changements survenus dans le procès de prélèvement fiscal qu'on considère, en général, à tort comme ayant libéré l'Etat de l'emprise du capitalisme financier traditionnel. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ARDANT Gabriel 1971 et 1972, Histoire de l'impôt, Livres I et II, Paris, Fayard. ARISTIDE 1990, La fortune de Sully, Paris, Imprimerie Nationale. ASSELAIN Jean-Charles 1989, "Continuités, traumatismes, mutations", Revue Économique, pp. 1137-1188, Vol. 40, n° 6, novembre, Paris, FNSP. BAYARD Francoise 1987, Le monde des financiers, Paris, Flammarion. BERGIN Joseph 1987, Pouvoir et fortune de Richelieu, Paris, Hachette-Pluriel. BLOCH-LAINÉ Francois et DE VOGUE Pierre 1960, Le Trésor Public et le mouvement général des fonds, Paris, P.U.F. BOSHER F. 1970, French Finance 1770-1795. From business to bureaucracy, Cambridge University Press. BOUVIER Jean 1972, "Le système fiscal français du XIXe siècle. Etude critique d'un immobilisme", Finances publiques d'Ancien Régime, finances publiques contemporaines, «Pro civitate», pp. 41-82, reproduit in SCHNERB 1973, pp. 226-262.
BOUVIER J. 1979, "L'extension des réseaux de circulation de la monnaie et de l'épargne. Système bancaire et marchés de l'argent", in BRAUDEL et LABROUSSE (1970 à 1982), tome 4, premier volume 1880-1914, pp. 161-198. BOUVIER J. 1980, "Monnaie et Banque d'un après-guerre à l'autre : 1919-1945", in BRAUDEL et LABROUSSE (1970 à 1982), tome 4, second volume 1914-années 1950, pp. 687-728. BOUVIER Jean et GERMAIN-MARTIN Henri 1969, Finances et financiers de l'Ancien Régime, Paris, PUF. BRAUDEL Fernand 1979, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe - XVIIIe, 3 tomes, Paris, Armand Colin. BRAUDEL Fernand et LABROUSSE Ernest 1970 à 1982, Histoire économique et sociale de la France, 4 tomes, 8 volumes, Paris, P. U. F. BRUGUIÈRE M. 1969, La première Restauration et son budget, Genève, Droz. BRUGUIÈRE M. 1975, "Histoire financière et histoire administrative", in INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ADMINISTRATIVES 1975, pp. 37-44. BRUGUIÈRE M. 1986, Gestionnaires et profiteurs de la Révolution, Paris, Olivier Orban. BRUGUIÈRE M. 1987, "L'administration des finances de Louis XVI à Bonaparte : ruptures et continuité", Servir l'État, pp. 161-185, Paris, Editions de l'école des Hautes Études en Sciences Sociales. BRUGUIÈRE M. 1989a, "Les receveurs généraux de Louis XVI : fossiles ou précurseurs ?", Études & Documents, tome I, pp. 99-120, Paris, Imprimerie Nationale. BRUGUIÈRE M. 1989b, "Révolution et finances. Réflexions sur un impossible bilan", Revue Économique, pp. 985-1000, Vol. 40, n° 6, novembre, Paris, FNSP. CARON Francois 1981, Histoire économique de la France XIXe - XXe siècles, Paris, Armand Colin. CHARLE C. 1980, Les hauts fonctionnaires en France au XIXe siècle, Paris, Archives Gallimard-Julliard. CHARLE C. 1982, "Naissance d'un grand corps. L'inspection des finances à la fin du 19e siècle", Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 42, avril, pp. 3-17, Paris, Minuit. CHARLE C. 1987, Les élites de la République, 1880-1900, Paris, Fayard. CLAMAGÉRAN Jean-Jacques 1867, Histoire de l'impôt en France, 3 tomes, Paris, Guillaumin. DAUMARD Adelyne 1976a, "L'Etat libéral et le libéralisme économique" in BRAUDEL et LABROUSSE (1970 à 1982), tome 3 1789-1880, premier volume, pp. 137-160. DAUMARD Adelyne 1976b, "Caractères de la société bourgeoise" in BRAUDEL et LABROUSSE (1970 à 1982), tome 3 1789-1880, second volume, pp. 829-844. DAUMARD Adelyne 1976c, "La hiérarchie des biens et des positions" in BRAUDEL et LABROUSSE (1970 à 1982), tome 3 1789-1880, second volume, pp. 845-896. DAUMARD Adelyne 1980a, "Puissance et inquiétude de la société bourgeoise", in BRAUDEL et LABROUSSE (1970 à 1982 ), tome 4, premier volume 1880-1914, pp. 401-453. DESSERT Daniel 1985, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris, Fayard,. FONTVIEILLE Louis 1976, "Evolution et croissance de l'Etat français : 1815-1969", Cahiers de l'I.S.M.E.A. , tome X, n° 9 à 12 (AF 13), Paris, ISMEA. FONTVIEILLE Louis 1982, "Evolution et croissance de l'Administration départementale française : 1815-1974", Cahiers de l'I.S.M.E.A., tome XVI, n° 1-2 (AF 14), Paris, ISMEA. FURET Francois 1974, "Le quantitatif en histoire", Faire de l'histoire, Le Goff J. et Nora P. éd., tome 1, pp. 42-61, Paris, Gallimard. FURET Francois 1978, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard. GILLE B. 1959, La banque et le crédit en France de 1815 à 1848, Paris, P.U.F.
GILLE B. 1970, La banque française au XIXe siècle, Genève, Droz. GUÉRY A. 1978, "Les finances de la Monarchie française sous l'Ancien Régime", Annales E. S. C., n° 2, mars-avril, pp. 216-239, Paris, Armand Colin. GUILLEMIN A. 1982, "Aristocrates, propriétaires et diplômés. La lutte pour le pouvoir local dans le département de la Manche 1830-1875", Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 42, avril, pp. 33-60, Paris, Minuit. INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ADMINISTRATIVES 1975, Histoire de l'administration française depuis 1800. Problèmes et méthodes, Genève, Droz. JEZE Gaston 1931, Cours de finances publiques, Paris, Marcel Giard. LALUMIÈRE Pierre 1973, Les finances publiques, 2 ème édition, Paris, Armand Colin. LEGENDRE Pierre 1975, Histoire de l'administration de 1750 à nos jours, Thémis, Paris, PUF. MARION Marcel 1928, "1819-1875. Les gouvernements de suffrage restreint et les gouvernements de suffrage universel à tendances conservatrices", Histoire financière de la France depuis 1715, tome V, Paris, Rousseau et Cie Editeurs. MARION Marcel 1931, "1876-1914. La troisième République jusqu'à la guerre", Histoire financière de la France depuis 1715, tome VI, Paris, Rousseau et Cie éditeurs. MASSALOUX J.P. 1989, La régie de l'enregistrement et des domaines au XVIIIe et au XIXe siècles, Genève, Droz. MATHIAS Peter et O'BRIEN PATRICK (1976), "Taxation in Britain and France 1715-1810. A comparaison of the social and economic incidence of taxes collected for the central governments", The Journal of European Economic History , vol. 5, n° 3, pp. 601-650, Rome. MAYER Arno 1983, La persistance de l'Ancien Régime. L'Europe de 1848 à la Grande Guerre, Paris, Flammarion. MAYEUR Jean-Marie 1973, Les débuts de la Troisième République , Paris, Seuil. MERINO J.-P. 1989, "L'affaire des piastres et la crise de 1805", Études & Documents, tome I, pp. 121-126, Paris, Imprimerie Nationale. MICHALET Charles-Albert 1968, Les placements des épargnants français de 1815 à nos jours, Paris, P.U.F. MORINEAU Michel 1980, "Budgets de l'Etat et gestion des finances royales en France au dix-huitième siècle", Revue Historique, n° 536, pp. 289-336, Paris, PUF. NEURISSE André 1978, Histoire de l'impôt, Paris, P.U.F. PERNOUD Régine 1981, Histoire de la bourgeoisie française, 2 tomes, Paris, Seuil. PONTEIL Felix 1968, Les classes bourgeoises et l'avènement de la démocratie, Paris, Albin Michel. PINAUD P.F. 1982a, "Le service de la trésorerie de 1790 à 1865 : les payeurs généraux", La Revue du Trésor, juin, pp. 319-328, Paris, Ministère de l'économie et des finances. PINAUD P.F. 1982b, "Le ministère du trésor public pendant le Consulat et l'Empire", La Revue du Trésor, octobre, pp. 550-560, Paris, Ministère de l'économie et des finances. PINAUD P.F. 1983, Les Trésoriers Payeurs généraux au XIXe siècle, Paris, Les Editions de l'Érudit. PINAUD P.F. 1986, "Finances et noblesse au XIXe siècle", La Revue du Trésor, août-septembre, pp. 482-489, Paris, Ministère de l'économie et des finances. PINAUD P.F. 1990, Les receveurs généraux des Finances, 1790-1865, Genève, Droz. PLESSIS A. 1989, "La Révolution et les banques en France : de la Caisse d'escompte à la Banque de France", Revue Économique, Vol. 40, n° 6, pp. 1001-1014, Paris FNSP. SAINT MARC Michèle 1983, Histoire monétaire de la France 1800-1980, Paris, P.U.F. SAUVY Alfred 1984, Histoire économique de la France entre les deux guerres, 3 volumes, Paris, Economica.
SCHNERB Robert 1938, "Technique fiscale et partis pris sociaux. L'impôt foncier en France depuis la Révolution", Annales d'Histoire économique et sociale, pp. 116-137, reproduit in SCHNERB 1973, pp. 79-104. SCHNERB Robert 1973, Deux siècles de fiscalité française XIXe - XXe siècle, (sous la direction de J. Bouvier et J. Wolff), Paris - La Haye, Mouton. SOBOUL Albert 1976, "La Révolution française" in BRAUDEL et LABROUSSE 1970 à 1982, tome 3 1789-1880, premier volume, pp 4-135. STOURM R. 1912, Le Budget, Paris, Felix Alcan. SUSSEL P. 1968, "La Restauration", Encyclopédie Universalis , volume 14, pp. 174-178, Paris. THERET B. 1989, Régimes économiques de l'Ordre Politique, Thèse d'Etat, Université Paris I. THERET B. 1990, Croissance et Crises de l'État : essai sur l'économie de l'Etat français de l'Ancien Régime à la Grande Transformation des années mil neuf cent trente, Paris, Éditions de l'IRIS. THERET B. 1991, "Apogée et déclin du rentier de la dette publique", Œconomia (à paraître). TOUTAIN Jean-Claude 1987, Le produit intérieur brut de la France de 1789 à 1982, Economies et Sociétés, tome XXI, n°5 (série AF n° 15), Paris, ISMEA. VERLEY P. 1989, "Les sociétés d'agents de change parisiens au XIXe siècle", Études et Documents, tome I, pp. 127-147, Paris, Imprimerie Nationale. WALLERSTEIN Immanuel 1980, Capitalisme et Économie-monde 1450-1640 , (tome 1 de Le système du monde du XVe siècle à nos jours), Paris, Flammarion. NOTES (1) Asselain 1989, p. 1153. (2) Cf. Bruguière (1986, 1987, 1989a et 1989b) et Pinaud (1982a, 1983, 1986 et 1990). Voir également Massaloux 1989. (3) Bruguière 1987, p. 161. (4) Comme en témoigne, par exemple, le fait que, bien que "l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines a(it) été fondée par la Ferme Générale", "aujourdhui, très peu de personnes s'en souviennent. Alors que naguère encore, les agents appartenant à cette administration tiraient vanité de l'ancienneté des méthodes de travail et des usages qu'ils s'appliquaient à conserver, tous croyaient que leurs devanciers les plus lointains avaient pris leurs fonctions à l'époque du Directoire ou sous le Premier Empire. Cette étrange disparition des souvenirs collectifs dans un corps imbu de ses traditions et possédant le culte du passé, s'explique par les lacunes de l'enseignement qui fut dispensé aux agents durant le XIXe siècle. (…) La formation professionnelle des receveurs relevait principalement de l'étude des dispositions de la loi du 22 frimaire an VII dont nul ne contestait les mérites et la noble ordonnance. Les ouvrages mis à la disposition des surnuméraires laissaient d'ailleurs dans l'ombre toute la législation de l'enregistrement antérieure à cette loi. Au surplus il est probable que les agents chargés de l'instruction de leurs jeunes collègues, après la Révolution, ne furent pas incités à se présenter comme les continuateurs des préposés des Fermiers Généraux, en raison de la détestable réputation faite à ces financiers et à leurs commis. Aussi, aux yeux de tous ceux qui reçurent cet enseignement, les institutions domaniales de l'Ancien Régime paraissent formées d'un fatras de coutumes incohérentes et, les bureaux du contrôle, des lieux envahis par les brumes du passé où s'exécutaient d'obscures besognes au seul bénéfice de personnages méprisables" (Massaloux 1989, p. 377).
(5) Bruguière 1975, p. 38. (6) Asselain 1989, p. 1152 (c'est nous qui soulignons). (7) Cf. Dessert 1985, Bayard 1987, Bergin 1987, Aristide 1990. (8) A l'inverse, on ne peut que regretter que chez ceux qui étudient le monde des élites, il ne soit nulle part question de ces personnages. Il en est ainsi, par exemple, dans l'ouvrage de C. Charle sur les hauts fonctionnaires au XIXe siècle dans lequel on ne trouve guère trace de nos financiers, excepté dans un paragraphe intitulé Persistance des privilèges dans lequel est reproduit un court extrait d'article de journal publié en 1895 et dans lequel un fonctionnaire des finances dénonce anonymement pèle-mèle l'arbitraire de leur mode de nomination, leur incapacité administrative, le niveau et le mode de leur rémunération (1980, p. 60). De même, cet auteur, lorsqu'il s'intéresse à l'Inspection des Finances (1982), n'accorde que très peu d'importance au fait qu'il s'agit à l'origine d'un corps de financiers (dans les années 1815-1875, 18 % des inspecteurs deviennent receveurs généraux et ils représentent près de 8 % de l'ensemble de ceux-ci) et les traite à la manière de n'importe quel autre corps de fonctionnaires. (9) Bruguière 1987, p. 182. (10) Bruguière in "Préface" à Pinaud 1990, p.4. (11) Pinaud 1990, pp. 71-72. (12) Respectivement Pinaud (1983, p. 12) et Pinaud (1986, p. 488). (13) Pinaud 1990, p. 6. (14) Pour notre part, ces soupçons sont nés à la lecture de Stourm 1912. (15) Cf. Théret 1989 et 1990. (16) Mayer 1983, p. 12. (17) Furet 1974, p. (18) Ardant 1972, p. 259. (19) Bruguière 1975, p. 37. (20) Cité par Bouvier 1972, p. 228. (21) Sussel 1968, p. 174. (22) Sous la Restauration, 80 % des 110 000 électeurs (27 pour 10 000 habitants) sont des propriétaires fonciers, la moitié des députés sont nobles, 40 % d'entre eux propriétaires fonciers; près de 40 % encore sont des fonctionnaires (Sussel 1968). (23) Lalumière 1973. (24) Propos du Comte Roy, un des plus gros rentiers de la dette publique sous la Restauration avant qu'il ne change d'avis en devenant lui-même ministre des finances de ce régime. (25) Ardant 1972, p. 269. (26) Schnerb 1938, p. 80. (27) Guéry 1978. M. Morineau (1980, pp. 290-301) a décrit cette "procédure budgétaire" d'Ancien Régime, montrant l'existence "d'états de prévoyance" et "d'états effectifs en fin d'année" qui traduisaient le souci des contrôleurs généraux des finances de suréquilibrer le budget ordinaire afin de financer partiellement l'extraordinaire et de faire un bilan annuel des finances publiques. Ces documents budgétaires étaient soumis à l'approbation royale qui, par là, autorisait prélèvements et dépenses comme le firent ensuite les Parlements. Les problèmes budgétaires de l'ancienne monarchie n'étaient donc pas liés à l'inexistence d'un budget mais essentiellement au non respect des prévisions et au fait que des "reliquats de rentrées presque vénérables télescopaient des anticipations sur deux à trois ans" problèmes qui étaient eux-même dus à la situation de guerre quasi-permanente et à ses reliquats sous forme de dette publique. Dès que la bourgeoisie libérale fut confrontée à une situation du même ordre, elle ne fit guère mieux d'ailleurs en la matière que la monarchie absolue. (28) Lalumière 1973, p. 56.
(29) Ibid, p. 68 (30) Ibid, p. 79 (31) Ibid, p. 427. (32) Cf. Théret 1991. (33) Bloch-Lainé et de Vogüé 1960. (34) Legendre 1975, p. 361. (35) Cf. infra encadré 1 dans lequel est récapitulée l'évolution institutionnelle de la recette générale. (36) Bloch-Lainé et de Vogüé 1960. (37) Legendre 1975. (38) Furet 1978. (39) Ce qui est un élément de la déchéance de l'Empereur promulguée par le Sénat et justifiée en "considérant que Napoléon a déchiré le pacte qui l'unissait au peuple français, en établissant des taxes autrement qu'en vertu d'une loi, contre la teneur expresse d'un serment qu'il avait prêté lors de son avènement au trône. Qu'il a commis cet attentat aux droits du peuple, lors même qu'il venait d'ajourner sans nécessité le corps législatif" (Ardant 1972, p. 264-265). (40) Stourm 1912, p. (41) Ibid. Il s'agit successivement des vingt Négociants réunis de 1799, des Dix Négociants et des Cinq Banquiers du Trésor public de 1801, de l'Agence des receveurs Généraux de 1802 et de la compagnie des Négociants Réunis de 1804 (Bruguière 1987, p. 180). (42) Cf. Mérino 1989. (43) Stourm 1912, p. 454. (44) Il subsiste une équivoque quant à la date d'institution du système "définitif " du «compte à intérêts réciproques» dans lequel les bonifications positives sont complétées par des débits d'intérêt pour toute somme perçue et non mise immédiatement à disposition de la Caisse du Trésor. Contrairement à Bruguière (1987 et 1989) et à Stourm (1912) qui considèrent que cette "invention" date d'emblée de 1806, il ressort de Pinaud 1990 (pp. 47-48 et 57-58) que le système ne serait définitivement mis au point qu'en 1820. (45) Cf. Bruguière 1987, p. 181 et 1989, p. 120. (46) Bruguière 1987, p. 181. (47) Ces schémas qui décrivent le déploiement organisationnel et hiérarchique respectivement des deux premières et des trois dernières de ces régies ont été construits essentiellement à partir de Stourm1912. Celui-ci en dressant en quelque sorte un constat en 1912 s'avère, en effet, être une source précieuse (et largement inexploitée) pour compléter les travaux contemporains de Bruguière et Pinaud plutôt orientés sur le premier XIXe siècle. (48) Stourm note que le ministre des finances ne fait que déléguer aux administrations financières une partie de ses pouvoirs, sans cesser de demeurer leur chef. En matière de personnel, la partie des pouvoirs qu'il délègue est très exactement définie. Pour les affaires, (…) la limite semble moins bien tracée, sur le papier tout au moins, car dans la pratique, la règle toujours observée est de recourir à l'autorité supérieure …" (c'est nous qui soulignons). (49) "Comment l'administration supérieure s'assure-t-elle, à son tour, que les receveurs remplissent scrupuleusement ces délicates et essentielles obligations de surveillance générales ? Comment parvient-elle à suivre l'emploi véridique du temps de ces milliers d'agents disséminés dans les campagnes, que leur éloignement risque de rendre trop indépendants ? La vieille régie, aidée des traditions de la ferme générale, a superposé, dans ce but, les plus ingénieux contrôles" (Stourm 1912, p. 409). Cf. également J. P. Massaloux qui a récemment rappellé en détail tout ce que doit à la Ferme Générale la Régie de l'Enregistrement et des Domaines instituée en 1791 pour succéder à l'Administration
Générale des domaines et droits domaniaux, régie intéressée séparée de la Ferme Générale avec la Régie des Aides en 1780 (1989, p. 72 et sv.). (50) M. Bruguière, Préface à Massaloux 1989, p. VII. (51) Jèze 1931, p. 520. Cet auteur note néanmoins qu'en 1931, date de son ouvrage, "le nombre des communes où existe la ferme de l'octroi est assez faible". (52) Il semble néanmoins que dans la mesure où comme les receveurs de l'enregistrement, ils sont les héritiers de la Ferme Générale et de la Régie Générale des Aides qui, avec l'Administration Générale des Domaines et Droits Domaniaux, lui a pour partie succédée en 1780, on puisse considérer comme logique qu'ils aient eux-aussi continué à être rémunérés par des remises. Ce serait tout à fait cohérent avec le fait que l'ensemble de l'organisation du travail de prélèvement reste celui du XVIIe siècle comme en témoigne, par exemple, la place importante encore dévolue aux surnuméraires non rémunérés et aux commis n'appartenant pas aux régies et rémunérés par leurs agents. (53) Encore que les directeurs des contributions directes ne soient pas exactement dans la même situation que leurs collègues des autres régies, leurs traitements fixes - situés entre 7.000 et 10.000 francs au lieu de 8.000 à 12.000 vers 1912 - étant plus faibles et compensés par "des remises proportionnelles allouées par les départements et les communes pour la confection et la transcription des rôles" des centimes additionnels locaux (Stourm 1912, p. 392). (54) Stourm 1912, p. 393. Cf. également Neurisse 1978, p. 98. (55) Cet engagement du collecteur sur ses propres deniers conduit les percepteurs à vérifier la bonne qualité des rôles, ces effets qu'ils s'engagent moyennant remise à recouvrer. Ainsi leur premier travail consiste à établir un état des cotes indûment imposées, puis au cours de la première année de recouvrement un état des cotes irrecouvrables, qui donnent lieu éventuellement à des ordonnances de décharge par le conseil de préfecture. "Une fois ces deux sortes d'ordonnances délivrées, et les rôles rectifiés en conséquence, s'il reste un arriéré, le percepteur le couvrira de ses propres deniers. En effet, à l'expiration de la troisième année depuis l'ouverture de l'exercice, les percepteurs versent spontanément dans leurs caisses, de leurs fonds personnels, la portion des rôles qui n'a pas été apurée. A cette époque, un état nominatif des restes à recouvrer est dressé, en vertu duquel le percepteur, bien que devenu créancier personnel des contribuables retardataires, conserve contre eux, à son profit, les privilèges du Trésor" (Stourm 1912, p. 398). Les percepteurs - ou plutôt en fait l'ensemble financier qui va de ceux-ci jusqu'au receveur général du département, forment en quelque sorte une compagnie d'assurance prémunissant l'Etat contre le risque de non recouvrement selon le même modèle que celui qui prévalait sous la monarchie absolue. Notons à ce propos que Stourm, après avoir indiqué que les retards à payer et les frais de poursuite étaient faibles, remarque qu'il "faut bien reconnaître que si la diminution de l'aisance publique, ou certaines défaillances des bonnes habitudes actuelles, ou quelque grande crise surtout, venaient à ralentir, d'une manière grave, la marche des rentrées, les receveurs ne pourraient guère continuer comme aujourdhui à désintéresser le Trésor de toute perte, de leurs propres deniers. Tout au moins, exigeraient-ils d'amples indemnités pour couvrir de tels risques, ainsi que cela se passait au début du siècle. De sorte que, précisément au moment où la garantie des agents de la perception deviendrait particulièrement utile et efficace, on la verrait s'évanouir" (ibid, p. 399). N'est-ce point là reconnaître une fragilité du système en cas de crise en tous points identique à celle que l'on a pu observer sous l'Ancien Régime ? (56) Daumard 1976b, p. 833. (57) Pinaud 1983 et 1990. (58) Pinaud 1983, p. 14.
(59) "Chaque percepteur recouvre en moyenne 180.000 francs de contributions directes sur le montant desquelles sont calculées les remises qui constituent ses émoluments" (Stourm 1912, p. 394). (60) Stourm 1912, p. 428. En ce qui concerne les contributions indirectes et les douanes, on manque d'informations, on l'a dit, sur le mode de rémunération de leurs divers contrôleurs, receveurs particuliers "sédentaires" ou "ambulants". On sait seulement, d'une part, que les receveurs buralistes ne sont pas fonctionnaires et sont rémunérés par une remise (environ 3% calculable à partir de Stourm 1912, p. 403 : soit 5 millions sur 180), d'autre part, que ce sont souvent également des commercants à compter parmi les 48.000 détaillants en tabacs, poudres, puis allumettes, rémunérés, quant à eux, par un taux de remise d'environ 9% (Cf. Stourm 1912, p. 405 : en 1910, 43 millions de remise sur les tabacs pour 497 millions de ventes). (61) Massaloux 1989, pp. 371-373. (62) "Au début du XXe siècle et comme autrefois, les commis travaillant dans les directions, les conservations des hypothèques et les bureaux de l'Enregistrement sont rétribués par les agents responsables du fonctionnement de ces services. Ils ne font pas partie du personnel de la Direction Générale" (Massaloux 1989, p. 369). (63) Il ne nous donne pas, en outre, d'informations sur les conservateurs des hypothèques, de même qu'il oublie pour le début du siècle, comme l'a remarqué M. Bruguière dans la préface de son livre, "d'insister sur les enrichissements dont bénéficièrent nombre d'agents de l'enregistrement, particulièrement bien plaçés pour acquérir à bon prix des domaines nationaux spéculatifs" (p. VIII). (64) Cf. Charle 1980. (65) Massaloux 1989, p. 221-222. (66) Massaloux 1989, pp. 331-332 (67) Pour l'enregistrement, on a divisé les 1189 millions de recettes figurant au budget de 1913 par 3500 (effectif du cadre principal de la Régie en 1900) soit un nombre correspondant aux 2800 receveurs de l'enregistrement donnés par Stourm pour 1913, aux 400 conservateurs des hypothèques donnés par Massaloux pour 1900, et à un effectif de 300 agents supplémentaires pour tenir compte de la vente des timbres. (68) Cf. Massaloux 1989, p. 332, note 47. (69) Charle 1980, pp. 17 et 21-22. (70) Ibid. (71) Rapportée également par Charle 1980, p. 216-217. (72) Il s'agit sans doute néanmoins d'un poste de receveur particulier des finances, soit le poste hiérarchique immédiatement supérieur à celui de percepteur. Toutefois, il apparaît clairement au vu des carrières suivies par certains receveurs que certaines perceptions, notamment à Paris, rapportaient plus que certaines recettes particulières, certains receveurs particuliers n'hésitant pas à rétrograder dans la hiérarchie des fonctions pour grimper dans la hiérarchie financière en accédant à ces perceptions (cf. Pinaud 1983 et 1990). (73) Il y a deux niveaux de sous-traitance, puisque les receveurs des autres régies financières ne dépendent pas de l'autorité hiérarchique du trésorier général. Ceux-ci apportent bien leurs recettes aux guichets des receveurs particuliers des finances, mais le trésorier général n'est pas responsable de "la qualité de leur travail de recouvrement" et de leur rendement, l'ancienne structure séparée entre commission, ferme et office étant maintenue à ce niveau du procès de prélèvement. Notons au passage que ceci n'est possible que dans la mesure où l'impôt indirect est de quotité, et qu'en conséquence, le trésorier général ne prend pas de risque sur un montant donné de prélèvement à recouvrer comme dans le cas de l'impôt direct. Par contre, receveurs particuliers des finances et percepteurs ne sont, à des degrés
divers, que "des préposés du trésorier général" qui dispose des fonds reçus par ceux-ci et en est seul responsable devant le ministre et la Cour des Comptes. (74) D'après Stourm 1912, p. 386, 400-401, 419 et 428. Ces données du budget de 1913 recoupent bien celles de Fontvieille (1976, p. 1955) pour les recettes de 1912, soit 1361 millions pour les impôts de consommation (contributions indirectes et monopoles), 685 millions de droits de douanes et un total pour l'Etat de 3797 millions (3865 chez Stourm). (75) Clamagéran 1867, tome 1, p. LXVI. (76) Cf. Clamagéran 1867 (tome 1, pp. LXV et LXVI), Mathias et O'Brien 1976 (pp. 645-646), Massaloux 1989 (pp. 64-65 et 76-78). (77) Encore qu'en ce domaine, c'est peut-être simplement le développement du chiffre d'affaires dû à l'extension du timbre qui a été le facteur le plus important de l'accroissement du rendement. On peut cependant considérer que la loi du 22 frimaire an VII (12 décembre 1798) qui a modernisé en le simplifiant le système des droits domaniaux n'a pas été indûment considéré comme "un modèle de perfection" et qu'elle a réellement entrainé par la rationalisation de la législation qu'elle a mise en place (meilleure clarté, élimination des exceptions et suppression des privilèges) une amélioration du rendement de l'impôt, ce qui expliquerait sa longévité tout à fait exceptionnelle (Massaloux 1989, p. 316-317, Ardant 1972, p. 173-174). (78) Il est frappant à ce titre de constater que lorsque Necker a créé la régie intéressée de "l'Administration Générale des Domaines et Droits domaniaux", conjointement à la "Régie Générale des Aides", par démembrement de la Ferme Générale, il n'y a pas eu non plus de réduction sensible du coût du prélèvement alors même que cette restructuration peut être considérée comme une "modernisation" prérévolutionnaire annonçant les réformes ultérieures. Sans doute faut-il voir là déjà l'effet du fait que l'autonomie de gestion ainsi acquise s'accompagnait d'un maintien des mêmes méthodes de travail et d'organisation ainsi que de l'utilisation du même personnel et de la même infrastructure (cf. sur ce point Massaloux 1989, pp. 72 et sv.). (79) Jéze 1931, p. 520. (80) On le voit néanmoins réapparaître épisodiquement dans les périodes de crise, comme, par exemple, après la Révolution avec les spéculateurs du Directoire et les faiseurs de services de l'Empire (Bruguière 1986). (81) "Les financiers d'Ancien Régime sont morts" (Bouvier et Germain-Martin 1969, p. 120). Ces auteurs néanmoins considéraient que "«l'industrie» de la finance n'est (…) pas morte avec la finance d'Ancien Régime. Elle a pris des formes nouvelles dans un contexte désormais nouveau, celui de l'époque du capitalisme développé". Et ils mettaient alors en avant le rôle désormais déterminant dans cette finance de la Haute Banque tenant la Banque de France, en admettant implicitement qu'il y a eu du côté fiscal «nationalisation» complète. (82) Legendre 1975, Massaloux 1989. Rappellons, à ce propos, que la rationalisation pré-révolutionnaire de la finance a touché également d'autres secteurs comme, par exemple, celui des trésoriers de la guerre et de la marine. Ainsi la banqueroute en 1788 du Trésorier général de la Marine qui suit la guerre d'indépendance américaine conduit à "la suppression de l'institution dans le cadre de la réforme d'ensemble du Trésor" de la même année (Bouvier et Germain-Martin 1969). (83) La pratique des avances rémunérant les comptables de cette régie ne réapparaît, en effet, que brièvement jusqu'en 1806, date de la réforme qui fixe les nouveaux rapports entre l'Etat et ses receveurs généraux. Il s'agissait de "bons à vue" émis après recouvrement des droits et qui permettaient aux comptables de profiter des délais de jouissance qui leur étaient laissés entre la date de l'émission et celle du paiement (Stourm 1912). (84) Pinaud 1990, p. 42. (85) Ibid, p. 43.
(86) La valeur globale du cautionnement des receveurs généraux aurait été dans toute la première moitié du siècle de 28 à 30 millions de francs (Stourm 1912, p. 458, Pinaud 1990, p. 67), soit, pour 87 trésoriers, entre 322 000 et 345 000 francs environ par trésorier, l'équivalent d'une bonne fortune au décès. (87) Stourm 1912, p. 455-456. (88) Ainsi, G. Jèze (1931) qui pourtant considère par ailleurs qu'elle est une pure affaire d'Etat, note que "pour le Trésor, la régie est la voie la plus économique, car le régisseur doit non seulement payer la somme stipulée, les gages de ses agents, mais encore retirer un certain profit proportionné aux avances qu'il fait, aux risques qu'il court, à la peine qu'il a, aux connaissances et à l'habileté nécessaires pour manier une affaire compliquée". (89) Pour plus de détail, cf. l'échéancier détaillé des modifications dans l'encadré 1. (90) "Les anciennes attributions des receveurs et payeurs se concentrèrent donc dans les mains des nouveaux titulaires, sans autre transformation, et le marquis d'Audiffret put voir avec une certaine fierté, qu'il ne dissimule pas d'ailleurs, son oeuvre traverser presqu'intacte plus de trois quarts de siècle" (Stourm 1912, p. 457). Or on ne compte que huit payeurs généraux qui accèdent à la nouvelle fonction en 1865, la plupart des postes étant occupés par les anciens receveurs généraux (Pinaud 1983), ceci traduisant simplement le fait que "contre toute attente", ce sont les postes de payeurs qui ont été supprimés et non ceux de receveurs (cf. Pinaud 1990, p. 68). (91) Stourm 1912, p. 464. Cf. également infra tableau 2. (92) Bouvier et Germain-Martin 1969. (93) Plessis 1989, p. 1002. (94) Plessis 1989, p. 1003. (95) Plessis 1989, p. 1004. (96) "A partir de la Restauration, les receveurs étaient contrôlés par les députés, qui, au nom, d'une certaine rigueur budgétaire, trouvaient les frais de trésorerie trop élevés. Ce fut l'un des perpétuels motifs des attaques parlementaires. Un autre motif, celui-là inavoué, de cette lutte, est que beaucoup de députés étaient aussi des banquiers. Ils voyaient dans les receveurs généraux des concurrents directs et puissants" (Pinaud 1990, p. 10). (97) Cela commence au cours de la Monarchie de Juillet lorsque la Banque de France élargit son réseau provincial en reprenant comme succursales les banques départementales, puis s'accentue sous le Second Empire avec la création des grandes banques dans les années 1860. En 1816, par contre, lorqu'ils sont autorisés à prendre en dépôt des fonds particuliers, "les receveurs généraux devenaient les seuls banquiers à disposer sur l'ensemble du territoire, de guichets qui leur permettaient de pourvoir aux mouvements de fonds. Leurs activités étaient fortifiées dans la mesure où ni la Banque de France, et encore moins les banques privées, n'offraient au public ou aux capitalistes autant de guichets (…) ce qui permet aux receveurs d'asseoir un quasi-monopole financier" (Pinaud 1990, pp. 54-55). (98) Le système de l'avance de la Banque de France n'est pas encore développé et de toute manière doit être négocié au coup par coup; l'aide apportée par la Banque au Trésor passe essentiellement par l'escompte des bons du Trésor. Or l'émission de ces bons est soumise à un plafond annuel voté par le Parlement et n'a donc pas la souplesse du compte d'avance des receveurs généraux. De même, plus tard, le montant du compte de la Caisse des dépôts au Trésor, dans lequel celle-ci peut déposer ses liquidités en excès provenant des Caisses d'épargne, est plafonné et fait l'objet d'un vote au parlement. En 1912, par exemple, Stourm note qu'il aurait suffi "de porter de 100 à 150 millions la faculté accordée aux Caisses d'épargne de déposer leurs fonds libres au Trésor pour que la dette flottante se procure immédiatement l'équivalent, et au-delà, du dépôt des fonds particuliers des trésoriers généraux" (1912, p. 465). Si le Trésor continue de faire appel à ces fonds, c'est donc parce
qu'ils restent en dehors du contrôle du parlement (et des banquiers) et offrent une plus grande souplesse de gestion à court terme. (99) Stourm 1912, p. 458. (100) En 1912, sur 673.000 F d'intérêts au titre des dépôts, il resterait 273.000 F pour les trésoriers généraux (3175 F par trésorier), soit un taux d'intérêt de 0,7 %, le taux servi aux titulaires des dépôts étant de 1,05% (calculs d'après Stourm 1912, p. 458 et p. 464). Mais à la grande époque du compte courant des trésoriers généraux, juste avant la réforme de leur statut, on peut estimer à 1.500.000 F le bénéfice à ce titre, soit plus de 17.000 F de revenu annuel moyen pour chaque trésorier général (évaluation pour 1880, cf. infra, tableau 2) (101) Michalet 1968, p. 63. C'est pourquoi d'ailleurs "en 1825, le syndicat des receveurs généraux est institué sous la forme d'une société commerciale, dans le but de fournir des capitaux à la Bourse, de soutenir la rente, de garantir un prix favorable aux valeurs publiques" (Ponteil 1968). Mais ce syndicat, créé à l'instigation de Villèle - ministre des finances de l'époque - a aussi pour but de rendre les receveurs généraux solidairement responsables de manière à ce que leurs faillites éventuelles n'aient pas de répercussion sur le crédit de l'Etat. On sait, par ailleurs, qu'il faisait partie des fonctions normales des préposés des trésoriers généraux que sont les receveurs particuliers des finances d'exécuter les ordres d'achats et de ventes de rentes émanant du public ainsi que de servir d'intermédiaires aux rentiers pour la conversion et le renouvellement de leurs inscriptions nominatives et au porteur (Stourm 1912, p. 443). (102) Michalet 1968, p. 63. (103) Gille 1959, p. 73. (104) Ponteil 1968. (105) A. Thiers, qui fut un moment en 1830 sous-secrétaire d'Etat aux finances, était le gendre du receveur général Dosne, fils d'un notaire au Chatelet, secrétaire du roi, ancien agent de change à Paris et futur Régent de la Banque de France (1836) (cité par Gille 1959, p. 74). (106) Pernoud 1981, t. 2, p. 322. B. Gille cite l'exemple suivant : "La place de receveur général échut pendant presque tout le règne de Louis Philippe, à un homme très entreprenant, Delahante. En même temps, Delahante devint peu à peu le plus important banquier Lyonnais, procédant même, à la fin de la période, à la concentration de petites banques locales (…)" (1959, p. 66). Le même auteur rapporte également qu'"une seule banque parisienne essaima à Lyon, la banque Audiffret dont l'existence fut assez courte (1827-1834)". Or les Audiffret sont également une famille très connue de fonctionnaires des finances qui compte plusieurs receveurs généraux (cf. infra). (107) Gille 1959, p. 74. (108) Stourm 1912, p. 452. (109) Le syndicat de 1825 "régi et administré" par les huit receveurs les plus importants du moment "dans le double but d'être utile au service public et aux intérêts particuliers de leurs collègues" avait "pour objet toutes les opérations de finance et de banque (qu'il) jugera avantageuses aux intérêts de la compagnie et principalement celles qui seront utiles au service du Trésor royal" (Pinaud 1990, pp. 246-251). Il s'agissait d'une "société commerciale" au capital de 30 millions, "maison de commandite formée des 86 plus grandes notabilités financières de la France" (Thiers, cité par Gille 1970). (110) "Les instructions disent, sans doute, que ces négociations ne doivent s'effectuer qu'au comptant, que les valeurs françaises douteuses et toutes les valeurs étrangères sont exclues, que les jeux de bourse sont formellement interdits. Aucune émission, en outre, ne peut avoir lieu aux guichets de la trésorerie ; l'affichage même des annonces d'émission dans la salle d'attente du public est défendue; il n'y a d'exception que pour les souscriptions aux obligations de la Ville de Paris et du Crédit foncier de France. La négociation des effets de
commerce est proscrite, sauf dans des cas exceptionnels. Les instructions interdisent (également) aux fondés de pouvoir d'effectuer, pour leur propre compte, les opérations défendues à leurs chefs" (ibid). Elles stipulent, enfin, qu'il "est interdit de la manière la plus formelle d'employer les fonds provenant de comptes ouverts à des particuliers en achats de valeurs, opérations d'escompte, ou avances en compte courant. Les trésoriers ne peuvent également s'en servir pour constituer leur encaisse. Ils doivent en verser l'intégralité au Trésor" (ibid). (111) Ces faillites sont très nombreuses jusqu'en 1814 : dans les fiches prosopographiques de P.-F. Pinaud (1990), on peut en dénombrer au moins une vingtaine, en y incluant les destitutions pour malversations et révocations pour débets, soit près de 10 % de l'effectif des 231 personnes qui occupent les fonctions entre 1795 et 1814. Elles existent encore pendant la Restauration : on peut en dénombrer au moins cinq à partir de Gille (1959) et Pinaud (1990) sans tenir compte des révocations dont on ne connait pas la cause. On peut en repérer encore au moins une sous le Second Empire et pas la moindre puisqu'il s'agit de celle de Panon Desbassayns de Montbrun (fils), neveu de Villèle. Et elles existent encore en 1888, car le ministre des finances d'alors lui-même nous dit qu'il les a rencontrées : "cela est arrivé et nous en avons des preuves dans plusieurs circonstances. Il y a eu des sinistres chez des trésoriers généraux" (Discours à la Chambre du 16 février 1888). Quelle "confusion", quel "scandale", car "les guichets se ferment alors, non pour les services publics, mais pour les dettes personnelles du titulaire. L'Etat, d'un côté, continue à recouvrer rigoureusement les impôts exigibles et de l'autre, son représentant, dans le même local, cesse de payer ses propres créanciers" (Stourm 1912, p. 460). (112) Tout au moins par l'Etat, car de nombreux indices incitent à croire que la transmission des charges n'était pas "gratuite", c'est-à-dire ne se bornait pas à la reprise du cautionnement et des immobilisations matérielles. (113) La concurrence pour les places se fait donc "à prix fixe". Deux remarques cependant sur ce point : il conviendrait d'abord de rechercher si le taux de remise sur le compte courant du Trésor public n'a pas varié en raison de diverses circonstances; il faut également considérer que la monopolisation de la ferme générale avait fini par limiter déjà la procédure concurrentielle pure d'adjudication. (114) A l'exception de la courte période - entre 1887 et 1889 - pendant laquelle une remise forfaitaire fait son apparition (cf. supra, encadré 1). (115) L'important ici n'est pas évidemment la nomination en elle-même mais les critères qui conduisent à cette nomination, à savoir le répondant financier et la fidélité au régime. (116) Il y a eu en l'occurence par cette réforme une économie fort importante de faite. Stourm évalue d'ailleurs l'importance de la réforme à cette aune, évaluant à plus de 30 % la réduction du "coût" des trésoriers payeurs généraux pour l'administration. (117) Combien est révélatrice la critique parlementaire suivante portée à l'institution au moment de la réforme de 1889 : "L'organisation actuelle des trésoriers généraux est un anachronisme, car l'Etat possède maintenant un crédit bien supérieur à celui de ses agents. Dès lors, pourquoi perpétuer l'existence de comptables qui jouissent des fonds du Trésor comme le feraient des banquiers, qui tirent profit des rentrées de l'impôts et du payement des dépenses publiques, qui prêtent à la dette flottante l'argent qu'ils recueillent personnellement de leurs clients particuliers ? Le souvenir du passé et l'intérêt personnel soutiennent seuls cet édifice vermoulu" (cité par Stourm 1912, p. 457). (118) Stourm 1912, p. 458. (119) Dans le premier XIXe siècle, on n'hésitait pas à être plus clair lors des débats sur le rôle des receveurs généraux. Ainsi Duchâtel, ancien de la Ferme Générale, puis directeur des domaines à l'époque de l'Administration Générale des Domaines et Droits Domaniaux, Directeur Général de l'enregistrement sous le Premier Empire, bénéficiant d'une double
noblesse d'Ancien Régime et d'Empire, conseiller d'Etat et Pair de France sous la monarchie de Juillet, considérait en 1832, face aux attaques de certains parlementaires contre le coût des receveurs généraux, qu'il "ne s'agit pas d'un simple traitement à réduire, il s'agit d'un système entier. Il s'agit de savoir si la Chambre veut que l'Etat ait pour correspondant dans les départements de grands capitalistes, si l'on veut que le système soit appliqué aux finances de l'Etat. Voulez-vous les avantages du système ? Il faut vous soumettre à sa condition. Or la condition première pour allier au service de l'Etat de gros capitalistes, c'est de leur offrir des profits, non pas trop élevés, mais en rapport avec leurs capitaux. Les avantages du système sont faciles à résumer : en premier lieu une avance de 63 millions à l'Etat, qui lui permet d'obtenir les autres emprunts dont il a besoin à de meilleures conditions, en second lieu et avant tout, une garantie qui couvre le Trésor de tous risques". De même, Thiers, bien placé pour le savoir personnellement en tant que gendre de receveur général, pouvait-il affirmer que "l'erreur vient de ce que l'on confond toujours les receveurs généraux avec les autres fonctionnaires. Mais il faut reconnaître qu'ils ne sont pas des fonctionnaires publics, mais bien en quelque sorte, des banquiers officiels, des manutentionnaires des fonds de l'Etat, et qu'ils lui procurent en cette double qualité, un double avantage" (cités par Pinaud 1990, pp. 60-61). (120) On "évalue à 31.445 environ le nombre des déposants aux trésoreries générales" (Stourm 1912, p. 459). (121) Cf. Pinaud 1986, p. 485. (122) C'est ainsi que Rouvier, ministre des finances, plaide, lors du débat parlementaire de 1889 sur la réforme des trésoreries, pour le maintien de leur possibilité de collecte de fonds particuliers : "Le maintien des capitaux qui existent autour de chaque trésorerie générale amène à ses guichets, qui sont les guichets du Trésor, une clientèle de l'Etat. Je vous demande de la lui laisser et de ne pas en faire le cadeau aux banquiers, qui vous la disputent et la réclament" (cité par Stourm 1912, p. 459). (123) L'Angleterre a, quant à elle, en effet, confié très tôt à la Banque d'Angleterre la gestion de sa dette flottante et consolidée. La finance française en comparaison a donc fait preuve d'une bonne capacité de résistance à l'investissement des banquiers dans "les finances publiques bourgeoises" et on peut considérer que le conflit entre la finance et la banque se poursuit pendant tout le siècle. (124) Bruguière 1989, p. 114. D'une manière générale, "si la noblesse de robe a payé son tribut à la Révolution au moment où triomphe la petite bourgeoisie jacobine, ses pertes sont sensiblement inférieures à celles de la noblesse de sang. D'après les statistiques dressées parr l'historien américain Greer, sur les 2.639 exécutions capitales qui ont eu lieu à Paris au moment de la grande Terreur, on compte 176 membres de la noblesse de robe, contre 314 membres de la noblesse de sang. Pourtant, 872 nobles de robe seulement ont émigré, sur une émigration de 16.431 nobles" (Pernoud 1981, t. 2, p. 305). (125) Pernoud 1981, t. 2., p. 305. C'est sans doute pourquoi Jean Ribes (1750-1830), ancien receveur général de Languedoc, Roussillon et Pays de Foix (1783), receveur général d'Orléans en mai 1789 qui met sa fortune à la disposition de Louis XVI en 1792, peut disparaître et réapparaître à la Restauration avec "près de 1.400.000 francs en 3% anglais" (Bruguière 1989, p. 110). (126) C. Charle (1980) note ainsi que bien des traits de l'Ancien Régime subsistent à ce niveau en raison de la continuité sociale entre certaines dynasties de robe et certains hauts fonctionnaires napoléoniens … (127) Bruguière 1989, p.100. (128) Gille 1959, p. 71. (129) Mais aussi bien sûr, dans tous les autres postes de la "fonction publique" à responsabilité financière impliquant un cautionnement moindre (payeurs généraux,
receveurs particuliers et des diverses régies, directeurs départementaux, etc…)et accessibles en conséquence aux officiers de moindre envergure financière. (130) Il s'agit d'André de Boutray et de Charles Taillepied de Bondy en 1802 (Pinaud 1990, p. 92 et 208). (131) A savoir Baudon de Mony (des familles Baudon et Puissant), Haudry de Janvry (des familles Houdry de Soucy et Payneau) et Brière de Surgy (lié à la famille Hocquart) (Pinaud 1990). (132) Soit environ 60 % de l'effectif dont on connait les origines. Cf. encadré 3. Ajoutons que des 113 receveurs généraux qui rentrent en fonction avant 1800, la moitié n'exerce plus au-delà de cette date. On ne dispose pas de renseignements sur 48 d'entre eux et 28 sont de familles bourgeoises d'offices. Outre 4 notaires royaux, on dénombre 7 notaires et une quinzaine d'administrateurs municipaux ou régionaux parmi ces nouveaux receveurs généraux, le reste des effectifs connus étant issus des milieux d'affaires banquiers, négociants et manufacturiers (10) et de propriétaires (5). Sur 1800-1814, outre les 28 receveurs d'origine inconnue et déjà 19 "héritiers" directs, les 106 nouveaux nommés se composent de 21 anciens officiers ou agents liés à la finance, 8 militaires, 5 administrateurs, 1 notaire, 12 négociants-banquiers-armateurs-manufacturiers et 2 propriétaires. (133) Cf. Bruguière 1989, p. 109 et p. 114. (134) Pinaud 1986, pp. 482-483. (135) Bruguière 1989, p. 111. (136) Pinaud 1986, pp. 484. (137) Il ne s'agit que de quelques cas choisis parce qu'ils mettent en jeu déjà un assez grand nombre de relations. Comme on peut le constater, en effet, en consultant les travaux de P. F. Pinaud, les receveurs généraux qui n'ont pas de liens familiaux avec d'autres sont plutôt l'exception que la règle. (138) Peut-être même que cette galaxie comprend encore plus d'étoiles que l'on a pu en recenser avec certitude. Il est possible, en effet, par exemple, qu'elle inclut également, par la médiation des Gibert du sous-groupe Fontenillat, la famille Harle issue du notariat qui compte, outre un régent de la Banque de France, deux receveurs généraux très importants qui se succèdent de père en fils (Jean, receveur de 1796 à 1812, Charles, son fils, receveur de 1812 à 1824, et Antoine Lafond, son gendre, négociant-juge au tribunal de commerce, régent de la Banque de France). Jean et Charles sont successivement membres du Syndicat et du Comité des receveurs généraux; Charles, par ailleurs gendre de député, finit également sa carrière comme député et Pair de France sous la Monarchie de Juillet, tout comme Antoine, son beau-frère (cf. Pinaud 1990, p.147). (139) Alexandre Collart-Dutilleul et Adolphe de Boubers ont par ailleurs fait leur classe ensemble sous l'autorité du baron Louis au Conseil intérieur du contentieux du premier ministère du Trésor (Pinaud 1982b, p. 557). (140) Cambacérés, d'une famille de magistrats conseillers au Parlement et à la Cour des aides pendant plusieurs générations sous l'Ancien Régime, éminence juridique grise de Bonaparte, a amassé sous l'Empire "une énorme fortune", touchant "plus de 300 000 francs par an au titre d'archichancelier" et "recevant diverses dotations, avec la qualité de prince" (Pernoud 1981, t. 2, p. 304-305) (141) Ceci est vrai de tous les groupes familiaux de financiers. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si, tout au long du siècle, la plupart des ministres des finances défendent ardemment les receveurs généraux dans les controverses parlementaires (cf. par exemple Pinaud 1990, p. 59 pour Roy, p. 62 pour Humann, p. 63 pour Lacave-Laplagne). Les travaux de P.F. Pinaud montrent, en effet, que ceux-là ont des liens de parenté avec ceux-ci (cf. Pinaud 1982b, 1983, 1986, et 1990), proximité durable qui commence avec Ramel, sous le Directoire, lequel a pour cousin germain Jean Baptiste Marragon, receveur général de 1799 à
1810 et à qui succède son fils Jean Philibert de 1810 à 1815. Cela continue avec Mollien lui-même qui a pour parent Adrien Lucy, fils de conseiller à la cour de Paris, receveur de 1831 à 1863, et dont, par ailleurs, deux secrétaires particuliers successifs, Athanase Bricogne (ainé) (1806) et Adolphe de Boubers (1808) (lié à la "galaxie" Baudon de Mony), sont également receveurs généraux respectivement de 1822 à 1830 et de 1846 à 1852. Le Baron Louis n'est pas en reste puisqu'il a, d'une part, un neveu, Roger Gaultier de Rigny, receveur général de 1819 à 1857, marié à une Laffitte et père d'un trésorier payeur général de 1877 à 1882, d'autre part, un fils de sa nièce mariée à un conseiller du roi, Louis Pernot de Fontenoy, également receveur général de 1817 à 1841. Son successeur Corvetto, quant à lui, se contente apparemment d'avoir pour gendre Nicolas Littardi, receveur général de 1818 à 1858. Villèle, pour sa part, a pour beau-frère Henry Panon Desbassayns, receveur général de 1824 à 1851, qui a lui-même un fils, Charles, receveur de 1853 à 1864, et qui est également parent du receveur Mourgue. Le Comte Roy, à son tour, a pour parent Hippolyte Roy qui sera receveur général de 1842 à 1864 après avoir été receveur particulier dès 1820 (à 24 ans). Dans les schémas 4 et 6, on constate également que les ministres Humann et Lacave-Laplagne sont très directement liés à plusieurs receveurs généraux eux-mêmes liés à leur tour par des liens de parenté tels qu'ils couvrent la quasi-totalité de la période 1795-1890. Citons enfin encore le cas de Pierre Magne, ministre des finances sous le Second Empire et au tout début de la Troisième République, qui a un fils (Alfred) receveur général puis trésorier payeur général de 1858 à 1870, puis de 1874 à 1877, ainsi qu'un neveu Pierre Maigne, receveur puis trésorier payeur général de 1857 à 1872. De plus, il n'y a pas que les ministres des finances qui aient des liens avec la recette générale, puisqu'on peut citer également, en vrac, les ministres et premiers ministres Rouher, Savary, Laffitte, Thiers, Casimir-Perrier, Portalis, Decazes, parmi les parents proches de receveurs. Enfin, on constate que nombre de receveurs mêlent allègrement leurs activités financières avec des activités politiques. Il est plus difficile, en l'état actuel des fiches prosopographiques publiées par P. F. Pinaud, de se livrer à ce même genre d'exercice pour la Troisième République installée. Notons cependant, au passage, que Paul Deschanel, homme politique qui compte dans les années 1880, a un frère Georges, ami intime de Joseph Caillaux, inspecteur des finances comme lui, chef de son cabinet, puis directeur au Ministère des finances, procureur général à la Cour des comptes et administrateur de sociétés, et qui a épousé une fille "richement dotée" du trésorier payeur général Panckouke dont l'autre fille est mariée à un sous-directeur de compagnie d'assurance (Charle 1982, p. 11). (142) Cf. Charle 1987. On remarquera également qu'au moment où le recrutement de l'inspection des finances se ferme aux "catégories les plus modestes", il n'y a pratiquement plus d'inspecteurs qui se dirigent vers les postes de receveurs et trésoriers payeurs (Charle 1982, p. 4). (143) Citons à ce propos le cas du comte de Matharel, inspecteur des finances en 1901, et qui, bien qu'il soit le parent direct de trois T. P. G. (cf. schéma 5) et le neveu d'un conseiller maître à la Cour des comptes ne continue pas dans cette voie (Charle 1982, p. 13). (144) Il est clair que l'on manque d'une étude des recettes générales du type de celle récemment mise en oeuvre par J. Levain et P. Verley sur les sociétés d'agents de change de Paris à la même époque (cf. Verley 1989). (145) Verley 1989, p. 146. (146) Mayeur 1973, p. 86. (147) La comparaison est ici d'autant mieux fondée que l'agent de change, à la forme sociétaire près, est un être social aussi hybride sur le plan juridique que l'est le receveur général avec son ambivalence de fonctionnaire public et de banquier privé. Les sociétés d'agents de change, en effet, "avaient pour but l'exploitation d'un «office» concédé personnellement par le ministre des finances" et "l'agent de change a été jusqu'en plein XXe
siècle un être juridique hybride, officier ministériel et commercant à la fois" (Verley 1989, p. 128). Cela se traduit d'ailleurs par une évolution de la profession qui évoque immédiatement celle de la recette générale quoiqu'avec un décalage important dans le temps, puisque "de métier risqué, à haut pourcentage de faillites sous le Second Empire, à rotation rapide des titulaires, à activité spéculative, il devient un métier dont on cherche à limiter le risque et où la charge tend à devenir héréditaire" (ibid, p. 131), "un métier de haute respectabilité qui classe d'emblée dans la haute bourgeoisie", "la profession évoluant vers une profession «fermée»" où les dynasties familiales s'affirment" (ibid, p. 142). Autre caractéristique commune, les cautionnements sont très peu variables (ibid, p. 130). (148) Verley 1989, pp. 127 et 130. (149) On peut se demander toutefois quel devait être l'instance de régulation d'un tel prix officieux puisque la profession ne disposait pas, et pour cause, d'une Chambre syndicale permanente comme c'est le cas pour les sociétés d'agents de change. (150) Verley 1989, pp. 140 et sv. (151) Dont "24 000 francs de rémunération fixe et environ 6000 francs de "frais de voiture" (ibid, p. 133). (152) Pinaud 1990, p. 59. (153) Charle 1980, p. 60. (154) En outre, l'écart entre le "chiffre d'affaires" estimé en 1913 et celui effectivement réalisé rapporté par Stourm (1912) nous donne le montant de l'économie réalisée cette année là grâce aux réformes de 1889 et de 1908. Cette estimation, quoique très grossière, est plus correcte que celle avancée par cet auteur qui suppose constant le chiffre de 1880. Elle donne une économie de plus de 50 %. (155) Les valeurs estimées sont données en italique dans les tableaux. (156) C'est ce niveau de commission pour 1820, 1832 et 1850 qu'on a introduit dans le revenu global calculé dans le tableau 2. Il conduit à une structure du coût global des receveurs où la part des commissions fiscales est relativement stable. Même le fait qu'à partir de 1866, les trésoriers touchent également des commissions sur les dépenses ne semble pas justifier, en effet, l'écart de structure apparaissant au tableau 3, alors que les coûts globaux varient relativement peu. (157) Guillemin 1982, p. 37. (158) Pinaud 1983, p. 13. Cet auteur raconte à ce propos qu'un "sous-secrétaire d'Etat aux finances" estimant que «tous ces trésoriers qui ne font pas leur métier (…) font, dans l'opinion publique, un très grand tort au gouvernement» n'en fut pas moins nommé T. P. G. quelque temps plus tard, place à laquelle il resta pendant vingt huit ans, y devenant "l'exemple type de ceux qu'il dénonçait". (159) Fontvieille 1976, pp. 1900-1901. (160) Daumard 1980, p. 416. 2,7% des successions supérieures à 50 000 francs en représentent 71,1%. (161) Verley 1989, p. 147. Par ailleurs, l'auteur note que pour les plus grosses successions, "l'exercice de la profession (n')a été (que) le marchepied qui a permis une résussite ultérieure dans les affaires". (162) Pinaud 1983, pp. 13-14. (163) Evidemment, les évaluations de Stourm sont elles-aussi controversables, et seule une exploitation plus systématique des données disponibles en la matière permettra de trancher définitivement sur ce point. (164) L'exemple de François Collart-Dutilleul est peut-être, à ce titre, instructif puisqu'admis à la retraite en 1887 à l'âge de 58 ans, il crée ensuite une banque à Tours, et il ne meurt qu'en 1913.